EPIGRAPHE
« Celui qui veut changer le monde, doit commencer par
se changer lui-même ».
Socrate
DEDICACE
A toi notre charmante épouse Esther Hadassa Mupikula,
mère de nos enfants, pour avoir été une compagne patiente
dans notre vie estudiantine et, ayant supporté que nous puissions
affronter les études supérieures dans le contexte très
critique, et pour l'importance que vous avez accordée à ces
études en acceptant que le budget familial soit perturbé.
A vous nos enfants,Manassé TSHIYA, Shekinah
MUNANGA(Muadi), Gemima MBUYANGA, Barnabas KAYEMBA, Olive MISENGA, et Ariel
Messie LUMBALA, pour avoir compris la quintessence de nos études
supérieures, voici le modèle à suivre.
Paul Sylvain MBAYA LUMBALA
IN MEMORIAM
A mon cher regretté géniteur, Valentin LUMBALA
KADIA BITENDE, qui nous a précédé dans l'au-delà
quelques mois avant la rédaction de ce mémoire pour couronner
notre cursus académique.Votre nom restera gravé dans cette oeuvre
scientifique parce qu'il nous servira toujours comme référence
durant notre parcours terrestre et nous garderons votre pieuse
mémoire.
Que l'Eternel trouve pour vous une place dans son fief
paradisiaque.
Adieu ! Et que ton âme repose en paix !
Paul Sylvain MBAYA LUMBALA
REMERCIEMENTS
Au terme de notre parcours scientifique sanctionnant la
fin du cycle de licence en gestion et administration des projets, nous sommes
tenus d'exprimer notre gratitude aux uns et autres.
Nos remerciements s'adressent d'une manière
générale aux autorités académiques,
décanales et au corps scientifique de l'Institut Supérieur
d'Etudes Sociales de Kananga (ISES/KANANGA, en sigle), pour un enseignement de
haute facture mis à notre disposition. Tout particulièrement aux
autorités de la Section de Sociologie Appliquée et
Développement communautaire, pour tant de chance nous accordée
à nous déployer académiquement tout au long de ce
deuxième cycle.
Aux Chefs des Travaux clémentine BAMBI BUNGI et
Faustin SHAMBA SHAMBA respectivement Directrice et Co-directeur, si richement
doués et de si haute culture, nous exprimons notre gratitude pour
s'être entièrement donnés à nous diriger. Leur
savoir-faire, leurs remarques, leur attention toute particulière furent
pour nous un bonheur, pour incruster en nous la rigueur scientifique en
dépit des moments pernicieux connus.
A ma mère Anastasie MUADI KALONJI.
Au révérend MANASSE KAYEMBE, la sentinelle des
âmes du Tabernacle de la Sainteté pour son assistance tant
matérielle que spirituelle.
Que nos très chers frères et soeurs,
cousins et cousines, Pauline MBELU, Jean-Claude KATAMBA et son épouse
TSHIBOLA , Emmanuel KALONJI MATUNGULU et son épouse Mélanie
MULANGA, Chantal NTUMBA, Jacquie KANYEBA, Anastasie NDAYA, Roberte KAPINGA,
Dieudonné NGALAMULUME, Ruth KABEDI, John Asaph MULUMBA ,
Générose MULANGA, Marthe MBUYANGA, Alphonsine MBUYI,
Thérèse TSHIDIBI, Giselle MUTEBA, Gracia NGALULA, Philo KALAMBA,
Jean NYEMBUE, et ceux dont les noms ne sont pas explicitement cités ici,
trouvent en ces quelques lignes notre reconnaissance et affection pour tout ce
qu'ils représentent pour nous.
A Nos oncles : Jean KAPENA KABUA KATANDA, Emmanuel
KALONJI MATUNGULU, nous disons merci.
A tous nos camarades et compagnons de lutte : Mamy
MUJINGA KABUYA, Aimée Espérance MATUNGULU NDUWA, Maurice PYOPYO
MUABANTU recevez notre gratitude pour votre accompagnement social, durant tout
le temps de nos activités académiques, Louange et gloire soient
rendues à notre Seigneur Jésus - Christ, qui nous a
gardé en vie, jusqu'à la faisabilité de ce travail
scientifique.
Nous ne tournons pas cette page sans remercier Monsieur
David MUKENGE, et Léon BANTSHI pour la saisie et le traitement
informatisé de ce travail.
Il serait ingrat de boucler cette rubrique sans remercier
amis et connaissances, pour leur accompagnement durant notre parcours
académique : les Chefs des travaux Sophie KAPINGA, Crispin IVUDI,
Odette KWETE, Crispin NTAMBUE. Sans oublier, Philippe TSHIDINDA Boudjo,
Louis-Marie CIBAMBA, Antoine KAPAMPU, Dieudonné TSHIMANGA NTUMBA,
Adélard KANUNDE NKONGOLO, et Henri Gérard EGEBE MUANGANDU (DP de
la RTNC/Kananga).
Enfin, que tous ceux qui ont contribué d'une
manière ou d'une autre à cet édifice scientifique,
trouvent à travers ces lignes, nos sentiments de très profonde
gratitude.
Paul Sylvain MBAYA LUMBALA
SIGLES ET ABREVIATIONS
AGR : Activités Génératrices des Revenus
CBMT : Centre Ba Mamu Tabulukayi
CCAP : Contrôle Citoyen d'Action Publique
CLD : Comité Local du Développement
CODESA : Comite de Développement Sanitaire
COGES : Comite de Gestion Scolaire
COPA : Comite de Parents
CS : Centre de Santé
CSLP : Cadre Stratégique de Lutte contre la
Pauvreté
CUD : Comite Urbain du Développement
DAI : Développement Activity Integrated
DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies
DEC : Développement Economique Communautaire
DECO : Développement Communautaire
DEL : Développement Economique Local
DL : Développement local
DSCRP : Document Stratégique de Contribution pour la
Réduction de la Pauvreté
DSRP : Document Stratégique de Réduction de la
Pauvreté
EC : Engagement Citoyen
ECZ : Equipe Cadre de Zone de santé
ETD : Entité Territoriale
Décentralisée
GAB : Gestion Axée sur les
Bénéficiaires
GSDL : Gouvernance Synergique du Développement Local
IGA : Integrated GovernenceActivities
INADES : Institut Africain pour le Développement
Economique et Social
INS : Institut national des statistiques
ISE : Infrastructures socio-économiques
ISES : Institut Supérieur d'Etudes Sociales
IT : Infirmier Titulaire
MCZ : Médecin Chef de Zone de sante
MEC : Mécanisme D'engagement Citoyen
MPME : Micros, Petites et Moyennes Entreprises
MRC : Municipalités Régionales de
Comité
OAC : Organisations à Assises Communautaires
OB : Organisation de de Base
OCB : Organisation Communautaire de Base
OCDE : Organisation Communautaire pour le
Développement Economique
ODD : Objectif pour le Développement Durable
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OSC : Organisation de la Société Civile
PAI : Programme Annuel d'Investissement
PD : Plan de Développement
PGI : Programme de Gouvernance Intégrée
PIP : Programme d'Investissement Prioritaire
PMA : Pays Moins Avancés
PNUD : Programme de Nations Unies pour le
Développement
PTF : Partenaires Techniques et Financiers
RDC : République Démocratique du Congo
SIMFA : Sensibilisation - Information -Mobilisation
-Formation -Action
SPL : Système Productif Local
URSS : Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
USAID : United States Agency for International
Development
ZS : Zone de Santé
0.INTRODUCTION
D
ans tout processus de développement, l'homme est au
centre de l'action. Il conçoit son propre développement selon ses
besoins, le met en oeuvre en y affectant des moyens requis et en
bénéficie lui-même tout en sauvegardant son milieu naturel.
Le concept de développement humain durable cadre
parfaitement avec ce principe de base en ce sens qu'il se comprend comme tout
processus de développement qui génère la croissance
économique, distribue de manière équitable les
bénéfices de celle-ci, maintient la capacité
intrinsèque de régénération de l'environnement
naturel, et replace l'homme au centre de toute action en augmentant ses
capacités et en élargissant les opportunités qui s'offrent
à lui à travers l'amélioration des conditions de vie dans
les domaines d'éducation, de santé, et de participation à
la vie socio-économique et politique sans aucune forme d'exclusion.
Aucun projet de société ne peut se
réaliser sans l'engagement et la pleine participation de tous les
membres du corps social concerné. De la même manière que
les sociétaires voudraient jouir des bénéfices de leur
projet, ils devraient en faire autant pour leur implication à sa
concrétisation. Le développement impose des sacrifices, par
conséquent les efforts à sa réalisation doivent être
partagés et fournis de manière équitable avec la
même exigence que celle requise dans la jouissance de ses
bénéfices.
Cela sous-entend que pour réussir un projet de
développement, il faudrait que tout le monde s'engage et participe
résolument à un niveau quelconque, si pas à tous les
niveaux. L'on ne peut concevoir un Etat où certains sont des acteurs et
d'autres des spectateurs jouisseurs, un Etat où certains paient les
impôts et d'autres les empochent impunément, un Etat où
certains travaillent et d'autres se prélassent au soleil (PNUD, 2008,
P.101).
Si l'amélioration des conditions de vie de l'homme est
le but du développement, celui-ci doit en être non seulement le
bénéficiaire mais aussi l'artisan, l'acteur de
prédilection. C'est pourquoi il est nécessaire que toutes les
catégories de la population participent au processus de
développement. Cette participation postule que tous et chacun soient
intéressés par tout programme et profitent du progrès
général enregistré. La participation des personnes
physiques, des groupes sociaux et de la population au processus de
planification et de mise en oeuvre de développement dans tous ses
aspects est une nécessité.
Il est facile de déployer cette participation au niveau
local du fait qu'à ce niveau, les problèmes que les populations
vivent et les solutions à y apporter sont bien connus de ces populations
et non de la bureaucratie et de la technocratie centrales. Le
développement doit donc se faire pour, par et avec la population.
C'est donc dire que l'engagement citoyen et la participation
des personnes physiques, des groupes sociaux et de la population fustigent la
possibilité que l'Etat impose ses décisions et exige que ce
dernier reconnaisse à cette population, à ces groupes sociaux et
à ces personnes physiques des initiatives, quitte à leur donner,
si besoin est, des aides techniques, financières ou autres. «
Le développement des pays duSud, et singulièrement celui des pays
africains, exige sans doute des changementsradicaux dans les conditions
politiques et administratives de ces pays, mais il nécessiteaussi la
participation et l'engagement populaire aux prises de décisions et des
institutions démocratiques offrant aux différentes couches de la
population et surtout aux masses populaires la possibilité d'exprimer
leurs points de vue concernant la marche de leur société
» (MAYAM. et F. STREIFFELER, 1992).
Cette participation n'est possible qui si l'homme prend
conscience et s'engage résolument dans ce processus, lequel (processus)
exige certains mécanismes, instruments, outils et stratégies pour
y parvenir. Le développement des communautés locales a
été toujours au coeur des préoccupations des
administrations coloniales et des États africains postcoloniaux.
Appelé développement communautaire dans les colonies britanniques
et animation rurale dans les colonies françaises, l'esprit et les
structures de ce mode d'intervention (développement des
communautés locales) ont été, pour l'essentiel,
conservés après les indépendances des pays d'Afrique dans
les années 1960.
Depuis les années 1980, les organisations non
gouvernementales (ONG) ; locales, nationales et internationales se
présentent comme les acteurs principaux qui appuient les initiatives des
populations ou qui travaillent avec elles dans des projets dont certains
réussissent mais d'autres échouent.
L'explication de ces phénomènes sociaux est au
centre de la sociologie du changement social. La décennie 1960-1970 a
été dominée par les théories explicatives de type
déterministe (Boudon, 1984), puis la théorie de
rationalité de l'acteur est devenue dominante à partir des
années 1980. Lorsqu'on fait une brève recension des
écrits, il semble ne pas y avoir un livre qui présente en un tout
à la fois l'historique et l'analyse sociologique du développement
communautaire en Afrique noire subsaharienne en particulier (Yao ASSOGBA, 2008,
pp.15-16).
Les mutations politiques qui s'observent depuis le
début des années 90 (confère discours de La Baule) dans
presque tous les pays de la zone francophone subsaharienne, avaient ouvert des
pistes porteuses d'espoir pour ces états qui constituent
l'écrasante majorité des PMA, caractérisés par une
pauvreté massive. Le lègue de la colonisation, marquée par
une forte tradition centralisatrice a beaucoup entravé la mise en oeuvre
de politiques et stratégies conséquentes de développement
et de bonne gouvernance.
L'histoire du développement des pays de la sous -
région, longtemps caractérisé par des systèmes
politiques fermés nous enseigne que depuis les années 1960, les
différents résultats dans l'exécution des multiples
projets de développement ont donné des résultats
mitigés : les échecs sont restés nombreux, les
succès rares ou incertains malgré les quantités
impressionnantes de ressources financières, et les espoirs
légitimes suscités.
0.1.CHOIX ET INTERET DU
SUJET
a. Choix du sujet
Les causes des échecs cumulés montrent à
travers des analyses successives que la responsabilisation effective des
populations à la base est une des conditions incontournablespour
accroître les chances de succès d'un développement qui ne
peut ni s'administrer, nis'imposer tout simplement parce qu'on ne
développe pas mais on se développe.
Dans cette optique on observe un peu partout une
volonté politique affichée de lutter contre la pauvreté
à travers la mise en oeuvre de Cadre Stratégique de Lutte Contre
la Pauvreté (CSLP) qui semble succéder aux insuffisances des
politiques d'ajustement structurel (la RDC a conçu le DSRP, et DSCRP
dans le but d'attaquer le taureau par les cornes). Comme le disait Socrate
(Platon, apologie de Socrate), avant de Changer le monde, il faut commencer par
se changer soi-même. À Roger MONDOLONI de
paraphraser : « changer le monde commence par se changer
soi-même », (
https://citation-celebre.le/parisien.fr,
consulté le 16/07/2021 à 12 h 33')
La majorité des Gouvernements des pays de l'Afrique
subsaharienne qui ont accédé à leur indépendance
depuis 1960 ont toujours fait du secteur rural la priorité des
priorités. Aujourd'hui on constate que des progrès ont
été enregistrés dans le secteur du développement
local mais ils restent néanmoins limités au regard des moyens
importants utilisés. En effet, les Conditions de vie des populations
locales se dégradent davantage et ces dernières sont
Confrontées à de multiples problèmes parmi lesquels on
peut citer : la précarité.
Les évaluateurs de l'aide au développement ont
en effet constaté que les interventions réalisées sans les
personnes concernées sont perçues comme des vaches à lait
des bailleurs, juste bonnes à la traite, elles ne sont pas vues comme
des outils de développement des groupes concernés
eux-mêmes.Chacun doit participer au processus de
développement : ceux qui conçoivent et ceux pour qui le
projet est établi qu'il ait échange entre eux (BAMBI
Clémentine, Planification Régionale : 2020).
Théoriciens et praticiens du développement
formulent généralement l'hypothèse que la participation
des populations aux projets les concernant, est garante de leur
réussite. L'analyse se raffine en montrant que les modes d'intervention
qui s'inspirent du paradigme interactionniste favorisent plus la participation
effective des gens que les modes d'intervention basés sur le paradigme
déterministe.
Ainsi, cette participation active de la communauté
à toutes les actions de développement trouve son essence dans un
véritable engagement citoyen, véritable fer de lance qui conduit
à l'appropriation et à la pérennité celles-ci.
Comme l'a souligné Bastien ENGELBACH (2003, p. 17)
: « Participer et être un citoyen actif, c'est avoir le
droit, les moyens, la place, le soutien voulu pour participer aux
décisions, influer sur elles et s'engager dans des actions et
activités de manière à contribuer à la construction
d'une société meilleure ».
La motivation du choix de cette étude est le souci de
voir la communauté de base prendre en mains son développement par
les initiatives de développement à travers une participation
communautaire active. Dans sa vision d'un développement endogène,
il est important que la communauté locale prenne l'initiative de
l'identification des projets qui répondent à ses besoins. Suivant
ses priorités, car les besoins réellement ressentis sont
multiples et les moyens (ressources) pour les satisfaire sont
limités.
Le choix de ce sujet d'étude tient également
à notre formation comme technicien en développement, concepteur
des projets et programmes visant l'amélioration des conditions
d'existence des communautés locales. Il est le fruit de nos
réflexions profondes et muries partant de la réalité et au
vu de l'importance de l'engagement des parties prenantes dans le processus de
développement, en RDC en général et dans la province du
Kasaï central en particulier. Lequel engagement conduit à la
réussite des projets et l'appropriation de ces derniers pour leur
durabilité et pérennisation. Nous sommes inspirés par la
nouveauté introduite par la structure DAI/USAID, dans son programme de
gouvernance participative (intégrée) (IGA).
Dans son discours lors de la célébration du
soixantième anniversaire de l'accession de la RDC, à sa
souveraineté tant nationale qu'internationale (le 30/06/2020), le
Président de la République Félix Antoine TSHISEKEDI
TSHILOMBO a déploré le fait que le PIB de la RDC est passé
de 600 USD (en 1960) à 400 USD actuellement pour la classe moyenne, soit
une baisse sensible de plus ou moins 33, 33%. Alors que la RDC était
comptée parmi les pays les plus riches du continent en 1960.
Cependant, le contexte socioéconomique actuel voudrait
que chacun ait des moyens financiers nécessaires pour vivre une vie
économiquement et socialement aisée. C'est en fait le travail qui
donne la chance de participer au développement et à la production
des richesses afin de bénéficier des revenus qui en
découlent pour s'éloigner de la pauvreté (FUMWAWAU Kiniati
J., 2015, p. 25).
b. Intérêt du sujet
Cette étude qui revêt un double
intérêt, nous aidera à analyser pour démontrer
à suffisance l'impact ainsi que l'importance de l'engagement citoyen
comme socle du changement social des communautés locales, en relevant la
quintessence de la participation et appropriation communautaires, dans les ETD
de la Ville de Kananga, plus particulièrement dans la commune de KATOKA,
laquelle a bénéficié de l'appui de DAI, dans son programme
de gouvernance intégrée (IGA).
G Sur le plan scientifique
Ce travail aidera des futurs chercheurs qui
s'intéressent à ce domaine à trouver, une source
d'informations et une banque des données permettant de bien mener leurs
recherches. Il sera également un instrument de référence
pour la vulgarisation des stratégies et outils de changement social
voulu par tous afin de parvenir à une gestion axée sur les
bénéficiaires (GAB).
Surtout pour des doctrinaires et penseurs d'approfondir la
quête du savoir sur la participation des populations au
développement local de la commune de Katoka et même corriger
éventuellement les erreurs que nous aurions commises.
G Sur le plan social.
Cette étude a pour avantage de mettre à la
disposition des autorités tant nationales que provinciales quelques
pistes des solutions qui permettront de relever certaines écailles et
insuffisances d'ordre socio-économiques susceptibles de relever le
défi de certains problèmes de développement au niveau
local. Et surtout de permettre aux techniciens en développement
d'accompagner efficacement les populations dans leurs efforts du processus de
changement et de quête du bien-être, mieux être, plus
être de la grande majorité.
0.2.ETAT DE LA QUESTION
Pour analyser et démontrer l'impact du mécanisme
d'engagement citoyen à l'amélioration des conditions
socio-économiques des communautés locales dans la province du
Kasaï centrale, l'organisation et l'orientation d'un travail scientifique
exigent, avant de s'y pencher ou de s'y lancer de faire la recension des
travaux précédemment produits en rapport avec la
thématique ou domaine de recherche sous examen.
L'Etat de la question est définie selon MUKADI
Luaba(2012-2013) comme « un inventaire de tous les travaux qui
existent sur le problème traité ainsi que, leurs
problématiques respectives afin de découvrir, ce qui n'a pas
été abordé ou ce qui a été mal abordé
ou abordé en partie, pour greffer sa problématique à
lui ».
Pour KABEMBA Tubelangane, B.A., (2014, p17.), Il s'agit de
parler des auteurs qui ont abordé dans le même domaine que nous,
enfin de faire une démarcation sur nos recherches avec les leurs.
L'auteur présente l'originalité de son sujet par rapport aux
écrits précédents. En effet, il présente un
inventaire critique des études et travaux antérieurs et
précise, l'apport et les limites de chaque oeuvre pour enfin
dégager l'originalité de son étude (MUAMBA Bakatubenga,
T., 2016-2017).
Pour nous, la revue de la littérature fait mention de
la quintessence des travaux antérieurs par rapport au sujet
d'étude de leur démarche, des conclusions. Par conséquent,
l'objet d'étude n'est pas nouveau, il a été abordé
par nos prédécesseurs des différentes manières et
sous d'autres angles.
D'une manière non extensive, voici quelques chercheurs
ayant abordé l'étude sous cet angle :
1. NOLEX FONTIL,
dans son mémoire de troisième cycle intitulé
« projets de développement communautaire en
Haïti : méthodologie d'analyse des besoins
locaux », département de gestion et administration,
management de projet, l'Université Senghor d'Alexandrie, 2009.
Dans cette étude scientifique, l'auteur démontre
que Les projets de développement communautaire sont, pour Haïti
comme tous les autres pays frappés par le mal du
sous-développement, un moyen judicieux de lutter contre la
pauvreté et la faim selon les termes des Objectifs du millénaire
pour le développement de 2000-2015 (actuellement contenus dans les
Objectifs de développement durable à l'horizon 2030, ODD 1 et 2).
Ils sont une composante de la nouvelle approche du développement, le
développement local, qui vise à faire participer les citoyens des
collectivités au développement national et d'en partager les
résultats directs.
Ces projets s'orientent vers une catégorie
spécifique de la population qui a toujours été
négligée et exploitée à cause de leur situation
socio-économique marginale, de leurs moyens économiques
précaires et de leur faible pouvoir revendicatif ; ces personnes
n'ont jamais pu prendre part aux décisions concernant leur propre
destinée.
Après environ deux décennies d'interventions
pour une meilleure condition de vie des communautés en
difficulté, projeteurs, spécialistes du développement,
responsables politiques réalisent que les impacts de ces interventions
sont plutôt faibles sur la réduction de la pauvreté dans le
contexte socio-économique haïtien.
Certains estiment que les activités conduites ont un
trop grand écart par rapport aux vraies attentes des communautés
cibles. D'autres, par contre, pensent que l'objectif des projets communautaires
reste noble, mais, la prise en charge post-projet par les
bénéficiaires qui n'est pas efficace. Sur le terrain, la question
se pose sur la démarche du choix des interventions, en particulier,
l'efficacité des processus suivis et des outils utilisés.
2. KAMAL El-Bata, dans sa thèse de
Doctorat en Sciences Administratives : « la gouvernance
synergique: une stratégie de développement local cas des
municipalités régionales de comité
québécoise », l'auteur de cette aventure
scientifique a montré par ailleurs que , la
gouvernance synergique du développement local (GSDL) d'une MRC est une
notion très récente qui vise à améliorer les
capacités organisationnelles, l'équilibre démocratique
territorial, le développement des compétences humaines, les
rapports entre les acteurs et à accroître la participation
plurielle à la prise de décisions ainsi que la gestion
concertée et stratégique du territoire.
L'objectif initial de cette thèse a été
de comprendre et d'identifier les mécanismes et les principes sur
lesquels repose le concept de gouvernance pour, par la suite, le
présenter sous son mode synergique comme stratégie de
développement local des MRC. Pour l'auteur, La gouvernance synergique
désigne l'ensemble des facteurs politiques, sociaux et organisationnels
qui sont stratégiquement planifiés par l'ensemble des parties
prenantes d'une collectivité en vue d'étudier, d'analyser et de
concevoir des mécanismes visant à mieux gérer tout
processus de développement local. Ces mécanismes, concernent
principalement la concertation dans la cogestion des actions collectives, la
démocratie participative, l'évaluation transversale, la gestion
du pouvoir et la formation à la gouvernance. Il conclut en soulignant
que les politiciens, autant la société civile que le
privé.
En effet, il y aurait, d'une part, une meilleure
compréhension des dynamiques sociales, politiques, et
organisationnelles, et, d'autre part, il serait plus facile de se les
approprier pour un meilleur usage ultérieurement.
Ensuite, il a énoncé que le principe de synergie
peut être un facteur d'efficience de la gouvernance d'une MRC.
D'ailleurs, lorsque les acteurs parviennent à mieux comprendre les
enjeux du développement local (les territoires de la MRC), les
collectivités (municipalités) peuvent alors envisager
l'amélioration de la réalité qui les entoure.
Nous pouvons donc conclure que plus grand est le nombre
d'acteurs qui visent la synergie, plus importante est l'appropriation des
enjeux de la gouvernance locale et, ainsi, plus grandes sont les chances
collectives de transformer les milieux.
3. TAGUET Younes, dans son mémoire de
DEA sur la « Gouvernance territoriale et développement
local : Illustration par le cas de la zone d'activités de la commune
d'El-KSEUR », Université A. MIRA de Bejaia
d'Algérie, 2014 ; après avoir posé sa
problématique relative à sa thématique et mené des
recherches y relative, cet éminent économiste est arrivé
à la conclusion selon laquelle, La gouvernance territoriale est
aujourd'hui une condition nécessaire à l'aboutissement des
projets de développement local. Elle se fait par la coordination, la
concertation entre les différents acteurs de la localité et
l'instauration d'une démocratie participative.
C'est dans ce cadre, que s'inscrit la problématique
portant sur la déduction d'existence ou non d'une gouvernance
territoriale au sein de la commune d'EL KSEUR et son apport quant aux projets
de développement local. Afin d'apporter quelques éléments
de réponse, il a constaté après des enquêtes sur le
terrain que l'inexistence de proximité organisationnelle et
institutionnelle entre les acteurs de la commune d'EL KSEUR entrave
l'émergence d'une gouvernance territoriale. Celle-ci se répercute
négativement sur le développement local.
Dans le souci d'affirmer ou d'infirmer ses hypothèses,
il a mené une enquête de terrain auprès des
différents acteurs de la commune d'EL KSEUR (Collectivités
Locales, Entreprises, Associations, Partis politiques, ...). Suite à
l'analyse et l'interprétation des réponses au questionnaire
élaboré d'une façon ciblée afin de répondre
aux préoccupations précises, l'auteur a constaté qu'il
existe une gouvernance territoriale dans la commune d'EL KSEUR.
Cependant, celle-ci est jugée médiocre, voire
tendant vers l'inexistence. Il ressort, également, qu'il faut mettre en
place des éléments qui peuvent garantir la réussite et
l'aboutissement des projets de développement local par la participation
des acteurs au processus de prise de décision, le renforcement de la
coordination et la concertation entre les différents acteurs de la
commune.
4. NGOYI TUELEKEJI Jean Paul, dans son
mémoire de licence, sur « problématique de la
participation communautaire au processus de développement de la ville de
Kananga, expérience de l'INADES-FORMATION » (2019-2020
à l'ISES/KANANGA).
Dans ce travail, l'auteur montre que la participation
communautaire aux actions du développement est la clé de voute de
la réussite et de la durabilité de celles-ci. Il met en exergue
le rôle prépondérant et prémonitoire des
organisations à assises communautaires (OAC) comme acteurs
endogènes qui doivent éveiller la vie dans les communautés
en lui apportant du sel pour son assainissement, la vivacité du milieu
vient des activités et de l'ambiance qu'apportent les OAC dans les
leaders d'opinion et dans les membres de la communauté.
Chaque ménage est appelé à poser des
actes palpables au bénéfice des membres de famille, du quartier,
de l'église et de la collectivité. L'Etat a le rôle
d'entreprendre des ouvrages d'intérêt public et communautaire lors
que les citoyens sont conscients et convaincus de participer. La participation
ayant pour secteur cible la conscience des bénéficiaires.
5. NGALAMULUME KAYEMBE Freddy, dans son
étude sur la problématique de la participation des
populations au développement local. Cas de la commune Agro-pastorale de
Lukonga, l'auteur fait état de lieu pour réaliser la
théorie du développement local participatif et celle de la
décentralisation pour corroborer la participation des populations de
Lukonga aux actions de développement de leur localité.
Néanmoins, n'étant pas associées à
toutes les étapes des programmes et projets, cette participation reste
tributaire du statut social des acteurs de la zone d'étude. Ces
ainés scientifiques sus-ventés ont abordé la participation
communautaire et son incidence dans le processus de développement.
Cependant, pour se démarquer de mes
prédécesseurs, estimons-nous que promouvoir l'engagement citoyen
est la seule voie par excellence d'éveiller la conscience de toutes les
parties prenantes au travers un encadrement de ces dernières afin d'un
engagement participatif au développement durable et intégral des
entités territoriales décentralisées voulu par la
constitution du 18 février 2006 ainsi que la loi organique sur la
Décentralisation.
0.3.PROBLEMATIQUE
Dans son ouvrage intitulé : «Pratique de la
recherche opérationnelle de la gestion'', MELESE, J définit la
problématique comme un ensemble des Questions qu'un chercheur se pose au
début de sa recherche sur son sujet. (Pratique de la recherche
opérationnelle de la gestion, Ed. DUNOD, PARIS, 1967, P25).
Pour BAKOLE MuanzaMartin (2017-2018), corroboré par
MUAMBA BatubengaThéophile, La problématique est l'ensemble
construit autour d'une question fondamentale. Elle consiste à passer
d'un objet concret à la formation d'un objet scientifique.
Cette question fondamentale devrait contenir dans le travail.
C'est dans cette question que découleront les hypothèses et le
plan de l'étude (le fil conducteur de la recherche).
La République Démocratique du Congo est le
troisième pays d'Afrique subsaharienne en termes de population
estimée à plus ou moins 84 millions d'habitants, après le
Nigeria et l'Egypte, et le deuxième en termes de superficie 2.345.410
km2. Elle est dotée d'abondantes ressources humaines et naturelles
(agricoles, minières, énergétiques, halieutiques,
touristiques...), parmi lesquelles une forêt tropicale qui est la
deuxième au monde par sa superficie, des sols fertiles, des pluies
abondantes et des ressources minérales variées et
considérables dont l'exploitation devrait être le gage de son
développement économique et social.
A l'indépendance en 1960, le pays disposait d'un tissu
économique intégré qui s'est, à la suite des
troubles, des sécessions, pillages, guerres et mesures
politico-économiques inconséquentes, totalement disloqué
compromettant ainsi les bonnes perspectives de son développement.
Soixante-unan après, l'économie du pays se
trouve dans un état de marasme et de déliquescence tel qu'un
diagnostic sans complaisance doit être posé de façon
à relever les problèmes à la base et proposer des pistes
de solutions susceptibles d'engager l'économie sur une relance soutenue
et durable. Difficile donc de comprendre ce paradoxe de cette économie
exceptionnellement dotée par la nature qui ne réussit que de
maigres performances comme l'affirma M. NZANDA-BUANA Kalemba(2008, p5).
La République Démocratique du Congo est donc l'
un
des dix pays les plus
pauvresdu monde, et
les
inégalités
y sont très marquées. Environ 80% de la population vivent en
dessous du
seuil de
pauvreté fixé à moins de 2 dollars par jour.
Près de 44% des femmes et environ 22% des hommes n'ont aucun revenu. Les
disparités régionales sont très fortes, avec un
taux de
chômage très élevé avoisinant les 40%, des
salaires et des
prestations
sociales dérisoires dans tout le pays (NZANDA BUANA Kalemba, idem,
p6).
L'engagement et La participation active
des citoyens sont considérés comme des éléments
clé pour améliorer la bonne gouvernance et la performance des
programmes de développement, cette dimension fondamentale découle
de la prise de conscience et de l'engagement responsable, socle et fondation
bétonnée de la réussite, de l'efficience,
l'efficacité de toute action tendant à l'amélioration des
conditions existentielles de l'homme.
Et pour y arriver, il faut une symbiose des efforts
conjugués de toutes les parties prenantes (gouvernants et
gouvernés, intervenants et bénéficiaires, ...).
Partant de ce qui précède notre
préoccupation est la suivante :
G L'engagement citoyen et la participation peuvent-ils
être un socle de la réussite de projets de développement
des communautés locales ?
A Comment consolider la participation effective de toutes
les parties prenantes et leur engagement au développement
local ?
B Quel est l'impact du mécanisme d'engagement
citoyen dans la commune de Katoka ?
0.4. HYPOTHESES
Les hypothèses sont des réponses provisoires
anticipées (modèles de raisonnement, propositions ou encore forme
prédisant là où les relations attendues entre deux ou
plusieurs variables selon l'ordre aux questions de la problématique
(KABEMBA Tubelangane, op-cit, p87).
C'est une tentative des solutions par rapport au
problème à étudier. Ainsi, tenant lieu des réponses
anticipées aux préoccupations précédemment
soulevées, les lignes qui suivent pourraient démontrer ce qui
suit :
G L'engagement citoyen et la participation active seraient le
socle du développement de communautés de base, étant
donné qu'ils permettent aux citoyens de participer activement à
la gestion de leur entité(communauté) et de demander aux
dirigeants des comptes.
G Pour consolider la participation effective de toutes les
parties prenantes, il serait important de sensibiliser et les impliquer
à toutes les actions du développement de leurs
communautés.
B A partir de l'intervention de DAI, la gestion de la commune
de Katoka paraitrait transparente, participative et redevable.
0.5.METHODOLOGIE
BAKOLE MUANZAMartin (2017-2018) définit la
méthodologie comme étant un ensemble des méthodes et
techniques qu'un chercheur utilise dans le but d'atteindre un objectif.
0.5.1. Méthode
Une méthode désigne un ensemble des
opérations ordonnées par lesquelles une discipline scientifique
cherche à atteindre ses objectifs. Au sens profond, une méthode
signifie une marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la
connaissance ou à la démonstration de la vérité ou
encore une démarche raisonnée que l'on suit pour arriver à
un but (NTUMBA Ngandu, P., 2011, p7).
Cependant pour MULOWAYI Dibaya(2013, p 53), C'est
une « procédure logique d'une science »,
c'est-à-dire l'ensemble de pratiques particulières,
qu'elle met en oeuvre pour que, le cheminement de ses démonstrations et
des théorisations soit clair, évident et irréfutable
BAKOLE Martin (ibidem) continue et souligne encore qu'elle est
une voie, un chemin, une démarche intellectuelle que le chercheur
emprunte dans la saisie, l'analyse et l'explication de son objet
d'étude. Elle implique donc un ensemble de règles de
validité interne et externe qu'il faut observer en vue de
résoudre un problème donné.
KALUNGA Mawezo(2013, p38) complète et dit : La
méthode est l'ensemble d'opérations scientifiquement
coordonnées, par lesquelles, une discipline cherche à atteindre
les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les
vérifie. C'est la voie à suivre pour atteindre un objectif
quelconque.
Pour nous, la méthode est une voie, un chemin à
suivre, pour atteindre un objectif bien défini. Elle sert à
orienter le chercheur, à rester dans sa ligne de conduite sans pour
autant se perdre dans les détails, en vue d'arriver à trouver la
vérité qu'on cherche.
Concernant notre étude, nous avons fait recours
à la méthode structuro-fonctionnelle.La méthode
structuro-fonctionnelle est un ensemble des techniques d'investigation dont
l'usage est très répandu. Elle donne un aperçu du
comportement et des perceptions des gens et permet d'étudier leurs
opinions sur un sujet particulier de façon plus approfondie que dans un
sondage.
Elle génère des idées et des
hypothèses pouvant contribuer à comprendre comment une question
est perçue par la population cible et permet de définir ou cerner
les options liées à cette question. La méthode
structuro-fonctionnelle se caractérise par une approche qui vise
à décrire et à analyser la culture et le comportement des
humains et de leurs groupes du point de vue de ceux qui sont
étudiés.
Elle met en effet l'accent à la fois sur la structure,
la nature et les fonctions jouées par les acteurs sociaux dans tout
changement.
Par conséquent, elle insiste sur la connaissance
complète ou holistique du contexte social dans lequel est
réalisée la recherche. La vie sociale est vue comme une
série d'événements liés entre eux, devant
être entièrement décrits, afin de refléter la
réalité de la vie de tous les jours. Cette commune comprend les
différents services dont chacun a une fonction. (
www.ernwaca.org).
Cette méthode nous a permis de considérer et
étudier la commune de Katoka comme une structure de développement
et comment elle se comporte en matière de développement local
participatif pour lutter contre la pauvreté et améliorer les
conditions de sa population.
Nous avons considéré plus adéquat par
rapport à notre thématique de mémoire, car ce thème
vise à analyser et comprendre le niveau d'implication et de
participation de la population au développement local.
A ce niveau, la perception, le comportement et l'implication
de la population sont des éléments à travers lesquels on
peut mieux appréhender le sujet d'études et comprendre la
situation.
0.5.2. Techniques
Selon MUKADI LUABA Nkamba, H., une technique de recherche est
une opération qui permet de collecter les données
nécessaires en fonction des objectifs de la recherche de le classer, de
les traiter et des construire les tableaux statistiques, les graphiques, les
digrammes, etc. Mais aussi les outils dont le chercheur en vue de bien mener
son investigation. Pour notre étude, nous avons fait appel à des
techniques ci-après :
1. Technique d'observation directe
Elle nous a permis de récolter sur le terrain les
données recherchées grâce à l'un ou l'autre de nos
sens et aussi d'entendre et de voir certaines réalités du
mécanisme d'engagement citoyen sans poser des questions.
2. Technique documentaire
Celle-ci nous a aidé à dépouiller les
ressources écrites (ouvrages, livres, articles, documents d'archives,
notes de cours, travaux de fin de cycle, etc.) pour recueillir les
données.
3. Technique d'enquête
Cette technique nous a permis de récolter de
façon ordonnée les différents points de vue des
enquêtés à travers un questionnaire écrit. C'est
dans cette optique qu'elle a été administrée aux
différentes strates de la communauté kanangaise en
général, et de la commune de Katokaen particulier, pour
déceler les problèmes liés aux responsabilités
sociétales des parties prenantes ou intervenants.
4. Technique d'interview
Elle nous a facilité d'interroger quelques personnes
sur la ville pour comprendre l'impact et ses conséquences du
mécanisme d'engagement citoyen.
0.6. DELIMITATION DU
SUJET
Cette étude étant complexe, nous
conférons une délimitation temporelle et spatiale :
G Dans le temps, notre étude s'étend sur une
période allant de 2018 à 2021 :La première
année est celle pendant laquelle nous avons constaté une
multitude d'interventions de la part de l'Etat, des partenaires nationaux et
internationaux ainsi que la prolifération des structures et
organisations de développement après les évènements
de triste mémoire dus à l'insurrection de la milice KAMUINA NSAPU
dont les impacts restent litigieux et aussi et surtout le début des
investigations.
Durant cette même période, nous avons
commencé à observer comment est-ce que la population de la
commune de Katoka au travers les organisations de la société
civile, de mouvements associatifs, des mouvement citoyens, les ONG fournissent
tant soit des efforts afin d'impliquer les citoyens de la Commune de Katoka
à la participation pour le développement. Et la seconde, est
celle de la diffusion des résultats de nos recherches.
G Dans l'espace, nous avons choisi comme notre champ
d'investigation, la commune de Katoka, dans la ville de Kananga, Province du
Kasaï Central qui a bénéficié les appuis de DAI-IGA
en matière d'engagement citoyen et de gouvernance participative.
0.7. DIVISION DU TRAVAIL
Cette étape constitue la base même de notre
travail en ce sens où elle fait état de la répartition des
différentes parties du sujet à décortiquer. Ainsi,
excepté l'introduction et la conclusion, notre travail comprendra trois
chapitres répartis comme suit :
G Le premier chapitre traitera des
généralités ;
A Le second chapitre sera consacré au
développement local et le mécanisme d'engagement citoyen
(MEC) ;
B Et enfin, le troisième et dernier parlera des
indicateurs et perspectives d'engagement citoyen dans la commune de Katoka.
0.8. DIFFICULTES
RENCONTREES
L'entreprise ainsi que l'aboutissement d'une recherche
scientifique ne sont pas une chose aisée pour un chercheur honnête
soucieux des résultats escomptés, et réalistes. C'est le
cas qui nous concerne. La rédaction de cette oeuvre scientifique nous a
valu des sacrifices et des privations. Etant donné qu'il n'y a pas de
rose sans épines, dit-on.
Ainsi nous avons été confrontés à
bien des pesanteurs dont les principales sont :
F Difficultés d'ordre professionnel : il nous a
été difficile de disponibiliser matériellement de temps
pour réconcilier les études et le travail, et pour parvenir
à la réalisation de cette oeuvre, nous avons été
contraints aux nuits blanches, à la privation des loisirs et confort,
afin des recueillir et rassembler les données nécessaires pour
notre travail.
F Pesanteurs d'ordre financier : Etudier est une
entreprise noble mais très coûteuse, surtout dans le contexte de
la Covid-19 où toutes les économies du monde ont
été secouées dans leurs fondements. Il a fallu faire des
sacrifices et des privations pour présenter à sa juste valeur ce
présent travail.
F Contraintes scientifiques : le corpus de terrain
étant une tâche rude, nous avons fait face à des
humiliations, réticences et oppositions tacites de certaines
personnalités auprès desquelles nous devrions recueillir
certaines données liées à notre recherche.
Qu'à cela ne tienne, notre courage et
détermination ainsi que notre abnégation nous ont aidé
à surmonter toutes ces difficultés et d'arriver aujourd'hui
à bon port. Comme il est écrit dans la Sainte
Bible :« une femme enceinte, oublie toute ses souffrances
quand un nouveau-né est arrivé dans le monde ».
Jean 16 : 21
CHAPITRE I :
GENERALITES SEMANTIQUES
A
vant de présenter le mécanisme d'engagement
citoyen et le développement des communautés de base, nous voulons
en premier temps situer nos lecteurs dans le vrai sens de notre expression ou
vocabulaire de base pour l'intangibilité de cette étude.
A cette dimension s'ajoute aussi, la présentation de
la commune de Katoka : l'histoire, la situation géographique,
politico-administrative, économique et industrielle, socioculturelle,
socio-sanitaire ainsi que démographique.
1.1.SECTIONI :
CONCEPTUALISATION
MULUMBATI Nganshi(1980, p22) précise que dans le
domaine de sciences sociales, les idées frisent de façon
divergente pour ce qui est de la signification à donner à tel ou
tel concept. MULUMBATI remarque que « la plupart des concepts »,
à force d'être utilisés dans le cours de conversation
deviennent flous et ambigus. Aussi leur définition devient-elle
impérative lorsqu'on s'engage dans une recherche.
1.1.1. Mécanisme
Selon le dictionnaire Universel Larousse, édition
spéciale de la République Démocratique du Congo (2010,
P.631), le mot mécanisme est la combinaison de pièces
disposées de façon à obtenir un résultat
déterminé. C'est aussi un mode de fonctionnement d'un ensemble
d'éléments dépendant les uns des autres.
Par extension, selon Wikipédia , on appelle
mécanisme,
tout
processus
déterministe,
évènements en cascade déterminés par des liens de
cause
à effet,comportement prévisible (par exemple,
mécanisme
de défense)... Combinaison d'éléments ou
d'opérations qui permet le fonctionnement d'un organe, d'une
activité(
http://fr.wikipedia.org,
consulté le 16/07/2021, à 12 h18').
1.1.2. Engagement
Selon Howard S. Becker (2006, pp.177-192), l'utilisation du
concept d'engagement (commitment) est largement répandue, mais ce
concept n'a que rarement fait l'objet d'une analyse formelle. Il contient une
explication sous-jacente de l'un des mécanismes
générateurs de comportements humains cohérents.
On parle d'engagement lorsqu'un individu, en prenant un pari
subsidiaire, associe à une ligne d'action cohérente des
intérêts étrangers à celle-ci. Les paris
subsidiaires sont souvent la conséquence de la participation d'un
individu à des organisations sociales. Une analyse du système de
valeurs depuis lequel sont pris les paris subsidiaires est nécessaire
pour comprendre pleinement les engagements.
Il poursuit et souligne que Le terme d'engagement (commitment)
connaît une popularité croissante dans le débat
sociologique. Les sociologues l'utilisent pour analyser des comportements aussi
bien individuels que collectifs. Ils en font un concept descriptif
utilisé pour désigner des formes d'action caractéristiques
de certains types d'individus ou de groupes. Ils en font une variable
indépendante permettant d'expliquer certains types de comportements
individuels ou collectifs. Ils l'utilisent dans l'analyse d'une grande
variétéde phénomènes : pouvoir, religion,
recrutement professionnel, comportements dans l'entreprise, attitude politique,
et ainsi de suite.
1.1.3.Citoyen
Le mot citoyen vient du concept citoyenneté.
L'idée de citoyenneté n'est pas neuve. Elle a traversé les
âges depuis la Grèce antique jusqu'à la Révolution
française, dont elle a constitué l'un des piliers. Elle continue
aujourd'hui d'être placée au frontispice du modèle
républicain. Mais son contenu et sa signification restent souvent
insaisissables ou mal compris. Il s'agit en effet d'une construction juridique
dont les contours ont évolué au cours du temps et qui,
aujourd'hui, cherche un nouveau souffle. Notre pays s'est construit sur
l'idée d'une citoyenneté transcendante, qui réunit dans un
même corps politique l'ensemble des individus qui forment la nation
souveraine autour du triptyque de notre devise (justice, paix, travail)
Pris adjectivement selon le Dictionnaire Universel, LAROUSSE
illustré (2009, p.206) ce qui est citoyen c'est ce qui est civique, qui
cherche à concilier éthique, responsabilité et
rentabilité.Le citoyen est défini comme une personne jouissante,
dans l'État dont il relève, des droits civils et politiques, et
notamment du droit de vote.
La citoyenneté relève donc d'un ensemble de
droits et de devoirs : droits civils fondés sur des libertés
individuelles comme la liberté de conscience et d'expression, la
liberté d'aller et venir, paiement des taxes..., droits politiques comme
celui de participer à la vie politique et d'être candidat à
toutes les fonctions publiques.
En contrepartie, le citoyen a l'obligation de respecter les
lois, de participer aux dépenses collectives en fonction de ses
ressources et de défendre la société dont il est membre,
si elle se trouve menacée. Le sociologue et politologue Dominique
Schnapper (2006, pp. 177-192) explique notamment qu'au-delà des droits
et des devoirs, le terme de citoyen caractérise également un
régime politique, dans lequel la légitimité politique
repose sur l'engagement citoyen. Le citoyen n'est pas seulement un sujet de
droit individuel, il est aussi le détenteur d'une part de la
souveraineté politique et c'est l'ensemble des citoyens,
constitués en collectivité politique ou en
« communauté de citoyens » qui, par
l'élection, choisit les gouvernants et son mode de gouvernance.
Citoyenneté, civisme, civilité...
Ces trois termes ont une étymologie commune :
« civis », la cité. Ainsi, le statut de
citoyen ne se limite pas à son versant politique, mais revêt aussi
un caractère moral propre au « vivre ensemble » et
à la civilité reposant sur le respect d'autrui et des lois. Mais
être citoyen, c'est aussi faire preuve de solidarité et
d'altruisme.
1.1.4.Engagement citoyen
L'engagement citoyen est défini comme la participation
active et démocratique des membres d'une communauté au
développement et au mieux-être de son milieu de vie. Notamment, la
citoyenne ou le citoyen engagée est conscient de son droit et de sa
responsabilité de participer activement à la vie de sa
communauté et de son pays; intègre les valeurs des droits humains
dans ses actions; réfléchit de façon critique et
constructive sur ses propres expériences et préjugés;
identifie les problèmes qui affectent la communauté et contribue
à les solutionner; participe activement et démocratiquement
à la réalisation d'actions concrètes au
bénéfice de l'ensemble de la communauté et du pays(
https://equitas.org).
Pour MATUNGULU Aimée(2008, p4), l'Engagement
Citoyen est un comportement positif qui peut amener un changement. Valeur
commune pour une participation aux actions du développement. Il est
basé sur des valeurs fortes comme l'écoute, le partage,
l'entraide et la solidarité... Il peut y avoir des actions de plus ou
moins longue durée. Pour finir l'engagement diffère selon
l'éducation, la façon de penser et les opinions de chacun.
Selon l'institut de recherche en santé du Canada, Par
« engagement des citoyens » (EC), on entend la participation
véritable des citoyens à l'élaboration de politiques ou de
programmes. En termes simples, les citoyens sont « engagés »
lorsqu'ils jouent un rôle actif dans la définition des enjeux,
l'examen des solutions possibles et la détermination des ressources ou
des priorités où orienter l'action. Cette « participation
véritable » peut avoir lieu à différents stades de la
préparation, de la planification et de la mise en oeuvre d'un projet,
mais la clé de l'EC consiste à écouter les citoyens et
à utiliser leurs idées efficacement.
Bref : c'est une disposition/comportement du Citoyen
à s'impliquer dans la résolution des problèmes de sa
communauté et un pilier du développement harmonieux. «
L'engagement des citoyens repose sur la conviction que les gens doivent et
veulent participer aux décisions qui touchent leurvie.» (IRCS,
2011, p.3)
1.1.5. Mécanisme
d'engagement citoyen
Selon MATUNGULU Aimée(Op. cit., 26), le
mécanisme d'engagement citoyen est une tentative d'organisation des
communautés qui permet une participation effective des
communautés au sein de l'ETD.
1.1.6. Développement
Vient du verbe développer, qui signifie grandir,
accroitre, passer d'un état inférieur a l'état
supérieur, connaitre une amélioration...Le terme
développement est utilisé dans les sciences humaines,
désigne l'amélioration des conditions et de la qualité de
vie d'une population, et renvoie à l'organisation sociale servant de
cadre à la production du bien-être. (RIST Gilbert, 1996, p.416).
Ce subjectif polysémique est défini de plusieurs manières
par différents auteurs, selon leurs orientations, et selon les
contextes.
Dans la littérature, le terme développement
désigne un large éventail de conception couvrant non seulement la
croissance économique mais aussi les objectifs et les valeurs de type
social, culturel et politiques assignés par une société
connue et axée sur l'épanouissement de l'individu entant que
clé de voûte du progrès. (PNUD, 1995, p.43)
Le « développement » est
un concept polysémique utilisé dans divers domaines ; on dit
développement d'un être vivant pour expliquer l'apparition de
nouveaux organes, son évolution vers la maturité ; le
développement d'une entreprise est un processus de changement pour
rendre celle-ci plus performante, plus compétitive par des choix
stratégiques ou des innovations. Dans le cadre de cette étude, il
a plutôt une connotation anthropo-socio-économique,
c'est-à-dire qu'il se rapporte à l'état des conditions de
l'existence humaine dans un milieu. Dans son rapport cité par Rist
(2001), la Commission Sud (1990) a formulé la définition suivante
:
Le développement est un processus qui permet aux
êtres humains de développer leur personnalité, de prendre
conscience en eux-mêmes et de mener une existence digne et
épanouie. C'est un processus qui libère les populations de la
peur du besoin et de l'exploitation politique, économique et sociale.
C'est par le développement que l'indépendance politique acquiert
son sens véritable. Il se présente comme un processus de
croissance, un mouvement qui trouve sa source première dans la
société qui est elle-même en train d'évoluer.
(p.329)
La définition de cette commission des
représentants de 25 pays du sud, est particulièrement originale.
En effet, le développement est un processus endogène à la
fois économique, social et politique qui favorise
l'épanouissement et l'autonomie d'une population dans son milieu
d'évolution.
Selon le professeur KABATUSUILABernard, c'est l'ensemble des
améliorations qualitatives et quantitatives des critères vitaux
d'une communauté (KABATUSUILA Bernard, 2010, p.74)
Notre fondement est la définition de GOFFAUX Joseph
cité par le chef des Travaux KAPINGA MUAMBA Sophie, soulignant que le
développement est un processus des changements dans les
mentalités, les habitudes sociales et les institutions d'une population,
qui mettent celle-ci, en état d'opérer sa croissance. Lui aussi
assis sur François Perroux parlant du développement
économique, c'est-à-dire les changements des structures mentales
et des habitudes sociales et les changements institutionnels qui permettent la
croissance du produit global et qui transforment les progrès
particuliers en progrès du tout social.
Pour LOUIS Auguste, cité par le Chef de travaux BAMBI
Clémentine : « développer un homme, le mettre
debout, le rendre responsable de son avenir, en faire l'auteur de son histoire,
le rendre libre » (Bambi Clémentine, 2021.).
Pour nous le développement est la réponse
adéquate aux exigences vitales des citoyens d'une communauté.
1.1.7.
Développement durable et équitable
De nos jours, il parait inconcevable à l'esprit des
développementistes des actions de développement qui ne prennent
pas en compte les générations futures. Les recherches montrent
que l'industrialisation, soubassement de la modernisation, est à
l'origine de grandes perturbations environnementales au point de mettre en
péril de nombreux écosystèmes.
Cependant, des millions de gens continuent de patauger dans la
misère. Les problèmes environnementaux seront toujours
présents et plus menaçants tant que les populations doivent avoir
à affronter la misère et l'injustice (BRUNDTLAND, 1987). Aujourd'hui, les esprits convergent plutôt vers un
développement qui touche toutes les couches sociales, un
développement avec une forme d'exploitation des richesses naturelles
avec moins d'impacts sur l'environnement et une distribution équitable
des profits sans toutefois compromettre l'existence des futures
générations.
1.1.8.
Développement intégré
Le développement intégré peut être
défini comme une vision globale et stratégique du
développement qui intègre tous les facteurs susceptibles
d'influencer le processus de développement de manière à
réduire au strict minimum ceux capables d'impacts négatifs. Il
s'agit d'un développement logique et rationnel qui prend en compte tous
les aspects y compris toutes les conditions nécessaires dans un but de
croissance (MORISE, 1992).
Le professeur KABATUSUILA Bernard le définit aussi
comme étant un développement consensuellement harmonisé,
programmé en faveur de plusieurs entités territoriales ou
géographiques voisines. Les décideurs politiques des pays
différents mais dont les frontières sont communes, peuvent opter
par exemple que le développement de leurs pays se fasse de
manière uniforme, en y investissant des moyens nécessaires.
On parle alors dans ce cas d'un développement
intégré, puisqu'il s'agit du développement uniforme et
volontariste de plusieurs espaces géographiques.
1.1.9.
Développement participatif
Le développement participatif est né du constat
des échecs des actions entreprises par des organisations de
développement des années 70 (Blanchet, 2001). Il consacre la
légitimité du droit des communautés à participer
dans les décisions les concernant. Selon l'OCDE, cité par Yoda
(2004).
Le développement participatif suppose davantage de
démocratie, un plus grand rôle pour les organisations locales, une
plus grande autonomie administrative, le respect des droits de la personne
humaine, y compris les systèmes juridiques efficaces et accessibles...
(p.15)
1.1.10. Développement
intégral
Il s'agit d'un développement qui touche tous les
secteurs de la vie nationale, locale.
Le développement intégral c'est promouvoir tout
homme et tout l'homme, prendre en compte la croissance matérielle mais
aussi spirituelle de la personne humaine. Dans la conception de l'Eglise,
l'homme est au centre même des choses et tout est ordonné par
rapport à lui. Tel est le développement intégral auquel
fait constamment référence la doctrine sociale de l'Eglise(BENOIT
XVI : 2009,p.135).
1.1.11. Développement
autocentré(autogéré)
Le développement autocentré est un
développement ou « self-releance » insiste
sur les efforts des nationaux ou locaux, ainsi que le recours
privilégié aux ressources nationales. Il s'agit d'une
stratégie qui vise le développement en commun d'un ensemble
régional ou d'un sous-ensemble régional. Il vise la mise en
commun de moyen de production.
1.1.12. Développement
communautaire
Après une enquête sur les expériences de
développement dans les pays du tiers-monde, les Nations unies en sont
venues à définir le développement communautaire dans ces
régions comme : L'ensemble des procédés par lesquels les
habitants d'un pays unissent leurs efforts à ceux des pouvoirs publics
en vue d'améliorer la situation économique, sociale et culturelle
des collectivités, d'associer ces collectivités à la vie
de la nation et de leur permettre de contribuer sans réserve aux
progrès du pays.
Les procédés supposent tous deux
éléments essentiels : les habitants participent activement [...]
des services techniques et autres sont fournis [...], ces programmes concernent
généralement des collectivités locales (SALBERG et
WEILSH-BONNARD, 1970, p. 56).
Pour le chef des Travaux KAPINGA MUAMBA Sophie
(op.cit.), ce concept renvoie à la prise de conscience,
l'autonomie des intéressés, la mesure à apporter au
soutien et à l'orientation des actions, l'amélioration des
capacités locales de prendre de décisions et d'en assurer les
conséquences, la promotion de l'approche participative dans
l'évaluation des situations et des besoins...
C'est une méthode du développement qui veut que
des individus qui habitent une communauté éveille leur
conscience, regardent autour d'eux et dans la même direction pour
connaitre pour connaitre leur environnement, découvrir de
réalités, identifier les problèmes généraux,
spécifiques, prioritaires, urgents graves ou dangereux, les besoins de
population ainsi que les moyens nécessaires pour les résoudre en
vue d'un monde meilleur(KAPINGA Sophie, 2017-2018, p.15).
1.1.13. Développement
alternatif
Le développement alternatif est un développement
dont les objectifs ont été redéfinis. Il se peut que la
dimension économique soit négligée par ceux qui
s'intéressent au développement, Ceux qui décident, il se
peut que aussi que ceux qui cherchent un dévelop-pement alternatif
visent peut-être une amélioration autre qu'économique et
sociale ou une autre dimension. Le développement alternatif est un autre
développement, n'importe quel développement, un
développement autosatisfaction (KABATUSUILA B., Op.cit.).
1.1.14. Développement
local (de communauté de base)
La théorie de développement local est née
à la suite des inégalités territoriales engendrées,
entre autres, par les différentes approches dites économiques,
exogènes qui n'ont pas souvent livré des résultats
appréciés.
Également, son émergence est en grande partie
due aux différentes réflexions qui ont eu lieu autour du concept
de développement local par certains auteurs, notamment les tenants du
pôle des systèmes productifs locaux (COURLET et PECQUEUR, 1992,
1993, 1998; Pecqueur, 2000), les tenants des milieux innovateurs (MAILLAT,
1991, 1996), les protagonistes des nouveaux districts industriels (BECATTINI,
1992; BAGNASCO, 1977), les auteurs de PME et l'entrepreneuriat (JOYAL, 1993,
1997; MARCHESNAY et JULIEN, 1996; PREVOST, 1993).
En somme, cette théorie est qualifiée
d'endogène parce qu'elle s'inscrit dans une perspective de
développement orienté principalement sur le territoire et la
collectivité ou dans une approche territoriale du développement
(AYDALOT, 1985).
Le développement local est la contribution qu'un petit
territoire, une organisation de de base (OB) apporte au mouvement
général du développement, en termes de plus-value
économique, sociale, culturelle, spatiale. C'est un produit de nature
globale, instrumenté par le projet de territoire d'une équipe,
articulé autour d'initiatives économiques et écologiques.
1.1.15. Communauté
La communauté est définie comme un groupement
dont les membres qui, mus par les intérêts et les gouts communs ne
sont pas nécessairement de même sang, mais constituent un
réseau d'interaction impersonnelle et vivent dans un territoire
donné où ils exercent au moins une activité productive
à laquelle ils sacrifient les temps et les ressources garantis par les
liens sacrés, les groupements s'intègrent habilement dans son
environnement et est prêt à de fendre ses intérêts
(KAPINGA Sophie, op.cit.).
Une communauté est un regroupement de personnes ayant
des traits, des caractères et d'intérêts communs,
organisée et structurée autour des objectifs communs avec des
moyens propres, vivant sur un territoire bien limité sous l'égide
d'un chef qui se trouve être le garant de la vie de ses populations.
Six facteurs déterminent cette communauté,
géographiques, démographiques, religieux et historique,
administratif et territorial, économiques et socio-culturels (BAMBI
clémentine, Idem).
1.1.16. Communauté de
base ou Communauté locale
La communauté locale, ou la communauté de base
ou encore, organisation communautaire est définieen
géographie
sociale, une communauté locale désigne
différents groupes de personnes vivant à proximité les uns
des autres, définit dans une même
zone
géographique. On parle ainsi de
collectivité
locale.
Autrement appelée l'organisation communautaire de
base est très importante pour parler de société
civile (GAUSSAIT, 2005). Elle se présente comme une réponse
à l'absence de l'État. Le concept désigne une structure
dans laquelle les gens vivant à proximité s'organisent afin de
promouvoir leurs intérêts, dans le but de susciter leur
mobilisation et leur insertion dans des processus de réalisation de
changements sociaux (Gerald DORE, 1986, p.211).
Bref, ces communautés sont appelées de base
parce qu'elles sont situées dans la pyramide à la base de la
hiérarchie par rapport au sommet. Ainsi, l'on peut recourir à des
éléments d'organisation, tels que : participation,
cohésion, direction politique, etc. (KABUE MBALASimon, 2021, p.5).
1.1.17. Analyse
Le mot analyse est employé dans différentes
matières. Ces différentes significations ne partagent pas
seulement le même nom, mais sont véritablement des applications
particulières d'un concept commun.
Selon le dictionnaire Larousse Illustré, Nouvelle
Edition (2009 : p.39), Ce substantif vient du verbe analyser, qui veut
dire soumettre à une analyse, étudier par analyse, examiner en
profondeur. Ainsi l'analyse est une étude faite en vue de discerner les
différentes parties d'un tout, de déterminer ou d'expliquer les
rapports qu'elles entretiennent les unes avec les autres.
En d'autres termes, l'analyse est l'examen de l'information
(trier, additionner, comparer) pour mieux comprendre les relations entre le
''tout'' et les "parties. Un examen qui tente de dégager les
éléments propres à expliquer une situation, un sentiment,
C'est une étude minutieuse, précise faite pour dégager les
éléments qui constituent un ensemble, pour l'expliquer,
l'éclairer : Faire l'analyse de la situation.
Action de résumer un texte en le décomposant en
ses éléments essentiels ; résultat de cette action (
http://fr.wikipedia.org,
consulté le 26/07/2021, à 13 h 50), le professeur Donatien
NGALAMULUME la compare à un examen de Laboratoire médical pour
déterminer les causes d'une pathologie en vue d'un traitement curatif
approprié.
1.1.18. Indicateur
Un indicateur est la traduction chiffrée d'un
phénomène ou d'un concept
Il existe de nombreuses définitions de la notion
d'indicateur. Toutes convergent plus ou moins autour de l'idée qu'un
indicateur est la traduction d'un concept ou d'un phénomène sous
la forme d'un signal (par exemple un code couleur) ou plus souvent encore d'un
chiffre.
Cette « traduction » a la plupart du temps pour but
:
· De simplifier une information (parfois complexe) pour la
rendre compréhensible et utilisable par un public cible (gestionnaires,
décideurs, grand public...) ;
· De décrire une situation à un moment et un
endroit donné puis, par réplication, de permettre des
comparaisons dans le temps et/ou dans l'espace (
http://www.millenaire3.com,
consulté le 03/11/2020).
Selon SEYNI NDIONE, par définition, un indicateur
désigne un impact, il est la marque sinon la signature ; en
pratique, en dépit de la simplicité de cette définition,
la caractéristique d'indicateurs n'est pas facile, car il relève
largement de la subjectivité (SEYNI NDIONE, 2005, p.211)
1.1.19. Perspective
Selon le Dictionnaire du français contemporain, le
concept perspective désigne l'espérance ou crainte
d'évènements considérés comme probables, quoique
éloignés (Dictionnaire du Français contemporain,
p.851).
1.1.20. Entité
Territoriale Décentralisée (ETD)
Une Entité Territoriale Décentralisée
(ETD) est une subdivision territoriale dotée de la personnalité
juridique, ayant des organes, un patrimoine et des finances propres.
On peut définir les entités territoriales comme
des entités de droit public correspondant à des groupements
humains géographiquement localisés sur une portion
déterminée du territoire national, auquel l'Etat a
conféré la personnalité juridique et le pouvoir de
s'administrer par des autorités élues.
C'est cette personnalité juridique qui confère
aux ETD leur autonomie sur le plan organique, juridique et financier.Cette
autonomie se mesure donc à trois niveaux :
· L'élection des responsables des entités
;
· L'étendue de leur pouvoir juridique ;
· L'importance des moyens matériels et notamment
financiers dont elles disposent.
1.2.SECTION 2 : PRESENTATION DE LA COMMUNE DE KATOKA
1.2.1. Situation historique
La commune de Katoka qui fut d'abord l'un des quartiers de la
commune mère de Ndesha et tire son origine de cours d'eau situé
entre deux de ses quartiers à savoir : KAPANDA et TUKOMBE.Elle
née le 04 Mai 1968 conformément à l'arrêté
n° 068/68 du ministère de l'administration du territoire et des
affaires coutumières de Monsieur le Commissaire d'Etat à
l'administration du territoire.
1.2.2. Situation géographique
1.2.2.1. Localisation de la commune de Katoka
La commune de Katoka se trouvant entre les quatre de cinq
communes de la ville de Kananga fait des limites avec celles-ci de la
manière suivante :
· Au Nord par la commune de Kananga et celle de Ndesha
dont elle est séparée par l'avenue Lulua qui est également
la route nationale N° 1 ;
· Au Sud par la rivière Nganza qui le
sépare avec la commune du même nom ;
· A l'Est par le ruisseau appelé Kele Kele, nom
qui porte l'un des quartiers de la commune ;
· A l'Ouest par la rivière Lulua qui sépare
la commune du territoire de Kazumba. Les cours d'eau qui desservent cette
commune sont : Kele Kele, Katoka, Mpokolo, Tukombe, MuanaNkuba, Munda
Mutoke, Ntambue, Kamabue, Kabilenge, Tshibalanga.
1.2.2.2.Climat, relief et végétation
Le climat de la commune de Katoka est le même que celui
du reste de la ville de Kananga, qui est chaud et pluvieux, c'est-à-dire
tropical humide, il compte deux saisons différentes : la saison de
pluie qui dure 9 mois et la saison sèche qui dure 3 mois.
Sa superficie est de 24 km2 et presque 8, 46 % de
celle de la ville de Kananga ; elle a une température entre
21° de longitude et la parallèle de 5, 33° de latitude Sud,
elle est située sur un plateau, le sol argileux et sablonneux.
Sa végétation se caractérise par les
galeries forestières le long de la rivière, la savane se remarque
par la présence des plusieurs bouquets dans lesquels on pratique
l'agriculture (rapport annuel de la commune de Katoka, 2019).
1.2.2.3. Situation démographique et administrative
Administrativement, la commune de Katoka héberge
une population d'environ 256.479 habitants répartie dans cinq quartiers
qui sont : Mpokolo, Kele Kele, Katoka, Kapanda et Tukombe.
Cette population appartient à des diverses ethnies,
notamment : les Lulua, les Bindi, les Tetela, les Luntu et les
autres, les trois groupements respectivement de Bena Mande, Bena Meta et Bena
Kabiya, se localisent dans la périphérie de la commune de
Katoka.
Le tableau ci-dessous représente la situation
démographique de la commune de Katoka.
Tableau n° 1 : Répartition de la
population
|
N°
|
Quartiers
|
Population
|
Total
|
%
|
|
Hommes
|
Femmes
|
|
1
|
KELE KELE
|
23.340
|
25.391
|
48.731
|
19
|
|
2
|
MPOKOLO
|
17.100
|
18.809
|
35.907
|
14
|
|
3
|
KATOKA
|
33.800
|
35.449
|
62.240
|
27
|
|
4
|
KAPANDA
|
22.900
|
23.266
|
46.166
|
18
|
|
5
|
TUKOMBE
|
28.000
|
28.426
|
56.426
|
22
|
|
Total
|
125.140
|
131.339
|
256.479
|
100
|
Source : rapport annuel de la
commune de Katoka 2019.
Dans ce tableau, nous remarquons que lorsqu'on compare
l'effectif des hommes à celui des femmes, ces dernières sont plus
nombreuses que les hommes et cela est dû au fait que ces derniers
pratiquent des travaux lourds.
1.2.3. Situation économique
Cette commune compte deux marchés principaux dont le
quartier dit Batetela où il y a la vente de divers articles et les
produits manufacturés, le marché agro-pastoral de TSHINSELEKA,
ici où se passent les activités commerciales des
différents produits alimentaires et manufacturés, et le
marché Nkashama où se vendent différentes planches servant
de bois de coffrage etc.... Cette commune de Katoka a sur le plan artistique
une menuiserie où se fabrique les meubles de tout genre.
A ceci, s'ajoutent d'autres activités
génératrices des revenus entre autres les cabines
téléphoniques, les étalages de vente d'articles divers,
qui permettent à la population de cette commune de découvrir
certaines économies sociales.
1.2.4. Organigramme
Bourgmestre
Bourgmestre Adjoint
Chef de Bureau
Services annexes
Services Administratifs
Comptabilité
Quartiers
Développement Rural
IPAMA
Droits Humains
Genre&Famille
Jeunesse
Economies
Protocol
Contentieux
Articles
Habitat
Droits humains
Tourisme
FPA
KAPANDA
KELE KELE
MPOKOLO
TUKOMBE KATOKA
Secrétariat
Source : Les archives de la Commune de
Katoka
1.2.5.Fonctionnement
1. Bourgmestre de la commune
Il est représentant du Gouverneur et l'autorité
locale : il assure la responsabilité du bon fonctionnement des
services publics et de la bonne marche de l'administration, il veille à
l'exécution des lois, règlements et décisions en maintien
de l'ordre public, il assure la tâche d'intérêt
général, il est coordonnateur et officier de la police judiciaire
à compétence générale.
2. Bourgmestre adjoint
Il s'occupe des problèmes économiques et du
suivi de l'exécution des projets de développement sous la
direction du bourgmestre, il est gestionnaire de crédit et officier de
police judiciaire à compétence générale.
3. Chef du bureau
Il coordonne l'administration de la commune.
4. Secrétaire
Il reçoit les courriers qui viennent de
l'extérieur, il détient trois registres :
ü Les registres de courriers reçus et
expédiés ;
ü Les registres de transmission des caisses ;
ü La saisie de correspondance de la commune.
5. Comptable
Il est chargé du mouvement de compte,
c'est-à-dire d'entrée et de sortie, possède le livre de
caisse, met la comptabilité à jour et exécute les budgets
de l'entité.
Conclusion partielle
A travers ce chapitre, nous avons eu à fixer les
concepts clés qui ont constitué l'ossature de ce travail, comme
le dit MulumbatiNgasha paraphrasé par Merton :''qu'une recherche
consciente de ses besoins ne peut passer outre la nécessité de
clarifier ses concepts ; car une exigence essentielle de la recherche est
que les concepts soient définis avec une clarté pour lui
permettre de progresser''.
Enfin, avant d'avoir présenté la commune de
Katoka qui nous a servi de cadre d'investigation, nous avons défini les
concepts tels que : engagement citoyen, mécanisme d'engagement
citoyen, développement local, communauté de base, analyse,
indicateur, perspective et ETD, sans oublier d'autres substantifs connexes.
CHAPITRE II:
DEVELOPPEMENT LOCAL ET MECANISMED'ENGAGEMENT CITOYEN(MEC)
2.1.SECTION 1 :
THEORISATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL (DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES DE BASE)
Depuis plus de deux décennies, la
référence au développement local tend à s'imposer
dans les discours de politique économique. Présenté comme
un mode de développement alternatif, il traduit la volonté
d'augmenter l'efficacité des politiques publiques en les rapprochant des
agents concernés, principalement les acteurs locaux. Cette pratique a
trouvé un écho favorable dans les territoires, axant leurs
stratégies de développement sur la mise en valeur de ressources
locales et s'appuyant sur des démarches volontaristes et
endogènes.
Si les principes du développement local se sont
continuellement ancrés dans les pratiques et progressivement traduits
par des préconisations concrètes en matière de
développement, le concept demeure encore peu stabilisé dans la
littérature. Du point de vue théorique, on admet qu'un territoire
peut produire du développement selon la manière dont il
fonctionne et s'organise.
Les travaux sur le développement local identifient les
dynamiques sociales comme vecteurs d'évolution des territoires. Le
constat établi est que la qualité des partenariats locaux
conditionne la capacité des agents à s'entendre et à
s'organiser - bref, à se coordonner - pour atteindre des objectifs de
long terme. On souligne ainsi le poids des expériences d'apprentissage
collectif et de coopération dans le développement des territoires
(Greffe, 2002).
L'appréhension des propriétés du lien
social (nature, qualité et densité des relations) se rattache aux
questions de coordination. L'examen de ces propriétés
amène, en effet, à considérer l'existence de relations de
solidarité, de confiance, de proximité entre les agents. Cette
manière d'aborder la coordination locale trouve ses fondements
théoriques, à la fois, dans les approches du capital social
(COLEMAN, 1988 ; PUTNAM, 1993) et de l'économie de
proximités (PECQUEUR et ZIMMERMAN, 2005, PP.6-7).
La première définition associée à
ce concept était avancée en 1983, par J.L. GUIGOU dans un
colloque à Poitiers ; « Le développement local est
l'expression de la solidarité locale créatrice de nouvelles
relations sociales et manifeste la volonté des habitants d'une
microrégion de valoriser les richesses locales, ce qui est
créateur de développement économique » (GOUTTEBEL
J.L, 2003, P.95). Cette définition montre l'importance de l'unification
des forces des acteurs locaux en vue de faire face aux différentes
menaces extérieures (marginalisation, déclin, expulsion, ou
disparition) et de la réappropriation des richesses de la région
par la population locale en vue de créer ce développement
local.
« Le développement local est une stratégie
visant à créer un environnement propice aux initiatives locales
afin d'augmenter la capacité de la collectivité à
s'adapter aux nouvelles règles de la croissance macro-économique.
Cette même stratégie verra aussi à trouver d'autres formes
de développement qui, par des modes d'organisation et de production
inédits, intégreront des préoccupations d'ordre social,
culturel et environne-mental dans des considérations économiques.
»
Selon Bernard VACHON et Francine COALLIER, « le
défi plus important du développement local, c'est sa
capacité à changer les mentalités, à passer de
mentalités d'échecs et d'assister à des mentalités
d'acteurs sociaux et économiques, à des mentalités de
créateurs » ; Pierre NARDIN.
2.1.1.Caractéristiques du
développement local
Il n'y a pas de modèle unique de développement.
Etant donné la diversité des conditions géographiques,
sociales et culturelles des collectivités, il existe de multiples
façons pour elles d'assurer leur développement. Le
développement comporte une dimension territoriale.
L'espace auquel il s'applique est déterminé par
une histoire, une culture et des ressources particulières ; l'ensemble
des membres de la collectivité est uni par un sentiment d'appartenance
et les liens de solidarité que crée la maîtrise collective
de cet espace. Le développement s'appuie sur une force endogène.
Cette force est la capacité, effective ou potentielle,
d'une collectivité à relever le défi de son
développement au moyen des ressources, des énergies et de la
synergie du milieu. Le développement local favorise l'expression de la
force endogène et mise sur celle-ci pour enclencher les
mécanismes d'action et réduire la dépendance de la
collectivité envers les initiatives d'origine externe.
Le développement local fait appel (i) à une
volonté de concertation et (ii) à la mise en place de
réseaux et de mécanismes de partenariat :
· En compartimentant leurs activités, les
institutions et les organismes nuisent à l'épanouissement de leur
communauté ;
· Toute stratégie de développement local
implique le décloisonnement des fonctions et des compétences
maintenues jusqu'ici enfermées dans des secteurs homogènes
d'activité et des programmes sectoriels.
L'approche du développement local appelle le
redéploiement des valeurs démocratiques par une stratégie
participative et une responsabilisation des citoyens envers leur
collectivité.
De ce qui précède, nous pouvons dégager
quelques mots clés à retenir :
- Développement global ;
- Micro-initiatives de développement ;
- Ressource humaine ;
- Approches multiples ;
- Dimension territoriale ;
- Valorisation des ressources locales ;
- Force endogène ; -volonté de concertation ;
- Pratique participative élargie ;
- Mise en place de réseaux et de mécanismes de
partenariat ;
- Responsabilisation des citoyens.
2.1.2.Pour un
développement local réussi
Les différentes phases. Tout processus de
développement ou de revitalisation comporte des phases qui se divisent
à leur tour en plusieurs étapes :
Phase I : - La prise de conscience
(suscitée par un événement déclencheur)et, -
Mobilisation des forces vives: information, sensibilisation, consultation,
animation et la manifestation d'une volonté
d'intervenir.
Phase II : Le diagnostic et
définition de la problématique. Vision stratégique.
Consensus sur les orientations à prendre et sur la formulation d'un
projet.
Phase III :La conduite
d'actions cohérentes selon des objectifs et des
échéanciers définis :
- Reconnaissance et appui des initiatives de
développement ;
- Évaluation des actions entreprises et des buts
poursuivis.
Nota:
Le sigle SIMFA permet d'évoquer, en un
terme simple, les principales composantes de la démarche, auxquelles
s'ajoutent les mécanismes d'évaluation :
Sensibilisation -
Information -Mobilisation
-Formation -Action.
Chaque étape est un préalable à
l'étape suivante. Ainsi, il ne peut y avoir :
- De mobilisation s'il n'y a pas eu de prise de conscience et
d'information ;
- D'actions cohérentes dans la réalisation d'un
projet s'il n'y a pas de vision stratégique ni de consensus sur les
orientations à prendre. La qualité des résultats d'une
étape influe sur la qualité des résultats de la
suivante.
Par exemple, la qualité de l'information sera
déterminante pour :
- La mobilisation à long terme de la population ;
- La définition juste de la problématique ;
- L'atteinte d'un consensus durable ;
- L'établissement de mécanismes de partenariat
solides ;
- La justesse de l'évaluation des actions entreprises
(PECQUEUR,1989, p.86).
2.1.3.Planificationdu
développement Local
Un plan de développement local est un cadre
retraçant l'ensemble des programmes et projet de développement
visant à atteindre, en adéquation avec les orientations
nationales et au terme d'une période donnée, un but, des
objectifs et des résultats définis de concert avec tous les
acteurs du développement, ainsi que les stratégies et les moyens
nécessaires.
La planification du développement vise essentiellement
l'amélioration quantitative et qualitative des services à rendre
aux populations d'une part et la création de richesses d'autre part.
trois instruments viennent appuyer cette démarche :
1) Le plan de développement (PD) qui décrit les
axes stratégiques et prioritaires de développement à long
terme,
2) Le programme d'investissement prioritaire (PIP) de
l'entité qui découle du plan de développement,
3) Le programme annuel d'investissement (PAI) qui est pris en
compte dans le budget de la province ou de l'entité territoriale
décentralisée.
a. Principes de base de la planification du
développement local
F La planification du développement local repose sur la
bonne gouvernance
F La planification du développement local doit
être collective et non partisane.
F La planification du développement local est une
oeuvre politique.
F La planification du développement local doit
être ambitieuse et réaliste
F La planification du développement local doit
s'intégrer dans la planification national et provincial et dans son
environnement immédiat.
F La planification du développement local doit
être portée par l'entité du niveau le plus apte à
livrer les services de base(subsidiarité) (La décentralisation en
bref, 2013, p.123).
2.1.4.Le développement
local : logique, outil, cadre d'action
Le développement est couramment analysé comme un
processus de transfor-mation et d'évolution de long terme. Le terme
local renvoie à la notion de territoire. S'interroger sur le
développement local revient à appréhender la question de
l'échelle pertinente à partir de laquelle s'opèrent ces
transformations. S'interpeller de cette manière invite à
considérer le territoire ou l'ETD dans ses multiples dimensions :
politique, administrative, identitaire, culturelle, de conduite d'actions
(champ d'intervention des acteurs), etc.
Le développement local exprime depuis trois
décennies un mouvement de prise en charge du territoire par les acteurs
locaux. D'abord apparu comme une nécessité contrainte par la
crise, il s'est peu à peu présenté comme un choix.
Le développement local se caractérise ainsi par
le passage d'une approche essentiellement thérapeutique -
répondre aux crises - à une approche préventive visant
à faciliter l'adaptation du tissu local (économique et humain)
aux enjeux auxquels il se confronte (internes, externes). Il repose sur la
mobilisation de nombreux acteurs, des dispositifs institutionnels particuliers,
qui facilitant et renforçant les dynamiques établies, contribuent
à augmenter la cohérence du territoire.
Dans l'exercice de synthèse sur le développement
local auquel nous nous livrons ici, nous nous attacherons à rendre
compte de ces caractéristiques. Nous viserons dès lors à
énoncer les logiques du développement local, à en
décliner les outils et à définir les cadres de l'action
locale.
2.1.4.1.Les logiques du
développement local
Le paradigme du développement local repose sur la
capacité d'acteurs locaux à s'organiser autour d'un projet
c'est-à-dire se fédérer autour d'un objectif de
développement commun en mobilisant les potentialités et les
ressources existant sur un territoire.
Cette définition revêt trois dimensions.
(i) Elle souligne le caractère localisé,
territorialisé des activités et des actions. (ii) Elle
invite à considérer la temporalité de ces actions. Les
actes finalisés, en effet, rendent compte de la faculté des
agents à concevoir un avenir commun.
Dans le cadre du développement territorial, cet
objectif commun repose sur la valorisation de ressources. (iii) Enfin,
elle exprime que le territoire résulte des interactions entre acteurs
impliqués dans une démarche collective. Ces trois points seront
successivement évoqués pour la compréhension des logiques
du développement local.
On s'accorde à l'idée que les principes d'action
locale se sont historiquement imposés en réaction aux
évolutions économiques. Le mouvement de globalisation, en
bouleversant les modes de produire, a induit des transformations des
activités productives sans pour autant nier la pertinence des
déterminants locaux. Ainsi, par exemple, parallèlement aux
pratiques de délocalisation et de production standardisée, s'est
accentuée l'affirmation du local avec la mise en valeur de produits
spécifiques et de processus de production territorialement
ancrés.
Ces mutations font apparaître un spectre de situations
complexes où le territoire demeure un lieu important de recomposition
des tissus industriels et économiques. C'est alors une
représentation nouvelle du territoire - englobant tout un ensemble de
questions jusqu'alors essentiellement abordées dans le seul cadre des
réflexions industrielles (dimension des unités productives,
flexibilité, coopération inter-firmes etc.) - qui est
proposée.
Elle souligne le déplacement des lieux et des
unités d'analyse de la croissance, appréhendant l'entité
territoriale décentralisée comme forme d'organisation
économique efficace. L'exemple des districts industriels et des
systèmes productifs locaux (SPL) peut être cité à ce
titre. Le succès de ces formes productives localisées
réside dans leurs modalités d'organisation marquées par
des traditions culturelles (savoir-faire) véhiculant des valeurs
communes, favorisant l'initiative locale et reposant sur des normes de
coopération entre agents.
Selon certaines considérations
précédentes, il ressort que les logiques de développement
local reposent sur l'adoption, par les acteurs, de stratégies de mise en
valeur de ressources territoriales. Dans les développements qui suivent,
nous tenterons de préciser quels mécanismes président
à ce processus.L'ETD est lieu de concentration de ressources. Ces
ressources, utilisées dans le processus de production,
définissent le potentiel d'offre territoriale. Les valoriser constitue
un enjeu de taille pour le territoire. Par ce biais, en effet, le territoire
parvient à différencier ou spécifier son offre, ce qui
dans une dynamique de développement est gage d'avantages
concurrentiels.
Ces ressources sont plurielles et de nature diverse
(COLLETIS-WAHL et PECQUEUR 2001, PEYRACHE-GADEAU et PECQUEUR, 2002 ;
ANGEON et CARON 2004). Elles peuvent être composites (c'est-à-dire
constituées par une variété d'éléments
combinés de multiples façons), spécifiques
(intrinsèques au territoire, non reproductibles et non cessibles),
complexes (recouvrant plusieurs propriétés à la fois) et
latentes. Par ailleurs, ces ressources peuvent être intentionnellement
construites.
Le processus de construction sociale de ressources repose sur
des dynamiques d'acteurs. C'est bien en effet de la capacité des acteurs
à révéler, activer, qualifier ou requalifier les
ressources dont il est question. Cela suppose que les acteurs s'engagent dans
des démarches de coopération. La stratégie de valorisation
de ressources peut alors être conçue comme le fruit de la
coordination d'acteurs impliqués dans des démarches d'action
collective (ANGEON et COLLOIS, 2002, p.96).
Le développement local désigne une dynamique
d'initiatives locales (privées ou publiques) qui met en mouvement des
acteurs. Ces derniers qui se réunissent autour d'un projet - dont le
principe de valorisation de ressources est l'essence - font collectivement par
ce biais exister le territoire. L'élaboration de projets se
concrétise à travers la mobilisation des acteurs autour d'une
stratégie commune. Elle trouve sa traduction opérationnelle dans
une programmation cohérente d'actions. Le développement local
peut être ainsi assimilé à un cadre favorable à
l'action collective au sein duquel le territoire se construit.
L'aboutissement de l'action collective suppose que les acteurs
parviennent à s'entendre sur les objectifs visés et les moyens de
les atteindre. La mise en cohérence des diverses représentations
du territoire que portent les acteurs est, en effet, le garant d'une dynamique
effective de coopération. Au sein d'un territoire, la coopération
entre acteurs se matérialise à travers l'établissement de
partenariats locaux. Ces réseaux d'acteurs locaux renforcent la
cohésion sociale et favorisent la cohérence territoriale. Cette
cohérence peut elle-même être renforcée et rendue
plus efficace par un cadre institutionnel adapté.
L'intérêt reconnu aux démarches d'action
collective locale s'est transcrit, en France par exemple, dans des cadres
institutionnels particuliers. Des structures nouvelles ont, en effet,
été imaginées (dont les plus connues sont les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et les Pays) qui
constituent les nouveaux référentiels de l'action locale. Ces
structures redéfinissent l'architecture institutionnelle en adoptant des
procédures de mise en accord des acteurs.
Pour ce qui concerne l'exemple des pays en
développement, concrètement, les centres d'intérêts
collectivement exprimés par les acteurs sont inscrits dans des chartes.
Ce qui importe ici, c'est le caractère conventionnel de ces chartes. Il
implique que les acteurs s'engagent dans une procédure de concertation.
Il souligne l'existence d'un accord local (sur les principes et les
finalités de l'action) indépendamment de toute
référence au document formel matérialisant les engagements
des partenaires.
Les chartes sont énoncées sous forme de contrats
qui instituent les relations de partenariat entre acteurs. On s'arrête
ici sur le caractère formel de la charte. On notera que l'engagement des
agents dans un contrat nécessite qu'ils s'inscrivent dans des rapports
de confiance mutuelle. Ces engagements sont volontaires. Il importe donc que
chacun des protagonistes adhère à ces principes et partage une
même vision du territoire, une conception commune de ses modalités
ou potentialités de développement.
Ainsi, ces cadres institutionnels - matérialisés
par la constitution d'une charte - visent à proposer des repères
pour l'action. Ce sont, en ce sens, de véritables projets de territoire,
c'est-à-dire qu'ils sont le support de démarches,
stratégies ou initiatives pour le développement du territoire. A
ce titre, ils définissent des objectifs à atteindre sous
certaines conditions ou contraintes. Ces dernières renvoient au fait
qu'existent - ou le cas échéant que soient stimulées - les
ressources nécessaires à la formulation du projet.
Un projet caractérise donc « la conjonction
d'analyses, de désirs et de savoir-faire collectif qui permet de
polariser l'action de chacun autour d'une ambition commune, de résister
aux forces centrifuges, de surmonter les contradictions internes
d'intérêts, de saisir les opportunités qui se
présentent d'exploiter les marges de manoeuvre, de replacer l'action de
chacun improvisée en fonction d'événements
aléatoires dans une perspective à long terme » (CALAME,
1991, p. 35).
Ces structures tendent à présenter le
développement local comme une pratique institutionnalisée sous de
multiples facettes. Fondée sur les logiques du développement
local et expression d'un mode de gouvernance territoriale, elles sont lieux
d'organisation de l'action collective.
Loin de se limiter à n'être qu'un simple
programme d'actions, le développement local repose sur la conviction que
les acteurs du territoire sont capables de mettre en adéquation leurs
initiatives, d'avoir une représentation commune de ses principaux
enjeux, de ses atouts ou de ses fragilités. Une telle
considération fait ressortir que les spécificités
territoriales importent dans le développement.
L'approche du développement local s'affranchit ainsi
des visions réductrices des théories économiques du
développement qui considèrent l'espace local comme une
entité neutre (ou réduite à un point). Elle fait
apparaître que les ressorts territoriaux facilitent la coordination, ce
qui dans l'analyse des conditions du développement, revêt un
caractère central.
2.1.6.Théorie de la
décentralisation
Dans les système politiques actuellement en vigueur
dans le monde, il existe plusieurs modes d'organisation administrative de
l'Etat. Ils varient selon les contextes politiques, économiques,
géographiques et culturels. Dans le cas d'un Etat unitaire, on opte
généralement pour centralisation, la décontraction ou la
décentralisation.
La centralisation est un mode de gestion de l'Etat dans lequel
l'impulsion et les décisions relèvent exclusivement des
autorités du gouvernement central, les autorités provinciales et
locales n'étant que de simples exécutants. Les entités
provinciales et locales ne jouissent pas d'une personnalité juridique
propre et ne disposent pas d'une autonomie de gestion. Le contrôle qui
s'exerce sur leurs actes est hiérarchique.
La centralisation est un système d'administration dans
lequel le pouvoir de décision est exercé à la fois, par
l'Etat et par des personnes morales autonomes soumises au contrôle, en
principe de légalité, des autorités étatiques. Qui
implique le transfert d'attributions de l'Etat à des
collectivités ou institutions différentes de lui et
bénéficiant, sous surveillance, d'une certaine autonomie de
gestion (BAKALJIKA Ntumbawishiye, 2010, pp.70-79)
La déconcentration est un mode de gestion de l'Etat
dans lequel les autorités du gouvernement central
délèguent aux autorités locales une fraction de l'exercice
de leur pouvoir, pour un certain nombre de matières précise.
Selon le principe de l'acte contraire, elles peuvent annuler
cette délégation à tout moment. Les entités
déconcentrées ne jouissent pas d'une personnalité
juridique propre ni d'aucune autre forme d'autonomie. Le contrôle qui
s'exerce sur leurs actes est hiérarchique.
La décentralisation est un mode de gestion de l'Etat
dans lequel la loi établit par avance et clairement les
compétences et les pouvoir réservés au gouvernement
central et aux entités décentralisées.
Il existe au niveau local des organes élus qui ont
parmi leurs attributions des fonctions législatives
règlementaires et de contrôle de l'organe exécutif local en
vue de faire participer la population à la gestion de la chose publique
au niveau local.
Les entités décentralisées jouissent
d'une personnalité juridique propre, mais aussi de diverses formes
d'autonomie (de gestion, budgétaire, en matière de ressources
humaines, etc.). Un contrôle de tutelle s'exerce sur les actes des
entités décentralisées. A la différence du
contrôle hiérarchique, le contrôle de tutelle doit respecter
des formes et des modalités particulières afin de
préserver l'autonomie des entités
décentralisées.
a. La décentralisation en RDC
La constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est
modifiée à ce jour, réalise plusieurs réformes
institutionnelles aussi profondes, importantes que complexes de l'Etat
congolais, en vue de mettre en place le nouvel ordre politique basé sur
les principes démocratiques affirmant notre détermination
à sauvegarder et à consolider l'indépendance et
l'unité nationale dans le respect de nos diversités et nos
particularités positives. La réforme de l'organisation
administrative et territoriale du pays est une des composantes des
réformes institutionnelles voulues par le constituant congolais.
b. Les objectifs de la
décentralisation
Les objectifs de la décentralisation en RDC, comme
partout en Afrique sont :
§ L'approfondissement de la démocratie ;
§ Le développement local ;
§ La lutte contre la pauvreté.
Le processus de décentralisation a
démarré et a connu des progrès significatifs
accompagnés par une volonté politique manifeste qui s'est
traduite par des acquis importants.
c. Les défis de la décentralisation
Les principaux défis pour la réussite de la
décentralisation en RDC sont les suivant : l'appropriation de la
décentralisation par les acteurs et la population ; le maintien de
la paix et de la sécurité ; la volonté
politique ; l'implication de tous ; l'existence d'une vision
commune ; la bonne gouvernance locale ; le financement de la
décentralisation ; le renforcement des capacités des
différents acteurs et mandataires ; l'organisations des
élections provinciales, urbaines, municipales, et locales (La
décentralisation en bref, idem).
La théorie de la décentralisation part du
principe que pour amorcer un développement local et participatif, il
faut accorder un certain pouvoir à des collectivités locales
reconnues par la constitution ou par la loi. La décentralisation et le
désengagement doivent, par des effets de synergie qui restent à
définir, permettre aux populations rurales d'assurer leur
développement, plus et de meilleure façon. Pour cet auteur, la
décentralisation apparait comme un effet direct d'une critique de l'Etat
au nom de la société civile et d'un renforcement des rapports
entre le monde urbain et le monde rural (Professeur VUNDUAWE Tepe Mako, 1982,
p.328).
Pour la Banque mondiale (2018), la décentralisation est
le transfert du sommet vers la base, certaines compétences de l'Etat au
profit des collectivités territoriales, des communautés locales
et du secteur privé dans le but d'améliorer les capacités
de fourniture de services en renforçant les capacités des
autorités, des communautés et groupes.
Bien plus, la décentralisation consiste à :
reconnaitre à l'intérieur de la collectivité nationale,
des collectivités plus restreintes ayant leurs intérêts
propres non contradictoires avec l'intérêt national, mais distinct
de celui-ci.
Pour assurer cette décentralisation, il faudrait donner
à ces collectivités des moyens juridiques, administratifs, et
financiers afin d'exprimer et de gérer leurs intérêts par
l'organe d'une représentation autonome, en respectant toutefois le cadre
d'un Etat unitaire (Loi organique n°08/16/ du 07 Octobre 2008).
Cette autonomie se caractérise par trois conditions
essentielles, ce qui toutefois, ne signifie point indépendance, à
savoir :
F L'autonomie matérielle :la structure
décentralisée jouit de la personnalité morale ; elle
dispose d'un patrimoine et d'affaires propres- qualifiées le plus
souvent d'affaires locales par opposition aux affaires nationales
gérées par l'Etat.
F L'autonomie organique : les affaires de la
structure décentralisée sont gérées par des organes
qui sont propres à cette structure décentralisée.
F L'autonomie fonctionnelle : la
structure décentralisée gère ses affaires plus ou moins
librement.
Selon Dennis A.RONDINELLI de l'Université du Wisconsin,
il y a quatre types majeurs de décentralisation(
https://fr.wikipedia.org/wiki/dennis) ;
une décentralisation administrative (déconcentration), une
décentralisation fonctionnelle (délégation), une
décentralisation politique (dévolution) et une
décentralisation structurelle (privatisation) ;(
https://fr.wikipedia.org).La
décentralisation économique ou décentralisation du
marché, affirme la Banque Mondiale, qui se présente sous la forme
la plus complète de décentralisation.
Du point de vue du gouvernement, elle se caractérise
par la privatisation et la dérégulation car elles
transfèrent les responsabilités des fonctions administratives du
secteur public au secteur privé. La privatisation et
dérégulation sont généralement, mais pas toujours,
accompagnées de libéralisation économique et de politiques
de développement du marché. Elles permettent que des fonctions
qui relevaient primordialement ou exclusivement du gouvernement soient
exercées par le secteur privé, les communautés, les
coopératives, les associations volontaires privées et d'autres
organisations non gouvernementales (
www.banquemondiale.org).
La décentralisation politique se base sur
l'hypothèse que les décisions prises avec une plus grande
participation des administrés sont bien fondées et
répondent mieux aux besoins des intérêts divers de la
société que celles prises uniquement par les autorités
politiques au niveau central (KATEMBUE Kabeya, 2011, pp39-40).
L'adoption de la politique de décentralisation
administrative en RDC est survenue sous forme de parachèvement du
processus de développement socioéconomique entrepris avec la
réforme administrative qui s'est concrétisée par la mise
en place des collectivités décentralisées,
consignée dans la loi sur la décentralisation (KANDU KAYEMBE
André, 2017, pp-109-120).
La décentralisation administrative c'est le transfert
de responsabilités de la planification, du financement et de la gestion
liée à certaines fonctions du gouvernement central et de ses
organes vers des unités d'administration sur le terrain, des cellules ou
niveaux sublimes de l'administration, des autorités publiques
semi-autonomes, des municipalités ou des régions (Idem, p.111)
Les principales conclusions de la section
précédente nous amènent à admettre l'idée
d'un développement situé dans l'espace. L'hypothèse
avancée est que les dynamiques d'évolution
différenciées qu'affichent les ETD sont expliquées par le
comportement des individus-acteurs. Le faisceau de relations qu'entretiennent
ces acteurs, les réseaux qu'ils mobilisent, le poids du temps long avec
ses implications en termes d'apprentissage collectif, importent dans l'analyse
des trajectoires des ETD.
En conséquence, l'ETD ne peut être
postulée : elle est le résultat de jeux d'acteurs en
relation les uns avec les autres.Processus collectif de création ou
d'innovation territoriale, le développement local tend à
fédérer des acteurs autour d'un projet commun. Il met en
évidence l'efficacité des relations entre les agents pour
valoriser les richesses dont ils disposent. Ces modalités de
coordination entre acteurs ne s'inscrivent pas nécessairement dans un
cadre marchand.
Comme souligné précédemment, les
dynamiques de développement local impliquent une conception
partagée par les acteurs des enjeux du territoire. L'idée
d'accord entre acteurs, énoncée comme condition nécessaire
à l'expression d'un projet, n'est pas sans poser de questions sur la
manière dont les intérêts individuels sont rendus
compatibles. La mise en cohérence des intérêts
privés ne relève pas, en effet, d'une harmonie spontanée
et l'expression des intérêts privés peuvent parfois
contrecarrer les logiques collectives.
L'analyse montre que celles-ci président aux relations
entre acteurs des systèmes de valeurs. Ces règles (entendues ici
au sens large) normalisent leurs comportements. Elles ne sont pas
nécessairement formalisées ; elles peuvent être
tacites.
Elles visent à concilier les intérêts
individuels en ce qu'elles font converger les anticipations et les
représentations des agents. De la capacité d'adhésion des
individus à ces systèmes de représentation
dépendent.En effet, la limitation de démarches individualistes et
le succès de l'action collective.
Ces règles partagées correspondent à un
ensemble des « institutions invisibles » (NORTH,
1990 ; DUPUY et TORRE, 1998, 2000), parmi lesquelles on peut mentionner
par exemple la confiance. Les rapports de confiance s'appuient sur les
engagements mutuels que prennent les agents les uns vis-à-vis des
autres. Ils facilitent leurs capacités d'anticipation (ils
éclairent les autres sur leurs intentions d'action) et régulent
leur liberté de conduite et d'action.
Favorisant une meilleure compréhension entre les
agents, encourageant la transparence et la circulation d'informations, ces
liens de confiance facilitent la coopération. Ils permettent, en outre,
de déboucher sur des régularités de comportement et
préviennent les défections ou les comportements opportunistes. La
confiance permet aux agents de forger leur espace de rapports. Elle contribue
à stabiliser ou à renforcer les liens entre les agents en
favorisant le développement de signes leur permettant de limiter les
problèmes d'asymétrie d'information et d'incertitude.
La confiance, présentée alors comme un
« lubrifiant des relations sociales » (ARROW, 1974), rend
possible la répétition des actes de coopération et
devient, ce faisant, une modalité de coordination entre acteurs. La
fréquence des interactions entretient les conditions de mise en accord
des acteurs du territoire sur la nature et l'orientation du projet qu'ils
entendent mettre en oeuvre.
Les habitudes de coopération favorisent l'adoption par
les acteurs de positions consensuelles. Ils parviennent, par ce biais, à
contrer plus efficacement la survenue des problèmes et à
s'accorder sur les priorités. Elles rendent compte de la capacité
des agents à reconnaître des enjeux communs et à se les
approprier. Ainsi, les institutions invisibles favorisent
l'établissement de liens entre acteurs, amplifient les dynamiques de
coopération et limitent les dissensions.
Le constat que la qualité des partenariats locaux
conditionne la capacité des agents à s'entendre et à
s'organiser pour atteindre des objectifs de long terme, souligne l'importance
des coordinations locales dans le développement. A l'issue de ce qui
précède, nous concevons que ces dynamiques sociales contribuent
à une meilleure circulation de l'information et renforcent l'action
collective.
2.2.SECTION 2 : THEORIE DU
MECANISME D'ENGAGEMENT CITOYEN
2.2.1. Origine
Pour certains, l'engagement citoyen ne peut être qu'un
engagement de contestation, de remise en question de l'ordre établi, de
revendication. De ce point de vue, engagement citoyen et militantisme vont de
pair.
Pour d'autres, l'engagement citoyen signifie un engagement
vis-à-vis d'autrui et de la collectivité, créateur d'un
espace public et de lien social. L'engagement citoyen englobe alors le
militantisme mais est conçu d'une manière plus large et peut
prendre différentes formes, il peut se vivre dans un contrat de travail
comme dans la participation à des manifestations, dans la signature de
pétition ou dans des actes d'achat raisonnés (par exemple achat
de produits écologiques ou boycott de produits provenant de certains
pays, etc.).
L'activité citoyenne se définit essentiellement
par son intention : au-delà d'un cercle familial ou amical,
contribuer au bien-être d'autres individus ou de la collectivité
dans son ensemble. Elle ressort d'une dynamique de la société
civile, qui n'est ni commerciale, ni partisane. Elle ne vise pas
essentiellement un profit financier ou un intérêt particulier.En
ce sens, elle est gratuite.
Bref, l'activité citoyenne répond
essentiellement à une éthique de la participation. Peu importe
qu'elle soit bénévole, défrayée ou indirectement
rémunérée dans le cadre d'un emploi.Nous adopterons dans
cette étude la définition large d'engagement citoyen (engagement
vis-à-vis d'autrui et de la collectivité en dehors du cercle
familial et amical) et nous nous centrerons plus spécifiquement sur
l'engagement citoyen volontaire au sein des organisations locales (OSC).
Le terme engagement volontaire suppose un engagement qui se
déroule en dehors d'un contrat de travail et n'est pas soumis à
une contrainte externe (liée par exemple à une
« activation » quelconque ou à un travail
d'intérêt public dans le cadre d'une peine de substitution).Sur
base des différentes typologies existantes, nous proposons de
dégager trois grandes catégories des motivations à
l'engagement volontaire dans les organisations :
F Les motivations morales et
idéologiques : volonté de défendre des valeurs,
un projet de société, d'être acteur dans la sphère
publique, de défendre un projet local etc.
F Les motivations altruistes : Envie d'aider d'autres
personnes,d'être utilesocialement.
F Les motivations instrumentales : qui sont de deux
ordres :
- Affectives : envie de se faire des amis, de
sortir de sa solitude, de se voir reconnu, besoin d'améliorer son estime
de soi,
- Utilitaristes :entretenir ou acquérir des
compétences et des connaissances, se faire des relations utiles
socialement ou professionnellement, enrichir son CV, acquérir de la
notoriété...
Différentes motivations peuvent être
présentes chez un même individu au moment de son engagement et ses
motivations peuvent évoluer au fil du temps.
A toute fin utile, nous concentrons sur les deux
premières catégories de motivations à l'engagement citoyen
participatif sans pour cela ignorer l'existence et l'importance des motivations
présidant à un engagement associatif (ANNE-MARIE DIEU,2002,
p.87).
2.2.2. Genèse de la
construction du sens moral chez l'être humain dans L'engagement citoyen
volontaire
L'engagement citoyen volontaire est le fait de personnes qui
s'engagent en fonction de valeurs et d'impératifs moraux.
a. Le lien entre les émotions et le sens
moral
Dans son livre « passions
withinreasons », R.H. Franck analyse une série d'actes
dans lesquels des individus risquent leur réputation, des pertes
matérielles voire leur vie pour autrui. Ou encore des situations
où des individus posent des actes alors qu'ils n'en tirent aucun profit
(comme aider une personne que l'on est certain de ne jamais revoir par la
suite, ou donner un pourboire dans un restaurant où on ne reviendra
jamais, etc.). C'est ce qu'il appelle le commitment problem.
A l'issue de son analyse, il arrive à la conclusion
que la survie en société nécessite que les êtres
humains éprouvent des passions et des émotions menant à
des actes qui ne vont pas dans le sens de la recherche d'un profit
immédiat.
Pour cet auteur, une partie des attitudes
désintéressées reposent sur un ensemble d'émotions
innées, dont la compassion. Il se réfère notamment aux
études menées par J.KAGAN sur les étapes de l'agir moral
chez l'enfant.Les travaux de Kagan portant sur des psychopathes adultes
démontrent d'émotions également que des compétences
émotionnelles et comportements moraux vont de pairs :
l'échec à développer les premières obères le
développement des seconds. L'absence d'émotions et l'absence de
sens moral seraient donc liées.
On peut en effet, comprendre que si je ne ressens aucune
tristesse ou compassion devant une personne qui souffre, je peux être
amené à ne pas considérer que faire souffrir quelqu'un est
un acte répréhensible. Ce qui ne signifie pas pour autant que je
ne connaisse pas les interdits sociaux mais bien que je ne les aie pas
intégrés comme significatifs pour moi.
Il y aurait donc chez la plupart des « petits
humains » un substrat émotionnel commun qui les
prédisposerait à une certaine empathie avec autrui,
prédisposition qui sont par la suite encouragées ou non par
l'environnement familial, éducatif et social. Ces prédispositions
peuvent aussi être orientées vers des groupes particuliers mais
pas vers un « autre » généralisé.
b. Le lien entre le développement cognitif et
le sens moral
Piaget a pour sa part étudié les liens entre le
développement cognitif et le développement moral. Il montre que
le sens moral se développe en même temps que la capacité de
se mettre à la place d'autrui (c'est ce qu'il appelle le
phénomène de décentration).
Un autre phénomène important également
pour le développement du sens moral est la capacité, qui apparait
chez les enfants aux alentours de 10 ans environ, à faire la
différence entre intentions et actions c'est à partir de ce
moment qu'ils vont avoir tendance à juger les comportements plus en
fonction des intentions présidant à l'action qu'en fonction des
résultats provoqués par cette action( ce n'est pas d'avoir
cassé le jouet d'un autre qui est le plus grave, mais de l'avoir fait
volontairement)(PIAGET, 1969, p.259)
Un autre auteur comme Piaget insiste sur l'aspect rationnel et
cognitif de l'activité morale alors que Franc met plus en avant l'aspect
émotif de cette activité. D'autres auteurs en lient intimement
les deux facettes. H. PARRET par exemple défend la conception selon
laquelle « le raisonnement même est affectif, et la
rationalité nécessairement émotive » (PARRET,
H., 1986, p.186)
Si on considère que la raison et l'émotion sont
à ce point liées, il est concevable que l'activité morale
(le fait de poser des jugements moraux ou d'orienter son comportement en
fonction de règles morales) repose à la fois su des
compétences cognitives et compétences affectives.
c. Sympathie et altruisme
Selon L.Boltanski(1993), la conception de la sympathie chez
Adam SMITH propose une piste intéressante pour comprendre les attitudes
altruistes. La sympathie est, pour Adam Smith, la faculté naturelle que
l'homme a de connaitre la souffrance d'autrui et d'y porter
intérêt. C'est par sa capacité imaginative que l'homme peut
se représenter la souffrance d'autrui.
Cela ne veut dire qu'il se glisse totalement dans la peau de
l'autre mais plutôt qu'il est capable d'imaginer ce que l'autre ressent
et d'en avoir de la compassion. C'est en cela que « la
médiation de l'imaginaire est importante parce qu'elle soutient
l'édifice moral et sociétal sans recourir à
l'identification communautaire ou à la fusion
édénique » (L.BOLTANSKI, 1993, p.63).
C'est par cette capacité imaginative que nous pouvons
nous sentir solidaires de personnes qui partagent d'autres conditions de vie
que les nôtres ou qui ne nous ressemblent pas. Mais, le sociologue
souligne bien le caractère acquis de ces capacités
imaginatives : elles doivent être développées et
nourries, soit grâce à nos propres expériences de la
souffrance, soit grâce à des oeuvres de fictions dans lesquelles
les sentiments et les états d'âme des personnes souffrantes ou des
personnes témoins de souffrance sont décrits.
L.BOLTANSKI, en partant des analyses d'Adam SMITH, aboutit
à l'idée qu'il existe des sensibilités communes face
à des spectacles des souffrances. C'est sur base de ces
sensibilités que vont s'élaborer les réactions altruistes
qui dans un deuxième temps vont être justifiées par des
principes moraux et éthiques. On rejoint ici, les auteurs faisant le
lien entre émotions, capacités cognitives (ici imaginatives) et
principes moraux.
2.2.3. Objectif de l'engagement
citoyen
S'engager en tant que citoyen indique que l'on entreprend une
action qui vise le politique puisque la citoyenneté nous interpelle
comme membre d'une démocratie. Or, une démocratie vivante demande
que ses citoyens s'investissent dans ses diverses instances et adoptent une
posture qui incarne l'idéal démocratique. L'engagement devient
donc une condition essentielle de la vie collective. Nous verrons qu'en
fonction des différentes sphères d'activités des citoyens,
certaines formes d'engagement disposent à une mobilisation allant des
intérêts personnels vers des intérêts publics et ici
se situe le coeur du sujet.
Depuis bien longtemps, on a constaté que la
société civile joue un rôle très important dans le
monde. Elle a contribué à l'avancement de la démocratie
dans beaucoup de pays et la construction d'un cadre de vie où toutes les
valeurs sociales se rencontrent.
Elle est généralement constituée des
personnalités mais surtout des associations professionnelles, des
syndicats, de confessions religieuses, des organisations non gouvernementales
de développement ou de défense de droits humains, des
associations socioculturelles, des associations savantes, des groupes de
pression comme les étudiants, des mouvements citoyens et de jeunes,
etc.Elle n'exerce pas un pouvoir ni une opposition politique mais joue un
rôle de lampe-témoin, de gardienne des valeurs, d'éveille
de conscience et de catalyseur sociale de développement.
Elle est toujours vigilante et défend les
intérêts de la population dans tous les secteurs de la vie face au
pouvoir politique ou économique mais elle peut aussi appuyer les actions
d'un gouvernement lorsque celle-ci sont positives (LOHOHOLA OSOMBA, P., 2003,
pp.59-60).
En effet, Katoka, comme l'une de cinq communes de la ville de
Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central connait les
activités d'engagement citoyen soutenues par les organisations non
gouvernementales qui viennent en appui aux organisations de la
société.
Appuyées par DAI et tant d'autres ONGD et ONGDH, elles
forment la population au travers des ateliers, les fora, la sensibilisation
à connaitre leurs droits et obligations, à les défendre et
à demander des comptes aux autorités publiques pour exiger la
bonne gouvernance. Elles forment un cadre de concertation dirigé par
l'un d'eux, pour analyser la situation de la population, soumettre des
propositions à l'autorité politique au travers le plaidoyer, le
lobbying afin que les autorités se sentent redevables vis-à-vis
de la population.
2.2.4. Conséquence du
mécanisme d'engagement citoyen
Au-delà du vote comme exercice d'expression citoyenne,
il existe un large éventail de possibilités pour que chacun
s'investisse dans la vie collective (bénévolat, actions communes
ponctuelles, etc...). L'engagement peut se traduire par des petits gestes du
quotidien pour faciliter ou améliorer la vie de ses voisins ou, encore,
venir en aide aux personnes en difficultés. Il peut être aussi
plus structuré via l'intégration d'une structure associative.
Par ailleurs, le militantisme correspond également
à une forme d'engagement citoyen dans le sens où il répond
à un désir de participation locale dans le but de favoriser un
point de vue particulier sur la façon de mieux vivre ensemble.
2.2.5. Avantages du MEC
Le mécanisme d'engagement citoyen a pour avantage de
créer un cadre de la bonne gouvernance et la capacité locale
nécessaire pour améliorer les conditions socio-économiques
de la communauté. L'évolution de la société
complexifie la notion d'engagement citoyen et invite à
reconsidérer des actions plus informelles comme de véritables
investissements en faveur d'une communauté.
Traditionnellement, nous connaissons des formats de
l'engagement sur la base de statuts particuliers : le bénévolat,
le volontariat, le salariat dans une association et le service civique.
Cependant, l'engagement ne se réduit pas à un statut. Il est bien
plus complexe à appréhender.
En effet, certaines actions citoyennes sont plus ou moins
visibles, plus ou moins valorisées. Elles ne sont pas toutes palpables
ou mesurables par des actions concrètes. De même, les formes
d'engagement deviennent moins structurées pour passer à un choix
«à la carte» à partir duquel les citoyens s'engagent
sur une demi-journée ou une journée sur une action
spécifique. La participation locale peut passer par des choses simples
et accessibles comme le fait de s'informer et de se former ou encore d'avoir un
comportement civique.
Du côté des entreprises, certaines mettent en
place une gouvernance plus partagée ou cherchent à avoir un
impact social et solidaire sur la société. Enfin, l'engagement
militant fait aussi partie de la participation locale. Militer,
débattre, réfléchir et se présenter à des
élections sont autant d'actions qui découlent d'un engagement
pour autrui. Par exemple, l'association Démocratie Ouverte a
élaboré un schéma qui résume clairement les
différents moyens au travers desquels un citoyen peut devenir acteur de
son territoire.
2.2.6. Inconvénients du
MEC
Dans certaines circonstances, une stratégie de
développement peut revêtir une certaine ambivalence. Elle
revêt un côté positif et négatif. Cela permet
à l'acteur de prendre de précautions nécessaires pour
minimiser les conséquences négatives.
Il en est de même du MEC qui exigent beaucoup de
prudences de la part des acteurs. Selon le Chef des Travaux IVUDI Crispin,
étant un couteau à double tranchant, le MEC peut conduire
à la violence, la répression, de part et d'autre, la
radicalisation, l'abandon, le découragement, surtout quand il s'agit des
intérêts des parties en présence, en occurrence du
plaidoyer, lobbying.
Le champ d'application des MEC, est très restreint
surtout dans les pays à régime autoritaire, socialiste voire
communiste où les libertés fondamentales sont très
limitées. La mauvaise utilisation du MEC peut conduire à des
velléités subversives, à la dérive et
déviance.
2.2.7. Mise en pratique du MEC
dans la communauté
Les mécanismes d'engagement citoyen exigent beaucoup de
patience, la persévérance, la détermination,
l'abnégation, l'esprit de créativité et de partenariat, la
constance et un leadership transformationnel. Il faut être suffisamment
outillé pour convaincre ses interlocuteurs et avoir également une
capacité de mobiliser et fédérer les acteurs. C'est ici,
où les séances des formations, de remise à niveau et de
sensibilisation des communautés valent leur pesant d'or, a
martelé BULABULAMVULA Guy, expert en Engagement Citoyen de DAI au
programme gouvernance intégrée, PGI en sigle.
Il est de toute notoriété scientifique que pour
qu'une communauté se développe, ses membres, encore moins, toutes
les composantes arrivent impérieusement à prendre conscience de
la précarité de leurs conditions d'existence par un diagnostic
référentiel objectif, afin d'aspirer au changement par une
décision éclairée et responsable pour inverser les
tendances en s'engageant dans la recherche des solutions aux problèmes
de développement qui sont les leurs. Cette détermination est
suscitée par une prise de conscience éclairée qui
amène à l'appropriation des actions de changement.
2.2.7.1. Engagement
L'engagement constitue une étape très importante
dans le processus de changement social. Il est la résultante d'une
conviction personnelle qui incite un individu ou groupe d'individus à
prendre une décision ferme de se lancer dans une action. C'est un
état d'esprit qui amène à une prise de conscience
conduisant à une volonté éprouvée de changement.
Cette détermination engendre la participation active. L'engagement
devient donc une condition essentielle de la vie collective.
L'engagement des citoyens repose sur la conviction que les
gens doivent et veulent participer aux décisions qui touchent leur vie.
En termes simples, les citoyens sont « engagés » lorsqu'ils
jouent un rôle actif dans la définition des enjeux, l'examen des
solutions possibles et la détermination des ressources ou des
priorités où orienter l'action.
2.2.7.2. La participation
La notion de participation peut être définie
comme le fait de partager quelque chose avec d'autres. Ce « quelque chose
» peut être un objet, une activité, un pouvoir.
Ainsi, la participation des populations locales à un
projet de développement signifie leur engagement dans le processus de
prises des décisions qui s'y rattachent. On peut distinguer
différents types de participation selon les mécanismes qui leur
font prendre corps. En se basant sur des facteurs tels que la motivation des
individus et les modes de mobilisation, MEISTER (1977) a élaboré
une typologie de participation qui est demeurée un classique.
Il existe cinq types de participation :
1. La participation de fait, fondée
sur la tradition qui regroupe des personnes ayant certains buts en commun, par
exemple les groupes d'âge ou de métier. Le recrutement des membres
n'est donc pas volontaire, mais de fait. La participation dans ce cas a pour
fonction de renforcer les traditions.
2. La participation volontaire se
déclenche sans l'aide d'une animation quelconque lorsque des personnes
partageant certains intérêts décident de se grouper en
syndicat, en coopérative ou en parti politique pour défendre
leurs intérêts. Le recrutement se fait de façon volontaire
et la participation a pour fonction sociale de satisfaire les besoins nouveaux
de la collectivité et de faciliter l'adaptation des membres de celle-ci
aux changements sociaux.
3. La participation spontanée renvoie
à une participation entièrement volontaire et sa
spontanéité tient au fait que les circonstances d'habitat
(voisinage) ou d'affinité quelconque (cliques) ont mis des gens
ensemble. Le recrutement se fait spontanément et la participation
répond à des besoins d'ordre affectif et psychologique.
4. La participation provoquée est
suscitée par des animateurs pour encourager des comportements
jugés nécessaires pour une meilleure adaptation au changement
social. Le recrutement est donc provoqué par la sensibilisation pour
remplir une fonction d'adaptation.
5. La participation imposée est
provoquée selon des normes établies par des animateurs
extérieurs au groupe, comme dans le cas des règles
imposées pour la distribution de l'eau d'irrigation. L'engagement est
obligatoire puisqu'il est nécessaire au fonctionnement d'un programme ou
d'un projet.La « participation véritable » peut avoir lieu
à différents stades de la préparation, de la planification
et de la mise en oeuvre d'un projet, mais la clé de l'EC consiste
à écouter les citoyens et à utiliser leurs idées
efficacement (YAO ASSOGBA, 2008, p.34).
Selon le Chef de travaux KAPINGA MUAMBA Sophie dans son cours
de Développement Communautaire I, qui dit « Participation »
sous-entend participer au pouvoir. C'est l'accès réel des hommes
aux décisions qui les affectent qu'ils considèrent comme
importantes.
Favorisant le travail en synergie, la participation met les
acteurs en confiance, permet l'appropriation des actions à mener par
toutes les parties prenantes, responsables les participants, favorise la bonne
gestion des activités par les acteurs concernés. Elle favorise
l'esprit d'initiative, la prise des décisions concertées et la
cohésion des membres de groupe qui par conséquent, deviennent
responsables.Il y a participation lorsque tous les groupes
d'intérêt au sein de la communauté sont consultés
avant de prendre une décision. On tient compte de tout un chacun pour
l'exécution de la décision « principe de self help
». La participation conduit à : la responsabilisation,
l'appropriation (Wonership), la bonne gestion des activités, l'esprit
d'initiative, la prise de décision (Yao ASSOGBA, op.cit.).
2.2.7.3. Le Contrôle
citoyen
C'est une voix par laquelle les politiques accordent
l'occasion à la population pour s'exprimer.Le contrôle citoyen se
fait toujours pour l'action publique, c'est pourquoi nous parlons du
contrôle citoyen de l'action publique (CCAP), en sigle, renvoie au
processus qui vise à renforcer la performance des collectivités
locales à travers un engagement civique et une participation active des
citoyens afin d'instaurer une culture de la transparence, de la Confiance, de
l'inclusion et d'amener les élus et les organes de gestion des
entités à améliorer leur travail. Il est autrement compris
comme outil qui aide le pouvoir à changer la façon de
gérer.
« Le Contrôle Citoyen de l'Action Publique (CCAP)
est le fait de pouvoir demander aux représentants officiels, aux
employeurs privés et aux fournisseurs de services de rendre des comptes,
ce qui implique qu'ils doivent répondre de leurs politiques, de leurs
actions et de l'utilisation des fonds ».
Les sociétés ont une échelle de valeurs,
un système lié à des normes sociales, c'est-à-dire
à des règles de conduite dont notamment les manières
d'agir. Mais généralement, il existe un écart entre
valeurs, normes sociales, et les actes quotidiens, d'où la
nécessité d'un contrôle social pour assurer le respect des
droits et devoirs des citoyens.
Le contrôle Citoyen est un ensemble de moyens et
pratiques, formels ou informels, mis en oeuvre au sein d'une
société ou d'un groupe social, afin que ses membres agissent
conformément aux règles ou aux modèles en vigueur dans le
but de garantir l'ordre social et un bon fonctionnement de la
société. Ledit fonctionnement dépend également de
la gestion des ressources de cette société.
Donc afin de s'assurer cette bonne gestion, Il est
indispensable que les notions telles que la recevabilité, la
transparence et l'intégrité soient le gouvernail des responsables
à divers niveaux. En effet, à cette ère de
démocratie, les exigences des citoyens évoluent à grands
pas.
Au-delà des votes périodiques, la tendance est
à un engagement réel et une participation des populations
à la formulation, la mise en oeuvre et au suivi-évaluation des
politiques. Les acteurs de développement, à tous les niveaux, ont
le devoir de rendre compte et les citoyens celui de contribuer et d'exiger. Ce
contrôle réunit des éléments clés (SEG TAABA,
2017, pp-37-38).
2.2.7.4. Les
éléments clés du CCAP
La transparence et l'accès équitable à
l'information constituent des éléments clés du CCAP. La
mise en place d'un système participatif efficient nécessite
cependant au moins trois conditions :
· Le contexte institutionnel global (voire
constitutionnel) doit être favorable à une concrète
expression des principes qui sous-tendent la participation. (Ici, la
qualité de décentralisation offerte dans le pays est
décisive).
· Les structures qui promeuvent la participation
citoyenne doivent disposer de procédures et mécanismes internes
qui permettent aux citoyens d'avoir une influence réelle sur les
décisions prises.
· Les citoyens doivent disposer des aptitudes et
capacités nécessaires pour influencer les décisions qui
les concernent directement.
Pour ce faire il y a une démarche à suivre pour
exécuter le contrôle citoyen de l'action publique. Cette
démarche d'exécution pour un CCAP efficace, peut être
déclinée en les points clés ci-après :
· Déterminer un point d'entrée (une
question ou un problème pertinent) et se mobiliser autour.
· Obtenir les informations relatives au point
d'entrée.
· La collecte d'information peut passer par l'observation
directe, la collecte des documents officiels (Plan de travail, rapports, etc.),
les entretiens individualisés, avec des groupes témoins de
citoyens sur les réalisations, les visites de terrain, avec prise de
photos, l'exploitation des médias (radios, TV, journaux), l'exploitation
des sites Internet, la mise à contribution des réseaux sociaux,
les documentaires filmés, les rapports alternatifs, le budget
participatif, les enquêtes et les sondages, etc.
· Analyser les informations recueillies.
· Diffuser ces informations.
· Mobiliser des énergies : Susciter
l'intérêt et établir des coalitions et partenariats avec
divers groupes concernés pour se faire entendre.
· Négocier le changement : Susciter une
réaction de la part des élus ou responsables concernés
pour plus de transparence et l'atteinte des résultats escomptés.
D'où sa concrétisation doit se réaliser avec les
acteurs.
2.2.7.5. Les acteurs et les
champs du CCAP
Le CCAP peut être mené par les réseaux ou
organisations de la société civile, les associations de base dans
les collectivités décentralisées, les médias, ou
les citoyens. Aussi, une synergie d'actions reste cependant très
importante pour réussir un CCAP. Car, les citoyens peuvent
contrôler l'action publique à divers niveaux (de la base au sommet
de la hiérarchie sociale). Le CCAP peut porter sur une multitude de
questions (politiques, gouvernementales, conduite de politique, dépenses
publiques, prestation de service, etc.), ou reposer sur diverses
stratégies (recherche, suivi, planification participative,
défense et promotion des droits, éducation, etc.). Ci-dessous
quelques exemples de champs d'investigation :
1. Exécutif : Ministère
sectorielle (lenteur administrative, rançonnement des usagers,
présence au poste, rendement des services, qualité des services
fournis, élaboration, exécution, et contrôle du budget,
délégation de compétences aux collectivités...),
Collectivités décentralisées (fonctionnement des organes,
fonctionnement de l'administration locale, mise en oeuvre et respect des plans
de travail, finances locales, maitrise d'ouvrage, civisme fiscal...)
2. Législatif : contrôle de
l'action gouvernementale, contrôle parlementaire, vote des lois, le
respect de la volonté des citoyens.
3. Judiciaire : fonctionnement des tribunaux,
exécution des décisions de justice, existence ou non des abus
4. Privé : Service fourni à
l'administration publique ou à la population (qualité des biens
et services fournis, délai d'exécution et respect des contrats,
degré de partenariat, coût des produits, effet sur la
santé...)
Avec la promotion à l'échelle mondiale de la
gouvernance participative et des données ouvertes, le contexte semble
désormais propice pour un CCAP par une société civile
plurielle qui peut compter sur une presse de plus en plus libre. Le
contrôle citoyen de l'action publique est un outil d'aide à la
gouvernance.
Tout dirigeant ou responsable soucieux d'un
développement durable, devrait contribuer à sa promotion afin de
bénéficier des compétences et observations des citoyens
qui, ici, jouent beaucoup plus un rôle de partenaires que de gendarmes.
Gouverner, c'est planifier et (ré) ajuster en vue d'un meilleur
résultat. Le CCAP est un moyen d'avoir un « feedback social »
afin de réussir la gouvernance, au service de la population dans tout
Etat démocratique.
La synergie Etat-Société civile, résultat
d'un CCAP efficace, restaure une image positive des institutions
étatiques, une gouvernance plus efficace et une meilleure mobilisation
citoyenne autour de l'Etat dans toutes ses dimensions (SEG TAABA, 2017,
idem).
2.2.7.6. La
redevabilité
Elle est définie comme l'obligation de rendre compte.
Elle relève d'une responsabilité quelconque qu'un individu peut
avoir ou une sorte de contrat entre une Institution et une communauté,
soit entre deux personnes qui se solde par une sanction positive ou
négative. C'est aussi considéré comme comportement
à promouvoir pour un développement harmonieux au sein des
communautés.
2.2.7.7. La
démocratie
Selon Abraham LINCOLN, c'est le pouvoir du peuple par le
peuple et pour le peuple. La démocratie telle que nous la concevons,
puise ses origines dans la cité-État athénienne du
Vème siècle avant notre ère.
L'étymologie du terme lui-même est d'origine grecque Demos (le
peuple), Kratos (le pouvoir). A l'origine, cela ne renvoie pas seulement au
pouvoir du peuple à décider de ses lois sans intervention
extérieure, mais vise principalement à donner aux individus les
capacités et opportunités de se diriger eux-mêmes, d'avoir
un contrôle sur leur destinée.
1. La démocratie en 2 dimensions : politique
et sociale
D'une part, au niveau politique, la démocratie peut
être comprise comme une procédure de décision collective
caractérisée par un certain type d'égalité entre
les membres d'une société. Cette égalité est bien
exprimée par la maxime « Un citoyen, un vote ». Bien que cette
procédure puisse varier (par le vote direct, l'élection de
représentant, un référendum), elle implique
essentiellement que : les décisions concernant l'ensemble de la
société doivent être légitimées par
l'ensemble de la population ; à La garantie que chacun puisse
s'exprimer selon ses convictions personnelles,
D'autre part, au niveau social, la démocratie n'est
pas qu'une procédure électorale. Elle doit aussi être
comprise comme une forme ou structure sociale qui repose sur des relations de
respect, de liberté et d'égalité entre les membres d'une
société. Autrement dit, une société
démocratique est une société où tous les individus
se reconnaissent mutuellement comme libres et égaux. Elle implique que
non seulement les lois et les institutions traitent tous les individus avec un
égal respect, mais que les citoyens se conçoivent eux-mêmes
et conçoivent leurs concitoyens comme des égaux.
Ce nouveau type de relations sociales s'oppose directement aux
hiérarchies traditionnelles ou religieuses qui accordent à
certains groupes de la société des privilèges
héréditaires ou sociaux. La démocratie en tant que forme
sociale suppose donc une attitude qui s'impose dans nos interactions avec nos
semblables formant ainsi une autre manière de vivre ensemble (V. Vertus
civiques). Bien entendu, ces deux dimensions de la démocratie, politique
et sociale, sont complémentaires. C'est parce que nous nous
considérons mutuellement comme libres et égaux que tous peuvent
participer aux décisions collectives.
De même, le fait de prendre des décisions de
manière démocratique stimule le sentiment d'égalité
entre les individus par le biais de la participation, mais aussi par les lois
et droits qui sont le résultat de ces procédures de
décisions. Il existe donc une vie démocratique qui façonne
autant les institutions collectives que nos manières d'interagir les uns
avec les autres et même notre identité personnelle (LINDA C. et JP
MARCAL, 2011 p.46).
2.2.8.Résultats du MEC
dans la communauté
De plus, la montée des dispositifs institutionnels de
participation locale renouvelle les modes d'engagement et donne à voir
un écosystème plus complexe. L'impulsion de démarches
participatives par les collectivités territoriales offre une nouvelle
possibilité aux habitants de s'engager. Plus encore, elle
représente une opportunité pour les citoyens de prendre part aux
affaires de leur territoire. La multiplication des budgets participatifs
symbolise cette volonté des collectivités territoriales
d'accompagner les initiatives citoyennes et d'encourager la participation
locale.
En effet, les habitants d'une collectivité territoriale
- et, dans la majorité des cas, sans distinction d'âge ou de
nationalité - peuvent soumettre un à plusieurs projets au service
de l'intérêt général au vote des citoyens afin
qu'ils soient financés.Les instances institutionnelles de participation
locale peinent à affirmer leur existence et à trouver des
volontaires. Pourtant, nombreux sont les citoyens engagés et ceux qui
demandent à être davantage intégrés dans
l'élaboration des décisions publiques. Or, ce serait une erreur
de considérer le développement des démarches
participatives locales en dehors du foisonnement des initiatives citoyennes
locales.
Au contraire, la valorisation des gestes civiques du quotidien
et de l'engagement citoyen peut se révéler être des leviers
de la participation citoyenne sur des dispositifs institutionnels. L'engagement
citoyen, sous ses diverses formes, est créateur de lien social. Les
actions collectives, petites ou grandes, favorisent une mise en commun des
ressources, la confrontation de points de vue et la considération
d'enjeux collectifs. Tout cela contribue à un renforcement du sentiment
d'appartenance à une communauté et un territoire. Il devient
alors un premier vecteur de mobilisation citoyenne autour des enjeux de la
localité.
Le résultat du mécanisme d'engagement citoyen
dans la communauté, c'est le changement social,
révélé par le changement de mentalité et
d'attitude. Grace aux informations et à la formation les populations
deviennent capables de comparer et d'imiter ce que font les autres sous
d'autres cieux et prennent des initiatives. Les actions de développement
doivent correspondre aux types de besoins et aux types de problèmes que
les communautés rencontrent. Les communautés seront capables de
participer, s'auto prendre en charge et de demander de comptes aux dirigeants
(KABUE MBALA Simon, idem).
2.3.SECTION 3 : LES PILIERS
DU DEVELOPPEMENT LOCAL
Le développement local est un concept bien
documenté et bien connu à travers le monde et ses actions
impliquent l'amélioration du niveau, du cadre et du milieu de vie d'une
communauté donnée par une intégration harmonieuse des
actions entre différents secteurs d'activités. Il propose une
approche globale, intégrée, communautaire et horizontale du
développement des collectivités.
Le développement local est un processus par lequel une
communauté devient le moteur de changement de son milieu, en vue
d'améliorer ses conditions de vie. Il repose sur deux grands piliers :
la gouvernance locale et le développement socio-économique. Le
développement se doit d'être démocratique,
équitable, respectueux de l'environnement, des droits humains, des
femmes et des minorités.
a. La gouvernance locale
Nous pouvons dire que la gouvernance est la manière ou
la façon de gouverner, de diriger ou de gérer un pays, une
province, une entité locale ou une collectivité locale, une
communauté et d'administrer les hommes et leurs biens ainsi que la
manière de gérer les ressources propres.
La gouvernance s'applique aussi aux entreprises comme aux
organismes et aux organisations non gouvernementales ainsi qu'aux associations
qui interviennent avec leurs règles et leurs objectifs dans la gestion
de la chose publique.Tandis que la bonne gouvernance est le fait de bien mener
la gouvernance. C'est une gestion qui respecte les normes et les règles
de jeux, les principes de management et les valeurs d'éthique en vue du
développement de la société de mieux être de la
population.
La bonne gouvernance a des exigences qu'il faut respecter,
c'est-à-dire les compétences, l'expertise, la
compétitivité, un environnement propice au business et
éthique professionnelle appropriée pour le développement
de l'entreprise ou de l'entité.Les critères ci-après sont
obligatoires dans l'observation de la bonne gouvernance. Il s'agit de :
· La participation ;
· L'efficacité et l'efficience ;
· La primauté du droit ;
· La transparence des procédures ;
· L'obligation de rendre compte ;
· La compétitivité ;
· La prospective, c'est-à-dire la capacité
d'anticiper les évènements et de résoudre les
problèmes relatifs à l'évolution de ces
évènements (management des événements) (NGINDU
Kalala, 2016, p.42).
Si la participation n'est que l'un de ces piliers, il est
clair que plus on implique les citoyens et les différents acteurs dans
les processus de décision, plus il y a des chances qu'ils suivent dans
la mise en oeuvre. Il doit donc y avoir un mécanisme de consultation
avant la prise de décision mais aussi après la décision
pour le suivi. Le but est d'utiliser les ressources du territoire de
manière optimale, dans le respect du droit, et qu'à la fin, les
citoyens soient satisfaits des services délivrés.
Nous faisons face au défi de la bonne gouvernance
partout dans le monde. Même dans les endroits où les
procédés démocratiques sont formellement appliqués,
il est clair que la corruption ou les intérêts des politiciens,
des bureaucrates, des hommes d'affaire, des groupes religieux ou ethniques et
les rivalités entre les partis politiques détournent souvent le
système.La bonne gouvernance est l'un de principes majeurs du
développement communautaire.Mot valise, le lexème «
gouvernance » est en pleine effervescence depuis son apparition. C'est un
concept qui prône la transversalité plutôt que la
verticalité, des actions endogènes plutôt
qu'exogènes, la pluralité plutôt que l'individualisme, les
arrangements plutôt que les conflits, le partage plutôt que le
monopole, etc.
Bref, c'est un concept qui a le mérite de nourrir les
réflexions sur la « manière de conduire » les «
affaires de l'Etat » (JESSOP, 1998). Expression utilisée en
français au X ième S., à la fois
appréhendée comme activité, processus et procédure,
la gouvernance est aussi « une manière de voir, un cadre d 'analyse
et un langage de définition et de solution aux problèmes, un
appareil d'examen clinique pour remonter à la source de la mauvaise
performance, et un outillage mental pour le désigner organisationnel et
l'architecte social » (PAQUET, 2010, p. 6).
Sur le plan étymologique, le mot « gouvernance
» a la même origine que le mot « gouvernement »,
c'est-à-dire le mot grec "kubernân" et le mot latin
"goubernare", deux termes qui signifient « diriger le navire
». Ce sont en fait les historiens anglo-saxons qui évoquaient
"the governance " pour désigner le « partage du pouvoir
» entre les différents corps constitutifs de la
société médiévale anglaise (SOLAGRAL, 1997).
Par la suite, le mot est tombé dans l'oubli jusqu'
à ce que COASE (1937), l'utilise dans son fameux article "The nature
of the firm" pour décrire « un ensemble de dispositifs »
employés par une entreprise en vue d'assurer des « modes de
coordination » plus efficaces que le marché. Au début des
années 90, Williamson (1985) évoque la « gouvernance
d'entreprise » pour encadrer et baliser les relations entre les
actionnaires et leurs dirigeants.
Dix ans plus tard, la gouvernance connaît un essor de
plus en plus grandissant, et ce, dans tous les champs disciplinaires. La
globalisation des marchés, l'organisation des sociétés
civiles, les déboires financiers, ici et là, la prise de
conscience de la dimension environnementale, la solidarité des
altermondialistes, la décentralisation de quelques services publics,
entre autres choses, sont autant de facteurs ayant contribué au
développement fulgurant de la notion de gouvernance (PAQUET G., idem).
Comme mode de gestion participative, la bonne gouvernance
favorise l'implication des acteurs concernés par le
développement. A cet effet, la gouvernance suppose une gestion
partagée, accès sur :
- La division de travail entre partie prenantes
- La répartition de responsabilité en fonction
de compétence de chacun
- Le respect des normes communautaires qui régissent le
fonctionnement d'une communauté
- L'application minutieuse de la grille : qui ? doit faire
quoi ? quand ? pourquoi ? et comment ?
Il s'agit là donc, de la bonne gouvernance qui engendre
l'accroissement du sens de propriété, d'autodétermination,
et renforcement du sens de responsabilité. La bonne gouvernance stimule
le processus d'empowerment, c'est-à-dire le pouvoir de prendre
en main sa propre destinée par le renforcement des individus et de leur
organisation. Elle a comme piliers : le respect des normes, la
transparence, la redevabilité...
b. Le développement
socio-économique
Le développement socio-économique n'est pas une
fin en soi, mais un moyen important pour permettre aux personnes d'aspirer
à un plus grand bien-être. Le développement
économique contribue à le rendre possible. Le processus de
développement économique ne peut s'identifier à la «
croissance économique » quantitative de la production ou du revenu,
car il doit prendre en compte l'amélioration de la qualité de vie
de la population.
Le développement économique doit être
« socialement juste », inclusif et porter une attention
spéciale aux femmes, aux jeunes, aux populations menacées
d'exclusion à cause de leur origine (migrations), de leur ethnie,
religion ou handicap.
Le développement économique doit être
« respectueux de l'environnement » et garantir que les
générations futures auront les mêmes possibilités
que ceux qui vivent aujourd'hui. Il doit être aussi « culturellement
ancré » et renforcer la capacité des personnes pour
conférer un sens et un but à la participation à la vie
sociale et économique de leur communauté.
Toutes ces composantes trouvent leur expression dans le
développement économique local ou territorial (DEL)
considéré comme le processus qui vise à entraîner
une amélioration des conditions et de la qualité de la vie des
gens qui vivent sur un territoire donné. Il va, cependant, bien plus
loin : le DEL se fonde sur une « approche territoriale » qui
conçoit le territoire comme un tout où interagissent divers
acteurs publics et privés, du secteur lucratif et non, à
l'échelon local, national ou international, des intervenants de divers
secteurs qui doivent s'accorder sur des stratégies communes en assumant
des rôles complémentaires où chacun fait ce qu'il sait
faire de mieux dans le cadre de stratégies partagées et
consensuelles.
Le développement socio-économique local est
participatif. Il se fonde sur des partenariats entre les autorités
locales, le secteur privé, l'université et d'autres centres
d'enseignement, d'autres agents du secteur public et de la
société civile pour favoriser l'activité commerciale
à l'échelon local.
Cela peut prendre de nombreuses formes, y compris les
entreprises d'économie sociale qui répondent aux besoins de
groupes marginalisés, ainsi que les micros,
petites et moyennes entreprises (MPME). Les initiatives de développement
socio-économique local revêtent un caractère communautaire
et sont définies localement.Les gouvernements locaux assurent le
leadership et la coordination dans la planification et la mise en oeuvre des
initiatives de DEL, soit directement soit par l'entremise d'une
délégation de pouvoirs aux organismes communautaires.
Les initiatives de développement
socio-économique local varient considéra-blement en fonction des
conditions et des besoins locaux. Elles peuvent comprendre le
développement d'infrastructures, la recherche et l'innovation, la
formation professionnelle, l'attraction de nouveaux investissements, les
services techniques et financiers aux entreprises nouvelles et existantes, les
politiques d'approvisionnement à l'appui de la commercialisation.
Le développement socio-économique local est un
processus à long terme qui vise à développer des
collectivités inclusives et résilientes. Les praticiens du DEL
admettent qu'il faut du temps pour renforcer les capacités locales et
intégrer les groupes marginalisés. Ils utilisent donc toute une
variété d'indicateurs pour mesurer la réussite.
Le développement local est un processus grâce
auquel la communauté participe au façonnement de son propre
environnement dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses
résidents. Cette démarche nécessite une intégration
harmonieuse des composantes économique, sociale, culturelle, politique
et environnementale. La composante économique devient souvent une
priorité, vu l'importance pour chacun d'être en mesure de gagner
sa vie et de subvenir de manière satisfaisante à ses besoins et
ceux de ses proches.
Cette approche est avant tout un phénomène
humain où les projets et l'action, plus que les institutions et les
politiques, mobilisent l'ensemble des intervenants de la communauté de
chacun des arrondissements. Pour qu'il soit durable, le développement
local doit reposer sur trois piliers fondamentaux : pilier
économique, pilier environnemental, et pilier social(
https://desl.ucl.org,
consulté le 28/07/2021 à 10 :03)
2.3.1.Dimensions du
développement local au niveauterminologique
L'approche du développement local est aussi
appelée développement économique communautaire (DEC) dans
sa version plus urbaine. Ce dernier terme serait plus utilisé aux
États-Unis et au Canada.L'approche du développement
économique communautaire peut donc se définir comme une approche
globale de revitalisation économique et sociale de collectivités
qui réunit quatre dimensions :
a) La dimension économique : vise
le déploiement d'un ensemble d'activités de production et de
vente de biens et services.
b) La dimension locale : touche la mise
en valeur des ressources locales d'un territoire, d'une ETD donnée, dans
le cadre d'une démarche partenariale tripartite où s'engagent les
principales composantes d'une communauté.
c) La dimension du DÉC : se veut
sociale et politique. Elle vise la revitalisation
économique et sociale d'une ETD en intervenant au niveau de l'emploi, du
logement, de la formation, de la santé et des services sociaux. Elle
cherche à favoriser la réappropriation de son devenir
économique et social par la population résidante. Il s'agit donc
"d'empowerment" de la communauté. Sur ce point, Bill NINACS
mentionne que le DÉC est une orientation stratégique que peut
prendre une intervention auprès d'une communauté plus
défavorisée.
d) La dimension communautaire :où
la communauté est le centre d'intérêt de l'intervention.
Quant à lui, le développement social fait
référence à la mise en place ou au renforcement, au sein
des communautés et à l'échelle de la collectivité,
de conditions qui permettent d'une part à une société de
progresser socialement, culturellement et économiquement et, d'autre
part, à tous les membres de cette société de participer au
progrès et de profiter de ses fruits, le plus équitablement
possible.
Dans cette optique, le développement social est
étroitement associé au développement économique et
au développement culture (TREMBLAYI et at ali., 1991, p.487).
2.3.2. Objectifs du
développement local
Trois objectifs primordiaux constituent le rouleau compresseur
du développement local, notamment :
1) Le développement local vise à
améliorer le cadre de vie des personnes de la communauté pour
qu'elles puissent profiter d'un environnement sain et agréable ;
2) Il vise également à améliorer leur
milieu de vie pour qu'elles puissent s'épanouir dans une
communauté qui leur offre plusieurs occasions sociales et culturelles
;
3) Il cherche à augmenter le niveau de vie afin que
chacun dans la communauté puisse travailler et donc gagner un revenu
pour pouvoir profiter des avantages de la communauté (création
d'emplois et répartition de la richesse).
2.3.3. Prérequis du
développement local
Le succès d'une démarche de développement
local dépend d'un certain nombre de préalables qui sont
regroupés sous trois volets : l'existence d'une communauté
locale, le partenariat et un climat propice à l'action.
2.3.3.1. Existence d'une
communauté locale
La participation et l'implication active de la population
sont essentielles à toute initiative de développement local, il
importe donc de commencer par bien identifier les communautés. La
communauté locale est le plus souvent définie selon des
intérêts divers et en fonction des services à donner aux
citoyens. La définition, des communautés passent aussi par la
reconnaissance des communautés aux prises avec des
réalités qui leurs sont propres tel que les femmes, les jeunes,
les communautés culturelles, les personnes avec un handicap, les
aînés, etc.
Il est nécessaire de déterminer les territoires
d'intervention selon les actions désirées et les
intérêts communs. Ces derniers ne cadrent pas toujours aux
territoires définis par l'État mais ils correspondent toujours
aux lieux où les citoyens se retrouvent, où le sentiment
d'appartenance et d'identité des communautés concernées
est important. Ainsi, à l'intérieur d'une même ville ou
d'un même arrondissement, il peut y avoir plusieurs
communautés.
La mobilisation des communautés implique un processus
permanent d'animation du milieu qui permet aux citoyens de prendre conscience
de leurs besoins et favorise leur prise en charge par les personnes
concernées elles-mêmes. Par conséquent, il est essentiel de
mieux former les citoyens aux rôles qu'ils peuvent avoir dans la
participation au développement local et à leur
société. Plus la participation est élevée et plus
les chances de réussite d'un projet sont probantes.
2.3.3.2. Partenariat
L'établissement de partenariat et la création de
réseaux d'échange doivent exister dans le cadre du
développement local et se concrétisera souvent par une ouverture
d'esprit. Les représentants des secteurs privés, public et
communautaire, dans le respect de leurs mandats et malgré des
intérêts parfois divergents, choisissent de travailler ensemble
afin de développer une participation intersectorielle et des
interventions transversales.
Le fait de rassembler les acteurs d'un milieu est un processus
politique qui consiste à faire travailler des groupes
d'intérêts parfois opposés et des leaders quelquefois
concurrents vers les intérêts collectifs des communautés
concernées. De véritables partenariats doivent ainsi
s'établir entre tous les intervenants du milieu et plus
particulièrement entre le pouvoir politique et les partenaires
socio-économiques.
2.3.3.3. Environnement et un
climat propice à l'action
La troisième condition nécessaire au
succès des politiques de développement local est
l'établissement d'un environnement et d'un climat propice à la
collaboration et à l'action communautaire et civique. Les
systèmes de valeurs, les héritages culturels et les
différences de formation, conjugués aux visions sectorielles des
divers intervenants et ministères, sont des éléments
contraignants et parfois paralysants qui nuisent à la formation d'un tel
environnement.
Il importe dans ce cas que les personnes en autorité,
de compétence ou de direction, qui possèdent un savoir être
et un savoir-faire particulier, mettent en commun leurs énergies afin de
provoquer l'émergence d'un tel climat et facilite le rassemblement
autour de projets intersectoriels mobilisateurs. C'est également
à ce niveau que les leaders naturels, par leur capacité de
convaincre et de rassembler, prennent toute leur importance en suscitant une
adhésion volontaire à l'action communautaire et civique.
L'émergence d'un environnement et d'un climat propice
à l'action s'établit souvent par un processus de réflexion
qui permet la fixation d'objectifs communs et l'identification de projets
concrets. Ce processus permet d'établir des plans, de fixer des
orientations et de retenir des objectifs pour concentrer tous les efforts de
chacun des acteurs dans la même direction.La réalisation des
projets de développement local exige enfin un processus d'organisation
minimal qui permet de mettre en place les structures nécessaires
à l'encadrement et au soutien des efforts de revitalisation
économique et sociale des communautés. Le processus
d'organisation vise également à assurer une cohabitation
harmonieuse avec l'environnement socio-administratif et une interaction
positive entres les structures formelles et informelles.
2.3.3.4. Maximisation de la
participation civique
Le développement local étant un processus
destiné en d'autres termes à l'amélioration du milieu de
vie d'une communauté donnée, il importe de bien rejoindre,
d'encadrer, développer et maximiser la participation des citoyens de
ladite communauté afin de garantir les chances de succès des
projets collectifs.
Depuis belle lirette, le développement des
collectivités a été pensé, réfléchi
et dirigé par les instances centrales et principalement publiques. Cette
forme traditionnelle de développement se concrétise souvent par
une politique de développement qui se situe parfois loin des
communautés et ne permet pas toujours de répondre à tous
les besoins d'une communauté existante.
Ces communautés sont complexes car elles regroupent de
nombreux besoins qui ont des réalités fort différentes.
Malgré les changements de ministères ou de programmes, les
citoyens demeurent toujours au coeur de l'intervention en développement.
Ils représentent le centre d'intérêts des actions et il
importe alors de leur laisser plus de place quant aux décisions de leur
milieu de vie. Après tout, ce sont eux qui restent après le
passage des acteurs et des experts, il devient donc essentiel d'aider à
faire et non faire à leur place. Il est temps de faire confiance aux
communautés établies afin de permettre aux forces du milieu de se
développer et de consolider des actions durables. Le temps est venu de
les aider dans une démarche d'appropriation de leur milieu.
En outre, il importe aussi de penser à une autre
façon de faire : le développement local est un nouveau concept
qui a fait ses preuves. Les résultats actuels démontrent bien que
l'augmentation du niveau de vie, de la qualité de vie et du cadre de vie
passe par la mobilisation des communautés et la concertation des acteurs
du milieu. Le développement local n'est pas le seul concept qui permet
d'obtenir des réalisations durables mais demeure un concept
incontournable qu'il faut intégrer dans notre nouvelle culture de
société. Il représente un concept unique dont il est
important de connaître et de reconnaître toutes les dimensions.
Enfin, le développement local est une approche
intégrée, multisectorielle et décentralisée de la
gestion et d'exécution des actions, dont l'enjeu principal demeure la
décentralisation des pouvoirs et budgets du haut vers la base, en toute
harmonie avec le reste de son environnement. Développer un langage
commun, miser sur les forces en place et maximiser les interventions de
réseautage et de jumelage sont des éléments essentiels
afin d'obtenir une meilleure mobilisation du milieu.
2.3.4. Les 4 conditions
clés du développement local :
1) Ancrage territorial des démarches de
développement local compris ici comme le dépassement des logiques
sectorielles plus que comme une circonscription spatiale de la décision.
Le territoire est ici un moyen et non une fin.
2) Processus d'intégration. C'est la question cruciale
de la place du sujet au sein de la société qui est posée
ici. Elle revêt des formes multiples : mobilisation locale, implication,
citoyenneté.
3) Prise en compte des dimensions culturelles. Le
développement local passe par le repérage d'un système de
valeurs, de croyances, de représentations qui doivent agir comme des
filtres pour la mise en place des actions sur le territoire.
4) Adoption d'un mode de pensée complexe. Il s'agit ici
de développer des modes d'apprentissage. Le développement n'est
pas une logique simple de reproduction mais un processus complexe, cognitif
dans lequel les acteurs du territoire doivent s'investir. C'est ainsi que
Jean-Pierre Jambes parle de territoires apprenants.
Conclusion partielle
Ce chapitre s'est articulé autour des trois
sections : la première s'est appesantie sur la théorisation
du développement local à travers laquelle nous avons
abordé les différentes facettes de cette approche fondamentale,
et la théorie de la décentralisation.A ce stade, nous avons
retenu que le développement local identifie les dynamiques sociales
comme vecteurs d'évolution des communautés de base.La seconde a
été consacrée à la théorie du MEC où
nous avons expliqué son origine, sa mise en pratique, ses avantages et
inconvénients ainsi que ses conséquences. Dans cette section,
nous avons pertinemment retenu que le cadre de la bonne gouvernance et la
capacité locale restent le bénéfice du mécanisme
d'engagement citoyen pour booster les conditions socio-économiques de la
communauté. La troisième et dernière section a
traité de la bonne gouvernance et du développement
socio-économique comme piliers du développement local, ainsi que
d'autres notions connexes.
CHAPITRE III :
INDICATEURS ET PERSECTIVES D'ENGAGEMENT CITOYEN ET DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA
COMMUNE DE KATOKA
D
ans ce chapitre, nous allons analyser non seulement les
indicateurs mais aussi les perspectives afin de mesurer l'impact de
l'engagement citoyen sur le plan socio-économique et culturel, à
travers des enquêtes que nous avons menées sur le terrain à
l'égard des intéressés obtenus sur base d'un
échantillon.
3.1. INDICATEURS DU
DEVELOPPEMENT DANS UNE COMMUNAUTE DE BASE
Un indicateur est une variable qualitative ou quantitative
permettant une appréciation simplifiée d'un
phénomène abstrait. Un indicateur traduit un ensemble de
données en une information compréhensible, soit en
agrégeant les données de façon synthétique, soit en
choisissant un seul fait représentatif pour tous les autres faits en
question. Cette information peut être intégrée par la suite
dans l'activité de l'utilisateur pour lequel l'indicateur a
été construit.
Dans une démarche d'évaluation, l'indicateur est
utilisé comme variable positionnée par rapport à une
référence, à un seuil, l'indicateur peut être
défini comme la mesure d'un objectif à atteindre. Pour cela,
l'indicateur doit bien correspondre à la mesure du problème en
question, le suivi doit être fait à des intervalles de temps
réguliers et en rapport avec le phénomène
étudié (GIRARDIN 2004 : 20).
La comparaison de différents systèmes
d'indicateurs montre que leurs utilisateurs n'ont pas tous la même
compréhension de ce terme (cf. HEILAND et al. 2003a). Par exemple,
l'indicateur de la production d'électricité à partir
d'énergies renouvelables est en effet souvent composé de
plusieurs indicateurs : la production d'électricité à
partir d'énergie éolienne, hydraulique ou photovoltaïque,
etc.
Dans ce cas-là, faut-il parler d'un indicateur ou de
plusieurs indicateurs ? Lorsque les valeurs des différentes composantes,
ou des différents indicateurs, sont agrégées en un seul
chiffre, il s'agit d'un indice. Le problème des différents
niveaux de concrétisation d'un indicateur est aggravé par une
utilisation divergente des unités de mesure : par exemple faut-il
mesurer l'étalement urbain en ha par jour ou en m par habitant et par an
? La version courte d'un indicateur décrit ce qui doit être
recensé sans pour autant dire comment ce recensement sera
effectué.
L'utilisation des versions courtes cache le fait que le
renseignement d'un indicateur demande parfois des efforts considérables,
en revanche elle permet une meilleure communication des indicateurs
auprès du grand public.
Les indicateurs se distinguent aussi en fonction de leur
utilisation : Tout d'abord, un indicateur peut ne contenir que des
éléments descriptifs et quantitatifs (utilisation
descriptive-quantitative). Il peut aussi contenir des éléments
qualitatifs, des jugements de valeur, par exemple « la taille des zones
naturelles remarquables » - comment définir le caractère
« remarquable » d'une zone naturelle (utilisation
descriptive-qualitative) ?
On parle d'utilisation normative lorsque l'indicateur contient
des jugements de valeur implicites ou explicites qui précisent une
orientation, un objectif, par exemple « le développement de
l'énergie solaire » - l'objectif serait donc d'augmenter le nombre
de capteurs solaires. Pour finir, il est possible de mélanger ces trois
formes d'utilisation (Jean-Paul Carrière, 2005, p.83).
Le développement démocratique, c'est d'abord le
développement des personnes. C'est pourquoi il est essentiel que la
démocratie, l'engagement citoyen se construisent et prennent ancrage
dans les valeurs, dans l'identité, et dans le tissu social du milieu.
Une telle démarche permet une véritable appropriation locale des
principes de la démocratie et du développement local, et garantit
l'obtention d'un consensus durable sur la pertinence et la signification des
transformations en cours. C'est que la citoyenneté demeure
enracinée dans un espace de vie, d'où elle est appelée
à rayonner.
Dans cette logique, l'approche d'accompagnement adoptée
par les partisans du développement à la base met l'accent sur
l'empowerment et sur le respect de l'autonomie des individus et des
collectivités dans leur démarche.La notion d'empowerment
définit le processus par lequel un individu et une
collectivités'approprient la capacité d'agir concrètement
et de façon autonome sur sa situation et sur son avenir. C'est donc la
démarche au travers laquelle on acquiert le pouvoir, et qui vient
renforcer la capacité de l'exercer.
Dans cet esprit, le développement local repose sur une
consolidation des processus démocratiques, à tous les niveaux, et
sur un renforcement de la dynamique économique.L'approche participative
s'appuie sur l'émergence d'une société civile forte,
portée et reconnue par les populations comme un outil de pouvoir dans le
domaine politique et dans le domaine économique.
Le développement local durable devient ainsi
l'incarnation et la réalisation des collectivités
mobilisées et organisées dans leur milieu, des
collectivités outillées et en contrôle des moyens
permettant d'améliorer leurs conditions de vie.
3.1.1.
Opérationnalisation des indicateurs du développement local
Tableau n°02 : Indicateurs du DL
|
Concept
|
Dimensions
|
Indicateurs
|
|
Rapports sociaux
|
Décisionnelle
|
· Définition de plan stratégique de
Développement en collaboration avec la population locale
· Accord de partenariat pour le Développement
|
|
Opérationnelle
|
· Partenariat lors de la réalisation des projets
de développement ;
· Participation de la population locale aux
différents processus.
|
|
Gestionnaire
|
· Gestion commune des projets ;
· Formation pour accroitre les capacités de la
population locale.
|
|
Participation
|
Décisionnelle
|
· Élaboration d'un plan de développement
local ;
· Consultation des personnes ressources ;
· Représentation et participation des populations
à l'instance de réflexion pour l'analyse de leurs besoins.
|
|
Opérationnelle
|
· Implication des organisations ou associations des
populations dans la conception et planification des actions de
développement ;
· Investissement humain des Populations.
|
|
Gestionnaire
|
· Gestion des projets(actions) par les
bénéficiaires ;
· Mise en place d'une commission Composée des
représentants de la population ;
· Bilan d'action des commissions Techniques.
· La culture de redevabilité par toutes les
parties prenantes
· Appropriation et pérennisation pour des
actions
|
Source : tableau
tracé par nous le 31/07/2021
3.2.ENQUETE SUR LES MECANISMES D'ENGAGEMENT CITOYEN
DANS LA COMMUNE DE KATOKA.
La maitrise et la connaissance quasi-complète du milieu
d'étude est une préoccupation majeure mais surtout centrale pour
tout chercheur désireux de résoudre un problème, de
chercher les besoins du milieu d'étude, ce qui peut être possible
que grâce à la technique d'enquête.
Selon OKONDO lorsqu'on veut connaitre le comportement d'une
personne, d'un groupe ou d'une communauté des personnes, ou se rendre
compte d'une situation, l'on peut sans intéresser ni influencer mais
l'observer de loin ou de près mais toujours est-il bon que l'observation
quant à elle seule ne suffit pas (OKONDO,2014,).
A l'égard de celui-ci, nous avons l'obligation
d'approcher et d'apprendre auprès des intéressés les avis
et considérations, raisons pour laquelle la population de la commune de
Katoka nous intéresse.
3.2.1. But de
l'enquête
L'enquête est une méthode de recueil de
données primaires à partir d'un questionnaire administré
à un échantillon d'une population cible. Elle peut prendre
diverses formes telles que sondage politique, un essai clinique, une
étude transversale... (DEL BAYLE Jean louis, 2000, p71).
Afin d'assurer sa crédibilité, la connaissance
scientifique doit se démarquer et se détacher du simple propos,
de l'intuition et de l'affirmation non vérifiée. Elle doit
appliquer des méthodes rigoureuses afin de recueillir, de valider et de
vérifier son information.
En matière de sciences sociales, l'enquête du
terrain est une procédure méthodologique appropriée
à la recherche empirique. C'est un processus qui permet d'obtenir
l'information relative aux phénomènes de société,
d'économie, d'espace... en vue de son analyse. Elle vise l'observation
et la compréhension des phénomènes de
sociétés tels que les comportements de consommation, les
attitudes et les opinions.
En marge de cette étude, notre enquête a pour but
de s'assurer que l'engagement citoyen et la participation active constituent
le socle du développement des communautés de base, notamment de
la commune de Katoka, en participant activement à la gestion de la
chose publique et en demandant de compte aux dirigeants, de se rendre compte du
degré d'implication de la population aux actions de
développement ; grâce à la sensibilisation de toutes
les parties prenantes et de s'assurer que la gestion de la commune est
transparente, participative, et redevable grâce à l'intervention
de DAI, à travers son programme de gouvernance
intégrée.
3.2.2. Préparation de
l'enquête
La commune de Katoka regorge en son sein 256.479 habitants et
un nombre important d'organisations de la société civile qui dans
un domaine ou un autre, ensemble avec la population de la ville de Kananga en
général et celle de la commune de Katoka en particulier exprime
quant à ce plusieurs besoins ressentis. C'est donc à cette
catégorie d'individus qu'est destiné notre questionnaire
d'enquête.
3.2.3. De
l'échantillonnage
Retenons ici que l'échantillon est un ensemble extrait
d'un univers plus large de telle manière que les conclusions qui en
découlent peuvent être extrapolées d'une manière ou
d'une autre sur l'ensemble de la population, tel qu'on l'aurait observé
dans l'ensemble. Il sied de savoir que le principe de
l'échantillonnage repose sur le fait que les informations obtenues sur
l'échantillon sont censées être proches de la
réalité du milieu.
C'est ainsi que le problème de choisir un groupe
d'individus ayant les mêmes caractéristiques et qu'il soit
représentatif, la commune de Katoka étant une population
exhaustive et plus large, il nous serait impossible d'atteindre toute la
population de cette commune, raison pour laquelle, nous avons choisi un
échantillon de 100 personnes sur une population totale de 256.479
habitants et avec qui nous n'étions pas à mesure d'attendre tout
le monde. (Rapport INS 2018-2019).
Tout en nous servant de la formule suivante admise en
statistique.

n= taille désirée de
l'échantillon
Z= l'écart fixé en général
à 1,96% (ou 2) et qui correspond à un degré de confiance
fixé 95% et d'une bonne représentativité. Dans le cas
sous- examen, nous avons pris Z en valeur de 1,96.
P= la proportion de la population cible ayant une
caractéristique ou incidence du problème étudié,
estimé en %(pourcentage). Donc, en cas d'espèce pour nous c'est
93% ou 0,93 la proportion de la population qui a connaissance du MEC et
participe aux actions de développement.
Q= 1.0 -p = 0,07
D= 5% (0,5) qui est égale à une proportion
d'erreur tolérée.
En reportant ces valeurs à la formule ci-dessous, nous
avons :
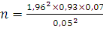
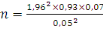 =
= 
 =
= 
 =
= 

Disons que notre échantillon est de 100 personnes qui
est selon nous, un échantillon représentatif, reparti, notamment
des leaders communautaires, de RECO, Chefs de quartiers, les OSC, l'ETD
sensés connaitre l'existence du mécanisme d'engagement citoyen
dans leur milieu respectif.
3.3. DEPOUILLEMENT, PRESENTATION
ET INTERPRETATION
Dans cette partie, il est question de peaufiner le profil
sociologique des enquêtés, de présenter les
différents avis et considérations recueillis sur le terrain
durant notre investigation, dans les tableaux et en faire une analyse suivie de
l'interprétation.
SECTION 1 : PROFIL
SOCIOLOGIQUE DES ENQUETES
3.3.1.Présentation de
l'échantillon
Pour constituer l'échantillon, nous avons
attribué une proportion aléatoire à chacune de
catégorie et se présente respectivement comme suite de 27%, 10%,
9%, 29% et 25%.On observe, dans les différents groupes cibles obtenus
à partir de l'outil de tirage, une majorité chez les leaders
communautaires, succédé par les OSC et les RECO et enfin suit les
deux autres catégories représentées faiblement.
Tableau n°3. Répartition des
enquêtés selon les structures
|
Sexe
Catégorie
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
OSC
|
14
|
13
|
27
|
27
|
|
Chef quartier
|
08
|
02
|
10
|
10
|
|
ETD
|
04
|
05
|
09
|
9
|
|
Leader communautaire
|
14
|
15
|
29
|
29
|
|
RECO
|
12
|
13
|
25
|
25
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nous-même
sur base de l'échantillon retenu.
Parmi les personnes soumises à l'enquête, nous
avons voulu interroger 27 membres des OSC dont 14 hommes et 13 femmes. C'en est
suivi des chefs quartiers dont 10 personnes, notamment, 8 hommes et 2 femmes. 9
membres de l'ETD dont 5 femmes et 4 hommes ont aussi fait partie de nos
enquêtés. Ensuite, nous avons pris 29 leaders communautaires dont
14 hommes et 15 femmes. Enfin, 25 RECO ont fait partie de notre enquête
dont 12 hommes et 13 femmes.
Il faut dire que les leaders communautaires sont majoritaires
que les autres catégories étant donné leur
représentativité dans nos communautés et par rapport aux
missions de PGI-IGA.
Tableau n°4 : Répartition des
enquêtés selon leur sexe et âge
|
Sexe
Age
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
20-30
|
13
|
05
|
18
|
18
|
|
31-40
|
11
|
09
|
20
|
20
|
|
41-50
|
03
|
18
|
21
|
21
|
|
51-60
|
12
|
11
|
23
|
23
|
|
61-70
|
09
|
05
|
14
|
14
|
|
71-et plus
|
04
|
-
|
04
|
04
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nous-même sur
base de l'échantillon retenu.
Les données du tableau n°4 portent sur le sexe et
l'âge des enquêtés. Ces résultats ont
révélé que 100 personnes ont été soumises
aux enquêtés dont 52 individus de sexe masculins et 48 de sexe
féminin.
Ce constat confirme le fait que la plupart des OSC et d'autres
structures à responsabilités sociales et sociétales sont
majoritairement occupées par les hommes que les femmes.
Ensuite, concernant les tranches d'âge des
enquêtés, il ressort que le grand nombre est âgé de
20 à 60 ans, soit 82 % des personnes actives, et 18 % des celles de 61
ans et plus.
La tranche d'âge la plus numériquement importante
est celle de 51 à 60 ans, soit 23 % des enquêtés, suivie
des tranches de 41 à 50 ans, 31 à 40 ans, 20 à 30 ans, 61
à 71 ans, et 71 ans et plus, qui représentent respectivement, 23
%, 21 %, 20 %, 18 %, 14 % et 4 %.
Ainsi, pour garantir la crédibilité des
résultats, toutes les strates d'âge ont été prises
en compte, notamment, le premier âge (représentant la jeunesse),
le deuxième âge (traduisant la maturité), et le
troisième âge (considéré comme celui de la
sagesse).
Tableau n°5 : Répartition des
enquêtés suivant leur sexe et niveau d'instruction
|
Sexe
Instruction
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Sans instruction
|
-
|
02
|
02
|
2
|
|
Primaire
|
02
|
05
|
07
|
7
|
|
Secondaire
|
31
|
29
|
60
|
60
|
|
Supérieur
|
19
|
12
|
31
|
31
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nous-même
sur base de l'échantillon retenu.
Les données de ce tableau révèle que sur
100 individus enquêtés, la majorité a le niveau
d'étude secondaire, elle représente 60 % de répondants ou
60 personnes dont 31 hommes et 29 femmes ; suivie de ceux ayant le niveau
supérieur dont le nombre s'élève à 31 sujets soit
19 hommes et 12 femmes, le niveau d'instruction le moins
représenté est du primaire ayant totalisé 7 individus,
soit 7 % et la proportion la plus faible est celle des analphabètes,
elle représente 2 % de la population totale soumise à notre
enquête.
Il se dégage que la majorité de la population de
la commune de Katoka a un niveau d'étude secondaire.
Tableau n°6 : Répartition des
enquêtés selon leur sexe et leur statut matrimonial
|
Sexe
Etat civil
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Célibataire
|
13
|
05
|
18
|
18
|
|
Marié(e)
|
34
|
30
|
64
|
64
|
|
Divorcé(e)
|
03
|
04
|
07
|
7
|
|
Veuf(ve)
|
02
|
09
|
11
|
11
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nous-même
sur base de l'échantillon retenu.
Les résultats de ce tableau ont montré que la
plus forte proportion des enquêtés représente les
mariés, 64 individus soit 64 % correspondant respectivement à 34
hommes soit 34 %, à 30 femmes soit 30%, suivis de 18 % de
célibataires dont 13 hommes, soit 13 % et 5 femmes soit 5 %. 11
enquêtés sont veufs soit 11 % dont 9 femmes et 2 hommes. Enfin, 7%
des sujets enquêtés sont divorcés, soit 4 femmes et 3
hommes.
Tableau n°7 : Répartition des
enquêtés selon leur sexe et leur profession
|
Sexe
Profession
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Libéral/ débrouillard
|
09
|
06
|
15
|
15
|
|
Opérateur économique
|
06
|
02
|
08
|
8
|
|
Fonctionnaire de l'Etat
|
15
|
15
|
30
|
30
|
|
Agent de développement
|
12
|
12
|
24
|
24
|
|
Etudiant
|
03
|
03
|
06
|
6
|
|
Sans emploi
|
07
|
10
|
17
|
17
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nous-même
sur base de l'échantillon retenu.
Du point de vue de la profession des enquêtés, il
ressort des données statistiques ci-dessus que 30 sujets soumis à
l'enquête sont agents et fonctionnaires de l'Etat soit 30%. 24 personnes
soit 24 % sont des agents de développement.
Par contre, les individus sans emploi représentent 17%
soit 17 sujets composés de 10 femmes et 7 hommes.Tandis que la
catégorie des débrouillards est de 15% ou 15 personnes dont 9
hommes et 6 femmes. Les opérateurs économiques et
étudiants représentent respectivement 8% et 6%, soit 6 hommes et
2 femmes, et 3 hommes et 3 femmes.
Cependant, ces statistiques confirment le caractère
administratif de cette commune et que la représentativité de
50/50 est constatée chez les agents de l'Etat, les Agents de
développement et les étudiants.
SECTION 2. DEPOUILLEMENT,
ANALYSE ET INTERPRETATION
Cette partie englobe nos seize questions que nous avons
administrées à chaque enquêté dont les
résultats se présentent de la manière suivante :
· A la question de savoir s'ils ont
déjà entendu parler du mécanisme d'engagement citoyen, les
avis ci-dessous ont été recueillis :
Tableau n°8 : La connaissance sur le
mécanisme d'engagement citoyen
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Oui
|
47
|
34
|
81
|
81
|
|
Non
|
04
|
12
|
16
|
16
|
|
Sans avis
|
01
|
02
|
03
|
03
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Parmi les 100 personnes soumises à l'enquête, 81
sujets soit 81 % disent connaitre l'existence des MEC, cela pour avoir
participé plusieurs fois aux séances de formation avec DAI qui en
est l'initiateur dans ses programmes d'action. 16 personnes soit 16%
d'enquêtés disent n'avoir jamais entendu parler de MEC
étant donné qu'elles n'ont pas régulièrement suivi
les formations organisées par DAI quant à ce. Enfin, 03 individus
soit 3% n'ont pas voulu s'exprimer à ce sujet étant donné
qu'ils ne font pas partie des structures ciblées par DAI-IGA.
· A la question de savoir comment ils ont pris
connaissance de l'existence de Mécanismes d'engagement citoyen, les
réponses ci-après ont été
données :
Tableau n°9 : la manière par laquelle
on a connu le MEC
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
A travers la formation avec DAI
|
44
|
44
|
88
|
88
|
|
Sensibilisation et information
|
05
|
03
|
08
|
08
|
|
Médias
|
03
|
01
|
04
|
04
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
En ce qui concerne la source d'information sur les
mécanismes d'engagement citoyen auprès de nos
enquêtés, 88 personnes soit 88 % indiquent qu'elles sont
informées à travers les différentes formations et
séminaires organisés par le programme de gouvernance
intégrée (PGI) de DAI/USAID. Par ailleurs, 08 sujets soit 8%
reconnaissent avoir été informés du MEC grâce
à la sensibilisation et plusieurs informations
bénéficiées auprès des relais communautaires et
quelques membres de la société civile qui travaillent avec DAI.
Enfin, 04 enquêtés soit 04% déclarent
avoir connu la notion de mécanisme d'engagement citoyen dans les
différentes émissions radio-télévisées
à travers les différentes chaines de la ville de Kananga.
· A la question avez-vous déjà
suivi une formation sur les mécanismes d'engagement citoyen, les
réponses ci-dessous ont été
données :
Tableau n°10 : la formation en
Mécanisme d'engagement citoyen
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Oui
|
39
|
30
|
69
|
69
|
|
Non
|
12
|
16
|
28
|
28
|
|
Sans
|
01
|
02
|
03
|
03
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Les informations statistiques contenues dans ce tableau
indiquent ce qui suit :
· 69 enquêtés soit 69 précisent et
affirment qu'ils ont suivi au moins une fois la formation sur les
mécanismes d'engagement citoyen auprès des organisations et
organismes de développement.
· 28 sujets soit 28% disent n'avoir jamais suivi la
formation sur les mécanismes d'engagement citoyen étant
donné qu'ils n'ont jamais été invités quant
à ce.
· 03 individus soit 03% se sont réservés
sur cette question estimant que les formations sur certaines matières
importantes pour la société se passent sans qu'ils soient
informés par les organisateurs formateurs.
· A la question de savoir ou de connaitre les
structures qui les ont formés sur le MEC, les réponses
ci-après ont été enregistrées, après avoir
affirmé connaitre le MEC :
Tableau n°11 sur la structure
formatrice
|
Sexe
Avis
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
PGI/DAI
|
42
|
42
|
84
|
84
|
|
UNICEF
|
01
|
02
|
03
|
03
|
|
CBMT
|
01
|
01
|
02
|
02
|
|
Autres
|
08
|
03
|
11
|
11
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Parmi les structures ayant organisé les
différentes formations sur les mécanismes d'engagement citoyen,
84 enquêtés soit 84% parlent de DAI-USAID dans son programme de
gouvernance intégrée où il place le MEC parmi ses grandes
stratégies de la participation citoyenne, de responsabilisation et de
redevabilité.
11 sujets soit 11% évoquent les autres structures comme
Handicap International, Accelere, ... qui ont également
intégré le MEC dans leur gestion et organisé des
formations auprès de leurs partenaires quant à ce.
03 individus soit 03% indiquent qu'ils ont suivi la formation
sur les mécanismes d'engagement citoyen auprès de l'UNICEF au
cours de ses appuis dans les structures respectives.
Enfin, 02 personnes soit 02% affirment avoir suivi la
formation sur les mécanismes d'engagement citoyen auprès du
Centre Bamamu Tabulukayi dans l'encadrement de ses partenaires avec qui ils
travaillent en synergie.
· A la question de connaitre les
différents mécanismes d'engagement citoyen parmi quelques-uns
énumérés, les enquêtés ont fournis des
réponses ci-dessous :
Tableau n°12 : Connaissances des
différents mécanismes d'engagement citoyen
énumérés
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Carte score communautaire
|
5
|
6
|
11
|
11
|
|
Audience publique
|
2
|
2
|
04
|
4
|
|
Redevabilité
|
8
|
7
|
15
|
15
|
|
Tribune d'expression populaire
|
8
|
3
|
11
|
11
|
|
Forum citoyen
|
4
|
3
|
7
|
7
|
|
Plaidoyer
|
7
|
7
|
14
|
14
|
|
Audition législative
|
-
|
1
|
01
|
1
|
|
Dialogue par action
|
-
|
1
|
01
|
1
|
|
Mobilisation
|
8
|
6
|
14
|
14
|
|
Conscientisation
|
3
|
4
|
07
|
7
|
|
Participation citoyenne
|
7
|
8
|
15
|
15
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Parmi les mécanismes d'engagement citoyen
maitrisés par nos enquêtés, 30 personnes soit 30% citent
respectivement la redevabilité et la participation citoyenne qui sont
les principaux moyens auxquels la communauté peut se saisir de la
gestion de différentes structures gouvernementales ainsi que sa
responsabilisation.
28 enquêtés soit 28% parlement respectivement du
plaidoyer et de la mobilisation comme des astuces nécessaires pour
accéder à leur développement.
22 citoyens soit 22% évoquent aussi respectivement la
carte score communautaire pour les uns et la tribune d'expression populaire
pour les autres comme des véritables outils d'expression et
d'échange dans le cadre du contrôle citoyen.
14 enquêtés soit 14% pensent respectivement au
forum citoyen et à la conscientisation communautaire comme moyen de
collaboration entre les dirigeants et la population pour assurer le
développement de la communauté.
4 individus soit 4% ont évoqué l'audience
publique qu'ils estiment être un cadre approprié d'échange
entre les dirigeants et les dirigés sans tabou. Enfin, 2 personnes soit
2% ont parlé respectivement de l'audition législative et le
dialogue par action qui demeurent des outils d'échange en vue de
promouvoir un développement participatif de toutes les parties
prenantes.
· A la question de savoir si ces
mécanismes d'engagement citoyen sont mis en pratique et
opérationnels dans la commune de Katoka, les enquêtés ont
donné des avis ci-dessous :
Tableau n°13 : la pratique ou
l'opérationnalité des MEC dans la commune de Katoka
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Oui
|
39
|
34
|
73
|
73
|
|
Non
|
07
|
09
|
16
|
16
|
|
Sans
|
06
|
05
|
11
|
11
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
En ce qui concerne l'opérationnalisation des
mécanismes d'engagement citoyen dans leurs entités respectives,
73 sujets soit 73% affirment que les MEC sont déjà effectifs dans
leurs entités grâce au suivi et évaluation des
différentes formations réalisées par DAI-PGI quant
à ce.
Les dirigeants sont devenus redevables et rendent compte de
leur gestion à la communauté et la population participe
activement aux actions de développement.
Par contre, 16 enquêtés soit 16% indiquent que
les MEC ne sont pas d'application dans leurs entités respectives
étant donné que le niveau de sensibilisation est faible tant au
niveau des dirigeants que dans la population.
Enfin, 11 personnes soit 11% se sont réservées
à cette question l'estimant être complexe du seul fait que
certains dirigeants plongés longtemps dans la corruption et les
antivaleurs s'opposent aux MEC.
· A la question de savoir comment la
communauté s'y prend pour mettre en pratique ces MEC, les
enquêtés ont fournies des réponses
ci-dessous :
Tableau n°14 : la manière dont la
communauté parvient à pratiquer le mécanisme d'engagement
citoyen
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
A travers les réunions
|
27
|
20
|
47
|
47
|
|
Sensibilisation
|
17
|
25
|
42
|
42
|
|
Formation
|
02
|
02
|
04
|
4
|
|
Mobilisation
|
03
|
01
|
04
|
4
|
|
Conscientisation
|
03
|
-
|
03
|
3
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Parmi les canaux utilisés pour parvenir à mettre
sur pied les mécanismes d'engagement citoyen dans leurs entités
respectives, 47 sujets soit 47% disent participer aux différentes
réunions organisées régulièrement pour analyser et
évaluer le niveau d'appréciation et d'observance de MEC tels
qu'enseignés par le PGI-DAI/USAID.
Par ailleurs, 42 enquêtés soit 42% disent
être sensibilisés par les Relais Communautaires et les membres des
organisations de la société civile sur le bien-fondé de
MEC au développement de leurs entités.
Ensuite, 08 sujets soit 8% parlent respectivement de la
formation et mobilisation qui sont comme des canaux d'éveil de
conscience qui sont généralement utilisés par les
dirigeants pour les MEC.
Enfin, 03 personnes soit 3% sont revenus sur la
conscientisation qui permet aux parties prenantes des revenir au bon sens pour
la mise sur pied des MEC comme pistes nécessaires pour promouvoir le
développement de l'entité.
· La question de savoir la nature et l'existence
des activités de développement réalisées
grâce la contribution locale, les enquêtés n'ont pas
hésité de donner des avis suivants :
Tableau n°15 : sur les activités de
développement réalisées à Katoka avec l'apport
local
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Assainissement du milieu et des routes(avenues)
|
25
|
34
|
59
|
59
|
|
Lutte antiérosive
|
15
|
10
|
25
|
25
|
|
Construction des infrastructures socio-économiques de
base (Ecole, Centre de santé, WC, public, source d'eau
|
12
|
04
|
16
|
16
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Parmi les activités communautaires phares
réalisées dans les entités avec la contribution locale, 59
enquêtés soit 59% évoquent l'assainissement du milieu
(propreté de parcelle, la coupe des fleurs, le ramassage des
déchets...) et routes (le cantonnage manuel, le curage des caniveaux...)
pour rendre l'entité très propres et agréable.
Par ailleurs, 25 sujets soit 25% disent s'adonner à la
lutte antiérosive comme leur champ de batail pour remblayer les
différentes têtes d'érosions et de ravins qui risquent de
détruire leurs avenues et leurs maisons ainsi que d'autres
infrastructures sociocommunautaires de base.
Enfin, 16 enquêtés soit 16% parlent de la
construction des ISE de base notamment les CS, les EP, les WC publiques, les
sources d'eau... pour éviter la propagation des maladies dans la
communauté.
· A la question de participation de la
communauté à la prise de décision des activités de
développement réalisées dans la commune de Katoka, les
enquêtés ont fournis les avis ci-après :
Tableau n°16 : sur la participation de la
communauté à la prise de décision des activités de
développement local
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Oui
|
25
|
34
|
59
|
59
|
|
Non
|
27
|
14
|
41
|
41
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
En ce qui concerne la participation à la prise de
décision pour les actions du développement de leur commune, 59
enquêtés affirment être concertés par les dirigeants
et autres responsables pour une prise de décision commune, sur la mise
en place de certaines actions de développement de l'entité.
Par contre, 41 sujets soit 41% fustigent les méthodes
encore archaïques et dictatoriales qui continuent à
caractériser certains responsables de la commune qui prennent les
décisions sur l'avenir de l'entité sans associer la population.
Lesquelles décisions aboutissent souvent à des échecs.
· A la question de connaitre la procédure
ainsi que la manière utilisée pour participer à la prise
de décisions, les enquêtés ont donnés
réponses suivantes :
Tableau n°17 : Canal de participation des
citoyens à la prise de décision
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Réunion de concertation
|
40
|
38
|
78
|
78
|
|
Mobilisation populaire
|
7
|
8
|
15
|
15
|
|
Contact porte à porte
|
5
|
2
|
07
|
7
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Parmi les voies utilisées pour permettre aux
enquêtés de participer à la prise de décision dans
le cadre des actions de développement de leur commune, 78 personnes soit
78% parlent des réunions de concertation et d'information
organisées par l'autorité communale regroupant toutes les parties
prenantes notamment, les chefs de quartiers, les RECO, les leaders
communautaires et les membres de la société civile autour des
analyses, discussions et débats afin de trouver des solutions communes.
15 sujets soit 15% indiquent la mobilisation populaire qui est
souvent assuré par les RECO pour éveiller la conscience des
membres de la communauté sur le rôle qu'ils doivent jouer dans le
développement de leur commune.
Enfin, 07 individus soit 7% sont revenus sur la
stratégie porte à porte qui est souvent utilisée par les
RECO sur des questions très importantes d'assainissement et de
prévention de certaines maladies et infections mortelles comme
Covid-19.
· A la question de savoir comment trouvez-vous
les moyens pour exécuter les activités de développement de
votre milieu, les enquêtés ont donné des réponses
ci-après :
Tableau n°18 : Sources des ressources
à affecter à l'exécution des activités de
développement
|
Sexe
Réponse
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Contribution locale de la communauté
|
43
|
40
|
83
|
83
|
|
Appuis des partenaires
|
01
|
03
|
04
|
04
|
|
Apports de l'ETD
|
08
|
05
|
13
|
19
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Concernant les sources exploitées pour obtenir des
moyens permettant d'exécuter les activités de
développement de la commune, 83 enquêtés soit 83% parlent
de contribution locale de la communauté au cours de laquelle les membres
de la communauté épris au bien-être de la population
offrent des dons (en espèces ou en nature) et d'autres donnent leurs
contributions.
Par ailleurs, 13 sujets soit 13% indiquent que l'ETD donne ses
apports (surtouts en termes de subvention) pour le développement de la
commune.
Enfin, 04 personnes soit 4% ont reconnu les appuis de certains
partenaires en développement comme PNUD, USAID, CTB, etc. dans les
actions de développement de leur entité.
· A la question quels sont les avantages de MEC
dans la commune de Katoka, les enquêtés ont donnés des
réponses suivantes :
Tableau n°19 : les avantages produits par
des mécanismes d'engagement citoyen dans la commune.
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Développement communautaire
|
11
|
10
|
21
|
21
|
|
Participation citoyenne
|
10
|
9
|
19
|
19
|
|
Bonne gouvernance
|
8
|
7
|
15
|
15
|
|
Transparence
|
6
|
8
|
14
|
14
|
|
Redevabilité
|
9
|
7
|
16
|
16
|
|
Démocratie
|
8
|
7
|
15
|
15
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Parmi les avantages tirés du mécanisme
d'engagement citoyen dans la commune de Katoka, 21 enquêtés soit
21% se disent satisfaits de la promotion du développement communautaire
qui est visible et palpable à travers différentes
réalisations au sein de la commune.
Pour leur part, 19 sujets soit 19% s'encouragent de la
participation citoyenne qui est devenue effective au sein de leur commune. Dans
la même veine, 16 enquêtés se félicitent de la
redevabilité et témoignent que d'ores et déjà, les
dirigeants rendent compte de leur gestion à la population.
30 sujets soit 30% évoquent respectivement la bonne
gouvernance et la démocratie qui sont devenues des valeurs effectives et
palpables dans leur commune depuis les interventions de PGI-DAI/USAID.
Enfin, 14 personnes soit 14% n'ont pas hésité de
témoigner une gestion transparente remarqué dans la commune de
Katoka grâce aux interventions et accompagnements de PGI-IGA.
· A la question de savoir les changements
positifs enregistrés grâce au MEC, les enquêtés ont
donnés les réponses ci-après :
Tableau n°20 : les changements positifs
enregistrés dans la commune de Katoka grâce au MEC.
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Changement des comportements
|
18
|
17
|
35
|
35
|
|
Protection de l'environnement et assainissement du milieu
|
15
|
12
|
27
|
27
|
|
Auto prise en charge
|
11
|
12
|
23
|
23
|
|
Eveil de la conscience
|
05
|
06
|
11
|
11
|
|
Collaboration
|
03
|
01
|
04
|
04
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Parmi les changements positifs enregistrés dans la
commune de Katoka grâce aux mécanismes d'engagement citoyen, 35
enquêtés soit 35% notent le changement de comportement
observé aussi bien dans le chef des dirigeants que celui de la
population comparativement au temps où le PGI-DAI n'avait pas encore
donné ses appuis dans cette entité.
27 sujets soit 27% justifient le changement positif dans le
domaine de la protection de l'environnement et l'assainissement du milieu qui
ont rendu la commune très propre coquette et agréable.
Dans l'autre registre, 23 individus soit 23% notent que l'auto
prise en charge est devenue une réalité dans la commune de Katoka
car, beaucoup de membres sont devenus autonomes.
Ensuite, 11 personnes soit 11% reconnaissent le niveau de
l'éveil de conscience dans le chef des habitants de cette
municipalité qui, par moment arrivent à réaliser certaines
activités de développement communautaire sans n'être
forcés ni interpellés.
Enfin, 04 enquêtés soit 4% félicitent le
niveau de collaboration entre les dirigeants et la population en ce qui
concerne la gestion de la commune et les activités de
développement communautaire.
· A la question comment jugez-vous la
manière dont la commune de Katoka est gérée par les
autorités locales, les enquêtés ont donné des avis
suivants :
Tableau n°21: avis des enquêtés sur
la manière dont la commune est gérée par les
autorités locales
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Très bonne
|
12
|
15
|
27
|
27
|
|
Assez bonne
|
21
|
13
|
34
|
34
|
|
Mauvaise
|
03
|
07
|
10
|
10
|
|
Aucun avis
|
16
|
13
|
29
|
29
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Les informations contenues dans ce tableau statistique
révèlent que :
· 34 enquêtés soit 34% jugent assez bonne la
manière dont les autorités locales gèrent la commune de
Katoka, étant donné que ce processus de MEC est dans sa phase
expérimentale non seulement dans cette commune, mais dans l'ensemble des
ETD du Kasaï central.
· 29 sujets soit 29% se sont réservés de
s'exprimer à cette question estimant que le MEC est une nouvelle
approche de gestion qui demande du temps et que l'on ne peut pas
déjà juger les autorités locales quant à ce.
· 27 personnes soit 27% jugent le bilan des
autorités locales très bon étant donné qu'en
dépit de quelques difficultés, il y a des réalisations
palpables.
· Enfin, 10 sujets soit 10% estiment que la gestion des
autorités est mauvaise pour autant que beaucoup d'anti-valeurs sont
encore visibles et tolérées dans la commune.
· A la question : les autorités
communales de Katoka sont-elles accessibles et favorables aux initiatives de
développement de la commune, a cette question les enquêtés
ont réagi de la manière suivante :
Tableau n°22 : les réactions sur les
autorités accessibles et favorables aux initiatives de
développement de la commune de Katoka.
|
Sexe
Réactions
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Oui
|
33
|
32
|
65
|
65
|
|
Non
|
10
|
12
|
22
|
22
|
|
Aucun avis
|
09
|
04
|
13
|
13
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
En ce qui concerne l'appréciation des
enquêtés sur les autorités locales de la commune de Katoka
en rapport avec les initiatives de développement communautaire, 65
sujets soit 65% disent qu'elles sont accessibles et favorables étant
donné qu'elles encouragent ces initiatives, les supervisent et les
appuient avec leurs propres apports en matériels ou en intrants ainsi
qu'en finances.
Par contre, 22 enquêtés soit 22% disent le
contraire et pensent que les autorités locales ne sont pas accessibles
et favorables aux initiatives de développement du fait que beaucoup
d'infrastructures se dégradent au vu et au su des autorités sans
aucune réactions de leur part.
Enfin, 13 personnes soit 13% ont émis des
réserves au sujet de cette question l'estimant très complexe.
· A la question que pensez-vous suggérer
pour le développement commu-nautaire de votre entité, les
enquêtés ont fait des propositions suivantes :
Tableau n°23 : les suggestions des
enquêtés pour le développement communautaire de
Katoka
|
Sexe
Réponses
|
Effectif
|
Total
|
%
|
|
Homme
|
Femme
|
|
Participation de la communauté aux actions du
développement
|
10
|
09
|
19
|
19
|
|
Obligation aux dirigeants de rendre compte de leur gestion
à la population
|
12
|
09
|
21
|
21
|
|
Associer les autres acteurs aux actions de
développement
|
12
|
11
|
23
|
23
|
|
Collaboration entre les parties prenantes
|
10
|
10
|
20
|
20
|
|
Observation stricte de MEC
|
08
|
09
|
17
|
17
|
|
Total
|
52
|
48
|
100
|
100
|
Source : nos enquêtes
menées dans la commune de Katoka du 01 au 31 juillet 2021
Pour promouvoir un développement communautaire efficace
dans la commune de Katoka, 23 enquêtés soit 23% proposent qu'il
faut associer les autres acteurs aux actions de développement
étant donné que le développement n'est pas l'affaire d'une
seule personnes ou d'une seule catégorie, mais bien une affaire de
tous ; chacun y apportant sa pierre dans la construction de
l'édifice.
21 sujets soit 21% estiment que les dirigeants, à
travers les mécanismes de redevabilité, doivent obligatoirement
rendre compte de leur gestion à la population afin de dissiper les
suspicions et les malentendus.
Par ailleurs, 20 enquêtés soit 20% encouragent la
collaboration entre toutes les parties prenantes au développement en
vertu du principe de l'union fait la force. 19 individus soit 19% reviennent
à la charge avec la participation tout azimut de la communauté
aux actions de développement car elle est le moteur de son
bien-être.
Enfin, 17 enquêtés soit 17% proposent que
l'observance stricte de MEC est une voie sans précédent de la
promotion du développement communautaire lorsqu'on analyse les avantages
et les changements qu'il procure dans ce processus.
3.3.1.Analyse des indicateurs et
perspectives
L'indicateur étant un élément qualitatif
ou quantitatif d'évaluation du degré de performance ou
d'amélioration de changement, la commune de Katoka, ETD
considérée comme structure de développement a connu de
changement et les améliorations dans sa gouvernance depuis les
interventions de DAI/USAID à travers son projet de gouvernance
intégrée.Les rapports sociaux entre les acteurs impliqués
dans le processus de développement local se sont également
améliorés sur le plan participatif, décisionnel,
opérationnel et managérial.
Afin d'apprécier plus à fond la perception des
répondants eu égard à cette thématique, ceux-ci ont
été interrogés sur les différents processus sociaux
favorisant l'émergence d'un développement local durable. Tous ont
souligné que le développement devait partir de la base,
c'est-à-dire du pilier local, estimant que la mise en pratique des MEC
offre des opportunités et des meilleures perspectives pour le
développement de Katoka.
Les indicateurs y afférents prouvent à
suffisance que cette entité est sur la bonne voie, car on a noté
la définition du plan stratégique de développement en
collaboration avec la population locale, sous l'impulsion de IGA/DAI, l'accord
de partenariat lors de réalisation de certaines actions de
développement justifié par la participation active de la
population locale aux différents processus.
Les capacités des acteurs locaux ont été
renforcées à travers les ateliers de formations et de
sensibilisation organisés directement ou indirectement par DAI et les
OSC d'interface. Le point culminant reste l'existence du plan de
développement local. Ces différentes formations ont aidé
à incruster la culture de gestion collégiale, participative,
transparente, redevable.
Dans la même veine, le capital humain et social est
ressorti comme un élément crucial pour toutes les parties
prenantes de Katoka, car les projets de développement doivent être
ancrés localement de façon à ce que chacun des citoyens
puisse s'approprier les leviers du développement. Ainsi, le
développement passerait par le respect d'une certaine éthique de
la bonne gouvernance.
En perspective d'avenir, les autorités communales
devront focaliser leur attention sur la mise en place d'une politique de
développement qui répond aux aspirations légitimes et
naturelles des milliers d'hommes et de femmes en lutte perpétuelle pour
qui, leur survie ne peut se faire que dans le contexte de
décentralisation réussie, qui constitue l'option
privilégiée pour la promotion de développement local.
La viabilité des communes étant une condition
pour l'efficacité de cette décentralisation, la participation de
tous les acteurs devient donc une préoccupation majeure et permanente
pour les tenants de cette nouvelle approche de développement local.Bref,
la commune de Katoka doit capitaliser tous les acquis du projet IGA en rapport
avec les mécanismes d'engagement citoyen, tel que suggéré
par la plupart d'enquêtés.
Le rôle des OSC consistera toutefois, à
contrôler l'action publique des dirigeants, des élus, à
exercer une influence sur les actions des autorités locales, à
améliorer l'offre des services aux citoyens. Tandis que les leaders
communautaires prendront de plus en plus conscience de la
nécessité de s'impliquer dans le développement de
communautés de base pour susciter la participation populaire aux
activités de développement.
3.3.2 Impact du MEC dans la
commune de Katoka
Le but ultime de MEC étant d'amener toutes les parties
prenantes, tous les acteurs à collaborer pour un développement
harmonieux durable des ETD, consécutif à une participation
citoyenne et faciliter la redevabilité et la transparence, sa mise en
pratique a eu un impact positif dans la commune de Katoka.
Hormis l'assainissement du milieu, la protection de
l'environnement, ainsi que la réalisation des certaines actions à
impact visible, les habitants de Katoka ont pris à bras le corps les
problèmes de développement de leur milieu.
Grâce au projet IGA, la communauté entreprend des
actions pour résoudre certaines difficultés et problèmes.
Les habitants de Kele Kele ont initié des cotisations pour se procurer
un terrain où seront érigées les infrastructures devant
abriter le Centre de Santé Kele Kele-Etat toujours locataire. Ces
contributions sont versées directement dans un compte bancaire ouvert
à cette fin. La zone de santé de Katoka a construit sur fond
propre des installations hygiéniques ultramodernes sous le leadership du
MCZ.
Les différentes sessions des formations ont
amené un changement de comportement dans le chef des citoyens de cette
entité dans la mesure où il existe une fine collaboration entre
l'ETD, les OSC, et les leaders communautaires pour la résolution de
certains problèmes à la base. Le Centre de santé Katoka 2
a vu son puis à placenta être reconstruit par la
communauté, tandis que la clôture de l'EP TSHISUMBU a
été réhabilitée en partie grâce aux
contributions locales.
La zone de santé de cette municipalité est
devenue une référence lors des revues mensuelles avec un
degré de performance très élevé dans la lutte
contre la tuberculose grâce à l'implication et la mobilisation
communautaire, témoigne le MCZ Isabelle. Grâce son plaidoyer, les
autorités communales ont disponibilisé un terrain pour la
construction du Bureau de la zone de santé.
La pratique de MEC dans cette entité a
ressuscité la culture de la redevabilité et transparence dans
plusieurs structures à responsabilités sociales et
sociétales. L'enquête a largement démontré le
changement de comportement des habitants surtout en rapport avec la protection
de l'environnement et des biens communautaires, assainissement du milieu.
Conclusion partielle
Ce chapitre focalisé sur les indicateurs et
perspectives du MEC et DL à Katoka a révélé
à travers les enquêtes la nouvelle approche introduite par
DAI-PGI/USAID, laquelle a un impactpositif dans cette ETD du fait que plusieurs
améliorations ont été constatées, dont
principalement la gouvernance participativeet transparente. Certes, il reste
encore beaucoup à faire pour maximiser les chances de la réussite
totale et pérenne du développement de cette commune.
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
A.CRITIQUES
Le développement est l'affaire de peuple, par le peuple
et pour le peuple. Qu'il soit endogène, intégral, soutenable ou
local, le développement est toujours et toujours tributaire de la
participation responsable active de toutes les parties prenantes.
Cependant, en analysant minutieusement certains
résultats de notre étude, bien que plus ou moins 59% de la
population participe à la prise de décision, mais 41% est mis
à l'égard et se déclarent exclus du processus par le fait
que certains responsables continuent à utiliser des méthodes
archaïques et dictatoriales pendant que nous militons pour la maximisation
de la participation.
Il s'est encore dégagé de notre étude que
certains mécanismes d'engagement citoyen tels que l'audition
législative et le dialogue par l'action restent méconnus de la
population, alors que d'importance capitale. Ceci résulte du fait que
les OSC ont du mal à organiser les séances de formation et de
sensibilisation en faveur de la communauté quant à ce.
Il se révèle également la faible
intervention financière et matérielle de l'ETD dans la
construction des ISE de base capable d'accélérer le
développement social de la communauté.
B.SUGGESTIONS
Partant des réalités constatées sur le
terrain et sur les expériences antérieures du
développement local participatif, en tant que technicien en
développement, nous formulons des suggestions suivantes :
1. A l'Etat/autorités
communales
· Parachever le processus de la décentralisation
par l'organisation des élections municipales, locales, et urbaines afin
d'avoir des dirigeants qui sont l'émanation de la population pour mettre
fin au clientélisme politique ;
· Observer strictement des critères obligatoires
de la bonne gouvernance locale (participation, efficacité et efficience,
primauté du droit, obligation de rendre compte,
transparence...) ;
· Renforcer la collaboration entre les acteurs de la
gouvernance publique (Etat-Société civile- Secteur
privé) ;
· Capitaliser les acquis du projet IGA ;
· Renforcer la mise en pratique des MEC à tous les
niveaux de la vie communale ;
· Mettre en place un cadre formel de dialogues et des
mécanismes de collaboration pour créer la confiance de la
population afin de permettre à chacun de contribuer ou de participer au
processus de développement ;
· Transformer la famille en cellule de base de
développement local et appuyer toutes ses initiatives de DL ;
· Augmenter les pourcentages de fonds d'investissement
pour les ISE de base.
2. OSC/Population
· Contribuer au renforcement des services de l'Etat et de
son administration pour satisfaire les besoins de la population ;
· Influencer les institutions et les services publics en
faveur du bien-être de la communauté locale ;
· Sensibiliser la population toute entière
à s'impliquer et à s'approprier les actions de
développement entreprises par l'ETD et les PTF en sa faveur ;
· Participer activement aux activités et projets
de développement afin de contribuer efficacement à
l'amélioration des conditions de vie de la communauté ;
· Exercer un contrôle citoyen et demander des
comptes aux institutions et services publics ;
· S'approprier et pérenniser les acquis du projet
IGA ;
· Sensibiliser et vulgariser les différents
mécanismes d'engagement citoyen pour leur mise en oeuvre
effective ;
· Promouvoir l'auto prise en charge et l'auto-promotion
communautaire pour la réalisation des programmes et actions de
manière indépendante et autonome ;
· Inculquer à la communauté la culture
fiscale afin de permettre à l'ETD d'avoir les moyens de sa politique.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici arrivé à la dernière phase de
notre travail de fin de deuxième cycle, qui a porté sur
« Engagement citoyen et développement des communautés
de base : Analyse des indicateurs et perspectives pour l'ETD de
Katoka. »
En abordant cette étude, l'objectif était de se
rendre à l'évidence si les mécanismes d'engagement
citoyen, source de participation active est la seule voie par excellence
d'éveiller la conscience de toutes les parties prenantes afin de
parvenir au développement durable et intégral de nos
communautés locales. Parce que, il se révèle que
l'engagement citoyen et la participation active des citoyens sont
considérés comme des éléments clé pour
améliorer la gouvernance locale, et la performance des programmes de
développement.
Pour atteindre cet objectif, notre préoccupation avait
tourné autour de trois questions fondamentales suivies des
hypothèses.Hormis l'introduction et la conclusion
générale, précédée de critiques et
suggestions, trois chapitres essentiels en ont constitué la
charpente.
Le premier parle des généralités sur les
concepts clés ayant constitué notre sujet, et la
présentation du milieu d'étude.Le deuxième a
été axé sur le développement local et le
mécanisme d'engagement citoyen.Enfin, dans le troisième et
dernier chapitre, nous avons parlé des indicateurs et perspectives
d'engagement citoyen et développement local dans la commune de
Katoka.
Dans cette étude, nous sommes partis des questions
suivantes :
F L'engagement citoyen et la participation peuvent-ils
être un socle de la réussite de projets de développement
des communautés locales ?
F Comment consolider la participation effective de toutes les
parties prenantes et leur engagement au développement local ?
F Quel est l'impact du mécanisme d'engagement citoyen
dans la commune de Katoka ?
Partant de ces questions nous avons posé trois
hypothèses :
F L'engagement citoyen et la participation active seraient le
socle du développement des communautés de base étant
donné qu'ils permettent aux citoyens de participer activement à
la gestion de leur entité et de demander des comptes aux dirigeants.
F Pour consolider la participation effective de toutes parties
prenantes, il serait important de sensibiliser et de les impliquer à
toutes les actions du développement de leurs communautés.
F A partir de l'intervention de DAI, la gestion de la commune
de Katoka paraîtrait transparente, participative et redevable.
Pour vérifier nos hypothèses et réaliser
notre travail, nous avons fait recours à la méthode
structuro-fonctionnelle qui nous a permis de considérer et
étudier la commune de Katoka comme une structure de développement
et comment elle se comporte en matière de développement local
participatif pour lutter contre la pauvreté et améliorer les
conditions de sa population. Car, cette méthode vise à
décrire et analyser la culture et le comportement des humains.
A ce niveau, la perception, le comportement et l'implication
de la population sont des éléments à travers lesquels on
peut mieux appréhender le sujet d'étude et comprendre la
situation. Elle a été appuyée par les techniques :
observation directe, documentaire, d'enquête, et d'interview.
En effet, en ce qui concerne la vérification de nos
hypothèses ou résultat d'enquête, les réponses aux
questions n°5, 6, 7 et 8(cfr Tableaux n°12, 13, 14 et 15).
Conformément à notre première hypothèse de
l'engagement citoyen et participation, socle de développement
local : à travers ceci, les citoyens participent activement aux
actions de développement, à la gestion de leur entité et
demandent des comptes aux dirigeants.
Quant à notre deuxième hypothèse, elle a
été vérifiée et affirmée par les
réponses aux questions n°7, 8, 9, 10, et 11(cfr. Tableaux
n°14, 15, 16, 17, et 18), constatant que toutes les parties prenantes sont
sensibilisées, impliquées et participent activement aux
initiatives locales, étant donné que 83% des
enquêtés apportent leurs contributions volontaires aux actions de
développement, le MEC est largement mis en pratique.
Concernant notre troisième et dernière
hypothèse, elle a été confirmée et
vérifiée à travers les réponses aux questions
n°12, 13, 14, 15 et 16(cfr Tableaux n°19, 10, 21, 22 et 23), car la
majorité de la population (61%) se félicite de la pratique de la
bonne gouvernance, caractérisée par la transparence, la
redevabilité et implication de la population par les autorités
locales grâce aux interventions de DAI, alors que cette nouvelle approche
est dans sa phase expérimentale.
En définitive, les résultats auxquels le travail
a abouti montrent que la mise en pratique de mécanismes d'engagement
citoyen demeure la clé de voute, la voie par excellence
d'éveiller la conscience de toutes les parties prenantes pour une
participation active au développement soutenable, équitable et
intégral des entités territoriales décentralisées
voulu par la constitution du 18 février 2006 ainsi que la loi organique
sur la décentralisation en RDC.
Nous croyons avoir laissé la voie de recherche, fort
enviée, libre pour les prochaines aventures scientifiques.
BIBLIOGRAPHIE
A. OUVRAGES
1. BAKAJIKA NtumbaWishiye, Décentralisation au
service de la paix, de la démocratie, du développement et de
l'unité nationale, Kinshasa, Ministère de la
Décentralisation et Aménagement du Territoire, 2010.
2. CALAME J., Projets de ville, projets de vie, esquisse
d'une théorie de l'action collective, Actes 5, 1991.
3. DEL BAYLE Jean Louis, Initiation aux méthodes de
sciences sociales, Paris-Montréal, Harmatan, 2000.
4. GORE, G., l'organisation communautaire,
définition et paradigme, volume3, numero2-3, Laval, 1986.
5. GOUTTEBEL. J. Y. « Stratégies de
développement territorial », 2èmeEd. Economica, Paris,
2003.
6. Greffe X., Le développement local,
Bibliothèque des territoires, Ed. De l'aube DATAR, Paris, 2002.
7. IRSC, Guide de l'engagement des citoyens, Canada, 2011.
8. Jean-Paul Carrière, La Mise En OEuvre De
Systèmes D'indicateurs Locaux, SE, 2005
9. KABEMBA TUBELANGANE, B.A., Méthode et nouveau
code scientifique, édition BEHD, Kananga-Kinshasa, 2014.
10. KADIEBUE B., Théorie de Conditions prioritaires
du développement, Kinshasa, Presse Universitaire du Congo, 2010.
11. KALUNGA Mawezo, et alii, les méthodes de
recherche et analyse en sciences sociales et humaines : une lecture de la
christologie de la scientificité interjective, édition,
EDUPC, Kinshasa, 2013.
12. KANDU Kayembe, André,
Décentralisation-Découpage territorial en RD Congo, «
Problème ou solution ?», Kinshasa, Ed. La confidence, 2017.
13. Lynda Champagne et Jean François Marcal,
L'engagement citoyen : fondements et pratiques, La démocratie, la
citoyenneté et les défis de la citoyenneté
contemporaine, AQOCI, Montréal Québec, 2011.
14. MALESE, J., Pratique de la recherché
opérationnelle de la gestion, Ed. DUNOD PARIS, 1967.
15. MULOWAYI Dibaya, S.E., Manuel et lexique de
sociologie général, éd. PUK, Kananga, 2013.
16. MULUMBATI Ngasha, Manuel de sociologie
générale, édition Africa, Lubumbashi, 1980.
17. NOLEX FONTIL, Projet communautaire en Haïti :
Méthodologie d'Analyse des besoins locaux, Mémoire de DEA en
Développement, département gestion et administration, management
de projet, l'Université Senghor, 2009.
18. NTUMBA Ngandu, P., Guide de rédaction d'un
travail de recherche scientifique, ISP/Kananga, 2011.
19. PAQUET, G. (2010). Révolution tranquille :
déconstruire et fonder ? Bilan et prospectives au Dixième
Colloque Annuel du CIRCEM (13-15 octobre 2010).
20. PARRET, H., les passions. Essai sur le discours de la
subjectivité, Ed. Mardaga, Bruxelles, 1986.
21. PECQUEUR B., le développement local, Syros
Collections Alternatives économiques, Paris, 1989.
22. PECQUEUR et ZIMMERMAN, fondements théoriques du
Développement local : quels apports du capital social et
l'économie de proximité, In « Economie et Institutions
», Open Edition, Paris, 2005.
23. PIAGET, J., le jugement moral chez l'enfant, PUF,
Paris, 1969.
24. RIST Gilbert, développement, histoire d'une
croyance occidentale, édition Presse de sciences, Paris, 1996.
25. SALBERG, J.E, Suzanne WEILSH-BONNARD, Action
communautaire, Paris, Éditions ouvrières, 1970.
26. TEISSERENC P., les politiques de développement
local, Economica, Paris, 2002.
27. TREMBLAY, Diane-Gabrielle et Vincent VAN SCHENDEL,
Économie du Québec et de ses Régions,
Télé-Université, Éditions Saint-Martin, 1991.
28. Yao ASSOGBA, Développement communautaire en
Afrique : comprendre la dynamique des populations, Québec, presse
de l'Université de QUEBEC, 2008.
B. DICTIONNAIRE
1. Dictionnaire Larousse illustré, édition
Larousse, Paris, 2009.
2. Dictionnaire Du Français Contemporain.
C. TRAVAUX DE FIN DE CYCLE, MEMOIRES ET
THESES
1. FUMWAWAU Kiniati J, les déterminants du
chômage parmi les jeunes diplômés d'université de
20-24 ans dans la ville de Kinshasa : avec interprétation statistique,
mémoire Faculté SPA, UNIKIN, 2015.
2. KAMAL El-Ba TA, La Gouvernance Synergique : Une
Stratégie De Développement Local Cas Des Municipalités
Régionales De Comté Québécoise, Thèse De
Doctorat En Administration (Dba), Université de Québec - à
Rivières, Canada, juin 2012.
3. KATEMBUE Kabeya, Entités Décentralisées
et Démocratie. Analyse prospective au Lac Mukamba, dans le Territoire de
Dimbelenge, Mémoire de licence, IDRS-T, 2011.
4. NGOYI TuelekejiJean Paul, « problématique de la
participation communautaire au processus de développement de la ville de
Kananga, expérience de l'INADES-FORMATION, mémoire de licence
(2019-2020 à l'ISES/KANANGA).
5. NOLEX FONTIL, projets de développement
communautaire en Haïti : méthodologie d'analyse des besoins
locaux, département de gestion et administration, management de projet,
mémoire de troisième cycle, l'Université Senghor
d'Alexandrie, 2009.
6. 7. TAGUET Younes, Gouvernance territoriale et
développement local : Illustration par le cas de la zone
d'activités de la commune d'El-KSEUR, Mémoire En vue de
l'obtention du diplôme de master En Management Economique Des Territoires
et Entrepreneuriat, Faculté des Sciences Économiques,
Commerciales et des sciences de Gestion Département des Sciences de
Gestion, Université A. MIRA de Bejaia, 26/ septembre / 2014.
D. COURS INEDITS
1. BAKOLE Muanza, M., Notes de cours de méthode de
recherche en sciences sociales, G2 GAP, ISES/Kananga, 2017
2. BAMBI BungiClémentine, Notes des planification et
Approche intégrée du développement, L1 GAP, ISES/Kananga,
2019-2020.
3. IVUDI Crispin, notes de cours de l'Aspect juridique du
développement communautaire, L1 GAP, ISES/Kananga, 2019-2020.
4. KABUE Mbala Simon, Notes de cours de psychosociologie de
communautés de base, L2 GAP, ISES/Kananga, 2020-2021.
5. KAPINGA MuambaSophie, notes de cours inédit,
Développement communautaire I, G1- GAP, ISES/Kananga, 2017-2018.
6. MUAMBA Bakatubenga, T., Notes de cours d'Initiation
à la recherche scientifique, G2, ISTM-Kananga, de Kananga, 2016-2017.
Inédit.
7. MUKADI Luaba, H., Cours inédit d'Initiation à
la recherche scientifique, G1, ISES-Kananga, 2012-2013.
8. NGINDU Kalala, Cours de décentralisation et
développement local, ISC, 2016.
9. NZANDA BuanaKalemba, cours de Théories de
développement et Sociologie de développement, L1/ECO, ULK,
2007-2008.
10. OKONDO, K. cours de communication sociale, G3 ISDR-T,
2014.
E. REVUES, ARTICLES ET AUTRES DOCUMENTS
1. Benoît XVI, Pape, Encyclique « Caritas
in veritate »,2009.
2. DIEU A.M., processus de l'engagement volontaire et citoyen
: des valeurs des individus, des associations.
3. Loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des ENTIT2S territoriales
Décentralisées.
4. MATUNGULU, A.E, Mécanisme d'engagement citoyen,
Mobile de formation, DAI/PBG, 2008.
5. NZANDA BuanaKalemba, Principaux problème de gestion
de développement au Congo (RDC), sur fond de l'expérience
empirique au Congo-Zaïre, Lettre de l'IRES. NS 2-3, 2008.
6. Rapport INS 2018-2019.
7. Rapport mondial sur le développement humain du PNUD,
1995, RDC.
8. Rapport National Du PNUD Sur Le Développement Humain
2008, RDC.
9. Réussir la décentralisation : CCAP, SegTaaba
Volume 2004, n°2 Dialogue citoyen Bénin : Les concepts-clés
de la citoyenneté, SOS Civisme Bénin, Mars 2017.
10. « Une conception juridique de la citoyenneté
», interview de Claudia Moatti, in « La citoyenneté romaine
», TDC n° 1092, 15 mars 2015.
11. La Décentralisation en bref, CTAD, Kinshasa,
2013
F. WEBOGRAPHIE
1. https://equitas.org,
consulté le 10/10/2020
2. https://equitas.org,
consulté le 11/10/2020
3. https://fr.wikipedia.org)
4.
https://fr.wikipedia.org/wiki/dennis
5. Voir l'article « citoyenneté » dans le
lexique du Guide républicain, Arkoun M., Azema J.-P., Badinter E. et
al., Delagrave/CNDP, 2004, [en ligne] :
www2.cndp.fr/laicite/pdf/guideabecedaire.pdf, consulté le 22/11/2020
6. www.banquemondiale.org
ANNEXES
I.QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
Sujet de l'étude :
« Engagement citoyen et développement des
communautés de base : Analyse des indicateurs et perspectives pour
l'ETD de KATOKA. »
I. IDENTIFICATION DE L'ENQUETE
1. Identification de l'enquêté selon
le sexe :

a. Masculin b. Féminin
2. Identification de l'enquêté selon
l'âge :






a. [20-30] b. [31-40] c. [41-50] d.[51-60]
e.[61-70] [71- et plus ]
3. Identification de l'enquêté selon le
niveau d'étude :

a. Sans niveau

b. Niveau primaire

c. Niveau secondaire

d. Niveau supérieur
4. Identification de l'enquêté selon
l'Etat civil :


1. Célibataire :
2. Marié (e) :

3. Divorcé (e) :

4. Veuf ( ve) :
5. Identification de l'enquêté selon la
Structure d'appartenance


a) OSC (organisation de la société civile) :

b) Chef du quartier :
c) ETD :

d) Leaders communautaires :

e) RECO :

6. Profession de l'enquête
a. Débrouillard/libéral

b. Opérateur économique/commerçant


c. Fonctionnaire de l'EtatM

d. Agent de développement

e. Etudiant
f. Sans emploi
II. QUESTIONS PROPREMENT DITES
1. Avez-vous déjà entendu parler du
mécanisme d'engagement citoyen ?



a. Oui b. Non c. Sans avis
2. Comment l'avez-vous su ?
Réponse :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Avez-vous déjà suivi une formation en
rapport avec le mécanisme d'engagementcitoyen ?



a. Oui b. Non c. Sans avis
4. Quel organisme ou structure avait organisé
cette formation ?
Réponse :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Quels est le mécanisme d'engagement citoyen
connaissez-vous parmi ceux énumérés
ci-dessous :

a. Participation citoyenne

b. Carte score communautaire

c. Audience publique

d. Redevabilité

e. Tribune d'expression populaire

f. Forum citoyen

g. Plaidoyer

h. Audition législative

i. Dialogue par action

j. Mobilisation

k. Conscientisation communautaire
6. Ces mécanismes sont-ils opérationnels
dans votre entité (commune, quartier, localité) ?



a. Oui b. Non c. Sans avis
7. Comment faites-vous pour y
parvenir ?
Réponse..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8. Quelles sont les activités
réalisées dans votre entité avec la contribution
locale ?

a. Assainissement du milieu et des routes

b. Lutte antiérosive

c. Construction des infrastructures socio-économique de
base (Ecole, Centre de santé, WC publics, source d'eau...)
9. Participez-vous à la prise de
décision concernant les actions ou les activités de
développement de votre commune ?


a. Oui b. Non
10. Comment ?
Réponse.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11. Comment trouvez-vous les moyens pour
exécuter les activités de développement dans votre
milieu ?
Réponse.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Quels sont les avantages du mécanisme
d'engagement citoyens dans votre commune de Katoka ?


a. Développement communautaire

b. Participation citoyenne

c. La bonne gouvernance

d. La transparence

e. La redevabilité
f. La démocratie
13. Quels sont les changements positifs avez-vous
enregistrés grâce au mécanisme d'engagement
citoyen ?
Réponse.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Comment jugez-vous la manière dont la
commune de Katoka est gérée par les autorités
locales ?

a. Mauvaise

b. Très mauvaise

c. Assez bonne
d. Très bonne

e. Aucun avis
15. Les autorités de KATOKA sont-elles
accessibles et favorables aux initiatives de de développement de votre
commune ?


a. Oui b. Non
16. Que pouvez-vous suggérer pour le
développement de votre entité ?


a. Participation active de la population aux actions de
développement
b. Obligation de rendre compte à la population

c. Associer d'autres acteurs aux actions de
développement de l'entité,

ONG, Organisations de la société civile

d. Collaboration entre toutes les parties prenantes
e. Observance stricte des mécanismes d'engagement
citoyen
Fait à Kananga, le ........./........./2021
Paul Sylvain MBAYA LUMBALA
II.FICHE TECHNIQUE
1. Titre du projet :« Formation sur l'Auto-prise en
charge communautaire dans la commune de Katoka ».
2. Organisation requérante : PNUD
3. Organisation d'exécution : GRONGD
4. Localisation : ville de Kananga, Kasaï central
5. Domaine d'intervention : socio culturel
6. Population cible :
F Bénéficiaires directs : les habitants de la
commune de Katoka
F Bénéficiaires indirects : population de la
ville de Kananga.
7. Durée du projet : 7 mois
8. Bailleur de fonds : PNUD (programme des nations
unies qui finance les
projets de développement)
9. Financement :
a) Apport local : 6.910,00$
b) Montant sollicité : 62.197,25$
10. Cout total du projet : 69.107,25$
III.PROPAL
TITRE DU PROJET :
FORMATION SUR L'AUTO-PRISE EN CHARGE COMMUNAUTAIRE DANS LA COMMUNE DE
KATOKA.
1. Contexte et justification
Aucun projet de société ne peut se
réaliser sans l'engagement et la pleine participation de tous les
membres du corps social concerné. De la même manière que
les sociétaires voudraient jouir des bénéfices de leur
projet, ils devraient en faire autant pour leur implication à sa
concrétisation.
Le développement impose de sacrifices, par
conséquent les efforts à sa réalisation doivent être
partagés fournis des manières équitables avec la
même exigence que celle requise dans la jouissance de ses
bénéfices. Elle sous-entend que pour réussir un projet de
développement, il faudrait que tout le monde s'engage et participe
résolument à un niveau quelconque si pas à tous les
niveaux.
C'est pourquoi, il est nécessaire que toutes les
catégories de la population participent au processus de
développement, la participation et l'engagement populaire à la
prise de décision et des institutions démocratiques offrent aux
différentes couches de la population la possibilité d'exprimer
leurs points de vue concernant la marche de leur société et
participer à la gestion de la chose publique.
La pertinence, encore moins la quintessence de ce projet
consiste à aider la communauté à prendre conscience de ses
responsabilités sachant que l'engagement et la participation des
citoyens sont des éléments clés d'autodétermination
pour améliorer la bonne gouvernance, la performance de programme de
développement.Cette dimension fondamentale découle de la prise de
conscience et de l'engagement responsable entant que citoyen à part
entière pour prendre en compte ses obligations, la promotion de se
droits et d'en jouir.
De ce qui précède, il y a lieu de souligner que
la population de Katoka n'a pas encore atteint la maturité voulue pour
se prendre en charge à travers des actions citoyennes, la participation
à la gestion de la chose publique, à la bonne gouvernance.
Ainsi,ceci permettra au peuple de participer efficacement, activement et
consciencieusement à l'autopromotion, à la gestion de la chose
publique, au contrôle citoyen et la bonne gouvernance.
2. Description du projet
Le projet prévoit une série d'activités
et d'actions capables de susciter la prise de conscience de la population
deKatoka pour l'auto - prise en charge communautaire et son autopromotion.
Pour y parvenir, la mise en oeuvre vaprendre en compte des
séances de sensibilisation, comprenant :les tribunes d'expression
populaire, la carte score commu-nautaire, les sessions de formation sur le
contrôle citoyen, le leadership transformationnel, l'engagement citoyen,
la rédevabilité, la participation citoyenne à la gestion
de la choses publique, éducation électorale (en prélude
aux élections municipales, locales et urbaines), le plaidoyer. Plusieurs
outils de communication seront mis en contribution pour l'atteinte des
objectifs.
3. Le promoteur du projet
· CRONG Kasaï Central
Ce projet sera porté par CRONG / Kasaï central
étant donné que cette organisation a une longue expérience
avérée en cette matière et jouit de la confiance et
crédibilité des plusieurs bailleurs des fonds et partenaires
bilatéraux et multilatéraux évoluant dans ce domaine
(PTF).
4. Objectifs
A) Objectif global : Promouvoir la participation
citoyenne à la bonne gouvernance pourun développement durable.
B) Objectifs spécifiques
· Susciter l'engagement citoyen et la participation de la
population à la gestion de la chose publique ;
· Former et sensibiliser les OSC à la
transparence, redevabilité et contrôle citoyen
· Susciter l'esprit d'initiative pour un
développement endogène.
· Renforcer les capacités en culture
électorale et démocratique.
5. Stratégies
· Formations des cibles ;
· Sensibilisation, conscientisation et animation
communautaire ;
· Création des points focaux ;
· Recrutement.
· Initiation des AGR
6. Activités
· Organisation de 16 sessions de formations en faveur des
sensibilisateurs, mobili-sateurs,vulgarisateurs sur l'engagement citoyen, la
redevabilité, la culture démocratique et électorale.
· Constitution des 25 points focaux après chaque
formation dans chaque quartier voire 25 localités comme centre de
vulgarisation du mécanisme d'engagement citoyen, de culture
démocratique et électorale.
· Organisation des tribunes d'expression populaire dans
chaque quartier sur la collaboration entre la communauté et les
autorités politico-adminis-tratives, policières et militaires et
élus ;
· Implantation des panneaux dans les 5 quartiers sur la
culture électorale, démo-cratique, mécanisme d'engagement
citoyen.
· Diffusion des messages et théâtres
participatifs sur l'auto prise en charge communautaire ;
· Elaboration et distribution de 5.000 exemplaires de
dépliants ;
· Suivi-évaluation ;
· Rapportage ;
· Audit.
7. Résultats attendus
· 625 personnes formées sur différentes
thématiques susmentionnées (60% d'hommes et 40% de
femmes) ;
· 10 tribunes d'expression populaires sont tenues en
raison de deux par quartiers ;
· 125 points focaux et vulgarisateurs sont
sélectionnés en raison de cinq par localités ;
· 5.000 exemplaires des dépliants sont produits et
distribués ;
· 25 panneaux sont implantés dans toutes les 25
localités ;
· 625 copies des modules produits à l'intention
des participants ;
· La communauté formée et
sensibilisée à l'autopromotion et l'auto prise en charge.
· Plus de 60% connait ses droit et devoirs
· Les AGR sont initiées.
8. La coordination ou comité d'exécution
La mise en oeuvre de ce projet se fera par une équipe
technique(exécutive) qui sera composée :
· Directeur du projet
· Assistant administratif et financier
· Chargé de programme
· Comptable
· Caissier
· Logisticien
· Informaticien
· Chauffeur
9. Partenaires locaux du projet
Pour arriver aux résultats escomptés
c'est-à-dire la promotion de l'auto-prise en charge, ce projet aura
comme partenaire local de mise oeuvre :
F Consortium BECADI COFERD :qui militent
pour la bonne gouvernance locale et le développement soutenable à
la base, la promotion féminine ainsi que l'autonomisation de la femme
rurale.
10. Suivi et évaluation
Le suivi et évaluation se feront par l'entremise de
l'INADES Formation antenne du Kasaï dont l'expertise et
l'expérience en la matière ne sont pas à démontrer.
Pour ce faire un plan de suivi et évaluation sera
élaboré enfin de suivre de plus près la mise en oeuvre et
le management du projet pour ajuster, réajuster aux besoins ce qui peut
l'être.
11. Chronogramme d'activités
|
N°
|
Activités
|
Périodicité
|
|
Ja
|
Fe
|
Ma
|
Av
|
M
|
Ju
|
Juil
|
|
01
|
Organiser les sessions des formations
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
Constitution des points focaux dans chaque quartier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
Organiser les tribunes d'expression populaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
Implantation des panneaux dans 25 localités
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
Productions des messages radiodiffusées et
théâtres participatifs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
Production des modules des formations
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
Elaboration et distribution de dépliants
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
Organisation de la carte score communautaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09
|
Suivi évaluation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Elaboration et rédaction du rapport final
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Audits
|
|
|
|
|
|
|
|
12. Budgétisation
|
N°
|
Libellé
|
Unité
|
Qté
|
C.U ($)
|
C.T($)
|
|
1
|
I. Formation
Phase préparatoire
F Réunion du staff du projet ;
F Rencontre avec les autorités ;
F Communication ;
F Conception de TDR
|
Pers.
Pers.
Crédit
|
5
2
Ff
|
25
20
Ff
|
125
40
25
|
|
Sous total
|
|
190
|
|
II. Formation
F Remise à niveau de formateurs ;
F Prime de formateurs x16 formateurs ;
F Location salle (50 x 16 x 6jours)
F Restauration participants (16 x 25 x 6jours)
F Remboursementtransport
|
Pers.
Pers.
Salle
Pers.
Pers.
|
5
5
1
625
625
|
50
100
50
10
5
|
250
8.000
4.800
24.800
12.000
|
|
Sous total
|
|
49.850
|
|
III. Equipement
F Marqueurs
F Production modules ;
F Papiers duplicateurs,
F Cartes de note ;
F Farde chemise ;
F Production banderoles,
F Mégaphone ;
F Panneaux ;
F Productions des dépliants ;
F Piles ;
F Bic.
|
Bte
1
Rame
Pot
Pc
Pc
Pc
Pc
Pc
Bte
Bte
|
16
625
20
65
625
5
25
25
5.000
10
15
|
10
5
5
12,50
0,15
50
25
100
1
30
12
|
160
3.125
100
812,5
93,75
250
250
2.500
5.000
300
180
|
|
Sous total
|
|
13.146,25
|
|
IV. Media
Emission + théâtre + message
|
|
2
|
700
|
1.400
|
|
Cout administratif 7%
|
|
|
|
4.521
|
|
Total général
|
|
|
|
69.107,25
|
Nous disons : dollars américains
soixante-neuf mille cent et sept point vingt-cinq
13. Cadre logistique
|
Logique d'intervention
|
IOV
|
Sources de vérification
|
Hypothèses
|
|
Objectif
Global
|
- Promouvoir et encourager la participation, la bonne gouvernance
pour un développement endogène soutenable
|
La communauté a pris conscience et participe à la
gestion de la chose publique et présente des initiatives de
développement
|
- Le contrôle citoyen exercé ainsi que la
redevabilité sont appliqués ;
- Rapport de sensibilisation
F Exécution de certains projets
|
F Que le bailleur finance
|
|
Objectifs spécifiques
|
-Susciter l'engagement citoyen et la participation citoyenne
à la gestion de la chose publique
-Former et sensibiliser les OSC à la transparence,
rédevabilité et l'exercice du contrôle citoyen ;
-Inculquer l'esprit d'initiatives locales ;
-Renforcer les capacités en culture électorale et
démocratique
|
- Les membres de la communauté sont formés et
sensibilisés à l'auto -prise en charge communautaire ;
- Certaines actions de développement local sont
entreprises ;
- Le contrôle citoyen et la rédevabilité sont
exercés ;
- La communauté a pris conscience de ses droits et
obligations et les réclame
|
- Les rapports de vulgarisateurs et points focaux ;
- Rapport de sondage d'opinion,
- Rapport d'écoute des émissions radio
diffusées
|
- Non implication de la communauté
|
|
Résultats attendus
|
-Formation des membres de la communauté sur
différentes thématiques
F Tenue des tep ;
F Les points focaux formés ;
F Production des dépliants ;
F Implantation des panneaux ;
F Production des modules de formation
|
- 625 personnes sont formées en 16 sessions ;
- 10 TEP sont organisées
- 5.000 exemplaires des dépliants sont produits ;
- 25panneaux implantés ;
- La communauté est formée et sensibilisée
pour l'auto - promotion ;
- La connaissance de la culturelle démocratique et
électorale sont accrues
- Les AGR sont initiées.
|
- Les listes des participants ;
- Rapport de formation ;
- Nombre des tep et plaidoyers organisés
- Dialogue entre gouvernants et gouvernés,
- Existence des ponts focaux ;
- Audiences publiques organisées
|
- Opacité des dirigeants ;
- Désintéressements spontanés de la
communauté
|
|
Activités réalisées
|
1. Formation par session ;
2. Constitution des points focaux ou noyaux
communautaires ;
3. Organisation de tep ;
4. Tenue des audiences publiques ;
5. Implantation des panneaux dans les 5 quartiers
6. Diffusions des messages et théâtres
participatifs ;
7. Production et distribution de modules et des
dépliants ;
8. Séances de sensibilisation et vulgarisation des
textes légaux.
|
F 16 sessions de formations organisées ;
F 5.000 exemplaires des dépliants
disponibilisés ;
F 125 noyaux communautaires installés ;
F Message et théâtre participatif
diffusées ;
F Rapport de formation
|
- Listes des participants ;
- 5 formateurs ;
- Rapport financier ;
- Modules de formation selon la thématique ;
- Les dépliants distribués ;
- Les médias diffusent les activités ;
-16 salles de réunions louées
- l'existence des termes de référence
|
- Stabilité politique
- La sécurité.
|
Fait à Kananga, le 10 /10 /2021
Paul
Sylvain MBAYA LUMBALA
Directeur du Projet
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
Erreur ! Signet non
défini.
DEDICACE
II
IN MEMORIAM
III
REMERCIEMENTS
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
V
0.INTRODUCTION
1
0.1.CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
0.2.ETAT DE LA QUESTION
5
0.3.PROBLEMATIQUE
8
0.4.HYPOTHESES
10
0.5.METHODOLOGIE
10
0.5.1. Méthode
10
0.5.2. Techniques
12
0.6. DELIMITATION DU SUJET
12
0.7. DIVISION DU TRAVAIL
13
0.8. DIFFICULTES RENCONTREES
13
CHAPITRE I : GENERALITES
SEMANTIQUES
14
1.1.SECTION I : CONCEPTUALISATION
14
1.1.1. Mécanisme
14
1.1.2. Engagement
14
1.1.3. Citoyen
15
1.1.4. Engagement citoyen
16
1.1.5. Mécanisme d'engagement citoyen
16
1.1.6. Développement
16
1.1.7. Développement durable et
équitable
18
1.1.8. Développement
intégré
18
1.1.9. Développement participatif
18
1.1.10. Développement intégral
19
1.1.11. Développement
autocentré(autogéré)
19
1.1.12. Développement communautaire
19
1.1.13. Développement alternatif
20
1.1.14. Développement local (de
communauté de base)
20
1.1.15. Communauté
20
1.1.16. Communauté de base ou
Communauté locale
21
1.1.17. Analyse
21
1.1.18. Indicateur
22
1.1.19. Perspective
22
1.1.20. Entité Territoriale
Décentralisée (ETD)
22
1.2.SECTION 2 : PRESENTATION DE LA
COMMUNE DE KATOKA
23
1.2.1. Situation historique
23
1.2.2. Situation géographique
23
1.2.2.1. Localisation de la commune de Katoka
23
1.2.2.2. Climat, relief et
végétation
23
1.2.2.3. Situation démographique et
administrative
23
1.2.3. Situation économique
24
1.2.4.Organisation et fonctionnement
25
1.2.5.Fonctionnement
26
CHAPITRE II : DEVELOPPEMENT LOCAL ET
MECANISME D'ENGAGEMENT CITOYEN (MEC)
27
2.1.SECTION 1 : THEORISATION DU
DEVELOPPEMENT LOCAL (DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES DE BASE)
27
2.1.1.Caractéristiques du
développement local
28
2.1.2.Pour un développement local
réussi
29
2.1.3.La Planification du développement
Local
30
2.1.4.Le développement local : logique,
outil, cadre d'action
31
2.1.4.1.Les logiques du développement local
32
2.1.4.2.Valorisation de ressources territoriales
33
2.1.4.3.Action collective
33
2.1.5.Quel cadre institutionnel pour les actions de
développement local ?
34
2.1.6.Théorie de la
décentralisation
35
2.1.7.De l'importance des coordinations locales dans
le développement
38
2.2.SECTION 2 : THEORIE DU MECANISME
D'ENGAGEMENT CITOYEN
40
2.2.1. Origine
40
2.2.2. Genèse de la construction du sens
moral chez l'être humain dans L'engagement citoyen volontaire
41
2.2.3. Objectif de l'engagement citoyen
43
2.2.4. Conséquence du mécanisme
d'engagement citoyen
44
2.2.5. Avantages du MEC
44
2.2.6. Inconvénients du mec
45
2.2.7. Mise en pratique du MEC dans la
communauté
45
2.2.7.1. Engagement
46
2.2.7.2. La participation
46
2.2.7.3. Le Contrôle citoyen
47
2.2.7.4. Les éléments clés du
CCAP
48
2.2.7.5. Les acteurs et les champs du CCAP
49
2.2.7.6. La redevabilité
50
2.2.7.7. La démocratie
50
2.2.8.Résultats du mec dans la
communauté
51
2.3.SECTION 3 : LES PILIERS DU
DEVELOPPEMENT LOCAL
52
2.3.1. Dimensions du développement local au
niveau terminologique
56
2.3.2. Objectifs du développement local
57
2.3.3. Prérequis du développement
local
57
2.3.3.1. Existence d'une communauté locale
57
2.3.3.2. Partenariat
58
2.3.3.3. Environnement et un climat propice à
l'action
58
2.3.3.4. Maximisation de la participation civique
59
2.3.4. Les 4 conditions clés du
développement local :
60
CHAPITRE III : INDICATEURS ET
PERSECTIVES D'ENGAGEMENT CITOYEN ET DEVELOPPEMENT LOCAL DANS LA COMMUNE DE
KATOKA
61
3.1. INDICATEURS DU DEVELOPPEMENT DANS UNE
COMMUNAUTE DE BASE
61
3.1.1. Opérationnalisation des indicateurs du
développement local
63
3.2.1. But de l'enquête
64
3.2.2. Préparation de l'enquête
65
3.2.3. De l'échantillonnage
65
3.3. DEPOUILLEMENT, PRESENTATION ET
INTERPRETATION
66
SECTION 1 : PROFIL SOCIOLOGIQUE DES
ENQUETES
66
3.3.1.Présentation de
l'échantillon
66
SECTION 2. DEPOUILLEMENT, ANALYSE ET
INTERPRETATION
70
3.3.1.Analyse des indicateurs et perspectives
86
3.3.2 Impact du mec dans la commune de Katoka
87
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
88
A.CRITIQUES
88
B.SUGGESTIONS
88
CONCLUSION GENERALE
90
BIBLIOGRAPHIE
92
ANNEXES
95
I.QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
95
II.FICHE TECHNIQUE
99
III.PROPAL
100
TITRE DU PROJET : AUTO-PRISE EN CHARGE
COMMUNAUTAIRE DANS LA COMMUNE DE KATOKA.
100
TABLE DES MATIERES
108




