
UFR Sciences de l'Homme et de la
Société
Département Sciences de
l'Education
Laboratoire CIVIIC
Année Universitaire 2014-2015
La conception de l'éducation chez
les betsimisaraka : analyse
à
travers les proverbes
(cas du village de Rantolava)
En vue de l'obtention du
Master 2 de recherche à distance Francophone
Sous la direction de France JUTRAS,
Professeur à
l'Université de Sherbrooke,
et de Pierre-Philippe
BUGNARD,
Professeur à l'Université de Fribourg
Suisse
Wenceslas Ludovic TOTO N° d'étudiant : 21312340
REMERCIEMENTS
Je remercie l'Agence Universitaire de la Francophonie et
l'Université de Rouen qui m'ont donné l'opportunité de
suivre la formation de MARDIF. Sans allocation d'études de ladite
agence, je pense que je n'ai pas pu être inscrit dans cette
université.
Mes remerciements s'adressent également à
l'ensemble du personnel enseignant et administratif du département de
Sciences de l'éducation (MARDIF), avec une mention particulière
à Madame JUTRAS France et Monsieur BUGNARD Pierre-Philippe. En effet, en
leur qualité de directeurs de mémoire, ils ont toujours fait
preuve de disponibilité tout en orientant mon travail vers les exigences
scientifiques.
Mes remerciements s'adressent aussi à tous ceux qui ont
contribué de loin ou de près à la réalisation de ce
travail tels que les autorités locales, les Tangalamena du village de
Rantolava et les notables locaux.
Je suis également reconnaissant envers ma femme pour
tous les sacrifices qu'elle a pu endurer, notamment ces derniers temps. Elle
s'est sentie parfois négligée pour laisser place à la
recherche et à la rédaction.
Merci à vous tous !
TOTO, Wenceslas Ludovic
LA CONCEPTION DE L'EDUCATION CHEZ LES BETSIMISARAKA :
ANALYSE A TRAVERS LES PROVERBES. Cas du village de
Rantolava.
RESUME
Historiquement, le territoire betsimisaraka a
été peuplé de trois clans différents, tels que les
Tavaratra (au Nord), les Tsikoa (au Centre) et les Tatsimo (au Sud). Il s'agit
d'un territoire situé dans la partie orientale de Madagascar. Comme
l'ensemble de la société malagasy, la
société betsimisaraka est une société de
l'oralité. Et, selon FANONY Fulgence, les traditions orales
betsimisaraka présentent une variété de genres
qu'on peut classifier en trois grandes catégories (les genres narratifs,
les genres sapientiaux et les genres poétiques). Les proverbes qui
constituent le centre de cette recherche, appartiennent aux genres
sapientiaux.
La civilisation de l'écriture proprement dite n'est
arrivée à Madagascar que très tardivement (avec la venue
des Européens, vers le XIXème siècle). L'éducation
se faisait alors de manière traditionnelle. Elle s'est transmise
à travers des « lövan-tsôfiñy »
(héritage de l'oreille), de bouche à l'oreille. Cette
éducation est assurée par toute personne en statut
d'aîné. Par ailleurs, malgré les diverses traditions
orales, on observe que seuls les proverbes restent les plus utilisés
dans la société contemporaine.
Puisés dans l'expérience de la vie, les
proverbes présentent un aspect éducatif considérable. Ils
nous transmettent des normes qu'exige la société ainsi que son
mode de fonctionnement. A travers les proverbes, nous sommes en mesure de
dégager les priorités éducatives dans la
société betsimisaraka. La recherche effectuée
montre qu'ils constituent un genre littéraire à vocation
pédagogique. La dimension pédagogique des proverbes se
présente en deux ordres : une pédagogie dite
« directe » avec une instruction à suivre
impérativement, d'où la formule de mise en garde « Aza
» (ne [...] pas) ; et la pédagogie dite « indirecte
», laissant un libre cours à la recherche et à la
méditation du sujet.
Cependant, avec l'évolution de la société
et l'arrivée de l'école de type occidental, la
société betsimisaraka, et le village de Rantolava en particulier
se trouvent actuellement entre la tradition ancestrale et la modernité
occidentale. Cette situation menace la sagesse et les valeurs culturelles
malagasy qui commencent à se dégrader. Et, malgré la prise
en compte de ces valeurs culturelles dans le programme scolaire, le champ
d'application est vraiment limité compte tenu de cette évolution
de la société. C'est ainsi que nous proposons quelques
suggestions pour pallier la situation. Notre suggestion est orientée
vers la fusion du système éducatif de type traditionnel et le
système de type occidental.
1
Mots-clés :
culture, éducation, pédagogie, proverbe,
société.
2
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS
RESUME 0
SOMMAIRE 2
LISTES DES CARTES, GRAPHIQUES, PHOTOS ET TABLEAUX 3
INTRODUCTION 4
PREMIERE PARTIE - THEMATIQUE, TERRAIN D'ETUDES
ET
APPROCHES METHODOLOGIQUES 8
CHAPITRE I -JUSTIFICATION DU THEME ET METHODOLOGIE DE TRAVAIL
9
I.1. La présentation de la recherche 9
I.2. Les approches méthodologiques adoptées et
leurs justifications 19
CHAPITRE II - NOTRE TERRAIN D'ETUDES : LE VILLAGE DE
RANTOLAVA 27
II.1. Une brève présentation
historio-géographique 27
II.2. Place de l'éducation au village de Rantolava
30
DEUXIEME PARTIE : RESULTATS ET INTERPRETATIONS
45
CHAPITRE III- LES PROVERBES : UN GENRE LITTERAIRE A
VOCATION
PEDAGOGIQUE POUR LES BETSIMISARAKA 46
III.1. L'art oratoire au quotidien 46
III.2. Société betsimisaraka : une école
de la vie par les proverbes 51
CHAPITRE IV - APPROCHES PEDAGOGIQUES D'UNE ECOLE SANS
MURS EN
PAYS BETSIMISARAKA 68
IV.1. Une pédagogie de deux ordres 68
IV.2.Les proverbes au quotidien en pays betsimisaraka
72
TROISIEME PARTIE : DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES
75
CHAPITRE V - LA PLACE DES TRADITIONS ORALES ET DES
VALEURS
MALAGASY DANS LE PROGRAMME SCOLAIRE 76
V.1. Dans les écoles primaires 76
V.2. Dans les collèges 80
V.3. Dans les lycées 84
CHAPITRE VI - LES LIMITES DU CHAMP D'APPLICATION 86
VI.1. Les réalités sociales 86
VI.2. Quelques suggestions 90
CONCLUSION 96
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 99
GLOSSAIRE 101
3
LISTES DES CARTES, GRAPHIQUES, PHOTOS ET TABLEAUX
Liste des cartes
Carte 1 - Localisation de la Commune Rurale d'Ampasina
Maningory par rapport à la
Région Analanjirofo 29
Carte 2 - Carte de
la Commune rurale d'Ampasina Maningoro où se trouve le village
de
Rantolava 30
Liste des graphiques
Graphique 1 - Taux de réussite aux examens du C.E.P.E
au cours des cinq dernières
années 32
Graphique 2 - Taux de réussite par sexe de 2009-2010
à 2013-2014 33
Liste des photos
Photo n°1 : Centre de Formation Pédagogique de
Rantolava...................... 31
Photo n°2 : Ecole Primaire Publique de Rantolava
................................... 31
Liste des
tableaux
Tableau 1- Synthèse du programme lié à
la culture et aux valeurs traditionnelles au
niveau du CP1 et CP2 77
Tableau 2- Synthèse du
programme lié à la culture et aux valeurs traditionnelles
au
niveau du CE 78
Tableau 3 - Les objectifs
pédagogiques liés à l'apprentissage de la culture et
des
valeurs traditionnelles malagasy au niveau du lycée
85
4
INTRODUCTION
Combien de fois les parents d'aujourd'hui se plaignent du
comportement de leurs enfants, que l'éducation ne cesse de se
dégrader par rapport à celle d'avant. Pourtant, nous savons
très bien d'une part que le taux de scolarisation, même dans les
pays en voie de développement, comme le nôtre, s'améliore
d'une année à l'autre et, d'autre part, que le nombre des
diplômés d'universités et des grandes écoles
augmente constamment. D'un autre côté, nous constatons que la
reconnaissance de ces diplômes varie souvent selon l'établissement
ou les centres de formation. Par ailleurs, cette reconnaissance varie
également d'une époque à l'autre et/ou d'un pays à
un autre. A Madagascar par exemple, on accorde parfois une reconnaissance plus
importante aux diplômés des pays étrangers que ceux des
universités nationales. Il se peut même qu'on juge la
compétence d'un individu par rapport à ses capacités
d'expression ou à sa facilité à s'exprimer en langue
étrangère. En fait, toute chose a son histoire. Par exemple,
l'éducation de type occidental implantée dans le pays au
début du XXème siècle avait comme objectif de
préparer les cadres indigènes à occuper des fonctions au
sein de l'administration coloniale française. Et, l'orientation
éducative de l'époque a été choisie afin de
répondre à cet objectif. Aujourd'hui encore, il existe des
valeurs différentes accordées aux diplômes et aux
diplômés.
Par ailleurs, on sait également qu'avant
l'éducation de type occidental, la population malgache disposait aussi
de ses propres orientations en matière éducative. Ces
orientations, sans aucun doute, répondaient aux besoins de la
société malgache, à sa structure ainsi qu'à son
fonctionnement. Même de nos jours, malgré l'existence d'une
structure administrative gouvernementale, la structure traditionnelle
résiste et reste présente, aussi bien à l'échelle
locale que nationale. Les Sojabe, les Tangalamena, entre
autres, continuent à assurer leur rôle dans la
société actuelle. Nous nous trouvons alors dans une
société se plaçant entre modernité occidentale
et
tradition ancestrale. Or, si l'« éducation
signifie socialisation de l'individu,
5
préparation d'un membre semblable aux autres et
utile à la communauté »1, naturellement, la
famille est le premier lieu de cette socialisation. « Elle a cependant
perdu certaines de ses fonctions en ce sens, au profit de l'école et des
médias, notamment.2» Ces derniers qui sont le fruit
de l'évolution de la connaissance de l'humanité deviennent
indispensables et participent pleinement non seulement à
l'éducation de l'individu, mais aussi au développement de la
société dans son ensemble. Désormais, « Les
parents, de nos jours, sont loin d'être les seuls agents de la
socialisation de leurs enfants, bien qu'ils continuent
généralement d'assumer la surveillance et la synthèse de
ces multiples influences»3. Cette situation rend leurs
tâches plus complexes que jamais. Si à un moment donné le
silence-apprentissage du cadet vis-à-vis de l'aîné
suffisait pour que l'enfant se socialise, le décollage technologique,
notamment dans le domaine de la communication tel que les médias
obligent l'aîné à se situer dans une position à la
fois d'éducateur et d'apprenant. Il en est de même pour les
maîtres d'écoles modernes. Se baser uniquement sur le concept
d'éducation moderne de type occidental s'avère un échec
éducatif si elle n'obtient pas l'approbation de la société
locale.
De nos jours, il est vrai que cette éducation par
l'écrit est indispensable car elle constitue notre porte d'entrée
dans le monde du travail. Elle permet également (par le biais des
certificats, brevets et diplômes divers) d'évaluer nos
connaissances et nos compétences. C'est notre référence
contemporaine. Il n'est alors pas étonnant de voir les jeunes qui ne se
soucient que d'obtenir des diplômes. Cependant, on observe que plus notre
société devient une « société d'intellectuels
», plus elle se dégrade. Le mal, l'insécurité et
divers actes de banditisme règnent presque totalement sur l'ensemble du
territoire malgache. On se pose des questions. Comment se fait-il que
1 LEIF, RUSTIN, Philosophie de l'éducation. Tome
1, Pédagogie générale, Delagrave, 1970, p.27.
2 PRONOVOST Gilles, Famille, temps et culture, dans
Comprendre la famille, 1991, p. 99-100.
3 DANDURAND Renée, DULAC Germain, Les nouvelles
familles et l'école : répercussions des changements familiaux en
milieu scolaire, dans Comprendre la famille, 1991, p.136
6
plus le nombre des chrétiens augmente, plus le mal se
multiplie dans notre société ? Comment se fait-il que plus le
nombre des instruits augmente, plus la pauvreté règne ? Les
églises comme les écoles ne sont pas capables d'assurer, à
elles toutes seules, toutes les responsabilités éducatives: ni le
christianisme, ni l'école telle qu'elle est conçue actuellement
ne sont de la culture malgache. Parfois même, on constate une
confrontation de valeurs.
Si nous disions plus haut que l'éducation signifie
socialisation, la notion de valeur joue alors un rôle important dans le
système éducatif car, généralement, les valeurs
d'une société « sont les principes fondamentaux qui
guident la vie [...] et les comportements de chacun des hommes et des femmes
qui la composent4». Chaque société dispose
de ses propres valeurs qui conditionnent son fonctionnement et régissent
la vie de ses membres. Mener une action éducative dans une
société donnée, nécessite une prise en
considération de ses valeurs, de sa structure, de sa culture.
Etant une société de l'oralité, la valeur
et la culture de la société malgache se transmettent alors,
généralement, à travers de la parole, du
lövan-tsofiñy (héritage de l'oreille).
Cependant, il nous semble difficile d'étudier l'ensemble de la culture
des Malagasy parce que le territoire est très immense. Nous avons choisi
alors un terrain d'étude spécifique : l'ethnie
betsimisaraka. Nous analysons à cet effet, et à travers
des öhabölaña ou proverbes, la conception
éducative de la société betsimisaraka. Quelle
relation y-a-t-il entre l'éducation et les proverbes ? Cette question
comporte des sous-questions étroitement liées, l'une par rapport
à l'autre : - Les proverbes contribuent-ils à
l'éducation des betsimisaraka ? - En quoi peut-on dire qu'ils
constituent un moyen d'éducation ?
4 Groupe La Poste, disponible sur
http://stagelaposte.2010.free.fr/wp-
content/documents/synthese valeurs.pdf
7
Le mémoire qui rapporte la recherche effectuée
comprend trois grandes parties, chacune subdivisée en deux chapitres. La
première partie présente la problématique et la
justification du choix du thème en analysant le contexte de la
société étudiée, mettant ainsi en exergue la place
de l'éducation. Elle annonce également les différentes
approches méthodologiques adoptées pour faire la collecte des
données en rapport avec les trois objectifs spécifiques de
recherche : analyser et décrire les dimensions pédagogiques
des proverbes betsimisaraka ; expliquer en faisant référence aux
proverbes, les orientations de l'éducation dans la structure et
l'organisation sociale des Betsimisaraka ; et présenter les enjeux de
ces orientations traditionnelles de l'éducation face à
l'évolution de la société et à l'éducation
de type occidental. La seconde partie, quant à elle,
révèle les résultats de la recherche et les
interprétations qui en découlent en analysant le sens des
proverbes par rapport à leur fin éducative. Enfin, la
dernière partie de notre travail tente de signaler les enjeux de cette
éducation de type traditionnel à base des proverbes face à
l'évolution de la société actuelle.
8
PREMIERE PARTIE - THEMATIQUE, TERRAIN D'ETUDES ET
APPROCHES METHODOLOGIQUES
9
CHAPITRE I -JUSTIFICATION DU THEME ET METHODOLOGIE DE
TRAVAIL
Généralement, l'étude de la culture et
des valeurs traditionnelles s'effectue dans le domaine de l'anthropologie, de
l'ethnologie, de la sociologie ou de l'histoire. L'
öhabölaña qui est le sujet principal de la recherche
que nous avons entreprise est l'une des traditions orales malagasy
dans son ensemble. Le traiter dans la science de l'éducation, bien
que ce ne soit pas vraiment nouveau, mérite une explication
particulière.
I.1. La présentation de la recherche
Dans cette première section, nous présentons un
aperçu général sur le choix du thème de recherche
ainsi que des justifications à ce sujet. Nous aborderons successivement
le contexte de la société étudiée, la
problématique et les objectifs de la recherche.
I.1.1. Le contexte de la société
étudiée
Le tout premier écrit qu'a connu Madagascar remonte aux
environs du XIème siècle : le Sorabe. Il s'agit d'un
manuscrit arabico-malgache qui s'est introduit, non pas sur la
totalité de la Grande île, mais uniquement, dans le Sud-Est, chez
les Zafiraminia. Mais la civilisation de l'école proprement
dite, entre, pour la première fois, dans le pays au temps du roi Radama
I, suite au traité de 1817, signé entre ledit roi et le
Gouverneur britannique à l'île Maurice, Robert Farquhar. Autrement
dit, l'apprentissage basé sur le système d'école de type
occidental est arrivé à Madagascar, en même temps que le
christianisme. Sur la côte-Est, à une centaine de
kilomètres de Fénérive-est (notre champ d'étude),
les premières écoles ont été l'oeuvre de David
Jones et de Thomas Bevan.
10
C'est ainsi que le peuple malgache est considéré
comme un peuple qui n'a connu que tardivement l'écriture. C'est une
population de la civilisation de l'oralité. Historiquement, on parle de
lövan-tsôfiña (héritage de l'oreille) comme
source, repère ou référence. Et, même jusqu'à
ce XXIème siècle, presque la moitié des adultes plus de 15
ans ne savent, ni lire, ni écrire. La culture de l'école n'est
toujours pas effective, notamment en milieu rural. Cependant, il n'est pas
question de penser que l'éducation ne figure pas parmi les
préoccupations des parents malagasy. Au contraire, ils ont leur propre
vision, leurs propres méthodes et techniques éducatives.
Néanmoins, comme toute éducation traditionnelle, « c'est
la tradition qui commande toute la vie. [...] L'enfant s'éduque par le
contact, par l'exemple, par ordres et défenses, dans la famille ; puis
de la même manière dans le clan, dans le
village5.» Les différentes manières
utilisées pour éduquer les enfants betsimisaraka, entre
autres, le conte, la devinette, le proverbe, les préparent pour
être utiles à leur communauté, en se basant sur la
réalité et les pratiques dans la vie quotidienne.
Par ailleurs, il importe de remarquer que seuls les proverbes
restent les plus pratiqués dans la vie quotidienne d'aujourd'hui, de
même que lors des cérémonies traditionnelles ou
officielles. Ils « servent souvent d'exemple et de modèle
paradigmatique pour mieux orienter les actions... Aussi, les cite-t-on souvent
comme des apophtegmes, c'est-à-dire des paroles mémorables
à l'honneur d'un ancien: ils traduisent, à ce moment-là,
toute la sagacité des aînés, des ancêtres. Ils
rappellent aux uns et autres la vertu d'avoir du bon
sens6». Les relations entre l'éducation et les
proverbes sont incontournables car ces derniers, présents presque
partout (en particulier les rasavölaña ou discours, lors
de tous les évènements importants de la vie des Malagasy...),
présentent des normes sociétales à inculquer dans le
5 LEIF, RUSTIN, op.cit., p.27
6FANONY Fulgence, Öhabölaña
betsimisaraka (Proverbes betsimisaraka). Université de Toamasina.
Article disponible sur :
www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana
betsimisaraka ou proverbes.pdf, p.3
11
comportement des jeunes et adultes. A travers ces proverbes,
nous pouvons définir le modèle, la structure et les normes
qu'exige la société betsimisaraka. Et, puisque l'éducation
est une « préparation d'un membre semblable aux
autres7», les proverbes comportent alors un aspect
éducatif.
I.1.2. La problématique de la recherche
En se référant aux différents proverbes
et expressions de la côte Est de la grande île, notamment chez les
Betsimisaraka, on se demande parfois quelle est leur signification et,
quel est leur objet. Les jeunes et les enfants doivent-ils toujours se
soumettre à leurs parents ? Faut-il penser qu'en aucun cas, les cadets
ne puissent pas surpasser les stades de leurs aînés ? Telles
étaient, entre autres, les questions que nous nous sommes posées
devant certains proverbes. Nous en retenons deux, par exemple, qui font
nettement allusion à la gérontocratie: «Söño
tsy mihoatra akondro » (littéralement, « Le taro ne
surpassera jamais le bananier »8 et «Sambaha lava
sômotro ny öraña, mböla zandrin'ny amaloño
» (Aussi longues que soient les barbes de la crevette, elle reste
toujours la soeur cadette de l'anguille)9. Autrement dit, ces
proverbes enseignent que les parents et les aînés se placent au
sommet de toutes les instances de la société et demeurent une
référence indispensable dans la vie quotidienne.
La situation ne se limite pas uniquement au niveau de la
relation cadet/aîné ; elle s'étend également
à la manière dont les femmes sont considérées dans
la société.
7 LEIF, RUSTIN, op.cit., p.27
8 Autrement dit, la taille d'un bon pied de taro
(vôdin-tsöño ; vôdin-tsahôño) ne
rivalisera jamais avec celui d'un bananier (vôdin'akondro). Ceci pour
signifier qu'un aîné a toujours une longueur d'avance sur son
cadet en termes de date de naissance.
9 Ce proverbe s'appuie sur le fait que, dans la conscience
collective des Betsimisaraka, qu'une anguille est de par sa taille nettement
plus longue qu'une crevette. C'est pour dire qu'un cadet a beau être plus
socialement important que son aîné, mais cette réussite
sociale ne le dédouanera jamais d'être respectueux envers son
aîné. Et si nécessaire, ce dernier ne manquera pas de
rappeler qu'en dépit de tout, sur le plan de l'âge il a toujours
une longueur d'avance sur ce cadet.
12
«Soy lahy nanambady akanga, lahiny tsy àry
hely » (tel un colibri qui s'est accouplé à une
pintade, le mal n'est jamais petit) enseignent-ils à leur propos. Ne
voit-on pas dans ce passage un indice de la société phallocrate ?
Certes, apparemment celle-ci n'est pas le modèle propre aux
betsimisaraka, mais cela ne nous empêchera pas d'étudier
le cas spécifique de ces populations.
D'autres aspects sociaux se présentent dans les
proverbes, par exemple, « Telotelo mandeha misy añivo, roroa
mandeha misy hikoraña, tökaña mandeha möra jerijery
» (se promenant à trois, il y en a un qui se trouve au milieu
; à deux, il y en a un avec qui on peut discuter ; seul, facile de
manquer de proches). Un proverbe qui rejoint la valeur distinctive des Malagasy
dans leur ensemble : le fihavanana. Pourtant, cette affirmation n'est
pas à l'abri des critiques ; elle est en effet en contradiction avec
d'autres comme « Tsara ny maro fö vitsy möra rasaña
» (il est bien d'être nombreux, mais il est facile de faire un
partage lorsqu'on est moins nombreux). Tantôt, on parle de l'importance
de la solidarité d'un grand nombre de personnes, tantôt on
évoque l'intérêt de petits groupes. On fait souvent appel
à la solidarité lorsque le besoin est indispensable
(rasa-tsiñy, funérailles...), par contre, on
préfère être moins nombreux lorsqu'il s'agit de partage de
bien tel que le rasa-lôva (héritage). Effectivement,
quelles idées sont transmises à travers « drakidraky
mamana atodim-boay... » (Une canne qui couva des oeufs de
caïman...), comme à travers «anti-bavy namotsy
nify... (Une vieille dame qui se brosse les dents...) » ? La suite
est : « misy raha kindreñy», c'est-à-dire
qu'il y a là un but précis. Il s'agit des faits et observations
qu'on ne pourrait pas ignorer. Il nous appartient alors de dégager la
signification de ces différents proverbes afin de définir l'objet
et la conception de l'éducation chez les Betsimisaraka, car
l'éducation, disait CLAPAREDE10, est une vie et non une
préparation à la vie.
10 Cité par LEIF, RUSTIN, op.cit.
13
En ce sens, par l'analyse des proverbes, nous essayerons de
définir grosso modo le mode de fonctionnement de la
société betsimisaraka puisque l'éducation n'a pas de sens
que si elle a un impact dans la vie sociale. On peut dire qu'elle n'a d'autre
champ d'application qu'en société. Or, « il arrive que
les individus qui vivent au sein d'une société ne soient pas ou
ne soient que partiellement conscients des structures de cette
société11». En fait, les proverbes que nous
venons de citer ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Ils ne sont que
de simples hypothèses et ne reflètent pas forcément les
significations profondes ou les conceptions complètes du modèle
de la société betsimisaraka. Comme l'a écrit
ANDRIAMANGATIANA, « ... ce n'est pas à travers l'habit qu'on
puisse comprendre la fonction; et ce n'est pas à travers la fonction non
plus qu'on puisse imaginer l'esprit. Il se peut que l'hypothèse et la
réalité soient largement
différentes12». Mais, quoi qu'il en soit,
EVANS-PRITCHARD a bien souligné que « sans les théories
et les hypothèses, on ne pourrait pas faire de recherche [...] car on ne
trouve (lorsqu'on a la chance de trouver) que ce que l'on
recherche13».
Dans la société de l'oralité qu'est la
société traditionnelle malgache, les proverbes revêtent un
statut particulier dans la mesure où il s'agit ici de « paroles
bien frappées » et qui sont puisées à
l'école de la vie et de l'expérience. Dans les proverbes, nous
dit à ce sujet le Pasteur Richard ANDRIAMANJATO, « la structure
même des phrases aident l'intuition à saisir par-delà les
mots ce que l'on veut exprimer »14 . Les proverbes sont
des paroles bien à propos, concises et faciles à retenir pour
être ainsi reproduites. « A Madagascar, tout bon orateur doit
avoir une
11 EVANS-PRITCHARD Edward Evans, Anthropologie sociale
(1950), p.18
12 ANDRIAMANGATIANA Iharilanto Patrick,
Vakivakim-piainana, p.25. Traduction libre de «... tsy ny
fanamiana no hamantarana hatrany ny asa ; ary tsy ny asa no haminaniana sahady
ny fanahy. Mety hifanalavitra manko ny tombana sy ny tena izy».
13 EVANS-PRITCHARD Edward Evan, op.cit., p.47
14 ANDRIAMANJATO Richard, Le Tsiny et le Tody dans la
pensée malgache. Paris, Présence Africaine, 1957, (pp.8 et
9)
14
bonne capacité mnémotechnique pour pouvoir
reproduire tel ou tel proverbe « bien frappé
»15 » s'il veut séduire son public. En une
image, le proverbe est comme un socle qui permet de poser solidement ses propos
pour être réellement entendus par l'autre. Dans des longues
palabres, on ne retient pas tout. Mais grâce à des proverbes on
s'accroche à l'essentiel de ce qui a été dit.
Dans ses études sur l'oralité malgache,
Eugène Régis MANGALAZA précise la fonction des proverbes :
« Il y a des paroles qui fuient dans les oreilles et qui n'arrivent
à ficeler rien d'autre que le souffle de leur émission ;
d'autres, à l'inverse, davantage mûries et mieux
macérées dans l'intimité du silence intérieur de
leurs auteurs, atterrissent tout naturellement dans les deux oreilles, pour s'y
loger directement au fond du tympan. Comme une corde habilement tressée,
cette deuxième catégorie de parole que sont les proverbes, sert
à « lier », pour mieux empaqueter toutes les
expériences sensibles et cognitives des uns et des autres pour enrichir
ainsi le patrimoine culturel du groupe. A l'image d'un fagot de brindilles, il
n'y a que les idées bien ficelées par les proverbes qui sont
faciles à transporter sans qu'elles risquent d'être
défaites en chemin par le vent de l'oubli16 »
I.1.3. L'objectif général de la recherche
Ces exemples que nous venons de montrer permettent de
comprendre jusqu'à quel point les proverbes ont une réelle
fonction éducative en pays betsimisaraka. Et c'est ce sur quoi
nous allons nous pencher dans la présente recherche.
15 FANONY Fulgence, Öhabölaña
betsimisaraka (Proverbes betsimisaraka). Université de Toamasina.
Article disponible sur :
www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana
betsimisaraka ou proverbes.pdf
16 MANGALAZA Eugène Régis, «
Sensibilités malgaches » in, Revue Hermès, N° 40.
Paris, 2004.
15
Plus précisément, nous poursuivons l'objectif
général de recherche de dégager la conception de
l'éducation chez les Betsimisaraka par l'analyse de leurs
proverbes. Pour ne pas nous éparpiller dans cette recherche (car le pays
betsimisaraka est immense, voir la carte à l'annexe 1) nous
allons limiter notre analyse aux proverbes d'un seul village : Rantolava
(District de Fénérive-Est).
En plus de l'intérêt pour le sujet, notre choix
s'explique également par notre parcours académique. Même si
nous ne faisons pas partie du corps professoral, nous sommes très
attaché au monde de l'éducation. Et nous ne ratons jamais la
moindre occasion qui se présente pour traiter d'éducation. En
plus, il nous est très agréable de nous investir dans notre
propre groupe ethnique : nous appartenons à l'ethnie
betsimisaraka. Cette recherche nous offre une excellente occasion de
nous investir dans l'étude de notre groupe d'appartenance, nous mettant
ainsi dans une posture à la fois difficile et excitante : vivre et se
regarder vivre. Cependant, notre familiarité par rapport au groupe
étudié du fait de notre appartenance à ce groupe comporte
une certaine difficulté. Car pour mener objectivement une telle
étude, il faut constamment faire preuve de distanciation, dans une
oscillation constante entre le proche et le lointain.
Dans cette recherche, nous nous intéresserons plus
particulièrement à ce que nous appelons la «
pédagogie indirecte » en pays betsimisaraka. Un exemple : «
Mahasöla ny mañatao satroko am-pihinanaña »
(littéralement, « rend chauve le fait de porter son chapeau pendant
le repas »). Il est question d'une manière de table que l'on veut
inculquer à l'enfant et rappeler à l'adulte. Si en marchant, en
cherchant du bois sec, en puisant de l'eau, en travaillant dans la
rizière ou dans toutes autres activités de la journée, on
peut porter son chapeau, il en est tout autrement, quand on s'assoit devant son
plat de riz. Au lieu de dire, « décoiffe-toi chaque fois que tu
prends ton repas », on fait plutôt allusion, au travers d'une
pédagogie indirecte, à une situation peu enviable (surtout pour
un jeune) : être chauve. Normalement, cette
16
fâcheuse perspective suffit par décourager toute
personne qui ose prendre le risque de porter son chapeau pendant le repas.
Biologiquement, on sait que cela n'est pas si véridique. Mais comme
cette relation « chapeau / repas » est devenue proverbiale, cela
signifie qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère.
Le mieux est de s'y conformer. La question qui se pose maintenant est de se
demander pourquoi faire cette recommandation vestimentaire (ne pas porter son
chapeau en prenant son repas) ? Des enquêtes de terrain nous aideront
certainement pour y répondre. Mais d'ores et déjà, nous
pouvons avancer l'hypothèse selon laquelle si tous les membres de la
famille s'amusent à porter leur chapeau en déjeunant ou en
dînant, il n'y aura pas suffisamment de place autour de la natte commune
où on présente le repas. Notons que nous sommes ici dans la
société traditionnelle betsimisaraka où on portait un
chapeau en paille à large bord. A cette époque-là, on ne
portait pas encore de casquette. De plus, on peut noter que le
satro-bory (un chapeau sans bord comme chez les musulmans) ne
se porte traditionnellement que dans le Sud (chez les Antandroy) et
dans Sud-Est (chez les Antaimoro, chez les Antaisaka, chez
les Antambahoaka) de la Grande île. En réalité, ce
proverbe porte sur une économie de l'espace pour qu'on ne se gêne
pas les uns par rapport aux autres au cours du repas. Mais à
côté de cela, il y a lieu de se demander aussi si le fait de se
décoiffer ne renvoie pas au gestuel du croyant devant le sacré.
N'y a-t-il pas une dimension sacrée dans le partage du repas familial,
en pays betsimisaraka ?
Toujours dans cette « pédagogie indirecte »,
il y a cet autre dicton : « Boka izay mandàka anabavy
» (littéralement : Sera frappé par la lèpre
celui qui donne un coup de pied à sa soeur). Nous avons affaire ici
à un dicton qui prône une attention bienveillante et une
tolérance à toute épreuve d'un frère envers sa
soeur. Car en cas de bagarre, le frère l'emporterait sur sa soeur. La
force d'un jeune garçon et celle d'une jeune fille sont, aux yeux des
betsimisaraka, différentes. Le jeune garçon ne doit donc pas en
abuser. S'il veut se battre, il n'a qu'à trouver un jeune garçon
de sa taille. En
17
d'autres termes, frère et soeur ne devraient pas se
battre, ou encore, aucun un homme ne devrait pas porter la main sur une femme
et, plus particulièrement, sur sa femme.
Par ailleurs, l'intérêt de se pencher sur les
proverbes est grand. Non seulement les proverbes ou
öhabölaña, comme l'a si bien souligné Jean
Pierre DOMENICHINI, présentent une grande valeur documentaire et
conservent le souvenir de l'histoire de la société
malgache17, mais ils permettent également d'avoir un regard
global sur l'ensemble du mode de fonctionnement de la société.
Autrement dit, les proverbes servent de porte d'entrée pour comprendre
les valeurs cardinales de cette société. Dans ce sens, on peut se
demander si ces proverbes ne constituent pas une sorte de « fait total
» dont parlait Marcel MAUSS18, à la suite de Bronislaw
MALINOWSKI19. L'exemple des proverbes relatifs au rapport
aîné / cadet que nous avons évoqué plus haut est
très éclairant à ce sujet. Nous y reviendrons plus tard.
Nous nous attacherons également à montrer la place des proverbes
dans le quotidien des Betsimisaraka. Par ce biais, nous serons en
mesure de souligner, des exemples à l'appui, la dimension
éducative de ces proverbes dans une société de
l'oralité. Ensuite, nous essayerons d'approfondir jusqu'à quel
point les proverbes ne se limitent pas à l'art oratoire, mais qu'ils
contribuent à la consolidation du lien social par une éducation
permanente de toutes les classes d'âge. Dans ce sens, les proverbes
paraissent consister en une véritable école de la vie.
17 DOMENICHINI Jean-Pierre, « La chèvre et le
Pouvoir. Première approche historienne d'un interdit ». in, Omaly
sy Anio. Revue d'Etudes historiques, N°9, Antananarivo, 1979, p.
79.
18 MAUSS Marcel, Essai sur le don. Forme et raison de
l'échange dans les sociétés archaïques, Paris,
PUF, 1960.
19 MALINOWSKI Bronislaw, Les Argonautes du Pacifique
occidental, Paris, Gallimard, 1963 ; Les jardins de corail, Paris,
Maspero, 1974
18
I.1.4. Les objectifs spécifiques de la recherche
L'éducation est une science très complexe. Elle
est le garant de toute harmonisation du fonctionnement d'une
société. Elle participe au processus de tout changement et
accompagne les politiques d'orientation y afférentes. Par ailleurs, nous
sommes également conscient que ce changement ne sera jamais effectif
quand il n'est pas endogène20. Cela nécessite une
implication complète des membres qui composent la société.
La prise en compte de la pratique, de la culture et des valeurs de ces
derniers, constitue une des raisons garantissant leur adhésion, et
par-delà, l'efficacité et la réussite de la politique
éducative. A Rantolava, un village betsimisaraka dont la population est
majoritairement rurale, le rasavölaña et les
öhabölaña sont une pratique quotidienne
présentant les lignes de conduites et les normes approuvés par la
communauté. Cela constitue une raison pour laquelle ce travail est
important pour mieux connaître l'éducation dans une
société de l'oralité comme celle de
betsimisaraka.
De manière à atteindre l'objectif
général de la recherche, nous proposons maintenant des objectifs
spécifiques :
· Analyser et décrire les dimensions
pédagogiques des proverbes betsimisaraka ;
· Expliquer, en faisant référence aux
proverbes, les orientations de l'éducation dans la structure et
l'organisation sociale des Betsimisaraka ;
· Présenter les enjeux de ces orientations
traditionnelles de l'éducation face à l'évolution de la
société et à l'éducation de type
occidental.
20 RAKOTOZAFY-HARISON Jean-Baptiste (2005),
Développement : Pratiques et projets sociaux. Cours du module
6, MSFD. ENS, Université de Fianarantsoa.
19
I.2. Les approches méthodologiques adoptées
et leurs justifications
Étant donné que cette recherche présente
en partie un aspect anthropologique, des démarches de types
socio-anthropologiques fondées sur l'entretien, l'observation et
l'analyse de documents constituent les approches de collecte et d'analyse des
données.
I.2.1. L'entretien libre et semi-directif
Le recours aux entretiens est particulièrement
adapté quand on souhaite reconstituer des histoires de pratiquants,
analyser les trajectoires des individus, les moments et les raisons qui guident
leur parcours21. Au cours de la présente recherche, les
entretiens se sont déroulés en deux temps. D'abord, une
enquête au niveau des ménages sans distinction préalable
nous a permis d'obtenir un échantillonnage représentatif de
familles du village. Ensuite, nous avons fait également appel à
un échantillon dit «de convenance». Pour composer ce dernier,
nous avons fait surtout appel aux Tangalamena,
mpiambinjiñy, aux mpirasavolaña ainsi qu'aux
autres membres de la société considérés comme
raiamandreny (personnes âgées). Il a aussi
été question de sélectionner au sein du village Rantolava
ou encore dans d'autres villages betsimisaraka des personnes
considérées comme étant instruites (selon la conception de
l'école moderne) et en même temps disposant d'une connaissance non
négligeable par rapport au fonctionnement traditionnel de la
société betsimisaraka. Certes, cette deuxième
étape n'a pas été exemptée de subjectivité.
En effet, le chercheur a recruté, non seulement des personnes cibles qui
ont des choses à dire sur le sujet, mais aussi le guide d'entrevue a
varié pour s'ajuster aux personnes interviewées.
21 TEMPORAL Franck, LARMARANGE Joseph (2006),
Déroulement des enquêtes quantitatives et/ou
qualitatives. Laboratoire Ponter, Département des Sciences
sociales, Facultés de Sciences Humaines et Sociales, Université
Paris 5, p. 11
20
Puisque de milliers de proverbes sont
répertoriés en pays betsimisaraka, il a
été judicieux de se focaliser sur ceux que les gens utilisent
quotidiennement. Le guide d'entretien a été basé sur cet
angle. Une fois recueillis, les proverbes ont été
classifiés en fonction de leur champ d'utilisation ou de leur
finalité respective. Par ailleurs, en vue de confronter les versions
pour une meilleure analyse et interprétation, et en fonction de
l'évolution du travail, nous avons demandé à d'autres
comme des femmes ou des jeunes d'accepter de participer à un entretien.
Mais comme l'affirme DE SARDAN Olivier22, l'entretien ne doit pas
être perçu comme une extraction minière d'informations.
Dans tous les cas, l'entretien de recherche est une interaction entre des
personnes.
I.2.1.1. L'enquête par entretien au niveau des
ménages
Nous avons enquêté 40 des 420 ménages du
village. Le choix de ces ménages a été fait au hasard et,
les questions posées ont été basées sur les
principaux points qui servent à atteindre nos objectifs de recherche.
D'abord, comme il s'agit d'une enquête préliminaire sur la place
des öhabölaña dans la vie familiale, nos questions
ont été posées en ce sens. Est-ce que les
öhabölaña sont encore utilisés ? Quels sont
les moments où ils sont les plus utilisés ? Quels sont les
avantages de l'utilisation de ces proverbes ? Ensuite, nous avons
évoqué des questions relatives à l'éducation au
niveau de la famille. Qui se charge de l'éducation des enfants ? Comment
se présente cette éducation ? Quels sont les domaines de
croissance que la famille développe chez les enfants ? Enfin, nous avons
aussi abordé des sujets relatifs à la structure et à la
vie socioéconomique du village.
Mais, cette enquête n'a pas été une
tâche facile. Nous avons été confronté à de
multiples contraintes pendant notre séjour au village de Rantolava.
D'une part,
22DE SARDAN Olivier, L'enquête
socio-anthropologique de terrain : synthèse méthodologique et
recommandations à usage des étudiants, p.37
21
nous sommes arrivé au moment de la campagne
électorale. Une difficulté importante est venue du fait que
certaines personnes nous ont confondu avec les membres du comité de
soutien d'un candidat quelconque. Et, d'autre part, ce séjour a
coïncidé également avec la célébration des
journées de l'enfance catholique du diocèse de
Fénérive-est dont la célébration officielle a
été organisée dans ce village. Cette situation explique,
en une partie, le faible nombre de ménages enquêtés.
1.2.1.2. Un échantillonnage de type « de
convenance »
Dans la plupart de cas, l'entretien a été
enregistré avant d'être retranscrit. Cependant, l'enregistrement
n'a pas exclu la prise de notes. Après la séance d'interview, il
nous a appartenu de transformer les entretiens en texte (retranscription et
traduction). Cette démarche nous a permis de prendre un temps de recul
pour pouvoir mieux comprendre le document écrit, donc le contenu et le
sens des entretiens, au lieu d'une simple impression primaire. Une fois
retranscrits et compris, nous avons procédé à la lecture
critique de ces documents, en essayant d'analyser le contexte, les allusions,
les malentendus, les références croisées, etc. Cet
exercice nous a permis de faire un classement des données pour servir de
matériaux à décortiquer, à désosser et
à désarticuler (TEMPORAL Franck et LARMARANGE Joseph, 2006).
Au total, nous avons interviewé trois
Tangalamena, deux notables, un directeur d'école et un adjoint
au chef de Fokontany. L'entretien avec les Tangalamena s'est
déroulé en deux étapes. D'abord, un entretien commun,
c'est-à-dire en groupe et assisté par l'adjoint au chef de
Fokontany, suivi d'un entretien individuel, une semaine
après.
I.2.2. L'observation, participante ou non
L'approche par observation, le plus souvent employée en
complément de l'enquête par entretien est issue des
méthodes de l'anthropologie. Elle consiste en un
22
long travail de description et d'interprétation afin de
mettre en lumière la complexité de pratiques sociales, de
rituels, des interactions, souvent même dans leurs aspects tellement
ordinaires qu'ils finissent par passer inaperçus,
considérés comme « naturels » par les
acteurs23. Cette technique nous a permis de mieux nous situer en
position de la neutralité scientifique et intellectuelle. Dans le cadre
de cette étude, nous entendons par observation, l'action d'avoir
assisté à des évènements marquants la vie du
village, tels que le Tsaboraha, la fangahoam-biavy et
ôrimbato (mariage traditionnel), funérailles... Il s'agit
d'une phase permettant d'enrichir l'analyse des données recueillies lors
de l'entretien ou dans d'autres sources. Elle nous lance dans deux postures
indispensables à la recherche : témoin et co-acteur ; mais le
premier n'englobe pas forcément le second. Certaines de ces
données d'observations ont été également
enregistrées et analysées comme ceux des entretiens.
Que ce soit dans l'observation ou au cours de l'entretien,
nous aimerions mettre en oeuvre certains aspects de la « méthode
philologique » que Marcel MAUSS développe dans son ouvrage
(Manuel d'ethnologie).
I.2.3. La recherche et analyse documentaire
L'étude et l'analyse des documents ont aussi
figurée parmi nos approches. Outre la revue de la
littérature24 qui nous a été indispensable
comme dans tous travaux de recherche, nous avons fait également appel
aux « documents directs écrits ». Dans ce sens, LOUBET DEL
BAYLE Jean-Louis25 indique qu'il s'agit de documents publiés
et d'archives. Nous avons travaillé sur ces deux catégories de
23 TEMPORAL Franck, LARMARANGE Joseph (2006), op.cit.,
p.11
24 Nous précisons quand même que l'article de
FANONY Fulgence, Maître des Conférences à
l'Université de Toamasina a été parmi les articles les
plus développés dans ce travail. Cet article qui est un recueil
de 1008 proverbes betsimisaraka nous a beaucoup aidé pour
compléter les proverbes collectés pendant les entrevues.
25 LOUBET DEL BAYLE Jean-Louis (2000), Initiation aux
méthodes des sciences sociales. Paris - Montréal :
L'Harmattan, 272 pp.
23
documents. D'abord, nous avons consulté les archives de
l'école primaire publique de Rantolava afin de comprendre la place de
l'éducation de type occidental dans ce village. Les parents se
contentent-ils de l'éducation traditionnelle ? Est-ce qu'ils accordent
une importance majeure à l'éducation de type occidental ?
Notre enquête documentaire ne s'est pas limitée
à ce choix parental en matière d'éducation. Nous avons
recueilli et analysé des programmes officiels. Notre objectif
était d'analyser si la préservation et la valorisation de la
culture et des valeurs traditionnelles figurent parmi les priorités
gouvernementales en matière d'éducation. C'est ainsi que nous
avons étudié les programmes scolaires du niveau I (primaire) au
niveau III (lycée).
I.2.4. Quelques concepts clés
Afin de comprendre les contenus des entretiens et de donner
des moyens de les analyser et de les comprendre, nous définissons les
concepts de base de notre étude.
- Culture : Par culture, MALINOWSKI fait
état des comportements communs, des croyances et des
rituels marquants la vie de la société dans ses diverses
facettes. La culture peut certes être appréhendée par
l'observation attentive des comportements des acteurs de la
société étudiée et des rituels qu'ils partagent,
mais cette observation ne saurait suffire. En effet, l'étude de la
culture implique que soit compris le sens donné par les acteurs
eux-mêmes à leurs comportements, à leurs croyances et aux
rituels prévalant dans leur société26 . Si nous
disions auparavant que les öhabölaña
présentent une grande valeur documentaire et conservent le souvenir
de l'histoire de la société malgache,
26 DUFOUR Stéphane, FORTIN Dominic et HAMEL Jacques
(1991), L'enquête de terrain en sciences sociales. L'approche
monographique et les méthodes qualitatives, p.25
24
l'analyse de la culture betsimisaraka nous aide
à comprendre le sens et la signification des proverbes
- Education : Pour Leif et Rustin, «
l'éducation signifie socialisation de l'individu, préparation
d'un membre semblable aux autres et utile à la
communauté27». Cette hypothèse est
également partagée par d'autres chercheurs comme Dewey. Ce
dernier affirme que : « L'enfant qui est éduqué à
l'école est un membre de la société et doit être
instruit et traité comme tel. L'école et ceux qui la dirigent
sont responsables envers la société, car l'école est avant
tout une institution créée par elle pour accomplir une oeuvre
spécifique : le maintien et l'amélioration de la vie
sociale28». Encore d'après Leif et Rustin: «
Etre éducateur c'est déjà avoir pris parti, et
adopté une doctrine morale et sociale qui permette de guérir et
de redresser ce que la morale et la société considèrent
comme malsain, aussi bien que de préserver et de cultiver ce qu'elles
jugent recommandables » 29
Cependant, une contradiction pèse sur nos
définitions de l'éducation. Pour les uns son but est l'action qui
doit s'exercer des adultes sur la jeunesse afin de lui transmettre
l'héritage des ancêtres, de lui donner les idées et les
moeurs qui lui permettront de mieux s'adapter à la société
dont elle va fournir la relève. Pour les autres elle doit
développer au maximum en chaque individu ses aptitudes afin de
ménager à son avenir les meilleures chances de succès.
D'un côté c'est le point de vue sociologique qui l'emporte, de
l'autre celui de la psychologie individuelle30.
- Education laïque : Toute forme
d'enseignement qui est indépendante de l'influence des églises et
de la croyance religieuse. Selon Anselme
27 LEIF, RUSTIN (1970), op.cit., p.27
28 DEWEY John, Ecole et enfant, p.134
29 LEIF, RUSTIN (1970), op.cit., p.129
30 Sociologie et Éducation. In: Enfance. Tome 12
n°3-4, 1959. Psychologie et Éducation de l'Enfance. pp.
324-333 (Article extrait des Cahiers Internationaux de Sociologie, 1951)
25
ZURFLUH, la société traditionnelle distingue les
actes répréhensibles sous trois aspects : l'un profane et
juridique (délits), l'autre sacré, lui-même divisé
en religieux (péché) et surnaturel
(sacrilège)31.
Bien que la religion moderne n'est arrivée à
Madagascar que tardivement, les Betsimisaraka accordent une grande valeur
à la religion traditionnelle, aux forces surnaturelles, au soutien des
ancêtres « razana » et aux autres croyances. La
question que nous posons est aussi celle de laïcité de
l'éducation. Pourrons-nous dire que l'éducation traditionnelle
betsimisaraka est laïque ?
- Pédagogie : Ce terme a
été composé au début par deux mots : «
paidos » qui signifie « enfant », et «gogia
», qui veut dire «mener ou conduire ». Son concept
désignait à l'époque l'esclave qui accompagnait les
enfants à l'école. Alors que « De nos jours, la
pédagogie désigne l'ensemble des méthodes et des pratiques
d'enseignement et d'éducation en tant que phénomène
typiquement social et spécifiquement humain. Il s'agit d'une science
appliquée à caractère psycho-social, dont l'objet
d'étude est l'éducation. La pédagogie reçoit des
influences de plusieurs sciences, telles que la psychologie, la sociologie,
l'anthropologie, la philosophie, l'histoire et la médecine, parmi
d'autres »32.
Les recherches récentes en matière de
pédagogie « nous montrent que les apprentissages seront
beaucoup plus facilement assimilés si l'individu ou l'apprenant est
actif. Ce qui veut dire qu'il devient acteur et intervient dans la construction
de ses propres savoirs ». On parle d'une pédagogie active : il
faut que « l'apprenant construise lui-même ses futurs savoirs, par
l'action d'étayage du professeur. Cette action consiste à guider
l'élève dans le
31 ZURFLUH Anselme (1993), Un monde contre le changement.
Une culture au coeur des Alpes, Uri en Suisse, XIIe - XXè
siècle. Zurich Loriens Books/ Paris Economica pour la version
française.
32 Définition de pédagogie - Concept et
Sens. Disponible sur :
http://lesdefinitions.fr/pedagogie#ixzz3OUFrM9VA
26
développement de raisonnements et de méthodes
qui sont propres à l'enfant et qui sont ou non validées ou
validables. Souvent pour mettre en place ce type de pédagogie on va
confronter les élèves à des situations de problèmes
que les enfants vont devoir surmonter en développant des
hypothèses, des techniques d'investigation ou raisonnements qui vont ou
non valider leurs hypothèses. Ce type de situation peut être
effectué avec les enfants en groupe ou seuls33 ».
Comment parler de l'éducation sans pédagogie ? Le concept de la
pédagogie est essentiel dans toute recherche en éducation. En
quoi peut-on affirmer que les proverbes présentent une vocation
pédagogique ?
- Société : Selon le
dictionnaire de philosophie en ligne, ce terme désigne un ensemble
organisé d'individus entretenant des rapports d'indépendance
réglés, exprimables sous la forme de règles naturelles ou
conventionnelles. Et, Jean-Jacques Rousseau34, en expliquant que
même dans la famille (qui selon lui est la plus ancienne de toute les
sociétés et la seule naturelle), si les membres décident
de continuer à rester unis, c'est volontairement et par convention.
L'analyse de ce concept « société »
est une importance majeure dans la présente recherche. Rappelons-nous
ici l'idée qu'il « peut donc ne pas y avoir conflit entre
l'inculcation des connaissances à l'individu et adaptation à la
société ou civilisation : il faut trouver cette harmonie...
» 35
33 Pédagogie et didactique. Disponible sur :
http://www.eduquer-respect.fr/pedagogie-et-didactique/
34 ROUSSEAU Jean-Jacques, Du Contrat Social, ou Principes
du droit politique ; in Collection complète des oeuvres,
Genève, 1780-1789, vol. 1, in-4° édition en ligne
www.rousseauonline.ch version
du 7 octobre 2012. Disponible sur
http://www.rousseauonline.ch/Text/du-contrat-social-ou-principes-du-droit-politique.php
, p.5
35 PESTALOZZI Johann Heinrich, cité par BLAIS
Marie-Claude, GAUCHET Marcel et OTTAVI Dominique, Pour une philosophie
politique de l'éducation, Pluriel, Editions Bayard, 2002. p. 128
27
CHAPITRE II - NOTRE TERRAIN D'ETUDES : LE VILLAGE
DE
RANTOLAVA
Le territoire betsimisaraka est immense et, pour
mieux délimiter notre recherche, nous avons choisi le village de
Rantolava comme étant notre terrain d'études. Mais, en parlant de
ce village, nous profitons également cette occasion pour parler de
l'histoire des Betsimisaraka en général.
Ce chapitre comprend deux sections : une section qui
présente une brève présentation
historio-géographique et une autre section qui met en évidence la
place de l'éducation dans le village de Rantolava.
II.1. Une brève présentation
historio-géographique
Dans cette section, nous présentons d'une
manière simplifiée la naissance du peuple betsimisaraka dans son
ensemble et celle du village de Rantolava en particulier.
II.1.1. Historique
II.1.1.1. Naissance de la confédération
betsimisaraka
Du point de vue historique, le territoire betsimisaraka
a été peuplé de trois clans différents, tels
que les Tavaratra (au Nord), les Tsikoa (au Centre) et les
Tatsimo (au Sud). Il est délimité au Nord par le fleuve
Bemarivo (Sambava) et, au Sud par le fleuve Mananjary , avec une longueur
d'environ 700 km. Au cours du XVIIIème siècle, le chef du clan
Tavaratra appelé Ratsimilaho, fils de Rahena
et d'un anglais Tom Tew, décide de rassembler tous les clans de la
côte centre-orientale de la grande île après ses
études en Angleterre. Il s'est alors marié avec la fille du chef
Tatsimo qui est devenu son allié contre les Tsikoa.
Après la défaite de ces derniers, Ratsimilaho installa sa
capitale à Fénérive-Est, en 1712. Et, à l'issu de
son
28
discours devant le peuple, il demanda leur soutien, leur
obéissance et respect. Il a fait promettre à son peuple de ne
jamais se désunir quelles que soient les circonstances. C'est à
partir de ce point-là que commence l'ère « Betsimisaraka
» (nombreux unis à jamais), et il devient Ramaromanompo (celui
qui a de nombreux serfs). Ramaromanompo a régné jusqu'à sa
mort en 1754. La population betsimisaraka est à l'image de ce
proverbe: « vilañy vy natrö-bazaha, teo vö niharo
» (marmite en fer rassemblée par un étranger, c'est
là qu'on s'est rencontré).
II.1.1.2. Origine du village de Rantolava
Auparavant, ce village situé au bord de l'Océan
Indien s'appelait « Tsiraka Anjavananto ». Les villageois
vivaient de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Mais,
l'absence d'eau potable, l'insuffisance des surfaces pour l'agriculture ont
obligé la population à se déplacer. Elle s'est alors
installée à proximité du lac Tampolo qui est maintenant
devenu un village nommé Rantolava. En ce qui concerne le nom du village,
nous pourrions avancer deux explications. Littéralement, le terme «
rantolava » est constitué de deux mots : «ranto» qui
signifie «prendre ou chercher ailleurs » et «lava» qui veut
dire « souvent ». Le nom du village vient du fait que ses habitants
ne cessent de faire des va-et-vient pour trouver de la nourriture, partant du
nouveau village vers celui d'autrefois. D'autres avancent que cette
dénomination a été attribuée à partir du nom
d'un « mpañajary » (guérisseur) qui s'appelait
« Ranto » et qui s'est installé dans la partie Sud du village
actuel. Mais, cette dernière hypothèse a été
niée par la plupart des aînés du village.
II.1.2. Présentation géographique
Figurant dans le territoire Tavaratra, Rantolava est
un village betsimisaraka situé dans la commune rurale
d'Ampasina Maningory, district de Fénérive-Est. Il se trouve
à 15 km du chef-lieu de la région Analanjirofo ,
traversé par l'ex-route nationale n°5.
Géographiquement, il est délimité au Nord par le village
de Takoböla,
29
au Sud par Tanambao Tampolo, à l'Ouest par Ambatomasina
et à l'Est, par l'Océan Indien (voire la carte n°1 et la
carte n° 2).
Actuellement, la population de Rantolava compte environ 1400
habitants dont la majorité est jeune. Le groupe ethnique dominant est le
betsimisaraka, issu des deux lignages dominants : Fahambahy
et Zafilango. Ensuite, viennent les antemoro, les
antavaratra, puis les merina.
Carte 1 - Localisation de la Commune Rurale
d'Ampasina Maningory par rapport à la Région
Analanjirofo

Sources : O.N.E, Rapport de synthèse sur
l'état de l'environnement de la Région Analanjirofo (2008) et
Plan Communal de Développement de la Commune rurale d'Ampasina
Maningory.
30
Carte 2 - Carte de la Commune rurale d'Ampasina
Maningoro où se trouve le village de Rantolava

Source : Mairie d'Ampasina Maningory, PCD,
2015
II.2. Place de l'éducation au village de
Rantolava
Le village de Rantolava abrite deux types d'école : une
école de type occidental, donc entre les quatre murs avec des programmes
officiels et, une école sans mur, sans manuels ni conception consciente
de l'éducation. Ce dernier type se transmet de bouche à l'oreille
et d'une génération à l'autre.
31
II.2.1. Le système éducatif de type
occidental
Bien qu'il se trouve à l'écart de la route
nationale, on trouve dans le village de Rantolava un système
éducatif de type occidental. Un centre de formation pédagogique
et une école primaire du premier cycle ont été
créés en 1971 (photo n°01 et photo n°02).

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 69,63% des
enfants de 6 à 10 ans fréquentaient l'école primaire de
Rantolava (source : EPP Rantolava). Cela signifie que la scolarisation figure
parmi les préoccupations des habitants. Par ailleurs, il a
été constaté que les résultats que les
élèves obtiennent aux examens officiels ne sont pas vraiment
satisfaisants. A titre d'exemple, en se référant aux
résultats des examens du C.E.P.E durant les trois dernières
années, le taux de réussite est au-dessous de 50% (2011-2012 :
43,28% ; 2012-2013 : 46,29% ; 2013-2014: 48,14%) tel que le rapporte le
graphique 1.
32
Graphique 1 - Taux de réussite aux examens
du C.E.P.E au cours des cinq dernières
années
Taux de réussite (%)

Taux de réussite (%)
100
64
43,28 46,29 48,14
2009-20102010-2011 2011-2012 2012-2013
2013-2014
Source : EPP Rantolava, 2015
En observant ce graphique, une question se pose. Pourquoi
cette brusque régression depuis 2009-2010? Selon l'explication du
directeur de l'école, celle-ci est le résultat de
différentes affectations des instituteurs titulaires. Pour pallier la
situation, l'association des parents d'élèves,
dénommée localement « FRAM36 » et, avec
l'accord de la direction de l'établissement recrute des maîtres
suppléants (maître FRAM). Généralement, ces
maîtres FRAM n'ont reçu aucune formation pédagogique avant
d'exercer le métier d'instituteurs.
Malheureusement, l'échec scolaire frappe l'ensemble des
niveaux, du CP137 au CM238. Le taux de redoublement est
inquiétant, surtout depuis l'année scolaire 2011-2012. Il passe
de 41% à 59%, l'année suivante. Mais on ne peut pas faire porter
toute cette responsabilité aux enseignants. La réunion du CPF qui
s'est tenue en date
36 FRAM : Fikambanan'ny Ray Aman-drenin'ny Mpianatra
(littéralement : Association des Parents d'Elèves)
37 CP : Cours préparatoire
38 CM : Cours moyen
du 13 janvier 2015 a soulevé un autre problème
majeur : l'importance de l'absentéisme. L'absentéisme est
lié aux difficultés économiques que les familles des
élèves rencontrent. En fait, pendant les saisons fortes (pour
l'activité de pêche) du lac Tampolo, les élèves
profitent cette occasion pour aider leurs parents en travaillant. Ainsi, ils
pourront participer à l'augmentation de revenus familiaux.
Par ailleurs, il a été également
remarqué qu'en termes de réussite scolaire, les filles s'en
sortent mieux que les garçons. Elles sont non seulement en
supériorité numériques, mais aussi leurs résultats
aux examens sont meilleurs à ceux des garçons. Le graphique
n°02 ci-après montre bel et bien cette différence. En effet,
le nombre des élèves de sexe féminin qui
réussissent est plus important ceux du sexe masculin.
Graphique 2 - Taux de réussite par sexe de
2009-2010 à 2013-2014
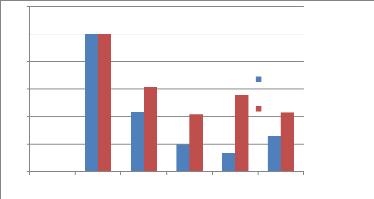
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
120
100
80
60
40
20
0
Taux de réussite pour les
garçons
Taux de réussite pour les filles
33
Source : EPP Rantolava, 2015
34
Cette différence de réussite scolaire ne se
retrouve pas uniquement au niveau de l'établissement scolaire. Elle est
le reflet de situation démographique du village. En 2014, par exemple,
sur un total de 191 enfants de 6 à 10 ans, les filles comptent pour 99,
ce qui donne un taux de filles d'environ 52%.
Au total, six (06) enseignants se chargent de
l'éducation des 271 élèves, y compris ceux du
préscolaire. Cela donne un ratio de 45,1 élèves par
enseignant. A la fin du primaire, pour continuer leurs études
secondaires, les élèves doivent aller au chef-lieu de la commune,
avec une distance moyenne d'environ 4 km que les élèves font
généralement à pied.
En ce qui concerne le centre de formation pédagogique,
on observe une régression. Bien qu'il ait accueilli des séances
de formation jusqu'en 2012, en réalité, le centre de formation
n'a été vraiment fonctionnel que dix ans. Cela s'explique d'abord
par la déviation du trajet lors de la construction de la nouvelle
RN539 qui a fait de Rantolava un village enclavé. Ensuite,
étant donné le climat, l'accès au centre est devenu de
plus en plus difficile, surtout en période de pluie. Enfin, il faut
aussi dire que le centre a été touché par la
création du Centre Régional de l'Institut de Formation
Pédagogique dans la ville de Fénérive-Est, en 2011. Ces
divers facteurs expliquent pourquoi le centre de formation pédagogique a
périclité.
II.2.2. L'éducation traditionnelle au village de
Rantolava
A côté de l'éducation de type occidental,
les villageois utilisent d'autres systèmes et méthodes
éducatives. Chaque parent se charge d'éduquer ses enfants,
notamment sur les pratiques de bonnes manières et du savoir-vivre. Cette
éducation se transmet à travers de traditions orales. Et, selon
FANONY Fulgence, la tradition orale betsimisaraka du Nord distingue toute une
variété de genres, que l'on peut
39 RN5 : Route Nationale n°5
35
répartir en trois classes. Il rapporte d'abord les
genres narratifs (les contes angano, les légendes korambe,
les discours kabary, les récits historiques
tantara, et les généalogies jijy
karazaña), ensuite les genres sapientiaux (les proverbes
öhabölaña, les propos galants fankahitry,
les circonlocutions hainteny, les maximes völantô,
et les devinettes et contes-devinettes ankamantatra), et enfin, les
genres poétiques (les dits, jijy, söva et
tökatöka ; les chants ôsiky et les comptines
enfantines dölan-jaza)40.
Dans le présent chapitre, nous analyserons chacun de
ces genres et de décrirons son utilité dans la croissance et le
développement de l'individu. Pour ce faire, nous prenons, au moins, un
exemple de chaque. L'exemple est choisi en fonction de sa place dans la
société actuelle.
II.2.2.1. Les genres narratifs a) L'angano (contes)
Le conte, souligne FANONY Fulgence, est le véhicule
d'un savoir transmis de génération en génération
qui, bien au-delà des leçons de morale sociale évidentes
et souvent simplistes, perpétue des modèles de vie et contribue
à former la vision du monde propre aux individus appartenant à
une culture donnée. Dans la soirée, en attendant et/ou
après le dîner, tous les enfants se rassemblent autour du
père de la famille qui raconte une histoire issue des contes. C'est
grâce à ces derniers que le père ou l'aîné
transmet des messages ou de comportements que les enfants doivent adopter ou
non, de leur faire comprendre une situation ou une tradition.
40 FANONY Fulgence, (2001). L'oiseau grand-tison et autres
contes des Betsimisaraka du Nord (Madagascar), Littérature orale
malgache, tome 1. L'Harmattan, 2001, p.10
Voici un exemple d'un conte concernant le chat et la souris :
|
Ra-posy sy ra-valavo
|
Le chat et la souris
|
1- Talöha elabe tañy hono, dia
mpinamaña be ra-posy sy ra-valavo;
2- Indraiky andro, tafara-dià zareo ary sendra
renirano ka voatery nañamboatra lakañan-tsomanga
hitsakaña;
3- Izy koà vita ny lakaña, dia
nivariña zareo roa ary nitsaka, ka ra-posy talöha ary ra-valavo
tafara,
4- Tan-dalaña anefa, mikiky ny lakaña
ra-valavo, hömana ilay tsomanga.
5- Nañotany hono ra-posy: ino marö raha
mañeno zañy ra-valavo?
6- Namaly hono ra-valavo:
mañamboamboatra pilasy
foaña...
7- Isaky ny mañotany hono ra-posy, dia mitovy
foaña ny valin-tenin'ny ra-valavo;
8- Farany tömbaka ny lakaña, ary dia
lentika;
1-
36
Il était une fois où le chat et la souris
étaient de bons amis ;
2- Un jour, en se promenant, ils arrivèrent au
bord de la rivière et, pour continuer leur trajet, ils devaient
construire une pirogue en patate ;
3- Après avoir construit ladite pirogue ils
montèrent à bord, le chat devant et la souris
derrière.
4- Et à bord, la souris ne cesse de grignoter en
mangeant la pirogue [patate],
5- Le chat lui demandait : quel est ce bruit ?
6- La sourie répondait : j'arrange ma place
!
7- A chaque fois que le chat posait la question, la
souris lui répondait par la même réponse.
8- Finalement la pirogue s'est écoulée
;
9- Ra-posy anefa nahay niloma flo, ka dia niloma flo izy
nitsaka;
10- Ra-valavo kosa tsy nahay niloma flo ka dia niantso
vonjy tamin'ny ra-posy fa efa tady ho sempotra.
11- Tsy na fleky anefa ra-posy satria fantany fa noho ny
fitiavan-
te flan'ny ra-valavo no
nahalentika anjare.
12- Farany, efa nihevi-te fla ho faty izy ka dia niangavy
mafy an-dra-posy : havoty zaho fö izy koà tonga an-tanety zaho
hoaninao!
13- Nalaka toky tsarabe ra-posy, ary na flomia toky
ra-valavo;
14- Lasa fla ra-posy nalaka azy, ary tonga tsarabe
tan-tanety ra-valavo;
15- Na flotany amin'izay ra-posy: efa pare amin'izay
ö? (izy efa maika te-hihina fla)
16- Namaly ra-valavo : andraso maimai fly hely fö
mböla le fly!
17- Mandritra iza fly fotoa fla izany anefa izy efa
manomboka mangady lavaka hilifasa fla,
18- Farany, tafalefa ra-valavo ary tsy
9- Le chat savait nager et, il a nagé jusqu'au
bout de la rivière.
10-
37
Par contre, la souris ne savait pas nager et elle demanda
au chat de lui venir en aide,
11- Le chat a refusé parce qu'il savait que c'est
à cause d'elle, que la pirogue s'est écoulée.
12- Alors, la souris se trouvait au bord de
désespoir et a promis au chat : sauve-moi et tu me mangeras une fois sur
terre !
13- Le chat lui a demandé une confirmation, et la
souris lui a confirmé.
14- Le chat décida alors de la sauver,
15- En arrivant, le chat lui demanda : tu es prête
? (il a hâte de la manger)
16- mais la souris répondit : attends d'abord que
je me sèche!
17- Alors qu'en même temps, elle commence à
creuser la terre pour s'y enfuir,
18- Elle réussit à s'échapper en
passant par le trou parce que le
afaka nañaraka raposy satria tsy
mahay mandeha
ambanin'ny tany.
19- Viñitra mafy ra-posy satria nofitahin'ny
ra-valavo ary nañoziña ny taranany izy nañano hoe: izy
kö mbola taranako foaña dia tsy maintsy mañejika sy mamono
sy hihinaña ireñy valavo ireñy.
20- `zeñy hono no mahatonga ny posy sy ny valavo
mifañejika hatramin'izao!
chat, par contre n'était pas capable de suivre son
trajet sous terre, et il s'est senti trahi,
19- Furieux, il a ordonné à ses descendants
de ne pas laisser aucune souris à s'échapper devant eux ;
20- C'est ainsi que le chat et la souris sont devenus les
pires ennemis !
38
Ce conte nous fait comprendre qu'avant tout agissement, il
faut penser à ses conséquences. Ici, on voit que l'impatience et
la gourmandise de la souris, a failli lui coûter la vie. Et même,
si elle n'a pas perdu sa vie, elle a été cependant privée
de liberté. Alors que si elle n'avait pas été si
égoïste et avec un peu de patience, elle aurait dû attendre
l'arrivée pour manger cette patate. N'est-il pas un «
véhicule d'un savoir transmis de génération en
génération et qui, bien au-delà des leçons de
morale sociale évidentes et souvent simplistes, perpétue des
modèles de vie et contribue à former la vision du monde propre
aux individus appartenant à une culture donnée41
» comme l'a si bien mentionné FANONY Fulgence ?
b) Le korambe (légendes)
Dans les villages betsimisaraka, le korambe
est une sorte d'histoire racontée à un groupe de personnes
en vue d'ouvrir un débat sur un sujet donné. A la
différence
41 Ibid., p.11
d'un conte ou « angano », le korambe
peut être une histoire réelle. Il peut être
également inventé par son initiateur.
D'abord, il permet aux membres d'une société
donnée de s'entraîner à parler en public,
généralement avec les jeunes ayant environ les mêmes
âges. Mais, cette question d'âge n'est pas une condition
indiscutable pour un korambe. Il se peut qu'on assiste à un
korambe dont l'initiateur est l'aîné. Ensuite, c'est une
distraction, un passe-temps : « Korambe amin-karatsiaña :
mampalady kiàka » (Korambe pendant une veillée
mortuaire : la nuit passe vite).
Voici un exemple de korambe enregistré le soir
du 29 août 2015. Il y avait eu plusieurs sujets abordés, mais nous
avons choisi le sujet ci-après. A ce moment-là, c'est le
père de famille qui aborde le sujet. Et, dans la maison, il y avait son
épouse, ses trois enfants, deux amis proches à la famille, sa
belle-fille (épouse de son fils aîné), une personne
importante du village (Tangalamena) et nous-même.
1. Indraiky andro, nandeha namonjy
taban-drafözaña ny vinanton'ôloño,
2. Kanjo böka, betsaka amoko be tany nandrian-jare
tao ka nivölaña rafözan'öloño : « à
ravinanto ô, anao midira añaty lay fö misy amoko ai !
»,
3. Tsy nahasahy zalahy io ;
4. Tonga andro hafa, efa paré koà ny
rafözan'ôloño,
1. Un jour, un homme (gendre) est venu pour aider sa
belle-mère dans son travail,
2.
39
Or, la cabane où ils dorment était pleine de
moustique et la belle-mère a dit à son beau-fils : « mon
gendre, entre dans la voile-mousquetaire parce qu'il y a beaucoup de moustiques
! »
3. L'homme n'a pas osé de le faire ;
4. Un autre jour, la dame continue à inviter son
gendre à entrer dans sa voile-mousquetaire ;
5. Farany, niditra tañaty lay zalahy, tsy
nahadiñy.
6. Izy koa tönga tao böka, nandry. Nefa,
sambaha hitodika amin-drafözaña, tsy sahiny;
7. Lasaña roa andro, karaha zèñy
foaña. Farany tsy nahadiñy eky ny rafözan'ôloño
kai nivölana: «anao io kony ravinanto, nañomezako zanako anao
iñy kony, anao tsy havako ai; tokony hiditra añaty dara anao
»
8. Niditra ny vinanton'ôloño ary
tafañano ny raha natahöraña ary ela ny ela, bikibo möka
ny rafözan'ôloño io;
9. Pé, nikabaron'ôloño böka i
zalahy vinanto io.
10. Nihöla böka i zalahy io, ary notantarainy
ny raha jiaby. Pé, voakabaro koa ny rafözan'ôloño
satria na mañano karaha akôry ny amoko, ny vinanto tsy
fantsôviña añaty lay.
5. Finalement, cet homme n'a pas pu résister et il a
accepté.
6.
40
A l'intérieur, il a dormi. Cependant, il n'a pas
osé tourner en face de sa belle-mère ;
7. Après deux jours, toujours la même chose. Et,
la belle-mère demande encore : « mon gendre, si je t'ai
accepté pour prendre ma fille, c'est parce que nous n'avons pas un lien
de sang ; donc tu peux entrer dans ma couverture »
8. Le beau-fils accepte et ils ont fait ce que l'on craint
déjà et la belle-mère a tombé enceinte.
9. En conséquence, le beau-fils a fait l'objet d'une
sanction sociale qui est le kabaro.
10. A son tour, il a riposté et raconte tout ce qui
s'est réellement passé. Alors, la belle-mère a
été aussi sanctionnée de la même manière
parce que quelle que soit la circonstance (ici, les moustiques), on ne peut pas
demander ou inviter son beau-fils à dormir dans son lit.
41
A la fin de l'histoire, une question a été
posée : qui est le fautif ? Puis, le débat est ouvert à
toutes les personnes présentes. En fait, ce korambe a
été initié pour apprendre aux jeunes les limites de la
relation qui devrait exister entre les beaux-parents et leur gendre.
c) Le rasavölaña (discours)
En ce qui concerne le rasavölaña, il
s'agit d'un discours partagé entre le «
mpirasavölaña » (celui qui est à l'origine du
discours, qui prend la parole en premier et explique l'objet de la rencontre
et/ou de sa prise de parole) et le « mpamaly
rasavölaña» (celui qui, par son statut social, est
généralement l'aîné, si la parole s'adresse à
un groupe de personne ; ou celui à qui la parole est directement
destinée). Le rasavölaña nous apprend la culture
d'écoute. Au moment de l'intervention du
mpirasavölaña, les autres personnes gardent le silence et
écoutent attentivement ce qu'il raconte. Et, en répondant, le
mpamaly rasavölaña, reformule à sa manière
ce que le mpirasavölaña a dit pour faire preuve qu'ils ont
non seulement bien écouté, mais aussi et surtout bien compris. Ne
voit-on la une forme d'écoute active ? Mais à côté
de cette question d'écoute, on observe également un silence qui
encadre l'apprentissage de l'assistance à travers les proverbes
utilisés pour ficeler le rasavölaña. Ce dernier,
utilisé dès la naissance jusqu'à la mort des gens, tient
une place importante dans l'éducation des enfants, des jeunes voire des
adultes. Il s'agit d'une éducation pour tout âge et à tout
endroit.
d) Le jijy karazana
(généalogies)
Le jijy karazana se fait à tout grand
rassemblement villageois et familial. Généralement, tout
évènement ou cérémonie d'une grande importance est
précédé d'un tsimandrimandry (une sorte de
veillée culturelle, voire une soirée). Pendant la soirée
où la plupart des jeunes s'amusent à faire du totorebika
(danser), d'autres par contre, en particulier les garçons, en
profitent pour s'amuser à draguer les jeunes
42
filles car les parents et les aînés sont tous
préoccupés, soit par les préparatifs, soit par les
boissons alcooliques. Notons qu'en betsimisaraka, tous les aînés
doivent prendre un verre d'alcool.
Par ailleurs, avoir une relation amoureuse avec un membre de
la famille est strictement interdit au village betsimisaraka de
Rantolava, même s'il s'agit d'une famille lointaine. Aussi à
chaque regroupement, il faut laisser place à un jijy karazana,
une sorte de présentation traditionnelle. Non seulement il permet aux
uns et aux autres de se faire connaissance (surtout entre les membres de la
même famille), mais aussi, par le biais du jijy karazana, les
jeunes sont en mesure de catégoriser ceux qu'ils peuvent
fréquenter ou non.
II.2.2.2. Les genres poétiques : le jijy et le
tökatoka
Le jijy et le tökatöka
développe la croissance intellectuelle, notamment pour les
adolescents et les jeunes. Ils les utilisent souvent pour exprimer leur
sentiment ou pour s'amuser. De plus, il se peut que des compétitions
aient été organisées à cette occasion. A un moment
donné, la déclaration d'amour et/ou l'intention de se
séparer se fait de manière poétique. Ci-après est
un exemple de tökatöka :
Dialecte local Traduction
libre
|
« Kapelapelaka
lökomaiñy
tsara fohaniñy andro
maiñy
Anao kö disaka
töndran-teña
Mahazo mody anao amaraiñy
»
|
plats sont les poissons
séchés,
agréables à prendre au bon jour
[quand
il ne pleut pas]
si tu es fatiguée de vivre ensemble
tu
pourras rentrer demain)
|
43
44
II.2. 2.3.Les genres sapientiaux
a) L'ankamantatra (les devinettes et
contes-devinettes)
L'ankamantatra appelé
généralement, devinette (et dans certains cas, conte-devinette)
est une tradition orale permettant le développement de l'intelligence,
de l'observation et de la maîtrise de l'environnement et de la nature. Il
invite les jeunes à prendre connaissance de tout ce qui se trouve autour
d'eux. Il est toujours précédé d'une formulation de
question : « Inona ary `zany ?» (Qui suis-je ?) :
Dialecte local Traduction
libre
« kapaiñy, tsy hita fery »
Coupé, sans laisser la moindre cicatrice
ou plaie
la réponse est l'eau, le vent ou encore le
feu
Ambony mahazo rano rempli d'eau de la haut [car en
milieu
rural betsimisaraka, on cherche toujours de l'eau dans les
cours d'eau] la réponse est le cocotier
b) L'öhabölaña (les
proverbes)
Selon le dictionnaire Larousse, il s'agit d'un court
énoncé exprimant un conseil populaire, une vérité
de bon sens ou une constatation empirique et qui est devenu d'usage commun. En
ce qui nous concerne, la signification pourrait prendre un sens un peu plus
particulier. Ce mot, appelé en pays betsimisaraka «
öhabölaña » est composé de deux termes :
« öhatra » qui veut dire « modèle »,
et « völaña » qui signifie «parole».
Il s'agit alors d'un modèle de vie ou du fonctionnement d'un être
vivant, exprimé de façon artistique pour être attirant,
frappant et facile à retenir. Les öhabolaña sont
donc «le fruit d'une juste observation de la quotidienneté de
la vie
qu'une parole bien tissée a su solidement ficeler
42». On pourrait ainsi dire que le proverbe exprime des
maximes ancrées dans l'expérience.
42 FANONY Fulgence, Öhabölaña
betsimisaraka (Proverbes betsimisaraka). Université de Toamasina.
Article disponible sur :
www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana
betsimisaraka ou proverbes.pdf
45
DEUXIEME PARTIE : RESULTATS ET
INTERPRETATIONS
46
CHAPITRE III- LES PROVERBES : UN GENRE LITTERAIRE A
VOCATION PEDAGOGIQUE POUR LES BETSIMISARAKA
Ce chapitre mettra en évidence la place de
l'oralité dans la vie quotidienne des Betsimisaraka avec l'exemple du
village de Rantolava à l'appui. Et à cette occasion, nous
expliquons également la fonction éducative des proverbes.
III.1. L'art oratoire au quotidien
Sur les enquêtés, seul un ménage a
répondu de ne plus utiliser de proverbes. Pour justifier cette
situation, notre interlocuteur avance qu'il n'est pas habitué à
prononcer tel ou tel proverbe. De l'autre côté, 97,5% des
ménages enquêtés affirment qu'ils utilisent toujours des
proverbes dans leur vie quotidienne. Généralement, pour ces
derniers, les proverbes sont utilisés pendant :
- Les tsaboraha
- Les mariages traditionnels,
- Les travaux communautaires,
- Les festivités culturelles,
- La présentation de condoléances, la
veillée mortuaire,
- Les circoncisions,
- Les périodes de conseil familial,
- Les réunions de résolution de conflits, etc.
Par ailleurs, même si les réponses tournent
autour de plusieurs évènements, les proverbes sont
généralement utilisés pendant la prise de parole telle que
le rasavölaña. Ces évènements ne sont que
des contextes justifiant le rassemblement villageois. En d'autres termes, les
öhabölaña sont présents à chaque fois
que les villageois se réunissent, quelle que soit la raison.
47
III.1.1. Au village de Rantolava : la maturité rime
avec art oratoire
La progression dans le parcours de la vie repose, entre
autres, à l'aune de la maîtrise de la parole. D'abord, on
relève le « silence apprentissage » de l'enfant et de
l'adolescent à qui on demande d'écouter et de retenir ce qu'on
leur dit. Viennent ensuite les timides prises de parole en public d'un jeune
homme à l'occasion de don de boisson (rasavölan-toaka),
à l'occasion d'un travail collectif (rasavölaña amin'asa
fandriaka, rasavölaña amin-dampoño), à
l'occasion d'une réunion villageoise (fandresan-teny
an-kavoriaña).
Le rasavölaña régit la vie de
l'homme de la naissance à la mort. A la naissance, les membres de la
société rendent visite à la famille du nouveau-né,
à la fois pour honorer ce dernier et pour féliciter sa source,
par le biais du rasavölaña. Généralement, le
contenu du discours est deux ordres : d'une part, souhaiter le bonheur et le
succès de l'enfant, et rappeler aux parents leur rôle dans le
développement et l'épanouissement de celui-ci et, d'autre part,
les rassurer qu'ils ne sont pas seuls dans cette tâche difficile, car
l'enfant appartient également à la société. Devenu
adulte, pendant les mariages traditionnels ou « orimbato »
(contrat de mariage), tout commence par le rasavölaña. A
la mort, le « rasavölam-paty » (discours de
condoléances, funérailles...) trouve aussi sa place. Et,
entre-temps, de nombreux évènements familiaux mettent en exergue
cette place de la parole et de l'art oratoire dans la vie quotidienne.
Sans nul doute, les rasavölaña
présentent un cheminent éducatif dans tout parcours de vie
en pays betsimisaraka. En un mot, l'art oratoire se transmet, au
village de Rantolava, d'aîné à cadet, il se construit et
s'affine avec l'âge.
III.1.2. Les proverbes : pour mieux ficeler la parole
Si la parole occupe une place importante dans la
société betsimisaraka qui résiste jusqu'à
nos jours, c'est parce qu'elle a sa particularité. Le vrai discours
betsimisaraka, est prononcé d'une manière artistique. Un
des facteurs rendant le rasavölaña artistique est
l'utilisation des proverbes. Ainsi, par exemple, au lieu de dire que le travail
est le garant de la survie, on fait allusion à un vieux maki : «
antidahim-bariky ny fianaña : izay tsy mambokoño, tsy
hömaña » (Ce qui ne saute pas, ne mange
rien)43. L'un des objectifs visés est, d'une part, le
renforcement de la capacité de mémorisation (retenir un bon
nombre de proverbes) et, d'autre part, l'intelligence de la situation (savoir
choisir le proverbe qu'il faut en fonction du contenu de son discours et de
l'auditoire). Prononcer un discours n'est pas uniquement maîtriser son
contenu, mais aussi la manière de le rendre attirant, facile à
retenir pour être utilisé dans la vie quotidienne. Pour ce faire,
les proverbes sont généralement sollicités.
Nous avons reproduis ci-après les proverbes les plus
utilisés par les familles enquêtées :
Domaines d'utilisation Öhabolaña
Traduction
Relation
cadet/aîné 1- Manan-jôky
afak'olan-
teny, manan-jandry afak'olan'entaña
1- Ce qui a un aîné est
déchargé de la parole, ce qui a un cadet est
déchargé de bagages
48
43 Proverbe cité et traduit par FANONY Fulgence,
Öhabölaña betsimisaraka (Proverbes
betsimisaraka). Université de Toamasina.
Article disponible sur :
www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana
betsimisaraka ou proverbes.pdf
2- Aza mañao felam-
boapaza: miritika
añambon'ny maventy
3- Kakazo mandriandry: tsy vakian'ny varatra
4- Aza mañano a baba, mahita biby
atahöraña
5- Aloha zôky, afara zandry
2- Ne sois pas comme la fleur d'un papayer : les plus
petites s'assoient au-dessus des plus grands
3- La foudre ne tombe pas sur un arbre
couché
4- N'appelle pas « père », en voyant un
animal effrayant
5- Avant l'aîné, derrière le
cadet
Statut de la femme 1-
Lañana feno rano :
ankiniña tsy avela
2- Tintely nanambady
aomby: lahin-draha tsy mbö
hely
3- Lalahy tsy mitan-
kapoaka
1- Un bambou rempli d'eau: on le pose, mais on ne le laisse
pas44
2- Tel un miel qui s'est accouplé à une vache : un
mal n'est jamais petit
3- Le mari ne doit pas tenir la tasse à mesurer
49
44 Chez les Betsimisaraka, le bambou est un récipient
d'eau. A chaque fois qu'on a besoin d'eau pour la cuisine ou pour la vaisselle,
on prend le bambou plein d'eau.
Solidarité et
entraide 1- Aleo very tsikalakalam-böla, toy izay
very tsikalakalam-pihavanaña
2- Vary amin-drano: an-tanety miara-maiña,
an-köraka miara leña.
3- Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika
4- Mpirahalahy mandeha añaty ala: izaho tokiny, izy
tokiko
5- Kakazo tökana, tsy mbö ala
6- Traño atsimo sy
avaratra: izay tsy
mahaleñy, hialöfaña
7- Asan-dakana: tsy vita tsy
hifanakönaña
8- Akanga maro: tsy
vakin'amboà
1- Vaux mieux perdre son argent, plutôt que de perdre
ses relations amicales
2-
50
Riz et eau : sur terre, ils se sèchent ensemble, dans
la rizière, ils se mouillent ensemble
3- Ceux qui s'unissent forme une pierre, ceux qui se
séparent deviennent sable
4- Deux frères qui se promènent dans la
forêt : je suis sa force, il est ma force
5- Un arbre n'est pas la forêt
6- Maison au Sud et au Nord : on se cache dans celle qui nous
protège de la pluie
7- La construction d'une pirogue ne se fait pas sans
participation d'une équipe
8- Un groupe de pintade n'est pas accessible à un
chien
51
Nous pouvons constater que le village est riche en
matière de proverbes relatifs à la relation entre
aîné/ cadet, à la solidarité ainsi qu'à la
cohésion sociale. Par contre, peu de proverbes ont été
recensés concernant le statut de la femme.
III.2. Société betsimisaraka : une
école de la vie par les proverbes
A travers les proverbes, nous pouvons apprendre le mode de
fonctionnement de la société, la structure sociale, les attitudes
et les comportements qui devraient être adoptés. Dans la
présente section, nous présenterons le mode de fonctionnement de
la société betsimisaraka, en particulier sur les formes des
relations sociales qui existent entre ses membres. Ensuite, nous analyserons
les priorités éducatives des Betsimisaraka.
III.2.1. L'importance du statut social
La société betsimisaraka est une
société hiérarchisée. C'est une
société qui accorde une importance majeure aux
aînés et à toute personne de sexe masculin.
Nous allons analyser successivement ces deux points évoqués.
III.2.1.1. Relations cadets/aînés
L'aîné, soulignent MERIOT et MANGALAZA,
est censé avoir une longueur d'avance sur les choses de la vie par
rapport à son cadet45. C'est la raison pour laquelle ce
dernier lui doit respect, soumission et obéissance. « Tsy
zana-gisa [zahay] ka hitarika ny reniny » (on n'est pas des oisons
qui dirigent leur mère), soutiennent les Betsimisaraka. De
plus, il faut faire preuve d'autant d'humilité que de soumission: «
tsy angady [zahay] ka hilöha lela na filo hilöha rañitra
» (on n'est pas
45 MANGALAZA Eugène, MERIOT Christian,
Anthropologie générale n°04 (Cours du premier
semestre 2012-2013). Disponible sur :
http://www.anthropomada.com/bibliotheque/Anthropologie-Generale-4.pdf
, p.20
52
comme la bêche, précédée par sa
langue ou de l'aiguille, par sa partie pointue). Ces proverbes sont des
introductions qu'on entend et qu'on utilise souvent dans les discours
traditionnels, tel que le rasavolaña. Consciemment ou
inconsciemment, celui qui parle transmet une norme sociale à son
auditeur, ce qui peut influer par la suite sur le comportement de ce dernier. A
côté de cette obéissance soi-disant inconditionnelle,
s'ajoute une exploitation apparente du cadet par l'aîné. MANGALAZA
et MERIOT ont fait une analyse à ce propos lorsqu'ils ont
développé la signification du proverbe : « Manan-jandry,
afaka olan'entana ; manan-joky afaka olan-teny » (Qui a un cadet est
déchargé des bagages et aîné, de la
parole)46. C'est-à-dire que lorsqu'on est accompagné
par un cadet, on est déchargé des bagages car c'est lui qui doit
les porter. Et quand on est avec l'aîné, on est
déchargé de la prise de parole car cela lui revient de droit.
Au tant de questions que de réponses : quelle
signification ? Pour quelles raisons? Au cours de ce travail, on tentera
d'apporter quelques pistes de réponse à ces questions
méritant sans aucun doute, de profondes réflexions.
a) Une question d'affection et de protection
D'une simple observation de l'extérieur, il semble
difficile de parler d'affection, et encore moins de protection à travers
de cette culture. Effectivement, on se référant aux
différentes traditions, l'hésitation semble trouver sa raison
d'être. Le plus remarquable de cette vision est le cas de construction
d'une maison. Ainsi par exemple, lorsque le père est encore en vie, le
fils ne pourra construire une maison qui est plus vaste et plus haute que celle
de son père. Cette culture est apparemment strictement opposé
à celle de l'Imerina47: « Adala izay toa an-drainy
» (Anormal,
46 Ibid., p. 21
47 Une autre région de Madagascar qui se situe dans les
hautes terres centrales. Le groupe de population qui y occupait fut les
Merina.
53
celui qui ressemble à son père). L'idée
est que l'enfant devrait faire mieux que son père, notamment dans la
question économique que sociale.
Quoi qu'il en soit, souvenons-nous d'une chose : «
aucune culture (parce qu'elle est l'expression de l'humanisation du monde,
tant sur le plan individuel que collectif) ne vaut pas plus qu'une autre
48». En fait, notre analyse tient compte de plusieurs
aspects. Reprenons, par exemple, le cas des oisons qui se promènent en
passant avant les oies, le risque est tout à fait présent.
N'ayant que peu de connaissances sur le milieu où ils vivent, les oisons
ne maîtrisent pas encore l'environnement, l'endroit à risque
où se trouvent les animaux sauvages ou encore l'endroit idéal
pour trouver de quoi à manger, les bösaka ou
ankirendriñy. Il en est de même dans : « Tsy
tsiatsiapiaña [zahay], hirômbaka öfaña »
(lorsqu'on pêche avec de la canne à pêche, il est souvent
constaté que seuls les petits poissons se pointent ; mais les anguilles
et les gros poissons ne sont que rarement pris de cette manière). Les
expériences de l'aîné par rapport à la vie obligent
le cadet de se mettre dans une posture du « silence-apprentissage »
comme l'ont signalé MERIOT et MANGALAZA.
D'autres faits sociaux qui justifient cet esprit d'affection
et de protection se manifestent lorsqu'un membre de la famille
(généralement des enfants) quitte le foyer pour des raisons
quelconques : travail, mariage, étude... Le chef de famille
(père) donne le « tso-drano » ou le « fafy
rano » (bénédiction) à l'intéressé
en prononçant des expressions comme « irin'ôlo fö
tsy hañiry ôlo » (inspiré par autrui, et non
s'inspirer d'autrui), « ho mamy hoditra amin'ny fiarahamonina
» (littéralement, avoir une « peau sucrée »
dans la société, c'est-à-dire être admiré par
l'ensemble de la
48 MANGALAZA Eugène, MERIOT Christian, Anthropologie
générale n°02 (Cours du premier semestre 2012-2013).
Disponible sur
http://www.anthropomada.com/bibliotheque/Anthropologie-Generale-2.pdf
, p. 10
54
société). Dans ce concept, peut-on vraiment
parler d'une exploitation et d'une soumission ?
En fait, la désapprobation sociale a toujours
été une honte pour la famille traditionnelle
betsimisaraka. Il appartient alors au chef de famille (père) ou
l'aîné (le cas échéant) de sauvegarder, de
protéger l'honneur et le prestige familial. L'aîné ne peut
agir qu'en fonction de la logique de la société : « Aza
mañano karaha fary, lohany ndraiky matsatso » (Ne soit pas
comme la canne à sucre, c'est la tête qui est la moins
sucrée de toutes les parties). L'idée est la suivante :
l'aîné devrait mener une vie exemplaire, avoir un comportement
digne de son nom et ne devrait agir qu'en fonction de la norme acceptée
par la société.
b) Une question de soutien et de la solidarité
familiale
La question de protection va vers un double sens.
Verticalement, entre les membres de la famille; et horizontalement, dans la
famille elle-même car l'aîné est responsable
vis-à-vis d'elle et des autres membres de la société. Face
à cette importante responsabilité de l'aîné, le
cadet pense avoir l'obligation de le soutenir. Il n'y a guère
d'exploitation car l'aîné « ne devrait pas faire comme le
moineau rouge : interdire aux autres de ne pas consommer d'une nourriture que
lui-même n'arrive pas à se priver » : « Aza
mañano fodilahimena, mandrara hômaña », disent
les Betsimisaraka.
Dans toutes ses actions et en fonction de ses
expériences, l'aîné prend tous les moyens par rapport
à son modèle du monde pour assurer le bien-être social et
individuel de son cadet. La réciprocité implique que le cadet a
l'obligation d'encourager et de soutenir l'aîné dans ses
tâches difficiles. En fait, la soumission, si l'on peut l'appeler ainsi,
n'est qu'une forme de participation du cadet au fonctionnement de la vie
familiale. De toute façon, pour qu'il y ait vraiment une soumission, il
faut qu'elle soit ressentie par l'intéressé. Or, dans la
société
55
traditionnelle, les cadets ne sont pas gênés par
ce système, du moins d'après notre propre hypothèse. C'est
une manière de garantir l'harmonie au sein de la famille qui est
d'ailleurs la première image de la société. Les
sociétés durent, disait EVANS-PRITCHARD49, parce que
leurs membres sont liés par une obligation morale. Et c'est dans ce sens
que nous voyons l'image de cette relation.
III.2.1.2 Le statut de la femme dans la
société betsimisaraka
Apparemment, les femmes de Rantolava ont toujours
occupé une place moins importante que les hommes. Elles se chargent du
ménage, de la cuisine et de l'éducation des enfants. Dans
certains cas, elles n'ont pas droit de s'assoir à une chaise et elles ne
peuvent pas s'installer dans certaines parties de la maison. En plus, bien que
les filles fréquentent l'école comme les garçons, une fois
revenues à la maison, elles sont appelées aux tâches
ménagères, à la pratique des bonnes manières et du
savoir-vivre, à apprendre les traditions, moeurs et coutumes pour
qu'elles puissent devenir de bonnes épouses, capables de s'occuper de
leur ménage respectif. « Viavy tsy mahay mandrary, tsy mahazo
aomby » (une femme qui ne sait pas faire de la vannerie, n'obtient
pas de boeufs) affirme-t-on. C'est ainsi qu'avant de demander la main d'une
jeune fille, la famille du jeune garçon s'informe sur la capacité
de la future mariée à s'occuper de cette tâche
ménagère. Les boeufs ne sont là qu'à titre
indicatif d'un cadeau offert lors du mariage. En général, les
jeunes filles fréquentent l'école seulement jusqu'à ce
qu'on les demande en mariage, même avant qu'elles soient majeures.
Nous voulons maintenant insister sur la place et la
considération de la femme dans la société traditionnelle
betsimisaraka. « Akoho vavy mañeno » (« une
poule qui chante », car en principe c'est le coq qui chante). Ce proverbe
montre que
49 Cité par MANGALAZA Eugène, MERIOT Christian,
Anthropologie générale n°03 (Cours du
premier semestre 2012-2013). Disponible sur
http://www.anthropomada.com/
bibliotheque/Anthropologie-Generale-3.pdf
, p.23
56
ce n'est pas la place des femmes de prendre la parole en
public. Il leur est en effet interdit de prendre la parole en public, de
prendre de décisions ou d'exprimer leur mécontentement. Certains
hommes vont loin pour expliquer cette situation de la femme. Ils expliquent que
les femmes sont d'une faible capacité intellectuelle par rapport
à celle des hommes, qu'elles sont incapables de réfléchir
sur un sujet d'une importance majeure, qu'elles sont faciles à
influencer et qu'elles pourraient changer d'avis du jour au lendemain. Alors,
en tant que chef de famille, les hommes pensent que la parole et les
décisions leur reviennent de droit.
Cependant, on peut le voir sous un autre angle comme l'a bien
évoqué M. MORA Richard50. Physiquement, les femmes
étaient anciennement considérées comme plus faibles que
les hommes. Par contre, la société était
déjà consciente qu'elles constituent le pilier de la famille.
Chez les Betsimisaraka, « Lalahy, tsy mitan-kapoaka »
(l'homme ne garde pas la tasse à mesurer). Cela prouve la confiance
absolue du mari à l'égard de son épouse, namaña
51. En fait, ce proverbe veut dire tout simplement que la
gestion du quotidien (riz blanc) et les ressources familiales relèvent
de la compétence exclusive de la femme. Elle est logiquement la personne
qui s'occupe du ménage et bien évidemment tout ce qui concerne la
cuisine.
C'est surtout parce que la femme est dans la cuisine qu'elle
est souvent privée de parole. Lorsqu'il y a de la visite, les membres de
la famille répartissent les tâches : les uns s'occupent des
visiteurs, en discutant avec eux, en écoutant l'objet de leur visite ;
tandis que les autres préparent ce qu'on a à offrir ou à
présenter (café, repas ou autres). Si la femme est privée
de la parole, c'est parce qu'elle avait d'autres occupations importantes, tout
comme les hommes. Seulement ses occupations ne demandaient pas d'effort
physique énorme. Par contre, la garantie de la réussite
50 MORA Richard, ancien Sénateur de Madagascar. Il nous
a accordé un entretien dans son atelier, sis à Maroantsetra
(Betsimisaraka nord), en date du 12 mai 2014.
51 « Namaña » (Littéralement, signifie
compagnie, ami, équipier ...) : chez les Betsimisaraka, on utilise le
mot « mpinamaña » pour dire « mpivady » (les
mariés) dans certaines régions de Madagascar.
57
familiale est entre ses mains, par le biais de
l'éducation qu'elle accorde aux enfants. Par ailleurs, on peut dire que
cette situation est toujours liée à la force physique de la
femme. Il se peut que, lors de la discussion ou au moment de la prise de
décision, il y ait certaines personnes mécontentes qui pourraient
se révolter et ou se manifester, voire provoquer par la suite un
affrontement. Donc, on veut éviter cet affrontement aux femmes car elles
ne disposent pas de force pour y faire face.
III.2.2. Les priorités de l'éducation
A l'unanimité, toutes les familles faisant objet de
notre enquête affirment que l'éducation des enfants relève
de la mère de famille. Mais, en réalité, cette
éducation est une affaire de tous les membres de la
société qui sont en position d'aîné. Cependant, il
n'y a pas vraiment une conception réelle de l'éducation.
Questionnés sur les questions relatives aux domaines de croissance
qu'ils développent chez les enfants, nos interlocuteurs répondent
de manières différentes.
Plus de 80% des personnes interviewées parlent d'une
éducation à la vie et à la morale comme priorité.
Nous entendons ici par éducation morale, toute forme d'apprentissage
permettant à l'individu de pouvoir se comporter conformément
à ce que la société considère comme étant
juste et qu'en même temps l'individu lui-même soit capable de faire
un auto-jugement. Cette éducation morale concerne principalement le
savoir-être et le savoir-vivre, c'est-à-dire l'adoption d'un
comportement semblable aux autres membres de la société (les
parents, les aînés, etc.). L'éducation à la vie,
quant à elle, vise à préparer l'individu à
être capable de prendre en main sa propre vie. C'est ainsi que les jeunes
garçons sont appelés à suivre les traces de leur
père ou de leur oncle. Après l'école ou pendant les
vacances, ils travaillent la terre ou pratiquent de la pêche. Les filles
aident leur mère à faire les tâches
ménagères.
58
III.2.2.1. L'obéissance
Dans la société betsimisaraka,
l'obéissance vis-à-vis de l'aîné est une des
premières priorités de l'éducation. Cette
obéissance constitue le garant de l'harmonisation de la vie
sociétale. Revenons-nous sur le proverbe concernant les oisons
cité plus haut. A l'image de ce proverbe, les parents, sont aux yeux des
Betsimisaraka, des personnes capables de gérer et de subvenir aux
besoins de leur famille, de leurs enfants. Ils servent également de
repères pour le futur foyer de leurs descendants.
En plus, la société rurale et traditionnelle
betsimisaraka est obligée de vivre avec cette forme de discipline
fondée sur l'obéissance. Lors d'un entretien avec les
Tangalamena du village, la raison de cette obéissance est bien
résumée par un proverbe : « Atody tsy miady amim-bato
» (un oeuf n'affronte jamais une pierre).
III.2.2.2. La socialisation et l'éducation au
travail a) La socialisation et l'entraide
L'éducation des enfants vers la socialisation et
l'entraide est une préoccupation permanente des Betsimisaraka. «
Mandehandeha mahita raha, midôko an-draño mahita jôfo
» (se promener permet d'observer des choses, le fait de rester chez
soi ne permet d'observer que du cendre) disent-ils à ce propos. Et, ils
continuent avec « Aza variaña mampandihy vavitsy foaña
fö, mbö mizahava raha fanoin'ôloño » (ne vous
contentez pas de faire danser vos jambes, mais regardez ce que les autres
font). Ce qui signifie que l'essentiel n'est pas la promenade. En invitant les
jeunes à sortir de chez eux, les Betsimisaraka pensent que
l'apprentissage ne se limite pas au sein de la famille. Cet horizon familial
est nettement insuffisant pour l'épanouissement de l'individu. Pour que
l'individu se développe, il a besoin de se
59
familiariser à l'ensemble du monde. Et, ce n'est que
par cette ouverture qu'il pourra comprendre le fonctionnement de la
société dans son ensemble.
Mais, puisque l'observation peut être participante ou
non, elle ne se limite pas au fait de « regarder », elle implique
également la participation effective dans les différentes
activités.
La socialisation et l'entraide se présentent sous
plusieurs formes. Ainsi par exemple, si un membre du village est
décédé, tous les membres du village se mobilisent pour
rendre hommage à la famille du défunt parce que : « raha
mahavoa fe, mety mahavoa valahaña » (ce qui touche la cuisse,
pourra toucher le sexe). Les jeunes sont aussi mobilisés. Ici,
l'objectif pédagogique est double. D'abord, inculquer cette idée
d'assistance à l'égard des personnes en difficulté car
rien n'est plus douloureux que de perdre un membre de la famille. Ensuite, pour
qu'ils observent le comportement des gens dans ce genre de situation (les
rites, les différentes sortes de discours...).
La culture et les méfaits de l'argent ne sont
introduits au village que très tardivement. Auparavant, les habitants
n'ont pas besoin de payer de la main d'oeuvre pour labourer leur terre ou
encore pour construire leur maison. « Aleo very tsikalakalam-bola, tsy
izay very tsikalakalam-pihavanana » (vaut mieux perdre de l'argent
que de perdre ses relations amicales). On parlait généralement du
« lampoña », « tambirô » et
« fandriaka ».
- Le fandriàka ou mifampila tànana :
c'est une sorte de travail tournant entre les membres de la
société. Les membres du village s'organisent et fixent le
calendrier pour effectuer le travail de chaque membre. Il appartient à
la famille faisant objet du travail communautaire d'offrir des boissons,
principalement des boissons alcooliques à titre de participation et
de
60
remerciements. Ces boissons sont offertes pendant le travail.
Et, si la durée du travail prend une journée et plus, elle se
chargera également du repas de midi.
- Le tambirô : à la différence du
fandriaka, ce terme est composé de deux mots : « tamby
» qui signifie « contrepartie » et « rô
» qui veut dire « bouillon ». Littéralement, le
tambirô désigne un travail communautaire contre du
bouillon (viande de zébus). Alors, le tambirô n'est pas
forcément systématique pour tous les membres. La famille qui fait
appel à un tambirô ne dispose pas d'un libre choix sur le
menu à présenter à ceux qui manifestent à son
appel.
- Le lampoña : à la différence
du tambirô, le lampoña est un travail contre
boisson alcoolique.
A travers de ces différents types de travail
communautaire, les jeunes apprennent non seulement à aider leurs
voisins, mais ils apprennent également à travailler pour leur
propre intérêt.
b) Adaptation et socialisation
En ce qui concerne la question de l'adaptation, «
trandraka an-tanimena, vôlon-tany arahiñy » (tel un
tanrec sous un sol rouge, devrait-il prendre la couleur de celle-ci), le
proverbe affirme l'intérêt de l'adaptation pour l'inclusion
sociale. Puisque l'inadaptation est une exclusion de la société,
« l'homme est contraint de s'accommoder aux
réalités52». C'est pour dire que la
capacité d'adaptation est une des bases de la socialisation. Chez les
Betsimisaraka, cette question d'adaptation inculquée aux jeunes se
présente sous plusieurs aspects : humilité, compréhension
et respect des autres, de leur valeur, de leur culture, de leur état, de
leur situation...
52 CHARRIER Jean-Paul (1968). L'inconscient et la
psychanalyse. P.U.F 108, Paris.
« Taölan-tsomanga nahaföla-nify, raha
hitàn'ôloño aza famaraña »
(Tige de patate ayant coupé la dent, ne contredit pas
ce que les autres ont vu).
61
Ce proverbe signifie que chaque individu vit ses propres
expériences, qu'il a son vécu personnel. Cela n'est pas
forcément semblable à ce que vivent les autres, alors que ceux-ci
influent certainement sur sa manière d'agir, de réfléchir,
et de vivre. Il est donc préférable de ne pas contredire les
propos d'autrui, de porter un pré-jugement, et, indépendamment
des raisons évoquées, cette attitude permet d'harmoniser la
communication.
Toujours dans les mêmes objectifs pédagogiques,
mais avec un autre
concept :
« Vero tingenam-pody, tsy fölaka fö
(Citronnelle à laquelle s'accroche un
milefitra » moineau, ce n'est pas de la fracture
mais
de la souplesse)
« Lalitra kö mahöla, vày
taköfaña » (Si les mouches sont folles, Il faut
couvrir
la plaie)53
Ces proverbes visent à développer chez les
enfants du pays, un esprit et comportement souple, simple, et ce, pour
éviter des confrontations inutiles pouvant nuire aux relations sociales
car « Faharetaña vidin'ny fitiavaña, meky ti- hisaraka
mamboly antsa » (La patience est l'épouse de l'amitié,
qui veut se séparer intente des alibis)54.
53 Traduction de FANONY Fulgence,
Öhabölaña betsimisaraka (Proverbes betsimisaraka).
Université de Toamasina. Article disponible sur :
www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana
betsimisaraka ou proverbes.pdf
54 Ibid.
62
c) L'éducation au travail
Pour commencer ce paragraphe, nous reproduisons ici, un des
proverbes relatifs à la relation cadet/aîné : «
Manan-jandry, afaka olan'entana ; manan-joky afaka olan-teny »
(Qui a un cadet est déchargé des bagages et aîné, de
la parole). L'explication de proverbe est vraiment multiple. Nous essayons de
proposer quelques interprétations qui sont toutes liées à
la force physique de l'individu. La première explication se rapporte au
développement physique de l'enfant, ici considéré comme le
cadet. La force physique de l'enfant a besoin d'être
entraînée à des différentes tâches que la vie
lui réserve. Notons que nous sommes dans une société
où les activités principales sont l'agriculture et la
pêche. Ces activités nécessitent l'utilisation de
l'énergie physique. Alors, le fait de toujours demander au cadet de
porter des bagages signifie qu'il est nécessaire de préparer son
corps au travail.
L'autre explication, quant à elle, est liée
à l'état physique des parents. Plus on vieillit, plus on devient
fragile. Alors, dans ce sens, on parle plutôt d'une éducation au
respect vis-à-vis des personnes âgées.
Mais, on parlant de cette éducation au travail, nous ne
pouvons pas passer sous silence cette expression souvent utilisée par
les adultes betsimisaraka: « aza mitantara angano andro
atoandro fö, mahavery » (ne raconte jamais un conte pendant
journée, il risque de vous faire perdre dans la nature). Cette
expression éducative explique bel et bien l'importance de la
journée de travail dans la société betsimisaraka. Nous
sommes conscient que cette expression n'est pas si claire en elle-même.
Un autre message est transmis à travers d'elle : si vous perdez votre
temps à raconter des contes, il se peut que vous laissiez à
côté votre tâche la plus importante. Et, si l'enfant
continue à prendre à la légère cette
recommandation, il risquera de ne pas pouvoir faire grande chose dans la
journée.
63
Nous reprenons également quelques proverbes de
l'article de Fulgence FANONY55, mettant en exergue cette
volonté d'éduquer les enfants betsimisaraka à la culture
du travail :
Dialecte local Traduction libre
|
Antidahim- bariky ny fiaiñaña:
izay tsy
mambokiñy tsy hömaña .
Toto varim-Bazimba:
izay tsy mañaño tsy
hômaña.
|
Vieux maki: celui qui ne sait pas sauter ne mange rien.
Pilonnage de riz de Vazimba (Premiers habitants de Madagascar),
ceux qui ne font rien ne mangent pas.
|
Akôho be holy tsy be fe. Les poules paresseuses
n'ont jamais
grosses cuisses.
Le point commun de ces proverbes est de faire apprendre que
chacun est responsable de son propre développement. A ces proverbes
cités par FANONY s'ajoute un autre : « tafôn'ny
am-pamindro : tsy araka ny mpalaka kitaiñy » (le désir
de celui qui veut se chauffer ne peut être satisfait par le chercheur de
bois de chauffage). En d'autres termes, nous ne pouvons être mieux servis
que par soi-même. Chacun est responsable de sa survie, de son
épanouissement en matière économique. Si vous êtes
paresseux, vous mourrez de la faim ; tel est le fond du message.
Mais, là aussi, cet apprentissage du travail s'effectue
selon la division sexuelle. L'oeuvre de RAVOLOLOMANGA Bodo56 est
très claire à ce sujet : « Au contact du père, le
garçon se familiarise avec l'outil et la technique, comme avec
la
55 FANONY Fulgence, Öhabölaña
betsimisaraka (Proverbes betsimisaraka). Université de Toamasina.
Article disponible sur :
www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana
betsimisaraka ou proverbes.pdf .
56 RAVOLOLOMANGA Bodo, Education, famille et
société : cas de l'enfant Tanala. Taloha n°12,
Archéologie des Hautes Terres, Paris, 1994.
64
coutume et le savoir-faire. Il apprend ainsi comment
manipuler une hache, une bêche, une scie ou un coupe-coupe. Comme son
père, il participe à peine aux travaux domestiques et passe la
plupart de son temps dans les champs, se charge des occupations
nécessitant un effort. La fille de son côté fait
l'apprentissage des corvées de la maison au contact de sa mère ou
de ses grands-mères et ses mères classificatoires57.
Les travaux féminins auxquels elle s'initie la lient étroitement
au village et ses environs immédiats ».
d) Quelques dérives et certaines limites de la
solidarité betsimisaraka
De nombreuses questions se posent également en
matière de la solidarité betsimisaraka. Revenons sur le
cas de « Drakidraky mamàna atodim-boay, manambitamby rano
androaña » (Une canne couvant des oeufs de caïman, c'est
pour se procurer de l'eau pour baigner). Est-il question d'inculquer un esprit
de méfiance permanente ou d'une relation d'intérêt ? La
réponse est vraiment très complexe : la méfiance, si elle
existe se range avec le jugement du public, alors que l'intérêt se
trouve du côté de l'acteur lui-même. A chaque action de
l'individu, la société essaie d'imaginer sa face cachée.
Quelle est vraiment son intention ? Où est-ce qu'il veut en venir ? N'y
a-t-il pas d'un piège ? Ce sont, entre autres, les questions que posent
certains membres de la société. En fait, comment pouvons-nous de
ne pas y penser lorsque nous entendons un proverbe comme :
|
«Antimaroa tsy ary
indraiky mamy lela : izy
koa
mamy lela, hindraña
|
(Les habitants de Maroa [diminutif de Maroantsetra, une ville
au Sud d'Antalaha dans la baie d'Antongil] n'ont jamais la « langue douce
», s'ils en usent, c'est
|
57 A Madagascar, toutes les femmes âgées sont
considérées comme des mères. Les mères
classificatoires sont l'ensemble de ces catégories de femmes.
65
hiasa » certainement pour demander de l'aide) 58
Pour comprendre l'ampleur du problème, il faudrait
remonter au XVIIIè siècle, période pendant laquelle s'est
formée la confédération betsimisaraka, voire la «
naissance » même du terme par l'initiative du Filohabe
(grand-chef) Ratsimilaho Ramaromanompo. En analysant l'histoire de cette
population, le lien est loin d'être naturel : il est d'ordre conjoncturel
et contextuel. C'est d'ailleurs dans cet angle que nous posons la question :
s'agit-il du « benatrötro » (nombreux qui se sont
réunis) ou « betsimisaraka » (nombreux unis à
jamais)? La première idée pose que l'unification de la population
ou de l'ethnie betsimisaraka (si on peut l'appeler ainsi) a
été d'ordre politique plutôt que social ; c'est le
système et la volonté politique du dirigeant de l'époque
qui la fait naître. Tandis que la seconde se rapproche du naturel qui
pouvait être lié aux origines ou aux conditions
géographiques (« union par contrainte ») telles que les
petites îles, comme celle de Sainte Marie...
III.2.2.3. La préparation à la vie sexuelle
et conjugale
Même si les proverbes relatifs à la
préparation à la vie conjugale n'ont pas été
vraiment évoqués lors de nos enquêtes auprès des
ménages, l'entretien auprès des cibles particulières tels
que les notables de la région nous a permis de connaître
suffisamment de proverbes pour justifier que ce thème figure parmi les
objectifs de l'éducation en terre betsimisaraka.
Nous citons ici alors quelques proverbes cité par LAVA
Jean-Claude, un enseignant de Malagasy retraité :
58 FANONY Fulgence, Öhabölaña
betsimisaraka (Proverbes betsimisaraka). Université de Toamasina.
Article disponible sur :
www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana
betsimisaraka ou proverbes.pdf
66
|
- Anti-bavy nahölan-jafy : izy koa tsy
hamono,
tongava maheky
- Sidilahy tratra nandry amin-jènany :
tsy
hampisaraka ny zama-jaza
|
- Une vieille dame violée par son petit-fils: si cela
ne tue pas, reviens souvent - Un neveu trouvé en couchant avec sa
tante : ne sera jamais un facteur de
divorce par son oncle
|
A travers de ces proverbes, la société transmet
à ses membres, en particulier aux jeunes garçons, des
réflexions sur la question relative à la vie sexuelle, d'une
part, mais aussi, sur la préparation à la vie conjugale, d'autre
part. De la première observation, ces proverbes autorisent les jeunes
garçons à entamer des relations sexuelles avec les femmes.
Seulement, pour ce faire, ils doivent respecter certaines limites. Ainsi par
exemple, en se référant au premier proverbe évoqué,
le message est tout à fait clair. Oui, un jeune garçon a le droit
d'avoir une relation sexuelle et de sortir avec une jeune fille de son
goût, mais surtout, il ne faut pas la détruire. Vous n'avez pas
droit de l'en abuser que si vous êtes prêts de la demander en
mariage. Ici, le mot « tuer » ne signifie pas strictement «
ôter la vie », mais ruiner et détruire l'avenir de quelqu'un.
Devenir une mère célibataire est une honte pour la famille
betsimisaraka. En plus, cette femme risque de ne pas trouver de mari
tout au long de sa vie car, en principe, aucun homme ne veut s'occuper d'un
« zana-bady » ou encore d'un « zana-drafy
» (littéralement : « enfant de l'épouse » ou
« enfant d'un rival »).
Dans la vie quotidienne, cette volonté éducative
se manifeste par la pratique de certaines formes de plaisanterie entre les
membres de la famille. Les plus remarquables sont celles qui existent entre
oncles et nièces, oncles et neveux ou neveux et tantes, ainsi que celle
qui existe entre le grand-père et ses petits-enfants. Dès son
enfance, la fille est habitué à être appelée par son
oncle comme étant « madamo », c'est-à-dire
« épouse ». Sur le même principe, c'est ce qui se
présente également entre la tante et son petit neveu. La tante
l'appelle « ramose » qui signifie « mari ». C'est
surtout dans ce sens que le deuxième öhabölaña
intervient. La tante et
67
son petit neveu sont considérés (selon la
plaisanterie des betsimisaraka) comme étant un couple (mari et
femme). C'est pourquoi on dit que lorsque le petit neveu se couche avec sa
tante, il s'agit d'une situation normale. Son oncle ne devrait pas se
fâcher.
De la même manière, mais avec un objectif
différent, il se peut que le grand-père et l'oncle appelle
respectivement leurs petit-fils ou leurs neveux comme étant de «
beaux-frères ». Et, c'est le sens véhiculé par le
second proverbe. Si on veut aller un peu plus loin, cette appellation signifie
que le garçon est le mari de sa mère. Autrement dit, dès
son enfance, il doit prendre soin de sa mère en tant que l'homme de la
maison. A l'absence de son père, il n'est pas considéré
comme étant un enfant, mais un homme de la famille. Comme ce qui se
présente avec les jeunes filles, ces différentes formes de
plaisanteries préparent psychologiquement les jeunes betsimisaraka,
à prendre leur responsabilité conjugale ou familiale, une fois
devenus adultes.
68
CHAPITRE IV - APPROCHES PEDAGOGIQUES D'UNE ECOLE
SANS
MURS EN PAYS BETSIMISARAKA
IV.1. Une pédagogie de deux ordres
L'approche pédagogique de l'école sans murs au
village betsimisaraka se distingue à celle de l'école de type
occidental. Les proverbes présentent deux catégories d'approches
: les proverbes à pédagogie directe et les proverbes à
pédagogie indirecte.
IV.1.1.Les proverbes a « pédagogie directe
»
Les proverbes sous formes d'interdiction à forte valeur
métaphorique se présentent comme un « impératif
catégorique ». Ici, le sujet est pris de force, sans lui laisser la
moindre alternative dans le comportement à prendre. Il est pris en
laisse, sans la possibilité de bifurquer par ici ou par là. Les
proverbes s'énoncent comme un ordre à suivre
impérativement (d'où le terme d'« impératif
catégorique »). Quelques exemples de proverbes de cette
catégorie : « Aza mañano karaha fary » (ne sois pas
comme la canne à sucre); « Aza mañano
fôdilahy mena » (ne sois pas comme le moineau rouge). Ces
proverbes commencent toujours par une formule de mise en garde « Aza
» (ne ... pas) et couvrent tous les domaines de la vie. Mais à
regarder de près, derrière cet « impératif
catégorique », il y a tout de même une explication pour
essayer de convaincre le sujet à suivre à la lettre la
recommandation. Autrement dit, on demande au sujet de tirer lui-même la
conclusion qui s'impose. La démarche pédagogique consiste ici
à inciter progressivement le sujet à trouver la conclusion
à partir d'une prémisse. En reprenant les deux exemples de
proverbe cités plus haut, on peut remarquer que le sujet à qui on
dit ces proverbes doit arriver à une conclusion qui va effectivement le
convaincre de suivre scrupuleusement la recommandation qu'on lui fait.
Formulés dans leur intégralité, ces trois proverbes
à « pédagogie directe » se présentent
respectivement ainsi : « Aza mañano fary : lohany
indraiky
69
matsatso » (ne sois pas comme la canne à
sucre : la tête est la moins sucrée) ; « Aza
mañano fôdilahy mena : mandrara hömaña » (ne
sois pas comme le moineau rouge : interdit, mais consomme quand
même). Il serait intéressant d'observer et de
décrire comment les aînés opèrent pour enseigner et
faire passer leur message proverbial à leurs cadets.
Grace à l'exemple de ces deux proverbes, nous pouvons
déduire que, pour la population betsimisaraka,
l'éducation commence par un témoignage de vie. L'éducateur
n'est pas uniquement celui qui dicte ce qu'il faut faire, mais par ses actions,
il se montre comme modèle à suivre par son cadet. En termes
d'approches, ces proverbes à pédagogie directe s'adressent
généralement aux enfants et aux jeunes considérés
encore immatures. L'éducation, étant un instrument de
transmission et de la conservation de la culture du groupe,59 ne
devrait pas être conçue comme une simple recommandation, elle doit
être pratiquée quotidiennement.
IV.1.2. Les proverbes à « pédagogie
indirecte »
Non seulement les proverbes de la catégorie de la
pédagogie indirecte sont métaphoriques, mais aussi ils sont
« ouverts », laissant ainsi libre cours à la recherche et
à la méditation du sujet. Ici, ce dernier n'est plus
considéré en tant que gamin à qui il est nécessaire
de dicter précisément ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire.
Car on pense qu'un gamin n'est pas assez mature pour prendre de son propre chef
telle ou telle bonne orientation sur le chemin de la vie. Le gamin a donc
besoin d'être guidé de près, d'être directement et
solidement pris en main.
Il en est tout autrement avec un adulte qui est
déjà parvenu à la pleine maturité. Etre adulte,
c'est avoir la pleine possession de toutes ses facultés de
59 PAUVERT J. C. Facteurs sociologiques de la
planification de l'éducation. In: Tiers-Monde. 1960, tome 1
n°1-2. pp. 135-144
70
discernement, c'est avoir l'intelligence des situations. Les
proverbes à « pédagogie indirecte » s'adressent plus
particulièrement à l'adulte qui, normalement, doit être
plein de bon sens. Et comme l'a si bien dit Descartes, « le bon sens est
la chose du monde la mieux partagée ». Autrement dit, tout
être humain mature, sain de corps et d'esprit doit être en mesure
de comprendre les proverbes à « pédagogie indirecte »
où il est question de sens de l'observation de la nature et des hommes,
d'interprétation symbolique, de raisonnement déductif, de
faculté intuitive. Ce sont des proverbes qui relèvent du bon
sens.
Voici quelques exemples donnés par FANONY
Fulgence60 de proverbe à « pédagogie indirecte
» :
· « Milomaño miôriky :
mankatahi-drano » (nager à contre-courant : rendre le fleuve
plus large) : tout homme sain d'esprit sait que nager à contre-courant
nécessite plus d'effort qu'en se laissant emporter par le courant. En
nageant à contre-courant, il est évident qu'il faut redoubler
d'effort pour traverser le fleuve à la nage.
· « Lalaña an-tsavoko: tsy hain'ny tsy
zana-tany » (Chemin des bois jeunes: inconnu à ceux qui ne
connaisent pas le pays, aux novices): C'est un proverbe qui prône la
prudence dans toutes les activités de la vie, en conseillant au sujet de
ne jamais prendre des risques inutiles. L'excès de zèle peut vous
jouer, en effet, de mauvais tours. C'est également un proverbe qui
valorise les savoirs d'expérience et dans ce sens, il ne faut jamais
minimiser son adversaire.
· « Lalitry koa lefaka, fery
taköfaña » (si les mouches sont folles, il faut couvrir la
plaie): C'est un proverbe qui conseille la sérénité
pour ne pas se laisser
60 FANONY Fulgence, Öhabölaña
betsimisaraka (Proverbes betsimisaraka). Université de Toamasina.
Article disponible sur :
www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana
betsimisaraka ou proverbes.pdf
71
entraîner idiotement par des provocations de
l'adversaire. Ne pas répondre à ces provocations est une autre
provocation, mais il faut y opposer la « force tranquille » qui finit
toujours par dérouter l'adversaire. Autrement dit, la stratégie
de la non-violence est payante, si on sait s'y prendre avec intelligence et
persévérance plutôt que par la force brute. Autrement dit,
ne faut jamais s'enfermer dans un aveuglement caractérisé. Avoir
compris cela est déjà un signe de maturité, nous dit le
proverbe. Par ailleurs, dans ce proverbe on trouve également en
filigrane toute une leçon de tolérance. Ce proverbe s'inscrit
dans la logique de l'apaisement en cas de conflit interpersonnel ou à
dimension collective.
· « Zanak'amaloño an-taboa-drano: hainy
ny môriky, tsy atoro azy ny mivalaña; fomban'ny mitôvo lava
leha » (une civelle dans une lagune : elle sait nager à
contre-courant, on ne lui apprend pas comment laisser s'emporter par le courant
; il n'est pas étonnant d'entendre un célibataire toujours
utiliser sa langue61). Ce proverbe est formulé sous
forme d'un syllogisme. Il est composé d'une majeure : «
Zanak'amaloño an-taboa-drano », d'une mineure : «
hainy ny môriky, tsy atoro azy ny mivalaña » et
d'une conclusion : « fomban'ny mitôvo lava leha ». Ce
proverbe insiste sur le côté négatif du célibat en
incitant tout jeune homme et toute jeune fille en âge de se marier de
fonder un foyer. Car en étant célibataire, à la
manière d'un DON JUAN, on se condamne à une errance amoureuse
sans fin. Cet autre proverbe va dans le même sens : «
Tasaratsara, tsy lany » (jolie, ne s'épuisera).
Indirectement, ce proverbe conseille au jeune homme ou à la jeune fille
en âge de se marier de prendre leur responsabilité dans la
consolidation collective du lien social par le choix définitif et
irrévocable d'un conjoint ou d'une conjointe.
61 FANONY Fulgence, Öhabölaña
betsimisaraka (Proverbes betsimisaraka). Université de Toamasina.
Article disponible sur :
www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana
betsimisaraka ou proverbes.pdf
72
Il est clair alors qu'être adulte ne signifie pas
être « parfait ». Cependant, s'il est possible de corriger
directement les délits d'un enfant, la situation est différente
lorsqu'il s'agit de corriger l'erreur commise par un adulte. La correction et
le conseil à donner aux adultes ne devraient remettre en cause sa
position et son statut d'exemple au niveau de sa famille comme au niveau de la
société. Ayant une forte expérience de la vie et une
certaine maîtrise de son environnement, l'adulte est en mesure d'en
déduire une conclusion à partir de tout proverbe qui est
normalement formulé à partir des observations de
l'environnement.
IV.2.Les proverbes au quotidien en pays betsimisaraka
Les proverbes donnent également tonalité et
couleur à la vie communautaire. Non seulement ils consolident le
sentiment d'appartenance à une même culture, à un
même terroir, mais ils servent également de repères dans le
parcours de vie de tout un chacun (car ici il faut apprendre à tout
âge). Les proverbes dans leur étonnante variété
s'adressent à toutes les classes d'âge, à toutes les
classes sociales : tout le monde peut se ressourcer intellectuellement dans les
proverbes pour mieux rebondir dans la vie.
IV.2.1. Pour une pédagogie de l'image
Il est question maintenant de montrer la place des images dans
les proverbes betsimisaraka. Nous avons affaire ici à la «
pédagogie du regard » (apprendre à regarder le monde).
Certains proverbes nécessitent une réflexion à partir
d'images. Le résultat de cette réflexion ou de cette
étude, qui peut être également une simple observation de la
vie quotidienne, devient une norme, un exemple ou un modèle de vie
à appliquer ou à éviter.
73
Voici quelques proverbes reliés pédagogie de
l'image, tirés de l'article de FANONY Fulgence :
- « Kakazo mandriandry, tsy latsaham-baratra
» (la foudre ne tombe pas sur un arbre couché). Il s'agit
d'une allusion faite à une personne pacifique qui ne veut faire
éclater la guerre avec qui que ce soit. En restant pacifique,
tranquille, calme et silencieux, on ne risquera pas de rendre les autres
furieux. Ainsi, on est à l'abri de tout conflit social.
- « Vato fisaka an-tany tsy mivaringariñy,
ôlo-mariñy mantom-pô » (pierre plate enfouie garde
son équilibre, le juste a le coeur serein). Allusion à la paix de
la conscience. Il s'agit aussi d'un proverbe qui parle d'une personne de
confiance, qui respecte sa parole et son engagement. Si on dit qu'un individu
est comme un « vato fisaka an-tany », c'est parce qu'on
pourra lui faire confiance.
IV.2.2. Sur les voies des savoirs d'expérience et de
la sagesse
Dans cette analyse, nous sommes convaincu que les savoirs
d'expérience et la sagesse se rejoignent dans la vision du monde de la
communauté villageoise de Rantolava. Ces savoirs
d'expérience s'acquièrent tout au long de la vie et à
chaque occasion de notre quotidien. Les proverbes sont comme une sorte de
« livre ouvert » qui veut se mettre à la portée de
l'ensemble de la communauté villageoise (dont Rantolava), tout
âge confondu et toute classe sociale confondues. Les proverbes ne sont
pas là uniquement dans la dimension d'une joute oratoire, mais ils sont
également dans leur dimension pédagogique et de recherche.
Les pratiques proverbiales sont presque les mêmes dans
l'ensemble du territoire betsimisaraka, Rantolava que dans d'autres
villages. Et, il est étonnant de constater que l'expérience de la
population se rejoint sur une même finalité pédagogique.
Nous relevons la présence d'une sorte de standardisation de normes
à
74
inculquer aux enfants ainsi qu'à l'ensemble des membres
de la société. Par le biais des proverbes, on peut arriver
à certaines conclusions sur les pratiques quotidiennes. En plus,
à travers des proverbes, nous pouvons faire de recherches aussi bien
dans le domaine éducatif, social ou encore organisationnel, etc.
75
TROISIEME PARTIE : DISCUSSIONS ET
PERSPECTIVES
« Il est vain de vouloir élever l'enfant pour
lui-même, comme s'il pouvait échapper
aux
nécessités sociales qui l'enserreront de toutes parts ; il n'est
pas possible de
fermer les yeux à tout ce que la
société humaine dans son ensemble, et
chaque
collectivité nationale en particulier, ont
élaboré de biens précieux,
matériels,
intellectuels, artistiques, moraux ».
Leif, Rustin (1970). Philosophie de l'éducation,
p.132
76
CHAPITRE V - LA PLACE DES TRADITIONS ORALES ET DES
VALEURS MALAGASY DANS LE PROGRAMME SCOLAIRE
Même si on observe qu'au village de Rantolava, voire
dans l'ensemble des villages betsimisaraka, les proverbes tiennent
encore une place non négligeable, nous ne pouvons cependant de ne
signaler au passage la dégradation de cette tradition orale.
L'utilisation de ces proverbes émane généralement des
aînés issus des générations
précédentes. La plupart des jeunes commencent à ne pas se
préoccuper, non seulement des proverbes, mais aussi de l'ensemble des
traditions orales.
Cette situation nous amène à analyser la raison
de cette dévalorisation de la culture traditionnelle
betsimisaraka. La première idée qui nous arrive à
l'esprit c'est de prendre connaissance des programmes scolaires et de
vérifier si la valorisation et l'étude des traditions ainsi que
les valeurs traditionnelles malagasy figurent ou non parmi les
préoccupations du système éducatif formel.
La société étudiée qu'est la
société betsimisaraka ne dispose pas encore d'un
établissement d'enseignement supérieur, autre que les instituts
de formation professionnelle. Et, le village de Rantolava, notre site
d'exemple, ne dispose que d'établissements pour l'enseignement primaire.
C'est la raison pour laquelle nous avons limité notre analyse
documentaire par aux programmes de l'enseignement secondaire (lycée et
collège) et de base (primaire).
V.1. Dans les écoles primaires
Dans les établissements publics, l'enseignement
primaire se fait en cinq ans : les cours préparatoires, les cours
élémentaire et, les cours moyens.
77
V.1.1. Les cours préparatoires
Les cours préparatoires s'effectuent en deux ans : le
cours préparatoire niveau I (CP1) et le niveau II (CP2).
Tableau 1- Synthèse du programme lié
à la culture et aux valeurs traditionnelles au niveau du CP1 et
CP2
|
Discipline
|
Thème /Contenus
|
CP1
|
CP2
|
|
Malagasy
|
La famille
|
- Connaissance et identification des membres de la famille
nucléaire
- Connaissance du rôle de chacun des membres
(l'enseignement peut se faire à partir d'un angano)
|
- La famille nucléaire et le
rôle de chacun des
membres
- La famille étendue
|
|
Les moeurs et
coutumes
|
|
Les élèves en classe du
CP2 commencent à
prendre connaissance des moeurs et
coutumes dans le village où ils vivent.
|
|
Langage et
Français
|
Discours et
expressions
sociales
|
- Discours de sociétés axés
sur la camaraderie,
invitation aux jeux ;
- Dialogue et conversation.
|
Identification des
membres de la famille.
|
78
|
Le savoir-vivre
|
|
- Savoir-vivre au sein de la famille ;
- Le respect vis-à-vis des
parents, des
aînés ainsi que des amis
|
|
Civisme
|
Sources
|
|
- Assistance à des
|
|
d'information et de
|
|
évènements importants du
|
|
la connaissance
|
|
village,
- Regarder la télévision et
écouter la
radio
|
|
|
|
- La lecture
|
V.1.2. Les cours élémentaires
Dans les cours élémentaires, les programmes se
résument suivant le tableau ci-après :
Tableau 2- Synthèse du programme lié
à la culture et aux valeurs traditionnelles au niveau du
CE
|
Discipline
|
Thème
|
Contenus
|
|
Malagasy
|
La famille nucléaire et la famille étendue
|
- Structure, organisation et fonctionnement de la famille
malagasy ;
- Le sens et la valeur de la famille chez les Malagasy
|
|
Français
|
Le village
|
Les éléments constitutifs d'un village
|
|
Sciences de
la vie et de
la terre
|
La vie au village
|
Les activités des habitants
|
79
|
Histoire
|
Les moeurs et
coutumes
|
Les élèves commencent à prendre connaissance
des moeurs et coutumes dans son village, les interdits ou les fady
|
|
Lignage et
descendants
|
Ils s'initient au jijy karazana, établissent un
arbre généalogique simple qui reflète les
générations successives.
|
|
Civisme
|
Le savoir-vivre
dans la vie
quotidienne
|
- Pendant les repas
- A la maison, en famille
- Dans le village, dans la société, en cours de
chemin (ex : on cède le passage aux aînés, on prend les
bagages de personnes âgées, on demande « pardon »
à chaque fois qu'on passe devant nos aînés...)
|
|
L'entraide
|
Les activités et les principaux travaux nécessitant
une entraide et une assistance mutuelle
|
|
La structure et le
fonctionnement de
la
société
|
- Dans la famille (une structure centrée autour des
parents)
- Dans le village (la structure administrative qui le
fokontany et, la structure traditionnelle dirigée par les
Tangalamena...)
|
V.1.3. Les cours moyens
Dans les cours moyens, les élèves rappellent et
approfondissent ceux qui ont été initiés dans les classes
précédentes.
V.1.3.1. La famille
Il est maintenant question de comprendre l'importance et la
nécessité de la famille, les différentes formes de
relations familiales, la discipline et le fonctionnement de la famille. En plus
de ce qui a été déjà évoqué, les
élèves dans les
80
cours moyens, les élèves étudient les
attitudes et le comportement que devraient avoir chacun des membres de la
famille.
Il faut aussi noter qu'ils commencent à apprendre des
proverbes relatifs au thème d'études :
- « Ny heloky ny ray, tsy heloky ny zanaka
» (délit du père, n'est pas du fils)
- « Arahabao ny mpandalo fa tsy fantatra izay ho
rafozanina » (saluer ceux qui passe sur le chemin parce qu'on ne sait
pas ceux qui vont devenir vos beaux-parents), etc.
V.1.3.2. La vie dans le village
Les élèves étudient les
différentes règles régissant la vie du village, de la
société. On leur apprend également les pratiques du
savoir-vivre et de l'entraide entre les membres du village. On leur demande de
citer quelques proverbes convenables à ce thème, comme : «
izay iray vatsy, iray aina » (ce qui prend la même
nourriture a la même vie)...
V.2. Dans les collèges
Au niveau des collèges, il a été bien
précisé qu'à la sortie du collège, les
élèves doivent être capables de comprendre et
d'apprécier la culture malgache et ses valeurs. Ce passage est à
la fois un objectif et un profil d'un élève ayant terminé
ses études au collège, si on ne parle que de la discipline
malagasy.
L'enseignement de la culture et des valeurs malagasy est
présent aussi bien dans la littérature que dans l'étude
des sociétés.
Théoriquement, les collèges malagasy
fonctionnent en deux cycles : un cycle d'observation (classe de sixième
et cinquième) et un cycle d'orientation (classe de
81
quatrième et troisième). En
réalité, la présence de ces deux cycles n'est pas vraiment
observée par les élèves et un grand nombre d'enseignants.
Notre étude tentera alors de faire une distinction entre ces deux
cycles, ce qui les différencie par rapport à l'enseignement de
cette culture et de ces valeurs malagasy.
V.2.1. Le cycle d'observation
V.2.1.1. La littérature
Dans les classes d'observation, l'apprentissage et la
valorisation de l'angano est réellement au menu. Cet
apprentissage commence par apprendre sa définition, les
différents éléments qui le composent, les acteurs, les
valeurs qu'il essaie de transmettre et surtout son rôle dans la
société malagasy.
Certes, les élèves n'entrent pas encore dans le
détail. Toutefois, certains points sont indispensables. Il s'agit
d'observer et de comprendre la situation initiale de l'acteur principal et sa
situation finale. Ensuite, la description des épreuves qu'il a
traversées pour arriver à cette situation finale. L'idée
est de faire comprendre aux élèves que, quel que soit leur
objectif, ils devraient passer à travers de multiples épreuves,
qui sont parfois difficiles. Et, en classe de cinquième, on apprend aux
élèves que l'angano joue un double rôle : une
culture distractive, donc un passe-temps et, une méthode et
moyen développement personnel.
V.2.1.2. La société malagasy
Dès la classe d'observation, les élèves
apprennent le sens du concept fihavanana si sacré pour
l'ensemble des Malagasy. Ils essayent de dégager les différents
aspects du fihavanana dans leur village respectif. Ici, on apprend aux
élèves ces différents types, ses manifestations dans la
société et son importance. Ainsi par exemple, on parle du
fihavanana par lien de sang, c'est-à-dire entre les individus
de même généalogie et, du fihavanana né de
la convention entre les
82
membres de la société comme le cas du «
fati-dra ». Ensuite, en ce qui concerne le
savoir-respecter, l'enseignant met en évidence l'importance du
respect entre les membres de la famille, entre les membres du village et
surtout, le respect que doit avoir un enfant vis-à-vis de ses parents.
Outre ces respects envers les hommes, membres de la société, on
éduque également les élèves à respecter leur
environnement tel que les animaux, les plantes, etc. Enfin, l'initiation
à l'étude sur l'entraide et l'assistance mutuelle dans la
société malagasy figure parmi les programmes en classe
d'observation.
En ce qui concerne la distraction dans la
société, on invite les élèves à citer les
différents types de distraction qu'ils observent dans la
société. Parmi ces distractions, on insiste plus sur les
activités culturelles et artistiques (chanson traditionnel-hira
gasy, söva...), d'une part, et les activités
sportives d'autre part (la lutte, tolona omby ...)
V.2.2. Le cycle d'orientation
Au niveau du cycle d'orientation, l'enseignement des
traditions orales, de la culture et des valeurs malagasy est centré
autour de trois objectifs spécifiques :
- connaître et vivre les valeurs malagasy dans
la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne le mode de pensée ;
- comprendre et respecter la culture malagasy ainsi
que les valeurs qu'elle véhicule ;
- connaître les spécificités de la culture
malagasy
A ce cycle, ces programmes ne sont plus véhiculés
dans la partie de la littérature. On enseigne plutôt les liens
entre la culture et les valeurs malagasy avec la vie en société.
On apprend également certaines moeurs et coutumes.
83
V.2.2.1. Le mariage traditionnel et le concept de la
famille
Les élèves étudient le concept du mariage
dans la société traditionnelle malagasy. Le mariage est
le début de la formation d'une famille et la seule qui est naturelle de
toutes les sociétés. Ils apprennent les rites et les
étapes à suivre avant de procéder au mariage, les
conditions nécessaires pour que le mariage soit parfait. Le kabary
am-panambadiana (discours de demande en mariage) est aussi au
programme.
Selon la conception malagasy : « ny
hanambadiaña, hiterahaña » (se marier, c'est pour avoir
d'enfants). Alors, les élèves analysent et tentent de comprendre
la valeur des descendants dans la société malagasy, la
place de la femme dans cette conception. Et, à ce sujet, ils
étudient les traditions liées celle-ci : le famangiaña
tera-bao (visite du nouveau-né).
V.2.2.2. L'organisation villageoise et les activités
de production
Les collégiens analysent la structure et les
différentes formes d'organisation communautaire dans les
activités de production. L'enseignement est dirigé en fonction
des réalités locales et régionales. Par ailleurs, le
programme propose que le valintanana (littéralement, ce terme
vient de deux mots : « valiny » qui veut dire «
réponse ou suite » et, « tànana »
qui signifie « main ». Il désigne alors l'action de se
prêter la main [de manière tournante] entre deux ou
plusieurs membres de la société en vue de réaliser un
travail précis) et le tambirô doivent
impérativement figurer dans le contenu du cours. Les autres formes sont
facultatives selon les régions.
Les élèves essayent de comprendre et de faire
une comparaison entre ces différentes formes d'organisation villageoise,
ainsi que leur déroulement.
84
V.2.2.3. Les relations entre les vivants et les
razaña
Au collège, l'enseignement de celles-ci est
tourné autour de deux principaux thèmes : la mort et
l'exhumation.
- La mort : description des traditions et rites en
cas de décès d'un membre de la famille, du village ou de la
société toute entière, les étapes à suivre
(de la préparation du corps à l'enterrement), l'importance de
l'enterrement dans le tombeau familial, la présentation de
condoléance (le kabary amim-pahoriaña ou discours de
condoléance ou pendant les veillées mortuaires)
- L'exhumation : description de la manifestation de
l'exhumation, ses principes fondamentaux et, le lien qui unit les vivants et
les razaña selon la croyance ancestrale.
V.3. Dans les lycées
Le lycée est la dernière phase de la
scolarisation où l'apprentissage de Malagasy en tant discipline à
enseigner est obligatoire. Alors, les programmes sont concentrés sur
l'analyse et la compréhension de la culture et des valeurs
malagasy.
A la sortie du lycée, les élèves
devraient être capables d'aimer, de valoriser et de défendre les
valeurs culturelles malagasy. Aussi, les objectifs spécifiques
ci-après sont proposés afin de parvenir à cet objectif qui
est global.
85
Tableau 3 - Les objectifs pédagogiques
liés à l'apprentissage de la culture et des valeurs
traditionnelles malagasy au niveau du lycée
|
Niveau
|
Objectifs spécifiques
|
|
Classe de 2nde
|
- Organiser ses idées, écouter et respecter celles
des
autres ;
- analyser les valeurs culturelles et intellectuelles
des
malagasy à travers des moeurs et coutumes;
|
|
Classe de 1ère
|
- distinguer la structure et les valeurs culturelles
malagasy
observées à travers des moeurs et coutumes
à celles des autres ;
- organiser les connaissances acquises par les valeurs de
sa
nation face à ses devoirs de citoyen.
|
|
Classe de
Terminale
|
- comparer les valeurs culturelles Malagasy à celles
des
autres nations;
- Comprendre la structure et le fonctionnement de
la
société malagasy, sa conception par rapport
à la vie en société et l'évolution de celle-ci en
fonction de l'histoire et le contexte.
|
86
CHAPITRE VI - LES LIMITES DU CHAMP D'APPLICATION DES
PROVERBES ET DES TRADITIONS ORALES BETSIMISARAKA
La situation présente un aspect assez paradoxal. Nous
avons écrit auparavant que la culture et les valeurs malagasy
sont actuellement en voie de disparition, alors que l'analyse des
programmes scolaires montre que ces disciplines figurent parmi les
préoccupations de l'éducation nationale.
Dans la présente section, nous tenterons de
présenter quelques raisons pouvant justifier ce paradoxe.
VI.!. Les réalités sociales
En général, les programmes tournent autour de la
vie en société. Nous avons parlé du savoir-vivre, du
savoir-respecter, de l'entraide et l'apprentissage des moeurs et coutumes.
Pourtant, la vie au village et en famille betsimisaraka ne prouve que
très peu l'acquisition des attitudes et des comportements liés
à ces points. Dans la plupart des cas, ils ne sont observés que
pendant les tristes périodes - fahoriaña
(décès d'un membre) ou pendant les tsaboraha.
VI.!.!. L'absence d'échanges familiaux
Parfois, les parents d'aujourd'hui croient consacrer plus de
temps à leurs enfants alors qu'en réalité ils ne font que
des tâches strictement indispensables. « La plus grande partie
de ce temps est consacrée à les préparer pour aller
à l'école ou à un évènement précis,
à les conduire [...j à d'autres endroits où les enfants
veulent aller et où les parents se sont obligés de les emmener,
ou encore à essayer de leur faire faire des choses qu'ils sont
censés faire »62. Pendant la journée, les
enfants du
62 HART Sura, HODSON Victoria, Parents respectueux,
enfants respectueux : sept clés pour transformer les conflits en
coopération familiale. La Découverte, Paris, 2005. p. 56
87
village se trouvent entre les mains d'instituteurs ou
institutrices, donc à l'école. Contrairement à la
société d'autrefois où l'école n'existait pas
encore et où l'enfant se socialise au sein de la famille, la
société actuelle est une société
évoluée et qui continue à s'évoluer.
Cette évolution de la société influe
également sur le rythme et le mode de son fonctionnement. Après
l'école, les enfants et les jeunes sont appelés à terminer
le reste des travaux domestiques et leur devoir du jour. Le koraña
amorom-pataña (échanges et conversation autour du
réchaud à bois) n'existe plus. Si auparavant, en attendant le
dîner, les membres de la famille se réunissent autour du
réchaud à bois pour faire du korambe ou d'écouter
l'angano, cette habitude ancienne cède actuellement sa place
à la radio. Le père de famille veut à écouter le
journal à la radio nationale, de 19 heures. En plus de la
pauvreté qui règne presque dans tout le territoire national, avec
l'arrivée des écoles, les parents d'aujourd'hui se voient
obligés de travailler un peu plus pour subvenir aux études de
leurs enfants. Ainsi, après une longue journée de travail, le
père de famille demande plus de temps de repos.
Alors, même si on apprend l'angano à
l'école, cet apprentissage devient un simple récit de la culture
traditionnelle. Les élèves n'ont même plus le temps pour le
mettre en pratique ou d'apprendre plus d'angano que donnent les
maîtres.
VI.1.2. L'importance de la monnaie
L'évolution de la société modifie les
priorités de ses membres. L'affirmation de LEIF et RUSTIN nous semble
importante à ce propos : « nous appartenons à une
nation, mais aussi à beaucoup de sous-groupes de cette nation, et nous
appartenons également à la civilisation occidentale et à
l'humanité »63. L'argent devient un
63 LEIF, RUSTIN (1970), op.cit., p.132
88
facteur déterminant de cette modification. L'entraide
sociale ne résout plus grand-chose, en ce qui concerne les besoins
fondamentaux. Dès l'accouchement de l'enfant, les parents
déboursent de l'argent pour la maternité, les vêtements. A
l'âge de 6 ans, ils doivent inscrire leur enfant à l'école
primaire publique et payer des frais de scolarité, des articles et
fournitures scolaires. Dans certains cas, avec la framisation64
des écoles publiques, les charges parentales pourraient augmenter
au cours de l'année scolaire. Ensuite, à la fin du primaire, si
les parents décident de poursuivre les études de leur enfant, ils
devront encore, outre les frais de scolarité et la participation
parentale aux enseignants-FRAM, se préparer au frais de loyer mensuel.
Le village de Rantolava ne dispose que d'un enseignement primaire. Pour les
études secondaires, les élèves doivent étudier au
chef-lieu de la Commune (5 km à pied) ou au chef-lieu du District (15 km
en vélo ou en moto).
Toute est alors question d'argent. Le fihavanana si
cher au betsimisaraka n'arrive plus à lui tout seul à
garantir le fonctionnement de la vie en société si on ne se
réfère qu'aux charges liées à l'éducation de
l'enfant. Or, nous ne pouvons non plus ne pas envoyer nos enfants à
l'école. Non seulement c'est un droit, mais c'est aussi une exigence
sociale.
VI.1.3. L'entraide et la cohésion sociale
Toutes les situations que nous avons évoquées
plus haut constituent des faits vécus dans la société.
D'ailleurs, comme l'affirment toujours Leif et Rustin, la société
est à la fois un fait et une valeur. Cette mutation de la
société se justifie par le proverbe : « Miasa tsy
mitamby haniña : miasa tsy hömaña, tsy
fataon'ôloño » (Travailler n'est pas demander de la
nourriture : travailler sans rien manger, ne se fait
64 Framisation : ce terme est né de la FRAM qui est une
association des parents d'élèves. Dans un grand nombre
d'établissements scolaires, les maîtres fonctionnaires
payés par le gouvernement ne sont pas suffisant. Cette situation oblige
la FRAM à recruter des maîtres suppléants dont elle prend
la charge.
89
pas). Désormais, l'idée de travail contre
nourriture devient un concept nouveau de la société
betsimisaraka d'aujourd'hui. Ici, la nourriture ne doit pas être
considérée au sens propre du terme, il s'agit plutôt de
l'argent.
Mais comme Kant, nous partageons l'idée qu'il n'y a pas
chez l'homme de dispositions au mal. Le mal vient de ce que la nature n'est pas
réglée65. A Madagascar, on dit : « Ny kakazo
no vañon-ko lakaña, ny tany naniriàny no tsara »
(un arbre devient pirogue66, c'est parce que le sol où il a
poussé est bon). Le tambirô, le fandriaka comme
le lampoño demandent du temps. Imaginons si pendant une
semaine, on a laissé notre foyer pour travailler dans les champs de nos
semblables sans apporter de l'argent. Comment allons-nous couvrir les charges
financières du mois ? Comment allons-nous payer les frais de
scolarités de nos enfants ? L'argent devient une exigence fondamentale
dans le fonctionnement de la vie familiale. Si auparavant, l'argent ne servait
qu'à l'achat de vêtement, au frais de transport et, pour un petit
nombre de personnes, à l'achat des matériaux de construction, il
est actuellement présent à tous les pas à franchir. Une
précision s'impose par rapport à l'idée que nous venons
d'évoquer : un petit nombre de personnes. Il faut savoir qu'à
l'époque, les maisons étaient construites en matériaux
locaux, donc on n'avait pas besoin d'argent pour s'en procurer. Seules, les
personnes aisées construisaient des maisons dont les toits sont en
tôle ou des bâtiments en matériaux durs.
En plus, au village de Rantolava, nous avons
déjà indiqué que la plupart des habitants vivent de
l'agriculture et de la pêche. Ce ne sont pas des salariés, ils
gagnent de l'argent en fonction de leur quantité de poisson au
quotidien. A chaque fois qu'ils
65 KANT Emmanuel, De la pédagogie.
66 Généralement, les Betsimisaraka construisent
des pirogues en bois. Cependant, il faut un grand arbre pour la construire. Ce
proverbe signifie que le comportement d'un individu ou des membres d'une
société est le reflet de l'environnement où il a
vécu. Ici, le proverbe parle d'un résultat positif de
l'éducation, mais il peut également expliquer le contraire.
Autrement dit, si un arbre ne peut devenir une pirogue, c'est parce qu'il a
été mal poussé.
90
laissent leurs activités quotidiennes au profit de
travail communautaire, un manque à gagner est constaté.
VI.1.4. La remise en cause du concept
cadet/aîné
Un grand nombre de Malagasy ne se rendent pas compte que le
concept cadet/aîné est actuellement dévié. En
réalité, cette forme de relation est une allusion faite à
la forme de relation qui existe entre les parents et leurs enfants et, par
extension, entre les personnes âgées et les jeunes. Cependant, ce
concept s'étend actuellement vers les responsables politiques et
administratifs. Ce dernier sens du concept influe certainement sur la
population.
En effet, sans tenir compte de son âge, un responsable
politique et administratif est appelé en betsimisaraka comme
étant un raiamandreny (littéralement : père et
mère). Même un Tangalamena, le gardien de la tradition,
l'appelle de cette manière. La question d'âge n'est plus un
critère pour qu'on soit considéré et respecté dans
la société. Désormais, la position sociale et politique
d'un individu le range directement en statut d'aîné. Alors,
être aîné n'est pas uniquement être celui qui a
vécu plus d'expériences dans la vie, mais aussi celui qui a
été désigné soit par son appartenance politique,
soit par son niveau d'instruction selon la conception moderne, pour occuper une
fonction précise dans l'administration.
VI.2. Quelques suggestions
Nous questionnons la signification des justifications
apportées par rapport aux transformations dans la société
alors qu'en réalité on ne parle que des
öhabölaña. En fait, ces derniers ne forment qu'une
partie de la tradition orale betsimisaraka. Le rôle de la
tradition orale en tant que outil éducatif ne peut pas être que
très rarement autonome. Sans rasavölaña ni
kabary, ni korambe etc., cette tradition ne vaut pas
91
grand-chose. Vouloir valoriser une des traditions orales
implique de prendre en considération l'ensemble et non pas se limiter
uniquement sur telle ou telle tradition.
Par ailleurs, si les öhabölaña ont,
aux yeux des Malgaches, cette vertu magique de pouvoir métamorphoser la
banalité du quotidien et l'insignifiance d'un fait en une réelle
source d'émerveillement67. Avec l'évolution de la
société, cette fonction sociale des proverbes commence à
se dégrader. Cette dégradation vient du fait que la plupart des
évènements pouvant regrouper les habitants du village ne
s'effectuent plus pour des raisons énoncées plus haut.
En plus, il faut également considérer que «
l'enfant que nous formons vivra dans une société
différente de celle où nous nous trouvons : différente
dans sa structure économique et sociale, dans son organisation
politique, et par le système d'idées qui aura cours
»68. L'enfant ne pourra pas s'échapper des
exigences du milieu dans lequel il se trouve ou de la société sur
laquelle il vivra une fois à l'âge adulte.
Ces propos sont suffisamment clairs pour affirmer que
retourner aux pratiques traditionnelles n'est pas toujours une solution pour
redynamiser et revaloriser les valeurs ancestrales. La valeur est une
identité, quelque chose de sacré et qu'il faut défendre.
La pratique, quant à elle, est la mise en application de cette valeur
dans la vie quotidienne, dans la société dans son ensemble.
Alors, si la société évolue, les pratiques sociales
devraient évoluer de la même sorte.
Nous tenterons alors de proposer quelques suggestions pour la
valorisation des traditions orales betsimisaraka, en particulier les
proverbes. En quoi pouvons-
67 FANONY Fulgence, Öhabölaña
betsimisaraka (Proverbes betsimisaraka). Université de Toamasina.
Article disponible sur :
www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana
betsimisaraka ou proverbes.pdf
68 LEIF, RUSTIN (1970), op.cit., p.133
92
nous participer à sauvegarder les valeurs
éducatives que ces proverbes véhiculent sans remettre en cause
les exigences actuelles de la société ?
VI.2.1. Les bourses culturelles
L'intégration de la culture et des valeurs
traditionnelles dans le programme scolaire est loin d'être suffisant pour
les préserver et de les valoriser. Sans un champ d'application,
l'apprentissage devient une obligation pour l'apprenant.
A Madagascar, le décret n°99-497 du 30 juin 1999
distingue deux catégories de bourses nationales dans les
établissements secondaires publics et privés. La première
catégorie est accordée aux meilleurs élèves admis
aux examens nationaux et, la deuxième est attribuée aux
élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont
été reconnues insuffisantes.
Mais ces bourses sont vraiment symboliques. Elles n'arrivent
même pas à régulariser les frais de scolarité. Le
taux annuel est de 20 000 Ariary, soit moins de 7 euros. En plus, les familles
en milieu rural ont presque le même niveau de vie. Or, les bourses de
mérite aux examens nationaux ne touchent que rarement, voire
miraculeusement, les élèves en milieu rural. Outre l'insuffisance
d'enseignants qualifiés, les ressources pédagogiques y sont aussi
insuffisantes. Aussi, cette catégorie de bourses concerne
généralement les élèves du milieu urbain qui
bénéficient d'une éducation qui les prépare
à ces concours.
Comme la préservation de la culture et des valeurs
traditionnelles figure parmi les préoccupations gouvernementales,
notamment au ministère de l'Education nationale par les programmes
d'études, les bourses culturelles constituent une des mesures
appropriées. Avec cette mesure, non seulement on revalorise notre
identité culturelle, mais on offre également une excellente
occasion aux enfants qui se trouvent dans les régions enclavées
de pouvoir bénéficier une bourse d'études leur
93
permettant de poursuivre leurs formations. Ainsi,
l'apprentissage de la culture et des valeurs traditionnelles n'est plus une
simple obligation, c'est une source de motivation.
Si dans la plupart de cas, à la fin du primaire, les
jeunes disposent encore beaucoup de possibilités pour continuer leurs
études au niveau II (collège). Car, installé dans chaque
chef-lieu de leur commune respective, le collège public forme des jeunes
issus des Fokontany environnants et il est à noter que
l'accès à ces collèges est à la portée d'un
grand nombre de parents d'élèves. Par contre, à la fin du
collège, ces jeunes devraient quitter leurs parents pour s'installer
dans le chef-lieu du district pour suivre leur étude en niveau III. Ceux
qui n'ont pas de famille en ville doivent louer un appartement,
indépendamment des autres frais liés à la scolarisation,
à la nourriture, etc. Les charges parentales deviennent de plus en plus
considérables. Ceux qui n'ont pas de moyens suffisants décident
d'arrêter leur étude et de rester dans leur village ou
Fokontany respectif. Les bourses constituent une mesure pourrait
améliorer la statistique sur le taux d'abandon scolaire dans les
brousses.
VI.2.2. La pédagogie des proverbes et l'approche
mixte
Si auparavant, l'apprentissage par les proverbes se faisait
à travers les écoles sans murs, c'est-à-dire dans la
nature par le biais des différents regroupements villageois, des actions
sociales et de l'entraide familiale, la question se pose maintenant quant
à sa continuité. Le mariage traditionnel-ôrimbato
commence à ne plus pratiquer. Et, s'il y en a encore, on a tendance
à négocier pour faciliter la procédure ou le
rasavölaña. Nous avons écrit plus haut que seuls
les tsaboraha et les veillées mortuaires constituent
actuellement un motif de regroupement villageois. Mais, là encore, son
aspect éducatif commence à disparaître. Compte tenu de
l'insécurité qui règne presque sur la totalité du
territoire national, un grand nombre de personnes hésite à
quitter leur foyer pour rester toute la nuit chez la famille du
défunt.
94
En plus, puisque la plupart des enfants fréquentent
aujourd'hui un autre type d'école, l'école de type occidental,
ils devraient se réveiller tôt pour aller à l'école.
Donc, leur participation à une veillée mortuaire est
généralement déconseillée.
Nous comprenons maintenant que les principes éducatifs
véhiculés à travers les öhabölaña
pourraient se situer actuellement en phase de disparition si nous ne
trouvons pas de solutions afin de fusionner la « pédagogie des
proverbes » et celle des autres pédagogies modernes. Et, c'est ce
que nous allons proposer maintenant.
Nous considérons qu'un objectif éducatif est de
faire intervenir les proverbes dans le processus d'apprentissage en classe.
Notre analyse montre que cette approche-mixte est compatible avec certaines
matières enseignées comme le Malagasy, le Civisme et
l'Histoire, notamment lorsqu'on veut mettre en évidence la relation de
cause à effet. Si dans les deux premières disciplines, cette
approche n'est pas vraiment nouvelle, sa mise en application dans
l'enseignement de l'histoire, quant à elle, est un
phénomène assez-nouveau et ne se voit pas souvent.
Voici quelques exemples qui reflètent ce que nous
venons de proposer. En étudiant les origines de l'insurrection de
194769 à Madagascar, par exemple, on apprend aux
élèves du collège que la promesse non tenue du
Général De Gaule lors de la Conférence de Brazzaville en
1944 constitue un des principaux facteurs cette insurrection. En effet, selon
les Betsimisaraka, voire les Malagasy en général : « Aza
mañano ririñin-dasaña tsy tsaroaña » (ne
fait pas oublier l'hiver de l'année dernière). Une allusion est
faite à quelqu'un qui a traversé un moment difficile dans le
passé et qui fait semblant de l'oublier une fois le problème
résolu. Pendant la guerre, lorsque la France et les alliés
étaient en difficultés, De Gaule a promis qu'il accordera
l'indépendance aux colonies françaises qui participeraient
à la guerre contre les Allemands. C'est une promesse qui n'a pas
été tenue à la fin de la guerre. On pourra
69 L'insurrection de 1947 est un des remarquables mouvements
de lutte contre l'ordre colonial à Madagascar.
également avancer d'autres raisons comme la
création du parti MDRM70 qui a été
considéré comme l'initiateur du mouvement. « Ny
hitsikitsika tsy mandihy foaña fö ao raha » (une
crécerelle ne danse pas pour rien, si elle danse, c'est parce qu'elle a
ses raisons). Toute initiative de créer une organisation quelconque doit
être motivée par un objectif. Si les Malagasy ont
décidé de créer un parti politique, c'est pour faire de la
politique, donc de prendre le pouvoir.
Les exemples sont multiples et nous pouvons dire que cette
approche mixte est valable dans tous les domaines de l'enseignement de
l'histoire. C'est aussi le cas dans la création de la
confédération betsimisaraka. En épousant la princesse du
clan Tatsimo, Ratsimilaho, chef de clan Tavaratra a pu
combattre facilement le clan des Tsikoa, au centre. « Izay
mitambatra vato, izay misaraka fasika » (ceux qui s'unissent forme
une pierre, ceux qui se séparent deviennent sable) ou encore «
Ny firaisankiña no hery » (l'union fait la force). Les
Tsikoa se trouvent seuls face aux Tavaratra et aux Tatsimo
qui ont déjà uni leur force.
L'intérêt de cette approche est double. D'abord,
elle permet aux élèves, donc à la jeunesse de toujours se
familiariser avec les proverbes ainsi qu'avec les messages qu'ils tentent de
transmettre. Ensuite, elle offre de nouvelles pistes éducatives quant
à l'objectif de l'enseignement de l'histoire. En apprenant l'histoire,
les jeunes sont également en mesure de choisir une attitude face
à une situation similaire.
95
70 MDRM : Mouvement Démocratique pour la Rénovation
de Madagascar.
96
CONCLUSION
Au terme de cette étude, nous pouvons dire que dans les
villages betsimisaraka, avec l'exemple de Rantolava à l'appui,
l'éducation par les proverbes (une école sans murs) est au coeur
du quotidien. Alors que le Centre de Formation Pédagogique de Rantolava
est réservé à des lettrés, à des
élites, à une poignée de privilégiés du
système éducatif mis en place par l'Etat, l'école de la
vie par les proverbes est une école pour tous et ouverte à
l'individu tout au long de sa vie. La société de l'oralité
qu'est la société traditionnelle betsimisaraka a
toujours veillé à l'éducation de tous les membres du
groupe (sans exception) car chacun doit avoir sa place dans le groupe. Aucun
individu ne doit pas être laissé en chemin. A chacun son rythme,
il est vrai, mais tous doivent cheminer progressivement. Dans cette
société de l'oralité, toute personne qui a un statut
d'aîné doit être un maître, un modèle, un
repère pour son cadet. Ici, faire c'est de refaire, c'est suivre les
traces de l'aîné car ce dernier est censé sentir les
écueils : « Ny alöha : mahita fôtotro»
(celui qui est à l'avant, trouve la racine ou l'origine). Les
aînés sont donc individuellement et collectivement responsables de
l'éducation des cadets, et ce, dans un esprit de partage : «
Mason-tsokiñy, masom-balavo : ny hita hely hientiñy mihiratra
amin-kavaña » (oeil d'hérisson, oeil de souris : on
regarde nos proches avec le peu ce qu'on a). Et c'est là que
réside, entre autres, la différence dans la démarche
pédagogique entre l'Ecole emmurée et de l'écrit qui est
implantée par les autorités de l'éducation nationale
depuis les années soixante-dix à Rantolava et l'Ecole sans murs
et de l'oralité qui est initiée par les ancêtres
(pédagogie de la parole tout au long de la vie) et modernité
(pédagogie des livres et de la sélection qui n'est
réservée qu'à telle ou telle élite seulement. L'
« Ecole emmurée des formateurs pédagogiques » avec ses
bâtiments vétustes (le Centre pédagogique) semble en
rupture avec son lieu d'implantation (le village de Rantolava). Car ici, une
autre type d'école, l' « Ecole sans murs des aînés
» a toujours existé et se renouvelle de génération en
génération
97
Le proverbe renvoie à toutes les dimensions de la vie :
aucun sujet n'y échappe71. Il nous permet de constater les
structures, le modèle et le concept de la
société betsimisaraka. A travers de
ceux-ci, les jeunes comprennent le
fonctionnement de leur
société, de la critiquer et/ou de l'améliorer. Nous ne
prétendons pas, durant la présentation de ce travail, être
en mesure de tout savoir ou de tout comprendre : loin de là ! Notre
intention était de dégager ces quelques orientations
éducatives, inculquées dans l'esprit de la population
betsimisaraka.
Sur ce qu'on a pu dégager de la société
betsimisaraka, on remarque qu'elle est organisée autour des
aînés, considérés comme détenteur du savoir
compte tenu de leur expérience de la vie. Pourtant, il ne s'agit pas de
négligence ou de l'exploitation du cadet comme l'on pense souvent : la
raison est surtout d'ordre affectif. En d'autre terme, il s'agit d'un principe
du «protectionnisme familial ». De l'autre côté, en ce
qui concerne la question du genre, et puisque la famille, disait Rousseau, est
la plus ancienne de toutes les sociétés, et la seule
naturelle72, ce projet nous a permis d'en déduire que si en
apparence on observe une sorte de subordination féminine, au fond, ce
n'est que les conséquences de la répartition des tâches et
de responsabilité entre homme et femme. Le concept est alors
différent de celui qui a été évoqué par
Herbert SPENCER. La femme betsimisaraka est une namaña et non
un objet.
En matière d'éducation, les proverbes abritent
simultanément deux éléments de base : le fond-contenu et
les moyens de transmission ; « il dévoile tout [contenu] en le
voilant [méthode]», disait FANONY à cet effet. En fait,
les proverbes, bien qu'ils se présentent sous forme d'une « formule
toute faite », nécessitent réflexion et analyse, avant d'en
déduire leur signification : le décodage de l'apprenant.
Et, dans le
71 FANONY Fulgence, Öhabölaña betsimisaraka
(Proverbes betsimisaraka) [en ligne]. Disponible et
téléchargeable en cliquant :
www.anthropomada.com/bibliotheque/
FANONYFulgence-
ohabolanabetsimisaraka ou
proverbes.com
72 ROUSSEAU Jean-Jacques, op.cit.
98
cadre de ce travail, nous nous sommes intéressé
aussi bien à leurs significations dans le sens propre du terme, donc
autant sur le contenu que sur les méthodes. A travers ces deux
dimensions, nous avons pu avancer certaines hypothèses concernant les
finalités éducatives du peuple betsimisaraka. Le tout
constitue un « un référentiel éducatif ». Or,
étant les reflets des pratiques réelles au quotidien ou des
réalités jugées naturelles, les proverbes font partie de
ce qu'on appelle la pédagogie de l'image (à l'image de) et du
symbolique. Cette pédagogie de l'image se manifeste par une forme d'une
recommandation directe ou indirecte. Le choix de ces approches est lié
soit par rapport au contexte, soit par rapport à l'âge, donc
à la maturité de la personne à qui elles s'adressent.
Par ailleurs, étant donné que les proverbes ne
sont pas les seuls moyens éducatifs, les hypothèses
avancées présentent certainement de limites. Un grand nombre
d'autres éléments culturels à vocation pédagogique
n'ont pas été développé. Nous faisons ici allusion
à des contes, aux devinettes, etc. Peut-être, dans les recherches
futures, nous aurons l'occasion de faire une analyse comparative de ces
différents éléments cultures afin de nous permettre d'en
déduire une conclusion plus complète. Cette recherche n'en est
que le début.
Enfin, il faut noter également qu'avec
l'évolution de la société et les conséquences de la
mondialisation, cette école de type traditionnelle commence à se
dégrader. Bien que les programmes scolaires mentionnent son importance,
son champ d'application devient de plus en plus limité.
99
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANDRIAMANJATO Richard, Le Tsiny et le Tody dans la
pensée malgache. Paris, Présence Africaine, 1957.
BLAIS Marie-Claude, GAUCHET Marcel et OTTAVI Dominique,
Pour une philosophie politique de l'éducation. Pluriel,
Editions Bayard, 2002.
CHARRIER Jean-Paul, L'inconscient et la psychanalyse.
P.U.F 108, Paris, 1968.
DANDURAND Renée et DULAC Germain, Les nouvelles
familles et l'école : répercussions des changements familiaux en
milieu scolaire, dans Comprendre la famille, 1991.
DEZ Jacques, Proverbes betsimisaraka in, Bulletin de
Madagascar, Tananarive, 1967.
DOMENICHINI Jean-Pierre, La chèvre et le Pouvoir.
Première approche historienne d'un interdit. In, Omaly sy Anio.
Revue d'Etudes historiques, N°9, Antananarivo, 1979.
DOMENICHINI-RAMIARAMANANA Bakoly, Du Ohabolana au Hainteny
: Langue littéraire et politique à Madagascar, Karthala,
Paris, 1983.
DUFOUR Stéphane, FORTIN Dominic et HAMEL Jacques,
L'enquête de terrain en sciences sociales. L'approche monographique
et les méthodes qualitatives, 1991.
FANONY Fulgence. L'oiseau grand-tison et autres contes des
Betsimisaraka du Nord (Madagascar), Littérature orale malgache,
tome 1. L'Harmattan, 2001.
HART Sura, HODSON Victoria. Parents respectueux, enfants
respectueux : sept clés pour transformer les conflits en
coopération familiale. La Découverte, Paris, 2005.
100
LAHADY, Pascal, Le culte betsimisaraka et son
système symbolique. Fianarantsoa, Editions Librairie Ambozontany,
1979.
LAIMIJAY Joël, Ny ohabölaña betsimisaraka
sy ny heviny marina. Antananarivo, Editions Imprimerie Iarivo, 1962
LEIF et RUSTIN, Philosophie de l'éducation.
Tome 1, Pédagogie générale, Delagrave, 1970.
LOUBET DEL BAYLE Jean-Louis, Initiation aux
méthodes des sciences sociales. Paris - Montréal :
L'Harmattan, 2000.
MANGALAZA Eugène Régis, Sensibilités
malgaches in, Revue Hermès, N° 40. Paris, 2004.
MAUSS Marcel, Essai sur le don. Forme et raison de
l'échange dans les sociétés archaïques, Paris,
PUF, 1960.
MALINOWSKI Bronislaw, Les Argonautes du Pacifique
occidental, Paris,
Gallimard, 1963 ; Les jardins de corail, Paris, Maspero,
1974.
PAUVERT J. C., Facteurs sociologiques de la planification de
l'éducation. In: Tiers-Monde. 1960, tome 1 n°1-2. pp.
135-144
PRONOVOST Gilles, Famille, temps et culture, dans
Comprendre la famille, 1991.
RAKOTOZAFY-HARISON Jean-Baptiste, Développement :
Pratiques et projets sociaux. Cours du module 6, MSFD. ENS,
Université de Fianarantsoa, 2005.
RAVOLOLOMANGA Bodo, Education, famille et
société : cas de l'enfant Tanala. Taloha n°12,
Archéologie des Hautes Terres, Paris, 1994
101
SAMSON Robert, Ohabölaña betsimisaraka.
Tamatave, Editions Imprimerie Tamatavienne, 1965.
Sociologie et Éducation. In: Enfance. Tome 12 n°3-4,
1959. Psychologie et Éducation de l'Enfance. pp. 324-333
(Article extrait des Cahiers Internationaux de Sociologie, 1951)
TEMPORAL Franck et LARMARANGE Joseph, Déroulement des
enquêtes quantitatives et/ou qualitatives. Laboratoire Ponter,
Département des Sciences sociales, Facultés de Sciences Humaines
et Sociales, Université Paris 5, 2006.
ZURFLUH Anselme, Un monde contre le changement. Une culture
au coeur des Alpes, Uri en Suisse, XIIe - XXè siècle. Zurich
Loriens Books/ Paris Economica pour la version française, 1993.
Webographie
DE SARDAN Olivier, L'enquête socio-anthropologique de
terrain : synthèse méthodologique et recommandations à
usage des étudiants. Disponible sur : www.anthropomada.com/
bibliotheque/sardan.pdf
Définition de pédagogie - Concept et Sens.
Disponible sur : http://lesdefinitions.fr/ pedagogie#ixzz3OUFrM9VA
EVANS-PRITCHARD Edward Evans, Anthropologie sociale
(1950). Ouvrage
disponible sur :
http://classiques.uqac.ca/classiques/Evans_pritchard/Anthropo_sociale/anthropologie
sociale.html
FANONY Fulgence, Öhabölaña betsimisaraka
(Proverbes betsimisaraka).
Université de Toamasina. Article disponible sur :
102
www.anthropomada.com/bibliothèque/
FANONYFulgence-ohabolana betsimisaraka ou proverbes.pdf, p.3
Groupe La Poste, disponible sur
http://stagelaposte.2010.free.fr/wp-content/documents/
synthese valeurs.pdf
MANGALAZA Eugène, MERIOT Christian. Anthropologie
générale n°04 (Cours du
:
premier semestre 2012-2013). Disponible sur
http://www.anthropomada.com/bibliotheque/
Anthropologie- Generale-4.pdf
MANGALAZA Eugène, MERIOT Christian. Anthropologie
générale n°02 (Cours du
premier semestre 2012-2013). Disponible sur
http://www.anthropomada.com/bibliotheque/
Anthropologie-Generale-2.pdf.
MANGALAZA Eugène, MERIOT Christian. Anthropologie
générale n°03 (Cours du
premier semestre 2012-2013). Disponible sur
http://www.anthropomada.com/bibliotheque/
Anthropologie-Generale-3.pdf.
Pédagogie et didactique. Disponible sur :
http://www.eduquer-respect.fr/pedagogie-et-didactique/
ROUSSEAU Jean-Jacques, Du Contrat Social, ou Principes du
droit politique ; in Collection complète des oeuvres,
Genève, 1780-1789, vol. 1, in-4° édition en ligne
www.rousseauonline.ch version
du 7 octobre 2012. Disponible sur
http://www.rousseauonline.ch/Text/du-contrat-social-ou-principes-du-droit-politique.php
103
GLOSSAIRE
Fihavanana A Madagascar, le
fihavanana est un système de règles, normes et
coutumes qui régissent la dynamique de la
société locale, édictent les comportements
interpersonnels, les modes de sociabilité et les stratégies
anti-risque (SANDRON Frédéric, 2008)
Fokontany Il s'agit d'une structure
administrative de base. Plusieurs
Fokontany forment arrondissement et l'ensemble de
plusieurs arrondissent constitue un district.
Razaña A Madagascar, ce terme
possède deux significations différentes.
En prenant l'exemple de « Tanindrazana »
(littéralement : terre des ancêtres) pour désigner la
patrie, le razaña est pratiquement synonyme des ancêtres.
Alors qu'en se référant au proverbe : « Raha razana tsy
hitahy : miheteza hiady vomanga » (si les razana n'aident
pas les vivants : qu'ils creusent de patates), le razana est en
quelque sorte la force surnaturelle des personnes décédées
et qui peut intervenir dans le monde du vivant.
Tangalamena Personne qui détient
l'autorité traditionnelle au sein du village.
Pour DEZ, il s'agit d'un personnage que l'on pourrait appeler
« prêtre de village », dont la fonction offre cette
particularité de constituer à leur profit un droit exclusif
d'invocation aux ancêtres. Nous pouvons dire qu'il assure
également la fonction de gardien de traditions, moeurs et coutumes.
Tsaboraha Coutume ancestrale
pratiquée généralement en pays des
Betsimisaraka. Le tsaboraha nécessite le
sacrifice d'un boeuf.
104
Table des matières
REMERCIEMENTS
RESUME 0
SOMMAIRE 2
LISTES DES CARTES, GRAPHIQUES, PHOTOS ET TABLEAUX 3
INTRODUCTION 4
PREMIERE PARTIE - THEMATIQUE, TERRAIN D'ETUDES ET
APPROCHES
METHODOLOGIQUES 8
CHAPITRE I -JUSTIFICATION DU THEME ET METHODOLOGIE DE TRAVAIL
9
I.1. La présentation de la recherche 9
I.1.1. Le contexte de la société
étudiée 9
I.1.2. La problématique de la recherche 11
I.1.3. L'objectif général de la recherche 14
I.1.4. Les objectifs spécifiques de la recherche 18
I.2. Les approches méthodologiques adoptées et
leurs justifications 19
I.2.1. L'entretien libre et semi-directif 19
I.2.1.1. L'enquête par entretien au niveau des
ménages 20
1.2.1.2. Un échantillonnage de type « de convenance
» 21
I.2.2. L'observation, participante ou non 21
I.2.3. La recherche et analyse documentaire 22
I.2.4. Quelques concepts clés 23
CHAPITRE II - NOTRE TERRAIN D'ETUDES : LE VILLAGE DE
RANTOLAVA 27
II.1. Une brève présentation
historio-géographique 27
II.1.1. Historique 27
II.1.1.1. Naissance de la confédération
betsimisaraka 27
II.1.1.2. Origine du village de Rantolava 28
II.1.2. Présentation géographique 28
II.2. Place de l'éducation au village de Rantolava
30
II.2.1. Le système éducatif de type occidental
31
II.2.2. L'éducation traditionnelle au village de Rantolava
34
105
II.2.2.1. Les genres narratifs 35
a) L'angano (contes) 35
b) Le korambe (légendes) 38
c) Le rasavölaña (discours) 41
d) Le jijy karazana (généalogies) 41
II.2.2.2. Les genres poétiques : le jijy et le
tökatoka 42
II.2. 2.3.Les genres sapientiaux 43
a) L'ankamantatra (les devinettes et contes-devinettes)
43
b) L'öhabölaña (les proverbes) 43
DEUXIEME PARTIE : RESULTATS ET INTERPRETATIONS
45
CHAPITRE III- LES PROVERBES : UN GENRE LITTERAIRE A
VOCATION
PEDAGOGIQUE POUR LES BETSIMISARAKA 46
III.1. L'art oratoire au quotidien 46
III.1.1. Au village de Rantolava : la maturité rime
avec art oratoire 47
III.1.2. Les proverbes : pour mieux ficeler la parole
48
III.2. Société betsimisaraka : une école
de la vie par les proverbes 51
III.2.1. L'importance du statut social 51
III.2.1.1. Relations cadets/aînés 51
a) Une question d'affection et de protection 52
b) Une question de soutien et de la solidarité familiale
54
III.2.1.2 Le statut de la femme dans la société
betsimisaraka 55
III.2.2. Les priorités de l'éducation 57
III.2.2.1. L'obéissance 58
III.2.2.2. La socialisation et l'éducation au travail
58
a) La socialisation et l'entraide 58
b) Adaptation et socialisation 60
c) L'éducation au travail 62
d) Quelques dérives et certaines limites de la
solidarité betsimisaraka 64
III.2.2.3. La préparation à la vie sexuelle et
conjugale 65
106
CHAPITRE IV - APPROCHES PEDAGOGIQUES D'UNE ECOLE SANS
MURS EN
PAYS BETSIMISARAKA 68
IV.1. Une pédagogie de deux ordres 68
IV.1.1.Les proverbes a « pédagogie directe »
68
IV.1.2. Les proverbes à « pédagogie indirecte
» 69
IV.2.Les proverbes au quotidien en pays betsimisaraka
72
IV.2.1. Pour une pédagogie de l'image 72
IV.2.2. Sur les voies des savoirs d'expérience et de la
sagesse 73
TROISIEME PARTIE : DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES
75
CHAPITRE V - LA PLACE DES TRADITIONS ORALES ET DES
VALEURS MALAGASY
DANS LE PROGRAMME SCOLAIRE 76
V.1. Dans les écoles primaires 76
V.1.1. Les cours préparatoires 77
V.1.2. Les cours élémentaires 78
V.1.3. Les cours moyens 79
V.1.3.1. La famille 79
V.1.3.2. La vie dans le village 80
V.2. Dans les collèges 80
V.2.1. Le cycle d'observation 81
V.2.1.1. La littérature 81
V.2.1.2. La société malagasy 81
V.2.2. Le cycle d'orientation 82
V.2.2.1. Le mariage traditionnel et le concept de la famille
83
V.2.2.2. L'organisation villageoise et les activités de
production 83
V.2.2.3. Les relations entre les vivants et les razaña
84
V.3. Dans les lycées 84
CHAPITRE VI - LES LIMITES DU CHAMP D'APPLICATION DES
PROVERBES ET
DES TRADITIONS ORALES BETSIMISARAKA 86
VI.1. Les réalités sociales 86
VI.1.1. L'absence d'échanges familiaux 86
VI.1.2. L'importance de la monnaie 87
107
VI.1.3. L'entraide et la cohésion sociale 88
VI.1.4. La remise en cause du concept cadet/aîné
90
VI.2. Quelques suggestions 90
VI.2.1. Les bourses culturelles 92
VI.2.2. La pédagogie des proverbes et l'approche-mixte
93
CONCLUSION 96
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 99
GLOSSAIRE 103



