PARTIE I :
IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE GESTION DE
L'ENVIRONNEMENT
8
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
L'identification des problèmes qui assaillent le DPM ne
peut impérativement se faire sans une étude préalable
portant sur l'état des lieux. La section I, ainsi,
porte sur la description du DPM, particulièrement la grande
côte et la section II consiste à identifier les
réels problèmes relevés sur le littoral.
SECTION I : DESCRIPTION DU DPM
Vue l'entendue du littoral sénégalais (en
particulier les Niayes) avec une diversité d'écosystèmes
marin et côtier, il serait indispensable de faire une étude
descriptive faisant état des lieux. Cela permet par ricochet
d'identifier les problèmes essentiels et de proposer des solutions.
Para I. aux plans physique et socioéconomique
Ce paragraphe s'articule autour de deux points: la description
physique de la grande côte d'une part et d'autre part, il s'agit
d'identifier les aspects socio-économiques du DPM.
A. les aspects fonciers et écologiques
La grande côte qui fait l'objet spécifique de
cette étude, est une partie intégrante des Niayes du
Sénégal. Elle se caractérise sur le plan physique par des
sols sablonneux et des sols rocheux par endroit plus proche des vagues. De
façon générale, la morphologie de la région des
Niayes se caractérise par diverses formes de reliefs allant des sommets
dunaires, qui culminent entre 15 et 20 m, aux dépressions interdunaires
où affleure la nappe phréatique. Ainsi un vaste manteau de sables
des formations du quaternaire couvre et commande l'allure du paysage local. On
distingue globalement trois grandes unités géomorphologiques :
les dunes intérieures ou dunes rouges, les dunes semi-fixées, et
les dunes blanches vives.
9
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Les dunes rouges4 sont alignées dans la
direction NNE-SSW au nord du secteur, et d'orientation N-S entre Mboro et
Potou, dans le sens des alizés continentaux (vents dominants de saison
sèche).
Ce sont des dépressions interdunaires dont le fond est
occupé par la nappe phréatique, subaflleurante (Blouin, 1990).
Ceci a permis le maintien d'une flore relique d'origine guinéenne (12%
des espèces), caractérisée notamment par le palmier
à huile (Elaeis guineensis) que l'on trouve autour des
dépressions.
On distingue d'ouest en est :
Les dunes littorales vives, situées
entre la plage sableuse et les dunes jaunes semi fixées. Cette
première catégorie de dunes dites « dunes blanches » ou
encore « dunes maritimes » est le résultat de la recrudescence
de la déflation éolienne, facilitée par les rigueurs
climatiques. Elles datent de la période actuelle ou subactuelle et sont
orientées de manière conforme à la direction dominante des
masses d'air. Elles sont façonnées par les vents alizés
à partir du matériau sableux côtier. Elles bordent le
littoral et se forment à partir des apports de la plage, nourries par la
dérive littorale. Généralement, elles surplombent les
autres formations dunaires. Leur orientation est peu précise.
Les dunes littorales semi-fixées ou
« dunes jaunes » constituent une bande irrégulière et
discontinue. Elles s'intercalent entre les dunes vives littorales et les dunes
intérieures.
Les dunes jaunes se terminent parfois par des fronts abrupts
de 10 à 20 m.
Les dunes rouges fixées font suite au
système des dunes jaunes. D'après les estimations faites par
Staljanssens (1986), la largeur de cette bande continue est inférieure
à 3 kilomètres.
Entre les systèmes dunaires, des dépressions
hydromorphes s'égrènent le long de la grande côte. Ce sont
les Niayes sensus stricto5, cuvettes inondées par des
fluctuations de la nappe phréatique au cours de l'année. La nappe
y affleure périodiquement, provoquant la formation de marais temporaires
ou permanents qui donnent son cachet particulier à cette
région.
Par ailleurs, les Niayes occupent une superficie de 2000
km2 environ et correspondent à une bande longue de 135 km et
large au maximum de 35 km. Elles abritent environ 419 espèces
représentant près de 20% de la flore sénégalaise.
Elles sont le lieu privilégié du maraîchage,
activité économique extrêmement importante tout le long de
cette côte, en plus de la pêche.
4 Ce sont des dunes appelées
également par les géographes de dunes ogoliennes car remonte au
temps géologique dans l'ère ogoliennes. Il ya de cela environ
25millions d'années.
5 Les Niayes sensus stricto ont des
formes et des dimensions très variables, on distingue deux types : - des
Niayes de petites dimensions orientées NNW-SSE,
- des Niayes de vaste superficie.
10
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Ceci entraîne une disparition progressive de la
végétation naturelle. Ces activités sont menacées
en certains endroits par la progression des dunes jaunes
ravivées6 et par une salinisation des sols et de la nappe.
Sur le plan climatique, inscrites dans la moitié sud de la zone
sahélienne, les Niayes et la région de Dakar sont
caractérisées par l'alternance de deux saisons annuelles : une
saison humide concentrée sur trois mois (juillet, août et
septembre) et une saison sèche qui dure les autres neuf mois. La
région des Niayes bénéficie en plus d'un microclimat assez
particulier par rapport aux autres parties du pays qui s'intègrent dans
les mêmes domaines climatiques qu'elle. Elle est
caractérisée par des températures modérées
influencées par la circulation des alizés maritimes
soufflés par les courants froids des Açores. La proximité
de l'océan favorise le fort taux d'humidité relative de 15 % dans
les zones les plus éloignées de la mer. Ce taux d'humidité
peut remonter jusqu'à 90 % à partir du mois d'avril.
Carte n°2 : la Grande Côte au
Sénégal (de Dakar à Saint-Louis)
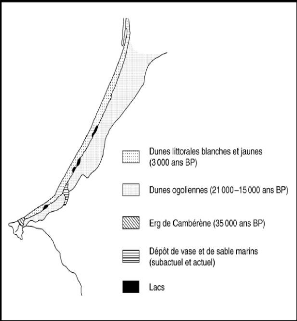
Source : enquête mémoire master II
environnement, 2010, M. SANOKHO
6 Ce sont des dunes de sables dont la coloration
demeure vive et claire en raison des phénomènes climatiques
changeant.
11
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
En effet, de nouvelles études dans l'espace
périurbain nous montrent : les Niayes à la fois une zone
d'agriculture semi-biologique et réserve d'équilibre biologique
avec plus de 140 espèces d'oiseaux et de reptiles (IRD, 1998). Ceux-ci
s'étendent derrière le cordon dunaire, le long de la côte
entre Dakar et Saint-Louis sont alimentées par une nappe
phréatique affleurant de 0,5m à 1m suivant les apports
pluviométriques et par des lentilles d'eau douce interdunaires
permettant des cultures maraîchères tout au long de
l'année. Soumises aux attaques anthropiques avec les
prélèvements effectués par un maraîchage intensif
d'une part et d'autre part, à une forte évaporation, le niveau
d'eau a considérablement diminué ces dernières
années. En plus, au niveau des Niayes, le DPM (en se
référant sur les 100 mètres de la limite des hautes
marées) concentre une importante réserve naturelle
constituée de mangroves et de marais.
Sur le plan écologique, la partie du DPM est une «
interface » soumises aux marées où sont en jeux des
phénomènes trophiques et fonctionnels très importants (un
écotone7 par rapport au paysage). En effet, a cause de la
montée des eaux maritimes de partout dans le monde, le littoral s'avance
sur les zones urbaines ou rurales en fonction des lieux. A cet effet, les
limites du DPM sont localement à mettre à jour
périodiquement à cause du recul du trait de côte, qui
pourrait être exacerbé par le changement climatique et la
montée des océans.
Une partie du DPM est juridiquement
protégée et classée suivant plusieurs
directives européennes (publié par Natura, 2000). Des
réserves naturelles nationales peuvent s'y étendre avec une
possibilité d'installer des parcs naturels marins ou encore des aires
marines protégées.
A l'instar des côtes ouest-africaines, les eaux
sénégalaises renferment une biodiversité riche qui
comprend, entre autres, des mammifères marins tels que les requins, les
lamantins, les dauphins, les otaries, les phoques, les baleines, les tortues
marines, les oiseaux côtiers (rapport national8, 2009).
Ces espèces qui étaient méconnues il y a
quelques années, font aujourd'hui l'objet d'une surexploitation qui
menace même leur survie. Par ailleurs, ces espèces subissent la
7 Zone de
séparation entre deux écosystèmes, autrement dit entre
l'écosystème marin et celui des habitations humaines ou
même écosystème constitué de terres
agricoles.
8 Ce rapport est publié en 2009 par la
direction de l'environnement et des établissements classés sous
l'institution tutelle du ministère de l'environnement et de la
protection de la nature modifiée et remplacée par le
ministère de l'environnement, de la protection de la nature, des bassins
de rétention et lacs artificiels.
12
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
dégradation de leurs habitats et du milieu marin, cela
a pour conséquence, la réduction de la biodiversité et le
raccourcissement des chaînes alimentaires qui englobe la disparition des
espèces carnivores. A cela s'ajoutent, certaines mauvaises pratiques
comme la pêche à explosif, qui atteint présentement des
proportions inquiétantes, car, aboutissant à la
désertification des fonds rocheux littoraux, dans des fonds
dépassant, en général 35 mètres.
Consciente de cela, l'Union Internationale pour la
Conservation de la nature (UICN) a inscrit ces espèces dans sa liste
rouge, qui concerne l'ensemble de la communauté internationale, et a
tiré sur la sonnette d'alarme pour leur sauvegarde et leur
préservation.
En effet, la richesse de la biodiversité marine au
Sénégal se manifeste par l'existence de plusieurs types
d'écosystèmes côtiers. Ceux-ci existent sur tout le long
des côtes sénégalaises. Ils sont constitués par les
côtes sableuses (la Grande Côte), les côtes rocheuses
(presqu'île du Cap Vert), les zones humides côtières
(Niayes). Egalement, cette richesse biologique se distingue au
niveau de la mangrove, les îles sableuses et les bolons dans les deltas
du Saloum et du Sénégal et des vasières au sud de
l'embouchure de la Casamance.
Il faut retenir que dans cette présente étude
bien que spécifique à la grande côte, prête
l'attention sur les autres écosystèmes qui existent au
Sénégal lesquels méritent bien d'être
soulignés.
Pour cela, les développements suivants vont porter sur
la description des mangroves et marais un peu partout au Sénégal.
L'intérêt consiste à intégrer dans les
recommandations générales tous les espaces du DPM au
Sénégal, car (bien que chaque DPM recèle des
particularités), les lois seront communes et uniformes dans la
protection de l'environnement sur ce domaine.
13
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
Carte N° 1 : les différents
écosystèmes du Sénégal (la répartition des
parcs, réserves, aires marines protégées au
Sénégal)

Source : enquête mémoire master II
(in rapport érosion côtière 2005).
Au Sénégal, en plus des Niayes, une zone par
excellente du littoral, il existe d'autres écosystèmes dont nous
allons tenter dans les lignes suivantes de faire une présentation
très brève.
? LES MANGROVES ET MARAIS COTIERS
La mangrove se caractérise par la présence d'une
formation végétale particulière de palétuviers. Au
Sénégal, l'écosystème constitué de
mangroves, occupe une superficie d'environ 300 000 hectares, essentiellement
dans les estuaires du Saloum (environ 80 000 ha) et de la Casamance (environ
250 000 ha) (Diop, 1986 ; Seck, 1993, in rapport national 2009).
14
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
En Casamance, l'écosystème de mangrove
identifié, est l'un des plus productifs du monde. Il abrite des
espèces animales spécifiques (huîtres, balanes, arches,
crabes) mais aussi il sert de refuge à des espèces d'oiseaux
(hérons, aigrettes) et à des juvéniles de poissons ou de
crevettes. Il contribue ainsi de manière significative au bon
fonctionnement des communautés de poissons du plateau continental. Les
mangroves font l'objet d'exploitation abusive par les populations locales en
vue de satisfaire leur besoin nutritionnel et financière. Il s'agit
notamment des activités de récolte de coquillages (arches et
huîtres), en général effectuées par les femmes
(Descamps, 1994). Ces coquillages sont autoconsommés et
commercialisés sous forme séchée. Les feuilles et fruits
des palétuviers sont utilisés dans l'alimentation mais aussi dans
la pharmacopée. Quant au bois, il est aussi bien utilisé pour la
construction que comme source énergétique.
Au niveau des estuaires et du Delta du Saloum, il se forme
plusieurs réseaux de marigots « bolons » et de lacs autour
desquels se développement une diversité d'espèces. La
végétation constituée essentiellement de mangroves et de
prairies a halophytes (Marius, 1977) ou « tannes herbues », est
colonisée par des espèces comme exemple Ipomoea
pescaprae, Cyperus maritimus.
En plus d'une importance d'espèces
végétales, le Sénégal dispose d'espèces
animales dont la recherche menée par Bodian (2000), fait
révéler la présence de près de 260 espèces
sur les côtes sénégalaises. Les données de recherche
disponibles indiquent pour le Sénégal une biomasse annuelle
moyenne variant entre 1 100 tonnes et 9 700 tonnes. Cette biomasse peut
atteindre, en année favorable 15 000 tonnes.
Entre autres écosystèmes marins, on peut
évoquer la réserve naturelle du Djoudj. Elle est
située en milieu azonal à cause des conditions hydrologiques et
pédologiques de la plaine inondable. Cette réserve est inscrite
comme patrimoine mondiale de l'UNESCO, bénéficie également
de la protection juridique de la convention internationale sur les zones
humides d'importance capitale (convention de Ramsar 1971).
En effet, La grande richesse biologique des
écosystèmes côtiers et marins résulte de courants
marins ascendants appelés upwelling9 et de la
diversité des habitats. Les ressources halieutiques des zones
côtières et marines et l'avifaune des régions
deltaïques constituent les principales ressources biologiques de ces
écosystèmes qui sont affectées par la surpêche et
9 Le Sénégal dispose des côtes les
plus poissonneuses a cause des courants ascendants appelés upwelling.
15
Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La
gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au
Sénégal : Etude
de la Grande Côte. Présenté par
Malick SANOKHO
l'exploitation du bois de mangrove. Ces pratiques abusives
constituent une menace pour la conservation de la biodiversité et des
écosystèmes marins et côtiers.
Les richesses écologiques et foncières qui
caractérisent le DPM font de lui, cette attraction exacerbée des
populations. Plusieurs activités humaines et industrielles y sont
localisées. Cela crée un fort changement du milieu dont l'analyse
suivante, nous éluciderons sur les aspects démographique et
socio-économique auxquels le DPM fait état.
| 


