|

BURKINA FASO
*************
Unité-Progrès-Justice
Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en sciences de la Santé et
de l'Éducation
(IFRISSE)
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme
de Master II Spécialité : Sciences de
l'éducation
Option : Planification et management de
l'éducation
=========
Thème: Gestion de l'éducation en
situation de crise sécuritaire au Burkina Faso : état des lieux
et perspectives dans la commune de
Titao
Présenté par : Sous la direction de
:
SANA Moctar Abdoulaye Dr Etienne OUEDRAOGO
Composition du jury
Président : Dr Guy Romuald OUEDRAOGO Membre 1 : Dr Etienne
OUEDRAOGO Membre 2 : Dr Evariste Magloire YOGO Date de soutenance : 20 mars
2021

A
Ma femme, Salamata BaDini et à
mes enfants, Mohamed et Abdoul-Majîd
II
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce mémoire est rendue possible
grâce au concours de plusieurs personnes. Nous tenons ici à
exprimer nos sincères remerciements et reconnaissances à tous
ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la
production de ce document.
Nos remerciements vont particulièrement à notre
directeur de mémoire, Docteur Etienne OUEDRAOGO pour la
disponibilité, la rigueur, la patience et l'attention qu'il a toujours
manifestées à notre égard tout au long de la
rédaction de ce mémoire.
Nos remerciements s'adressent également à
l'administration de l'institut de Formation et recherche interdisciplinaires en
sciences de la santé et de l'éducation (IFRISSE) pour ses
diverses contributions à la réussite de notre formation.
A l'ensemble des enseignants de l'IFRISSE qui ont toujours
manifesté leur disponibilité pour la réussite de notre
formation, nous vous disons grandement merci.
A toute la première promotion des étudiants en
sciences de l'éducation de l'IFRISSE, vous nous avez permis, à
travers les échanges d'expériences, de tenir le cap
jusqu'à la fin de cette formation. Nous vous disons merci.
A l'ensemble des personnes qui ont bien voulu accepter se
prêter à nos entretiens et questionnaires, nous vous disons merci
pour votre disponibilité.
A Monsieur Adolphe TIONOU, Attaché d'administration
scolaire et universitaire, chef de service des études et de la
planification de la Direction Régionale de l'Education
Préscolaire, Primaire et Non Formelle (DREPPNF) du Nord, merci pour
votre simplicité et votre disponibilité à mettre à
notre disposition des informations statistiques.
A Monsieur Moustapha GUIRO, Attaché d'administration
scolaire et universitaire, chef de service des ressources humaines de la
Direction Provinciale des Enseignements Post-primaire et Secondaire (DPEPS) du
Loroum, merci pour l'hébergement et l'accompagnement dans
l'administration de nos questionnaires.
Nous ne saurions terminer nos propos sans dire merci à
nos parents pour ce qu'ils nous ont transmis comme valeurs et sans lesquelles
nous ne serions pas ce que nous sommes.
III
RESUME
L'éducation est un droit reconnu à tout individu
et inscrit dans la Constitution de la plupart des pays. Le Burkina Faso,
s'inscrivant dans cette logique, a élaboré plusieurs plans de
développement du secteur de l'éducation dont certains sont
toujours en cours d'exécution. L'objectif principal étant la
quête d'une éducation de qualité pour tous. Cependant, de
nouveaux défis s'imposent aux acteurs de l'éducation. Parmi ces
défis figure la scolarisation des élèves des zones
à forts défis sécuritaires. Cette problématique
constitue l'objet de notre recherche dont le thème est : «
Gestion de l'éducation en situation de crise sécuritaire
au Burkina Faso : état des lieux et perspectives dans la commune de
Titao». Notre ambition est d'appréhender les efforts des
acteurs directs de l'éducation dans le sens de favoriser une prise en
charge scolaire adéquate des élèves déplacés
dans la commune de Titao. Pour y parvenir, nous avons, après une
étude documentaire, procédé à la collecte de
données à travers des entretiens et des questionnaires. L'analyse
des données recueillies nous a conduit à la conclusion selon
laquelle, dans la prise en charge scolaire des élèves
déplacés dans la commune de Titao, les acteurs directs de
l'éducation mettent en oeuvre des pratiques efficaces en matière
d'éducation en situation de crise sécuritaire. Ces pratiques sont
entre autres la prise de certaines dispositions organisationnelles,
matérielles, psychosociales et la prise en compte de la
spécificité des élèves déplacés dans
la conduite des activités pédagogiques et socioéducatives.
Cependant, la vérité à laquelle nous sommes parvenu est
relative car nous ne sommes pas parvenu à une validation absolue de
toutes nos hypothèses de recherche. Des recommandations ont donc
été faites pour l'amélioration de la prise en charge
scolaire des élèves déplacés.
Mots clés : Education - crise
sécuritaire - gestion
ABSTRACT
Education is a right recognized for every individual and
enshrined in the Constitution of most countries. Burkina Faso, following this
logic, has drawn up several development plans for the education sector, some of
which are still being implemented. The main objective being the quest for
quality education for all. However, new challenges are facing education actors.
Among these challenges is the education of students in areas with strong
security challenges. This issue is the subject of our research, the theme of
which is: "Education management in a security crisis in
IV
Burkina Faso: state of play and perspectives in the
municipality of Titao". Our ambition is to understand the efforts of direct
education actors in the direction of promoting adequate school care for
displaced students in the municipality of Titao. To achieve this, after a
documentary study, we collected data through interviews and questionnaires. The
analysis of the data collected led us to the conclusion according to which, in
the school management of displaced students in the municipality of Titao, the
direct actors of education implement effective practices in matters of
education in situation of security crisis. These practices are among others,
the taking into account of some organizational, material, psychosocial
arrangements and the taking into account of the specificity of the displaced
students in the conduct of the educational and socioeducational activities.
However, the reality we have arrived at is relative because we have not
achieved absolute validation of all of our research hypotheses. Recommendations
were therefore made for improving the educational support of displaced
students.
Keywords: Education - security crisis - management
V
SOMMAIRE
REMERCIEMENTS II
RESUME III
SOMMAIRE V
SIGLES ET ABRÉVIATIONS VI
LISTE DES TABLEAUX VIII
LISTE DES FIGURES X
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES 3
INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE 4
CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE 5
CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LA LITTERATURE
15
CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE L'ETUDE 35
CONCLUSION A LA PREMIERE PARTIE 52
DEUXIEME PARTIE : ASPECTS PRATIQUES 53
INTRODUCTION A LA DEUXIEME PARTIE 54
CHAPITRE IV : PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES
DONNEES COLLECTEES 55
CHAPITRE V : VERIFICATION DES HYPOTHESES DE RECHERCHE, LIMITES
ET RECOMMANDATIONS 88
CONCLUSION A LA DEUXIEME PARTIE 96
CONCLUSION GENERALE 97
BIBLIOGRAPHIE 99
TABLE DES MATIERES 102
ANNEXES i
VI
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AGR : Activité Génératrice de Revenus
APE : Association des Parents d'Elèves
AVS : Agent de la Vie Scolaire
CCEB : Chef de Circonscription d'Education de Base
CEB : Circonscription d'Education de Base
CEG : Collège d'Enseignement Général
CNSE : Coordination Nationale des Syndicats de l'Education
CONASUR : Conseil National de Secours d'Urgence et de
Réhabilitation
COPROSUR : Conseil Provincial de Secours d'Urgence et de
Réhabilitation
CPE : Conseiller Principal d'Education
DAMSSE : Direction de l'Allocation des Moyens
Spécifiques aux Structures Educatives
DPEPPNF/L : Direction Provinciale de l'Education
Préscolaire Primaire et Non Formelle du
Loroum
DPEPS/L : Direction Provinciale des enseignements
post-primaire et secondaire du Loroum
DRC : Conseil Danois pour les Réfugiés
EPT : Education Pour Tous
ESH : Enfants en Situation de Handicap
FMI : Fond Monétaire International
HCR : Haut-Commissariat pour les Réfugiés
IIPE : l'Institut Internationale de Planification de
l'éducation
INEE : Réseau Inter-agences pour l'éducation en
situations d'urgence
L.M.P.H.T : Lycée Municipal Pierre Hazette de Titao
LPL : Lycée Provincial du Lorum
MENAPLN : Ministère de l'Education Nationale, de
l'Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales
VII
OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Economique
OCHA : Bureau de la coordination des affaires humanitaires
ODD : Objectifs du Développement Durable
ONG : Organisation non gouvernementale
PDDEB : Plan Décennal de Développement de
l'Education de Base
PDSEB : Programme de Développement Stratégique
de l'Education de Base
PER : Programme d'Education par la Radio
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
PSEF : Plan Sectoriel de l'Education et de la Formation
SIG : Service d'Information du Gouvernement
SSEZDS : Stratégie nationale de Scolarisation des
Elèves des Zones à forts Défis Sécuritaires
SSAP : Stratégie de Scolarisation
Accélérée/Passerelle
TBS : Taux Brut de Scolarisation
TICE : Technologies de l'information et de la communication
pour l'enseignement
VDP : Volontaire pour la Défense de la Patrie
VIII
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Les différentes provinces de la
région du nord 35
Tableau 2: Etat numérique des établissements par
commune 37
Tableau 3: Présentation de la population d'étude
44
Tableau 4: proportion des publics cibles dans la population
totale 45
Tableau 5: Echantillon par public cible 45
Tableau 6: Echantillon définitif 46
Tableau 7: Acteurs outils d'enquête 49
Tableau 8: Etat de recouvrement des questionnaires au niveau
des enseignants 55
Tableau 9: Etat de recouvrement des questionnaires
adressés au élèves 56
Tableau 10: Avis des enseignants sur les effectifs dans les
classes 58
Tableau 11: Avis des enseignants sur les formations
reçues 59
Tableau 12: opinions des enseignants sur le cadre de formation
59
Tableau 13: Avis des enseignants sur l'existence de supports
pédagogiques 60
Tableau 14: Avis des enseignants sur la dotation des
élèves déplacés en kits scolaires 60
Tableau 15: opinions des enseignants sur les services au
profit des élèves déplacés 61
Tableau 16: Avis des AVS sur les services au profit des
élèves déplacés 63
Tableau 17: Avis des élèves
déplacés sur les difficultés de réinscription 63
Tableau 18: Avis des élèves
déplacés sur le temps passé à la maison 64
Tableau 19: Avis des élèves
déplacés sur les facilitations de réinscription 64
Tableau 20: Avis des élèves
déplacés sur les soutiens en fournitures scolaires 65
Tableau 21: Opinions des élèves sur
l'acquisition de soutiens autres que les fournitures scolaires
66
Tableau 22: Sentiments des élèves avant
l'inscription dans l'établissement d'accueil 66
Tableau 23: Sentiments des élèves après
intégration des établissements d'accueil 67
Tableau 24: Avis des élèves sur les services
psychosociaux bénéficiés 67
Tableau 25: Avis des élèves sur l'attitude du
personnel éducatif 68
Tableau 26: Visualisation des tendances des réponses
des différents publics ciblent selon les trois
sous variables de la dimension no 1 70
Tableau 27: Avis des enseignants sur la présence
d'élèves déplacés dans leurs classes 71
Tableau 28: Opinions des enseignants sur l'assiduité et
la ponctualité des élèves aux cours 72
IX
Tableau 29: Opinions des enseignants sur la satisfaction en
besoins de matériels pédagogiques et
didactiques 73
Tableau 30: Avis des enseignants sur la pratique
d'activités socioéducatives 74
Tableau 31: Avis des enseignants sur les organisateurs des
activités socioéducatives 74
Tableau 32: Avis des enseignants sur la participation des
élèves déplacés aux activités
socioéducatives 75
Tableau 33: Avis des AVS sur la pratique d'activités
pédagogiques 76
Tableau 34: Avis des AVS sur la pratique d'activités
socioéducatives 76
Tableau 35: Opinions des élèves
déplacés sur leur capacité à apprendre 77
Tableau 36: Point de vue des élèves sur
l'existence d'activités de soutien extra-scolaire 78
Tableau 37: Opinions des élèves
déplacés sur la pratique d'activités
socioéducatives 78
Tableau 38: Visualisation des tendances des réponses
des différents publics cibles selon les deux
variables de la dimension no 2 80
Tableau 39: Avis des enseignants sur la mobilisation de la
communauté locale 80
Tableau 40: Avis des AVS sur la mobilisation de la
communauté locale 81
Tableau 41: Visualisation des tendances des réponses
des différents publics cibles concernant la
dimension no 3 84
X
LISTE DES FIGURES
Figure 1: Evolution des taux de scolarisation au Burkina Faso
7
Figure 2: Hangar réalisé par des parents
d'élèves 83
Figure 3: Hangar réalisé par l'ONG
Solidarité Internationale 83
1
INTRODUCTION
Les objectifs du développement durable (ODD) que se
sont fixés les pays membres de l'Organisation des Nations Unies placent
la question du développement de l'éducation au premier ordre des
priorités. Aussi, la Constitution burkinabè, en son article 18,
reconnaît l'éducation, l'instruction et la formation comme des
droits sociaux. Par ailleurs, sa reconnaissance comme un puissant moteur de
développement économique et un excellent moyen de lutte contre la
pauvreté (PETIT & COMHAIRE, 2010) favorise aujourd'hui
l'adhésion de toutes les couches sociales à son
développement. Cependant, force est de constater que dans le monde et
particulièrement au Burkina Faso, nombreux sont les enfants qui,
jusqu'aujourd'hui, n'ont pas accès aux structures éducatives ou
qui n'achèvent pas quand ils entrent dans un cycle donné et ce,
pour diverses raisons. Amadou DIAOUNE (2016) mentionne cinq principales causes
du décrochage scolaire en Afrique francophone. Il s'agit de
l'extrême pauvreté de la population, des programmes scolaires peu
adaptés aux réalités économiques, sociales et
culturelles, du recrutement d'enseignants à faible niveau
académique, de la faiblesse des ressources publiques allouées au
secteur de l'éducation et des conflits et guerres.
Les conflits et guerres comme causes de décrochage
scolaire est une problématique qui est d'actualité au Burkina
Faso. En effet, depuis 2016, plusieurs établissements scolaires sont
fermés pour cause d'insécurité due à des attaques
terroristes. Ces attaques, au départ, avaient pour cible les forces de
l'ordre, les représentations de l'administration territoriale et les
espaces fréquentés par les expatriés (OUBDA, 2020).
Cependant, depuis janvier 2017, des enseignants dans le Sahel et le Nord du
Burkina Faso reçoivent des menaces de groupes terroristes. Ces menaces
ont été mises à exécution avec l'assassinat, le 3
mars 2017, d'un enseignant à Kourfayel, dans la province du Soum. Depuis
cet incident, beaucoup d'établissements scolaires ont vu leurs portes
fermées, laissant des milliers d'enfants et d'adolescents hors des
structures éducatives. Selon le Service d'Information du Gouvernement
(SIG), « la situation à la date du 15 février 2019 fait
ressortir 1135 établissements fermés empêchant 154233
élèves de jouir de leur droit à l'éducation dont
46% de filles » (
www.sig.bf/2019/02/communique-57/).
En pareille circonstance, le plus urgent pour ces populations
déplacées c'est de pouvoir se reloger et se nourrir dans un
environnement plus sécurisé. Mais face à cette situation,
l'éducation de ces enfants et adolescents déplacés pour
cause d'insécurité doit-elle attendre ? Nombreuses sont les
structures qui s'intéressent à l'éducation en
2
situation de crise. Ces structures sont entre autres les
institutions internationales telles que la Banque Mondiale, le Fond
Monétaire International (FMI) ; les organisations humanitaires (le
Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), Save the Children, Human
Rights Watch, Plan International etc.) ; les collectivités locales ; la
société civile etc. Il s'agit pour ces différentes
entités, de participer, au nom du droit à l'éducation pour
tous, au financement, à la planification et la gestion des
systèmes éducatifs qui subissent les conséquences de
conflits armés ou de catastrophes naturelles. Comme toute
problématique, la question de l'éducation en situation de crise
intéresse aussi le chercheur. Machel, Lanoue, Chelpi-Den Hamer, Sinclair
etc. ont abordé cette problématique sous plusieurs angles dont
l'impact des conflits sur l'éducation, la planification et gestion de
l'éducation en situation de crise. Toutefois, la crise
sécuritaire que traverse le Burkina Faso, à l'heure actuelle,
impose une réflexion sur l'offre éducative en contexte
d'insécurité. Nous nous sommes alors proposé de mener la
réflexion sur le thème « Gestion de
l'éducation en situation de crise sécuritaire au Burkina Faso :
état des lieux et perspectives dans la commune de Titao».
L'étude à mener se veut être notre contribution
à l'atteinte des objectifs du système éducatif
burkinabè qui sont entre autres, l'accélération du
développement quantitatif et qualitatif de l'offre éducative et
la quête d'un système éducatif plus démocratique
(Loi d'orientation 2007). La réalisation du présent travail
commande le plan de recherche suivant :
- une partie théorique qui comporte trois chapitres
à savoir la problématique, le cadre de référence et
le cadre méthodologique ;
- une partie pratique qui est subdivisée en deux
chapitres, à savoir la présentation, l'analyse et
l'interprétation des données collectées ; la
vérification des hypothèses, les limites de la recherche et
recommandations.
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES
3
4
INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE
La première partie de notre recherche dresse le cadre
théorique. Elle est structurée en trois parties dont la
problématique, le cadre de référence et le cadre
méthodologique. Il s'agit dans le premier chapitre de faire un
aperçu sur le développement du secteur de l'éducation au
Burkina Faso, d'identifier les défis auxquels font face les acteurs de
l'éducation dans un contexte d'EPT avant de décliner les
questions, objectifs et hypothèses de recherche. Le deuxième
chapitre nous permet ensuite de clarifier les concepts clés de la
recherche, de définir les théories sur lesquelles la recherche se
fonde et d'explorer la littérature sur la question de l'éducation
en situation de crise. Enfin, dans le troisième chapitre, nous
présentons le dispositif méthodologique. Il s'agira
concrètement de présenter la zone d'étude, la
méthode de recherche, la population cible, les instruments de collecte
et les techniques d'analyse des données.
5
CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE
BEAUD (1985, p. 31) définit la problématique
comme un « ensemble construit autour d'une question principale, des
hypothèses de recherche et des lignes d'analyses qui permettent de
traiter le sujet ». Ainsi, notre tâche, dans ce chapitre, est
de faire un bref aperçu sur le développement de
l'éducation au Burkina Faso, de voir les défis qui se
présentent au système éducatif burkinabè avant de
décliner les questions, les objectifs et les hypothèses de
recherche.
I.1) Contexte
Le contexte de notre étude présente les efforts
consentis par les autorités éducatives du Burkina Faso pour
assurer le développement du secteur de l'éducation. Il aborde
également les défis auxquels font face les acteurs et partenaires
de l'éducation dans leur quête de l'éducation pour tous.
I.1.1) Du développement du secteur de
l'éducation
Nelson Mandela disait ceci : « L'éducation est
l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde
». En effet, la nécessité d'éduquer n'est
aujourd'hui un sujet à débat pour aucune société.
Elle trouve, de ce fait, une place importante dans des Déclarations et
Conventions internationales qui invitent ou enjoignent les Etats signataires
à faire de l'éducation un droit fondamental pour
l'humanité. A ce titre, la déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948 en son article 26 déclare que « toute personne a
droit à l'éducation ». Aussi, la convention relative aux
droits de l'enfant (1989), quant à elle, enjoint, en son article 28, les
Etats signataires à rendre obligatoire et gratuit l'enseignement
primaire et à favoriser l'accessibilité aux autres ordres
d'enseignement. Ces nombreux traités internationaux ont favorisé
la mise en oeuvre des politiques de l'éducation pour tous (EPT)
engagées depuis la conférence de Jomtien en Thaïlande en
1990, réaffirmées à Dakar en 2000 puis plus ciblé
à Incheon en 2015. Ces conférences se sont données pour
objectifs d'accorder à tous les enfants, jeunes et adultes,
l'accès à une éducation de base de qualité. La
conférence d'Incheon fixe l'échéance de l'atteinte de ces
objectifs à l'horizon 2030.
Le Burkina Faso, signataire des différentes
déclarations internationales issues de grandes rencontres sur
l'éducation, a inscrit dans sa Constitution, à son article 18, le
droit à l'éducation, à l'instruction et à la
formation pour toute personne vivant sur le territoire burkinabè. Ainsi,
la politique nationale considère l'éducation comme
« la priorité des priorités
». Ces engagements
6
internationaux et la disposition constitutionnelle nationale
ont conduit à des reformes du système éducatif et à
l'adoption de plans stratégiques afin de répondre aux besoins
éducatifs du moment.
C'est dans cette logique de quête d'une éducation
pour tous qu'il a été adopté en 2007, la loi no
013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation.
Cette loi stipule en son article 3 que toute personne vivant au Burkina Faso a
droit à l'éducation, sans discrimination aucune, notamment celle
fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, la religion, les
opinions politiques, la nationalité, ou l'état de santé.
Ce droit s'exerce sur la base de l'équité et de
l'égalité des chances entre tous les citoyens. L'article 15 de
cette même loi énonce les objectifs du système
éducatif burkinabè. Parmi ces objectifs, sont inscrits
l'accélération du développement quantitatif et qualitatif
de l'offre éducative de base et la réduction des
inégalités de toutes sortes en vue d'assurer l'encadrement de la
petite enfance ; la scolarisation de tous les enfants d'âge scolaire ;
l'alphabétisation, à court ou moyen terme, de tous les
adolescents et adultes analphabètes qui ont été
précocement déscolarisés ou qui n'ont pas
été scolarisés ; l'encadrement des enfants d'âge
scolaire et des adultes à besoins éducatifs spécifiques.
Par ailleurs, ces deux dernières décennies ont été
marquées par la mise en oeuvre de plans et programmes dont le plan
décennal de développement de l'éducation de base (PDDEB),
le programme de développement stratégique de l'éducation
de base (PDSEB) qui est à son terme et le plan sectoriel de
l'éducation et de la formation (PSEF).
Le PDDEB a couvert la période 2000-2009 avec un
objectif cible de 70% de taux brut de scolarisation. Il a servi de cadre de
référence à l'intervention des acteurs du système
éducatif au Burkina Faso. Ce plan visait l'accroissement de l'offre
éducative de base, l'amélioration de la qualité de
l'enseignement et le développement des capacités de pilotage du
secteur éducatif. Par ailleurs, le gouvernement du Burkina Faso a,
à la fin du PDDEB, engagé un autre programme afin d'assurer une
continuité dans la gestion programmatique du secteur de
l'éducation. Ce programme se veut encore plus global en incluant les
différents degrés d'enseignement et est beaucoup plus
orienté vers la recherche de la qualité de l'éducation
(OUEDRAOGO, 2016). Il s'agit du programme de développement
stratégique de l'éducation de base (PDSEB) qui couvre la
période 2010 à 2020 et qui envisage poursuivre le
développement de l'enseignement primaire mais aussi des autres niveaux
d'éducation à l'exception du supérieur et de la recherche.
Il envisage également diversifier les actions d'alphabétisation
et de post alphabétisation. Malgré les progrès
significatifs
7
enregistrés ces dernières années dans le
secteur, le système éducatif burkinabè demeure
généraliste, peu professionnalisant, peu adapté aux
besoins du marché de l'emploi et moins holistique d'où
l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation et de la formation
(PSEF). Le PSEF (2017-2030) qui couvre l'ensemble des ordres d'enseignement
allant du préscolaire au supérieur, a pour ambition de contribuer
au développement du secteur de l'éducation et de la formation
à travers une coordination efficace et une mise en cohérence des
interventions de tous les acteurs. En effet, les programmes stratégiques
du PSEF sont le développement de l'accès à
l'éducation et à la formation ; l'amélioration de la
qualité de l'éducation et de la formation ; le pilotage et le
soutien au secteur de l'éducation et de la formation. Toutefois il est
à remarquer que dans la mise en oeuvre de ces politiques
éducatives, le PDSEB semble être considéré comme le
document de référence par le MENAPLN et ses partenaires
techniques et financiers. Le PSEF est rarement évoqué dans les
documents de planification opérationnelle.
L'engagement de l'Etat burkinabè dans la quête
d'une éducation pour tous a eu un écho favorable sur l'ensemble
du territoire. Les indicateurs d'accès et de couverture ces
dernières années portent à croire que l'objectif de
l'éducation pour tous à l'horizon 2030 (Objectifs de
Développement Durable) pourrait être atteint. En effet, les taux
d'accès et de scolarisation ont connu des évolutions
remarquables. Le graphique ci-dessous indique l'évolution du TBS entre
2013 et 2018
Figure 1: Evolution des taux de scolarisation au Burkina Faso
TBS au primaire, post primaire et secondaire
|
100
|
|
|
|
|
|
|
80
|
|
|
|
88,5
|
90,7
|
|
83
|
83,7
|
86,1
|
|
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
40
|
|
44,9
|
46,6
|
49
|
52
|
|
20
|
40,2
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
16,2
|
17
|
|
12,8
|
13,2
|
15
|
|
|
|
2013-2014
|
2014-2015 Primaire
|
2015-2016
Post primaire
|
2016-2017
Secondaire
|
2017-2018
|
Source : annuaires statistiques 2017-2018
primaire, post primaire et secondaire
8
Entre 2013 et 2018, le TBS, au primaire, a
évolué de 81,3% à 90,7%, avec un TAMA1 de
1,79%. Quant au post primaire, il a évolué de 36,7% à 52%
sur la même période, avec un TAMA de 5,28%. Le secondaire, avec
des taux nettement inférieurs aux taux des deux autres ordres
d'enseignement, a aussi vu son TBS passé de 13,9% à 17% sur cette
même période 2013 à 2018, avec un TAMA de 5,83%.
De façon générale, on peut constater
qu'entre 2013 et 2018, les TBS au Burkina Faso ont évolué de
façon croissante dans les trois ordres d'enseignement que sont le
primaire, le post primaire et le secondaire. Le secondaire enregistre
l'évolution la plus importante bien que les TBS dans cet ordre
d'enseignement restent les plus bas. Ces améliorations en matière
de scolarisation dans les trois ordres d'enseignement suscités seraient
la résultante des politiques d'éducation pour tous
engagées dans le PDDEB et le PDSEB et qui prend désormais en
compte le post primaire et le secondaire.
Malgré les efforts considérables
déployés par le Burkina Faso pour garantir le droit à
l'éducation pour tous, le système éducatif est
perpétuellement confronté à de nouveaux défis.
I.1.2) Les obstacles à l'éducation pour
tous
Au Burkina Faso, les taux brut de scolarisation de 2017-2018,
respectivement au primaire, post primaire et secondaire de 90,7% ; 52% et 17%
(voir graphique 1) permettent d'affirmer que malgré les efforts fournis
par l'Etat, les collectivités, les partenaires techniques et financiers
et les ménages, un nombre important d'enfants en âge d'être
à l'école et d'adolescents sont malheureusement hors des
structures éducatives. Ces taux brut de scolarisation permettent de
déduire qu'au Burkina Faso, jusqu'en 2018, plus de 9,3% des enfants dont
l'âge est compris entre 6 et 11 ans ne fréquentent pas le sous
cycle primaire. Ce taux est de plus en plus important lorsqu'on évolue
dans les cycles post primaire et secondaire. Il est de 48% au post primaire et
de 83% au secondaire.
Par ailleurs, les taux d'achèvement respectivement au
primaire, au post primaire et au secondaire en 2018 sont de 63%, 40,6% et 14,8%
(annuaire statistique, 2017-2018). Ces faibles taux d'achèvement
laissent percevoir une faible efficacité interne du système
éducatif car nombreux sont les enfants et adolescents qui
n'achèvent pas leur cursus scolaire.
1 Taux d'accroissement moyen annuel
9
Les raisons de la non scolarisation et/ou de la
déscolarisation des enfants au Burkina Faso sont légions. Pour
KONKOBO (2008), les causes de la non scolarisation ou de la
déscolarisation des enfants sont essentiellement d'ordre
économique et social. Il soutient que le faible revenu des parents
d'élèves conjugué aux coûts très
élevés de la scolarité constitue un facteur majeur de la
déperdition scolaire. Aussi, la mauvaise perception que certains parents
ont de l'école est source de déscolarisation. Cependant, un
phénomène nouveau vient s'ajouter à la liste des raisons
de la non scolarisation ou de la déscolarisation des enfants au Burkina
Faso. Il s'agit de la crise sécuritaire dans plusieurs localités
du pays. En effet, depuis l'année scolaire 2016-2017, l'école
burkinabè est la cible d'attaques terroristes récurrentes de la
part de groupes armés dans certaines régions du pays. Ces
régions à forts défis sécuritaires sont la
région du Nord, du Sahel, du Centre-Nord, de l'Est, de la Boucle du
Mouhoun et du Centre-Est. Cette situation a créé la psychose dans
le monde éducatif, entrainant l'interruption des activités
d'apprentissage, la fermeture et la destruction de plusieurs
établissements, la destruction du matériel, l'abandon
forcé des classes par les enseignants, la déscolarisation massive
des élèves ainsi que le déplacement des populations
à l'intérieur du pays. Cette nouvelle situation vient accroitre
le taux de déperdition scolaire au niveau national. Le ministre de
l'éducation national, de l'alphabétisation et de la promotion des
langues nationales, dans un point de presse en date du 15 février 2019
publié par le Service d'Information du Gouvernement (SIG) dans son
site
www.sig.bf, faisait la situation
des établissements fermés. En effet, à cette date, la
situation faisait ressortir 1135 établissements fermés
empêchant 154 233 élèves de jouir de leur droit à
l'éducation.
La menace qui pèse sur le monde éducatif dans ce
contexte d'insécurité a aussi fait l'objet d'une
déclaration de la Coordination Nationale des Syndicats de
l'Education(CNSE). En effet, la CNSE, dans sa déclaration du 06 Mars
2017 publiée par le site
news.aouaga.com, a informé
l'opinion de la situation sécuritaire délétère dans
les établissements d'enseignement de la région du sahel. Selon
ses informations,
L'école de Petèga dans le Département de
Diguel a reçu des visiteurs peu ordinaires le 25 janvier 2017 aux
environs de 16h. Armés et cagoulés, ils ont proféré
des menaces à l'endroit de l'enseignant qu'ils ont trouvé en lui
enjoignant d'enseigner désormais en arabe ou de quitter le village (
www.news.aouaga.com).
Aussi, le 31 janvier 2017 les écoles des villages de
Kouyé, de Goundoumbou et de Lassa dans le département de
Baraboulé reçurent la visite de ces individus avec pour
injonctions, l'enseignement
10
du coran et le port du voile par les enseignantes. En outre,
le vendredi 03 Mars 2017, les différentes menaces de ces hommes ont
été mises à exécution par l'assassinat de
l'enseignant Salifou Badini, Directeur de l'Ecole Primaire de Kourfayel dans
l'enceinte de son l'école.
Depuis l'incident de Kourfayel, beaucoup
d'établissements furent obligés de fermer les portes. Dans un
second communiqué de presse en date du 23 mai 2019 publié par le
SIG, le Ministre portait à nouveau à la connaissance de l'opinion
publique qu'à cette date, 1933 écoles étaient
fermées sur toute l'étendue du territoire burkinabè
laissant ainsi 326 152 élèves hors des structures
éducatives. Face à cette nouvelle situation, des mesures ont
été prises par l'Etat burkinabè afin que ces milliers
d'enfants et adolescents des zones d'insécurité puissent avoir
accès aux structures éducatives. Les plus illustratives sont
l'organisation, en 2017-2018, d'examens spéciaux au profit des candidats
du Nord et du Sahel et l'élaboration d'une stratégie nationale de
scolarisation des élèves des zones à forts défis
sécuritaires.
D'énormes efforts ont été consentis au
Burkina Faso pour assurer l'éducation pour tous. Cependant, il convient
de souligner que de nouveaux défis se présentent aux acteurs et
partenaires de l'éducation. Parmi ces défis figure en bonne
position la question de l'offre éducative en situation de crise
sécuritaire. Cette problématique retient notre attention pour
diverses raisons.
I.2) Justification du choix du thème de recherche
La décision d'étudier la question de la gestion
de l'éducation en situation de crise sécuritaire à travers
un mémoire de master est motivée par plusieurs raisons.
I.2.1) Les raisons personnelles
Nous exerçons dans le domaine de l'éducation et
nos obligations professionnelles consistent à mettre les
élèves dans des meilleures conditions d'apprentissage. Cela
implique la création d'un climat favorable aux apprentissages mais aussi
la création d'un cadre d'échanges avec les différents
acteurs locaux de l'éducation afin d'atténuer les risques de
déperdition scolaire. Cependant, la crise sécuritaire que
traverse le Burkina Faso nous amène à constater avec impuissance
la fermeture de plusieurs établissements laissant des milliers
d'élèves hors des structures éducatives. La question que
nous nous sommes posée est la suivante: Quelle est la posture de la
communauté éducative endogène pour sauver la
scolarité de ces enfants et adolescents qui fuient les zones
d'insécurité?
11
Certes, la scolarisation de ces enfants est un défi
à relever au niveau étatique mais il faut également une
mobilisation sociale pour accompagner l'action gouvernementale. Cette recherche
est alors pour nous, une occasion de voir de plus près la pratique des
acteurs et partenaires de l'éducation, à différents
niveaux de responsabilité, pour la quête d'une éducation
pour tous. Cela nous permettra ainsi de mettre concrètement en pratique,
sur notre lieu de travail, des connaissances techniques appropriées et
d'adopter de nouvelles techniques et habitudes de planification.
I.2.2) Les raisons politico-éducatives
Il convient de noter que d'énormes efforts sont
consentis par l'Etat burkinabè, les collectivités territoriales
et les partenaires techniques et financiers dans le domaine de
l'éducation ces dernières décennies. Ces efforts ont
permis d'améliorer considérablement les données en
matière d'offre éducative. Cependant, la question
sécuritaire sape aujourd'hui les énormes efforts des acteurs de
l'éducation et les plans de résilience face à cette
nouvelle problématique sont peu définis dans la politique
éducative. Le Ministère de l'Education Nationale, de
l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN),
dans sa stratégie nationale de scolarisation des élèves
des zones à forts défis sécuritaires au Burkina Faso
2019-2024, mentionne que :
Grâce à la longue et relative période de
stabilité jusqu'en 2014, le pays n'a pas été
confronté à une crise humanitaire majeure, au-delà des
inondations du 1er septembre 2009 qui a quelque peu affecté le secteur
de l'éducation. La coordination des situations d'urgence n'est donc
qu'à ses débuts, même s'il existe des groupes sectoriels de
suivi de l'éducation en situation d'urgences entre-temps tombée
en léthargie mais réactivée en 2018 à la faveur de
la crise actuelle (SSEZDS, 2019).
Cette recherche pourrait donc contribuer à aider les
acteurs et utilisateurs des services éducatifs dans les prises de
décisions.
I.2.3) Les raisons scientifiques
Dans le champ universitaire, les travaux scientifiques
produits au Burkina Faso sur la question de l'éducation en situation de
crise semblent être rares. D'où l'intérêt d'une
meilleure appropriation de cette nouvelle problématique. Cette recherche
pourrait donc constituer « une propédeutique »
à toute recherche ultérieure au Burkina Faso sur la
problématique de l'éducation en situation de crise
sécuritaire.
12
L'éducation, en dépit de sa reconnaissance
universelle comme droit fondamental pour l'humanité, est mise en mal en
période de conflit armé. En effet, lorsqu'un Etat est
confronté à une situation de crise sécuritaire, il
rencontre le plus souvent des difficultés à garantir et
protéger les droits de l'Homme et particulièrement le droit
à l'éducation. Cela est dû au non-droit qui règne
dans ces zones de conflit, à savoir la destruction des infrastructures
et la désorganisation des ressources. Le développement d'un
programme scolaire qui répond le mieux possible aux besoins de la
population touchée par la crise est tout aussi vital dans un contexte
pareil. Il est donc important que des actions fortes et courageuses soient
entreprises afin de permettre aux enfants de continuer à
bénéficier de ce droit fondamental qu'est l'éducation.
Toutefois, SINCLAIR (2003, p. 30-31) affirme,
Aucune crise ne ressemble à une autre et il n'existe
pas de réponse miracle à ce type de situation. La solution doit
toujours être conçue au niveau local et s'appuyer sur une
évaluation participative des besoins afin d'atteindre les meilleurs
résultats le plus rapidement possible.
Notre question de recherche va donc s'intéresser aux
pratiques et sollicitations des acteurs endogènes de l'éducation
pour favoriser le maintien scolaire des enfants et adolescents
déplacés.
I.3) Questions, objectifs et hypothèses de
recherche
Nous déclinerons dans ce point la question principale
et les questions secondaires ; l'objectif général et les
objectifs spécifiques ; l'hypothèse principale et les
hypothèses secondaires.
I.3.1) Questions de recherche
La question principale qui oriente notre recherche se formule
comme suit : Dans quelles mesures les acteurs directs de
l'éducation en situation de crise sécuritaire mettent-ils en
oeuvre des pratiques efficaces pour la prise en charge scolaire des enfants et
adolescents déplacés dans la commune de Titao ?
Cette question principale suscite trois questions secondaires
:
? Quelles sont les dispositions organisationnelles,
matérielles et psychosociales prises par les administrations scolaires
au profit des enfants et adolescents déplacés dans la commune de
Titao?
> Quelles sont les activités pédagogiques et
socioéducatives conçues et pratiquées par les enseignants
et les animateurs de la vie scolaire au profit des enfants et adolescents
déplacés dans la commune de Titao ?
> Quelle est la contribution de la communauté locale
aux côtés de l'administration scolaire dans le cadre de la prise
en charge scolaire des enfants et adolescents déplacés dans la
commune de Titao?
I.3.2) Objectifs de recherche
Il s'agit pour nous, à ce stade, de définir
notre objectif général et les objectifs spécifiques. Notre
recherche vise à appréhender les efforts des acteurs directs de
l'éducation dans le sens de favoriser une prise en charge scolaire
adéquate des élèves déplacés dans la commune
de Titao.
De façon spécifique, il s'agit de :
> Découvrir et analyser la pertinence des actions
posées par les administrations scolaires d'un point de vue
organisationnel, matériel, psychosocial dans la prise en charge scolaire
des enfants et adolescents déplacés dans la commune de Titao.
> Rechercher et analyser les activités
pédagogiques et socioéducatives pratiquées par les
enseignants et les animateurs de la vie scolaire dans la prise en charge
scolaire des enfants et adolescents déplacés dans la commune de
Titao.
> Apprécier l'existence d'une mobilisation et un
engagement social en faveur de la prise en charge des élèves
déplacés dans la commune de Titao.
> Formuler des recommandations pour favoriser le maintien
scolaire des enfants et adolescents déplacés dans la commune de
Titao.
I.3.3) Hypothèses de recherche
Les hypothèses constituent des réponses
provisoires aux questions de recherche. Pour QUIVY et CAMPENHOUDT (2006)
cités par OUEDRAOGO (2016, p. 197), « un travail ne peut
être considéré comme une véritable recherche s'il ne
se structure autour d'une ou de plusieurs hypothèses. ».
Ainsi, il s'agira pour nous dans ce point, de définir
notre hypothèse principale et les hypothèses secondaires.
13
L'hypothèse principale qui sous-tend notre recherche est
la suivante :
14
Dans la prise en charge scolaire des élèves
déplacés dans la commune de Titao, les acteurs directs de
l'éducation mettent en oeuvre des pratiques efficaces en matière
d'éducation en situation de crise sécuritaire.
Cette hypothèse principale se décline en trois (03)
hypothèses secondaires :
? Les administrations scolaires prennent des dispositions
pertinentes du point de vue organisationnel, matériel et psychosocial en
vue d'assurer la continuité de la scolarisation des enfants et
adolescents déplacés dans la commune de Titao.
? Les enseignants et les animateurs de la vie scolaire
conçoivent et mettent en pratique des activités
pédagogiques et socioéducatives pertinentes et adaptées au
profit des enfants et adolescents déplacés dans la commune de
Titao.
? La communauté locale se mobilise et s'engage de
manière efficace et efficiente par des actions variées pour
soutenir l'administration scolaire dans une prise en charge des enfants et
adolescents déplacés dans la commune de Titao.
Les résultats de nos enquêtes nous permettront de
confirmer ou infirmer ces hypothèses en conclusion finale. En effet, il
s'agira pour nous de recueillir des informations auprès des acteurs
directs2 de l'éducation et d'autres personnes ressources et
de confronter ces informations. Cette confrontation nous permettra de mesurer
le degré d'application de mesures et initiatives individuelles et
collectives dans la prise en charge scolaire des élèves
déplacés ainsi que l'efficacité de ces mesures et
initiatives sur l'épanouissement des élèves
déplacés. La confirmation de nos hypothèses va se fonder
donc sur la reconnaissance des acteurs et bénéficiaires des
services éducatives de l'existence de mesures et initiatives de prise en
charge. Par ailleurs, la confirmation d'au moins deux hypothèses
secondaires nous permettra de valider l'hypothèse principale.
Il nous faut à présent aborder le cadre
conceptuel et la revue de la littérature afin de circonscrire le sujet
traité et d'élargir nos connaissances à travers les
écrits des auteurs qui se sont intéressés au même
champ de recherche.
2 Acteurs plus proches des bénéficiaires
des services éducatifs
15
CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE
LA
LITTERATURE
Ce chapitre aborde trois points. Il s'agit de la clarification
des concepts, des théories de référence et la revue
critique de la littérature.
II.1) Clarification des concepts
Afin de mieux comprendre d'entrée de jeu le sens de
notre thème d'étude, une clarification conceptuelle
s'avère nécessaire. Selon QUIVY et CAMPENHOUDT (1995), «
sans la conceptualisation, la recherche se perd dans le flou,
l'imprécision et l'arbitraire». Ainsi, dans ce sous chapitre,
nous éluciderons quelques concepts indispensables à la
compréhension de notre discours. Il s'agit notamment des concepts crise
; éducation ; éducation en situation de crise ; gestion de
l'éducation ; activités pédagogiques et
socioéducatives ; prise en charge ; dispositions organisationnelles ;
dispositions matérielles ; dispositions psychosociales ; mobilisation
sociale et engagement social.
? Education en situation de crise
Avant toute définition, il convient de préciser
que le concept « Education en situation de crise » couvre plusieurs
appellations qui renvoient à une même réalité. Dans
les documents que nous avons consultés, il est parfois fait usage de
« Education en situation d'urgence », « Education en situation
de crise » ou « Education en situation de post-crise ». Pour la
présente recherche, le concept « Education en situation de crise
» sera utilisé. Mais essayons d'abord une définition des
termes « éducation » et « crise ».
Selon Georges ROCHE (2002), le terme « éducation
» vient du latin educare qui signifie d'abord tirer du sein de la
mère, puis amener à, élever. L'éducation est
à la fois le processus de développement des facultés
morales, physiques et intellectuelles et le résultat de ce processus. E.
DURKHEIM, quant à lui, la définit « comme l'action
exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont
pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objectif de susciter et
de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques,
intellectuels et moraux que réclame de lui et la société
politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est
particulièrement destiné ». Cette définition
donnée par Durkheim met en exergue les exigences de la
société sur le
16
comportement de l'individu, en tant que membre de cette
société, sans toutefois s'intéresser aux aptitudes
personnelles qu'il pourrait développer. Cependant, la Ligue
Internationale d'Education Nouvelle, citée par MIALARET (1976, p.5),
estime que
L'éducation est un processus qui « consiste
à favoriser le développement aussi complet que possible des
aptitudes de chaque personne, à la fois comme individu et comme membre
d'une société régie par la solidarité.
L'éducation est inséparable de l'évolution sociale ; elle
constitue une des forces qui la détermine ... ».
Cette définition donnée par la Ligue
Internationale d'Education Nouvelle nous semble plus démocratique car
elle met en congruence les intérêts individuels de l'être et
celles de la société.
Le mot « crise » quant à lui, est un terme
polysémique employé dans une multitude de domaines tels que
l'économie, la politique, la justice etc. Selon Le Robert, le terme
« crise » vient de l'étymon grec krisis, qui signifie
«décision » c'est-à-dire une réponse à
une situation particulière. Charles F. Hermann cité par YACOUBI
(2014) définit la notion de « crise » comme « une
situation qui menace les buts essentiels des unités de prise de
décision, réduit le laps de temps disponible pour la prise de
décision, et dont l'occurrence surprend les responsables».
C'est dire alors qu'une crise est un ensemble de difficultés qui affecte
négativement la bonne marche d'une situation jugée normale.
Cependant, LAGADEC(1991) pense que toute difficulté ne doit pas
être assimilée à une crise. Mais, c'est au moment où
les fonctions spécialisées dans la résolution de la
difficulté ne sont plus à mesure d'assurer le retour à la
situation normale qu'on parle de crise. L'on pourrait donc caractériser
la situation d'insécurité que traverse le Burkina Faso comme une
crise sécuritaire car les structures habilitées à assurer
la sécurité des biens et des personnes ne sont plus en mesure
d'atteindre leurs objectifs dans certaines localités du pays. Par
conséquent, des populations se déplacent pour rejoindre des zones
plus sécurisées. Nous pouvons dès à présent
envisager une définition du concept « Education en situation de
crise ».
Le Réseau Inter-agences pour l'éducation en
situations d'urgence (INEE) décrit l'éducation en situation de
crise comme :
une opportunité pour un apprentissage de qualité
à tout âge dans des situations de crise; y compris le
développement de la petite enfance, l'instruction primaire, secondaire,
non formelle, technique, professionnelle, supérieure et pour les
adultes, qui offre une protection physique, psychosociale et cognitive,
permettant de maintenir et sauver des vies (INEE, 2012).
17
Elle est envisagée à la fois comme un outil de
protection des enfants contre toutes formes d'exploitations et comme un
dispositif essentiel pour répondre aux besoins psycho-sociaux des
enfants et véhiculer des messages de paix et de réconciliation
(MAGALI, 2010). Par ailleurs, Save the Children dans son guide pour
l'éducation en situation d'urgence donne la définition suivante :
« un ensemble d'activités conceptuelles permettant aux
apprenants de continuer à s'instruire de manière
structurée, même dans des situations d'urgence, de crise ou
d'instabilité à long terme » (Save the Children, 2007).
Ainsi, nous pourrions, à la lumière de cette définition
dire que l'éducation en situation de crise est perçue comme un
effort supplémentaire fourni par les acteurs et les partenaires de
l'éducation afin de maintenir les enfants et les adolescents dans des
structures éducatives malgré la situation de crise.
? Gestion de l'éducation
Les définitions de la gestion varient selon les
auteurs. Pour TERRY et FRANKLIN (1985, p. 4), la gestion est « un
processus spécifique consistant en activités de planification,
d'organisation, d'impulsion et de contrôle visant à
déterminer et à atteindre des objectifs définis
grâce à l'emploi d'êtres humains et à la mise en
oeuvre d'autres ressources ». La définition de BERGERON (1984,
p. 91) semble se rapprocher de celle de TERRY et FRANKLIN. Pour lui, la gestion
est « un processus par lequel on planifie, organise, dirige et
contrôle les ressources d'une organisation afin d'atteindre les buts
visés ». Cependant, LASSEGUE et MEYER donnent chacun une
définition restrictive du terme gestion. Pour LASSEGUE (1993, p.197) la
gestion est « la réalisation d'objectifs par l'intermédiaire
d'autres personnes ». Quant à MEYER (1978, p. 68), la gestion est
définie au sens strict comme « la mise en oeuvre, par un
responsable, des ressources qui lui sont confiées, en vue d'atteindre,
en respectant certains nombres de règles, l'objectif pour lequel ces
ressources ont été mises en place ».
De ces différentes définitions, nous retenons
que pour certains auteurs, la gestion commence à partir de
l'élaboration du plan jusqu'à sa mise en oeuvre.
C'est-à-dire que la gestion englobe la planification. Pour d'autres
auteurs, par contre, la gestion se limite à la mise en oeuvre d'un plan
précédemment élaboré. Dans la présente
recherche, nous nous alignons derrière LASSEGUE et MEYER pour qui la
gestion se limite à l'exécution d'un plan en vue d'atteindre des
objectifs fixés. Par conséquent, la gestion de l'éducation
serait l'exécution d'un plan dans le secteur de l'éducation en
vue d'améliorer l'efficacité interne et externe d'un
système éducatif ou d'un sous-secteur de
18
l'éducation. Cette gestion est d'ordre administratif
mais prend aussi en compte les activités pédagogiques et
socioéducatives. (BERGERON-VACHON, 2014)
? Activités pédagogiques et
socioéducatives
Selon le Dictionnaire Le Larousse, une activité est un
ensemble d'actes coordonnés et des travaux de l'être humain, ou
une faction spéciale de cet ensemble. C'est aussi un ensemble de
phénomènes psychiques et physiques correspondant aux
activités de l'être vivant, relevant de la volonté, des
tendances, des habitudes, de l'instinct. Dans le cadre scolaire,
les activités sont des moyens d'action, des actes
quotidiens, mis en exergue par le formateur ou le facilitateur et
exécutés par les apprenants en interactions avec le guide ou des
pairs, pour obtenir un changement souhaité, défini d'avance par
un objectif opérationnel à court terme, un objectif
général à moyen terme ou un but à plus ou moins
long terme ; dans un programme ou un cycle de formation » (OKONGO,
2009).
De ce point de vue, les activités dites
pédagogiques ont un caractère obligatoire et sont soumis à
une évaluation sommative qui permet à l'apprenant de progresser
dans son cursus scolaire. Quant aux activités socioéducatives,
elles n'ont pas un caractère obligatoire mais elles complètent
l'action pédagogique et répondent à diverses demandes
d'ordre sociocommunautaire. Selon les objectifs visés par la
présente recherche, ces activités sont donc susceptibles d'avoir
un caractère plus particulier dans un contexte de prise en charge
d'élèves déplacés pour cause
d'insécurité.
? Prise en charge
Selon le Dictionnaire Le Robert, l'expression « prise en
charge», a le sens de prendre quelqu'un sous sa responsabilité,
d'assurer son entretien, ses dépenses. Cette définition semble
avoir une connotation financière. Pour BARTHOLD (2009), la prise en
charge est l'ensemble des procédés ou des stratégies
utilisés par une personne ou une institution pour satisfaire les besoins
d'une personne ou d'un groupe. Il est question, dans cette étude, de la
satisfaction des besoins scolaires des élèves
déplacés pour cause d'insécurité. La satisfaction
de ces besoins nécessite des dispositions qui sont d'ordre
organisationnel, matériel et psychosocial.
? Disposition organisationnelle
Selon le dictionnaire Le Robert, le terme « disposition
» renvoie à l'action de disposer, de mettre un certain ordre. Il
peut être utilisé au pluriel pour désigner les moyens et
précautions par lesquels
19
on se dispose à quelque chose. Dans l'expression «
prendre des dispositions », l'on aperçoit l'action d'adopter des
mesures, de faire des préparatifs en vue d'atteindre un objectif
précis. Une disposition organisationnelle serait donc un arrangement
organisationnel ou en d'autres termes, une coordination d'activités en
vue d'atteindre plus efficacement des objectifs fixés. Lorsque nous nous
situons dans le contexte de notre étude, il s'agit de voir tout ce qui
est entrepris en termes de coordinations d'actions pour faciliter d'une part le
travail du personnel éducatif dans la prise en charge des
élèves déplacés et d'autre part pour créer
les conditions favorables à leur(les élèves
déplacés) intégration ou réintégration
scolaire. Il s'agit concrètement de soumettre à une analyse, les
mesures de sécurité dans les structures éducatives, les
conditions d'accueil des élèves et des acteurs et la
capacité de ces acteurs à gérer des questions
spécifiques telles que la prise en charge des élèves
déplacés.
? Dispositions matérielles
Le matériel est l'ensemble des objets ou des
instruments utilisés dans une exploitation. En admettant la
définition donnée au terme « dispositions » dans le
point précédent, nous déduisons que l'expression «
dispositions matérielles » fait donc allusion à une
organisation des instruments nécessaires à la conduite d'une
activité. Dans le cadre de notre étude, il s'agit de
l'organisation des instruments nécessaires à la conduite des
activités pédagogiques et socioéducatives. Il est par
ailleurs important de rappeler que l'utilisation de l'expression «
organisation des instruments» dans ce contexte précis impose deux
interprétations. Il s'agit d'une part de l'acquisition du
matériel et d'autre part, sa mise à la disposition des usagers
que sont le personnel éducatif et les élèves.
? Dispositions psychosociales
Selon le Robert, l'adjectif « psychosocial »
désigne ce qui se rapporte à la psychologie humaine dans la vie
sociale. La psychologie humaine dans la vie sociale se centre sur l'individu
dans un groupe, des relations qu'il entretient avec le groupe ou bien de son
attitude et de ses représentations envers le groupe. Les dispositions
psychosociales dans le cadre de notre étude seraient donc une
préparation à une prise en charge des élèves
déplacés en vue d'une intégration adéquate dans
leur nouvel environnement scolaire. Cette prise en charge a lieu dans deux
domaines d'activités pouvant s'entremêler. Il s'agit d'une part de
l'interprétation du comportement de l'individu et d'autre part de
l'intervention qui recouvre l'information, la motivation, les conseils et
l'aide. Selon le Guide de
20
formation de base sur l'appui psychosocial en milieu scolaire
de l'Unicef (2011, p.5), ces actions doivent contribuer à :
- chasser chez les élèves le stress,
l'anxiété, la peur, la méfiance, les
préjugés, l'agressivité verbale et physique,
l'intolérance, le repli sur soi;
- développer chez les élèves des
sentiments et des comportements de responsabilité, de cohésion,
de confiance, de solidarité, de paix et de tolérance ;
- faire de l'école un milieu convivial, sain et protecteur
pour les filles et les garçons.
? Mobilisation sociale
Selon RAKOTOVOLOLONA (2008), la mobilisation sociale est un
processus qui utilise la communication pour rassembler un grand nombre de
personnes autour d'une action afin d'atteindre un objectif social commun
grâce aux efforts et aux contributions de tous. En d'autres termes la
mobilisation sociale met l'accent sur le rassemblement d'une communauté
autour d'un but commun dans un temps donné. Elle revêt une
importance capitale en matière d'éducation et surtout en contexte
d'éducation en situation de crise. En effet, l'éducation par
définition recommande une mobilisation qui se veut sociale autour de
l'enfant afin de l'inculquer les valeurs de cette société
à laquelle il va appartenir. Par ailleurs, l'affaiblissement de
l'appareil étatique en période de crise sécuritaire
(MACHEL, 1996) renforce davantage la nécessité d'une telle
mobilisation. La mobilisation sociale, dans le cadre de notre étude,
comprend toutes les activités de prise en charge, de sensibilisation, de
formation et d'animation permettant aux communautés de jouer pleinement
leurs rôles et responsabilités dans le sens d'accompagner les
acteurs éducatifs dans la prise en charge scolaire des
élèves déplacés.
? Engagement social
BERGERON-VACHON(2014) définit l'engagement social comme
le croisement des identités personnelles et collectives de personnes
impliquées dans une mobilisation sociale. Pour ION (2012), c'est une
forme de dialogue individuel et collectif. Il s'agit pour l'individu de
s'associer à une action collective sans renoncer à être
soi-même. L'engagement social implique donc une conviction et un
dévouement personnel de l'individu pour la défense d'une cause
commune orientée vers la quête d'une justice sociale. Il ne peut
donc y avoir de mobilisation sociale sincère
21
sans un engagement social. La prise en charge scolaire des
enfants déplacés ne saurait être une réussite sans
un engagement social.
II.2) les théories de référence
Notre souci dans ce sous-point est d'identifier des
théories sociologiques sur lesquelles la gestion de l'éducation
en situation de crise s'adosse pour orienter ses actions. Ainsi,
l'incrémentalisme, la théorie du capital humain et la
pédagogie différenciée ont été retenues pour
cette étude.
II.2.1) La théorie incrémentaliste de la
planification
L'origine de l'incrémentalisme est le plus souvent
associée aux travaux de Charles E. Lindblom, « The Science of
Muddling Through » parus en 1959. En effet, se fondant sur le concept de
rationalité limitée de l'être humain dans son anticipation
du futur (SIMON, 1955) cité par (Ba, 2019), la théorie
incrémentaliste considère l'activité de planification
moins comme la conception d'un plan-document formel qu'un « processus
itératif marqué par des ajustements continus suivant les
aléas de l'action » (QUINN, 1982). En d'autres termes, les
évènements imprévisibles qui surviennent dans
l'exécution d'un plan ne permettent pas d'anticiper les
réalisations futures. Ils imposent donc à l'organisation une
révision permanente des ambitions de départ. Dans cette
perspective la théorie incrémentaliste se caractérise par
sa souplesse et ses actions se déroulent de manière
itérative jusqu'à l'atteinte des objectifs visés. A ce
titre, les plans sont soumis à des changements imperceptibles par
l'adaptation progressive et continue de ses processus opérationnels.
Bien que notre champ d'étude soit la gestion de
l'éducation en situation de crise, nous évoquons cette
théorie de la planification qui, de par son fondement, nous rapproche
plus de la gestion du point de vue de TERRY(1985) pour qui la gestion est
« un processus spécifique consistant en activités de
planification, d'organisation, d'impulsion et de contrôle visant à
déterminer et à atteindre des objectifs définis
grâce à l'emploi d'êtres humains et à la mise en
oeuvre d'autres ressources ». Dans la pratique quotidienne en
matière d'éducation en situation de crise, les acteurs de
l'éducation tentent toujours de s'adapter à la
réalité du terrain et aux besoins des bénéficiaires
de l'action éducative. Le gestionnaire ne saurait donc se contenter d'un
plan préétabli même si ce plan constitue une boussole pour
ce dernier.
22
Si la théorie incrémentaliste s'intéresse
à la gestion opérationnelle de l'éducation dans le
contexte de notre étude, la théorie du capital humain aborde un
aspect de la légitimité de l'éducation qui requiert la
mobilisation et l'engagement de toute la communauté.
II.2.2) La théorie du capital humain
Le capital humain peut se définir comme un ensemble
d'aptitudes, de connaissances et de qualifications que possède chaque
individu. Il se définit, selon l'OCDE (Organisation de
Coopération et de Développement Economique), comme «
l'ensemble des connaissances, qualifications, compétences et
caractéristiques individuelles qui facilitent la création du
bien-être personnel, social et économique » (OCDE,
1998). Elle rajoute que « Le capital humain constitue un bien
immatériel qui peut faire progresser ou soutenir la productivité,
l'innovation et l'employabilité» (Ibid.,2001).
Samuelson et Nordhaus cité par FRAISSE-D'OLIMPIO (2009)
donnent ici une définition qui met en exergue le rôle de
l'institution scolaire dans le développement du capital humain. Ils
soutiennent que c'est le « stock de connaissances techniques et de
qualifications caractérisant la force de travail d'une nation et
résultant d'un investissement en éducation et en formation
permanente ». Le capital humain se développe en divers
occasions à travers l'acquisition de connaissances au sein de la
famille, les activités formelles d'enseignement et de formation, la
formation sur les lieux de travail et les connaissances acquises dans la vie
professionnelle et également à travers les acquis informels
OKACHA (2015).
Les origines de la théorie moderne du capital humain
remontent aux années 1960 avec Théodore Schultz et Gary Becker
à travers leurs analyses théoriques et empiriques des liens entre
l'investissement en capital humain et la rémunération des
travailleurs.
En effet, Schultz s'est intéressé à
l'économie du développement où il est parvenu à la
conclusion selon laquelle la formation et l'éducation constituent un
moyen essentiel pour améliorer la productivité et par ricochet la
rémunération du travailleur. En effet, pour atteindre le
développement, il faut investir dans le domaine de la formation et
l'éducation qui sont des sources de production et d'amélioration
du capital humain.
Gary Becker, quant à lui, il est le précurseur
de l'économie comportemental. Sa conviction est qu' « il est
possible d'évaluer les déterminants économiques qui
influencent, même de façon minime, l'ensemble des comportements
humains » (FRAISSE-D'OLIMPIO, 2009). Becker a imprimé
sa
23
marque dans la science économique en l'associant
à des champs longtemps réservés à la sociologie
telle que l'éducation et la formation. Il estime que chaque travailleur
possède un capital dont la source est de l'inné d'une part et de
la formation d'autre part. Becker est du même avis avec Schultz que
l'optimisation du capital humain passe nécessairement par un
investissement dans l'éducation et la formation. Par ailleurs, le
salaire étant considéré comme la
rémunération de l'investissement dans l'éducation, le
revenu du travailleur dépendra alors de l'importance de l'investissement
dans le développement de son capital humain.
L'aspect qui nous intéresse dans cette théorie
et qui affecte notre thème de recherche est la mobilisation et
l'engagement social autour de la question éducative.
Conscient que l'éducation contribue au développement
humain, à l'insertion de l'homme et à sa participation à
la vie sociale, la communauté bénéficiaire ne limite pas
son action à l'envoi des enfants à l'école mais elle
participe à l'effort d'éducation à travers un
investissement humain, matériel et financier. En dépit du
contexte sécuritaire délétère actuel et aussi de la
pauvreté des ménages, ceux-ci doivent supporter les
différents coûts liés à l'éducation et
à la formation des enfants. Mais ils semblent désormais
comprendre le bien-fondé de l'éducation et la formation des
enfants et s'y investissent davantage malgré les difficultés.
II.2.3) La pédagogie différenciée
Selon ROBBES (2009), c'est au début du XXe
siècle que Celestin Freinet s'inspire des expériences de Helene
Parkhurst, Carl Washburne et Robert Dottrens pour mettre en place des plans de
travail individuel. Cela dans le but « de permettre à des
élèves d'âges, d'aptitudes, de comportements, de
savoir-faire hétérogènes, mais regroupés dans une
même division, d'atteindre par des voies différentes des objectifs
communs, ou en partie communs » (Inspection générale de
l'Education Nationale, 1980). Il faudra cependant attendre jusqu'aux
années soixante-dix pour voir la généralisation de ces
pédagogies dites différenciées dans les écoles
françaises et ce, à partir de la création du
collège unique accueillant tous les élèves. La notion de
l'équité va alors avoir tout son sens dans le processus
d'enseignement-apprentissage. Il ne s'agira plus de mettre les
élèves dans les mêmes conditions de passation
d'épreuve, mais plutôt de gérer chaque élève
selon sa personnalité et son origine sociale. Des
expérimentations vont donc être conduites par des chercheurs au
cours des années soixante-dix afin de développer cette nouvelle
pratique
24
pédagogique. Le but étant de favoriser des
pratiques pédagogiques inclusives dans des classes à effectifs
hétérogènes. Les éléments
caractéristiques de l'hétérogénéité
des élèves à partir desquels s'organise la
pédagogie différenciée sont les différences
cognitives, psychologiques et socioculturelles des apprenants. En effet, les
apprenants ne peuvent en aucun cas avoir un même degré
d'acquisition des connaissances que l'institution scolaire exige. Aussi, chaque
apprenant a un vécu et une personnalité propre à lui dont
relève sa motivation, sa volonté, son attention, sa
créativité, sa curiosité, son énergie, son plaisir
en contexte d'apprentissage.
En dépit de toutes ces différences entre les
apprenants qui compliquent davantage l'action pédagogique, la
pédagogie différenciée se fonde sur le principe
d'éducabilité de l'être humain et de l'idéal
d'égalité des chances pour tous pour légitimer son
application.
Cette pédagogie dite différenciée serait
une aubaine pour les apprenants en contexte d'éducation en situation de
crise sécuritaire. L'éducation dans la ville Titao ces
dernières années, objet de la présente étude, est
un cas illustratif. En rappel, depuis les fermetures d'établissements
scolaires pour cause d'insécurité dans la province du Loroum, les
établissements de la ville de Titao accueillent un nombre important
d'élèves issus des établissements fermés. Ces
élèves déplacés arrivent non seulement avec un
retard de progression dans les programmes d'enseignement mais aussi subissent
un choc psychologique dû aux situations qu'ils ont vécues. Ils
sont, dans la majorité des cas, intégrés dans des classes
ordinaires où les élèves sont déjà en avance
dans les programmes d'enseignement. L'enseignement de ces élèves
nécessite une prise en charge particulière qui fait
nécessairement appel à la pédagogie
différenciée.
II.3) La revue de la littérature
La revue de la littérature consiste en un compte rendu
analytique des productions scientifiques (mémoires, thèses,
articles scientifiques et ouvrages généraux) qui se sont
intéressées à la question traitée, ici, celle de la
gestion de l'éducation en situation de crise. Nous optons de
présenter ce compte rendu en fonction des concepts clés
élucidés ci-avant. Ainsi, nous nous intéressons à
la genèse du concept « Education en situation de crise » ;
à l'impact des conflits sur l'éducation ; à l'offre
éducative en situation de crise ; à la planification de
l'éducation en situation de crise.
25
II.3.1) De la genèse du concept Education en
situation de crise
Dans leur article Education et conflit : Les enjeux de l'offre
éducatif en situation de crise, MAGALI et al. (2010) donnent un
aperçu sur les arguments qui ont motivé l'émergence et le
développement de l'éducation en situation de crise. Pour ces
auteurs, l'émergence de ce nouveau paradigme résulte de
l'ambition de la communauté internationale à atteindre
l'éducation pour tous. En effet, à partir des années 1980,
l'éducation a été d'office considérée par
les institutions internationales telles que la Banque Mondiale et le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), comme un indicateur de
développement humain. Par ailleurs, l'adoption en 1989 de la Convention
relative aux droits de l'enfant qui fait de l'éducation un droit
fondamental, a favorisé la mise en oeuvre de politiques de
développement du secteur de l'éducation à l'échelle
internationale.
Toutefois cet élan de développement de
l'éducation rencontrera des difficultés dans les pays en
développement. En effet, l'application des politiques d'ajustement
structurels dans les pays sous-développés, à la fin des
années 1980, conduira des Etats à réduire
considérablement la part de leurs budgets alloués au secteur de
l'éducation, considéré comme « non productif
».
Ainsi, à la faveur des assises juridiques qui font de
l'éducation un bien universel et de la « démission »
des Etats, les agences d'aide au développement se sont vue
obligées d'intervenir dans ce domaine pour le financer et proposer des
programmes d'intervention souvent imbriqués ou en marge des
systèmes déjà existant dans les pays
sous-développés. Les années 1990 et 2000 seront donc
marquées par des campagnes en faveur de l'éducation pour tous
à travers des conférences sur l'éducation telle que
Jomtien, Salamanque, Amman et Dakar. Aussi, les organisations de la
société civile sont mises à contribution, au nom de
l'approche participative, pour développer ce secteur qu'est
l'éducation (PETIT & COMHAIRE, 2010).
C'est dans cette nouvelle dynamique d'éducation pour
tous à l'horizon 2015 (Jomtien 1990), qu'un regard particulier est
accordé aux enfants vivant dans des zones de conflit ou atteints par des
catastrophes naturelles. Magali Chelpi-den Hamer précise que
l'expression « éducation en situation d'urgence » vit le jour
pour la première fois à la conférence d'Amman en 1996. Son
objectif était de concevoir des programmes spéciaux
d'éducation pour les enfants issus des zones de conflit ou de
catastrophe naturelle et qui n'ont pas accès aux structures
éducatives au même titre que les autres enfants.
26
Plusieurs auteurs se sont donc intéressés
à cette nouvelle problématique en l'abordant sous plusieurs
angles dont l'impact des conflits sur l'éducation, l'offre
éducative en situation de crise, la planification et la gestion de
l'éducation en situation de crise. Cependant, plus de deux
décennies après l'émergence du concept éducation en
situation de crise, certains pays et surtout les pays en développement
sont peu regardants sur la prise en compte d'actions préventives afin
d'atténuer l'impact d'une crise éventuelle sur leurs
systèmes éducatifs. Le Burkina Faso compte parmi ces pays car il
vient à peine de se doter d'une Stratégie Nationale de
Scolarisation des Elèves des Zones à forts Défis
Sécuritaires(SSEZDS) en février 2019.
II.3.2) Impact des conflits sur l'éducation
L'article 28 de la convention relative aux droits de l'enfant
consacre le droit à l'éducation. MACHEL (1996), dans son rapport
intitulé « Impacts des conflits armés sur les enfants
», donne quelques arguments qui légitiment la considération
du droit à l'éducation comme un droit fondamental. L'auteure
estime que l'éducation structure la vie des enfants et peut inculquer
des valeurs communautaires ; promouvoir la justice et le respect des droits de
l'homme et favoriser la paix ; la stabilité et l'indépendance.
Cependant, en période de conflit, beaucoup de risques pèsent sur
l'éducation. L'auteure dépeint donc dans son rapport, l'impact
des conflits sur les systèmes éducatifs.
Machel soutient qu'en période de conflit, les
écoles constituent une cible privilégiée pour certains
combattants. «Dans les régions rurales, l'école est
souvent le seul bâtiment permanent de quelque importance, et c'est
souvent elle qui est bombardée, fermée ou pillée la
première ». Aussi, le personnel enseignant, souvent
considéré à tort comme représentant de
l'administration centrale, est souvent pris pour cible. Ces perturbations ont
un coup sur la qualité de l'éducation. En effet, les enfants ne
sont plus à mesure de suivre un cursus scolaire normal du fait de
l'intermittence de l'offre éducative, de l'incapacité des
élèves de disposer de fournitures scolaires mais aussi et surtout
de l'installation d'un climat d'inquiétude qui ne favorise pas les
apprentissages. Par ailleurs, l'enfant, en plus d'être victime d'une
privation de bonne éducation, est exposé à un certain
nombre de dangers sociaux. Ils sont notamment recrutés comme soldats
avec toutes les déviances sociales que cela implique. Les filles, en
particulier, sont généralement sujettes à des violences
sexuelles. Par ailleurs, l'auteure affirme qu'en période de conflit, le
financement du secteur de l'éducation rencontre d'énormes
difficultés. En effet, le poids de l'investissement militaire
associé à une santé économique fragilisée
des Etats en conflit ne favorise pas l'investissement dans les domaines
27
sociaux comme l'éducation. Cet argument est soutenu par
PILAR ET GONZALO (1999) qui estiment que
Bien que les organisations d'aide humanitaire ne cessent
d'accroître leurs efforts et les budgets en faveur des
nécessités de base, l'éducation fait rarement partie des
priorités et subit en général la première des
restrictions budgétaires en temps de crise.
Dans sa brochure intitulée « Faire de
l'éducation en situation d'urgence une priorité au Burkina Faso
», Save the Children (2019) vient corroborer les propos de Machel sur les
effets néfastes des crises sécuritaires sur les systèmes
éducatifs. En effet, selon cette ONG3, au Burkina Faso,
l'éducation est devenue la principale cible des attaques armées,
après les forces armées de défense et de
sécurité. Cela a conduit à la destruction
d'établissements, de matériels scolaires et la fuite des
enseignants. Ainsi, en février 2019, la seule région du sahel
enregistrait plus de 550 écoles du primaire et du secondaire
fermées. L'étude fait également état d'une
insuffisance d'infrastructures d'accueil de la population scolaire
déplacée, du manque de personnel qualifié pour une prise
en charge adéquate des élèves déplacés.
Si l'école est considérée comme une
victime en période de crise sécuritaire, il convient de noter que
certains auteurs trouvent en lui le germe déclencheur de certaines
crises. En effet, LANOUE (2007) appréhende l'impact des conflits sur
l'éducation comme une riposte à une injustice longtemps
cultivée par l'institution scolaire. Pour lui, les systèmes
éducatifs hérités du système colonial, très
élitiste, ne favorisent pas l'ascension sociale des couches
défavorisées. Ainsi, le ciblage des édifices scolaires
serait une façon de rendre justice. « En Côte d'Ivoire, au
plus fort de le crise de novembre 2004, les jeunes patriotes, miliciens
pro-gouvernementaux ont pillé et incendié, à Abidjan et en
d'autres villes du sud, des lycées et des écoles
françaises ».
Les études réalisées par ces trois
auteurs mettent en exergue les défis auxquels font face les
autorités éducatives et les acteurs locaux pour assurer la
continuité de l'offre éducative en période de conflits
armés. Ils nous interpellent implicitement sur le devoir de chacun pour
relever ces défis. Ces défis sont d'une part la
réhabilitation des infrastructures éducatives, la
sécurisation des domaines scolaires, l'acquisition de nouveaux
matériels, la gestion du personnel enseignant et administratif et
d'autre part l'encadrement des élèves. La présente
recherche s'inscrit dans une
3 Organisation Non Gouvernementale
28
perspective de description et d'analyse des pratiques en
matière de gestion de l'éducation en situation de crise. Mais une
telle étude ne peut se mener sans au préalable s'imprégner
de ces dégâts causés par la crise sécuritaire et ce
que cela implique comme nouveaux besoins pour le personnel éducatif et
les apprenants, d'où l'intérêt pour nous d'évoquer
l'impact des crises sur l'éducation.
Faces aux multiples difficultés rencontrées par
les Etats pour assurer l'offre éducative en situation de crise, diverses
initiatives se développent par différents acteurs et partenaires
pour accompagner ces Etats dans le souci d'assurer la continuité de
l'offre éducative dans les zones de conflit ou à la
périphérie de ces zones.
II.3.3) Les pratiques en matière d'éducation
en situation de crise
MAGALI (2010) s'est intéressée au parcours
scolaire des réfugiés libérien en côte d'Ivoire.
Elle soutient que les agences internationales investies dans le champ de
l'éducation, dans le souci de préparer un retour éventuel
des réfugiés dans leur pays d'origine, ont été
favorables à l'implantation d'écoles de réfugiés
utilisant le programme d'enseignement du pays d'origine des
réfugiés. Toutefois, cette mesure est diversement
appréciée par les praticiens et bénéficiaires des
services éducatifs. En effet, les personnes en faveur des écoles
de réfugiés soutiennent l'argument selon laquelle
s'intégrer dans les écoles ivoiriennes impliquait automatiquement
un changement de langue de l'anglais au français. Toute chose qui
pourrait faire perdre aux enfants réfugiés leur capacité
à parler l'anglais et à conserver leur identité
culturelle. Aussi, certains enfants, du fait de leurs âges
avancés, étaient d'office inadmissible dans les écoles
ivoiriennes. Par ailleurs, le gouvernement ivoirien ne disposait pas assez de
structures éducatives pour accueillir tous les
réfugiés.
Si pour certaines personnes, le choix d'une école de
réfugiés s'avère obligatoire, d'autres familles de
réfugiés sont plus favorables à l'intégration dans
les écoles ivoiriennes. Ce choix, selon Magali, est lié au
degré d'intégration des réfugiés au sein de la
communauté hôte. En effet, bien avant le déclenchement de
la guerre civile au Libéria, ces deux peuples, ivoirien et
libérien, entretenaient de bonnes relations. Ainsi, du début de
la guerre civile à la fin des années 1980, la majorité des
réfugiés libériens ont été accueillis au
sein de la population ivoirienne.
En plus de ces deux possibilités de scolarisation, des
établissements ont été créés par des
promoteurs privés afin de répondre à certains besoins
spécifiques des réfugiés à savoir la scolarisation
en cycle secondaire qui n'est pas pris en charge par le HCR.
29
La diversité de l'offre éducative en situation
de crise présentée par Magali dans le cas ivoirien
intéresse également BAUJARD (2010) dans son article « Les
réfugiés au coeur d'une offre éducative multiple : Le cas
de Delhi (Inde) ». En effet, l'Inde a été depuis les
années 1960 une terre d'asile pour les tibétains, les birmans et
les afghans. Selon l'auteur, la diversité des origines des
réfugiés et la spécificité de leurs besoins en
éducation justifie la multiplicité de l'offre éducative.
Les réfugiés tibétains bénéficiaient d'un
système éducatif parallèle et inclusif, à la
différence du système scolaire de leur pays d'origine où
l'éducation était uniquement réservée aux moines.
La gestion est alors assurée par l'administration tibétaine en
inde, les organisations internationales et les soutiens individuels. Les
langues d'enseignement étaient l'anglais et le tibétain.
Cependant, l'enseignement, trop généraliste, ne répondait
pas au marché de l'emploi. Malgré cela, les parents s'y
attachaient au détriment de la formation professionnelle, jugée
peu valorisante.
Pour ce qui est des réfugiés afghans et birmans,
ils ne bénéficiaient pas d'un système scolaire
parallèle. En effet, par le truchement du HCR, ils étaient
intégrés dans les écoles indiennes. Toutefois,
l'accès à ces écoles exigeait la présentation d'un
certain nombre de documents tels que le « certificat de naissance »,
la « ration card »4, le « tribal certificate
»5, ce qui réduisait un peu la chance d'accès aux
écoles gouvernementales pour certains enfants qui ne disposent pas de
ces documents.
Dans cette même logique de proposition d'offres
éducatives selon les différents contextes de crises
sécuritaires, SANCHEZ-MAZAS et al (2018) explorent la situation des
réfugiés sur le sol Suisse. Dans l'article intitulé «
Scolarisation des enfants de demandeurs d'asile: nouvelles pratiques, nouveaux
dispositifs, nouveaux « métiers » sous le signe de
l'incertitude », ces auteurs montrent l'engagement des acteurs locaux dans
la prise en charge scolaire des enfants de réfugiés et ce,
malgré les multiples difficultés que rencontre l'institution
scolaire. En effet, la politique Suisse en matière d'asile demeure
très restrictive. Toutefois, l'institution scolaire s'efforce d'assurer
l'éducation des enfants de demandeurs d'asile. Cette dichotomie, entre
le manque de volonté politique dans l'accueil des demandeurs d'asile et
le devoir de l'institution scolaire dans la scolarisation des enfants
(Convention internationale sur les Droits de l'Enfant de 1989, ratifiée
par
4 Document délivré par le
gouvernement indien et permettent d'obtenir de la nourriture et des produits de
première nécessité à des prix réduits.
5 Document certifiant l'origine birmane des
réfugiés à cause de leur ressemblance physique avec les
indiens du nord-est
30
la Suisse en 1997), rend difficile l'action pédagogique
des acteurs de l'éducation. Mais selon Sanchez-Mazas et al, en
dépit des difficultés rencontrées par l'institution
scolaire, des initiatives endogènes sont développées pour
permettre aux enfants d'asile de bénéficier du droit à
l'éducation. Parmi ces initiatives existe « le tandem
d'enseignantes de classes d'accueil » qui est une méthode mise en
place pour favoriser un suivi efficace des enfants d'asile. Il s'agit d'actions
coordonnées par deux titulaires de classes qui accueillent des enfants
d'asile. En effet, au regard des multiples trajectoires scolaires des
élèves, ces enseignantes les faisaient passer d'une classe
à une autre au bout d'une semaine ou d'une journée et ce, en
fonction de la progression et des besoins de l'élève. Elles se
concertent régulièrement avec la directrice afin de suivre
l'évolution scolaire des enfants. Aussi, la spécificité
des besoins de ces élèves à conduit les enseignantes
à assurer à la fois le rôle d'enseignante, de travailleuse
sociale et d'animatrice.
Si d'une part, le personnel exerçant en milieu scolaire
entreprend des initiatives pour satisfaire les besoins spécifiques des
enfants de demandeurs d'asile, Sanchez-Mazas et al notent par ailleurs que la
spécificité de leurs besoins nécessite l'engagement
d'intervenants volontaires. Ainsi, les jeunes engagés pour le service
civil sont, depuis juillet 2016, sollicités pour le soutien à la
formation et à l'éducation scolaire. Ils ne tiennent pas de
classe mais constituent des agents de liaison entre l'école et les
familles des élèves. Par ailleurs, ils prennent en charge des
activités para et périscolaires qui, aussi, participent à
l'éducation des élèves. Les propos ci-après d'un
« civiliste » témoignent de leur importance au
côté des enseignants :
J'essaye de comprendre pourquoi, comment, parce c'est vrai que
parfois on a des enfants qui n'ont jamais été scolarisés,
donc en classe ils sont complètement perdus, ils font tout et n'importe
quoi. Donc forcément, c'est moi qui vais vers les parents et qui demande
: qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que parfois c'est un peu
délicat, parce que des familles ont traversé des périodes
difficiles, avec des guerres ou des choses comme ça. C'est à moi
de poser des questions de temps en temps pour que l'enseignant comprenne
pourquoi l'enfant est comme ci ou comme ça ».
Par ailleurs, l'auteur soutient que le travail du civiliste
« est une forme de bricolage pour pallier le manque de ressources
institutionnelles.
Egalement, Sanchez-Mazas et al mentionnent l'existence de
« l'éducateur-migrant » qui joue le rôle du
grand-frère sur le chemin de l'école. Il accompagne, joue et
veille à la sécurité des mineurs. Il est par la même
occasion, l'interlocuteur entre l'école et la famille. Aussi,
existe-t-il les « tuteurs associatifs » qui apportent un soutien
extrascolaire aux enfants migrants et à leurs familles. Par ailleurs,
ils facilitent l'intégration sociale des enfants en mettant en exergue,
dans leurs activités,
31
les codes culturels et scolaires du pays d'accueil. Cela
sous-entend que le tuteur associatif soit imprégné de la culture
du pays d'origine de l'enfant migrant.
Ces différents auteurs susmentionnés se sont
plus appesantis sur la prise en charge scolaire des enfants ayant le statut de
réfugié. Dans cette prise en charge, différentes offres
éducatives se conjuguent au bénéfice des demandeurs
d'asile. Par ailleurs, la prise en charge scolaire des enfants et adolescents
réfugiés ressemble toujours à un système de
bricolage afin de répondre à un besoin urgent. La
réalité de la gestion de l'éducation en situation de crise
au Burkina et particulièrement dans la commune de Titao ne saurait
déroger à cette logique de multitude d'offres éducatives
et de bricolage. Toutefois, on pourrait souligner le changement de contexte. En
effet, la grande majorité des personnes déplacées sont
internes et viennent des communes voisines (Banh, Sollé et Ouindigui) ou
de provinces voisines comme le Soum. Le rapprochement des communautés
résidentes et déplacées serait un atout en terme
d'intégration car elles partageaient déjà certaines
réalités socioculturelles. Par ailleurs, à la faveur du
redéploiement6 du personnel de l'éducation des zones
d'insécurité, les besoins en enseignants et personnel
administratif pourraient être satisfaits et constituerait un atout pour
la prise en charge des élèves déplacés.
Ces études présentent donc beaucoup
d'intérêt pour notre recherche. Elles invitent à une
synergie d'actions dans cette gestion de l'éducation en situation de
crise. C'est justement dans l'optique d'appréhender cette synergie
d'actions que notre étude cherche à découvrir et analyser
les efforts des acteurs locaux dans la prise en charge des élèves
déplacés dans la commune de Titao.
II.3.4) La planification de l'éducation en situation
de crise
SINCLAIR (2003) dans son ouvrage « Planifier
l'éducation en situation d'urgence et de reconstruction »,
commandité par l'Institut Internationale de Planification de
l'éducation (IIPE), s'intéresse à l'éducation des
populations victimes de crise ou de catastrophe naturelle. Elle appelle toutes
les organisations engagées dans l'aide à ces populations à
faire de leur accès à l'éducation une priorité. Par
ailleurs Sinclair propose, aux organismes et aux planificateurs de
l'éducation, des orientations pour la planification de
l'éducation dans de telles circonstances. En effet, l'auteure
décline les principes de l'éducation en situation de crise qui
par définition ne diffère pas des
6 En 2019 et 2020, le MENAPLN a procédé
à la réaffectation de son personnel issu des
établissements scolaires fermés
32
principes d'éducation en situation normale. Cependant,
en situation de crise, « ils revêtent une importance
particulière » qui est « d'ordre procédurale
». En effet, les organismes humanitaires qui se chargent de soutenir
l'éducation en situation de crise sont financés par divers
bailleurs de fonds. Il importe donc que les fonds alloués soient
utilisés de façon rationnelle afin de mériter la confiance
des bailleurs. Aussi, est-il essentiel de prendre en compte, dans les
programmes, les besoins spécifiques des populations victimes de la
situation de crise. Cela nécessite, sans condition, l'implication des
acteurs endogènes dans l'élaboration des plans d'actions. Par
ailleurs, elle précise que les planificateurs de l'éducation en
situation de crise sont toujours confrontés à des contraintes de
temps. L'urgence ici commande des actions ponctuelles et bien mesurées.
D'ailleurs, la planification à court terme constitue une des
conditionnalités des bailleurs de fonds (SINCLAIR, 2003).
Les principes de l'éducation en situation de crise dont
parle Sinclair sont notamment l'accès à l'éducation, les
ressources, les activités et programmes scolaires, la coordination et le
renforcement des capacités.
? De l'accès à l'éducation en
situation de crise
Favoriser l'accès à l'éducation en
période de crise revêt une importance capitale. En effet,
au-delà de faire de l'enfant ce que la société exige de
lui demain (DURKHEIM, 1922), l'éducation en situation de crise est un
cadre de protection de l'enfant et peut contribuer au retour de la paix. Aussi,
constitue-t-elle une thérapie contre les conséquences
psychologiques subis par les populations déplacées. Elle pourrait
par ailleurs soulager les parents d'enfants déplacés lorsque
l'Etat, les partenaires sociaux et la population endogène en fait une
cause commune. Ainsi, l'accès à l'éducation en situation
de crise requiert des efforts supplémentaires quant au
déploiement des enseignants, au recrutement de volontaires et à
leur formation, à la disponibilité d'abris
sécurisés, de fournitures scolaires et de matériel
pédagogique. Par ailleurs, il est important d'avoir un regard
particulier sur les obstacles pouvant empêcher l'accès des enfants
aux structures éducatives.
? Les ressources humaines et les
activités
L'éducation de manière générale et
en particulier l'éducation en situation de crise ne saurait être
l'apanage de l'Etat et des organisations d'aide humanitaire seules. La
communauté endogène doit
33
s'impliquer activement dans la gestion en vue de l'atteinte de
résultats probants. Cette approche est d'ailleurs encouragée par
les grandes institutions d'aide. En effet, Une bonne gestion scolaire
dépend, en grande partie, de la participation active et créative
des acteurs directs, de la collaboration et du travail en équipe, afin
de satisfaire les besoins des élèves (Déclaration de
Salamanque, 1994). Pour SINCLAIR (2003), la communauté locale pourrait
initier des clubs d'activités pour les jeunes, mettre en place une
formation sur l'organisation et le financement d'activités au profit des
jeunes, proposer des enseignants et autres acteurs volontaires au sein de la
communauté touchée par la crise. Il est par ailleurs important de
renforcer les capacités des acteurs déjà sur le terrain.
Cela se traduit par des formations continues du personnel d'éducation
sur la prise en charge efficace des enfants déplacés. Quant aux
activités pédagogiques et éducatives
bénéfiques en situation de crise, Sinclair mentionne les
activités récréatives, d'expression, d'éducation
à la résolution de conflits, d'éducation à la
tolérance, d'éducation à la citoyenneté etc.
Prenant appuis sur ces orientations susmentionnées, les
autorités éducatives burkinabè, dans le cadre de la
scolarisation des enfants déplacés pour cause
d'insécurité, ont élaboré la
Stratégie de Scolarisation des Elèves des Zones à forts
Défis Sécuritaires(SSEZDS) au Burkina Faso. L'un des
défis majeurs de la SSEZDS est le maintien et continuité de
l'éducation dans les zones touchées par la crise
sécuritaire. Il s'agit de veiller à :
? assurer la réouverture des écoles
fermées là où les conditions sont réunies pour
assurer la reprise des cours au plus vite avec l'appui des
communautés;
? mener des campagnes de sensibilisation pour le retour des
communautés, des enseignants et des élèves ayant
déserté les zones touchées en coordination avec les
services compétents;
? développer des approches éducatives
adaptées à la situation : évaluation diagnostique, cours
de remédiation ou adoption de programmes accélérés
pour le rattrapage de deux à trois années d'enseignement selon
les cas ;
? poursuivre les efforts de réduction de la proportion
d'enfants en dehors de l'école (out of school) à travers des
approches reconnues efficaces comme la SSAP (Stratégie de scolarisation
accélérée/Passerelle)
? les écoles franco-arabes rénovées, les
foyers coraniques modernisés;
34
> renforcer les initiatives de prise en charge des enfants
en situation de handicap (ESH) et accélérer la scolarisation et
le maintien des filles qui constituaient déjà des cibles
défavorisées avant la crise;
> déployer des programmes d'appui psychosocial aux
personnes affectées avec une forte capacitation des enseignants à
mener des activités ludiques susceptibles d'aider les enfants à
évacuer le stress ;
> développer des initiatives de maintien du
personnel sur le terrain là où leur sécurité peut
être garantie avec l'appui des communautés à travers les
mesures de prévention et de préparation, l'utilisation de
personnel local;
> créer les conditions de regroupement des
élèves affectés pour la poursuite des apprentissages,
surtout ceux en classe d'examen dans les zones sûres ;
> introduire les Technologies de l'information et de la
communication pour l'enseignement (TICE) y compris le Programme d'Education par
la Radio (PER) en vue d'assurer la routine éducative dans les zones
à accessibilité réduite;
> organiser si besoin des examens spéciaux au profit
des enfants ayant perdu une partie de l'année et
bénéficiant d'un soutien en cours de rattrapage ;
> redéployer les enseignants dont les
établissements sont fermés pour la rescolarisation des
élèves déplacés ;
> mettre en place un dispositif de surveillance des
mouvements des enfants vers les zones sûres en vue d'assurer leur accueil
dans de bonnes conditions et leur rescolarisation : prise en charge sanitaire
et alimentaire des élèves déplacés;
amélioration de l'hygiène et l'assainissement de l'environnement
scolaire ;
> renforcer la résilience des écoles des
zones non touchées par des mesures de prévention et de
consolidation de la paix, de gestion des situations d'urgence et d'assistance
psychosociale.
La SSEZDS se présente comme une boussole pour les
acteurs de l'éducation en situation de crise au Burkina Faso. Son
intérêt pour nous dans cette présente recherche, c'est
d'une part, de s'imprégner, à travers elle, des
différentes orientations en matière de politiques
éducatives dans ce contexte d'éducation en situation de crise et
d'autre part, d'être à mesure de faire une analyse objective des
pratiques éducatives des acteurs locaux.
35
CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE L'ETUDE
Dans ce sous chapitre, nous expliquerons et justifierons les
méthodes et les instruments qui seront utilisés pour
appréhender et collecter les données. Pour QUIVY et CAMPENHOUDT
(2011), Il est avant tout important, dans une recherche, que le chercheur soit
capable de concevoir et de mettre en oeuvre un dispositif d'élucidation
du réel c'est-à-dire dans son sens le plus large, une
méthode de travail. Ce chapitre va donc traiter de la zone de la
recherche, de la méthode de recherche, de la population cible, de
l'échantillon de recherche, des techniques de collecte des
données, de la validation des instruments de recherche et du mode
d'analyse.
III.1) Zone de la recherche
La question sécuritaire touche aujourd'hui plusieurs
régions au Burkina Faso. Pour des contraintes diverses, notamment celles
liées au temps, à l'insécurité, aux moyens
matériels et financiers limités, la présente recherche va
se mener uniquement la commune de Titao. La commune de Titao est située
dans la région du nord qui compte quatre provinces. Le tableau suivant
présente les différentes provinces de la région et leurs
chefs-lieux.
Tableau 1: Les différentes provinces de la région
du nord
|
Province
|
Chef-lieu
|
|
Lorum
|
Titao
|
|
Passoré
|
Yako
|
|
Yatenga
|
Ouahigouya
|
|
Zondoma
|
Gourcy
|
Source : Elaboré par nous même
Les quatre provinces de la région du Nord sont le
Lorum, chef-lieu Titao ; le Passoré, chef-lieu Yako ; le Yatenga,
chef-lieu Ouahigouya et du Zondoma, chef-lieu Gourcy. Les provinces du Yatenga
et du Lorum constituent les deux provinces dans la région du nord
où les attaques terroristes se sont multipliées depuis le
déclenchement de la crise sécuritaire. Cette situation a
occasionné le déplacement de nombreux habitants des zones rurales
vers les centres urbains, notamment Ouahigouya et Titao. Selon Le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires (OCHA), à la date du 29 octobre
2019, le nombre de déplacés internes dans la
36
province du Lorum se situait entre 10001 et 30000 habitants.
Quant à celui de la province du Yatenga, il se situait entre 1000 et
10000 habitants. Nous avons choisi la commune de Titao dans la province du
Lorum comme zone de recherche au regard de l'importance de la population
déplacée dans cette localité. Titao est la seule commune
urbaine parmi les quatre communes que compte la province du Lorum. La carte
ci-dessous nous donne une présentation de la province du Lorum.
Photo 1 : carte géographique de la province du Lorum
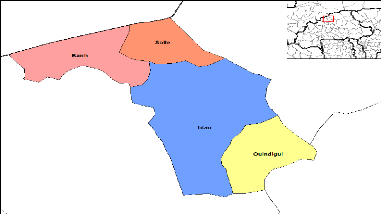
Source : Wikipédia
La province du Lorum compte quatre(04) communes dont les
chefs-lieux sont Banh, Ouindigui, Sollé et Titao. La ville de Titao,
chef-lieu de la province, accueille un grand nombre de personnes
déplacées venues des autres communes de la même province ou
de provinces voisines. Selon le
secrétariat permanent du Conseil National de Secours
d'Urgence et de
Réhabilitation(CONASUR), la province du Lorum est
classée quatrième sur le plan national en terme de province de
provenance et d'accueil de populations déplacées internes. Elle
enregistre à la date du 12 février 2020, 20649 personnes
déplacées d'une localité vers une autre dans la même
province ou du Lorum vers une autre province. Par ailleurs, à cette
même date, la province a
37
accueillie 18700 déplacés
internes7. Nous estimons qu'au sein de cette
population déplacée, il existe des enfants et des adolescents en
âge de fréquenter les structures éducatives.
Le tableau suivant présente l'état numérique
des établissements fonctionnels et fermés par commune dans la
province du Lorum.
Tableau 2: Etat numérique des établissements par
commune
|
Commune
|
Etablissements fonctionnels
|
Etablissements fermés
|
|
PPS8
|
Primaire
|
Total
|
PPS
|
Primaire
|
Total
|
|
Banh
|
0
|
0
|
0
|
3
|
38
|
41
|
|
Ouindigui
|
1
|
9
|
10
|
6
|
22
|
28
|
|
Sollé
|
0
|
0
|
0
|
2
|
26
|
28
|
|
Titao
|
11
|
30
|
41
|
3
|
38
|
41
|
|
Total
|
12
|
39
|
51
|
14
|
124
|
138
|
Source : rapports périodiques DPEPS/L et DREPPNF/N
Selon les rapports périodiques produit par la DPEPS/L
et la DREPPNF/N sur l'état de fonctionnement des établissements
scolaires, sur un total de 26 lycées et collèges dans la province
du Lorum, 03 sont implantés dans la commune de Banh, 07 dans la commune
de Ouindigui, 02 dans la commune de Sollé et 14 dans la commune de
Titao. A la date du 15 janvier 2020, 12 établissements secondaires dont
11 dans la seule commune de Titao et 01 dans la commune de Ouindigui sont
fonctionnels. Par ailleurs, le seul établissement fonctionnel de la
commune de Ouindigui est délocalisé au centre-ville de Titao.
Quant aux écoles primaires, 39 sont fonctionnelles et 124 sont
fermées. Des 39 écoles fonctionnelles, 30 sont localisées
dans la commune de Titao et 09 dans la commune de Ouindigui. La concentration
des établissements fonctionnels dans la seule commune de Titao et
principalement dans la ville de Titao se justifie par le déplacement des
populations rurales vers le seul centre urbain de la province. Ces
différents arguments susmentionnés nous motivent donc à
mener nos investigations dans la ville de Titao afin de s'imprégner de
la gestion des acteurs, surtout en situation de crise.
7 Enregistrement des personnes déplacées
internes du Burkina Faso No 02/2020 du CONASUR
8 Post primaire et secondaire
38
Notre terrain d'enquête va donc concerner les
écoles primaires et les établissements d'enseignement post
primaire et secondaire de la ville de Titao. Un certain nombre de raisons ont
motivés le choix de ces trois ordres d'enseignement. En effet, nous
avons tenus compte de l'obligation scolaire au Burkina Faso qui est de 6
à 16 ans selon la loi d'orientation de l'éducation. Cette tranche
d'âge concerne le cycle primaire et post primaire. Aussi, la
proximité entre le post primaire et le secondaire qui partagent
d'ailleurs les mêmes acteurs, nous oblige à prendre en compte cet
ordre d'enseignement qu'est le secondaire. Nous sommes par ailleurs acteur de
l'éducation et nous intervenons au post primaire et au secondaire. Les
résultats de cette étude pourraient nous servir dans notre propre
gestion quotidienne de l'éducation.
III.2) Méthode de la recherche
De par son objectif, la présente recherche se voudrait
être une recherche appliquée. La recherche appliquée est
« prioritairement tournée vers une finalité pratique (appui
à la décision, à l'intervention, etc. » (Lefrancois,
1991, p. 144). Il s'agit d'une recherche appliquée en ce sens qu'elle se
donne pour objectif d'appréhender les efforts des acteurs directs de
l'éducation dans le sens de favoriser une prise en charge scolaire
adéquate des élèves déplacés. Ainsi, les
résultats auxquels nous sommes contribueraient à améliorer
les pratiques en matière de gestion de l'éducation en situation
de crise sécuritaire.
Elle (la recherche) s'inscrit dans un champ déjà
exploré par d'autres chercheurs et sur la base de théories
préétablies. Nous avons pu donc dans le chapitre (II) faire une
recension de quelques recherches qui s'intéressent à l'offre
éducative et à la gestion de l'éducation en situation de
crise. Par ailleurs, la théorie incrémentaliste de la
planification, la théorie du capital humain ainsi que la
pédagogie différenciée semblent de notre point de vue
inspirer la gestion de l'éducation en situation de crise. Nous avons
adopté donc la méthode déductive, en nous inspirant des
recherches et des théories suscitées, pour vérifier nos
hypothèses. En effet, la méthode déductive consiste
à analyser le particulier à partir du général,
à lire une situation concrète spécifique à l'aide
d'une grille théorique générale préétablie.
Il convient par ailleurs de noter que le choix d'une méthode commande
l'application de stratégies appropriées pour la collecte des
données.
La stratégie de collecte des données est une
démarche choisie pour aborder un sujet à des fins de
prélèvement d'informations soumises à l'étude.
Notre étude étant de type déductif, la stratégie de
« l'enquête » nous semble approprier pour la collecte de nos
données. En effet, pour OKONGO,
39
l'enquête est « une opération qui
consiste à une interrogation particulière portée sur une
situation comportant des individus, et ce dans un but de
généralisation. Il s'agit pour le chercheur de poser des
questions, mais sans avoir le désir explicite de modifier la situation
dans laquelle il agit » (OKONGO, 2009,p. 42).
Dans le souci de recueillir des informations riches et
variées, la présente recherche s'inscrit dans la perspective
d'une approche mixte. Cette approche emprunte à la fois des
éléments propres à la recherche qualitative et à la
recherche quantitative.
III.3) La population cible et l'échantillon de
recherche
Ce point traite du public concerné par la recherche et
de l'échantillon sur lequel nos enquêtes ont porté.
III.3.1) La population cible
N'DA (2002) cité par NDAGIJIMANA (2013, p. 147)
définit la population comme « une collection d'individus
(humains ou non) c'est-à-dire un ensemble d'unités
élémentaires (une personne, un groupe, une ville, un pays) qui
partagent des caractéristiques communes précises selon des
critères définis. Les critères peuvent concerner par
exemple l'étendue, l'âge, le sexe, la scolarité, le revenu
etc. ». Partant de cet éclairage, notre population cible sera
constituée d'acteurs et de partenaires sociaux du monde éducatif.
Ainsi, de façon empirique, nous avons retenu des personnes ressources
dans les structures diverses et capables de nous fournir des informations
qualitatives et quantitatives. Il s'agit notamment de responsables de
structures déconcentrées de l'éducation, de
représentants d'organismes humanitaires, de chefs de services (chefs
d'établissement, censeurs, conseillers principaux
d'éducation(CPE) et intendants ou économes), d'enseignants,
d'agents de la vie scolaire, d'élèves et de parents
d'élèves.
? Les autorités éducatives
Les autorités éducatives composent l'ensemble
des autorités gouvernementales, des ministères, des
départements, des institutions et des agences qui y sont
associées et qui sont chargées de garantir le droit à
l'éducation. Ils exercent une autorité sur l'offre
éducative au niveau national et local. Dans des situations où
l'autorité gouvernementale est compromise, des acteurs non
étatiques, tels
40
que les ONG et les agences des Nations Unies, peuvent parfois
assumer cette responsabilité. (INEE, 2012)
? Le chef d'établissement
Le proviseur, dans un établissement d'enseignement
secondaire, le directeur dans un établissement d'enseignement post
primaire ou dans une école primaire, sont les premiers responsables des
établissements scolaires. L'article 3 et 4 de l'arrêté
no 2018-315/MENA/SG du 25 septembre 2018 portant attributions des
responsables dans les établissements d'enseignement post primaire et
secondaire dispose que le chef d'établissement (proviseur ou directeur)
est le responsable de la gestion administrative, pédagogique et
financière de son établissement. Tout le personnel est
placé sous son autorité. Le chef d'établissement reste
donc, dans une grande majorité des cas, celui à qui incombe la
plus grande part de pouvoirs dans l'établissement scolaire. A ce titre,
il est chargé de l'organisation du fonctionnement de
l'établissement, tant au plan pédagogique et éducatif
qu'au plan administratif et financier. Dans le cadre de la prise en charge des
élèves déplacés, il est donc de son devoir de
veiller à l'accueil de populations d'élèves très
diverses, de mettre en oeuvre des programmes plus propices à
l'intégration de ces populations, de proposer des activités
permettant une démarche plus personnalisée et privilégiant
un apprentissage actif plus autonome. Toutefois, dans l'esprit d'une gestion
participative, le chef d'établissement est entouré de
collaborateurs directs qui sont le censeur, le conseiller principal
d'éducation (CPE), l'intendant ou l'économe dans les
établissements d'enseignement post primaire et secondaire. Par ailleurs,
dans les écoles primaires, le chef d'établissement (directeur
d'école) collabore directement avec les enseignants.
? Le censeur
Le censeur est le responsable du service du censorat dans un
établissement d'enseignement secondaire. Il est choisi parmi les
professeurs et devient ainsi leur supérieur hiérarchique
immédiat. A cet effet, il est chargé de coordonner les
activités pédagogiques. Il seconde le chef d'établissement
en cas d'absence. Du fait de son rapprochement avec le personnel enseignant et
aussi de son rang hiérarchique au sein de l'établissement
scolaire, le censeur est détenteur de diverses informations relatives
à la gestion pédagogique et administrative qui pourront nous
être utiles.
41
? Le conseiller principal
d'éducation
Le conseiller principal d'éducation est le responsable
du service vie scolaire dans un établissement d'enseignement post
primaire ou secondaire. Il est choisi au sein du personnel d'animation de la
vie scolaire. Il est sous la responsabilité du chef
d'établissement et a sous sa responsabilité les conseillers
d'éducation, les attachés d'éducation et les assistants
d'éducation. Les fonctions du CPE se situent dans le cadre
général de la vie scolaire et contribuent à placer les
élèves dans les meilleures conditions possibles d'apprentissage.
Le CPE exerce ses responsabilités dans trois domaines principaux de vie
scolaire qui sont :
- le fonctionnement de l'établissement : il est
chargé d'organiser la vie collective quotidienne en dehors du temps de
la classe et en liaison avec la vie pédagogique dans
l'établissement ;
- la collaboration avec le personnel enseignant : il travaille
en étroite collaboration avec les professeurs à travers les
échanges d'informations sur le comportement et sur l'activité de
l'élève (ses conditions de travail, ses résultats, la
recherche en commun de l'origine de ses difficultés et des interventions
nécessaires pour lui permettre de les surmonter) ;
- l'animation éducative : il crée des conditions
de dialogue dans l'action éducative, sur le plan collectif et individuel
et organise le personnel de vie scolaire à l'animation de la vie
scolaire.
Ces différentes responsabilités du CPE font de
lui un acteur clé dans l'accompagnement des élèves en
général et des élèves déplacés en
particulier.
? L'intendant ou l'économe
L'intendant dans un établissement d'enseignement
secondaire et l'économe dans un établissement d'enseignement post
primaire est le responsable de la gestion financière et
matérielle. Il est sous la responsabilité du chef
d'établissement et est chargé de l'exécution du budget de
l'établissement.
? Le personnel d'encadrement de la vie
scolaire
Le personnel d'encadrement de la vie scolaire, quant à
lui, est composé de conseillers d'éducation, d'attachés
d'éducation et d'assistants d'éducation. Ils sont chargés
de l'exécution des tâches liées à l'animation de vie
scolaire. A cet effet, ils ont la responsabilité de maintenir la
discipline au sein de l'établissement, d'encadrer les
élèves dans la cour de l'école, pendant les heures
d'étude et lors
42
des sorties, de suivre la scolarité des
élèves, de communiquer avec les parents d'élèves et
les élèves sur leur scolarité etc. En outre, ils
collaborent étroitement avec les enseignants intervenant dans les
classes dont ils ont la responsabilité afin d'assurer une gestion
efficace de la vie scolaire. Tout comme le CPE, les conseillers,
attachés et assistants d'éducation jouent un rôle important
dans l'accompagnement scolaire des élèves.
? Les enseignants
Dans les établissements scolaires, les enseignants
(professeurs des lycées et collèges et professeurs
d'écoles primaires) sont chargés de dispenser les enseignements
théoriques et pratiques aux élèves et de procéder
à l'évaluation des connaissances. Ils constituent ainsi les
acteurs en contact permanant avec les élèves. Ils sont aussi
régulièrement sollicités pour encadrer les
élèves dans les activités socioéducatives.
? Elève déplacé
Le Petit Larousse (2001) définit le terme «
élève » comme étant « un
garçon ou une fille qui reçoit un enseignement dans un
établissement scolaire ». Ce garçon ou cette fille est
donc le maillon essentiel au centre de l'action éducative. En effet, des
ressources humaines, financières et matérielles sont
mobilisées autour de l'action éducative pour assurer la
réussite scolaire de cet enfant ou adolescent. Mais en situation de
crise, cette offre éducative pourrait être
hypothéquée à cause de l'insécurité qui y
règne et peut conduire à la fermeture totale des
établissements scolaires des zones concernées. Dans le souci de
continuer à bénéficier de l'offre éducative, cet
enfant ou adolescent pourrait être obligé de se déplacer de
sa localité vers une autre localité dans un même pays. Cet
enfant ou adolescent est donc appelé « élève
déplacé ».
? Parents d'élèves
Selon le Petit Larousse(2005) le terme « parents
» désigne le père et la mère. Ainsi, parents
d'élèves renvoie au père et à la mère de
l'élève. Dans le cadre de la présente étude,
l'expression « parent d'élève » prend en
compte toute personne qui a la charge d'un enfant inscrit dans un
établissement d'enseignement. Il peut donc s'agir du père, de la
mère mais aussi de toute autre personne physique qui répond au
nom des deux parents biologiques d'un élève dans le cadre de sa
scolarisation. Les parents d'élèves sont des partenaires
privilégiés de l'école et sont organisés en
association dénommée Association des Parents
d'Elèves(APE). Ils disposent d'un bureau dans chaque
établissement. Selon l'article 20 de
l'arrêté no 91-133/MEBA/MESS du 3 octobre 1991 portant
création des associations des parents d'élèves, le bureau
est l'organe exécutif de chaque association de parents
d'élèves. Il est composé de sept (07) membres. Par
ailleurs, le rôle de l'APE est d'organiser ou de participer à
l'organisation des manifestations propres à faciliter les rapports entre
l'administration, le corps enseignant et les élèves ; d'informer
les parents sur tout ce qui concerne la vie et l'organisation de l'école
; de stimuler et encourager les élèves dans leurs
activités d'éducation et de formation ; de participer aux efforts
d'organisation et de gestion de l'école.
Après la description sommaire de la population
d'étude, il est important de présenter la situation
numérique de cette population.
Notre échantillon est issu des structures
déconcentrées du MENAPLN, d'établissements publics
d'enseignement primaire, post primaire et secondaire de la commune de Titao. Il
s'agit notamment de la DPEPS/L, de la CEB9 1 de Titao, du
Lycée Provincial du Lorum(LPL), du lycée municipal Pierre Hazette
de Titao (LMPHT), du CEG d'accueil de Titao, du CEG de Titao, de l'école
primaire Titao A et de l'école primaire Titao B. Aussi, des membres de
bureaux APE de ces établissements suscités seront
considérés dans notre échantillon d'étude. Le
tableau ci-dessous présente l'état numérique de la
population d'étude dans ces différents établissements.
43
9 Circonscription d'éducation de base
44
Tableau 3: Présentation de la population d'étude
|
Structures
|
Personnels de
direction
|
Enseignants
|
AVS
|
Elèves déplacés
|
APE
|
Total
|
|
DPEPS
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
CEB
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
LPL
|
3
|
44
|
3
|
28
|
7
|
85
|
|
LMT
|
3
|
30
|
3
|
137
|
7
|
180
|
|
CEG de
Titao
|
1
|
15
|
1
|
100
|
7
|
124
|
|
CEG d'accueil
|
1
|
9
|
1
|
319
|
7
|
337
|
|
Titao A
|
1
|
7
|
0
|
27
|
8
|
43
|
|
Titao B
|
1
|
7
|
0
|
120
|
8
|
136
|
|
Total
|
12
|
112
|
8
|
731
|
44
|
907
|
Source : Enquête terrain, mars 2020
Comme mentionné plus haut, notre population
d'étude est composée d'autorités éducatives, de
personnels de direction, d'enseignants, d'AVS, d'élèves
déplacés et de membres de bureau APE. Dans les différentes
structures retenues, douze (12) personnels de direction, cent douze (112)
enseignants, huit (08) AVS, sept cent trente et un (731) élèves
déplacés et quarante-quatre (44) membres de bureau APE ont
été recensés dont un total de 907 personnes. Cependant, il
convient de noter qu'à travers notre enquête exploratoire qui nous
a permis de récolter ces informations, nous avons pu constater que
l'effectif des élèves déplacés n'est pas stable du
fait que ces élèves n'arrivent pas au même moment dans
leurs établissements d'accueil. Aussi peut-on constater des
départs permanents de certains pour d'autres horizons. Par
conséquent, l'effectif des élèves déplacés
n'est qu'une approximation.
III.3.2) Echantillon de la recherche
Nous entendons par échantillon de recherche, un sous
ensemble d'une population, relativement plus petit et choisi avec
rationalité, de manière à représenter le plus
fidèlement possible cette population. Ainsi à partir de la
population présentée ci-avant, nous avons procédé
à un échantillonnage stratifié en prélevant dans
chaque public cible la même proportion que ce public cible
représente dans la population totale (907).
45
Tableau 4: proportion des publics cibles dans la population
totale
|
Structures
|
Effectifs dans la population totale
|
Proportion en % dans la population totale
|
|
Personnel de direction
|
12
|
1
|
|
Enseignants
|
112
|
12
|
|
AVS
|
8
|
1
|
|
Elèves déplacés
|
731
|
81
|
|
APE
|
44
|
5
|
|
Total
|
907
|
100
|
Source : conçu par nous-même
Ce tableau présente la proportion de chaque cible dans la
population totale qui est de 907. Ainsi, par exemple nous nous
intéresserons à 1 pour cent des 12 personnes de direction.
Nous avons choisi de façon aléatoire de mener
l'enquête avec 250 personnes sur le total de 907. Nous formulons
l'hypothèse que ce nombre d'individus dans la population total est
raisonnablement suffisant pour requérir les informations
nécessaires à notre analyse.
Tableau 5: Echantillon par public cible
|
Structures
|
proportion dans la
population(en %)
|
Nombre d'individus dans
l'échantillon
|
|
Personnel de direction
|
1
|
3
|
|
Enseignants
|
12
|
30
|
|
AVS
|
1
|
3
|
|
Elèves déplacés
|
81
|
202
|
|
APE
|
5
|
12
|
|
Total
|
100
|
250
|
Source : conçu par nous-même
46
Le tableau ci-avant présente le nombre d'individus qui
seront impliqués dans l'enquête réparti par public cible.
Ainsi à titre d'illustration, il est prévu d'enquêter sur
202 élèves déplacés. Le tableau ci-après
permet enfin de visualiser notre échantillon définitif par
structure.
Tableau 6: Echantillon définitif
|
Structures
|
Personnels de
direction
|
Enseignants
|
AVS
|
Elèves déplacés
|
APE
|
Total
|
|
DPEPS
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
CEB
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
ONG
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
L.P. Loroum
|
3
|
5
|
1
|
8
|
1
|
18
|
|
L.M.P.H.T
|
2
|
5
|
1
|
38
|
1
|
47
|
|
CEG de
Titao
|
1
|
5
|
1
|
28
|
1
|
36
|
|
CEG d'accueil
|
1
|
5
|
1
|
84
|
1
|
92
|
|
Titao A
|
1
|
5
|
|
7
|
1
|
14
|
|
Titao B
|
1
|
5
|
|
33
|
1
|
40
|
|
Total
|
12
|
30
|
4
|
198
|
6
|
250
|
Source : conçu par nous-même
Ce tableau montre le nombre d'individus de
l'échantillon par structure et par public cible. La répartition
ici est aléatoire. De même, nous avons procédé par
ajustement pour que certains publics cibles comme les Animateurs de la vie
scolaires et le personnel de directions soient plus représentés
que la proportion calculée, au détriment de l'échantillon
des parents d'élèves et des élèves
déplacés. Par ailleurs, un représentant d'ONG intervenant
dans le domaine de l'éducation en situation de crise a été
inclus dans le personnel de direction. Ce tableau permet donc d'avoir à
l'idée, le nombre cumulé d'individus à enquêter
lorsque l'on se rend dans une structure donnée.
III.4) Instruments de collecte des données
Il s'agit ici d'indiquer les instruments les plus
appropriés avec lesquels les informations seront recueillies sur le
terrain. Les instruments retenus pour la collecte des données dans la
présente étude sont le questionnaire et l'entretien
semi-directif. L'utilisation de ces deux instruments, en notre
47
sens, répond aux exigences de l'approche mixte car ils
permettront d'une part, d'obtenir des données quantitatives et d'autre
part, de recueillir auprès de personnes ressources, « des
informations et des éléments de réflexion très
riches et nuancés » (CAMPENHOUDT, 2011, p. 170). La
triangulation des données d'entretiens et des questionnaires permettra
ainsi de mieux cerner la réalité de la gestion de
l'éducation en situation de crise dans notre zone étude.
III.4.1) Le questionnaire
L'enquête par questionnaire, selon CAMPENHOUDT,
consiste à poser à un ensemble de
répondants, le plus souvent représentatif d'une population, une
série de questions relatives à leur situation sociale,
professionnelle ou familiale, à leurs opinions, à leurs attentes,
à leur niveau de connaissance ou de conscience d'un
évènement ou d'un problème, ou encore sur tout autre point
qui intéresse les chercheurs (idem, p.167).
Au regard de la taille des échantillons et du champ
d'étude, nous avons opté pour le questionnaire dit d' «
administration directe » pour le personnel enseignant, le
personnel d'encadrement de la vie scolaire et les élèves
déplacés en raison de leur nombre relativement
élevé et de leur capacité à pouvoir renseigner les
questionnaires par eux-mêmes. Le questionnaire d'administration direct
consiste, pour l'enquêteur, à donner à
l'enquêté toutes les explications utiles pour une meilleure
compréhension des questions et il lui appartient
(l'enquêté) de remplir lui-même le questionnaire. L'avantage
principal du questionnaire est le fait de répondre à l'exigence
de représentativité. Cependant, il convient de noter qu'il
présente aussi des limites. En effet, la fiabilité des
réponses requiert que plusieurs conditions soient remplies. Ces
conditions sont : « la rigueur dans le choix de l'échantillon,
la formulation claire et univoque des questions, la correspondance entre le
monde de référence des questions et le monde de
référence du répondant, l'atmosphère de confiance
au moment de l'administration du questionnaire, l'honnêteté et la
conscience professionnelle des enquêteurs » (CAMPENHOUDT, 2011,
p. 169). Ces conditions sont prises en compte dans l'élaboration des
questionnaires, afin garantir dans une certaine mesure, la scientificité
du travail.
III.4.2) L'entretien semi-directif
L'entretien est un procédé d'investigation
scientifique, utilisant un processus de communication verbale pour recueillir
des informations en relation avec le but fixé. Il est dit semi-directif
lorsqu'il permet d'orienter en partie le discours des personnes
interrogées autour de différents thèmes définis
48
au préalable par l'enquêteur et consignés
dans un guide d'entretien. Le choix porté sur l'entretien semi-directif
se justifie par le fait qu'il permet de collecter des réponses riches
visant à comprendre des pratiques et/ou les perceptions des interviewers
en lien avec la question de recherche. Cet instrument d'enquête met
nécessairement l'enquêteur en contact direct avec son
interlocuteur. Il nous paraît plus opérationnel pour les
autorités éducatives, les chefs de services et les membres des
bureaux APE en raison de leur nombre relativement réduit. Par ailleurs,
dans les bureaux APE, il n'est pas rare de rencontrer des membres qui ne sont
pas à mesure de lire ou d'écrire. Un entretien serait donc
approprié pour cette catégorie de personnes.
Tout comme le questionnaire, l'entretien comporte des
difficultés qu'il convient de souligner. En effet, l'utilisation de cet
instrument requiert des aptitudes communicationnelles dont la maitrise
nécessite une formation pratique aux techniques d'entretien. Cela nous
oblige à nous intéresser une fois de plus aux conseils de
CAMPENHOUDT (2011) qui prévient tout utilisateur de cet outil, de tenir
compte du contexte de l'entretien. Cela suppose que l'enquêté
adhère au projet, que le temps et le lieu soient bien choisis pour
éviter les perturbations, que la confiance soit instaurée entre
l'enquêté et l'enquêteur. Il faudrait également
éviter la prise de note systématique qui pourrait contribuer
à distraire l'enquêté. Parmi ces conditions
suscitées, la question de la prise de note semble être la plus
délicate. Une chose est de conduire l'entretien, une autre chose est de
recueillir de façon fidèle l'information fournie par
l'interlocuteur sans perturber l'entretien. Pour cela nous utiliserons, avec
l'accord de nos interlocuteurs, un enregistreur afin de transcrire assez
fidèlement le contenu des messages à recueillir.
Le tableau suivant présente enfin les acteurs qui
seront enquêtés et les outils d'enquête qui vont servir pour
chacun.
Tableau 7: Acteurs outils d'enquête
|
Acteurs
|
Outil d'enquête
|
|
Structures
|
Fonction
|
|
Structures déconcentrées
|
DPEPS
|
Guide d'entretien
|
|
CCEB
|
Guide d'entretien
|
|
Etablissements
|
Chefs d'établissements
|
Guide d'entretien
|
|
Censeurs
|
Guide d'entretien
|
|
CPE
|
Guide d'entretien
|
|
Enseignants
|
Questionnaire
|
|
Agents vie scolaire
|
Questionnaire
|
|
Elèves déplacés
|
Questionnaire
|
|
Partenaires sociaux
|
APE
|
Guide d'entretien
|
|
Responsables ONG
|
Guide d'entretien
|
Source : conçu par nous
III.5) Validation des instruments de collecte des
données
Dans ce point, il s'agit de définir le processus par
lequel nos instruments de collecte de données seront testés afin
de mesurer leur efficacité.
Après l'élaboration des questionnaires et des
guides d'entretien, nous avons procédé à un test de ces
instruments afin de vérifier la correspondance entre le sens que nous
donnons aux questions et la compréhension que la population cible a de
ces questions. Ainsi, nous avons procédé à une
administration des questionnaires et des guides d'entretien à 13
personnes dans la ville de Titao qui est notre terrain d'étude.
Cependant, ces 13 personnes à qui nous avons soumis ce test ne sont pas
incluses dans notre échantillon de recherche. Ces personnes sont
réparties comme suit :
? Pour le questionnaire : Trois (03) enseignants ;
49
Trois (03) animateurs de la vie scolaire ;
50
Quatre (04) élèves déplacés;
? Pour le guide d'entretien
Deux (02) membres de l'équipe de direction;
Un (02) parent d'élève.
Ces différents exercices nous ont permis de
réajuster un certain nombre de questions dont la formulation semblait
ambigüe aux yeux des enquêtés ou ne répondrait pas
à nos objectifs. Aussi, nos guides d'entretien adressés au
personnel de direction et aux parents d'élèves ont subi des
modifications à l'issue de cette phase de test. Comme tout guide
d'entretien, nous avons prédéfini un certain nombre de questions
mais d'autres questions de relance ont dû être posées en
fonction des éléments de réponses donnés par notre
interlocuteur.
III.6) L'administration des instruments de collecte
Nous nous sommes rendus dans la commune et les structures
concernées par l'enquête pour y déposer les outils
d'enquêtes tout en négociant des rendez-vous avec les
enquêtés pour la réalisation des entretiens individuels, ou
pour la récupération des questionnaires remplis.
III.7) Le traitement des données recueillies
Après la collecte des données, nous avons fait
le point des questionnaires récupérés et des entretiens
réalisés, puis nous avons procédé à la
synthèse des réponses des différents groupes
enquêtés. Le dépouillement s'est fait avec Sphinx Plus
2 qui est un logiciel de traitement et d'analyse de données.
Une triangulation des données quantitatives et qualitatives nous a
permis de procéder à leur interprétation afin de cerner
toutes les tendances qui se dégagent, dans la perspective de confirmer
ou d'infirmer nos hypothèses de recherche.
III.8) Méthode d'analyse et résultats
attendus
Notre échantillon d'étude est composé
d'administrateurs, d'exécutants, de partenaires et de
bénéficiaires des services éducatifs. Ainsi, nos
questionnaires et guides d'entretien sont conçus de sorte à
pouvoir vérifier l'effectivité d'une pratique ou d'une mesure
à travers la congruence des informations au sein de chaque strate
(autorités éducatives, chefs de services, partenaires sociaux
51
et élèves) et entre les différentes
strates. Cette vérification s'est faite à travers une analyse
quantitative et qualitative des données dans chaque strate.
? L'analyse quantitative
L'analyse est dite quantitative lorsque les données
à analyser sont observables et quantifiables (N'DA, 2002) cité
par (NDAJGUIMANA, 2013). Beaucoup des travaux de recherche dans le domaine des
sciences sociales utilisent la méthode quantitative dans le traitement
des données. Pour notre part, nous avons retenu 232 personnes auxquelles
nous devons à l'aide d'un questionnaire connaitre leurs opinions sur
l'effectivité d'une prise en charge scolaire des élèves
déplacés dans la commune de Titao.
? L'analyse qualitative
Pour PAILLE ET MUCCHIELLI (2008, p.9), l'analyse qualitative
permet d'analyser des données en extrayant le sens plutôt que de
les transformer en pourcentages ou en statistiques. Elle met à profit
les capacités naturelles de l'esprit du chercheur et vise la
compréhension et l'interprétation des pratiques et des
expériences plutôt que la mesure de variables à l'aide de
procédés mathématiques.
A travers ces distinctions, l'analyse qualitative va donc nous
permettre d'observer les réponses issues des entretiens et des questions
ouvertes issues des questionnaires. Nous avons ainsi 18 personnes à qui
nous avons soumis les entretiens. Les données qualitatives issues de ces
entretiens vont être confrontées avec les données
quantitatives afin de tirer une conclusion objective.
La validation de nos hypothèses se fera donc par une
triangulation des données recueillies dans les différentes
strates suscitées. La constatation d'avis similaires à la
majorité simple, relatifs à une pratique ou à une mesure
donnée permettra de valider l'existence de cette pratique ou de cette
mesure. Nous avons au total quatre strates, les autorités
éducatives, les chefs de services, les partenaires sociaux et les
élèves. Si par exemple une idée est partagée par au
moins trois strates, cette idée est considérée valide.
Cependant, la validation absolue d'une hypothèse devra
nécessairement recueillir les avis positifs de toutes les strates
suscitées.
52
A l'issu de l'analyse des données, les résultats
suivants sont attendus:
? La présence effective de dispositions
organisationnelles, matérielles et psychosociales en vue d'assurer la
continuité de la scolarisation des enfants et adolescents
déplacés dans la commune de Titao.
? La conception et la mise en pratique d'activités
pédagogiques et socioéducatives par les enseignants et les
animateurs de la vie scolaire au profit des enfants et adolescents
déplacés dans la commune de Titao est effective.
? Effectivité d'une mobilisation et d'un engagement de
la communauté locale dans la prise en charge scolaire des enfants et
adolescents déplacés dans la commune de Titao.
CONCLUSION A LA PREMIERE PARTIE
Dans cette première partie, une analyse contextuelle
nous a permis de relever des avancés liées à l'EPT au
Burkina Faso. Cependant, force est de constater que de nouveaux défis se
présentent aux différents acteurs de l'éducation. Parmi
ces défis figure la question de l'offre éducative en situation de
crise sécuritaire. Le cas de la province du Loroum nous a permis de
formuler notre question de recherche et de décliner les objectifs et
hypothèses de recherche. Nous avons par la suite présenté
la zone d'étude, la démarche méthodologique, les outils,
les techniques de traitement et d'analyse des données à
collecter.
Après la description du cadre théorique de notre
recherche, nous allons nous appesantir sur ses aspects pratiques.
DEUXIEME PARTIE : ASPECTS PRATIQUES
53
54
INTRODUCTION A LA DEUXIEME PARTIE
Dans cette deuxième partie, nous présentons les
aspects pratiques de notre recherche. Il s'agit plus concrètement dans
le chapitre IV, de faire le bilan du recouvrement des outils de collecte des
données et de procéder ensuite à l'analyse et à
l'interprétation de ces données. Ce travail préliminaire
doit aboutir à la validation et à la discussion de la
validité de nos hypothèses, objet du chapitre V. nous terminerons
cette partie avec la présentation, dans le chapitre VI, des limites de
notre travail et quelques recommandations pour l'amélioration de la
prise en charge scolaire des enfants et adolescents déplacés dans
la commune de Titao.
55
CHAPITRE IV : PRESENTATION, ANALYSE
ET
INTERPRETATION DES DONNEES COLLECTEES
Ce chapitre est réservé à
l'établissement de l'état de recouvrement de nos outils de
collecte des données puis à la présentation, analyse et
interprétation de ces données.
IV.1) Etat de recouvrement des outils de collecte des
données
Il est question ici de faire le point sur les taux de
recouvrement des questionnaires et de réalisation des entretiens que
nous avons administrés à notre échantillon
d'étude.
IV.1.1) Recouvrement des questionnaires adressés aux
enseignants
Il faut rappeler que trente (30) enseignants ont
été retenus pour l'enquête en raison de cinq enseignants
par établissement. Le tableau suivant fait l'état de recouvrement
de ces questionnaires.
Tableau 8: Etat de recouvrement des questionnaires au niveau des
enseignants
|
Echantillon
|
Questionnaires
Recouvrés
|
Taux
de recouvrement
|
|
CEG de Titao
|
5
|
5
|
100 %
|
|
L.M.P.H.T
|
5
|
5
|
100%
|
|
L.P. Loroum
|
5
|
5
|
100%
|
|
Titao A
|
5
|
5
|
100%
|
|
Titao B
|
5
|
5
|
100%
|
|
CEG d'accueil
|
5
|
4
|
80%
|
|
Total
|
30
|
29
|
96,66%
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Ce tableau indique que sur 30 questionnaires
administrés, 29 enseignants en ont répondu et acceptés
nous retourner les questionnaires renseignés. En termes de pourcentage,
il convient de signaler que 96,66% des questionnaires au niveau des enseignants
ont pu être recouvrés.
56
IV.1.2) Recouvrement des questionnaires adressés aux
AVS
A ce niveau, comme prévu, nous avons soumis nos
questionnaires à quatre (4) AVS. Trois d'entre eux ont accepté
nous retourner leurs questionnaires remplis. Ce qui représente un taux
de recouvrement de 99,99%.
IV.1.3) Recouvrement des questionnaires adressés
aux élèves Tableau 9: Etat de recouvrement des
questionnaires adressés aux élèves
|
Structures
|
Echantillon
|
Questionnaires recouvrés
|
Taux de recouvrement(%)
|
|
CEG de Titao
|
28
|
28
|
100
|
|
L.M.P.H.T
|
38
|
33
|
86,84
|
|
L.P. Loroum
|
8
|
8
|
100
|
|
Titao A
|
7
|
7
|
100
|
|
Titao B
|
33
|
30
|
90,91
|
|
CEG d'accueil
|
84
|
68
|
80,95
|
|
Total
|
198
|
174
|
87,87
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Nous avons prévu soumettre nos questionnaires à
198 élèves déplacés. Nous avons pu recouvrer tous
les questionnaires dans trois (03) établissements et dans trois (03)
autres établissements, le taux de recouvrement se situe entre 80 et 91%.
En raison de la suspension des cours depuis le mois de mars pour raison de la
COVID-19, nous n'avons pas pu rencontrer tout le public élève
souhaité. Cette situation nous a contraint à effectuer une
seconde phase d'administration de questionnaires aux élèves dans
la première quinzaine du mois d'octobre. Cela nous a permis d'atteindre
un taux de recouvrement total de 87,87%.
IV.1.4) Guide d'entretien adressé au personnel de
direction
En rappel, le guide d'entretien adressé au personnel de
direction a concerné dix (10) chefs de services et deux (2)
autorités éducatives dans la province. Au niveau des
autorités éducatives, nous avons pu effectivement mener deux (2)
entretiens comme prévu. Cependant, au niveau des chefs de services, neuf
(9) entretiens sur dix (10) ont pu être réalisés. En effet,
parmi nos personnes de
57
ressources, un seul n'a pas répondu à nos
questions. Ce dernier n'a pas honoré notre rendez-vous pour des raisons
de santé en famille qui nécessitaient des déplacements
réguliers de sa part. Nous avons pu alors nous entretenir avec onze (11)
personnes sur les douze (12) prévus. Par ailleurs, l'échantillon
choisi au titre des ONG, du fait de sa taille réduite, a
été associé au personnel de direction.
IV.1.4) Guide d'entretien adressé aux parents
d'élèves
Six (6) présidents APE ont été retenus
pour les entretiens au niveau des parents d'élèves. De ces six
personnes, Quatre (4) ont pu effectivement répondre à nos
questions. Les deux autres ont été contactés à
plusieurs reprises sans pouvoir obtenir un rendez-vous.
IV.2) Présentation, analyse et interprétation
des données recueillies
Ce sous chapitre est réservé à la
présentation des données recueillies, à leur analyse et
interprétation. Les données sont présentées selon
trois (03) thèmes en lien avec nos hypothèses de recherche. Ces
thèmes sont les suivants :
? les dispositions organisationnelles, matérielles et
psychosociales ;
? les activités pédagogiques et
socioéducatives ;
? la mobilisation de la communauté locale
IV.2.1) Les dispositions organisationnelles,
matérielles et psychosociales
Notre objectif à ce niveau est de vérifier
l'existence, dans les établissements scolaires fonctionnels de la
commune de Titao, de dispositions organisationnelles, matérielles et
psychosociales en vue d'assurer une intégration réussie des
élèves déplacés. Pour ce faire, nous nous sommes
intéressés aux mesures sécuritaires ; aux conditions
d'accueil ; aux conditions alimentaires et matérielles ; aux services
psychosociaux prises en faveur du personnel éducatif et des
élèves déplacés.
IV.2.1.1) Données recueillies auprès des
enseignants
Les enseignants ont donné leurs avis sur les
dispositions organisationnelles, matérielles et psychosociales.
58
? Les dispositions organisationnelles
La première question relative aux dispositions
organisationnelles était de savoir quel dispositif sécuritaire
est mis en place pour assurer la protection de l'environnement scolaire ? Comme
on peut le constatez, il s'agit d'une question ouverte et donc les intervenants
ont la possibilité de développer leurs points de vue. Ainsi, la
grande majorité des enseignants enquêtés pense qu'aucun
dispositif sécuritaire n'est mis en place pour assurer la protection des
domaines scolaires. Cependant, certains pensent qu'un minimum d'effort est
fourni par les autorités locales. Il s'agit notamment de la mise en
place de cellules de veille dans les établissements scolaire et des
actions de sécurisation générale de la ville par
l'administration sécuritaire.
Le flux de populations scolaires vers la ville de Titao va
nécessairement engendrer la question de disponibilité de
structures d'accueil. Nous avons donc voulu porter un regard sur les effectifs
des élèves dans les classes. La question suivante a donc
été posée à nos enquêtés : Comment
jugez-vous les effectifs des élèves dans vos classes ? Le tableau
ci-dessous présente les différents avis des enseignants.
Tableau 10: Avis des enseignants sur les effectifs dans les
classes
|
Effectifs
|
Nb. Citations
|
Fréquence
|
|
Normal
|
10
|
34,5%
|
|
Pléthorique
|
19
|
65,5%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
34,5% des enseignants enquêtés estiment que les
effectifs dans les classes sont normaux. Cependant 65,5% des
enquêtés sont d'avis contraire. Ils soutiennent que les effectifs
sont pléthoriques. Ces effectifs pléthoriques pourraient
s'expliquer par l'arrivée massive des élèves
déplacés dans la ville de Titao. La question suivante est donc de
savoir si le personnel en charge de la conduite des activités
pédagogiques est suffisamment formé pour prendre en charge des
questions spécifiques liées à l'éducation en
situation de crise sécuritaire.
59
Tableau 11: Avis des enseignants sur les formations
reçues
|
Formations
|
Nb. Citations
|
Fréquence
|
|
Approches pédagogiques
|
1
|
3,4%
|
|
Approche safe school
|
15
|
51,7%
|
|
secourisme
|
2
|
6,9%
|
|
Formation en prise en charge psychosociale
|
11
|
37,9%
|
|
Jamais
|
12
|
41,4%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Le nombre de citations est supérieur au nombre
d'observations du fait de réponses multiples (4 au maximum). Il ressort
de ce tableau que sur les 29 enseignants enquêtés, 15 ont
reçu une formation sur l'approche Safe school, 11 sur une formation en
prise en charge psychosociale, 2 enseignants en secourisme et un seul sur les
approches pédagogiques. Cependant, 12 personnes estiment n'avoir jamais
pris part à une formation en lien avec la prise en charge
spécifique des élèves déplacés. De ce qui
précède, nous pouvons retenir que la formation reçue par
les enseignants est plus orientée vers la prise en charge psychosociale
que la prise en charge pédagogique.
A la question de savoir dans quel cadre ils ont reçu
ces formations, nos enquêtés donnent les réponses suivantes
:
Tableau 12: opinions des enseignants sur le cadre de formation
|
Cadre de formation
|
Nb. Citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
13
|
44,8%
|
|
En formation initiale
|
1
|
3,4%
|
|
En formation continue
|
16
|
55,2%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Le nombre de citations est supérieur au nombre
d'observations du fait de réponses multiples (2 au maximum). 13
personnes n'ont pas donné de réponse à cette question. 16
personnes déclarent avoir bénéficié de ces
formations sur le terrain (en formation continue) et une seule personne, en
formation initiale. Du point de vue donc des enseignants, l'acquisition de
compétences en lien avec l'éducation en situation de crise
sécuritaire se fait sur le tas.
60
? Dispositions matérielles
Les enseignants se sont également exprimés sur
les dispositions matérielles prises pour accompagner l'encadrement des
élèves déplacés. A ce sujet, il était
d'abord question de savoir si des supports pédagogiques avaient
été mis à leur disposition dans le cadre de la prise en
charge scolaire des élèves déplacés. Aussi a-t-il
été question de savoir si les élèves
déplacés avaient été dotés en kits
scolaires. Les avis des enseignants relatifs à la première
question sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 13: Avis des enseignants sur l'existence de supports
pédagogiques
|
Supports pédagogiques
|
Nb. Citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
1
|
3,4%
|
|
Oui
|
3
|
10,3%
|
|
Non
|
25
|
86,2%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
86,2% des enseignants enquêtés reconnaissent
n'avoir pas reçu de supports pédagogiques dans le cadre de la
prise en charge des élèves déplacés. Seulement
10,3% des enquêtés ont répondu par l'affirmative à
cette question et une seule personne ne s'est pas exprimée. Du point de
vue donc des enseignants, il n'y a pas, de façon formelle, un
accompagnement de l'autorité éducative sur le plan du
matériel pédagogique afin de favoriser une prise en charge
adéquate des élèves déplacés.
A la question de savoir si les élèves ont
reçu des dotations en kits scolaires (livres cahiers, sacs
d'école etc.), les enseignants enquêtés donnent leurs avis
dans le tableau ci-après.
Tableau 14: Avis des enseignants sur la dotation des
élèves déplacés en kits scolaires
|
Dotation kits scolaires
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Oui
|
13
|
44,8%
|
|
Non
|
16
|
55,2%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
61
A cette question, les avis sont partagés. 55,2% des
enseignants enquêtés estiment que les élèves
déplacés n'ont pas reçu de kits scolaire. Ils sont
cependant 44,8% à affirmer que des kits scolaires ont bien
été distribués aux élèves
déplacés.
? Dispositions psychosociales
Pour évaluer les dispositions psychosociales, nous nous
sommes appesanti sur les services d'accueil, d'inscription, de restauration, de
soin et des espaces récréatifs. Les enseignants
enquêtés se sont donc exprimés sur les services dont
bénéficient les élèves déplacés dans
leurs établissements.
Tableau 15: opinions des enseignants sur les services au profit
des élèves déplacés
|
Services au profit des élèves
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Accueil
|
17
|
58,6%
|
|
Inscription gratuite
|
10
|
34,5%
|
|
Restauration gratuite
|
6
|
20,7%
|
|
Espaces récréatifs
|
1
|
3,4%
|
|
Soins gratuits
|
1
|
3,4%
|
|
Autres
|
0
|
0,0%
|
|
néant
|
9
|
31,0%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Le nombre de citations est supérieur au nombre
d'observations du fait de réponses multiples (6 au maximum). Selon le
résultat du questionnaire adressé aux enseignants, nous
constatons que les services dont bénéficient les
élèves déplacés sont de trois ordres. Il s'agit de
l'accueil (58,6%), l'inscription gratuite (34,5%) et de la restauration
gratuite (20,7%). On note une seule citation en faveur des espaces
récréatifs et des soins gratuits. Cependant, neuf (9) enseignants
enquêtés estiment que les élèves
déplacés ne bénéficient d'aucun service.
Les enseignants enquêtés sont d'avis que les
élèves déplacés bénéficient d'un
certain nombre de services dans leurs établissements d'accueil. Il
s'agit notamment des services d'accueil, d'inscription gratuite et de
restauration gratuite.
62
IV.2.1.2) Données recueillies auprès des
AVS
? Les dispositions organisationnelles
Des trois AVS à qui nous avons soumis le questionnaire,
deux ont répondu à l'affirmatif quant à l'existence de
dispositifs sécuritaires dans l'environnement scolaire. Si l'un
évoque la présence d'une clôture en grillage autour du
domaine scolaire, l'autre cite la mise en place d'une cellule de veille au sein
des établissements par le truchement de DRC (Conseil Danois pour les
Réfugiés). En effet, des plans de sauvetage ont été
élaborés dans chaque établissement pour permettre au
personnel éducatif et aux élèves de ne pas céder
facilement à la panique en cas de coups de feu et d'adopter de bonnes
méthodes d'évacuation des lieux si cela s'avère
nécessaire. Quand est-il donc des effectifs dans les classes ?
Contrairement aux avis des enseignants sur cette question, les AVS pensent que
les effectifs sont normaux dans les classes. Un de nos interlocuteurs pense
d'ailleurs que le plus important, dans ce contexte d'éducation en
situation de crise, n'est pas de respecter les effectifs dans les classes mais
de permettre à tout élève déplacé de pouvoir
se réinscrire. En rappel, selon le manuel des normes éducatives
au Burkina Faso (2020), les effectifs des élèves ne doivent pas
excéder 50 dans les classes du primaire, 70 dans les classes du premier
cycle de l'enseignement secondaire et 60 dans les classes du second cycle.
A la question de savoir si les AVS ont reçu des
formations en lien avec la prise en charge spécifique des
élèves déplacés, deux des trois AVS
enquêtés ont répondu par l'affirmatif. Ils déclarent
tous deux avoir reçu une formation sur l'approche Safe School conduite
par DRC, ce qui a, de leur point de vue, permis aux établissements de
mieux s'organiser pour parer à d'éventuelles attaques.
? Dispositions matérielles
De l'avis des AVS enquêtés, des kits scolaires
sont octroyés aux élèves déplacés. En effet,
ils sont deux sur trois à répondre par l'affirmatif à la
question de savoir si les élèves déplacés dans
leurs établissements respectifs ont reçu des kits scolaires. Pour
plus de certitudes, ils soutiennent que ces kits ont été
donnés par une ONG du nom de Terre des Hommes. Soulignons cependant que
les AVS n'interviennent que dans les établissements post-primaire et
secondaire. Par conséquent, leur avis sur cette question ne peut se
limiter qu'à leur zone d'intervention.
? Dispositions psychosociales
Les avis des AVS sur les services au profit des
élèves déplacés sont présentés dans
le tableau ci-après.
63
Tableau 16: Avis des AVS sur les services au profit des
élèves déplacés
|
Services au profit des élèves
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Accueil
|
2
|
66,7%
|
|
Inscription gratuite
|
1
|
33,3%
|
|
Restauration gratuite
|
3
|
100%
|
|
Espaces récréatifs
|
0
|
0,0%
|
|
Soins gratuits
|
0
|
0,0%
|
|
Autres
|
0
|
0,0%
|
|
néant
|
0
|
0,0%
|
|
TOTAL OBS.
|
3
|
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Dans ce tableau, le nombre de citations est supérieur
au nombre d'observations du fait de réponses multiples (6 au maximum).
Les AVS enquêtés ont montré qu'il existe trois services
dont bénéficient les élèves déplacés.
Il s'agit premièrement des conseils qui reçoivent trois citations
soit 100% du total des observations, suivi de l'accueil qui reçoit deux
citations soit 66,7% du total des observations et enfin l'inscription gratuite
qui reçoit une seule citation soit 33,3% du total des observations.
IV.2.1.3) Données recueillies auprès des
élèves déplacés ? Les dispositions
organisationnelles
Au niveau des élèves, notre objectif dans cette
section était de s'imprégner des conditions dans lesquelles les
élèves déplacés sont accueillis dans les
établissements d'accueil.
Tableau 17: Avis des élèves déplacés
sur les difficultés de réinscription
|
Difficultés à l'inscription
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
1
|
0,6%
|
|
Oui
|
102
|
58,6%
|
|
Non
|
64
|
36,8%
|
|
Ne sait pas
|
7
|
4,0%
|
|
TOTAL OBS.
|
174
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
Plus de la moitié des élèves
déplacés qui ont répondu à nos questionnaires
disent avoir eu des difficultés pour se réinscrire (58,6%). 36,8%
d'entre eux reconnaissent n'avoir pas eu de difficulté
64
et seulement 4% ne savent pas si leur réinscription
s'est fait avec des difficultés ou pas. Ces différents taux nous
permettent de dire que du point de vue des élèves
déplacés, la réinscription dans les établissements
d'accueil n'est pas toujours aisée. Le temps que ces
élèves ont passé à la maison avant leur
réinscription pourrait confirmer ces difficultés.
Tableau 18: Avis des élèves déplacés
sur le temps passé à la maison
|
Temps passé à la maison
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
1 mois environ
|
36
|
20,7%
|
|
2 mois environ
|
62
|
35,6%
|
|
Plus de 2 mois
|
76
|
43,7%
|
|
TOTAL OBS.
|
174
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
Selon le tableau ci-dessus, 43,7% des élèves
enquêtés ont passé plus de deux mois à la maison
après la fermeture de leurs établissements. 35,6% d'entre eux
estiment ce temps passé à la maison à environ deux mois et
20,7% estiment ce temps à environ un mois. Ces différentes
données viennent étayer l'opinion des élèves sur
les difficultés de réinscription et laissent apercevoir des
insuffisances de planification dans la réintégration scolaire des
élèves après la fermeture d'un établissement.
Dans la recherche du nouvel établissement, les parents
d'élèves ne semblent pas se mettre en marge même si cela
accuse souvent un retard.
Tableau 19: Avis des élèves déplacés
sur les facilitations de réinscription
|
Facilitation pour
l'inscription
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
5
|
2,9%
|
|
Mes parents
|
130
|
74,7%
|
|
Les autorités éducatives
|
47
|
27,0%
|
|
Personne
|
0
|
0,0%
|
|
TOTAL OBS.
|
174
|
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
65
Les élèves enquêtés estiment
à la majorité absolue (82,2%) que leur réinscription a
été facilitée par leurs parents. Seulement 14,4% d'entre
eux soutiennent qu'ils ont pu se réinscrire grâce à l'aide
des autorités éducatives. Lorsque nous analysons
profondément l'avis des élèves déplacés sur
cette question, on s'aperçoit que de leur point de vue, la facilitation
de leur inscription se résume au paiement des frais de
scolarité.
? Dispositions matérielles
Au niveau des élèves déplacés,
nous avons voulu savoir si après réinscription dans un
établissement d'accueil, ces élèves ont pu
bénéficier de soutien en fournitures scolaires et autres besoins
matériels et de qui ont-ils bénéficié de ce
soutien.
Tableau 20: Avis des élèves déplacés
sur les soutiens en fournitures scolaires
|
Soutien en fourniture scolaire
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
5
|
2,9%
|
|
Mes parents
|
130
|
74,7%
|
|
On nous a donné à l'école
|
47
|
27,0%
|
|
Un parrain
|
0
|
0,0%
|
|
TOTAL OBS.
|
174
|
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
Le nombre de citations est supérieur au total
d'observations du fait des réponses multiples (3 maximum). Les
données de ce tableau nous montrent que les parents sont les principaux
pourvoyeurs de fournitures scolaires aux élèves. Ils
bénéficient de 130 citations soit une fréquence de 74,7%.
Les dons reçus à l'école viennent en deuxième
position avec 47 citations soit une fréquence de 27%. Notons cependant
que les dons reçus à l'école englobent à la fois
les acquisitions de la part de l'Etat et éventuellement celles des ONG
et autres associations.
Les élèves déplacés
bénéficient-ils d'autres soutiens matériels ? A cette
question, les élèves enquêtés donnent leur opinion
dans le tableau ci-après.
66
Tableau 21: Opinions des élèves sur l'acquisition
de soutiens autres que les fournitures scolaires
|
Autres soutiens
|
Nb. citations
|
Fréquences
|
|
Non réponse
|
4
|
2,3%
|
|
Vivres
|
7
|
4,0%
|
|
Tenue scolaire
|
7
|
4,0%
|
|
Vélo
|
9
|
5,2%
|
|
Autres
|
2
|
1,1%
|
|
Aucun
|
149
|
85,6%
|
|
TOTAL OBS.
|
174
|
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
Le nombre de citations est supérieur au total
d'observations du fait des réponses multiples (4 maximum). Selon les
données fournies par le tableau ci-dessus, 85,6% des
élèves enquêtés disent n'avoir rien reçus
comme autres soutiens matériels tels que des moyens de
déplacement, des vêtements, des vivres etc. les soutiens en vivres
et vêtements reçoivent seulement 7 citations chacun, soit une
fréquence de 4% de part et d'autre. Par ailleurs, 9 citations ont
été accordées au soutien en moyen de déplacement,
soit une fréquence de 5,2%. Au regard de ces taux faibles, on pourrait
retenir que du point de vue des élèves, très peu
d'élèves déplacés ont pu bénéficier
d'autres soutiens matériels en dehors des kits scolaires.
? Dispositions psychosociales
En abordant les dispositions psychosociales, nous nous sommes
intéressés dans un premier temps aux sentiments des
élèves déplacés avant leur redéploiement
dans les différents établissements d'accueil.
Tableau 22: Sentiments des élèves avant
l'inscription dans l'établissement d'accueil
|
Sentiment avant
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
1
|
0,6%
|
|
Pas content
|
136
|
78,2%
|
|
Content
|
37
|
21,3%
|
|
TOTAL OBS.
|
174
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
Les données présentées dans le tableau
ci-dessus nous révèlent que 78,2% des élèves
enquêtés n'étaient pas contents avant leur
réintégration scolaire dans les établissements d'accueil.
Ils sont cependant 21%, ceux qui étaient contents malgré
l'interruption des cours suite à la fermeture de
67
leurs établissements. Par ailleurs, une seule personne
ne s'est pas exprimée sur cette question. Si la majorité des
élèves enquêtés disent ne pas être contents
avant leur intégration dans leurs établissements d'accueil, le
seront-ils après leur intégration ? Le tableau suivant
présente l'opinion des élèves déplacés sur
cette question.
Tableau 23: Sentiments des élèves après
intégration des établissements d'accueil
|
Sentiments après
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
5
|
2,9%
|
|
Pas content
|
31
|
17,8%
|
|
Content
|
138
|
79,3%
|
|
TOTAL OBS.
|
174
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
Les élèves déplacés semblent
apprécier leur intégration dans les établissements
d'accueil car selon les données présentées dans le tableau
26, seulement 17,8% des élèves enquêtés estiment ne
pas être contents dans leurs nouveaux environnements scolaires. La grande
majorité de ces élèves (79,3%) est contente de
réintégrer un établissement à nouveau.
Les élèves déplacés, pour leur
épanouissement dans un nouvel environnement scolaire, doivent
nécessairement bénéficier de certains services
psychosociaux de la part de leurs encadreurs. Ils ont exprimé leur
opinion sur l'existence de ces services dans les tableaux ci-après.
Tableau 24: Avis des élèves sur les services
psychosociaux bénéficiés
|
Services psychosociaux
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
1
|
0,6%
|
|
On nous donne des conseils
|
161
|
92,5%
|
|
On mange à la cantine scolaire
|
73
|
42,0%
|
|
On nous montre des jeux
|
15
|
8,6%
|
|
On nous soigne quand est malade
|
26
|
14,9%
|
|
Néant
|
6
|
3,4%
|
|
TOTAL OBS.
|
174
|
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
Le nombre de citations est supérieur au total
d'observations du fait des réponses multiples (4 maximum). Selon les
élèves enquêtés, les services dont ils
bénéficient sont premièrement les conseils qui totalisent
161 citations sur 174, ensuite la cantine scolaire (73 citations) et dans
une
68
certaine mesure les soins gratuits (26 citations). Nous avons
retenu les soins gratuits malgré la faible fréquence de citations
(14,9%) par supposition que seuls les élèves tombés malade
pourront avoir l'occasion de bénéficier de ce service. Par
contre, on ne peut pas considérer que ces élèves
bénéficient de jeux pour faciliter l'intégration sociale
car la fréquence de citation pour cette modalité (8,6%) est
très faible. Et pourtant, des jeux, s'il en existe, tous les
élèves pourraient en bénéficier.
Les élèves enquêtés se sont
également exprimés sur l'attitude du personnel éducatif
à leur égard.
Tableau 25: Avis des élèves sur l'attitude du
personnel éducatif
|
Attitude des encadreurs
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
2
|
1,1%
|
|
Ils sont gentils
|
164
|
94,3%
|
|
Ils sont méchants
|
0
|
0,0%
|
|
Ils nous donnent la parole régulièrement
|
91
|
52,3%
|
|
Ils ne nous écoutent pas
|
0
|
0,0%
|
|
TOTAL OBS.
|
174
|
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
Le nombre de citations est supérieur au total
d'observations du fait des réponses multiples (3 maximum). De l'avis des
élèves enquêtés, le personnel éducatif adopte
de bonnes attitudes à leur égard. En effet, selon les
données présentées dans le tableau 25, les
élèves estiment que les enseignants et le personnel administratif
et de la vie scolaire sont gentils envers eux. Cette modalité
reçoit 164 citations soit une fréquence de 94,3%. Ils estiment
par ailleurs que ces encadreurs leur donnent régulièrement
l'opportunité de s'exprimer pendant les activités
pédagogiques et socioéducatives. L'opportunité de prise de
parole reçoit 91 citations soit une fréquence de 52,3%.
IV.2.1.4) Entretiens réalisés avec les
autorités éducatives et les chefs de services
? Les dispositions organisationnelles
Les autorités éducatives et chefs de services se
sont prononcé sur les dispositions organisationnelles. Pour celles
liées à la sécurisation des domaines scolaires, les
personnes interviewées estiment qu'il n'y a pas un dispositif
particulier mis en place par l'administration sécuritaire pour
sécuriser les élèves et le personnel éducatif. Les
établissements scolaires bénéficient seulement du cadrage
d'ensemble prévu par l'administration sécuritaire pour
sécuriser la ville. Cependant, des démarches ont
été entreprises par les autorités éducatives
auprès du haut-
69
commissariat qui a bien voulu prendre attache avec les
services de la sécurité pour la sécurisation surtout des
élèves vivants dans les zones périphériques. Pour
ce qui est de la présence d'agents de sécurité à
proximité des établissements, l'administration sécuritaire
n'a pas honoré cette doléance car dit-elle, cela peut amener
l'ennemi à prendre les établissements pour cible. Par ailleurs,
des membres des administrations scolaires, des enseignants et des
élèves ont bénéficié d'une formation sur les
mesures de sécurité à adopter dans les
établissements scolaires en cas d'attaque. A ce sujet, un de nos
interviewés s'exprime : « nous avons reçu une formation
d'une semaine sur comment se mettre à l'abri en cas d'attaque et cela a
été suivie de simulations dans les établissements.
C'était vraiment instructive ».
S'agissant de l'accueil des élèves
déplacés, les autorités éducatives au niveau de
l'enseignement secondaire ont procédé à un
redéploiement des élèves, d'abord des classes d'examen et
ensuite des classes intermédiaires. Le redéploiement de ces
élèves a nécessité l'ouverture d'un nouvel
établissement nommé « classes d'accueil ou CEG d'accueil
». Aussi, le nouveau lycée communal qui disposait de salles a
été retenu comme site d'accueil. Toutefois, les
établissements scolaires tels que le CEG de Rimassa et de Bouna qui
pressentaient une fermeture éventuelle, ont eu une longueur d'avance en
se délocalisant dans d'autres locaux disponible dans la ville de Titao.
Certains établissements ont même procédé à
l'ouverture en leur sein, d'une classe spécifique pour accueillir des
élèves de classe d'examen qui accusaient un grand retard dans les
programmes d'enseignement. Au niveau de l'enseignement primaire, les directeurs
d'écoles par leurs propres initiatives ont emprunté des locaux ou
érigé des hangars pour augmenter les capacités d'accueil.
Aussi, l'ONG Educo par l'entremise de la direction provinciale a
accompagné les écoles à travers la construction de classes
temporaires.
? Dispositions matérielles
En recoupant les différentes interventions des
personnes interviewées, on retient qu'il n'y a pas d'accompagnement
particulier de la part des plus hautes autorités éducatives.
Cependant, des initiatives endogènes ont permis aux élèves
déplacés de bénéficier dès la rentrée
scolaire de kits scolaire. Par exemple, une autorité éducative
nous a fait entendre ceci : « au niveau des kits scolaires, il n'y a
pas eu un accompagnement particulier mais comme il fallait anticiper, nous
avons pu, à travers les quantités qui ont été mis
à notre disposition, prendre en compte ces enfants
déplacés dans la distribution des kits scolaires en début
d'année ». Par ailleurs, les établissements
70
scolaires ont reçu des dons en nature au profit des
élèves déplacés et du personnel éducatif.
Les principaux donateurs sont les ONG tels que Educo, DRC, Terre des Hommes et
des associations locales. Ces dons sont composés de table-bancs, de kits
d'hygiène, de frais de scolarité, de vivres, de lampes solaires,
de vêtements et de documents. Cependant, tous les élèves
déplacés n'ont pu bénéficier de ce soutien. Les
plus récentes vagues d'élèves déplacés
semblent être les plus favorisés.
? Dispositions psychosociales
La prise en charge psychosociale est l'une des principales
actions des ONG suscitées. Selon nos interlocuteurs, des psychologues
ont été commis à cette tâche. En effet, un
psychologue a été commis à la prise en charge des
enseignants qui vivent des stress suite à des menaces ou pour avoir
vécu de façon directe ou indirecte des situations de violence.
Par ailleurs, des enseignants, des AVS et des élèves ont
bénéficiés de formation à travers le projet Safe
school. Cette formation visait d'une part à outiller les acteurs de
l'éducation du minimum de savoir-faire en matière de prise en
charge psychosociale. Il s'agissait d'autre part de forger la résilience
des acteurs face au phénomène d'insécurité et leur
enseigner les bonnes habitudes et aptitudes à avoir en pareil
circonstance. Il faut souligner également que de l'avis des personnes
interviewées, les autorités éducatives, administratives et
sécuritaires ne se lassent pas d'effectuer des visites
régulières dans les établissements scolaires. Et cela est
beaucoup encourageant pour le personnel éducatif et les
élèves.
Tableau 26: Visualisation des tendances des réponses
des différents publics ciblent selon les trois sous variables de la
dimension no 1
|
dispositions organisationnelles
|
Dispositions matérielles
|
Dispositions psychosociales
|
|
Enseignants
|
+ ou -
|
+ ou -
|
+
|
|
AVS
|
+
|
+
|
+
|
|
Elèves déplacés
|
+ ou -
|
+ ou -
|
+
|
|
Autorités et chefs de service
|
+
|
+
|
+
|
Source : Conçu par mous même
Le signe (+) exprime des réponses tendant à dire
qu'il y a une effectivité des dispositions organisationnelles,
matérielles et psychosociales au bénéfice des
élèves déplacés tandis que le signe
71
(-) exprime une tendance exprimant le contraire. Enfin, le
signe (+ ou -) ne nous permet pas de décider de l'une ou de l'autre des
réponses précédentes.
IV.2.2) Les activités pédagogiques et
socioéducatives
Nous nous intéressons dans ce point à la prise
en charge pédagogique et socioéducative des élèves
déplacés.
IV.2.2.1) Données recueillies auprès des
enseignants ? Les activités
pédagogiques
Avant de s'imprégner de la prise en charge
pédagogique des élèves déplacés, nous avons
d'abord voulu nous assurer de leur présence effective dans les classes
tenues par nos enquêtés. Ainsi, la question suivante a
été posée aux enseignants interviewés : Existe-t-il
des élèves déplacés dans les classes que vous tenez
? Le tableau suivant présente les avis des enseignants sur cette
question.
Tableau 27: Avis des enseignants sur la présence
d'élèves déplacés dans leurs classes
|
Présence d'élèves
déplacés
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Oui
|
25
|
86,2%
|
|
Non
|
2
|
6,9%
|
|
Ne sait pas
|
2
|
6,9%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Selon les données présentées dans le
tableau ci-dessus, 86,2% des enseignants enquêtés confirment la
présence d'élèves déplacés dans leurs
classes à charge. Seulement 6,9% des enquêtés estiment ne
pas avoir d'élèves déplacés dans leurs classes. Par
ailleurs, 6,9% d'autres ne savent pas s'il existe ou non des
élèves déplacés dans leurs classes.
De l'avis des enseignants enquêtés, ces
élèves déplacés rencontrent beaucoup de
difficultés d'apprentissage. On pourrait citer les difficultés
d'adaptation, les retards de progression dans les cours, la forte psychose qui
les anime, le manque de documents, l'écart de compréhension des
cours, la timidité, le manque de concentration etc.
Pour pallier ces difficultés, des efforts
supplémentaires sont fournis par les enseignants. La manière de
procéder des enseignants diffère souvent d'un enseignant à
un autre mais de façon globale l'on retient que plusieurs
procédés s'intègrent au grand bonheur des apprenants. Il
s'agit notamment de
72
la mise en confiance de l'apprenant et des activités de
remise à niveau. En effet, selon un des enseignants
enquêtés, l'enseignant doit dans un premier briser les
barrières psychosociales entre lui et l'apprenant et ensuite mettre
l'accent sur l'explication et la ré-explication du cours. Par ailleurs,
beaucoup d'enseignants mettent l'accent sur les cours de rattrapage, les
travaux de groupe, le tutorat et les exercices à domicile.
Mais est-ce que les enseignants résolvent seuls les
difficultés de leurs élèves déplacés ? A
cette question, 41,4% des enseignants enquêtés disent associer
d'autres personnes à la résolution des difficultés des
élèves déplacés. Les personnes associées
sont les autres collègues enseignants, les AVS, les parents
d'élèves et l'action sociale par le recensement des
élèves en difficultés. Cependant, 37,9% des
enquêtés disent gérer seul ces difficultés et 20,7%
n'ont pas donné de réponse à cette question.
De l'avis des enseignants enquêtés, les
élèves déplacés semblent apprécier l'action
pédagogique des enseignants. Le tableau suivant présente la
régularité des élèves déplacés aux
activités d'apprentissage.
Tableau 28: Opinions des enseignants sur l'assiduité et la
ponctualité des élèves aux cours
|
Régularité au cours
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
6
|
20,7%
|
|
Absentéistes
|
6
|
20,7%
|
|
Assidus
|
14
|
48,3%
|
|
Ponctuels
|
10
|
34,5%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Le nombre de citations est supérieur au total des
observations du fait des réponses multiples (2 au maximum). Dans ce
tableau, le nombre de citations en faveur de l'assiduité des
élèves déplacés aux cours est de 14 sur 29
observations soit une fréquence de 48,3% et le nombre de citations en
faveur de leur ponctualité est de 10 sur 29 soit une fréquence de
34,5%. L'absentéisme reçoit 6 citations soit une fréquence
de 20,7%. Six (6) personnes ne se sont pas exprimées sur cette question.
Ces non réponses pourraient s'expliquer par le fait que ces enseignants
n'ont pas d'élèves déplacés dans leurs classes
à charge. Ainsi, de l'avis des enseignants enquêtés, les
élèves déplacés sont assidus aux cours. Quant
à leur ponctualité, les avis recueillis ne nous permettent pas
d'affirmer de
73
façon absolue son effectivité. Du reste,
l'absentéisme ne semble pas être une habitude pour ces
élèves.
Si les enseignants semblent être engagés à
accompagner les élèves déplacés dans la
résolution des difficultés scolaires, le soutien des hautes
autorités éducatives n'est cependant pas à la hauteur de
leurs attentes. En effet, dans ce contexte d'éducation en situation de
crise sécuritaire, les enseignants manquent de formations continues en
lien avec les approches pédagogiques, qui en réalité
pourraient favoriser une prise en pédagogique adéquate. Seulement
3.4% des enseignants enquêtés (cf. tableau 11) reconnaissent avoir
reçu, dans le contexte d'éducation en situation de crise
sécuritaire, une formation en lien avec les approches
pédagogiques. Les formations sont axées uniquement sur la prise
en charge psychosociale (cf. tableau 11). Par ailleurs, selon l'opinion des
enseignants enquêtés, les besoins en matériels
pédagogiques et didactiques ne sont pas satisfaits.
Tableau 29: Opinions des enseignants sur la satisfaction en
besoins de matériels pédagogiques et didactiques
|
Satisfaction des besoins
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Oui
|
24
|
82,8%
|
|
Non
|
5
|
17,2%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
A la lecture du tableau ci-dessus, 24 enseignants sur 29
disent avoir des besoins en matériels pédagogiques et didactiques
non satisfaits soit une fréquence de 82,8%. Seulement 17,2% des
enseignants enquêtés ont une satisfaction de leurs besoins en
matériels pédagogiques et didactiques.
Au regard du manque de formation en approches
pédagogiques et des besoins non satisfaits en matériels
pédagogiques et didactiques, l'on pourrait donc dire que la satisfaction
personnelle dans le service rendu à des enfants en détresse est
la principale motivation qui accompagne les enseignants dans leurs
engagements.
? Les activités socioéducatives
Les activités récréatives et
socioéducatives que l'on rencontre le plus souvent dans les
établissements d'enseignement sont les sketchs, les sorties
détente, les compétitions inter-établissements, les
sensibilisations, les activités génératrices de revenus,
les conférences etc. Nous
74
avons donc voulu savoir comment les élèves
déplacés sont impliqués dans ces activités
toutefois s'il en existait. Tout d'abord, quel est l'avis des enseignants
enquêtés sur l'existence de ces activités dans les
établissements scolaires de la ville de Titao ?
Tableau 30: Avis des enseignants sur la pratique
d'activités socioéducatives
|
Activités socioéducatives
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
2
|
6,9%
|
|
Sketch
|
5
|
17,2%
|
|
Sorties détentes
|
2
|
6,9%
|
|
Compétitions inter-établissements
|
3
|
10,3%
|
|
Sensibilisations
|
18
|
62,1%
|
|
Activités génératrices de revenus
|
4
|
13,8%
|
|
Conférences
|
3
|
10,3%
|
|
Néant
|
6
|
20,7%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Le nombre de citations est supérieur au nombre
d'observations du fait des réponses multiples (6 au maximum). Dans le
tableau, on peut constater que les activités telles que les sketchs, les
compétitions inter-établissements, les AGR et les
conférences reçoivent chacun une fréquence de citation
situé entre 10 et 20%, les activités de sensibilisations sont les
plus pratiquées avec une fréquence de citation de 62,1%. Les
sorties détentes sont moins effectuées avec une fréquence
de citation de 6,9%.
A la question de savoir qui organise ces activités, les
enseignants enquêtés citent plusieurs acteurs. Tableau 31: Avis
des enseignants sur les organisateurs des activités
socioéducatives
|
Organisateurs
|
Nb. Citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
7
|
24,1%
|
|
Moi
|
10
|
34,5%
|
|
D'autres enseignants
|
14
|
48,3%
|
|
Des élèves
|
11
|
37,9%
|
|
Des personnes extérieures
|
6
|
20,7%
|
|
Ne sait pas
|
2
|
6,9%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
75
Le nombre de citations est supérieur au nombre
d'observations du fait des réponses multiples (4 au maximum). Les
résultats du questionnaire adressé aux enseignants
révèlent que les personnes impliquées dans l'organisation
des activités récréatives et socioéducatives sont
les enseignants (48,3% de citations), les élèves (37,9% de
citations) et des organisateurs extérieurs (20,7%). Par ailleurs, 34,5%
des enseignants enquêtés disent être eux-mêmes
impliqués dans l'organisation de ces activités. Quant à la
participation des élèves déplacés, la
majorité des enseignants enquêtés estiment qu'ils sont y
impliqués.
Tableau 32: Avis des enseignants sur la participation des
élèves déplacés aux activités
socioéducatives
|
Participation des élèves
déplacés
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
7
|
24,1%
|
|
Oui
|
16
|
55,2%
|
|
Non
|
0
|
0,0%
|
|
Ne sait pas
|
6
|
20,7%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Selon les résultats du questionnaire adressé aux
enseignants, sept (7) personnes ne se sont pas exprimées sur cette
question et six (6) ne savent pas si les élèves
déplacés participent aux activités
récréatives et socioéducatives. Ces deux catégories
d'observations pourraient être attribuées aux enseignants
enquêtés qui ne tiennent pas des élèves
déplacés. Leurs observations récoltent un taux
cumulé de 44,8%. Nous constatons également que 55,2% des
enseignants enquêtés sont d'avis que les élèves
déplacés participent aux activités
récréatives et socioéducatives organisées dans
leurs établissements d'accueil. Les propos suivants viennent des
enseignants expliquant comment ils impliquent les élèves
déplacés dans ces activités :
y' Nous les associons aux élèves non
déplacés lors de ces activités
y' ils participent librement comme les autres
élèves
y' ils participent au même titre que les autres
élèves
y' les élèves déplacés sont
intégrer aux autres élèves dans toutes les
compétitions
y' ils participent à travers les jeux de rôles
y' nous les incitons à la prise de parole en leur confiant
des responsabilités
76
IV.2.2.2) Données recueillies auprès des
AVS
Les AVS donnent ici leurs opinions sur la conception et la
pratique d'activités pédagogiques et socioéducatives.
? Les activités pédagogiques
Tableau 33: Avis des AVS sur la pratique d'activités
pédagogiques
|
Activités pédagogiques
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
1
|
33,33%
|
|
Oui
|
1
|
33,33%
|
|
Non
|
1
|
33,33%
|
|
TOTAL OBS.
|
3
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Des trois AVS enquêtés, un seul dit concevoir des
activités de remise à niveau au profit des élèves
déplacés. Mais à la question de savoir comment il organise
ces activités, il répond que ces activités sont
organisées en séance de sensibilisations. La sensibilisation peut
être considérée comme une activité
socioéducative ou même une action psychosociale. Cependant, si
elle est orientée vers l'organisation du travail pédagogique,
elle peut être considérée comme une activité
pédagogique. Mais au regard des attributions des AVS dans
établissement scolaire, on pourrait penser que la réponse
donnée par notre enquêté s'oriente plus vers des actions
socioéducatives et psychosociales.
? Les activités socioéducatives
Les avis des AVS sur la pratique des activités
socioéducatives sont présentés dans le tableau
ci-après.
Tableau 34: Avis des AVS sur la pratique d'activités
socioéducatives
|
Activités socioéducatives
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Sketchs
|
0
|
0,0%
|
|
Sorties détentes
|
0
|
0,0%
|
|
Compétitions inter-établissements
|
2
|
66,7%
|
|
Sensibilisations
|
3
|
100%
|
|
Activités génératrices de revenus
|
0
|
0,0%
|
|
Autres
|
0
|
0,0%
|
|
Néant
|
0
|
0,0%
|
|
TOTAL OBS.
|
3
|
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
77
Le nombre de citations est supérieur au nombre
d'observations du fait des réponses multiples (6 au maximum). Dans le
tableau, on peut constater que du point de vue des AVS, les sensibilisations et
les compétitions inter-établissements sont les seules
activités socioéducatives menées dans les
établissements scolaires. Quant à l'organisation de ces
activités, les acteurs impliqués sont les AVS eux-mêmes,
les enseignants et les élèves. Ils estiment aussi que les
élèves déplacés participent à ces
activités au même titre que les élèves non
déplacés sans discrimination ni stigmatisation. Des postes de
responsabilité leur sont accordés et ils reçoivent
l'accompagnement des acteurs dans leurs tâches.
IV.2.2.3) Données recueillies auprès des
élèves déplacés
? Les activités pédagogiques
Les élèves enquêtés ont
été d'abord interrogés sur leur capacité à
assimiler les cours dans leurs établissements d'accueil. Sur cette
question, beaucoup d'élèves déplacés semblent ne
pas rencontrer d'énormes difficultés. Leur opinion est
présentée dans le tableau ci-après.
Tableau 35: Opinions des élèves
déplacés sur leur capacité à apprendre
|
Capacité à apprendre
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
2
|
1,1%
|
|
Oui
|
126
|
72,4%
|
|
Non
|
46
|
26,4%
|
|
TOTAL OBS.
|
174
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
Selon les données présentées dans le
tableau ci-dessus, la majorité des élèves
déplacés (72,4%) ne rencontre pas de difficultés majeures
d'apprentissage dans leur nouvel environnement scolaire. Les
élèves qui disent rencontrer des difficultés
d'apprentissage sont au nombre de 46 et représentent 26,4% des
élèves enquêtés. Ce taux est moins important mais en
contexte d'éducation pour tous, cette proportion d'élèves
n'est pas à négliger.
Pour pallier ces difficultés, le corps enseignant dit
entreprendre plusieurs initiatives que nous avons présentées dans
le point (IV.2.2.1). Existe-t-il un accompagnement extra-scolaire pour ces
élèves en difficultés ?
78
Tableau 36: Point de vue des élèves sur l'existence
d'activités de soutien extra-scolaire
|
Types d'activités de soutien
Existence d'activités de soutien
|
Non Réponse
|
Cours à domicile
|
Cours de soutien en
groupe
|
Autres
|
TOTAL
|
|
Oui
|
0
|
15
|
32
|
5
|
52
|
|
Non
|
130
|
2
|
1
|
0
|
133
|
|
TOTAL
|
130
|
17
|
33
|
5
|
185
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque
couple de modalité. La majorité des élèves
enquêtés dit ne pas avoir de soutien dans les apprentissages en
dehors de ce qu'ils reçoivent à l'école. Seulement
quelques-uns disent bénéficier d'un soutien extra-scolaire dans
les apprentissages. Lorsque nous faisons un lien entre l'existence
d'activités de soutien extra-scolaire et le type d'activité, il
ressort que seulement 15 des 174 élèves enquêtés
reçoivent des cours à domicile, 32 élèves
reçoivent des cours de soutien en groupe et 5 élèves
reçoivent des soutiens autres que les cours à domicile et les
cours de soutien en groupe.
? Les activités socioéducatives
Les avis des élèves déplacés sur
la pratique d'activités socioéducatives sont
présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 37: Opinions des élèves
déplacés sur la pratique d'activités
socioéducatives
|
Activités socioéducatives
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
1
|
0,6%
|
|
On joue au ballon
|
81
|
46,6%
|
|
On fait théâtre
|
9
|
5,2%
|
|
On nettoie notre école
|
130
|
74,7%
|
|
On organise des sorties
|
10
|
5,7%
|
|
Autres
|
21
|
12,1%
|
|
TOTAL OBS.
|
174
|
|
Source : Enquête de terrain, juin et
octobre 2020
Les élèves déplacés mènent
des activités socioéducatives dans leur nouvel environnement
scolaire. Selon les élèves enquêtés, ces
activités se résument aux traditionnelles activités des
élèves en milieu scolaire tel que le football, le nettoyage de la
cours de l'école. Ces activités sont organisées par des
enseignants et d'autres élèves.
79
IV.2.2.3) Entretiens réalisés avec les
autorités éducatives et les chefs de services
? Les activités pédagogiques
Selon les autorités éducatives et les chefs de
service avec qui nous nous sommes entretenus, le problème
pédagogique majeur auquel les enseignants font face est le grand retard
accusé par les élèves déplacés dans les
programmes d'enseignement. Pour pallier les difficultés
engendrées par ce retard, des actions pédagogiques sont
entreprises. Ainsi, du côté de l'encadrement pédagogique,
des conseils sont prodigués aux enseignants. Les propos suivants sont
issus de nos entretiens :
Propos no 1
Nous avons reçu tous les professeurs commis à la
classe de 3e de Ouindigui et de Tollo (très en retard) pour
un partage d'expériences. Comment aller vite et concrètement avec
les élèves ? Je leur ai répété ce qu'un de
nos encadreurs nous a dit. Je cite : « l'éducation en situation
d'urgence recommande d'aller à l'essentiel et de faire beaucoup
d'exercices. Trier l'essentiel et faire beaucoup d'exercices.
Propos no 2
Il n'y a pas eu de façon formelle une formation
particulière mais quand nous sortons, ce que nous prodiguons comme
conseils à nos enseignants, qui ne manquent pas de façon
récurrente de soulever les difficultés, c'est d'appliquer la
pédagogie différenciée, de décrocher ces
élèves afin qu'ils puissent acquérir ceux dont il est
nécessaire pour pouvoir apprendre plus aisément la notion qu'il
faut leur enseigner. C'est difficile dans les classes mais nous pensons que les
enseignants abattent un travail colossal. C'est comme si tu tenais deux
divisions à la fois. Tu as par exemple un CM1 avec des
élèves qui n'ont pas le niveau CM1. Il faut donc leur apprendre
en aparté afin de leur permettre de cerner les notions
antérieures qui doivent leur permettre de cerner facilement la notion
que tu es entrain d'enseigner.
Les autorités éducatives et chefs de services
reconnaissent par ailleurs que les enseignants font un don de soi dans leurs
actions pédagogiques en faveur des élèves
déplacés. En effet, les enseignants sont engagés
volontairement et sans désintéressement à dispenser des
cours de rattrapages et de soutien pendant les temps libres.
? Les activités
socioéducatives
A travers les entretiens avec les autorités
éducatives et les chefs de services, il revient de façon
récurrente qu'en dehors des activités socioéducatives
traditionnelles pratiquées dans les établissements telles les
interclasses, d'autres activités ludiques ne sont pas pratiquées
en faveur des élèves déplacés. D'ailleurs
pensent-ils que la priorité est d'aider les élèves
à rattraper leur retard
80
et de créer un minimum de conditions agréables
de vie pour eux. Cependant, ils reconnaissent qu'à travers la formation
Safe School, les enseignants ont effectivement acquis des aptitudes qui leur
permettent d'organiser des jeux adaptés à permettre aux enfants
de dériver les angoisses.
Tableau 38: Visualisation des tendances des réponses
des différents publics cibles selon les deux variables de la dimension
no 2
|
Activités pédagogiques
|
Activités socioéducatives
|
|
Enseignants
|
+
|
+ ou -
|
|
AVS
|
+
|
+ ou -
|
|
Elèves déplacés
|
+ ou -
|
+
|
|
Autorités et chefs de service
|
+
|
+ ou -
|
Source : Conçu par nous même
Le signe (+) exprime des réponses tendant à dire
qu'il y a une effectivité des activités pédagogiques te
socioéducatives spécifiques au bénéfice des
élèves déplacés tandis que le signe (-) exprime une
tendance exprimant le contraire. Enfin, le signe (+ ou -) ne nous permet pas de
décider de l'une ou de l'autre des réponses
précédentes.
IV.2.3) La mobilisation de la communauté locale
Les différents acteurs se sont également
prononcés sur la mobilisation sociale de la communauté locale
autour de l'action éducative.
IV.2.3.1) Données recueillies auprès des
enseignants
A la question de savoir si la communauté locale se
mobilise autour des actions éducatives, nos répondants au niveau
des enseignants ont des avis partagés. Les résultats de leurs
avis sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 39: Avis des enseignants sur la mobilisation de la
communauté locale
|
Mobilisation de la communauté
locale
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Non réponse
|
2
|
6,9%
|
|
Oui
|
12
|
41,4%
|
|
Non
|
15
|
51,7%
|
|
TOTAL OBS.
|
29
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
81
Des 29 enseignants enquêtés, 12 sont d'avis que
la communauté locale accompagne les administrations scolaires dans la
gestion éducative soit une fréquence d'avis positifs de 41,4%.
Cependant, 51,7% de nos répondants admettent qu'elle ne s'y implique.
Par ailleurs, 6,9% des enseignants enquêtés ne se sont pas
exprimés sur cette question. Les enseignants qui estiment que la
communauté locale se mobilise autour de l'action éducative disent
également qu'elle s'y implique à l'occasion des
compétitions sportives et des journées culturelles; pendant les
activités de clôture de l'année scolaire ; pendant les
moments de sensibilisations ; pendant les examens scolaires.
IV.2.3.2) Données recueillies auprès des
AVS
Le tableau suivant présente les avis des AVS sur la
participation de la communauté locale à l'action
éducative.
Tableau 40: Avis des AVS sur la mobilisation de la
communauté locale
|
Mobilisation de la
communauté locale
|
Nb. citations
|
Fréquence
|
|
Oui
|
2
|
66,7%
|
|
Non
|
1
|
33,3%
|
|
TOTAL OBS.
|
3
|
100%
|
Source : Enquête de terrain, juin 2020
Selon les données recueillies auprès des AVS,
ils admettent à la majorité (66,7%) que la communauté
locale participe à l'action éducative. Leur implication se
perçoit à travers leur participation aux séances de
sensibilisations et conseils des élèves déplacés,
aux compétions interclasses. Ils contribuent également à
rendre disponible des table-bancs au profit des élèves
déplacés.
IV.2.3.3) Entretiens réalisés avec les
autorités éducatives et les chefs de services
La participation de la communauté locale à
l'action éducative dans le contexte d'éducation en situation de
crise sécuritaire est unanimement reconnue par les autorités
éducatives et les différents chefs de services. Certains
affirment que leurs premiers partenaires au niveau de la communauté
locale sont les APE qui sont toujours prompts à agir. L'action des APE
se perçoit au niveau organisationnel, matériel et
psychosocial.
82
Au niveau organisationnel et matériel, les
administrations scolaires ont pu par le biais des APE, mener des
échanges avec la communauté locale. Ce qui a abouti à
l'installation de comités de veille et cela dans la quête de
résilience face au nouveau contexte d'insécurité. Par
ailleurs, dans la majorité des établissements, les parents
d'élèves se sont retournés dans les villages où les
écoles sont fermées pour ramener des table-bancs au profit des
élèves déplacés. Aussi, dans certains
établissements, les APE ne se font prier pour apporter leur modeste
contribution. Elles s'attèlent à la réhabilitation d'un
toit décoiffé, elles accompagnent en termes de dotation en rames,
ancres etc. En outre, les communautés religieuses apportent leurs
contributions. En effet, les communautés musulmane et catholique ont,
sous l'égide du haut-commissariat et du COPROSUR, trouvé des
familles d'accueil pour des élèves déplacés. Aussi,
la communauté catholique a essayé d'apporter son aide dans la
quête de locaux à usage de salles de classes en offrant ses locaux
pour l'accueil des élèves déplacés. Mais selon les
informations que nous avons reçues d'une autorité
éducative, ce soutien n'a pas été effectif par crainte de
représailles des groupes terroristes.
Au niveau psychosocial, des relais communautaires ont
été identifiés dans les différentes
communautés qui doivent toujours remonter l'information. Ils travaillent
en tandem avec le psychologue pour prendre en charge les cas de stress. Dans
les établissements, les APE contribuent également aux
sensibilisations, conseils et encouragements des élèves
déplacés dans les classes.
IV.2.3.4) Entretiens réalisés avec les
parents d'élèves
Selon les parents d'élèves avec qui nous avons
eu les entretiens, un effort à la hauteur de leur possibilité a
été fait pour accompagner les administrations scolaires dans la
prise en charge scolaire des élèves déplacés.
Même si dans les villages qui manquaient d'organisation, les
élèves déplacés étaient
éparpillés dans les différents établissements de la
ville de Titao, il convient de reconnaitre que certains APE
d'établissements fermés mieux organisées ont pu avoir des
locaux dans la ville de Titao pour reloger leurs élèves. Cela a
également nécessité de leur part le rapatriement du
matériel nécessaire tel que les table-bancs et autres
matériels de bureau vers les nouveaux cites identifiés dans la
ville de Titao. En outre, l'accompagnement des APE se fait à travers un
appui-conseil aux élèves déplacés pendant leurs
passages dans les classes et aussi un soutien financier aux activités
socioculturelles et en consommables de bureau. Par ailleurs, des initiatives
locales ont permis à des APE de construire des hangars
améliorés dans des établissements de la ville de
83
Titao pour accueillir le flux d'élèves
déplacés. La photo suivante est une illustration des oeuvres des
parents d'élèves.
Figure 2: Hangar réalisé par des parents
d'élèves

Source : Photo prise par nous
même
Des organisations d'aide humanitaire telle que
Solidarités International se sont inspirées de l'initiative des
parents d'élèves pour offrir à des établissements
scolaires de la ville de Titao des hangars du même modèle que
celui présenté ci-dessus mais plus améliorés. La
construction de ces hangars a été un soulagement pour les acteurs
de l'éducation et les parents d'élèves. En effet, les
autorités éducatives et les parents d'élèves dans
la ville de Titao avaient, à un moment donné,
épuisé les alternatives immédiates qui consistaient
à emprunter des bâtiments non occupés de la ville pour en
faire des salles de classes.
84
Figure 3: Hangar réalisé par l'ONG
Solidarité Internationale

Source : Photo prise par nous
même
De l'avis des parents d'élèves, le rôle de
la communauté locale dans la prise en charge scolaire des
élèves déplacés semble peu visible mais très
importante. En effet, à la faveur des liens familiaux entre les
villages, beaucoup d'élèves déplacés ont pu
recevoir dans l'immédiat des familles d'accueil. Ils reconnaissent
cependant que le nombre des élèves déplacés en
auto-hébergement n'est pas négligeable.
Tableau 41: Visualisation des tendances des réponses
des différents publics cibles concernant la dimension no 3
|
Tendance des réponses
|
|
Enseignants
|
+ ou -
|
|
AVS
|
+
|
|
Autorités et chefs de service
|
+
|
|
Parents d'élèves
|
+
|
Source : Conçu par nous même
85
Le signe (+) exprime des réponses tendant à dire
qu'il y a une forte mobilisation sociale tandis que le signe (-) exprime une
tendance à dire qu'il y a absence de mobilisation sociale. Enfin, le
signe (+ ou -) ne nous permet pas de décider de l'une ou de l'autre des
réponses précédentes.
IV.2.3.5) Synthèse de l'analyse des données
recueillies
Il s'agit ici de faire la synthèse de nos
différentes analyses afin de pouvoir confronter les différents
points vue.
? Les dispositions organisationnelles, matérielles
et psychosociales
En résumé, les enseignants et les
élèves enquêtés ont une position dubitative quant
à l'effectivité des dispositions organisationnelles dans la prise
en charge scolaire des élèves déplacés. Certains,
mais pas la majorité absolue, réfutent l'existence de ces
dispositions organisationnelles. Ils pointent du doigt la pléthore des
élèves dans les classes, ce qui est la conséquence d'un
manque d'infrastructures d'accueil. Par ailleurs, ils estiment que les domaines
scolaires ne sont pas suffisamment sécurisés pour favoriser un
travail dans la quiétude. Aussi, pensent-ils que l'autorité
éducative ne dispose pas de système performant de
réintégration des élèves déplacés.
D'autres cependant, pensent que des dispositions sur le plan organisationnel
sont prises pour accueillir et intégrer les élèves
déplacés. Ils citent la mise en place de cellules de veille dans
les établissements scolaires, ils reconnaissent par ailleurs que les
enseignants bénéficient de formations continues en lien avec la
prise en charge psychosociale des élèves déplacés.
Les AVS et les autorités éducatives partagent le même point
de vue sur l'existence de formations au profit du personnel éducatif.
Ils s'accordent par ailleurs avec la minorité d'enseignants qui
reconnaissent l'existence de cellules de veille dans les établissements
scolaires. Aussi, évoquent-ils les délocalisations
d'établissements des campagnes vers le centre-ville de Titao,
l'ouverture d'établissements d'accueil, la construction de classes
temporaires, le redéploiement du personnel éducatif et du
matériel des établissements fermés vers les
établissements de la ville de Titao. Quant aux effectifs des
élèves dans les classes, ils estiment que la priorité
c'est de pouvoir scolariser à nouveau les élèves
déplacés que de respecter des effectifs dans des classes.
Pour ce qui est des dispositions matérielles, les
enseignants enquêtés sont en majorité d'avis qu'ils ne sont
pas pédagogiquement outillés pour prendre en charge les
élèves déplacés. Aussi, ces élèves
86
déplacés ne bénéficient pas de
soutien dans l'acquisition des fournitures et autres matériels
scolaires. Les élèves déplacés que nous avons
interrogés soutiennent également la thèse des enseignants
sur l'octroi de fournitures scolaires. Seulement 27% des élèves
enquêtés ont reçu des kits scolaires dans leurs
établissements d'accueil. Par ailleurs, ils sont insignifiants, ceux qui
bénéficient d'autres matériels tels que des vivres, des
vêtements ou des moyens de déplacement. Pour eux, les parents sont
les principaux pourvoyeurs de tous ces besoins. Les AVS, pour leur part, n'ont
pas été interrogés sur la disponibilité du
matériel pédagogique mais pour ce qui est des fournitures
scolaires, leur avis contraste avec celui des enseignants et des
élèves car estiment-ils que les élèves
déplacés bénéficient de soutien en fournitures
scolaires. A ce sujet, les autorités éducatives et les chefs de
services reconnaissent que des dispositions particulières ne sont pas
prises en faveur des élèves déplacés par
l'administration scolaire. Cependant, pour les élèves du
primaire, les fournitures scolaires leur étaient déjà
données à la faveur de la politique de gratuité scolaire.
Par ailleurs, les organismes d'aide humanitaire font dons de matériels
divers mais malheureusement ces dons n'atteignent pas la majorité des
élèves déplacés.
En confrontant les informations recueillies auprès des
enseignants, des AVS, des élèves déplacés et des
autorités sur les dispositions psychosociales, il ressort que les
élèves déplacés bénéficient d'un
certain traitement psychosocial à même de garantir une certaine
quiétude dans leur nouvel environnement d'apprentissage. En effet, les
élèves déplacés sont accueillis, ils
bénéficient d'une inscription dès qu'ils se
présentent dans un établissement, ils bénéficient
de conseils et de la cantine scolaire. Cette prise en charge est rendue
possible grâce à l'engagement volontaire des acteurs
éducatifs d'une part mais aussi grâce à l'accompagnement
des partenaires sociaux par le renforcement de capacités du personnel
éducatif sur la prise en charge psychosociale.
? Activités pédagogiques et
socioéducatives
Les enseignants, les AVS, les autorités
éducatives et les chefs de services enquêtés s'accordent
sur le fait que des activités pédagogiques sont initiées
au profit des élèves déplacés. Pour ce qui est de
la faisabilité, les enseignants organisent individuellement ou de
façon concertée des cours de rattrapage et des travaux de groupe.
En effet, le cours de rattrapage est un cours dispensé aux
élèves qui ont accusé un retard dans l'évolution
des programmes d'enseignement. Pour certains enseignants, les
élèves déplacés qui ont des difficultés
d'apprentissage sont intégrés dans des groupes de travail
où des tuteurs leur sont désignés. Il s'agit ici de
promouvoir la paire-éducation.
87
En effet, l'élève tuteur est cet
élève parmi ses paires qui peut orienter ses camarades en
l'absence de l'enseignant. Les enseignants bénéficient par
ailleurs d'un appui-conseil de la part des encadreurs pédagogiques sur
les méthodes de travail. Il convient cependant de noter que de l'avis
des élèves enquêtés, ces activités
pédagogiques d'appui ne sont pas soutenues par les parents
d'élèves. En effet, en dehors des sacrifices fournis par les
enseignants à l'école, les élèves
déplacés dans leur majorité ne bénéficient
pas d'autres encadrements à domicile. Pour ce qui est des
activités socioéducatives, les acteurs s'accordent à dire
que seuls les interclasses et les activités de salubrité sont
plus menées. Et les élèves déplacés sont
impliqués au même titre que les autres élèves et ce,
dans un souci de favoriser une meilleure intégration de ces
élèves. Des activités ludiques spécifiques au
profit des élèves déplacés ne semblent donc pas
être la vraie priorité du point de vue du personnel
éducatif. En effet, de nos entretiens avec les autorités
éducatives, il ressort que les enseignants ont
bénéficié, à travers le projet Safe School, de
compétences pour implémenter de jeux dénommés
« Les couleurs parlent », « Carrés coopératifs
», « Balle de l'éléphant », « Saule dans le
vent ». Mais dans les établissements, ni les enseignants, ni les
élèves ne citent ces jeux parmi les activités
socioéducatives pratiquées.
? Mobilisation de la communauté
locale
En dehors des enseignants dans leur minorité qui
circonscrivent l'action éducative de la communauté locale aux
tâches ordinaires des APE (soutien à l'occasion des
compétitions sportives et des journées culturelles; pendant les
activités de clôture de l'année scolaire ; pendant les
moments de sensibilisations ; pendant les examens scolaires), les autres
strates enquêtées s'accordent à reconnaitre
l'élargissement de l'accompagnement de la communauté locale
à d'autres domaines aussi importants. Ils sont unanimes que la
communauté locale s'investit dans deux domaines importants :
l'appui-conseil et la logistique. En effet, elle participe activement à
des activités telles que :
y' les séances de sensibilisations et de conseils ;
y' la recherche des sites de relocalisation des
élèves déplacés
y' l'aide au redéploiement du matériel
éducatif vers les nouveaux sites identifiés ;
y' la construction de hangars temporaires pour recevoir les
élèves déplacés ;
y' l'implication dans les cellules de veille ;
y' l'hébergement des élèves
déplacés rendu possible grâce aux liens familiaux ;
88
CHAPITRE V : VERIFICATION DES HYPOTHESES
DE
RECHERCHE, LIMITES ET RECOMMANDATIONS
V.1) vérification des hypothèses
A l'issue de la présentation, de l'analyse et de
l'interprétation des résultats de nos enquêtes, nous nous
intéressons à présent à la vérification de
nos hypothèses de recherche.
V.1.1) Vérification de l'hypothèse no 1
Selon notre hypothèse secondaire no 1, Les
administrations scolaires prennent des dispositions pertinentes du point de vue
organisationnel, matériel et psychosocial en vue d'assurer la
continuité de la scolarisation des enfants et adolescents
déplacés dans la commune de Titao. Qu'en est-il ?
A travers la revue de littérature, nous avons pu
constater qu'en situation de crise sécuritaire occasionnant des
déplacements de populations, les enfants et adolescents
déplacés bénéficient d'offres éducatives
afin que leur droit à l'éducation soit respecté.
MAGALI(2010) dépeint cette situation avec l'exemple des
réfugiés libériens en Côte d'Ivoire. En effet, les
enfants de ces réfugiés bénéficiaient soit d'une
inscription dans des écoles parallèles ou une intégration
dans le système éducatif ivoirien ou les deux trajectoires
scolaires de façon alternée. S'agissant du contexte
burkinabè, la réintégration des élèves
déplacés dans des établissements d'accueil, l'adoption de
comportements résilients et l'accompagnement psychosocial des
élèves déplacés font partie des défis de
notre système éducatif et inscrits dans la SSEZDS. Après
confrontation des données recueillies, les différentes strates
enquêtées s'accordent dans leur majorité que les
administrations scolaires prennent des dispositions pour accueillir les
élèves déplacés, outiller le personnel
éducatif et les élèves de stratégies de
résilience face aux attaques terroristes, accompagner les
élèves déplacés à travers des conseils et
des encouragements. Ces mesures ont permis la réintégration
scolaire des élèves déplacés qui se sont
présentés dans des établissements scolaires fonctionnels
dans la commune de Titao. Par ailleurs, les élèves
déplacés se sentent heureux de réintégrer un
environnement scolaire plus sécurisé et de poursuivre à
nouveau leur cursus scolaire. De ce qui précède, nous pouvons
admettre que Les administrations scolaires prennent des dispositions
pertinentes du point de vue organisationnel, matériel et psychosocial en
vue d'assurer la continuité
89
de la scolarisation des enfants et adolescents
déplacés dans la commune de Titao. Notre hypothèse
no 1 est donc validée.
V.1.2) Vérification de l'hypothèse n°
2
Selon notre hypothèse secondaire no 2, les
enseignants et les animateurs de la vie scolaire conçoivent et mettent
en pratique des activités pédagogiques et socioéducatives
pertinentes et adaptées au profit des enfants et adolescents
déplacés dans la commune de Titao.
Sanchez-Mazas et al (2018) décrivent différentes
méthodes appliquées par des enseignants suisses dans la prise en
charge scolaire d'enfants de demandeurs d'asile. Il s'agit par exemple du
tandem d'enseignants de classes d'accueil et de l'implication dans l'action
pédagogique et socioéducative, de volontaires qui jouent le
rôle de relais entre l'école et les familles. Après analyse
des données recueillies auprès de nos personnes ressources, nous
sommes parvenus à la conclusion selon laquelle les enseignants, dans les
établissements d'enseignement primaire, post-primaire et secondaire de
la ville de Titao organisent des cours de rattrapage, des travaux de groupes au
profit des élèves déplacés. Aussi, dans des groupes
de travail, des élèves tuteurs sont désignés pour
accompagner les élèves en difficulté. Par ailleurs, les
enseignants et les AVS, même s'ils ne conçoivent pas
d'activités ludiques conseillées pour des enfants en situation de
détresse, impliquent toujours les élèves
déplacés dans les activités socioéducatives
ordinaires telles que les interclasses et les journées culturelles.
Cette implication se fait par des jeux de rôles. Nous estimons donc, au
regard de ces activités sus-identifiées, que les enseignants et
les animateurs de la vie scolaire conçoivent et mettent en pratique des
activités pédagogiques et socioéducatives pertinentes et
adaptées au profit des enfants et adolescents déplacés
dans la commune de Titao. Notre hypothèse
no 2 est donc validée.
V.1.3) Vérification de l'hypothèse n° 3
et validation de l'hypothèse principale
Selon notre hypothèse secondaire no 3, la
communauté locale se mobilise et s'engage de manière efficace et
efficiente par des actions variées pour soutenir l'administration
scolaire dans une prise en charge des enfants et adolescents
déplacés dans la commune de Titao.
La théorie du capital humain confère à
l'éducation et la formation une place importante dans le
développement du capital humain. Ce qui fait d'elles (l'éducation
et la formation) la préoccupation
90
non seulement de l'institution scolaire mais aussi de toute la
communauté. Ainsi, par la description des activités de remise
à niveau des enfants de demandeurs d'asile en suisse, nous avons pu
constater avec Sanchez-Mazas et al (2018) que des volontaires dans la
communauté locale s'impliquaient au côté des enseignants
dans la conduite d'activités pédagogiques et
socioéducatives. SINCLAIR (2003) affirmait cependant qu'aucune crise ne
ressemblait à une autre et il n'existait pas de réponse miracle
à un type de situation. Mais la solution devrait toujours être
conçue au niveau local et s'appuyer sur une évaluation
participative des besoins afin d'atteindre les meilleurs résultats le
plus rapidement possible. Après analyse des données recueillies,
nous sommes parvenus à la conclusion selon laquelle la communauté
locale de Titao, dans la prise en charge scolaire, s'investit dans l'aide
à la réintégration scolaire des élèves
déplacés et dans l'appui-conseils. De façon
spécifique, les différents domaines de leurs interventions sont
les séances de sensibilisations et de conseils ; la recherche des sites
de relocalisation des élèves déplacés ; l'aide au
redéploiement du matériel scolaire vers les nouveaux sites
identifiés ; la construction de hangars temporaires pour recevoir les
élèves déplacés ; leur implication dans les
cellules de veille ; l'hébergement des élèves
déplacés. Nous estimons alors que la communauté locale se
mobilise et s'engage de manière efficace et efficiente par des actions
variées pour soutenir l'administration scolaire dans une prise en charge
des enfants et adolescents déplacés dans la commune de Titao.
Notre hypothèse no 3 est donc validée.
A ce stade de notre travail, nos trois hypothèses sont
validées. Ainsi, notre hypothèse principale selon laquelle
dans la prise en charge scolaire des élèves
déplacés dans la commune de Titao, les acteurs directs de
l'éducation mettent en oeuvre des pratiques efficaces en matière
d'éducation en situation de crise sécuritaire est
confirmée.
V.2 Discussion de la validité des
hypothèses
Si les différentes hypothèses sont
validées comme nous l'avons relevé plus haut, il s'agit bien plus
de tendance que de confirmation à l'absolue. Nous relevons ici
contradictions des réponses des enquêtés et aussi les
variables qui montrent que ces hypothèses ne sont pas confirmées
à l'absolue. Ainsi nous voulons montrer que la vérité
à laquelle nous sommes parvenus est relative.
91
V.2.1 Discussion de la validité de
l'hypothèse 1
Des réponses données par nos interlocuteurs sur
l'hypothèse 1 selon laquelle les administrations scolaires prennent des
dispositions organisationnelles, matérielles et psychosociales en vue
d'assurer la continuité de la scolarisation des enfants et adolescents
déplacés dans la commune de Titao, il est établit que
seule l'effectivité de la variable dispositions psychosociales a fait
l'unanimité chez les personnes enquêtées. Pour les
variables dispositions organisationnelles et matérielles, les AVS et les
autorités éducatives confirment leur effectivité pendant
que chez les enseignants et les élèves, les résultats ne
permettent pas d'établir l'effectivité totale de ces
dispositions. Une analyse non partisane permet toutefois de reconnaitre que
malgré les multiples difficultés rencontrées, les
administrations scolaires fournissent des efforts remarquables pour garantir la
continuité de la scolarisation des élèves
déplacés.
V.2.2 Discussion de la validité de
l'hypothèse 2
L'hypothèse 2, selon laquelle les enseignants et les
animateurs de la vie scolaire conçoivent et mettent en pratique des
activités pédagogiques et socioéducatives au profit des
enfants et adolescents déplacés dans la commune de Titao, serait
validée à l'absolu si tous les acteurs enquêtés
s'accordaient sur l'effectivité des deux variables que sont les
activités pédagogiques et socioéducatives. Pour ce qui est
de la variable activités pédagogiques, l'on peut, à
travers les réponses données par les différentes
catégories de personnes enquêtées attester
l'unanimité des avis sur son effectivité. En effet, seuls les
avis des élèves ne permettent pas d'établir
l'effectivité de ces activités. Mais la position des
élèves peut être justifiée par le fait qu'ils ne
sont pas à mesure de faire la distinction entre activités
pédagogiques habituelles et celles menées dans le cadre de la
prise en charge d'élèves déplacés du moment
où se sont les mêmes activités d'apprentissage.
Au niveau des activités socioéducatives, on note
une tendance contraire à la précédente variable. Les
élèves confirment l'effectivité de ces activités
pendant que les enseignants, les AVS et les autorités ont des avis qui
tendent à dire que quelque chose d'important n'est pas fait à ce
niveau. Ce qui d'ailleurs, nous éloigne davantage d'une validation
absolu de notre hypothèse.
92
V.2.3 Discussion de la validité de
l'hypothèse 3
L'effectivité de l'hypothèse 3, hypothèse
selon laquelle la communauté locale se mobilise et s'engage par des
actions variées pour soutenir l'administration scolaire dans une prise
en charge des enfants et adolescents déplacés dans la commune de
Titao, est la mieux partagée par les différente catégories
de personnes enquêtées. En effet, à l'exception des
enseignants, tous s'accordent à dire que la communauté locale
participe activement et diversement à la réintégration
scolaire des élèves déplacés. Du côté
des enseignants, les avis sont partagés et ceux en faveur de la
mobilisation de la communauté n'est pas négligeable.
V.3) Les limites de la recherche
Toute activité entreprise par l'être humain
comporte nécessairement des limites. Pour ce qui concerne la
présente recherche, les limites sont liées d'abord à la
zone de recherche très limitée. Nous aurions souhaité
mener la recherche dans plusieurs communes à fort défis
sécuritaire du Burkina Faso. Cela nous aurait permis de découvrir
et de comparer des modes de gestion de l'éducation en situation de crise
sécuritaire d'une localité à une autre dans le même
pays. Mais pour des contraintes matérielles, financières et
sécuritaires, cette recherche n'a concerné que la commune de
Titao. Ainsi, nous émettons des réserves quant à la
généralisation des résultats de cette étude. Outre
cette limite, il convient de noter que le recouvrement de nos questionnaires
n'a pas été fait à cent pour-cent malgré notre
volonté de le faire. En effet, la fermeture des classes due à la
COVID-19 ne nous a pas permis de terminer nos enquêtes en juin comme
prévu. Il a fallu que nous y retournions en octobre pour rencontrer les
élèves des classes intermédiaires. Mais, compte tenu que
l'année scolaire n'était pas totalement installée, nous
n'avons pas pu recouvrer le maximum de nos questionnaires.
V.4) Des recommandations pour une meilleure prise en
charge des élèves déplacés
Des suggestions ont été faites par les acteurs
enquêtés. Ces suggestions pourraient donc contribuer à
garantir la continuité des apprentissages et permettre ainsi une
meilleure prise en charge des élèves déplacés dans
les établissements fonctionnels. Les plus pertinentes de ces
suggestions, de notre point de vue, ont été recensées et
analysées pour en faire des recommandations. Il s'agit donc de :
93
? doter chaque élève
déplacé en lampes d'éclairage
Au cours nos entretiens, une autorité éducative
nous informait que la majorité des élèves
déplacés vivent dans les quartiers périphériques
appelés communément « non- lotis ». La crise
sécuritaire a occasionné une extension exponentielle des
non-lotis dans la ville de Titao. Malheureusement, ces quartiers ne sont pas
desservis en réseau électrique. Aussi, le contexte
sécuritaire a obligé l'administration sécuritaire à
instaurer le couvre-feu et la restriction de circulation de 18 heures à
06 heures dans le ressort de la province du Loroum, suivant arrêté
no 2019-02/MATDC/RNRD/GVR-OHG/CAB du 10 octobre 2019. Cette mesure,
qui initialement devait prendre fin le 14 novembre 2019, a connu une
prorogation jusqu'à cette période où nous menions nos
enquêtés. Et pourtant les élèves moins nantis se
servent des salles de classes éclairées ou de l'éclairage
public pour étudier les nuits. Dans ce contexte de couvre-feu, il leur
est donc quasiment impossible de profiter de cet avantage. Par
conséquent, chaque élève doit être doté en
lampe et de préférence, en lampe solaire-chargeable.
? impliquer les parents dans l'organisation des cours
d'appui
Notre étude est parvenue à la conclusion selon
laquelle les parents d'élèves ne s'impliquent pas assez dans
l'accompagnement pédagogique de leurs enfants. Certes que cela peut
s'expliquer par le niveau d'étude des parents mais d'autres alternatives
existent pour pallier cette insuffisance. Il s'agit par exemple de l'engagement
d'un répétiteur et aussi du suivi de la scolarité de
l'enfant en se rendant régulièrement dans son
établissement. Cela permet aux parents de s'imprégner,
auprès des enseignants ou des services «vie scolaire», de
l'évolution du travail de l'enfant et de son comportement en milieu
scolaire.
? doter les élèves
déplacés en matériels de première
nécessité (vêtements, savons, pâtes, pommades pour
les filles, nourriture sec etc.)
A travers nos entretiens et questionnaires, nous avons pu
constater que les élèves déplacés, dans leur
majorité ne bénéficiaient pas des dons en nature faits par
certains organismes d'aide humanitaire. Et pourtant, ils en ont vraiment
besoin. Une autorité éducative raconte,
Beaucoup d'élèves déplacés ont
rejoint la ville de Titao sans même emporter le minimum de
matériel nécessaire. Les vendredis, jour de marché de
Titao, les élèves déplacés déambulent dans
le marché dans l'espoir de rencontrer un parent qui pourrait leur
apporter des vivres ou des vêtements.
Pour ce qui est de la nourriture sec, l'idéal serait de
prioriser le riz, le haricot et le couscous dont la cuisson n'engage pas
beaucoup de dépenses supplémentaires contrairement au maïs
brut qui demande beaucoup de transformations.
? rétablir la sécurité afin de
faciliter le retour rapide des élèves déplacés dans
leurs villages
Il y a des élèves déplacés qui
sont en auto-hébergement et il n'est souvent pas facile pour eux de
subvenir à certains besoins. Pour les garçons, le problème
ne se pose pas assez mais pour les filles, quand elles n'ont pas un logeur,
elles sont exposées à beaucoup de risques tels que le
harcèlement sexuel, le viol etc. Cependant, quand les enfants sont
scolarisés à côté des parents, les risques
susmentionnés peuvent être minimisés. Ainsi, à
l'endroit de l'administration sécuritaire, il faut travailler à
restaurer la sécurité dans les campagnes afin que les classes
fermées puissent rouvrir. Certes, le travail s'avère difficile
mais avec l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie
(VDP) au côté des forces armées nationales, les
résultats donnent de l'espoir.
? redynamiser les cantines scolaires
Les cantines scolaires, même si elles fonctionnent dans
les établissements, ne démarrent pas tôt leurs services.
Aussi, en dehors d'un seul établissement où les frais de cantine
des élèves déplacés sont subventionnés par
un partenaire social, les élèves déplacés des
autres établissements de la ville de Titao, en dehors du primaire, sont
assujettis au paiement de 75 F le plat. Ce qui n'est pas souvent aisé
pour un élève déplacé. Il faut par ailleurs
mentionner que la direction de l'allocation des moyens spécifiques aux
structures éducatives (DAMSSE) doit revoir sa politique de distribution
de vivres dans les établissements des zones à fort défis
sécuritaire. En effet, des établissements appelés
communément classes d'accueil ou CEG d'accueil ont été
spontanément créés pour accueillir les
élèves déplacés. Aux dires des autorités
éducatives avec qui nous nous sommes entretenus, ces classes ou
établissements d'accueil non enregistrés dans le fichier de la
DAMSSE ne peuvent bénéficier des vivres que par un arrangement
local. En effet, ces classes dites d'accueil sont arrimées à un
établissement déjà existant afin de
bénéficier des vivres au nom de cet établissement. Il y a
donc nécessité d'implémenter les cantines endogènes
qui pourrait résoudre la question de la lourdeur administrative et
permettre la dotation des cantines scolaires en vivres dès la
rentrée scolaire.
94
? exempter les élèves
déplacés du paiement des frais de scolarité
95
A travers les données recueillies auprès de nos
interlocuteurs, nous avons pu constater que les élèves
déplacés étaient assujettis au paiement des frais de
scolarité malgré la situation difficile qu'ils vivent. Toute
chose qui peut contribuer à leur déscolarisation si les parents
ne sont pas à mesure d'honorer ces frais.
? renforcer la compétence des enseignants sur le
plan pédagogique
La majorité des enseignants enquêtés ont
exprimé la grande difficulté de prise en charge
pédagogique des élèves déplacés. La
réalité de cette difficulté est soutenue par les
autorités éducatives et les chefs de services qui disent recevoir
plusieurs plaintes de la part des enseignants sur la question. En effet, la
gestion de l'éducation en situation de crise sécuritaire est un
nouveau paradigme pour le monde éducatif burkinabè et cela
nécessite un renforcement de capacités des acteurs. Mais du point
de vue des acteurs enquêtés, les formations reçues sont
plus orientées vers la prise en charge psychosociale. Il faut donc que
les acteurs directs de l'éducation, en particulier les enseignants,
bénéficient des séances de formations afin de capitaliser
les expériences individuelles acquises en matière prise en charge
pédagogique des élèves déplacés.
? organiser plus d'activités
socioéducatives pour permettre aux élèves
déplacés de mieux s'intégrer dans la communauté
d'accueil
Les activités socioéducatives semblent ne pas
être la priorité des acteurs de l'éducation dans la ville
de Titao. Et pourtant, en contexte d'éducation en situation de crise,
les jeux contribuent à l'épanouissement des enfants. Il serait
donc intéressant que les enseignants, surtout les enseignants du
primaire qui accueillent les enfants dès leur jeune âge,
pratiquent plus de jeux pour accompagner les activités
pédagogiques. Par ailleurs, les acteurs de l'éducation de
façon générale doivent susciter chez les
élèves, la paire-éducation. Et le moyen le plus efficace
c'est d'encourager la création et la pratique de clubs scolaires et
d'associations qui riment avec les préoccupations majeures des
élèves dans leur environnement scolaire.
? Mettre en place un système performant d'accueil
des élèves déplacés
A travers nos enquêtes, nous avons pu découvrir
que la majorité des élèves déplacés,
après la fermeture de leurs établissement d'origine, sont
restés à la maison environ deux mois avant de
96
bénéficier d'une réinscription. Il est
donc nécessaire que les APE soient mieux organisées et qu'elles
communiquent davantage avec les autorités éducatives afin que des
solutions endogènes précèdent les décisions
administratives si elles tardent à être prises.
CONCLUSION A LA DEUXIEME PARTIE
A travers les données recueillies auprès de nos
interlocuteurs, des informations riches et variées ont pu être
extraites des entretiens et des questionnaires. Ces données nous ont
permis de faire une analyse approfondie de la problématique de l'offre
éducative en situation de crise sécuritaire dans la commune de
Titao. Une analyse qui nous a permis à terme de juger la validité
de nos hypothèses émises au début de la recherche et de
formuler des recommandations pour une meilleure prise en charge scolaire des
élèves déplacés dans la commune de Titao.
97
CONCLUSION GENERALE
Au terme de ce travail, nous rappelons que l'objectif
principal visait à appréhender les efforts des acteurs directs de
l'éducation dans le sens de favoriser une prise en charge scolaire
adéquate des élèves déplacés dans la commune
de Titao. Dans la recherche des dispositions et activités mises en
oeuvre par les acteurs locaux de l'éducation, nous avons formulé
l'hypothèse que dans la prise en charge scolaire des
élèves déplacés dans la commune de Titao, les
acteurs directs de l'éducation mettent en oeuvre des pratiques efficaces
en matière d'éducation en situation de crise. Pour avoir
suffisamment d'informations, nous avons choisi de mener une enquête
auprès des autorités éducatives, des personnels de
direction, des enseignants, des encadreurs de la vie scolaire, des
élèves et des parents d'élèves. Nos instruments de
collecte des données portent sur le questionnaire et l'entretien. Pour
analyser les données, nous avons utilisé des méthodes
quantitatives et qualitatives. L'analyse des résultats nous a permis
d'atteindre nos objectifs fixés au départ. Nous avons d'abord
recherché et analysé la pertinence des actions posées par
les administrations scolaires du point de vue organisationnel, matériel,
psychosocial dans la prise en charge scolaire des enfants et adolescents
déplacés dans la commune de Titao. Ce qui nous a permis de
constater que les administrations scolaires prennent des dispositions
organisationnelles, matérielles et psychosociales en vue d'assurer la
continuité de la scolarisation des enfants et adolescents
déplacés dans la commune de Titao. Nous avons également
exploré les activités pédagogiques et
socioéducatives conçues et pratiquées par les enseignants
et les animateurs de la vie scolaire. De nos analyses des données
recueillies, il est ressorti que les enseignants et les animateurs de la vie
scolaire conçoivent et mettent en pratique des activités
pédagogiques et socioéducatives au profit des enfants et
adolescents déplacés dans la commune de Titao. Par ailleurs, la
communauté locale ne se met pas en marge dans cet accompagnement
éducatif. Elle se mobilise et s'engage par des actions variées
pour soutenir l'administration scolaire dans une prise en charge des enfants et
adolescents déplacés dans la commune de Titao. Ainsi, au terme de
cette étude, nous sommes parvenu à la conclusion selon laquelle
dans la prise en charge scolaire des élèves
déplacés dans la commune de Titao, les acteurs directs de
l'éducation mettent en oeuvre des pratiques efficaces en matière
d'éducation en situation de crise. Pour une meilleure prise en charge
scolaire des élèves déplacés, des recommandations
ont été faites par les acteurs de l'éducation. Parmi
lesquelles recommandations figurent la dotation de chaque élève
déplacé en lampes d'éclairage ; l'implication des parents
dans l'organisation des cours d'appui ; la dotation des élèves
déplacés en matériels de
98
première nécessité (vêtements,
savons, pâtes, pommades pour les filles, nourriture sec etc.) ; le
rétablissement de la sécurité afin de faciliter le retour
rapide des élèves déplacés dans leurs villages ; la
redynamisation des cantines scolaires ; l'exemption des élèves
déplacés du paiement des frais de scolarité ; la formation
pédagogique du personnel enseignant ; l'organisation d'activités
socioéducatives pour permettre aux élèves
déplacés de mieux s'intégrer dans la communauté
d'accueil ; la mise en place un système performant d'accueil des
élèves déplacés ; la dotation des
élèves déplacés en kits scolaires.
Sans avoir la prétention d'avoir épuisé
la question de la gestion de l'éducation en situation de crise
sécuritaire au Burkina Faso, nous pensons que d'autres recherches
viendront approfondir et élargir notre champ de connaissances sur cette
question.
99
BIBLIOGRAPHIE
BARTHOLD, A. (2009). La prise en charge psychosociale des
alcooliques à l' Association pour la Prévention de l'Alcoolisme
et des Accoutumances Chimiques (APAAC). Consulté le février
11, 2019, sur Memoire Online:
https://memoireonline.com
BEAUD, M. (1985). L'art de la thèse: Comment
préparer et rédiger un mémoire de master,une thèse
de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net.
Paris: La Découverte.
BERGERON-VACHON, F. (2014). L'engagement social des jeunes au
Québec: Points de vue de militant(e)s ayant participé aux
mobilisations artistiques durant le mouvement étudiant du printemps
2012. MONTRÉAL, Québec. Consulté le Mars 3, 2019, sur
http://archipel.uqam.ca./id/eprint/6486
CAMPENHOUDT, L. v., & QUIVY, R. (2011). Manuel de
recherche en science sociale. Paris: Dunod.
COOMBS, P. H. (1970). Qu'est-ce que la planification de
l'éducation ? Consulté le Avril 25, 2019, sur UNESCO
Bibliothèque Numérique:
https://unesdoc.unesco.org
DURKHEIM, E. (1922). Education et sociologie. Paris:
Librairie Félix Algan.
FRAISSE- D'OLIMPIO, S. (2009). Les fondements
théoriques du concept de capital humain. Consulté le
Février 7, 2021, sur SES- ENS:
http://ses.ens-lyon.fr/articles/les-fondements-theoriques-du-concept-de-capital-humain-partie-1-68302
INEE. (2012). Normes Minimales pour l'éducation:
Préparation, Intervention, Relèvement.
Inspection générale de l'Education Nationale.
(1980). La pédagogie différenciée au Collège.
Paris: CNPD.
ION, J. (2012). S'engager dans une société
d'individus. France: ARMAND COLIN.
KONKOBO, M. K. (2008). Les causes et les consequences de
la déperdition en Afrique: cas du Burkina. Consulté le Juin
2, 2019 , sur LE TEMPLE DU SAVOIR:
https://pascallonkou.blog4ever.com/les-causes-et-les
LAGADEC, P. (1991). La gestion des crises: Outils de
réflexion à l'usage des décideurs. (Ediscience,
Éd.) MCGRAW-HILL.
Loi 013-2007/AN du 30juillet 2007 portant loi d'orientation de
l'éducation. (s.d.). MACHEL, G. (1996). IMPACT DES CONFLITS ARMES
SUR LES ENFANTS.
100
MAGALI, C.-d. H., FRESIA, m., & LANOUE, E. (2010).
Education et conflits: les enjeux de l'offre éducative en situation de
crise. Autrepart, pp. 3-22. Consulté le Mai 6, 2019, sur
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2010-2-page-3.htm
MIALARET, G. (1976). Education nouvelle et monde
moderne. Paris: PUF.
Ministère de l'Education Nationale de Côte
d'Ivoire. (2011). Guide de formationde base sur l'appui psychosocial en milieu
scolaire. Côte d'Ivoire.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE
LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES. (2019). Stratégie Nationale de
Scolarisation des Elèves des Zones à forts Défis
Sécuritaires au Burkina Faso 2019-2024.
Récupéré sur Portail des plans et politiques
d'éducation:
planipolis.iiep.unesco.org
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE
LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES. (2020). Manuel des normes
éducatives au Burkina Faso. Ouagadougou: MENAPLN.
NDAGIJIMANA, J.-B. (2013). Les facteurss de la faible
motivation et leurs effets sur l'apprentissage: Cas des élèves de
l'école normale primaire(ENP/TTC) au Rwanda. Bouaké, Côte
d'Ivoire: Université de Bouaké.
NICOLAI, S., HINE, S., & WALES, J. (2015). l'Education en
situation d'urgence et crises prolongées: vers une intervention
consolidée. Oslo: ODI. Consulté le Juin 21, 2019, sur
https://inee.org/system/files/resources/ODI_Oslo_Summit_EiEPC_paper_June_2015_-_FINAL_%2528short_27pg%2529_FRE_LowRes.pdf
OCDE. (1998). L'investissement dans le capital humain: une
comparaison internationale. Paris: Editions de l'OCDE.
OCDE. (2001). Du bien-être des nations : le
rôle du capital humain et social. Paris: Editions de l'OCDE.
OKONGO, G. (2009). Nouvelles approches pour la pratique
des activités socio-éducatives en milieu scolaire (Etude de 43
établissements). Dakar: Université Cheick Anta Diop.
OUBDA, M. (2020). Du défi sécuritaire à
la ménace terroriste au Burkina Faso(2010-2018). Revue semestrielle
de la recherche, p. 332.
OUEDRAOGO, E. (2016, Septembre). La qualité de
l'éducation au Burkina Faso: Efficacitédes enseignements
-apprentissages dans les classes des écoles rimaires. (U.
Européenne, Éd.) Consulté le Janvier 11, 2020, sur
https://www.theses.fr/2016LARE0031.pdf
PETIT, P., & COMHAIRE, G. (2010).
Société civile et éducation: le partenariat à
l'épreuve du terrain. Consulté le Avril 16, 2019, sur
Academia:
http://www.academia.edu
101
RAKOTOVOLOLONA, S. J. (2008). Communication et
mobilisation sociale pour un changement de comportement en eau, assainissement
et hygiène. Antananarivo: Université
d'Antananarivo. Consulté le Août 20, 2020, sur
https://www.memoireonline.com/09/08/1532/m_communication-mobilisation-changement-social-changement-comportement-eau11.html
REZINE, O. (2015). CAPITAL HUMAIN, EDUCATION ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE : Une approche économétrique. Tlemcen.
Consulté le Mars 17, 2020, sur
http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/7231/1/capital-humain-education-croissance-economique.Doc.pdf
ROBBES, B. (2009). La pédagogie différenciée
: historique, problématique,cadre conceptuel et méthodologie de
mise en oeuvre. La pédagogie différenciée (p.
34). Paris: laboratoire CREF - EA 1589.
Save the Children. (2007). Guide pour l'éducation en
situation d'urgence.
SINCLAIR, M. (2003). Planifier l'éducation en
situation d'urgence et de reconstitution. (Unesco, Éd.) Paris:
Institut International de planification de l'Education. Consulté le
Octobre 2, 2019, sur
https://inee.org/system/files/resources/planning
TERRY, G. R., & FRANKLIN, S. G. (1985). Les principes du
management. (G. Economia, Éd.) Paris: Librairie du Bassin.
Unesco. (2015). Rapport mondial de suivi sur
l'éducation pour tous.
UNESCO, I. (Réalisateur). (2018). Qu'est-ce que la
planification de l'éducation [Film]. Consulté
le Juillet 2, 2019, sur
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch
%3Fv%3DI02Ciab7eqQ&ved=2ahUKEwjAxIKBzfTuAhUPTxUIHdUTDB4QtwIwDXo
ECAoQAg&usg=AOvVaw36YDzXyg3aaLv0npwEOOI5
YACOUBI, F. (2014). La communication publique de crise.
(INHESJ, Éd.) Versailles: Université Versailles
Saint-Quentin.
102
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS II
RESUME III
SOMMAIRE V
SIGLES ET ABRÉVIATIONS VI
LISTE DES TABLEAUX VIII
LISTE DES FIGURES X
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES 3
INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE 4
CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE 5
I.1) Contexte 5
I.1.1) Du développement du secteur de l'éducation
5
I.1.2) Les obstacles à l'éducation pour tous 8
I.2) Justification du choix du thème de recherche 10
I.2.1) Les raisons personnelles 10
I.2.2) Les raisons politico-éducatives 11
I.2.3) Les raisons scientifiques 11
I.3) Questions, objectifs et hypothèses de recherche
12
I.3.1) Questions de recherche 12
I.3.2) Objectifs de recherche 13
I.3.3) Hypothèses de recherche 13
CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LA LITTERATURE
15
II.1) Clarification des concepts 15
II.2) les théories de référence 21
II.2.1) La théorie incrémentaliste de la
planification 21
II.2.2) La théorie du capital humain 22
II.2.3) La pédagogie différenciée 23
II.3) La revue de la littérature 24
II.3.1) De la genèse du concept Education en situation de
crise 25
103
II.3.2) Impact des conflits sur l'éducation 26
II.3.3) Les pratiques en matière d'éducation en
situation de crise 28
II.3.4) La planification de l'éducation en situation de
crise 31
CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE L'ETUDE 35
III.1) Zone de la recherche 35
III.2) Méthode de la recherche 38
III.3) La population cible et l'échantillon de recherche
39
III.3.1) La population cible 39
III.3.2) Echantillon de la recherche 44
III.4) Instruments de collecte des données 46
III.4.1) Le questionnaire 47
III.4.2) L'entretien semi-directif 47
III.5) Validation des instruments de collecte des
données 49
III.6) L'administration des instruments de collecte 50
III.7) Le traitement des données recueillies 50
III.8) Méthode d'analyse et résultats attendus
50
CONCLUSION A LA PREMIERE PARTIE 52
DEUXIEME PARTIE : ASPECTS PRATIQUES 53
INTRODUCTION A LA DEUXIEME PARTIE 54
CHAPITRE IV : PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION
DES DONNEES
COLLECTEES 55
IV.1) Etat de recouvrement des outils de collecte des
données 55
IV.1.1) Recouvrement des questionnaires adressés aux
enseignants 55
IV.1.2) Recouvrement des questionnaires adressés aux
AVS 56
IV.1.3) Recouvrement des questionnaires adressés aux
élèves 56
IV.1.4) Guide d'entretien adressé au personnel de
direction 56
IV.1.4) Guide d'entretien adressé aux parents
d'élèves 57
IV.2) Présentation, analyse et interprétation
des données recueillies 57
IV.2.1) Les dispositions organisationnelles,
matérielles et psychosociales 57
IV.2.1.1) Données recueillies auprès des
enseignants 57
IV.2.1.2) Données recueillies auprès des AVS
62
104
IV.2.1.3) Données recueillies auprès des
élèves déplacés 63
IV.2.1.4) Entretiens réalisés avec les
autorités éducatives et les chefs de services 68
IV.2.2) Les activités pédagogiques et
socioéducatives 71
Nous nous intéressons dans ce point à la prise en
charge pédagogique et socioéducative des
élèves déplacés. 71
IV.2.2.1) Données recueillies auprès des
enseignants 71
IV.2.2.2) Données recueillies auprès des AVS 76
IV.2.2.3) Données recueillies auprès des
élèves déplacés 77
IV.2.2.3) Entretiens réalisés avec les
autorités éducatives et les chefs de services 79
IV.2.3) La mobilisation de la communauté locale 80
IV.2.3.1) Données recueillies auprès des
enseignants 80
IV.2.3.2) Données recueillies auprès des AVS 81
IV.2.3.3) Entretiens réalisés avec les
autorités éducatives et les chefs de services 81
IV.2.3.4) Entretiens réalisés avec les parents
d'élèves 82
IV.2.3.5) Synthèse de l'analyse des données
recueillies 85
CHAPITRE V : VERIFICATION DES HYPOTHESES DE RECHERCHE,
LIMITES ET
RECOMMANDATIONS 88
V.1) vérification des hypothèses 88
V.1.1) Vérification de l'hypothèse no 1
88
V.1.2) Vérification de l'hypothèse no 2
89
V.1.3) Vérification de l'hypothèse no 3
et validation de l'hypothèse principale 89
V.2 Discussion de la validité des hypothèses 90
V.2.1 Discussion de la validité de l'hypothèse 1
91
V.2.2 Discussion de la validité de l'hypothèse 2
91
V.2.3 Discussion de la validité de l'hypothèse 3
92
V.3) Les limites de la recherche 92
V.4) Des recommandations pour une meilleure prise en charge des
élèves déplacés 92
CONCLUSION A LA DEUXIEME PARTIE 96
CONCLUSION GENERALE 97
BIBLIOGRAPHIE 99
TABLE DES MATIERES 102
105
ANNEXES i
i
ANNEXES
Questionnaire adressé aux élèves
déplacés
Ce questionnaire est destiné à
l'élaboration de notre mémoire de master en sciences de
l'éducation à l'Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de l'Education(IFRISSE),
sur le thème : Gestion de l'éducation en situation de crise
sécuritaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives dans
la commune de Titao.
Notre seule ambition est purement académique. Nous vous
garantissons donc un total anonymat et vous remercions pour votre
disponibilité
I.Identification
1 . Dans quelle école es-tu présentement? . . .
.
2 . De quelle école viens-tu? . . . . . . . . . . . . . .
.
3 . Classe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
II.1.Dispositions organisationnelles
4 . 1.Après la fermeture de ton école, combien
de temps es-tu resté(e)à la maison ? . . . . . . . .
5 . A-tu eu des difficultés pour avoir la place dans
ton nouvel école? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
6 . Qui t'a aidé à avoir la place dans ton
nouvel
école? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
1 mois environ 2 mois environ
plus de 2 mois
Oui Non Ne sait pas
Mes parents les autorités éducatives
personne
II.2.Dispositions matérielles
|
7 . Qui paye tes fournitures scolaires? . . . . . . .
|
|
Mes parents on nous a donné à l'école
un parrain
|
|
8 . A-tu reçu d'autres aides? . . . . . . . . . . . . . .
.
|
|
Vivres tenue scolaire vélo
autres: aucun
|
|
|
|
II.3.Dispositions psychosociales
|
9 . 2 .Comment tu te sentais avant ton arrivée dans
ton nouvel école? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
|
pas content content
|
|
10 . comment on s'occupe de toi dans ton nouvel
école? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
|
|
on nous donne des conseils
on mange à la cantine scolaire
on nous montre des jeux
on nous soigne quand on est malade
aucun
Vous pouvez cocher plusieurs cases (4 au maximum).
|
|
|
|
11. Comment vos maitre ou vos professeurs se comportent envers
vous? . . . . . . . . . . . . .
|
12.
|
ils sont gentils
ils sont méchants
ils nous donnent la parole régulièrement ils ne
nous écoutent pas
Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum).
|
|
|
|
13. comment tu te sens maintenant dans ton nouvel
établissement? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
pas content content
|
|
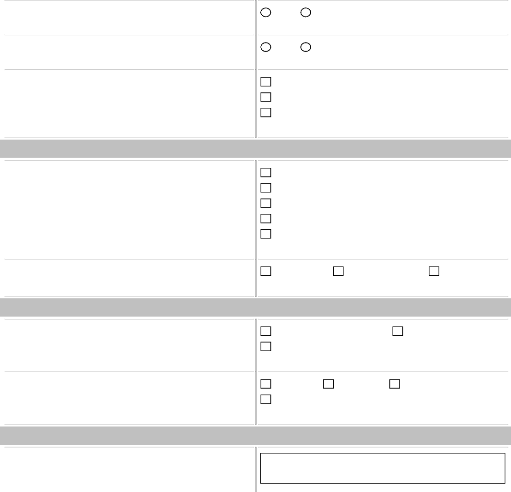
16. A part les cours, qu'est-ce que vous faites
encore à l'école? . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
17. Qui organise ces activités? . . . . . . . . . . .
.
13. Est-ce que tu arrives bien à apprendre tes
leçons? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
14. Est-ce que quelqu'un t'aide à apprendre tes
leçons à la maison? . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
15. Si oui, comment on t'aide à apprendre tes
leçons? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
III.2.Activités socioéducatives
IV.Mobilisation de la communauté locale
18. A part les maîtres ou les professeurs, qui
t'encourage à aimer l'école? . . . . . . . . . .
.
19. ils t'encouragent avec quoi? . . . . . . . . . . .
V.Suggestions
20. Propose des solutions pour une meilleure prise en charge des
élèves déplacés dans les
établissements fonctionnels . . . . . . . . . . .
on joue au ballon on fait théatre
on nettoie notre école on organise des sorties autres
Vous pouvez cocher plusieurs cases.
les élèves les enseignants autres
Vous pouvez cocher plusieurs cases.
Oui Non
Oui Non
cours à domicile
cours de soutien en groupe autres:
Vous pouvez cocher plusieurs cases.
mes parents d'autres personnes
on ne m'encourage pas
Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum).
conseils nourriture fournitures scolaire
autres
Vous pouvez cocher plusieurs cases.
III.1.Activités pédagogiques
II
Questionnaire adressé aux enseignants
Ce questionnaire est destiné à
l'élaboration de notre mémoire de master en sciences de
l'éducation à l'Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de l'Education(IFRISSE),
sur le thème : Gestion de l'éducation en situation de crise
sécuritaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives dans
la commune de Titao.
Notre seule ambition est purement académique. Nous vous
garantissons donc un total anonymat et vous remercions pour votre
disponibilité
I.Identification
|
1 . Etablissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
|
|
|
|
2 . Discipline enseignée . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.1.Dispositions organisationnelles
|
|
3 . Quel dispositif sécuritaire est mis en place pour
assurer votre protection dans l'environnement
scolaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
|
|
|
|
4 . comment jugez-vous les effectifs des élèves
dans
vos classes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
normal pléthorique
|
|
|
5 . Avez-vous reçu des formations en lien avec la prise en
charge spécifique des élèves déplacés?
|
|
Approches pédagogiques
Approche Safe school
Sécourisme
Formation en prise en charge psychosociale
Jamais
Vous pouvez cocher plusieurs cases (4 au maximum).
|
|
|
6 . Si oui, dans quel cadre avez-vous reçu cette
formation? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
En formation initiale En formation continue
Vous pouvez cocher plusieurs cases.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.2.Dispositions matérielles
|
Oui Non
Oui Non Oui Non
III
7 . Avez-vous reçu des supports pédagogiques en
lien avec l'éducation en situation de crise
sécuritaire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
8 . Avez-vous eu des besoins non satisfaits en
matériels pédagogiques et didactiques? . . .
9 . Vos élèves ont-ils reçu des dotations en
kits scolaires (livres,cahiers,sacs d'école etc.)? .
|
II.3.Dispositions psychosociales
|
|
10. Quels sont les services dont bénéficient les
élèves déplacés dans votre établissement?
|
Accueil inscription gratuite
restauration gratuite espaces récréatifs
soins gratuits néant
Autres
|
|
|
|
III.1.Activités pédagogiques
11. Existe-t-il des élèves déplacés
dans les classes que vous tenez? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Oui Non Ne sait pas
|
12.
Oui Non
absentéiste assidu ponctuel
Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum).
si oui, quelles sont les difficultés d'apprentissage
qu'ils rencontrent? . . . . . .
13. comment gérez-vous ces situations difficiles?
14. est-ce que vous associez d'autres acteurs dans la
gestion des difficultés de ces élèves? . .
15. Si oui, qui est associé et comment
procédez-vous? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Quelle est la régularité de ces
élèves à vos
cours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
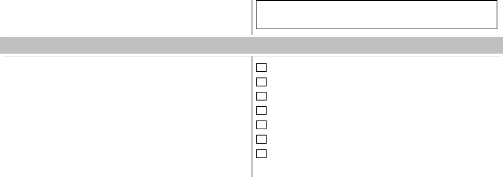
19. Quels genres d'activités récréatives et
éducatives sont menés dans votre établissement? . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Si oui,comment sont organisées ces
activités?
III.2.Activités sociaux éducatives
sketch
sorties détente
compétition inter-établissements
sensibilisations
AGR(activités génératrices de revenus)
conferences
néant
Vous pouvez cocher plusieurs cases (5 au maximum).
iv
Est-ce que vous concevez des activités de remise
à niveau au profit des élèves
déplacés?
20.
Moi
d'autres enseignants
des élèves
des personnes exterieures
ne sait pas
Vous pouvez cocher plusieurs cases (4 au maximum).
Oui Non Ne sait pas
Qui organise ces activités s'il y'en a? . . .
.
21. les élèves déplacés
participent-ils à ces
activités? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
22. Si oui, comment vous les y impliquez? . . .
IV.Mobilisation de la communauté locale
23.
oui non
Est-ce que la communauté locale s'implique dans
l'organisation d'activités parascolaires?
24. A quelles occasions elle s'implique dans
l'organisation de ces activités? . . . . . . . . .
25. Quel est le degré de leur implication dans ces Faible
moyen fort aucun
activités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
V.Suggestions
26. Quelles solutions préconisez-vous pour une meilleure
intégration des élèves déplacés dans
les établissements fonctionnels? . . . . . . . .
V
vi
Questionnaire adressé aux AVS
Ce questionnaire est destiné à
l'élaboration de notre mémoire de master en sciences de
l'éducation à l'Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de l'Education(IFRISSE),
sur le thème : Gestion de l'éducation en situation de crise
sécuritaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives dans
la commune de Titao.
Notre seule ambition est purement académique. Nous vous
garantissons donc un total anonymat et vous remercions pour votre
disponibilité
|
I.Identification
|
|
|
|
|
1 . Etablissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
|
|
|
|
2 . Titre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.1.Dispositions organisationnelles
|
|
3 . Quel dispositif sécuritaire est mis en place pour
assurer votre sécurité dans le domaine scolaire?
|
|
|
|
|
4 . comment sont les effectifs dans vos classes à
charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
|
Normal Pléthorique
|
|
|
5 . Avez-vous reçu une formation en lien avec la prise en
charge spécifique des élèves déplacés?
|
|
Approche Safe school
Secourisme
Formation en prise en charge psychologique Jamais
Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum).
|
|
|
6 . Si oui, dans quel cadre avez-vous reçu cette
formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
|
En formation initiale En formation continue
Vous pouvez cocher plusieurs cases.
|
|
|
|
|
|
|
|
II.2.Dispositions matérielles
|
|
7 . vos élèves déplacés ont-ils
reçu des kits scolaires(livres,cahiers,sacs d'école etc.)? .
|
|
Oui Non
|
|
|
8 . Si oui, qui les a offert ces kits scolaires? . .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II.3.Dispositions psychosociales
|
|
9 . Quels sont les services dont bénéficient les
élèves déplacés dans votre établissement?
.
|
|
Accueil inscription gratuite
conseils restauration gratuite
espaces récréatifs soins gratuits
néant
Vous pouvez cocher plusieurs cases (6 au maximum).
|
|
|
|
Oui Non
III.1.Activités pédagogiques
10. Existe-t-il des élèves déplacés
dans les classes que vous tenez? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
11.
si oui,quelles sont les difficultés d'apprentissage qu'ils
rencontrent? . . . . . .
12. Comment gérez-vous ces difficultés s'il en
existe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
13. Est-ce que vous concevez des activités de remise
à niveau au profit des élèves
déplacés?
|
Oui Non
|
|
|
14. Si oui, comment sont organisées ces
activités?
|
15.
|
16.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.2.Activités socioéducatives
|
|
17. Quels genres d'activités récréatives et
éducatives sont menées dans votre établissement? . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
18.
|
19.
|
sketch
sorties détente
compétition inter-établissements
sensibilisations
Activités Génératrices de Revenus
autres
néant
Vous pouvez cocher plusieurs cases (6 au maximum).
|
|
|
20. Qui organise ces activités s'il y'en a? . . .
.
|
21.
|
22.
|
Moi
mes collègues
des enseignants
des élèves
des personnes extérieures
ne sait pas
Vous pouvez cocher plusieurs cases (5 au maximum).
|
|
|
23. les élèves déplacés
participent-ils à ces activités? . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
|
24.
|
25.
|
Oui Non Ne sait pas
|
|
|
26. Si oui, comment vous les y impliquez? . . .
|
27.
|
28.
|
29.
|
30.
|
|
|
|
|
|
|
|
IV.Mobilisation de la communauté locale
31. connaissez-vous les parents de vos élèves
déplacés? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Oui Non
|
vii
20. Si oui, à quelle occasion les avez-vous
rencontré? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guide d'entretien à l'intention des
présidents APE
Ce questionnaire est destiné à
l'élaboration de notre mémoire de master en sciences de
l'éducation à l'Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de l'Education(IFRISSE),
sur le thème : Gestion de l'éducation en situation de crise
sécuritaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives dans
la commune de Titao.
Notre seule ambition est purement académique. Nous vous
garantissons donc un total anonymat et vous remercions d'avance pour votre
disponibilité.
I.Identification
1 . Fonction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
II. Les dispositions organisationnelles, matérielles
et psychosociales
2 . combien d'élèves déplacés
avez-reçus depuis le
début de la crise sécuritaire? . . . . . . . . . .
. .
3 . Quelles sont les mesures prises pour assurer la
sécurité des acteurs et des élèves dans votre
établissement? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
4 . Quelles sont les actions entreprises sur le plan
matériel pour assurer une meilleure gestion des élèves
déplacés inscrits dans votre établissent?
5 . Quelles sont les actions entreprises en terme de prise en
charge psychosociale afin assurer une meilleure gestion des
élèves déplacés inscrits
dans votre établissent? . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Activités pédagogiques et
socioéducatives
6 . Quelles sont les activités pédagogiques
organisées dans le cadre de la prise en charge des élèves
déplacés dans les établissements de
votre ressort? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . En dehors des activités pédagogiques, ces
élèves sont-ils impliqués dans d'autres activités?
.
8 . quelles sont ces activités et comment elles sont
menez? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Mobilisation de la communauté locale
VIII
9 . Quelles sont vos relations avec le personnel éducatif
dans la prise en charge des élèves
déplacés? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
2 . combien d'élèves déplacés
avez-reçus depuis le
début de la crise sécuritaire? . . . . . . . . . .
. .
Guide d'entretien à l'intention des
autorités éducatives et chefs de services
Ce questionnaire est destiné à
l'élaboration de notre mémoire de master en sciences de
l'éducation à l'Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Sciences de la Santé et de l'Education(IFRISSE),
sur le thème : Gestion de l'éducation en situation de crise
sécuritaire au Burkina Faso : état des lieux et perspectives dans
la commune de Titao.
Notre seule ambition est purement académique. Nous vous
garantissons donc un total anonymat et et vous remercions d'avance pour votre
disponibilité.
I.Identification
1 . Fonction: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .
II. Les dispositions organisationnelles,
matérielles et psychosociales
3 . Quelles sont les mesures prises pour assurer la
sécurité des acteurs et des élèves dans vos ou
votre
Etablissement(s)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
4 . Quelles sont les actions entreprises sur le plan
matériel pour assurer une meilleure gestion des élèves
déplacés inscrits dans votre établissent?
5 . Quelles sont les actions entreprises en terme de prise en
charge psychosociale afin assurer une meilleure gestion des
élèves déplacés inscrits
dans votre établissent? . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Activités pédagogiques et
socioéducatives
6 . Quelles sont les activités pédagogiques
organisées dans le cadre de la prise en charge des élèves
déplacés dans les établissements de
votre ressort? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . En dehors des activités pédagogiques, ces
élèves sont-ils impliqués dans d'autres activités?
.
8 . quelles sont ces activités et comment elles sont
menez? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Mobilisation de la communauté locale
ix
9 . Quelles sont vos relations avec la communauté locale
dans la prise en charge des élèves
déplacés? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
X
| 


