3.1.3 Les activités de restauration des
écosystèmes dégradés de l'AMP
3.1.3.1 Les causes de la dégradation des
écosystèmes marins et côtiers
Selon les pêcheurs et les principaux gestionnaires, la
rareté de certaines espèces est principalement due à
l'absence d'habitat adéquat à leur reproduction et à leur
survie. Cela provient, du chalutage démersal, de la surpêche, de
l'utilisation de filet dormant etc. L'ensemble de ces causes notées est
à l'origine de la menace de certaines espèces listées par
les pêcheurs (cf. Annexe 11). Cependant, des mesures doivent être
prises par les différents gestionnaires des écosystèmes
marins et côtiers sur l'applicabilité des lois et
règlements visant une gestion durable des ressources halieutiques.
Les principales causes de la dégradation des
écosystèmes de mangrove au niveau de l'AMP sont : la salinisation
des sols selon 40,90% des femmes enquêtées, l'ouverture de la
brèche d'après 18,90% , le barrage de Diama selon 9,60%, les
changements climatiques pour 8,80%, l'utilisation d'instruments destructeur des
racines de palétuviers lors de la cueillette des huîtres selon 8%,
l'érosion côtière d'après 5,8% et l'acidité
des sols selon 8%.
40,90%
18,90%
8,80% 8,00% 9,60% 8%
5,80%

Figure 12 : Différentes causes de la
dégradation de la mangrove selon les femmes transformatrices
32
3.1.3.2 Les conséquences de cette
dégradation des écosystèmes mangrove
L'analyse de la figure 13 montre que les conséquences
de la dégradation de la mangrove sont
la baisse de la production
ostréicole selon 70%, une baisse des revenus d'après 20% et
le
déracinement des palétuviers selon 10% des femmes
enquêtées. Cependant, on constate que la
dégradation de
la mangrove favorise une baisse de la production ostréicole qui se
répercute sur
la vie socio-économique des femmes
transformatrices des huîtres à Diél Mbam.
Cependant,
Badji (2012) stipule que les activités de production sur
la mer et les côtes sont perturbées par
l'absence d'habitat ou
de végétation, et les conséquences de la
dégradation sont multiples et
néfastes pour l'environnement et
se répercutent sur la vie socio-économique de la population

Baisse de la production ostréicole
Baisse des revenus Déracinement des arbres
20%
10%
70%
Figure 13 : Conséquences de la
dégradation de la mangrove selon les femmes transformatrices
3.1.3.3 L'impact de l'immersion des récifs
artificiels sur les ressources halieutiques
En 2009, l'AMP de Saint-Louis dans le cadre de ses
activités d'aménagement, a bénéficié d'un
appui de Compact/FEM, pour la confection et l'immersion de trois cent deux (302
récifs artificiels) dans les zones de frayères (Zone de
Protection Intégrale) avec une technologie locale. Puis en 2014, sous le
financement du projet FEM, l'Aire Marine Protégée de Saint-Louis
à travers le GIE Suxali AMP a confectionné quatre cents (400)
récifs artificiels pour contribuer à l'atteinte des objectifs de
conservation du site. Ainsi, dans le courant du mois d'octobre, l'équipe
en place a programmé l'immersion des récifs artificiels en
mer.
3.1.3.3.1 Analyse comparative des résultats des
études biologiques de 2009 et de 2015 En 2009, vingt-cinq (25)
taxons d'un poids total de 73 kg ont été dénombrés
alors qu'en 2015 trente-quatre (34) taxons d'un poids total de 87,223 kg ont
été inventoriés au niveau de l'AMP de Saint-Louis. Pour
une période de six (6) ans, le nombre de taxons a évolué
de neuf (9) points avec un différentiel de poids de 14,223 kg.
33
Seules 12 espèces que sont Brachydeuterus auritus,
Chlorocombis chrysurus, Drepane africana, Cynoglossus senegalensis, Ephippion
guttifer, Ilisha africana, Pentanemus quinquarius, Pseudotolithus senegalensis,
Sardinella aurita, Sardinella maderensis, Stromateus fiatola et
Trichiurus lepturus sont communes aux deux pêches. Ainsi, ces 12
espèces en commune peuvent être considérées comme
étant la base permanente du peuplement de l'AMP de Saint-Louis en saison
froide. Cependant, en 2015, environ 402 individus composés de 34
espèces, appartenant à 20 familles ont été
identifiées (Cf. Annexe 12). En termes de diversité
spécifique la famille des Scianidea et des Mugilidae avec quatre (4)
espèces chacune sont les plus représentatives, viennent ensuite
les Ariidae (3 espèces) et les Portunidae (2 espèces). Ce
résultat peut être expliqué par l'effort de conservation
consentis pour l'amélioration de la remontée biologique au niveau
de l'AMP.

40
90
80
70
60
50
30
20
10
0
Etat de référence 2009 Pêche
expérimentale 2015
73
25
87,223
34
Poids (Kg) Taxons
Figure 14: Taxons et poids dénombrés
à l'AMP lors des deux pêches expérimentales
3.1.3.3.2 Niveau de satisfaction des pêcheurs
après immersion de récifs artificiels
Selon 44,4% des pêcheurs interrogés, l'immersion de
récifs artificiels est assez satisfaisante contrairement à 55,6%
qui pensent que l'activité n'est pas satisfaisante.
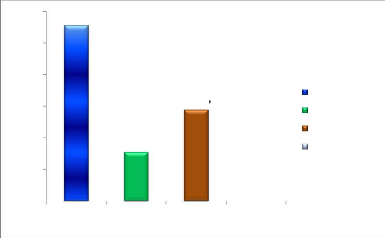
Satisfaisant Très
satisfaisant
Peu
satisfaisant
Pas
satisfaisant
Pas satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant
Très satisfaisant
55,60%
28,90%
15,50%
0,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
34
Figure 15 : Niveau de satisfaction des
pêcheurs après immersion de récifs artificiels
| 


