ANNEXES
Annexe1 : des généralités sur
l'apiculture
Répartition des abeilles mellifiques en Afrique et
au Bénin
En Afrique, on rencontre de nombreuses sous-espèces de
l'abeille Apis mellifica tels que :
· Apis mellifica intermissa ou tellienne ;
· Apis mellifica major d'Afrique du nord-ouest
;
· Apis mellifica sahariensis, saharienne ;
· Apis mellifica lamarckii égyptienne ;
· Apis mellifica nubica, soudanaise ;
· Apis mellifica scutellata ;
· Apis mellifica littorea ;
· Apis mellifica monticola ;
· Apis mellifica adansonii;
· Apis mellifica capensis, du Cap ;
· Apis mellifica unicolor, de Madagascar ;
· Apis mellifica jemenitica (Jean-Prost, 1987).
La figure 19 illustre la répartition africaine des
différentes sous-espèces de l'abeille Apis mellifica.
Des sous-espèces africaines, celle que l'on retrouve en Afrique
occidentale est Apis mellifica adansonii.

B
ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE
BANTE

Source : SMITH, 1961
Figure 6: Répartition
géographique d'Apis mellifica adansonii et d'autres
espèces d'abeilles africaines.
Au Bénin, les travaux menés sur la typisation des
abeilles mellifères dans le Nord
Bénin sont parvenus aux conclusions selon lesquelles,
les abeilles identifiées peuvent être réparties en deux
groupes: un premier groupe avec des abeilles petites, jaunes, plus agressives
et produisant plus de miel et un second groupe avec des abeilles plus grosses,
noires, moins agressives et produisant moins de miel (Hounkpe, 2005).
Toutefois, malgré cette apparente différence,
les abeilles du Nord-Bénin appartiennent à la même
sous-espèce adansonii d'Apis mellifica.
Alors la taxonomie de l'abeille mellifère du
Nord-Bénin est la suivante :
· Embranchement des Arthropodes ;
· Classe des Insectes ;
· Ordre des Hyménoptères ;
· Superfamille des Apoidea ;
· Famille des Apidae ;
· Genre Apis ;
· Espèce A. mellifera ou A.
mellifica.
· Sous-espèce A. mellifica adansonii

C
ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE
BANTE
Comportements de l'abeille mellifère
Les comportements suivants sont rencontrés en Afrique
de l'Ouest chez la mouche à miel, Apis mellifica adansonii
(Mensah, 2008).
Ainsi, on peut noter que :
_ le développement de sa colonie est très rapide
;
_avant le lever du soleil, les abeilles butinent
déjà le nectar et pollen ;
_ Pendant les journées chaudes, les abeilles
ouvrières ne butinent que le matin et le
soir ;
_ l'essaimage est fréquent et conduit des fois à
une désertion ;
_ la sous-espèce A. mellifica adansonii
déserte le nid pour plusieurs raisons : présence
d'un prédateur à l'intérieur (fausse teigne,
fourmis) ou à l'extérieur (oiseaux, lézards)
de la ruche, mauvaise protection de la ruche contre les facteurs
climatiques, usage
intempestif de fumées, etc. ;
_ Les abeilles africaines ont rarement des moeurs pillardes ;
_ Les abeilles africaines sont agressives. Cette
agressivité est une adaptation qui leur a
permis de survivre malgré la présence des
prédateurs ;
_ les ouvrières construisent 1.050
cellules/dm2.
. Morphologie de l'abeille mellifère
Le corps de l'abeille mellifère comprend les trois
parties suivantes (Maurizio, 1968) : la tête; le thorax; l'abdomen ;
(figure 20).
La tête est de forme variable selon les types
d'individus et porte une paire d'antennes situées de chaque
côté de la tête, jouant un rôle important dans
l'orientation, le toucher, l'odorat et l'ouïe ; deux yeux composés,
situés de chaque côté de la tête et intervenant dans
la vision lointaine, la distinction des couleurs et la détection de la
direction des ultra-violets du soleil ; trois yeux simples ou ocelles,
disposés en triangle en haut de la tête, intervenant dans la
vision rapprochée ; un appareil buccal, renfermant la lèvre
supérieure, la lèvre inférieure, deux mandibules et la
langue.

D
ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE
BANTE
Le thorax est formé de trois segments dont le
prothorax, le mésothorax et le métathorax. Le thorax porte deux
paires d'ailes dont une sur le mésothorax et l'autre sur le
métathorax, puis trois paires de pattes articulées en cinq
segments.
Les pattes antérieures, fixées au prothorax sont
pourvues de peignes qui servent à nettoyer les antennes. Les pattes
médianes rattachées au mésothorax sont une sorte de main
au moyen de laquelle l'abeille dépose les pelotes de pollens. Enfin, les
pattes postérieures, reliées au métathorax, portent chez
les ouvrières une structure spécialisée de collecte du
pollen appelée corbeille.
L'abdomen est constitué de sept segments. Il porte la
plupart des organes essentiels de l'abeille à savoir : le coeur, les
organes génitaux, le jabot, l'intestin, les glandes à venin, les
glandes cirières et la glande de Na1sanov. La figure 20 montre la
morphologie d'Apis mellifera adansonii.
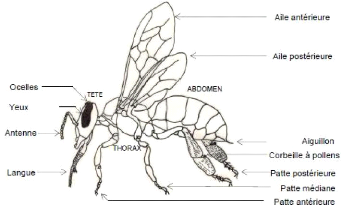
Photo 13: Morphologie d'Apis mellifera
adansonii
Concept de colonie et durée de vie des
abeilles
Une colonie d'abeilles est généralement
constituée d'une reine, de 15.000 à 60.000 ouvrières et de
quelques dizaines à 1.000 mâles ou faux bourdons, suivant les
saisons, la race, les qualités génétiques et l'âge
de la reine (Laflèche, 1990). Le tableau 12 nous renseigne sur les
différenciations entre reine, ouvrières et faux bourdons. Dans
les colonies sauvages, les


E
ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE
BANTE
mâles sont un peu plus nombreux que dans les colonies
domestiquées du fait que dans ces dernières, on n'offre à
la reine que des cellules d'ouvrières dont quelques-unes seulement sont
élargies par les ouvrières aux dimensions de cellules des
mâles.
Tableau 9 : Différenciation de la Reine,
l'Ouvrière et le Mâle (Apis mellifera)
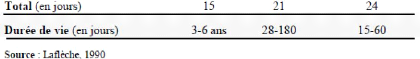
Rôles et fonctions des habitants de la ruche
Reine
Entre le 5ème et le 13ème jour après sa
naissance, la reine (figure 21), stimulée par des ouvrières qui
la poussent et la secouent dans une marche de va-et-vient rapide jusqu'au trou
d'envol, finit par sortir de la ruche pour être fécondée en
vol nocturne par un ou plusieurs mâles. Sa fonction
post-fécondation est de pondre plusieurs centaines d'oeufs par jour
dès que les conditions climatiques sont favorables, c'est-à-dire
lorsque les ouvrières peuvent récolter du pollen. La reine peut
pondre sans interruption. Elle pose un oeuf au fond de chaque alvéole
(Laflèche, 1990).

F

G
ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE
BANTE

Photo14 : Reine entourée d'une colonie
d'ouvrières Ouvrières
Les fonctions des ouvrières sont multiples. Dans leur
jeunesse, elles restent dans la ruche et s'occupent entre autres de la
construction des bâtisses, du nettoyage des alvéoles après
la naissance des abeilles, de la nourriture de larves, de l'accumulation des
réserves de miel et de pollen, de la transformation dans leur jabot du
nectar et du miel (Laflèche, 1990).
Faux Bourdons
Outre leur rôle essentiel dans la fécondation des
reines, les fonctions secondaires des mâles sont encore imprécises
: ils ne butinent pas, ne possèdent ni de corbeilles à pollen, ni
de glandes cirières, ni celles de Nasanov, ni de glandes à venin.
Le mâle est une abeille spécialisée à
l'extrême ; ses organes sexuels, en proportion des dimensions de son
corps, sont plus volumineux que ceux de la plupart des autres habitants de la
ruche (Laflèche, 1990).
Composition physico-chimiques, propriétés
et utilisations des produits de la ruche
Le miel et tous les autres produits de la ruche
possèdent des vertus thérapeutiques très
diversifiées. L'api thérapie est de plus en plus répandue
et intéresse tant la médecine moderne que traditionnelle
où elle utilise le miel, la cire, le pollen, la propolis, la
gelée royale et même
ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE
BANTE
le venin d'abeille. La médecine traditionnelle et les
études scientifiques actuelles forment un ensemble remarquable
Miel
Le miel est le produit le plus abondant et le plus
précieux de la ruche. Il provient de la transformation du nectar et du
miellat butinés par les abeilles sur les plantes. Le miel est un produit
entièrement naturel d'origine animale. Sa composition dépend de
nombreux facteurs : espèces florales butinées, race d'abeilles,
état physiologique de la colonie (Sounon, 2000). Pour déterminer
le type de miel de fleurs, on utilise le comptage au microscope des grains de
pollen qu'il contient. Il n'existe pratiquement pas de miel ne provenant que
d'une seule fleur. Lorsque la proportion de grains de pollen d'une seule plante
représente plus de la moitié de l'ensemble du pollen, le miel
prend le nom de cette plante (Philippe, 1999). Le miel peut présenter
une coloration très variable allant du jaune clair au brun presque noir,
suivant l'origine de la fleur ou les altérations qu'il a pu subir
(Sounon, 2000). De plus, le miel cuit issu de la cueillette perd ses valeurs
nutritionnelles, contrairement au miel cru issu d'un élevage bien
contrôlé.
Le miel est un milieu dysgénésique pour le
développement microbien. Cela est dû
à son acidité (pH compris entre 3 et 5,5) et sa
forte concentration en sucre (80%) qui ne permet pas la présence d'eau
libre. Sa densité moyenne (miel mûr) est de 1,4 (CENAPI, 1992).
C'est un produit hygroscopique (absorbe l'humidité de l'air pour
s'hydrater). Il contient des levures qui peuvent se multiplier si la teneur en
eau est élevée (supérieur à 18%) pour provoquer la
fermentation alcoolique. Le miel a une composition moyenne (tableau 13) de 75
à 80% d'hydrate de carbone (sucres essentiellement réducteurs),
18 à 20% d'eau ; 0,3% d'acides ; 0,4% de protéines et aminoacides
; 0,2% de minéraux, des vitamines des diastases et 1 à 5% de
substances diverses (Crane, 1980). Le miel possède des
propriétés enzymatiques, antibiotiques et est utilisé
comme recalcifiant osseux et dentaire intéressant. Très efficace
dans le traitement des ulcères de l'estomac et du duodénum, le
miel possède une action favorable sur la flore intestinale ; lutte
contre la toux, les refroidissements et normalise la composition du sang en
accroissant le taux d'hémoglobines (Laflêche, 1990). Toutefois,
pour ne pas perdre certaines de ces propriétés, le miel ne doit
pas être chauffé. S'il devient nécessaire de le
liquéfier, il faut s'interdire de dépasser 35 à
40°C.

H
ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE
BANTE
Tableau 10: Composantes approximatives du
miel
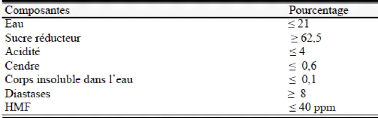
Pollen
Le pollen est la cellule mâle des fleurs
libérée après la déhiscence des anthères. Il
constitue la principale source de nourriture du couvain des abeilles, depuis
l'état larvaire jusqu'à la jeune adulte. Grâce aux
nombreuses propriétés nutritives et médicinales du pollen,
de nombreux apiculteurs français, en plus de la récolte du miel
ont entrepris la récolte du pollen. D'autres ont même
abandonné le miel pour se consacrer uniquement au pollen (Philipe,
1999). La couleur du pollen varie
Selon le genre de plante dont il est issu. Bien que fortement
utilisé en alimentation humaine et en thérapeutique, sa
composition chimique n'est pas entièrement connue. Néanmoins, il
convient de signaler qu'après un an de conservation à
l'état sec, l'efficacité du pollen est réduite à
76% et après deux ans à zéro. On peut donc conclure que le
pollen en conservation est soumis à des changements chimiques, et que sa
teneur en principes actifs diminue en fonction de la durée de
conservation. Il est conseillé d'en consommer de moins d'un an (Philipe,
1999).
Propolis
La propolis est une substance visqueuse et collante de couleur
variable (jaune clair, noire, vert, brun), qui est fabriquée par les
abeilles à partir de la régurgitation de substances
résineuses des pollens ou de la récolte sur les bourgeons
d'arbres (Laflèche, 1990). La propolis est utilisée par les
ouvrières pour colmater les fissures et trous de leur ruche ou comme
substance antiseptique pour enrober un corps étranger putrescible
qu'elles ne parviennent pas à évacuer de la ruche. Elle
possède des propriétés antifongiques et

I
ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE
BANTE
anesthésiques. C'est un excellent produit antirouille
(Fronty, 1980). Toutefois, sa composition chimique varie fortement selon sa
provenance.
Venin d'abeille
Liquide transparent, d'une odeur prononcée et d'un
goût âcre, le venin d'abeille est produit par des glandes
situées à la partie postérieure de l'abdomen des
ouvrières et de la reine. Il s'accumule dans le sac à venin
relié à l'aiguillon piqueur (Philipe, 1999). Il contient des
acides, de l'histamine, des substances azotées, des graisses volatiles
contenant de nombreuses diastases, une substance antibiotique très
active, des facteurs de diffusion (Laflèche, 1990). Le venin d'abeille
est susceptible de créer un anticorps assurant l'immunité
à certaines maladies. Il possède de ce fait des
propriétés antirhumatismales, antinévralgiques,
anti-infectieuses, révulsives, cardiotoniques, anticoagulantes et
vasodilatatrices (Laflèche, 1990). A la suite d'une piqûre
d'abeille, une douleur aiguë et vivace se traduit par de simple
gonflement, engourdissement et oedème. A faible dose, le venin d'abeille
agit sur le système nerveux central des mammifères en provoquant
des réactions anaphylactiques dues aux amines vaso-actives. Il induit
généralement une toxicité locale bénigne.
Appliqué en grande quantité correspondant à une centaine
de piqures, il occasionne une toxicité générale
manifestée par des crampes, une respiration ralentie puis
irrégulière et une hémolyse (Philipe, 1999).
Cire
La cire d'abeille est une substance grasse
secrétée par les quatre paires de glandes à cire
situées sur la partie ventrale de l'abdomen des ouvrières
âgées d'environ 15 jours (Philipe, 1999). Sa production
nécessite la consommation d'une importante quantité de miel : 12
kg de miel pour produire 1 kg de cire (Fronty, 1980). La cire de l'abeille
domestique Apis mellifera se compose de 16% d'hydrates de carbone, 31
% d'alcools monohydriques à chaînes simples, 3% de diols, 31%
d'acides gras, 13% d'acides hydroxiques et 6% d'autres substances (Downing,
1961). Elle s'utilise en cosmétologie pour fabriquer des crèmes
pour la peau, des rouges à lèvre et sert de teinte pour les
tissus Wax. En pharmacie, elle est utilisée pour l'enrobage des pilules
(Kokoye, 1991).

J
ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE
BANTE
Couvain
Le couvain est le stade larvaire que traversent les mouches
à miel avant leur transformation en insecte parfait. Il loge dans le
corps de la ruche et selon les différentes métamorphoses suivies,
peut être qualifié de couvain ouvert ou operculé. Le stade
larvaire dure 9 jours chez la reine, 14 jours chez le mâle et 11 jours
chez l'ouvrière (Laflèche, 1990).
Annexe 2: de laMatrice de données
caractéristiques socio-culturelles des apiculteurs
|
Localité
|
Langue parlée
|
Niveau
d'inscription
|
Activité principale
|
Chasseurs de miel rencontrés
|
sexe
|
|
Akpaka
|
T
|
A(1), Na(2)
|
1
|
|
3
|
M
|
|
Alloba
|
T, M
|
A(1), Na(10), P(1)
|
1
|
|
2
|
M
|
|
Aoro
|
Y
|
P(2), S(5)
|
1,3
|
|
7
|
M
|
|
Atokolibé
|
T
|
Na(1)
|
1
|
|
|
M
|
|
Banon
|
T
|
Na(6), A(1), P(3)
|
1,3
|
|
9
|
M
|
|
Bigina1
|
M, Y
|
P(4), Na(2), S(1)
|
1 ;
|
3
|
2
|
M
|
|
Bigina2
|
Y
|
A(5)
|
1
|
|
|
M
|
|
Bigin a3
|
T, Y
|
P(2), A(1), Na(2)
|
1
|
|
|
M
|
|
Koko
|
M, T
|
Na(9), A(11),
P(12), S(4)
|
1 ;
|
2 ; 3
|
7
|
M, F(9)
|
|
Kpreketè
|
H, Y
|
A(2)
|
1
|
|
|
M
|
|
Lougba
|
T
|
Na(3), p(2)
|
1
|
|
3
|
M
|
|
Mayamon
|
T
|
A(3), Na(1)
|
1
|
|
|
M
|
|
Sako
|
T
|
Na(1)
|
1
|
|
|
M
|
|
Agoua
|
T
|
|
1
|
|
4
|
M
|
|
Tobé
|
T
|
P(1)
|
1 ;
|
3
|
|
M
|
Légende : T : Tcha, M :Mahi, Y :Yom, H
:Holli, Na : Non alphabétisé, A : Alphabétisé, P
:
Primaire, S : Secondaire, 1 :Agriculture, 2 :Elevage, 3
:Autre, (nombre concerné), M : Masculin, F : Féminin.

K
ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE
BANTE
| 


