|
Julie, GENSOUS Année 2014 - 2015

|
Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
/ Beau
Site
|
|
La réaction du MERM face à une situation
d'urgence en imagerie médicale
Unité d'enseignement 6.5 :
Organisation du travail, analyse des pratiques et recherche
professionnelle
Sous la guidance de : Mr BONELLI Jean-François
Cadre de santé du service d'imagerie du CHU Archet Nice
Julie, GENSOUS Année 2014 - 2015

|
Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
/ Beau
Site
|
|
La réaction du MERM face à une situation
d'urgence en imagerie médicale
Unité d'enseignement 6.5 :
Organisation du travail, analyse des pratiques et recherche
professionnelle
Sous la guidance de : Mr BONELLI Jean-François
Cadre de santé du service d'imagerie du CHU Archet Nice
Note aux lecteurs
« Il s'agit d'un travail personnel et il ne peut faire
l'objet d'une publication en tout ou partie sans l'accord de son auteur
»
Remerciements
En premier lieu, je remercie Monsieur BONELLI, cadre de
santé d'imagerie médicale de l'hôpital de l'Archet 2
(Nice). En tant que directeur de mémoire, il m'a guidée,
orientée et conseillée dans mon travail tout au long de cette
année.
Je tiens également à remercier le Docteur
RAFFAELLI, directeur de formation, et Madame CIPPOLINI, coordinatrice de
section, pour leur implication dans notre formation avec la mise en place de la
réforme d'études. Je remercie également tous les
professeurs et intervenants pour la qualité de l'enseignement
dispensé au cours de ces trois années de formation.
Je remercie aussi le directeur de Lycée Honoré
Estienne d'Orves / Beausite pour nous avoir accueillis dans son
établissement.
Pour finir je souhaite remercier mes parents, qui m'inspirent
et me poussent toujours à aller de l'avant, ainsi que mes compagnons et
étudiants manipulateurs de formation avec qui je partage les mêmes
visions de la profession.
Je remercie en particulier Monsieur Aurélien CLEMENT,
pour m'avoir encouragée et soutenue au cours de ces trois belles
années d'étude.
Glossaire
MERM Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale
IMRT Imagerie médicale et Radiologie
Thérapeutique
CHU Centre Hospitalier Universitaire
AFGSU Attestation de Formation aux Gestes et Soins
d'Urgences
DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation
et des Statistiques
CCMU Classification Clinique des Malades aux Urgences
O.R.U MIP Observatoire Régional des Urgences
Midi-Pyrénées
SMUR Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
VVP Voie Veineuse Périphérique
HAS Haute Autorité de Santé
SFN Société Française de Neurologie
CIRCATI Comité Interdisciplinaire de Recherche et de
travail sur les Agents de Contraste en
Imagerie
SFR Société Française de Radiologie
ANSM Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des Produit de Santé
EAACI Académie d'Allergologie et d'Immunologie
Clinique
IRA Insuffisance Respiratoire Aigüe
ACR Arrêt Cardio Respiratoire
SAMU Service d'Aide Médicale d'Urgence
DAE Défibrillateur Automatique Externe
NRBCE Nucléaire Biologique Radiologique Chimique et
Explosif
PAS Procéder Alerter Secourir
LVA Libération des Voies Supérieures
PLS Position Latérale de Sécurité
RCP Réanimation Cardio-Pulmonaire
CESU Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence
MCE Massage Cardiaque Externe
DPC Développement Professionnel Continu
Sommaire
1. Introduction 1
2. De la situation d'appel à la question de
départ 3
2.1. Situation d'appel 3
2.2. Analyse et questionnement 4
2.3. Recherches préliminaires 5
2.4. Questions de départ 7
3. Qu'est-ce que l'urgence en imagerie
médicale ? 7
3.1. Définition 7
3.2. Classification CCMU 7
3.3. Situations d'urgence en imagerie médicale
9
3.3.1. Législation 9
3.3.2. Urgences 10
3.3.2.1. Syncope 10
3.3.2.2. Crise de spasmophilie 10
3.3.2.3. Crise d'épilepsie 11
3.3.2.4. Extravasation 11
3.3.2.5. Choc anaphylactique 13
3.3.2.5.1. Définitions 13
3.3.2.5.2. Classification de Gell et Coombs 14
3.3.2.5.3. Classification des réactions
d'hypersensibilité selon l'EAACI 15
3.3.2.5.4 : Classification de Ring et Messmer 16
3.3.2.5.5 : Les signes du choc anaphylactique 16
3.3.2.6. Détresse respiratoire 17
3.3.2.7. Arrêt cardio-circulatoire 18
3.3.3. Prise en charge 19
3.3.3.1. Syncope 19
3.3.3.2. Crise de spasmophilie 20
3.3.3.3. Crise d'épilepsie 20
3.3.3.4. Extravasation 21
3.3.3.5. Choc anaphylactique 22
3.3.3.6. Détresse respiratoire 22
3.3.3.7. Arrêt cardio-respiratoire 23
4. La réaction du MERM... le stress !
24
4.1. Etymologie et définition 24
4.2. Auteurs 25
4.2.1. Claude Bernard (1813 -1878) 25
4.2.2. Walter Bradford Cannon (1871 - 1945) 26
4.2.3. Hans Selye (1907 - 1982) 26
4.2.4. Richard S. Lazarus (1922 - 2002) et Susan Folkman 29
4.3. Physiologie du stress 30
4.3.1. Médullo-surrénale et catécholamines
30
4.3.2. Cortex surrénal et corticostéroïdes
31
4.4. Les causes du stress au travail 32
4.4.1. Définition 32
4.4.2. Classification des stresseurs 33
5. Comment le gérer ? 36
5.1. Le maintien des connaissances par la
répétition 36
5.1.1. Définition 36
5.1.2. Auteurs 36
5.1.2.1. Ivan Pavlov (1849-1936) 36
5.1.2.2. Edward Lee Thorndike (1874-1949) 37
5.1.2.3. John Broadus Watson (1878-1958) 39
5.1.2.4. Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990) 40
5.1.2.5. Hermann Ebbinghaus (1850-1909) 40
5.2. AFGSU 42
5.3. Formations hospitalières et DPC
44
5.4. Le simulateur, un outil de répétition
? 45
5.4.1. Les simulateurs 45
5.4.1.1. Définitions 45
5.4.1.2. Origine et évolution 45
5.4.1.3. Techniques de simulation 47
5.4.2. Simulation en santé 48
5.4.2.1. Les modèles de simulation en santé 49
5.4.2.2. Avantages 50
5.4.2.3. Limites 51
5.4.2.4. Centres de simulation 52
5.4.2.4.1. En Amérique du Nord 52
5.4.2.4.2. En France 52
6. Hypothèse de recherche 54
7. Enquête de terrain 54
7.1. Choix et construction de l'outil d'enquête
54
7.2. Choix des lieux et des populations 54
7.3. Modalités de réalisation
55
7.4. Résultats attendus 55
8. Conclusion 56
9. Bibliographie 57
10. Annexes 62
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 1
1. Introduction
« Le manipulateur est l'aide qui fait fonctionner les
appareils pour le médecin radiologiste ; c'est lui qui entretient
l'appareillage en bon état, développe les plaques, manipule le
porte ampoule, répare les défauts de l'installation
électrique. Son rôle est en principe, celui d'un ingénieur
technicien ; quand il a été affecté à un poste
mobile, il doit comme le médecin être particulièrement
actif, habile et débrouillard. » (Extrait du livre, La
radiologie et la guerre, Marie Curie - Editions Félix Alcan 1921)
Marie Curie apporte dans son livre la toute première
définition du métier de MERM. Bien des choses ont changé
depuis (et heureusement) mais l'essence même de la partie technique du
métier est restée intacte. C'est une partie très
importante de notre métier de « technicien » en imagerie
médicale mais ce n'est pas la seule facette de notre profession ; cette
dimension n'est pas unique et la dimension relationnelle partagée avec
le patient prend une place tout aussi importante.
Dans notre époque propice aux résultats à
tous prix et à la qualité avant tout, il est indispensable de ne
pas oublier cette approche « soignant » qui fait l'essence d'un bon
MERM. Cette relation soignant-soigné peut tout simplement se traduire
par une explication détaillée de l'examen qui va suivre si le
patient présente de l'angoisse, ou alors accepter de faire rentrer un
proche en cabine avec le patient si celui-ci en ressent le besoin ou encore
faire écouter de la musique pendant l'examen IRM d'un patient pour
essayer de le détendre. Cette notion de relationnel
soignant-soigné n'est pas quelque chose qui s'apprend. Les limites entre
bon manipulateur qui se contente de faire des images et excellent manipulateur
qui rajoute en plus un soin attentionné et bienveillant pour son patient
sont minces.
Depuis les mots de Marie Curie au début du
XIXème siècle et aujourd'hui, bien des progrès
ont été fais en matière de technologie et de techniques en
parallèle avec l'évolution des moeurs et de la
société. Ce qui était tenu pour acquis il y a 10 ans peut
facilement devenir obsolète 5 ans plus tard. La capacité à
se maintenir à niveau est donc très importante. Et c'est d'autant
plus difficile vu la rapidité d'évolution des nouvelles
technologies.
Aujourd'hui, les examens réalisés en imagerie
médicale se doivent d'être toujours plus performants dans le but
d'obtenir un examen d'une qualité toujours plus élevée,
alliant efficacité et
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 2
rapidité de l'acte ainsi que confort et satisfaction du
patient. La préoccupation première de l'amélioration de
notre métier s'axe sur la radioprotection patient avec le principe ALARA
« As Low As Reasonably Achievable » qui vise à diminuer encore
et toujours la dose reçue par les patients lors de leur examens.
Malgré toutes les évolutions il y a des facteurs que l'on ne peut
influencer. Le nombre d'urgences rencontrées en imagerie médicale
en est un parfait exemple.
Bien que l'imagerie médicale ne soit pas un secteur
privilégié de l'urgence elle rencontre tout de même son lot
d'évènements et d'imprévus. Même si la diminution de
toxicité des produits de contraste iodé en scanner ou des
produits de contraste gadolinés en IRM ont été une des
principales évolutions en la matière, il faut se rendre compte
que, malheureusement, peu de choses peuvent être faites quant à
l'incidence de survenue des urgences, celles-ci dépendant uniquement de
l'état de santé du patient.
En tant que MERM nous devons être capables de
réagir et de prendre en charge ces urgences, avec efficacité et
rapidité, malgré le stress intense que cela engendre.
Mon mémoire se base sur trois notions qui sont les
suivantes : l'urgence, le stress et la gestion du
stress.
J'aborderai ce mémoire en commençant par mes
situations d'appel, bases m'ayant servi à l'élaboration de mon
questionnement. Je consacrerai ensuite une partie théorique comprenant
une première sous-partie sur la définition de l'urgence, les
situations d'urgence rencontrées par les MERM et leur prise en
charge.
Dans une seconde sous-partie je développerai la notion
de stress et, dans une troisième sous partie, comment le gérer,
à l'aide de différents outils.
Je soumettrai ensuite mon hypothèse de recherche. Cette
dernière devra être testée auprès d'une certaine
population sur le terrain.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 3
2. De la situation d'appel à la question de
départ
2.1. Situation d'appel
Etudiante en DTS IMRT j'ai pu au cours de mes trois
années de formation réaliser de nombreux stages en milieu
privé et publique. Pendant mes stages, quelle que soit la
spécialité rencontrée, j'ai toujours posé les
même questions aux manipulateurs qui me formaient : «
Rencontrez-vous souvent des situations d'urgence, comme un arrêt
cardio-respiratoire par exemple ? » ou « Est-ce que cela vous arrive
souvent d'avoir une urgence vitale pendant un examen ? »
Innocemment au départ puis au fur et à mesure de
mon avancée dans la formation et de la construction de ma conscience
professionnelle je me suis sérieusement posée la question. Et je
l'ai très sérieusement posée aux manipulateurs m'entourant
tout au long de mes stages. Les deux situations suivantes vécues en
stage n'ont fait que renforcer mon intérêt pour ce sujet.
C'est en début de deuxième année, lors
d'un stage de médecine nucléaire en CHU, que j'ai
rencontré ma première situation d'urgence. L'examen
programmé était une scintigraphie pulmonaire pour un nourrisson
d'un an, celui-ci était accompagné de sa mère. En arrivant
dans le service le patient était calme, installé dans les bras de
sa mère ; après son installation il pleurait beaucoup ne
comprenant pas pourquoi il était maintenu de force avec sur le visage un
masque, qui lui englobait le nez et la bouche, le tout maintenu par un inconnu
( !). Avec en plus une hotte aspirante au-dessus de la tête, et deux
étrangers le regardant fixement (un manipulateur et moi-même).
Situation plutôt perturbante pour un enfant de cet âge... Tout
était prêt, le matériel était en place et le patient
en position. Lors de la phase d'inhalation du produit radioactif tout se
déroulait comme prévu. Après quelques inspirations,
entrecoupées de cris et de pleurs, la manipulatrice a mesuré la
radioactivité absorbée par le patient, le résultat
était anormal. Aucune radioactivité n'était
décelée. Les manipulateurs se sont concertés, nous nous
sommes concentrés sur l'installation du patient et sur le
matériel tout en continuant de le faire respirer jusqu'à ce que
sa mère, qui regardait la scène dans un coin de la pièce,
ne pousse un cri. Toute notre attention est alors revenue sur l'enfant qui
était devenu bleu. Tout son visage était cyanosé. En une
fraction de seconde le matériel a été
débranché et retiré, les médecins appelés et
l'enfant pris en charge pour qu'il se ré-oxygène. Pendant ce
court laps de temps je me suis rendue compte que le niveau de stress des
manipulateurs avait grimpé en flèche car ils ne savaient pas quoi
faire.
J'ai été surprise par la rapidité de
réaction de l'équipe. L'arrivée des médecins a
été immédiate et ils ont pris en charge l'enfant qui a
retrouvé un état respiratoire normal. Personnellement, durant
les
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 4
secondes où tout se passait, j'ai été
incapable de réagir et je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pu
qu'observer les manipulateurs agir avec rapidité pour prévenir et
alerter mais paniquer pour les soins à réaliser. Après cet
incident j'ai interrogé les manipulateurs sur leur ressenti et leur
réponse générale fut « stress et panique à
bord ».
Au cours de la même année j'ai effectué un
stage de scanner dans un CHU spécialisé dans l'urgence. Lors d'un
examen injecté pour une suspicion d'embolie pulmonaire sur une patiente
en fin de vie, venant du service de réanimation, celle-ci a fait un
arrêt cardio-respiratoire. Les manipulateurs ne se sont pas rendus compte
tout de suite de l'état de la patiente. En effet l'interne
réanimateur discutait avec un manipulateur et le deuxième
manipulateur m'expliquait le déroulement de l'injection du produit de
contraste iodé sur la console de scanner. Nous nous en sommes rendu
compte lors de la vérification des images scanographiques, la
distribution du produit de contraste dans le corps de la patiente était
anormale. C'est à cet instant que l'interne réanimateur a vu que
le tracé du monitoring était à plat. Tout a
été très vite. Un manipulateur est entré en salle
et a crié « arrêt cardiaque ». Il a sorti la table de
l'anneau du scanner pour rapprocher la patiente de l'interne, qui a
commencé les gestes de premier secours. Le manipulateur en salle de
console a appelé le numéro d'urgence, le personnel de
réanimation est arrivé dans la minute avec tout le
matériel nécessaire pour réanimer la patiente. En quelques
secondes radiologues, médecins et infirmiers urgentistes sont
arrivés en salle d'examen. Après 30 minutes de réanimation
le coeur de la patiente a repris un rythme et il a été
décidé de poursuivre l'examen avec une seconde injection.
Durant cette situation d`urgence les manipulateurs sont
restés en salle de console, à regarder les réanimateurs.
Je leur ai demandé par la suite, leurs impressions et leur ressenti par
rapport à cet évènement. Leur discours a été
légèrement différent de la première situation car
ils travaillent dans un service d'urgence mais l'impression
générale était tout de même un état de stress
intense.
2.2. Analyse et questionnement
Suite à ces situations et à la formation AFGSU
suivie lors de mon cursus j'ai décidé de débuter mon
mémoire autour du thème de la prise en charge de l'urgence par le
MERM.
J'ai remarqué qu'au cours de la prise en charge de
situations d'urgence les manipulateurs sont stressés, anxieux, voir en
panique. Nous sommes pourtant des soignants et nous nous devons de
réagir efficacement et correctement face à l'urgence pour assurer
une prise en charge efficace et la survie du patient.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 5
2.3. Recherches préliminaires
Afin de me renseigner sur cette constatation j'ai
décidé de mettre en place une enquête exploratoire
basée sur la question de départ suivante :
Sommes-nous capables en tant que MERM de prendre en
charge efficacement et rapidement une situation d'urgence ?
Ce questionnaire a été soumis dans trois CHU,
à trois manipulateurs de scanner de chaque CHU. J'ai choisi un CHU
spécialisé dans l'urgence et deux CHU non
spécialisés dans l'urgence et dont les spécialités
et activités sont différentes pour pouvoir comparer les
réponses de manipulateurs de différents services.
Les manipulateurs interrogés ont été
choisis selon la disponibilité de l'équipe par rapport à
l'activité du service et ce sont donc des manipulateurs de
différents sexes, âges et ancienneté dans le service qui
ont été interrogés.
J'ai interrogé chaque manipulateur en privé pour
ne pas qu'ils soient influencés par leurs collègues. A chaque
manipulateur était donné un exemplaire du questionnaire
d'enquête, je leur ai posé chaque question à l'oral et ils
m'ont répondu selon leur impression et ressenti.
L'enquête exploratoire (Annexe 1) comporte les questions
suivantes : Question n°1 : Quelle est votre définition
d'une situation d'urgence ?
55% des manipulateurs interrogés incluent la notion de
vitalité dans la situation d'urgence et 77% incluent la notion de
vitesse dans la réalisation de l'examen.
Il est intéressant de noter que 45% des manipulateurs
ne pensent pas qu'une situation d'urgence soit vitale, ne mettant donc pas en
jeu la vie du patient.
Question n°2 : Etes-vous souvent confronté
à une de ces situations d'urgence ?
- Arrêt circulatoire
- Détresse respiratoire
- Crise d'épilepsie / tétanie
- Crise de panique / spasmophilie
- Réaction allergique grave (type oedème de
Quincke)
L'arrêt circulatoire, la détresse respiratoire,
la crise d'épilepsie / tétanie et la crise de panique /
spasmophilie ont été vécues par 60% des manipulateurs.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 6
La réaction allergique grave quant à elle n'a
été rencontrée que par 44% des manipulateurs.
Ces situations ne sont donc pas si exceptionnelles, mais est-ce
que les manipulateurs se jugent aptes à les prendre en charge pour
autant ?
Question n°3 : Pensez-vous savoir y réagir
efficacement et rapidement ?
33% des manipulateurs jugent savoir réagir efficacement et
rapidement à ce type de situation.
Cela concerne la population de manipulateurs travaillant en CHU
d'urgence car plus souvent confronté à ces situations.
33% des manipulateurs ne se sentent pas capables de réagir
efficacement à ce genre de situation, cela concerne la population de
manipulateurs ne travaillant pas en CHU d'urgence.
33% des manipulateurs m'ont répondu OUI et NON. En me
spécifiant que OUI, théoriquement, ils sont aptes à
réagir efficacement et rapidement mais qu'en pratique ce n'est
absolument pas le cas.
Question n°4 : Pensez-vous être suffisamment
formé à réagir à ce type de situation ? 55% jugent
que OUI, 44% jugent que NON et 11% répondent OUI et NON
Dans l'ensemble tous les manipulateurs, même ceux qui m'ont
répondu oui, jugent que la formation théorique est suffisante,
même si elle n'est pas adaptée aux manipulateurs, mais que la
formation pratique est insuffisante.
Question n°5 : Comment, selon-vous, pouvez-vous vous
améliorer ? Voilà ce qu'ils m'ont répondu :
- Continuer la formation AFGSU mais à des intervalles plus
rapprochés (non pas tous les 4 ans), avec des « piqûres de
rappel » tous les ans.
- Faire des simulations dans le service de l'équipe, dans
leurs locaux avec leur matériel. Revoir les gestes, l'ordre de la prise
en charge et surtout comment réagir au sein du service.
- Être formé par la réanimation, personnel
plus fréquemment confronté aux situations d'urgence. -
Créer un manipulateur référent en protocole d'urgence.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 7
2.4. Questions de départ
Comment le MERM peut-il réagir efficacement et
rapidement à une situation d'urgence si celui-ci n'y est pas souvent
confronté. Lors d'une urgence tous les manipulateurs se sentent
stressés et anxieux, cédant parfois à la panique.
Mes questions de départ sont les suivantes : Quelles
sont ces urgences ? Quel est le facteur principal qui en altère la prise
en charge ? Quels sont les outils mis à notre disposition pour apprendre
à le gérer et à le minimiser ?
3. Qu'est-ce que l'urgence en imagerie médicale
?
On trouve autant de définitions de l'urgence que de
personnels de santé. C'est une notion que chacun s'imagine
différemment. Certains l'associent à un arrêt cardiaque pur
et simple, d'autre à n'importe quel évènement
imprévu et potentiellement délétère pour le
patient. Dans un premier temps nous allons définir
précisément ce qu'est l'urgence, ensuite nous parlerons des
situations d'urgence que peuvent rencontrer les MERM, enfin nous finirons en
rappelant les gestes à effectuer pour les prendre en charge.
3.1. Définition
Etymologiquement, l'urgence vient du latin urgere qui
signifie « pousser », « presser ». La définition du
mot « urgence » par le Dictionnaire Le Robert est la suivante :
URGENCE : « 1). Caractère de ce qui est urgent.
2). Nécessité d'agir vite. 3) Sans délai, en toute
hâte». Cette première définition pose une notion
essentielle : la vitesse d'action. Cette notion est admise par tous et chacun
sait qu'une situation d'urgence appelle à une réaction rapide des
soignants. Elle peut consister soit en la réversibilité des
symptômes déjà constatés, soit en la
prévention d'une aggravation, soit en un sauvetage pur et simple.
3.2. Classification CCMU
Le Ministère de la Santé propose dans une
enquête DREES du 11 Juin 2013 une classification nommée CCMU.
L'O.R.U MIP apporte lui aussi une version de la CCMU. Pour vous en proposer une
approche complète je me propose de mixer les deux versions.
Il faut savoir que la CCMU subdivise les patients en cinq
classes selon l'appréciation subjective de leur état clinique
initial. Les classes I et II incluent les patients dont l'état clinique
est jugé stable. La classe III groupe les patients dont le pronostic
vital n'est pas jugé engagé et les classes IV et V comprennent
les patients dont le pronostic vital est jugé engagé.
Classe I : Etat lésionnel et/ou pronostic fonctionnel
jugés stables. Abstention d'acte complémentaire diagnostique et
thérapeutique à réaliser par le SMUR ou un service
d'urgences.
Classe II : Etat lésionnel et/ou pronostic fonctionnel
jugés stables. Décision d'acte complémentaire diagnostique
ou thérapeutique à réaliser par le SMUR ou un service
d`urgences.
Classe III : Etat fonctionnel et/ou pronostic fonctionnel
jugés susceptibles de s'aggraver aux urgences ou durant l'intervention
du SMUR. Pas de mise en jeu du pronostic vital.
Classe IV : Situation pathologique engageant le pronostic
vital. Prise en charge ne comportant pas de manoeuvre de réanimation.
Classe V : Situation pathologique engageant le pronostic
vital. - Prise en charge comportant la pratique immédiate de manoeuvres
de réanimation.
Classe D : Patient décédé. Pas de
réanimation entreprise par le médecin du SMUR ou du service des
urgences.
Classe P : Patient présentant un problème
psychologique et/ou psychiatrique dominant l'absence de toute pathologie
somatique instable.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 8
Schématisation de la CCMU selon l'O.R.U MIP
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 9
Il est intéressant de constater que le stress chez les
soignants augmente de façon proportionnelle à la gravité
de l'urgence. Prenons l'exemple d'une légère chute de tension
chez un patient auquel on pose une VVP. Tout MERM saura réagir face
à cette situation et ne se laissera pas gagner par le stress. A
contrario, si ce même MERM se retrouve face à un arrêt
cardiaque, son stress va grimper en flèche et il risque de céder
à la panique (la notion de stress sera abordée dans la partie
4).
D'après le Docteur VIGHETTI,
anesthésiste-réanimateur au CHU de Grenoble, « il y a 3
à 18 cas d'arrêts cardiaques pour 100 lits. 45 % d'entre eux
surviennent en service de réanimation et 35 % en service de soins.
». Les personnels soignants ne sont donc pas équitablement
logés face aux urgences. Voyons maintenant quelles sont les situations
d'urgence auxquelles le MERM peut faire face durant sa carrière.
3.3. Situations d'urgence en imagerie
médicale
3.3.1. Législation
Côté législation, depuis notre passage en
système Licence, certains détails inhérents au rôle
du manipulateur en situation d'urgence ont été mis à jour.
Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a
publié une version, consolidée suite à
l'arrêté modificatif du 4 juin 2013, des caractéristiques
du « Diplôme de technicien supérieur en imagerie
médicale et radiologie thérapeutique ». Ils
détaillent à la page 12 de cet article, « l'activité
2 : Information de la personne soignée et mise en oeuvre des soins dans
le cadre de la continuité des soins » et plus
précisément ils définissent le domaine de
compétence du manipulateur en situation d'urgence : «
Réalisation des soins d'urgence :
- Réalisation des gestes et soins d'urgence en
application de protocoles en situation d'urgence vitale
- Mise à disposition du chariot d'urgence - Assistance du
médecin »
Ce texte reste bien évasif sur les termes exacts de ce
que peuvent être les urgences rencontrées par le MERM, nous vous
proposons une liste des situations d'urgence que peuvent rencontrer les MERM en
secteur d'imagerie médicale. Pour plus d'exhaustivité, nous ne
nous limiterons pas à une seule spécialité du
métier de MERM mais passerons en revue l'ensemble des
spécialités d'imagerie médicale (Attention : la
radiothérapie n'étant pas de l'imagerie médicale mais de
la thérapie, cette spécialité n'est pas prise en compte
dans ce travail).
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 10
3.3.2. Urgences
Dans cette partie nous allons définir différentes
situations d'urgence.
3.3.2.1. Syncope
Selon l'HAS dans ses recommandations professionnelles sur les
pertes de connaissances brèves de l'adulte : prise en charge
diagnostique et thérapeutique des syncopes, le terme « malaise
» ne doit plus être utilisé car imprécis et regroupant
des situations cliniques floues et différentes. Le malaise décrit
une plainte alléguée par le patient sans
spécificité et ne définit pas un cadre médical en
particulier.
Nous parlerons plutôt de syncope qui est définie
comme une perte de connaissance transitoire, à début rapide, de
durée généralement brève, spontanément
résolutive, s'accompagnant d'une perte de tonus postural avec un retour
rapide à un état de conscience normal et due à une
ischémie cérébrale globale et passagère. Cette
perte de connaissance, qui dure en moyenne 20 secondes, est souvent brutale.
Elle s'accompagne généralement d'un retour à la normal
très rapide en terme de comportement et d'orientation.
Les symptômes d'une syncope typique sont les suivants :
sensation d'engourdissement, sueurs, nausées, baisse de la vision
(« voile noir devant les yeux »), perte de connaissance
(complète, brève et brutale), chute avec possibilité de
traumatisme, amnésie de la crise, pâleur importante et hypotonie
musculaire.
3.3.2.2. Crise de spasmophilie
La spasmophilie est dûe à
l'hyperexcitabilité neuro-musculaire, c'est-à-dire qu'en
réponse à des stimuli le système nerveux central et/ou
périphérique et les muscles réagissent de façon
disproportionnée. Il faut savoir qu'il existe deux types de causes
principales, que l'on peut rencontrer isolément, consécutivement
ou de façon concomitante : humorale et ventilatoire.
La cause humorale est liée à une carence dans
l'organisme de certains micro-éléments, principalement le
magnésium et le calcium.
La cause ventilatoire est liée quant à elle
à la respiration rapide, saccadée et superficielle du sujet
(souffle court, diaphragme peu sollicité). L'hyperventilation s'exprime
par un manque d'oxygénation cellulaire et par l'élimination
excessive de gaz carbonique. Ce sont surtout les femmes jeunes qui, en alliant
stress et angoisse, commencent à hyper ventiler.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 11
Les symptômes à reconnaitre sont :
accélération du rythme respiratoire associé à une
sensation d'étouffement et d'oppression, tétanie musculaire
(incapacité à bouger, fourmillements et picotements), sueurs,
vertiges, crampes et sensation de perte de connaissance.
3.3.2.3. Crise d'épilepsie
La SFN propose des recommandations (approuvées par
l'HAS) de bonnes pratiques concernant la prise en charge d'une première
crise d'épilepsie de l'adulte.
L'épilepsie est définie comme une pathologie
cérébrale caractérisée par une
prédisposition durable à générer des crises et par
les conséquences cognitives, comportementales, psychologiques et
sociales de cette condition.
La crise d'épilepsie (aussi appelée comitiale)
est quant à elle définie comme une survenue transitoire de signes
et/ou de symptômes dus à une activité neuronale
cérébrale excessive ou anormalement synchrone. Elle entraine une
perte de conscience brutale (non annoncée), des mouvements cloniques des
membres (secousses musculaires anarchiques et violentes), une morsure de la
langue et un relâchement des sphincters. Cette crise s'accompagne d'une
résolution spontanée après quelques secondes ou minutes
ainsi que d'une amnésie post-critique.
Il faut savoir que chaque personne est potentiellement
épileptique. En fait les personnes sujettes à ce genre de crise
ont juste un seuil épileptogène plus bas que la moyenne. Pour
faire simple, l'épilepsie se caractérise par des décharges
soudaines et de courte durée (en général) d'influx nerveux
anormaux dans le cerveau. Elles peuvent avoir lieu soit dans une zone
précise du cerveau, soit dans son ensemble. Dans de très rares
cas, les crises peuvent être prolongées et entraîner
d'importantes séquelles neurologiques par privation. De plus, des
dommages peuvent être causés aux neurones en raison de la
libération de substances excitatrices et de catécholamines
associées au stress aigu. Certaines crises peuvent même
s'avérer mortelles. Le phénomène est rare et
méconnu et porte le nom de « mort subite inattendue et
inexpliquée en épilepsie ».
3.3.2.4. Extravasation
En Avril 2005, la CIRCATI et la SFR ont mis en place une fiche
de recommandation pour la pratique clinique concernant la prévention de
l'extravasation de produit de contraste qui sert toujours de
référence de nos jours.
L'extravasation est définie comme le passage de
produits intraveineux en dehors de la lumière vasculaire, donc dans les
tissus environnants. Ce n'est pas l'extravasation en elle-même qui est
une
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 12
urgence mais plutôt ses conséquences sur le
patient. Dans le pire des cas elle peut conduire à une nécrose ou
à une ulcération des tissus de la zone injectée. Elle peut
faire suite à une blessure de la veine lors de la pose d'un
matériel d'injection ou d'une rupture d'une paroi veineuse du fait de
l'hyper pression.
Une extravasation doit être suspectée dans les
circonstances suivantes :
- Plainte du patient concernant une sensation de brûlure
ou de picotement au niveau du point d'injection
- Induration ou oedème du point d'injection (grossissement
de la zone du membre injectée)
- Absence de retour sanguin après tentative d'aspiration
de produit par la seringue
Attention : notez que tous les patients ne ressentent pas de
sensation de douleur lors d'une
extravasation.
Il existe différentes catégories de facteur de
risque et/ou de gravité concernant l'extravasation :
? Liés au patient : âges extrêmes de la
vie, troubles de la conscience, troubles de la vascularisation
artérielle, troubles du drainage veineux ou lymphatique, troubles
trophiques
? Liés au site d'injection : topographie (dos de la
main, poignet, dos du pied, cheville...), ancienneté de la perfusion (=
24 heures), injection en amont d'un site de ponction récent, pansement
masquant le site d'injection (retardement du diagnostic d'extravasation)
? Liés à la technique d'injection : utilisation
d'une aiguille plutôt que d'un cathéter, utilisation d'un
injecteur automatique
? Liés au produit de contraste : type de produit
utilisé (hyperosmolalité), quantité élevée
du produit de contraste ayant pu diffuser
N.B. : La gravité est reconnue si la quantité de
produit de contraste ionique d'osmolalité élevée
injectée est supérieure à 30cc ou si la quantité de
produit de contraste non-ionique de basse osmolalité injectée est
de 100cc. Elle est aussi reconnue s'il y a une faible abondance du tissu
sous-cutané et s'il existe une atteinte vasculaire ou des troubles
trophiques.
Il est possible de prévenir l'extravasation et de
limiter son importance. Pour cela le MERM devra, concernant la voie veineuse,
éviter d'utiliser une voie veineuse déjà en place,
utiliser un cathéter court en adaptant le débit au calibre
utilisé, privilégier une veine au pli du coude, éviter
toute compression du membre perfusé et enfin vérifier la
qualité du cathétérisme par une injection test
(sérum physiologique).
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 13
Il est aussi important de prévenir le patient du risque
et de lui demander de se manifester en cas de douleur (en sachant que
l'extravasation peut être indolore).
Enfin la surveillance du point d'injection est primordiale
avant la réalisation de l'acte d'imagerie (surveillance visuelle et
tactile).
3.3.2.5. Choc anaphylactique
Avant de parler du choc anaphylactique nous allons rappeler
brièvement les notions d'allergie et d'hypersensibilité ainsi que
les différentes classifications existantes.
3.3.2.5.1. Définitions
L'allergie est la conséquence pathologique d'un conflit
antigène - anticorps. Dans un même temps il y a présence
d'antigène (allergène), d'anticorps et d'une réaction qui
aboutit à la libération de substances (histamines,
leucotriènes, cytokines...) responsables des manifestations cliniques de
l'allergie.
Les antigènes sont des substances
étrangères à l'organisme comme par exemple : le pollen,
les poils de chat, le venin d'hyménoptère (guêpe), les
médicaments ou encore, et c'est ce qui nous intéresse
particulièrement, les produits de contraste. Ils pénètrent
dans l'organisme par voie aérienne, digestive, cutanée ou par
voie intramusculaire, sous cutané ou intraveineuse. L'antigène
est bien toléré par la plupart de la population, toutefois,
certaines personnes déclenchent une réaction inadaptée,
excessive et pathologique : c'est l'allergie, qui est une forme de
l'hypersensibilité.
Les anticorps sont des substances (globuline IgE)
fabriquées par l'organisme après un premier contact avec
l'antigène. Il est important de noter qu'une réaction allergique
se produit uniquement lors de la deuxième rencontre avec
l'antigène. La première rencontre avec celui-ci est ce que l'on
appelle l'étape de sensibilisation. Chaque anticorps est
spécifique d'un antigène. Les anticorps circulants responsables
de l'allergie humorale ou immédiate se concentrent dans certains organes
cibles (muqueuse nasale, épithélium bronchique,...) et
conditionnent la localisation des manifestations allergiques. Les anticorps
tissulaires quant à eux sont absents du sérum mais sont
présents à l'intérieur des cellules de l'organisme, ils
sont responsables de l'allergie différée.
L'hypersensibilité est un terme général
regroupant l'ensemble des réactions d'allure allergique.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 14
3.3.2.5.2. Classification de Gell et Coombs
Gell et Coombs, immunologistes anglais, ont proposé en
1975 une classification de l'hypersensibilité qui sert encore de
référence de nos jours. Cette classification répartit
l'hypersensibilité en quatre types (I, II, III et IV), selon la forme
d'action et le temps de réponse. Les trois premiers types sont
médiés par des anticorps et le quatrième par les
lymphocytes T.
? Hypersensibilité de type I : C'est le type le plus
fréquent et le plus important du point de vue clinique, il correspond
à l'hypersensibilité immédiate avec les anticorps
circulants qui sont des immunoglobulines de type IgE. On parle
d'hypersensibilité immédiate car les symptômes apparaissent
entre 10 et 20 minutes, voire moins. Ces anticorps IgE se trouvent à
l'état libre dans le sang circulant. Les symptômes allergiques
apparaissent lorsque ceux-ci se fixent à la surface des mastocytes et
des basophiles qui réagissent avec l'allergène correspondant. Il
en résulte une production par les mastocytes de substances actives
telles que : histamines, prostaglandines, leucotriènes, etc... Ces
substances sont les médiateurs chimiques de l'allergie. Elles entrainent
une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité
capillaire, une contraction des muscles lisses et occasionnent des
éruptions cutanées, des oedèmes, une hypotension, un
spasme bronchique et un spasme digestif.
? Hypersensibilité de type II : Elle est dite
cytotoxique ou cytolytique. Dans ces réactions immunes, les anticorps
sont libres dans le sérum alors que l'antigène est fixé
à la surface de certaines cellules ou est un composant de la membrane
cellulaire elle-même. Quand les anticorps réagissent avec
l'antigène, il se produit une activation du complément qui
aboutit à la détérioration de la cellule et même
à sa lyse. Les maladies relevant de ce mécanisme sont par exemple
les anémies hémolytiques ou le purpura thrombopénique.
? Hypersensibilité de type III : Aussi appelée
« par complexe immun », elle est due à la circulation
d'anticorps appelés précipitines qui appartiennent à la
classe des IgG. Les anticorps réagissent avec des antigènes et
produisent un complexe antigène - anticorps (complexe immun). Ces
complexes se déposent dans les tissus et entrainent une accumulation de
polynucléaires et une libération d'histamine qui est responsable
d'une atteinte tissulaire. On dit que ce type d'hypersensibilité est
semi-retardé à cause d'un délai de manifestation d'au
moins 6 heures. Comme exemple de maladie relevant de ce mécanisme nous
pouvant citer la polyarthrite rhumatoïde.
? Hypersensibilité de type IV : Aussi appelée
« hypersensibilité retardée à médiation
cellulaire » elle se différencie des trois autres car elle n'est
pas la conséquence de l'action d'anticorps mais de cellules
immunocompétentes, les lymphocytes. Elle se caractérise par un
délai d'action de 24 à 72 heures.
Elle n'est pas transmise par injection de sérum mais
par injection de cellules vivantes, essentiellement les lymphocytes T. Cette
hypersensibilité entraine des lésions tissulaires inflammatoires
qui peuvent conduire à des lésions tissulaires
irréversibles. Nous pouvons citer comme exemple de pathologies qui se
base sur cette hypersensibilité les granulomes, l'eczéma de
contact ou le rejet de greffe tissulaire.
3.3.2.5.3. Classification des réactions
d'hypersensibilité selon l'EAACI

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 15
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 16
3.3.2.5.4 : Classification de Ring et Messmer
La classification de Ring et Messmer permet de stratifier en
quatre grades de gravité clinique croissante les signes cliniques des
réactions d'hypersensibilité de type immédiat.

3.3.2.5.5 : Les signes du choc anaphylactique
? Signes cutanés : Ils associent érythème
et urticaire qui peuvent être localisés sur la face, le cou et la
région antérieure du thorax avant de se
généraliser. Il peut aussi y avoir apparition d'un oedème
de Quincke ou angio-oedème (gonflement rapide de la peau et des
muqueuses) qui concerne quant à lui le visage, la langue, le larynx et
le pharynx. Il peut entrainer une gêne respiratoire et une dysphagie.
? Signes respiratoires : Une infiltration oedémateuse
et une bronchoconstriction peuvent entrainer une obstruction respiratoire
à différents niveaux. Une atteinte des voies aériennes
supérieures se manifestant par une rhinorrhée, une obstruction
nasale, une toux sèche et dans les cas les plus graves d'une obstruction
des voies aériennes supérieures. Une atteinte de voies
aériennes inférieures se manifeste par un bronchospasme. On peut
aussi observer un oedème aigu du poumon.
? Signes cardiovasculaires : Ils associent une tachycardie et
une hypotension voir un état de choc auxquels peuvent être
associés chez l'adulte des troubles de l'excitabilité et de la
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 17
conduction, une ischémie ou une nécrose
myocardique. L'arrêt cardiaque n'est pas exceptionnel et survient parfois
d'emblée en l'absence de bronchospasme et de signes cutanés.
? Signes digestifs : Ils associent une sécrétion
exagérée des glandes salivaires, des nausées, des
vomissements, des diarrhées et des douleurs abdominales.
3.3.2.6. Détresse respiratoire
On parle d'insuffisance respiratoire aiguë, ou de
détresse respiratoire, lorsque les échanges gazeux deviennent
brutalement insuffisants pour couvrir les besoins de base de l'organisme. Sans
apport rapide d'oxygène, les cellules nerveuses sont incapables de
fonctionner et la mort est inéluctable dans les minutes qui suivent. De
très nombreuses situations peuvent entrainer cette insuffisance
respiratoire comme une insuffisance d'oxygène dans l'air ventilé
(altitude, feu), une insuffisance du débit d'air respiré (crise
d'asthme grave, obstruction des voies aériennes), une perturbation des
échanges gazeux alvéolaires (infection pulmonaire, oedème
du poumon), une atteinte de la fonction circulatoire (arrêt
cardio-respiratoire, collapsus) ou une perturbation des échanges gazeux
cellulaires (intoxication par monoxyde de carbone).
L'insuffisance respiratoire chronique est la
conséquence de maladies ou d'opérations pulmonaires qui ont
« amputé » une partie importante des surfaces d'échange
respiratoires: obstruction bronchique par cancer, infections, maladies
respiratoires, tabac... L'insuffisant respiratoire chronique a donc un nombre
limité d'alvéoles pulmonaires fonctionnelles ; il vit en
permanence avec des taux sanguins d'oxygène très bas, et certains
malades nécessitent même un apport supplémentaire d'O2
à domicile, de façon intermittente ou permanente (bouteilles,
extracteur d'oxygène). Cet équilibre respiratoire précaire
peut se rompre facilement : toute cause limitant l'apport d'oxygène
(traumatisme, infection, intoxication, maladie respiratoire ou cardiaque...) ou
tout besoin excessif de l'organisme (effort, fièvre, émotion...)
peut précipiter la survenue d'une véritable détresse
respiratoire. Cette « décompensation respiratoire » d'un
malade déjà en dette d'oxygène est donc plus grave et
d'évolution plus rapide que chez toute autre victime soumise à la
même cause. On parle alors d'une « insuffisance respiratoire
aiguë chez un insuffisant respiratoire chronique ».
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 18
3.3.2.7. Arrêt cardio-circulatoire
Nous abordons maintenant l'urgence la plus redoutée par
tout professionnel de santé et ce à quoi pensent 90% des MERM
lorsqu'on leur parle d'urgence. N'importe quel MERM travaillant, par exemple,
en scanner sera un jour confronté à un ACR. Autant y être
bien préparé, mais pour cela il faut déjà savoir ce
que c'est et comment le reconnaître.
L'ACR est une urgence vitale. C'est une interruption brutale
de la circulation sanguine dans le corps ainsi que de la respiration. La mise
en place d'une réanimation précoce peut, parfois, permettre
d'éviter le décès. Attention, un ACR n'est pas
systématiquement un arrêt cardiaque suivi d'un arrêt
respiratoire, il peut aussi être un arrêt respiratoire suivi d'un
arrêt cardiaque.
Les causes de l'ACR sont multiples. Elles peuvent être
cardiovasculaires (troubles du rythme de la conduction, infarctus du myocarde,
dissection aortique, hémorragie...), traumatiques (accident de la voie
publique, chute...), neurologiques (accident vasculaire
cérébral), respiratoires (« fausse route », noyade,...)
ou dues à une intoxication (monoxyde de carbone, médicamenteuse,
éthylique,...)
Les signes de l'ACR sont les suivants :
- Perte de conscience (absence de réponse verbale, motrice
et d'ouverture des yeux volontaires)
- Arrêt respiratoire même après
libération des voies aériennes
- Abolition du pouls carotidien ou fémoral
- Cyanose
- Pupille en mydriase
Le score de Glasgow est un outil facilement utilisable par
n'importe quel soignant qui permet d'évaluer l'état de conscience
d'un patient.
Il faut savoir qu'un patient en état d'ACR a un score de
Glasgow égal à 3.





GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 19
Connaître les urgences que peuvent rencontrer les MERM est
un point fort mais savoir y réagir c'est encore mieux !
3.3.3. Prise en charge
3.3.3.1. Syncope
Les épisodes de syncope arrivent principalement lors de
la pose de VVP ou d'abords veineux. Cette urgence est toute relative.
Il faut immédiatement allonger le patient et si
possible lui relever les jambes, par exemple en les appuyant contre le mur,
pour améliorer le retour de sang vers le coeur et le cerveau. Le patient
doit rester allongé pendant au moins 5 à 10 minutes,
jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Les tentatives pour se lever et
s'asseoir avant ce temps de repos pourraient entrainer une autre syncope. Si le
patient est dans l'impossibilité de s'allonger il est possible de
réaliser les contre mesures suivantes pendant quelques minutes. Elles
permettent d'augmenter la pression artérielle et interrompent
l'épisode de syncope. Le patient doit croiser les jambes et contracter
ses muscles, il doit joindre ses mains et les serrer fermement l'une contre
l'autre ou manipuler une balle anti-stress.
Attention : Il ne faut pas faire boire le patient ou le forcer
à rester debout.
Il est important de rester au côté du patient
pour le surveiller et de noter combien de temps dure sa perte de connaissance.
On peut à la fin de son épisode lui conseiller d'appeler un
médecin.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 20
3.3.3.2. Crise de spasmophilie
Le plus souvent, les spasmophiles ont l'habitude de faire des
crises et prennent donc un traitement, dans le cas contraire, il faudra isoler
la personne, l'asseoir ou l'allonger, la rassurer en faisant preuve de calme.
Il faut l'inviter à maitriser sa respiration en respirant lentement. Il
est important de discuter avec elle pour essayer de l'apaiser et de la
calmer.
3.3.3.3. Crise d'épilepsie
Voici les recommandations de la Ligue Francophone Belge contre
l'Epilepsie. Il n'est pas possible d'interrompre une crise d'épilepsie,
il faut la laisser suivre son cours naturellement en prenant des
précautions.
Ce qu'il faut faire :
- Dégager un espace autour de la personne, enlever tout
objet dangereux qui pourrait la blesser
- Protéger la tête de la personne avec, par exemple,
un coussin ferme ou une veste roulée en boule
- Desserrer les vêtements autour du cou et s'assurer que
les voies respiratoires sont dégagées
- Retirer les lunettes
- Placer la personne en PLS pour l'aider à respirer
- Noter l'heure du début de la crise
- A la reprise de conscience, rassurer la personne durant la
période de confusion
Ce qu'il ne faut pas faire :
- Ne pas déplacer la personne pendant le
déroulement de la crise, sauf en cas de danger (route, escalier...)
- Ne pas entraver ses mouvements - Ne pas la soulever
- Ne pas donner à boire
- Ne pas mettre d'objet entre ses dents. Attention ! Il est
impossible d'avaler sa langue durant une crise d'épilepsie mais il est
possible de faire une fausse déglutition (avaler de travers)
après la crise. C'est pour cela qu'il est important de placer la
personne en PLS pour que la salive puisse s'écouler à
l'extérieur si la déglutition n'est pas
récupérée.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 21
- Ne pas importuner inutilement la personne dans la
période de confusion qui suit la reprise de conscience.
Il est nécessaire d'appeler une aide médicale
dans différents cas : lors d'une première crise, si la crise dure
plus longtemps que d'habitude chez la personne concernée ou si la crise
dure plus de 10 minutes, si les crises se suivent sans reprise complète
de conscience entre elles, si la personne s'est cognée la tête
durant la crise et qu'elle ne présente pas de signe de reprise de
conscience dans les 10 minutes après la fin de la crise et enfin si il y
a des blessures que l'on est pas en mesure de soigner ou si la personne est
tombée lourdement (hématomes et douleurs).
3.3.3.4. Extravasation
Voici les recommandations de prise en charge d'une extravasation
selon la CIRCATI et la SFR. ? Mesures immédiates :
- Arrêt immédiat de l'injection en cas de plainte du
patient ou de perception d'un problème
- Tentative d'aspiration du produit extravasé par le
cathéter d'abord laissé en place, puis, après l'avoir
enlevé, par expression cutanée.
- Surélévation du membre concerné pendant
les trois heures suivantes, en cas de gravité potentielle.
- Hypothermie locale par application de glace pendant au moins
20 minutes ; puis toutes les heures pendant 6 heures, sans contact direct entre
la glace et le membre (envelopper dans un linge).
? Mesures différées :
- Evaluation de la gravité potentielle.
- Estimation du volume injecté (au vu de la
quantité restante dans la seringue).
- Estimation de l'étendue et de la localisation de
l'extravasation par la pratique de clichés du membre.
- Recherches de signes de mauvaise tolérance par un
examen clinique, vasculaire et neurologique : aspect cartonné ou
phlycténulaire de la peau, oedème important, trouble de la
perfusion distale (syndrome des loges) regroupant paresthésies,
renforcement des douleurs segmentaires, hypoesthésie, diminution de la
force musculaire et diminution des pouls.
- Informer le patient quant aux signes de mauvaise
tolérance imposant une prise en charge immédiate. - En cas de
gravité, contrôle médical le lendemain pour s'assurer d'une
évolution favorable ;
- Signalement de l'extravasation dans le compte rendu et
auprès du médecin traitant.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 22
3.3.3.5. Choc anaphylactique
Voici les recommandations de l'ANSM concernant la prise en charge
d'un choc anaphylactique.
- Appel d'aide d'urgence
- Arrêt de l'injection du produit suspecté
- Oxygénation au masque à haute concentration
- Voie veineuse efficace
- Allonger le patient sur le dos et surélever ses membres
inférieurs
- Adrénaline IV par titration, toutes les 1 à 2
minutes, en fonction du grade et de la pression artérielle
? Grade I : pas d'adrénaline
? Grade II : bolus de 10 à 20jig
? Grade III : bolus de 100 à 200jig
? Grade IV : arrêt circulatoire : massage cardiaque
externe + adrénaline bolus de 1mg toutes les 1 à 2 minutes
à renouveler + mesures habituelles de réanimation d'une
efficacité cardio-circulatoire
Attention ! Le MERM n'est pas habilité à
injecter de l'adrénaline en IV. Le protocole cité
précédemment concerne le personnel de réanimation.
Les antihistaminiques sont habituellement administrés
par voie orale ou parentérale. Des corticoïdes sont
préconisés pour moduler la réaction retardée. En
cas de bronchospasme, les nébulisations de bronchodilatateurs sont
utilisées. En cas d'hypovolémie un remplissage par
macromolécules avec utilisation de drogues vasopressives sont
utilisées. La seule réelle prévention consiste en la
non-introduction de l'allergène et même si les
prémédications et tests allergologiques peuvent diminuer le
risque de survenue d'une allergie, ils n'empêchent pas les
réactions graves.
3.3.3.6. Détresse respiratoire
En cas de détresse respiratoire il faut laisser le
patient au repos strict, en position demi-assise s'il est conscient et
oxygéner à fort débit (15L/min) en surveillant sa fonction
respiratoire. Il faut vérifier la liberté des voies
aériennes supérieures et mettre en place un monitorage du rythme
cardiaque et de l'oxymétrie de pouls.
Si la ventilation devient inefficace il faut continuer
d'oxygéner le patient mais sous forme de ventilation artificielle.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 23
3.3.3.7. Arrêt cardio-respiratoire
Nous allons ici donner les recommandations du Conseil
Français de Réanimation Cardio-Pulmonaire et de la Croix Rouge.
Les gestes de premiers secours doivent être réalisés le
plus tôt possible pour permettre d'augmenter les chances de survie.
1) Prévenir le numéro d'urgence ou appeler le 15
(SAMU)
- Décrire ce que l'on a vu et l'état de la
victime
- Donner l'adresse précise du lieu où se trouve la
victime, dans une structure hospitalière : le
service
- Dire ce qui a été fait ou ce qui est fait
- Ne pas raccrocher avant qu'on ne le précise
2) Masser le coeur de la victime et si possible pratiquer le
bouche à bouche en alternance
- Allonger la victime sur une surface dure
- Se mettre à genoux contre la victime, sur le
côté
- Positionner ses mains l'une sur l'autre, au milieu du thorax,
entre les deux seins, les bras
bien tendus.
- Appuyer de tout son poids, bien au-dessus : avec tout le
corps
- Exercer des pressions fortes : enfoncer les mains de 3
à 4cm dans la poitrine et remonter les
mains entre chaque pression pour faire circuler le sang
- Effectuer les pressions sur un rythme régulier, en
comptant jusqu'à 30
En alternance, effectuer deux insufflations, ou bouche à
bouche, toutes les 3O pressions
- Reprendre ensuite le massage cardiaque : série de 30
pressions
3) En présence d'autres personnes leur demander
d'aller chercher le défibrillateur automatique externe (DAE) et suivre
ses instructions pas à pas.
- Mettre le DAE en marche et prendre connaissance des
instructions figurant sur l'appareil - Dénuder la poitrine de la
victime
- Placer les électrodes à même la peau
conformément aux instructions figurant sur leur emballage ou sur les
électrodes
- S'assurer que personne ne touche la victime lors de l'analyse
du rythme cardiaque de la victime
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 24
- S'assurer que toutes les personnes présentes sont
éloignées de la victime et de son environnement
immédiat
- Appuyer sur le bouton de défibrillation si cela vous
est demandé. Un défibrillateur entièrement automatique
administrera le choc électrique sans votre intervention.
- Si le DAE vous y invite, effectuer des compressions
thoraciques sans tarder. Alterner les séries de 30 compressions et de 2
insufflations.
- Continuer à suivre les indications du DAE
jusqu'à ce que la victime retrouve une respiration normale ou
jusqu'à l'arrivée des secours.
- Si la respiration redevient normale, arrêter la
réanimation, mais ne pas éteindre le DAE et laisser les
électrodes en place sur la poitrine de la victime. Si celle-ci reste
inconsciente, mettez-la sur le côté, en position latérale
de sécurité.
Attention ! Le protocole cité
précédemment concerne la prise en charge d'un ACR chez l'adulte
et on chez l'enfant ou le nourrisson.
4. La réaction du MERM... le stress !
4.1. Etymologie et définition
Etymologiquement, le mot stress vient du latin stringere qui
signifie étreindre, serrer, resserrer, lier. Il a donné naissance
en français à étreindre, entourer avec les bras en serrant
étroitement (pour embrasser ou pour étouffer) et secondairement
à détresse, sentiment d'abandon, de solitude ou d'impuissance que
l'on éprouve dans une situation poignante (besoin, danger,
souffrance).
Apparu au XVIIème siècle en Angleterre (et
seulement au XXème en France), il était utilisé pour
exprimer la souffrance et la privation résultant d'une vie
éprouvante ; au XVIIIème siècle, on observe une
évolution sémantique de ce terme puisque l'on passe de la
conséquence émotionnelle du stress à sa cause : une force,
une pression produisant une tension et à plus ou moins long terme une
déformation. On constate alors que le mot stress est souvent
accompagné du terme « strain » signifiant tension excessive
conduisant à une rupture.
Le dictionnaire le ROBERT définit le stress comme une
réaction de l'organisme à une agression, un choc physique ou
nerveux et comme une situation de tension, traumatisante pour l'individu.
Le dictionnaire Larousse le définit comme un
état réactionnel de l'organisme soumis à une agression
brusque.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 25
Avant d'aller plus loin dans l'étude du stress mais
surtout dans la solution pour améliorer son contrôle par les MERM,
il me semble indispensable d'étudier son historique. De son point de
départ avec Claude Bernard puis au travers de Walter Bradford Cannon,
Hans Selye et enfin Richard Lazarus en collaboration avec Susan Folkman.
4.2. Auteurs
4.2.1. Claude Bernard (1813 -1878)
Tout le monde s'accorde à dire que Claude Bernard est
le point de départ du concept d'homéostasie et donc,
indirectement, de la notion de stress. Médecin, physiologiste et
philosophe de la biologie, Claude Bernard a largement contribué à
repenser le vivant. Il est le père de la physiologie moderne et pose les
principes de la médecine expérimentale.
Il fut ainsi le principal initiateur de la «
révolution physiologique » qu'il décrivit lui-même
très lucidement : « de tous les points de vue en biologie, la
physiologie expérimentale constitue à elle seule la science
vitale active, parce qu'en déterminant les conditions d'existence des
phénomènes de la vie, elle arrivera à s'en rendre
maître et à les régir par la connaissance des lois qui leur
sont spéciales » (Claude Bernard, 1865, Introduction à
l'étude de la médecine expérimentale).
Dans ce même livre il dit que « tous les
mécanismes vitaux, quelques variés qu'ils soient, n'ont toujours
qu'un but, celui de maintenir l'unité des conditions de vie dans le
milieu intérieur » (Claude Bernard, 1865, Introduction
à l'étude de la médecine expérimentale). Il
précise sa pensée dans un autre de ses ouvrage en 1878 en disant
« la fixité du milieu intérieur est la condition d'une
vie libre et indépendante » (Claude Bernard, 1878,
Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et
aux végétaux). De plus ses recherches sur la digestion et la
fonction glycogénique du foie l'ont progressivement conduit vers
l'élaboration du concept de « milieu intérieur ».
Ce concept, totalement original, constitue le pivot de la
nouvelle physiologie qu'il voulait créer, discipline autonome au sein
des sciences de la vie, intégrant les données anatomiques,
histologiques et physico-chimiques disponibles à l'époque.
Bien avant que la notion d'homéostasie, apparue pour sa
part dans les années 1940, ne soit clairement énoncée, on
peut constater que Claude Bernard en avait posé les bases.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 26
4.2.2. Walter Bradford Cannon (1871 - 1945)
Il faudra attendre l'aide de Walter Bradford Cannon et sa
célèbre phrase disant que l'homéostasie est
l'équilibre dynamique qui nous maintient en vie pour que finalement le
concept d'homéostasie soit forgé. Ce mot provient du grec
?ìïéïò qui signifie similaire et
óôÜóéò qui signifie stabilité.
Cannon ne s'est pas arrêté là puisqu'en 1911, il observe la
stimulation des glandes médullosurrénales sous l'effet de la peur
(la partie 4.3 de ce mémoire sera consacrée aux mécanismes
physiologiques du stress). Cela lui permettra de décrire les
réactions physiologiques provoquées par différentes
émotions telles que la peur ou la colère et de prononcer en 1915
son fameux « flight or fight » pour décrire les deux
réponses possibles à un stress à savoir « fuir ou
combattre ». Plus tard il insistera sur le rôle des facteurs
psychologiques, les émotions, dans les processus d'adaptation. Pour lui,
la réponse au stress fait partie d'un système unifié
corps-esprit dans lequel l'excitation physiologique et l'expérience
émotionnelle fonctionnent en symbiose : le stimulus qui déclenche
une émotion agit simultanément au niveau du cortex et repose sur
un ensemble de régulations coordonnées.
Pour le moment il n'est question que d'homéostasie et pas
encore de stress.
4.2.3. Hans Selye (1907 - 1982)
Hans Selye est considéré comme le
véritable fondateur de la théorie du stress. Il a consacré
sa vie à son étude. Professeur et chercheur à
l'Université de Montréal, il a fondé l'Institut de
médecine et de chirurgie expérimentale en 1945 ainsi que
l'Institut international du stress.
Selye donne une définition médico-psychologique
du stress qui est la suivante : le stress est la réponse non
spécifique de l'organisme à toute demande d'adaptation qui lui
est faite. Le stress correspond à des manifestations organiques non
spécifiques en réponse à une agression physique.
L'ensemble de ces réponses non spécifiques est provoqué
par un agent agressif physique entraînant des réponses
stéréotypées quel que soit l'agent.
Hans Selye est clairement l'acteur majeur dans la
découverte du stress et nous allons consacrer une partie plus longue
pour développer ses idées, qui semblent encore être
aujourd'hui d'actualité et résolument novatrices pour son
époque. C'est en 1950 que Selye a élaboré un modèle
théorique le "Syndrome Général d'Adaptation" (SGA) qui
précise qu'à la suite d'un stress, l'organisme a pour objectif de
rétablir l'homéostasie. Le SGA se décompose en trois
stades :

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 27
- 1ere phase : la phase d'alarme : Elle survient
après le stress (phase en dessous du niveau de résistance normal,
puis passage au-dessus).
Selye la décrit comme une phase « de mobilisation
des ressources hormonales », on constate durant cette phase que le niveau
de stress descend sous le niveau normal, tout simplement car l'organisme
réagit à l'agent stressant et va préparer une
réponse psychomotrice comme par exemple la fuite ou le combat. Cette
phase est divisée en deux parties.
? le choc qui représente un état de surprise et
qui traduit un état de souffrance générale de l'organisme.
On observe comme signes tachycardie, augmentation du tonus musculaire,
dilatation des pupilles, hypothermie ou encore hypotension.
Cette phase dure de quelques minutes à 24 heures.
? le contre-choc qui représente le développement
des moyens de défense active, caractérisé par l'inversion
des signes de la phase de choc ; c'est-à-dire une augmentation de la
diurèse, l'augmentation du volume plasmatique ou encore
l'élévation de la température.
L'agent stressant peut être de tout type (objet,
personne, animal, évènement etc...), il va demander à la
personne de s'adapter à cet évènement, ce qui va la
fragiliser et la rendre vulnérable.
Ce stade comprend le temps de préparation et la
mobilisation des ressources pour faire face au stress.
Durant cette première phase la personne est
particulièrement exposée, mais une réponse de l'organisme
va lui permettre de reprendre le dessus, ce qui nous emmène à la
seconde phase.
2eme phase : la phase de résistance : Elle
correspond à une période de compensation avec une recharge des
moyens de défense et l'utilisation des ressources mises à
disposition. (phase au-dessus du niveau de résistance normal).
Les résistances de la personne vont passer largement
au-dessus du seuil normal, c'est un phénomène de compensation.
L'individu résiste à l'agent stressant, cette phase va
dépendre de la durée d'exposition à l'agent stressant
ainsi que de la capacité individuelle de résistance à
celui-ci. La personne qui reste dans cette phase maitrise son sujet mais perd
de l'énergie, ce qui contribue à l'usure de l'organisme. La phase
de résistance prolonge et accentue les phénomènes
amorcés au cours de la phase de contre-choc. Pour faire simple,
l'organisme s'est habitué aux stimuli. Cependant si les stimuli se
prolongent encore, on passe en phase d'épuisement.
3eme phase : la phase d'épuisement : Il s'agit
du moment à partir duquel les ressources biologiques et psychologiques
deviennent insuffisantes (phase de déclin du niveau de résistance
de la phase précédente). Le niveau de résistance de
l'individu tombe inexorablement sous le seuil normal, c'est-à-dire que
l'organisme ne cherche plus à lutter et se soumet. Cette phase à
lieu lorsque l'agent stressant persiste par sa durée ainsi que par son
intensité et que la personne s'obstine à y faire face. L'individu
doit puiser une énergie considérable dans ses réserves
profondes pour y faire face et s'en suit des dommages irréparables tels
que la dépression ou différentes maladies psychosomatiques, cette
étape peut conduire jusqu'à la mort à partir du moment
où toutes les réserves sont épuisées.
Ces conceptions physiologiques reposent sur un schéma
stimulus-réponse critiquable car elles ne prennent pas en compte les
variations interindividuelles. Elles définissent l'individu comme passif
face à une situation stressante et n'intègrent pas de composantes
psychologiques, ni d'évaluation subjectives des situations
environnementales. Cependant c'est un modèle encore vrai de nos jours et
applicable de façon analogue à tout ce qui nous entoure,
l'exemple en est pour les cellules qui après avoir subi un stimulus ont
deux choix possibles, l'adaptation ou la mort.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 28
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 29
4.2.4. Richard S. Lazarus (1922 - 2002) et Susan
Folkman
Il faudra attendre les années 1960-1970, et des
travaux, dépassant le modèle linéaire de type «
stimulus-réponse » de Selye, pour commencer à mettre en
évidence l'importance des perceptions, autrement dit des processus
cognitifs, dans la survenue de l'état de stress.
Le modèle transactionnel du stress de Lazarus et
Folkman, proposé en 1984, permet de décrire ces processus
cognitifs.
Ces auteurs postulent que ce ne sont pas les
événements eux-mêmes qui déterminent l'apparition
d'un état de stress. Selon Lazarus « le stimulus n'existe pas
en soi comme stress, c'est le sujet qui peut ou non l'évaluer comme tel
» (Lazarus, 1984), ce qui est déterminant, ce sont les
perceptions et le vécu de ces événements. C'est
l'évaluation de la situation et des ressources personnelles qui
déterminent l'existence, ou non, du stress.
Ils apportent ainsi une définition plus complète
de la notion de stress : une transaction entre la personne et l'environnement
dans laquelle la situation est évaluée comme débordant les
ressources d'un individu et pouvant mettre en danger son bien-être. Il
faut comprendre que l'individu peut être responsable de l'importance des
agents stressants agissant sur son organisme.
Grâce à ces auteurs nous avons une approche
interactionniste cognitive du stress : le stress implique un processus incluant
à la fois la personne, l'environnement et leurs transactions.
Selon eux, l'individu confronté à une situation
stressante procède à deux types d'évaluation :
? l'évaluation primaire ou stress perçu,
consiste à envisager ce qui est en jeu dans la situation : les
challenges et les défis amènent des émotions positives
tandis que les pertes et les menaces apportent des émotions
négatives. Ainsi les réactions au stress dépendent moins
du stress objectif (agent déclenchant) que du stress perçu
(variable modératrice).
? L'évaluation secondaire ou contrôle
perçu consiste à envisager les différentes options pour
« manager » la situation, la changer, l'accepter ou l'éviter.
L'individu fait l'inventaire de toutes ses ressources personnelles et sociales.
Cette perception du contrôle peut être vue, soit comme un processus
perceptivo-cognitif transitoire lié au contexte, soit comme une
caractéristique stable de la personnalité.
Après ce tour d'horizon non exhaustif, mais le plus
complet possible du point de vue des auteurs, attardons nous sur une vision
plus physiologique du stress.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 30
4.3. Physiologie du stress
Supposons que vous soyez en danger ou que vous vous
préparez à affronter une situation difficile, comme par exemple :
prendre en charge un patient en état d'arrêt cardiaque pendant un
examen d'imagerie médicale. Votre fréquence cardiaque va
augmenter ou vous aurez la chair de poule. Mais quelle est exactement la cause
de ces réactions ?
4.3.1. Médullo-surrénale et
catécholamines
Ces phénomènes font partis de la réaction
de « lutte et de fuite » provoquée par deux hormones
élaborées par la médullo-surrénale,
l'adrénaline et la noradrénaline. Ces hormones font parties de la
classe de composés que l'on appelle les catécholamines qui sont
synthétisés à partir de l'acide aminé qu'est la
tyrosine. L'adrénaline et la noradrénaline jouent
également un rôle comme neurotransmetteurs dans le système
nerveux.
Un facteur de stress positif ou négatif (pouvant aller
d'un plaisir extrême à la prise de conscience d'un danger mortel)
stimule la sécrétion d'adrénaline et de
noradrénaline par la médullo-surrénale. Ces hormones
agissent directement sur plusieurs tissus cibles et fournissent une
poussée bioénergétique. Elles accélèrent la
dégradation du glycogène dans le foie et les muscles
squelettiques, et provoquent la libération de glucose par les
hépatocytes ainsi que la libération d'acides gras par les
adipocytes. Ce glucose et ces acides gras circulent dans le sang et les
cellules de l'organisme peuvent les utiliser comme source d'énergie.
Outre le fait qu'elles augmentent la disponibilité des
sources d'énergie, l'adrénaline et la noradrénaline ont
des effets importants sur les systèmes cardiovasculaire et respiratoire.
Par exemple, elles font augmenter à la fois la fréquence
cardiaque et le débit systolique, et elles dilatent les bronchioles des
poumons, action qui accélèrent le transport d'oxygène
jusqu'aux cellules de l'organisme. (C'est pourquoi les médecins
prescrivent de l'adrénaline comme stimulant cardiaque et comme
bronchodilatateur en cas de crise d'asthme.)
Les catécholamines provoquent aussi la contraction des
muscles lisses de certains vaisseaux sanguins et le relâchement de
certains autres, ce qui diminue l'apport de sang à la peau, aux
intestins et aux reins, et augmente le débit vers le coeur,
l'encéphale et les muscles squelettiques.
L'adrénaline agit principalement sur la
fréquence cardiaque et le métabolisme, alors que le rôle
primordial de la noradrénaline consiste à garder la pression
artérielle constante.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 31
La sécrétion par la
médullo-surrénale est stimulée par des influx nerveux
transportés à partir de l'encéphale par
l'intermédiaire de la partie sympathique du système nerveux
autonome.
Sous l'effet d'un stimulus de stress, l'hypothalamus produit
des impulsions nerveuses qui se rendent à la
médullo-surrénale, où elles déclenchent la
libération d'adrénaline. La noradrénaline est
libérée indépendamment de l'adrénaline. Les
hormones de la médullo-surrénale constituent un autre exemple de
voie neuro hormonale simple. Dans ce cas, les neurones
sécrétoires sont des cellules nerveuses modifiées,
appartenant au système nerveux périphérique, plutôt
que des neurones sécrétoires de l'encéphale qui
libèrent des hormones dans la neurohypophyse.
4.3.2. Cortex surrénal et
corticostéroïdes
Les hormones stéroïdes du cortex surrénal
répondent à des stimuli hormonaux. Sous l'effet d'un stimulus de
stress, l'hypothalamus produit une hormone de libération qui provoque la
libération d'ACTH (stimuline) par l'adénohypophyse. Lorsqu'elle
atteint le cortex surrénal, en passant par la circulation sanguine,
l'ACTH agit sur les cellules endocrines qui synthétisent et
sécrètent une famille d'hormones stéroïdes
appelées corticostéroïdes. Les concentrations
élevées de corticostéroïdes dans le sang
arrêtent la sécrétion d'ACTH, ce qui constitue un autre
exemple de rétro-inhibition.
Chez l'humain, les deux principaux types de
corticostéroïdes sont les glucocorticoïdes, comme le cortisol
et les mineralocorticoides, comme l'aldostérone. Il est de plus en plus
évident que les glucocorticoïdes et les mineralocorticoides
permettent le maintien de l'homéostasie quand l'organisme subit un
stress de longue durée, comme une maladie chronique ou une perturbation
émotionnelle prolongée.
Les glucocorticoïdes agissent principalement sur la
bioénergétique, notamment le métabolisme du glucose. Les
glucocorticoïdes quant à eux augmentent la glycémie.
Ils favorisent la synthèse du glucose à partir
de sources qui ne sont pas des glucides, mais qui sont notamment les lipides et
les acides aminés. De plus, les glucocorticoïdes rendent les
cellules adipeuses et les cellules musculaires au repos résistantes
à l'insuline, ce qui empêche le glucose d'être «
avalé » par ces dernières cellules et augmente la
réserve de glucose disponible dans le sang pour d'autres types de
cellules, comme celle de l'encéphale. Cela fait augmenter les ressources
énergétiques disponibles.
Les glucocorticoïdes agissent également sur les
muscles squelettiques, dans lesquelles ils provoquent la dégradation des
protéines. Les squelettes carbonés qui résultent de cette
dégradation sont transportés jusqu`au foie et aux reins, qui les
transforment en glucose et les libèrent dans le sang. La
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 32
synthèse du glucose à partir des
protéines musculaires est un mécanisme homéostatique qui
apporte une quantité supplémentaire d'énergie quand
l'activité en nécessite plus que ce que la réserve de
glycogène du foie peut fournir. Les glucocorticoïdes peuvent
également aider l'organisme à faire face à une situation
de stress externe de longue durée.
Les mineralocorticoides agissent surtout sur
l'équilibre électrolytique et hydrique. Ainsi, dans le rein,
l'aldostérone favorise la réabsorption d'ions sodium et d'eau
à partir du filtrat, ce qui provoque une augmentation de la pression
artérielle et du volume sanguin. La sécrétion
d'aldostérone est augmentée principalement par l'angiotensine II,
par une voie de régulation qui permet aux reins de maintenir
l'équilibre électrolytique et hydrique du sang. Mais lorsqu'une
personne se trouve en état de stress grave, l'augmentation de la
concentration d'ACTH qui en résulte entraine
l'accélération de la sécrétion
d'aldostérone, de même que des glucocorticoïdes, par le
cortex surrénal.
4.4. Les causes du stress au travail
Après avoir défini le stress historiquement et
physiologiquement il faut se demander quelles sont les causes du stress au
travail.
Pour répondre à cette question il semble essentiel
d'introduire la notion de stresseur.
4.4.1. Définition
Au sens général du terme, les stresseurs (agents
stressants) correspondent à tous les évènements,
situations, conditions de vie, pressions de l'environnement (exemples :
problème à résoudre, difficultés relationnelles)
qui créent du stress.
Pour être plus précis la notion de stresseur
correspond aux différents problèmes rencontrés par une
personne au niveau professionnel, familial et social, comme la quantité
d'informations à traiter par unité de temps, le nombre et
l'importance des décisions à prendre, la charge professionnelle,
les décalages entre le travail prescrit et le travail réel,
l'inadéquation entre le type de travail et les désirs d'une
personne, les différents changements de la vie, les difficultés
relationnelles ou bien une maladie.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 33
4.4.2. Classification des stresseurs
Il existe de nombreuses classifications des stresseurs.
? Les stresseurs physiques (environnementaux et
physiologiques)
Les stresseurs physiques causent une tension ou une contrainte
sur notre corps. Nous pouvons citer comme exemple les blessures, les maladies
chroniques, la douleur ou encore le manque de sommeil.
? Les stresseurs psychologiques
Les sentiments, les craintes, les décisions, les
ennuis, les frustrations, la confiance ou l'estime de soi sont des stresseurs
psychologiques. Ce sont des évènements, situations, individus ou
commentaires négatifs ou dangereux. Le MERM est confronté en
permanence à ce type de stresseur. Pour citer les plus évidents
on pourrait dire les cadences de travail trop élevées, le
sentiment d'abandon de la part de la hiérarchie, une mauvaise entente
avec les collègues de travail ou encore un sentiment de non
reconnaissance face au travail effectué.
? Les stresseurs organisationnels et sociaux
Lorsqu'on demande aux travailleurs quels sont selon eux les
stresseurs responsables de leur stress au travail, ceux-ci sont le plus
fréquemment cités. Effectivement, ils sont les plus
médiatisés et permettent de surcroit de se plaindre de sa
hiérarchie. Landier et Labbé ont proposé en 2005 un
modèle qui permet de mesurer le climat social d'une entreprise. Ils
proposent 32 irritants regroupés en cinq familles :
A : stresseurs liés à l'incertitude et à
l'imprévisibilité au travail
B : stresseurs liés au manque de reconnaissance
C : stresseurs liés aux relations interpersonnelles
D : stresseurs liés aux problèmes de
communication
E : stresseurs liés aux changements et aux valeurs
F : stresseurs liés au job design
Pour revenir à des exemples plus concrets on peut citer
le rapport avec la famille et les amis, les rapports avec sa hiérarchie
et collègues de travail, la contrainte de temps, les exigences et
attentes des autres.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 34
? Les stresseurs absolus et relatifs
Les stresseurs absolus sont facilement compréhensibles,
objectifs et universellement reconnus comme stressants. Tout individu va
réagir à ce type de stresseur. Comme exemple nous pouvons citer
un tremblement de terre ou un tsunami.
Les stresseurs relatifs sont quant à eux subjectifs,
ils dépendent de la personne qui les subi. Ils causent
différentes réactions chez différentes personnes. Comme
exemple nous pouvons citer la pression au travail ou le passage d'un examen,
certains le verront comme une simple formalité, d'autres s'en rongeront
les ongles d'appréhension.
? Les stresseurs aigus et chroniques
Les stresseurs aigus correspondent à des crises ou
à des situations de vie critiques et comportent souvent un
caractère dramatique d'intensité et de
sévérité. Ce sont des conditions extrêmes et rares,
elles correspondent à des exceptions qui ne sont ni quotidiennes, ni
communes. Ces situations de crise ont une fréquence d'occurrence
très basse dans la population et dans le temps. Elles sont donc peu
représentatives du cours habituel voir « normal » de la vie
d'un individu. Attention à ne pas penser que ces situations sont
inexistantes, elles ont juste une faible prévalence. Holmes et Rahe ont
représenté quantitativement les stresseurs aigus en mettant en
place une échelle (Annexe 2), Rahe, Q.H., Holmes, T.-H. (1967), The
Social Reajustment Rating Scale, Journal of Psychosomatic Research, 11,
213-218.).
Cette échelle gradue de 11 à 100 l'effet
stressant que peuvent avoir des situations de la vie. Il faut ensuite
additionner chaque évènement et selon le résultat ils ont
établi une relation entre les événements de la vie et le
degré du stress chez un individu ainsi que de l'impact de ces niveaux de
stress sur la santé. Ainsi ils écrivent que de 0 -150 points il
n'y a pas de risque de maladies ou d'accidents, de 151 - 199 points il existe
30-35% de risques de maladies ou d'accidents, de 200 - 299 points on passe
à 50-55% de risques de maladies ou d'accidents, et pour finir de 300
points et plus on atteint 80% de risques de maladies ou d'accidents.
Les stresseurs chroniques sont des conditions ou situations
durables, stables, communes, qui ne sont pas subites, urgentes ou
imprévues. Ils réfèrent au quotidien et au style de vie de
l'individu. Ces situations prises seules non pas d'importance ; c'est
l'accumulation de ces situations qui va graduellement contribuer à
créer un climat de tension engendrant ainsi du stress chez l'individu.
Il faut comprendre par-là que ce qui confère à ces
évènements un risque élevé d'engendrer le stress
est la récurrence et l'effet cumulatif qui s'ensuit.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 35
C'est seulement à la suite de l'accumulation, lorsque
le stress est présent, que ces stresseurs sont identifiables,
d'où la difficulté de mettre en place des actions à leur
égard.
? Sharpe et Lewis (1978)
Ils ont définis six classes de stresseurs.
Les stresseurs de performance : ils sont en rapport avec la
réalisation d'un travail physique et mental où interviennent des
situations d'évaluation, les rôles sociaux et les attentes
à l'égard de soi-même.
Les stresseurs de menace : ils sont en rapport avec des
situations personnelles ou sociales. Ils sont perçus comme dangereux
pour le soi physique et psychologique car ils portent atteinte à
l'estime de soi, l'image de soi, à la satisfaction des besoins
fondamentaux, et à l'équilibre dépendance-autonomie.
Les stresseurs d'ennui : ils sont associés à des
situations routinières dans lesquelles l'individu sent qu'il manque de
stimulations. Ils concernent les divers secteurs de la vie d'un sujet.
Les stresseurs de frustration : ils sont en lien avec des
situations perçues comme indésirables et sur lesquelles
l'individu ne peut exercer son contrôle. Exemple : toute forme
d'impuissance physique comme la maladie ou sociale comme l'injustice.
Les stresseurs de perte ou de deuil : ils sont dus à la
perte d'une personne aimée ou d'une dimension valorisée comme par
exemple l'argent, le travail ou la jeunesse.
Les stresseurs physiques : voir stresseurs physiques
explicités plus haut.
Nous savons maintenant ce qu'est le stress, mais pourquoi le
MERM stress-t-il ?
Voici mon raisonnement :
L'imagerie médicale n'est pas par définition un
secteur de l'urgence.
Le MERM est peu confronté aux situations d'urgence.
Il n'y a pas de répétition de ces situations par
le MERM.
Or plus une situation est rencontrée, donc
répétée, meilleure sera la réaction du MERM lors de
sa
prochaine apparition.
Dans cette troisième partie est introduite la notion de
répétition, essentielle à l'amélioration de la
gestion du stress par le MERM. Nous parlerons aussi des outils
mis à disposition du MERM lui
permettant d'apprendre à gérer son stress.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 36
5. Comment le gérer ?
Les notions de savoir, de savoir-faire et de savoir être
nous ont été introduites dès notre premier jour de
formation. Le savoir, aussi appelé savoir théorique est
considéré comme acquis en sortie d'école, à la fin
de notre formation DTS ou DE. Le savoir-faire s'acquiert avec la pratique et
l'expérience professionnelle au cours de notre carrière. Enfin le
savoir-être nous permet de faire face à des situations qui sortent
de l'ordinaire et nous permet de transmettre notre savoir et d'enseigner. Nous
le développons avec le recul, grâce à nos années
d'expériences, il nous permet de devenir expert ou
référent.
Pour être un bon manipulateur, il faut acquérir et
développer ces trois qualités.
Comment éviter la perte des connaissances
théoriques et pratiques des manipulateurs au cours de leur vie
professionnelle ?
5.1. Le maintien des connaissances par la
répétition
5.1.1. Définition
Selon le dictionnaire Le Robert le mot
répétition signifie : Fait de recommencer (une action), fait de
répéter pour s'exercer et selon le dictionnaire Larousse signifie
: Réitération d'une même action.
La répétition est à la base de
l'apprentissage, tous les élèves de première année
de médecine, et de tout corps de métier, connaissent cette
phrase. En effet, personne ne peut contredire le fait que plus une action est
répétée, rejouée et
réinterprétée plus vite viendront les automatismes
liés à la gestion de cette action. D'où la perte du
caractère stressant de cette action.
5.1.2. Auteurs
Il existe des grands noms dans l'histoire, que la plupart des
gens connaissent sans forcément avoir fait de grandes études,
tels que Pavlov, Thorndike et Watson.
5.1.2.1. Ivan Pavlov (1849 - 1936)
Médecin et philosophe russe, il fut un
précurseur concernant la notion de réflexe conditionné
qu'il définissait comme « discipline, éducation, habitude
» et partait du postulat que toutes les activités psychiques ne
sont que la résultante de processus physiologiques de type
réflexe.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 37
Dans les années 1890-1900, Pavlov a fait de nombreuses
expériences sur les chiens. Il cherchait à démontrer ce
que provoque un conditionnement sur la salivation du chien.
Il faut savoir que le conditionnement est le fait de
conditionner, conditionner signifiant selon le dictionnaire Le Robert :
déterminer le comportement de... ; influencer moralement ou
intellectuellement.
Voici un résumé de son expérience et des
conclusions qu'il en a tiré :
1) Présenter de la nourriture au chien ?
Réflexe de salivation du chien Le chien possède un réflexe
inné chez les animaux, la salivation.
2) Sonner une cloche ? Absence de réflexe de
salivation chez le chien En absence de conditionnement le chien ne
réagit pas.
3) Association du son de la cloche (stimulus) à
l'action de nourrir le chien
4) Répétition de l'étape 3 dans le
temps
5) Son de cloche sans présentation de nourriture ?
Réflexe de salivation du chien
Le son de cloche engendre chez le chien le réflexe de
salivation même en l'absence de nourriture.
Le chien assimile le son de la cloche (stimulus) à
l'arrivée imminente de nourriture.
Grâce à cette expérience Pavlov a
réussi à prouver que les réactions acquises par
apprentissage et habitudes deviennent des réflexes lorsque le cerveau
fait le lien entre stimulus et action qui s'en suit. On rejoint ici la notion
de réflexes innés et acquis. Ses expériences ont eu une
portée scientifique énorme, et sont encore admises aujourd'hui.
Elles sont notamment à l'origine du film Orange Mécanique de
Stanley Kubrick. Des exemples de processus de conditionnement sont visibles
partout comme, par exemple, la prise de drogue ou de cigarettes qui
s'accompagnent d'une sensation de bien-être chez les personnes
dépendantes.
5.1.2.2. Edward Lee Thorndike (1874 - 1949)
Psychologue américain et contemporain de Pavlov, il a
eu un rôle de pionnier dans des domaines très divers tels que
l'éthologie, la théorie de l'apprentissage et la
pédagogie. Il publie en 1898 les résultats de ses
premières recherches dans Animal Intelligence, ouvrage relatant de
psychologie animale. Ses expériences, réalisées sur
plusieurs espèces animales, consistent à créer des
situations d'apprentissage
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 38
de type « boites-problèmes ». Il a pu
observer deux phénomènes principaux : d'une part, l'apprentissage
s'effectue par essais-erreurs et d'autre part, la réduction progressive
des comportements inappropriés s'effectuant de façon similaire
chez toutes les espèces animales.
On retrouve à chaque fois une courbe d'apprentissage
identique quel que soit l'animal étudié.

Courbe d'apprentissage d'après Thorndike
Il a démontré que plus les essais étaient
successifs, plus la réaction de l'animal était rapide.
Sa principale expérience « boite - problème
» consistait à enfermer un chat affamé dans une cage dont la
porte de sortie était munie d'un loquet. A l'extérieur de la cage
il y avait de la nourriture. Dans cette situation le chat ne peut sortir pour
atteindre la nourriture qu'en faisant appel à une manipulation
déterminée, qu'il doit découvrir par tâtonnement,
petit à petit.
Grâce à ses expériences il a pu
définir une première loi qui est la suivante :
? Loi de l'exercice : les connexions entre la situation et la
réponse sont renforcées par l'exercice et affaiblies lorsque
l'exercice est arrêté. Le renforcement des connexions entre une
situation (la cage dans laquelle se trouve l'animal) et la réponse (la
manipulation adéquate du loquet) conduit à une augmentation de la
fréquence d'apparition de la réponse correcte.
Cependant Thorndike pense que l'exercice est inefficace s'il
ne s'accompagne pas d'une sanction, il soumet alors une seconde loi.
? Loi de l'effet : Une connexion est renforcée ou
affaiblie par l'effet de ses conséquences. Si la connexion
situation-réponse est suivie d'un état de satisfaction du sujet
(récompense) elle est renforcée ; si elle est suivie d'un
état non satisfaisant (punition) elle est affaiblie.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 39
Cette conception qui lie apprentissage et motivation a
influencé la manière d'envisager l'apprentissage.
Thorndike a donc mis en évidence l'apprentissage par
essais et erreurs basé sur l'association entre situation et
réponse. L'ouvrage de Thorndike a été important pour la
psychologie animale mais aussi pour la psychologie humaine en montrant que le
comportement humain peut être étudié sur les mêmes
expériences que le comportement animal. Il a contribué à
la révolution béhavioriste qui a fait passer la psychologie de
l'étude de l'activité mentale à l'étude des
comportements, de leur acquisition et de leur évolution. Il a
également eu une influence prépondérante dans le domaine
des théories de l'apprentissage.
5.1.2.3. John Broadus Watson (1878 - 1958)
Psychologue américain, il s'est largement
inspiré des travaux et résultats des deux premiers scientifiques
précédemment cités, il faisait lui aussi partie du courant
béhavioriste. Il voulait faire de la psychologie une science objective,
étudier rigoureusement des comportements observables face à des
stimuli. La finalité de ce courant est d'orienter, de modifier le
comportement des Hommes pour qu'ils puissent réorganiser leur existence
ainsi que l'éducation de leurs enfants. Pour faire simple disons que le
but était la prédiction et le contrôle du comportement des
Hommes. Watson va partir du postulat de départ émis par Pavlov
sur l'animal pour le transposer à l'Homme. Il considère le
réflexe conditionnel comme principe de base de toute acquisition chez
l'Homme. Pour cela il va réaliser plusieurs expériences.
En 1920 il réalise une expérience nommée
« l'expérience du petit Albert » (dont la moralité est
contestée aujourd'hui) qui consiste à présenter un rat
blanc à un enfant de 11 mois. L'enfant s'accommode et s'habitue à
la présence du rat sans manifester de réaction de peur. Ensuite,
Watson présente à plusieurs reprises le rat blanc à
l'enfant mais en frappant à coup de marteau une barre de fer, produisant
un bruit violent, ce qui fait sursauter et tomber l'enfant.
Par la suite quand Watson présentera un rat blanc
à l'enfant, ce dernier se mettra à pleurer et à trembler
instinctivement. Il faut savoir que la peur de l'enfant s'est
généralisée à d'autres objets poilus et blancs
comme des lapins blanc, ou du coton. Bien que discutable sur le plan humain,
cette expérience a le mérite de transposer la théorie
d'apprentissage à l'Homme. Watson conclura que chaque être humain
nait avec les mêmes capacités innées (c'est-à-dire
le même potentiel) mais que c'est l'environnement dans lequel il
évolue qui va façonner sa personnalité.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 40
5.1.2.4. Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990)
Ce psychologue et penseur américain ira encore plus
loin dans la réflexion en créant la notion de conditionnement
« opérant ».
Le terme opérant désigne une forme de
conditionnement qui, sur le plan des procédures expérimentales,
doit être distingué du conditionnement pavlovien. Ses
expériences utilisent une cage nommée « cage de Skinner
» dans laquelle on introduit un rat ou un pigeon. Elle est munie d'un
petit levier et d'un distributeur de nourriture, l'animal, appuyant par hasard
sur le levier (acte moteur définissant la réponse) est
immédiatement récompensé par de la nourriture (le
renforcement). Il constate ensuite que la réponse renforcée,
c'est-à-dire appuyer sur le levier et obtenir de la nourriture, a
tendance à se reproduire. Comme si l'animal agissait pour se nourrir. Ce
schéma expérimental se base sur les travaux de Thorndike sur
l'apprentissage par essais et erreurs et sur sa formulation de la loi de
l'effet. Cependant c'est Skinner qui a affuté le concept pour en faire
un outil de recherche.
La différence avec le conditionnement pavlovien est
qu'il n'existe pas de lien entre la réponse étudiée et le
renforcement. La relation est totalement arbitraire et elle est la condition du
renforcement. En effet le sujet agit sur son milieu alors que dans les travaux
de Pavlov le sujet se borne à subir son environnement en s'y adaptant,
sans le modifier. Ce schéma « opérant » rend compte des
conduites acquises au contact de l'environnement dans l'ensemble du
règne animal. Il faut savoir que ce type d'apprentissage peut
s'accompagner soit d'un renforcement positif (récompense), soit d'un
renforcement négatif (punition). L'expérience de la « cage
de Skinner » est un exemple de renforcement positif.
Apprendre devient donc développer des comportements
nouveaux adaptés aux stimuli proposés. L'apprentissage est
basé sur la répétition et les étapes successives,
cela permet la maîtrise d'un élément qui, accumulé
à un autre amène une autre maîtrise.
Après avoir étudié les bienfaits de la
répétition, on peut se questionner sur la fréquence de
cette répétition.
5.1.2.5. Hermann Ebbinghaus (1850 - 1909)
Psychologue allemand, il faisait partie du courant
psychologique de l'associationnisme qui examine comment les faits ou les
idées peuvent être associés dans la pensée les uns
aux autres, et aboutir à une forme d'apprentissage.
Cette question, Ebbinghaus et Wozniak, se la sont posés
et ont pu apporter une réponse par la modélisation. Il faut
savoir qu'Ebbinghaus a beaucoup travaillé sur la mémoire. En se
prenant lui-
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 41
même comme cobaye lors de ses expériences, il
mémorisait des centaines de syllabes du type consonne/voyelle/consonne
en essayant diverses façons de les mémoriser (voix haute, temps
de pause différents, chronométrage, ...). De ces résultats
il construisit la première courbe d'apprentissage ; cette
dernière s'améliorait avec les répétitions d'abord
rapidement puis plus lentement jusqu'à la maitrise de sa liste de
syllabes.
Il théorisa que notre courbe de mémoire se
présente comme une courbe exponentielle décroissante et que sans
sollicitation, au bout de 3 jours, on avait oublié 90% de ce qu'on
venait de mémoriser. A travers ses auto-observations il a donc
étudié comment les individus apprennent et se rappellent d'un
matériel par la révision, qui est la répétition
consciente d'un matériel à mémoriser.
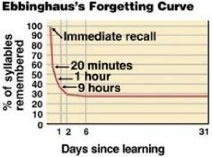
Le polonais Piotr Wozniak a quant à lui, près
d'un siècle plus tard, réussi à modéliser cette
courbe de façon plus précise
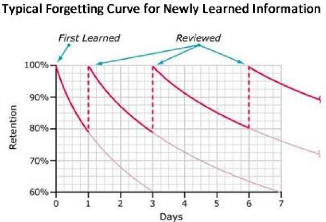
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 42
En ayant connaissance de cette théorie, on peut
appliquer ce principe d'apprentissage par la répétition aux MERM
pour diminuer le stress ressenti lors de la prise en charge d'une situation
d'urgence.
Nous allons maintenant aborder les différents outils
proposés aux MERM qui leur permettent de gérer l'urgence.
Comme toute profession, le métier de MERM repose sur
des textes de loi qui permettent de cadrer leurs rôles et leurs limites.
Le Code de la Santé Publique contient une partie réglementaire
concernant les professions de santé. Dans le Livre III sont
concernés les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires
de puériculture et ambulanciers. Le titre V parle plus
spécifiquement de la profession du MERM. Le chapitre premier concerne
les règles liées à l'exercice de cette profession et
contient six articles (Article R4351-1 à 6) qui définissent les
compétences du MERM. Il est précisé dans le sixième
point de l'Article R4351-3 que le MERM « En outre, dans le cadre de
l'exécution des actes mentionnés à l'article 2 ci-dessus,
le manipulateur d'électroradiologie médicale : [...] Accomplit,
en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à
l'intervention du médecin ; ».
De plus, notre promotion fait partie du nouveau
référentiel de manipulateurs en électroradiologie
médicale, stipulant que nous sommes passés en système
licence. L'ensemble de nos compétences acquises en formation sont
regroupées dans l'Arrêté du 24 août 2012 relatif au
diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et
radiologie thérapeutique (le référentiel de mes
compétences est consultable sur internet, faisant 184 pages je n'ai pas
jugé bon de le joindre à ce mémoire). Cela implique que
moi, mes camarades de promotion ainsi que l'ensemble des étudiants de
France bénéficiant du même régime de diplôme,
avons eu une formation identique concernant la prise en charge de l'urgence.
Cette formation se compose de l'ensemble des cours théoriques et
pratiques répartis sur les trois années et plus
spécifiquement concernant l'urgence sur la formation AFGSU.
5.2. AFGSU
Le ministère des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes défini les objectifs de cette formation.
En premier lieu elle vise à améliorer la prise
en charge individuelle des urgences vitales avec l'efficacité et la
promptitude dont le professionnel de santé doit faire preuve pour
exercer son métier. Ces urgences (arrêt cardiaque, asphyxie par
corps étranger et hémorragies externes) sont rares mais les
gestes d'urgence doivent être immédiatement entrepris et
maîtrisés.
En deuxième lieu elle doit permettre de diffuser les
bons comportements face à des pathologies potentiellement
évolutives et bénéficiant d'une fenêtre
thérapeutique étroite.
En troisième lieu elle s'adresse à la
collectivité et à la gestion des risques.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 43
Les professionnels de santé et tous les personnels
exerçant dans une structure de soins ou médico-
sociale doivent pouvoir se situer et agir devant toute
situation de crise sanitaire. Leurs rôles et leurs
missions sont inscrits dans la planification des
réponses à ces situations graves. C'est l'objectif de
l'enseignement du module risques collectifs de l'AFGSU 1 et 2
et de l'AFGSU spécialisée face à un
risque NRBCE, dont je ne parlerai pas ici.
L'AFGSU 2 fait l'objet d'un enseignement obligatoire pour la
majorité des cursus de formation
initiale des professions médicales, pharmaceutiques,
odontologiques et paramédicales, dont la nôtre.
Ainsi, un professionnel de santé, pour obtenir son
diplôme, doit automatiquement être titulaire de
cette attestation. Il devra tout au long de sa vie
professionnelle actualiser ses connaissances tous les
4 ans, dans le cadre de la formation continue.
L'AFGSU (1 et 2) nous a été dispensée
pendant 6 demi-journées. Celles-ci se découpent en cours
théoriques ainsi qu'en mises en situation sur mannequin
et volontaires et en différents scénarii.
Voici les différents thèmes abordés
pendant notre formation :
- Hygiène
- Découverte d'une victime
- Procédure PAS
- Bilan de conscience
- L'obstruction des voies aériennes
- Libération des voies aériennes
supérieures (LVA)
- Mise en PLS
- Les hémorragies : simples et avec présence de
corps étranger
- La RCP : définitions, origines, recommandation du
CESU, identification, technique de MCE
(Massage Cardiaque Externe) et insufflations, conduite
à tenir face à l'enfant en arrêt cardiaque et
conduite à tenir dans le cadre hospitalier
- Utilisation d'un DAE
- Les malaises
- Les traumatismes
- Les plaies
- Les brûlures : les différents degrés et
leur prise en charge
- Electrisation - électrocution :
différenciation et prise en charge
- Les intoxications : extraction d'urgence hors d'un
véhicule, retrait du casque, pose de collier
cervical, immobilisation de membre
- La menace d'accouchement inopiné
- Morsure de serpent et piqûre d'insectes
- Conduite à tenir face à plusieurs victimes
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 44
- Techniques de relevage et brancardage
- Alerte des populations et situations d'exception / Plan
blanc / Plan NRBC
Cette formation a vraiment sa place dans nos études et
la renouveler tous les 4 ans est une nécessité.
5.3. Formations hospitalières et DPC
Toute institution hospitalière, qu'elle soit publique
ou privée, propose à ses professionnels de santé une
formation continue. Celle-ci participe à leur épanouissement et
à l'amélioration du service rendu dans le cadre de leurs
activités professionnelles.
Médecins, infirmières, MERM, brancardiers,
aides-soignants, tous les professionnels bénéficient de
formations continues qui leur sont proposées pendant leur
carrière, dans le cadre d'un accompagnement professionnel
personnalisé.
Ces formations entrent dans l'objectif du DPC.
Il existe de nombreux thèmes de formations et, bien
évidemment, ceux concernant la prise en charge
de l'urgence et la gestion du stress ne font pas exception.
Toutes les institutions proposent la formation AFGSU 1 et 2
ainsi que leur réactualisation.
Il existe aussi des formations concernant la gestion du
stress, proposée par exemple au CHU de Nice
ou de Bordeaux.
Ces formations ont pour objectifs généraux :
- Aider les professionnels à conserver leur position
soignante dans le cadre de l'urgence
- Déchiffrer leur comportement
- Utiliser toutes les ressources mises à disposition
- Gérer leur stress pour rester opérationnels
- Définir le stress et se familiariser avec son
mécanisme
- Mettre en place des stratégies de communication
adaptées pour ne pas disperser leur énergie
physique et psychique.
Toute formation à une durée de validité
qui lui est propre. Citons l'exemple de l'AFGSU qui doit être
renouvelée tous les quatre ans. Ce temps de renouvellement n'est-il pas
trop long ? N'a-t-on pas le temps en quatre ans d'oublier tout ce que l'on a
appris ?
Sachant que la connaissance et le savoir-faire se basent sur
la répétition, nous nous proposons de parler d'un outil largement
utilisé en Amérique du Nord mais si peu en France.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 45
5.4. Le simulateur, un outil de
répétition ?
5.4.1. Les simulateurs
5.4.1.1. Définitions
Avant de parler du simulateur en lui-même il faut se
demander qu'est-ce que la simulation.
Le mot « simulation » vient du latin simulatio
et selon le dictionnaire Le Robert signifie : Représentation
simulée du fonctionnement d'un processus. On peut également le
définir comme une représentation d'un objet par un modèle
plus facile à étudier ou comme la reproduction artificielle du
fonctionnement d'un appareil, d'une machine, d'un système, d'un
phénomène. Le but des techniques de simulation est de
prévoir le comportement de systèmes physiques complexes (ponts,
avions, fusées, centrales nucléaires, techniques
médicales...). Passons maintenant au simulateur. Le mot «
simulateur » vient du latin simulator. Le dictionnaire Le Robert
le définit comme un appareil qui permet de représenter
artificiellement un fonctionnement réel.
5.4.1.2. Origine et évolution
Impossible de parler de simulateurs sans évoquer les
pionniers en la matière dans le domaine de l'aéronautique. Leurs
inventions ainsi que leurs utilisations remontent aux années 1910.
C'est l'ingénieur Leon LEVAVASSEUR, pionnier de la
construction aéronautique qui a créé le premier simulateur
nommé « Tonneau Antoinette ». Ce simulateur était
composé par deux tonneaux en équilibre permettant de ressentir
les commandes complexes de son propre avion l'Antoinette, créé en
1904.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 46
En 1929 Edwin Albert LINK, océanologue et
passionné de l'aviation, a créé le simulateur de vol LINK
TRAINER. Il fut utilisé pendant plus de 25ans par l'armée et par
les compagnies aériennes du monde pour la formation au pilotage sans
visibilité de leurs pilotes.
Sa particularité était une cabine fermée
totalement obscure qui permettait l'isolement du pilote, donc un meilleur
conditionnement psychologique pour le vol à l'aveugle.
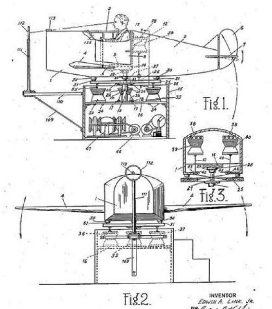
A l'origine il ne s'agissait que de sièges
rudimentaires, équipés de volants et dont l'utilisation
était exclusive aux particuliers. Les années ont passé et
le développement des simulateurs s'est poursuivi jusqu'à la mise
au point de machines capables de restituer les sensations auxquelles le pilote
d'un chasseur américain pouvait s'attendre. Au début
l'utilisation à grande échelle n'était pas encore faite
car les aviateurs en herbe préféraient monter à bord d'un
véritable avion en tant que co-pilote. Finalement, après une
série d'accidents tragiques dans l'armée américaine,
l'utilisation des simulateurs s'est démocratisée. Les
avancées technologiques se faisaient de plus en plus nombreuses et les
simulateurs devenaient de plus en plus réalistes. Les simulateurs de vol
se sont aussi spécialisés par rapport aux différents
appareils sur le marché et complexifiés. L'apparition des
systèmes de simulation visuels avec recours aux images de
synthèse sont venus se greffer sur des simulateurs toujours plus
performants afin de rendre l'expérience toujours plus
réaliste.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 47
De nos jours, les simulateurs de vol en aéronautique
sont rendus obligatoires pour n'importe quel pilote, en effet, avant même
de pouvoir voler sur des lignes grand public, un pilote de ligne doit faire ses
preuves sur simulateur et continuellement renouveler l'expérience afin
d'être toujours accrédité à voler avec sa compagnie
aérienne. Ce modèle est tellement répandu de nos jours que
tout à chacun peut faire l'acquisition d'un simulateur chez lui et
s'adonner à n'importe quel jeu de simulation de vol pour peu qu'il en
ait les moyens.
Les pilotes de ligne ne sont plus les seuls à utiliser
les simulateurs, on peut citer l'armée qui a recours de plus en plus
à la simulation. Ces deux exemples ne sont qu'un grain de sable parmi
les dizaines de corps de métier utilisant les simulateurs dans leur vie
de tous les jours (conduite automobile, jeux vidéo, fêtes foraine
et autres).
5.4.1.3. Techniques de simulation
Nous allons brièvement développer, à
titre indicatif, les différentes techniques de simulations
utilisées par tout corps de métier de nos jours.
? La simulation numérique : Elle met en oeuvre
uniquement un logiciel (modèle jouant des évènements
suivant des conditions d'entrées prédéfinies) et constitue
l'ensemble des modèles stratégiques qui permettent
d'évaluer le comportement de dispositifs de forces dans un
scénario donné. On entre un schéma prédéfini
dans la machine, et le scénario va se jouer selon des paramètres
prédéfinis. Dans certain cas l'homme peut interagir. L'exemple le
plus connu étant les « jeux de guerre » sur ordinateurs.
? La simulation hybride : Elle implique du matériel
réel, c'est-à-dire que l'on associe des modèles
d'évènements réels à des évènements
virtuels, qui seront repris dans la simulation globale. Ce type de simulation
permet par exemple, dans le cas de l'armée, de simuler le
détachement ennemi dans un exercice de combat en limitant la mise en
oeuvre de ressources réelles. C'est une simulation plus «
réelle » que la simulation numérique.
? La simulation interactive : Elle fait interagir l'homme au
travers d'une interface informatique « homme-machine ». L'avantage de
ce type de simulation est la prise de décision par l'individu dans le
scénario simulé, cependant elle n'est pas représentative
des gestes et actions réels. Encore une fois les choix de la machine
sont limités et seuls quelques schèmes sont possibles.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 48
? La simulation pilotée : Elle permet à l'homme
de jouer son propre rôle face à l'environnement simulé.
Elle utilise des simulateurs classiques qui permettent de se familiariser avec
les commandes du système représenté. C'est dans cette
catégorie que l'on peut ranger les simulateurs de vol utilisés
par les compagnies aériennes ou les simulateurs de conduite automobiles
utilisés par les auto-écoles.
? La simulation instrumentée : Elle met en jeu des
individus réels utilisant du matériel réel mais dont les
effets sont simulés et mesurés à des fins d'analyse. Ainsi
chaque élément du simulateur est équipé de
système d'enregistrement permettant le suivi en temps réel de la
situation et son enregistrement. L'intérêt étant le
débriefing de situation post-simulation qui permet la réflexion
et l'apprentissage par l'erreur. C'est la simulation qui se rapproche le plus
possible de la réalité.
5.4.2. Simulation en santé
Concernant la simulation en santé, l'HAS a retenu cette
définition : « Le terme simulation en santé correspond
à l'utilisation d'un matériel (comme un mannequin ou un
simulateur procédural), de la réalité virtuelle ou d'un
patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements
de soin, dans le but d'enseigner des procédures diagnostiques et
thérapeutiques et de répéter des processus, des concepts
médicaux ou des prises de décision par un professionnel de
santé ou une équipe de professionnels » (Chambre des
représentants, USA, 111th congress 02-2009).
Les premiers secteurs médicaux à avoir
utilisé les simulateurs furent les secteurs d'anesthésie et de
médecine d'urgence. En effet, ces deux secteurs constituent des
activités à haut risque mettant en jeu des techniques et une
organisation avec un niveau impératif de haute fiabilité.
Grâce aux récentes évolutions technologiques, ces
simulateurs patients reproduisent maintenant fidèlement la physiologie
humaine. En projetant les participants dans un environnement ultra
réaliste, ces simulateurs permettent de développer leur
raisonnement clinique dans différentes situations cliniques.
Que ce soit les étudiants en médecine, les
infirmières anesthésistes ou encore les MERM, tout personnel
médical ou paramédical peut venir se confronter à une
situation d'urgence pilotée par un responsable afin d'évaluer son
degré de stress.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 49
5.4.2.1. Les modèles de simulation en
santé
? La simulation organique englobe les simulations sur animaux,
les simulations sur cadavres humains ou encore les simulations sur patients
standardisés. Ce sont des acteurs spécialement entrainés
pour jouer une situation clinique de manière reproductible, c'est ce que
l'on appelle la simulation humaine du vivant. Cette dernière
catégorie est particulièrement utile pour former les
étudiants à l'interrogatoire médical, l'examen physique,
et pour développer leurs compétences en matière de
communication. Le type de situation pouvant être reproduit est
illimité.
? La simulation non organique électronique à
interface non naturelle utilise des simulateurs virtuels. Elle consiste
à s'entrainer sur des logiciels de simulation, reposant sur un
environnement 3D, qui représente chaque organe et son comportement
anatomique et biomécanique. Ce type de simulation permet
d'appréhender des situations complexes ou d'étudier des concepts
illustrés de manière plus concrète grâce à
l'informatique. Il n'y a pas de limite dans la diversité des situations
que l'on peut créer mais le coût de création des
environnements réalistes virtuels est très élevé.
De plus les simulateurs virtuels n'offrent pas d'interactivité avec
l'utilisateur. On peut dire que par leur réalisme, ils se rapprochent
des jeux vidéo les plus performants.
? La simulation non organique électronique à
interface naturelle, aussi appelée simulateur à
réalité virtuelle, combine équipements réels et
logiciels de simulation pour générer des données et
fournir la rétroaction à l'usager.
? La simulation non organique synthétique.
Elle peut être procédurale lorsqu'elle utilise
des simulateurs anatomiques simples (simulateurs passifs). Ils peuvent
être faits de plastique, tissu, caoutchouc ou matériaux
déformables (silicone ou latex). Ils n'utilisent aucune instrumentation
ni programme de visualisation et sont destinés aux novices. Leur
objectif principal est la reproduction de certaines techniques précises
comme, par exemple, la pose de cathéter veineux avec un bras de
perfusion ou l'intubation avec l'utilisation de tête et de tronc.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 50
Il existe d'autres simulateurs plus complexes, appelés
Simulateurs Anatomiques Instrumentés et/ou Virtuels, qui associent un
programme informatique à un système d'interface haptique,
graphique (avec visualisation 3D ou réalité virtuelle) et
acoustique pour une reproduction haute-fidélité de l'intervention
simulée. Ils sont dotés de systèmes mécaniques qui
permettent à l'utilisateur de ressentir un retour de force ou une
résistance lors de la manipulation. Cela est possible grâce
à l'utilisation de mannequins et instruments médicaux
dotés de capteurs d'efforts, de position, de pression,
d'accélération ou de capteurs tactiles. Ils offrent une meilleure
immersion dans l'intervention simulée et permettent la reproduction de
situations interventionnelles de haute technicité. Ces simulateurs sont
utilisés par des novices mais aussi par des praticiens confirmés
pour diversifier et développer en continu leurs connaissances en
améliorant leur dextérité.
La technique qui permet à ce jour de s'approcher au
plus près de la réalité tant sur le plan de
l'anthropomorphisme que sur le plan d'interactivité est la simulation
synthétique de patient, appelée aussi simulation «
haute-fidélité ». Elle utilise des mannequins grandeur
nature pilotés par ordinateur reproduisant un patient (qu'il soit
adulte, enfants ou nouveau-né) avec des structures anatomiques et des
réponses physiologiques très réalistes. Ils peuvent par
exemple parler, respirer, répondre à des stimuli et à des
scénarii divers et complexes. Ils peuvent être dirigés soit
par un opérateur qui va les faire réagir aux interventions des
participants (opérateur-dépendant), soit intégrer
directement dans leur programme informatique des modèles physiologiques
qui lui permettent de réagir automatiquement aux interventions des
participants (non opérateur-dépendant).
5.4.2.2. Avantages
- Réduction du risque médical (patient) /
Amélioration du bénéfice patient
- Diminution du temps de formation nécessaire avec les
patients
- Réduction des complications liées au non-respect
des protocoles
- Formation des principes fondamentaux, des procédures
de base mais aussi des évènements critiques avec ou sans stress
environnemental, dans un environnement réaliste
- Transfert des connaissances théoriques en connaissances
pratiques
- Développement de savoirs faire sans conséquences
sur la réalité
- Apprendre à prévoir les implications et les
conséquences de ses décisions
- Développer des habiletés d'ordre
supérieur : analyse, synthèse, argumentation, prise de
décision, résolution de problèmes
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 51
- Améliorer l'interaction entre l'apprenant et son
équipe / Faire appel à des renforts
- Prendre la direction en tant que leader team
- Répartition des tâches de travail
- Gestion des moyens techniques et humains disponibles
- Reconnaissance plus précoce de l'incident en conditions
réelles
- Simulation de situations, cas cliniques ou pathologies rares
- Formation individuelle et formation au travail en
équipe
- Formation adaptable aux besoins de chaque élève,
de chaque profession (niveau de difficulté)
- Absence de contraintes temporelle / Possibilité de
répétition selon les nécessités
- Homogénéisation de la formation des
professionnelles
- Soins aux patients standardisés et reproductibles
- Familiarisation avec le matériel utilisé en
pratique clinique
- « Débriefing » après la séance
de formation
- Gain de temps de formation
- Gain financier
- Expérimentation de nouvelles techniques sans
expérimentation animale
5.4.2.3. Limites
Si la simulation présente de nombreux avantages pour la
formation, elle souffre cependant de quelques inconvénients et limites
que nous allons brièvement citer.
Tout d'abord elle ne convient pas à tous type
d'étudiants. En effets les personnalités discrètes,
négatives, introverties ou extraverties ou qui n'ont pas
d'intérêt pour ce type de formation peuvent être
réticentes.
Il faut prendre en compte l'aspect financier d'un centre de
simulation. La mise en place du programme de simulation, les locaux, le
matériel, leur maintenance et la présence d'un personnel
qualifié en simulation représentent un investissement non
négligeable.
L'aspect émotionnel et stressant de la simulation
représente aussi un frein pour les participants. D'où
l'importance de la séance de débriefing pour expliquer, analyser
et apporter une démarche constructive à la formation en insistant
sur le caractère non sanctionnant de celle-ci.
Enfin, malgré les progrès technologiques en
robotique, le matériel utilisé ne recrée pas le
réalisme d'un patient de chair et d'os. La sémiologie
cutanée ainsi que la motricité sont quasi inexistantes sur les
mannequins actuels.
5.4.2.4. Centres de simulation
5.4.2.4.1. En Amérique du Nord
La simulation est largement intégrée dans
l'enseignement des disciplines de santé en Amérique du Nord. Elle
est utilisée de façon routinière dans les formations
médicales, chirurgicales et paramédicales mais aussi dans les
formations de diététique et de pharmacie. Le premier centre de
simulation Canadien a ouvert en 1995 à Toronto peu de temps après
les premiers centres aux Etats-Unis. Il existait une demi-douzaine de centres
de simulation en 1999, plus de 60 ayant ouverts selon un recensement de 2009.
La simulation est un symbole d'excellence pour les établissements de
soins et d'enseignement. L'évolution de la simulation en Amérique
du Nord éclaire probablement le futur de la simulation en France.
5.4.2.4.2. En France
|
La France compte 16 centres de simulation médicale.
Cartographie des centres de simulation en santé de
France
|
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 52
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 53
A Nice nous avons la chance de posséder un centre de
simulation médicale. Il s'agit du premier centre de ce type en France.
Développé avec Harvard Medical International, dans le cadre de la
convention qui lie les deux institutions et est sous la responsabilité
des Pr Jean-Paul Fournier et Jacques Levraut. Il est pour l'instant
dédié aux étudiants du second cycle de médecine et
a pour objectif d'enseigner à la fois les pratiques sur des mannequins
sophistiqués et comment réagir à des situations
aigües auxquelles ils pourront être confrontés (douleur
thoracique, abdominale, dyspnée...).
Pendant les sessions chaque geste est replacé dans son
contexte clinique (indications, contre-indication, maîtrise du geste,
gestion d'éventuelles complications). Les sessions visent aussi à
améliorer le raisonnement clinique en intégrant les notions de
sémiologie, de thérapeutique et de prise en charge globale.
D'autres programmes sont en cours de développement
comme la sécurité des soins, l'entrainement aux gestes techniques
invasifs et l'ouverture du centre aux personnels paramédicaux pour la
formation aux gestes et soins d'urgence.
La pratique de la simulation en santé est devenue une
méthode pédagogique incontournable. Elle est remarquable par le
fait qu'elle s'intéresse avant tout à l'apprenant tout en
conservant une certaine éthique vis-à-vis du patient («
jamais la première fois sur le patient »). La résolution
d'une situation d'urgence met en jeu la mobilisation de connaissances
théoriques, la transformation de celles-ci en connaissances pratiques,
ainsi que la gestion des ressources humaines et matérielles
adéquates. La mise en situation des soignants au travers du simulateur
les aide à acquérir une compétence et une expertise qu'ils
ne pourraient pas obtenir aussi rapidement par le biais du seul enseignement
traditionnel, que ce soit pendant les cours théoriques ou au lit du
patient. Les séances de simulateur réaliste ne remplacent
naturellement pas les méthodes d'enseignement traditionnelles mais les
complètent. Une analyse globale, récente et complète,
ayant pour but de comparer les résultats de la formation par simulation
par rapport à la formation « classique », apporte des
conclusions très intéressantes. En sélectionnant 609
études comportant 35 226 participants dans la littérature, la
formation par la simulation est constamment associée à une
amélioration significative des connaissances, des pratiques, de la
gestion du stress et des comportements.
Le simulateur sera la base de mon hypothèse de
recherche.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 54
6. Hypothèse de recherche
Suite à ces recherches théoriques j'ai
décidé de poser l'hypothèse de recherche suivante :
Le simulateur influe sur la gestion du stress du MERM
lors de la prise en charge d'un
patient en situation d'urgence.
7. Enquête de terrain
7.1. Choix et construction de l'outil
d'enquête
Pour vérifier une hypothèse de recherche nous
disposons de deux outils de recueil de discours qui sont les suivants : le
questionnaire et l'entretien.
Afin de vérifier mon hypothèse de recherche, j'ai
choisi de mettre en place un questionnaire d'enquête qui va me permettre
de recueillir méthodiquement des données et chiffres.
Pour produire une étude statistique fiable je choisis de
mettre en place un questionnaire d'enquête à choix uniques et
multiples. Il sera majoritairement constitué de questions fermées
mais comportera aussi quelques questions ouvertes. (Annexe 3).
7.2. Choix des lieux et des populations
Je choisis de soumettre mon questionnaire d'enquête en
secteur hospitalier public et privé afin d'avoir une vision plus large
et étendue de mon sujet.
Le thème de mon mémoire porte sur le secteur de
l'imagerie médicale et non de la thérapie, la population
ciblée sera donc constituée des MERM travaillant en service :
- d'imagerie conventionnelle - d'imagerie interventionnelle - de
scanner
- de remnographie
- de médecine nucléaire
Je tiens à préciser que les MERM travaillant en
service de radiothérapie ne constituent pas une population cible pour
mon questionnaire d'enquête.
7.3. Modalités de réalisation
Mon questionnaire d'enquête sera mis à
disposition en secteur publique (CHU Pasteur 2 et l'Archet 2, Nice) ainsi qu'en
secteur privé (Centre Antoine Lacassagne, Nice).
Dans le but de collecter un maximum d'informations
exploitables dans des délais raisonnables j'ai créé mon
questionnaire d'enquête sous forme Google drive. Il sera distribué
par l'intermédiaire de Facebook et promu grâce à
l'administrateur Manipulateur en Radiologie.
Le recueil des réponses et des informations me
permettra d'émettre des tendances et graphiques qui seront
présentés le jour de la soutenance du mémoire.
7.4. Résultats attendus
Les centres de simulation médicale sont peu
implantés en France, leur utilisation dans un but pédagogique de
formation des MERM n'est pas entrée dans les moeurs.
Je m'attends donc à ce qu'une grande majorité
des MERM répondant à mon questionnaire n'aient pas pu
bénéficier d'une formation utilisant un simulateur
médical.
Cependant je m'attends à des retours positifs de la
formation vécue par les MERM sur simulateur et je porte un réel
intérêt pour la question concernant leur opinion sur la diminution
du stress que cette formation peut apporter.
D'un autre côté j'espère avoir un grand
nombre de réponses positives quant à la formation sur la gestion
du stress et sur la prise en charge de l'urgence.
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 55
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 56
8. Conclusion
En Avril 2014 il nous a été demandé de
fournir un thème général, grossier, de notre futur
mémoire. A cette époque il m'a été impossible de le
soumettre à mon directeur de mémoire et mon incertitude s'est
prolongée jusqu'en Septembre pour la rentrée de ma
troisième année d'étude.
Le thème de la gestion du stress face à l'urgence
n'a pas été choisi par hasard.
D'un naturel stressé, j'ai toujours été
intéressée par la gestion du stress afin de l'appliquer à
mes études ou dans ma vie personnelle. Grâce aux situations
rencontrées en stage j'ai remarqué que la réaction entre
MERM est différente et que la notion de gestion du stress est
très personnelle. Face à l'urgence il n'est pas question
d'égalité.
Pour mener à bien ce projet j'ai abordé la
notion d'urgence et son application dans le domaine médical. J'ai
ensuite développé des notions abstraites et physiologiques sur le
stress et, pour finir, j'ai traité de la gestion du stress par la
répétition grâce à l'emploi de divers outils.
Toutes ces recherches m'ont amenée à
m'interroger sur l'influence du simulateur médical dans le domaine de la
gestion du stress face à l'urgence. Pour cela j'ai réalisé
un questionnaire à choix uniques et multiples, joint en Annexe 3, que
j'ai soumis à différents MERM dans le domaine public et
privé.
En cette fin d'études je suis plus que satisfaite de
mon travail et de l'évolution de celui-ci. Indécise au
commencement, j'ai réussi à aboutir à une réflexion
constructive sur un thème qui me préoccupait depuis le
début de ma formation. A savoir : comment mieux gérer son stress
lors d'une situation d'urgence.
Il m'est impossible d'apporter une réponse
définitive quant à mon hypothèse de recherche.
En effet la formation du MERM par l'utilisation du simulateur
est peu intégrée dans les moeurs françaises. Il serait
intéressant de poursuivre cette étude dans 5 ou 10 ans pour
apprécier l'évolution du nombre de MERM formés sur
simulateur et des bénéfices apportés par cette
formation.
L'utilisation du simulateur par le MERM est-elle seulement un
effet de mode ou a-t-elle un réel avenir en tant qu'outil
pédagogique pour la prise en charge de l'urgence ?
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 57
9. Bibliographie
? Concernant la partie 3. sur l'urgence :
http://www.urgences-simulation.com
http://portail-urgence.com/fr/liens?id_theme=3
http://www.urgences-serveur.fr/IMG/pdf/ACR_CMU_2008.pdf
http://www.efurgences.net/index.php/seformer/efurgences/132-classifications
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006914249&idSectionTA=
LEGISCTA000006190638&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150514
http://www.sfmu.org/upload/consensus/rbp_epilepsie_premiere_crise_adulte.pdf
http://www.sf-neuro.org/sites/sfn.prod.saegir.cyim.com/files/files/recommandations.pdf
http://www.sfmu.org/upload/consensus/syncopes_-_argumentaire_2008-07-31_18-37-7_786.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/cci.pdf
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/session3__comprendrelarealitedutriage.pdf
http://www.sfmu.org/upload/consensus/syncopes_-_argumentaire_2008-07-31_18-37-7_786.pdf#page=64&zoom=auto,-26,652
http://www.sfmu.org/upload/consensus/834.pdf
https://www.orumip.fr/
https://www.orumip.fr/wp-content/uploads/2011/11/ccmu.pdf
http://www.cellam.fr/wp-content/uploads/2013/06/Clement-Auger.pdf
http://www.besancon-cardio.org/cours/39-syncope.php#04
http://spasminfo.com/
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=spasmophilie-pm-symptomes
http://spasmophilie.org/
http://www.oncomip.org/fr/espace-professionnel/oncomip-pediatrique/procedures/procedures-medicales/prise-charge-l-extravasation-chimiotherapie.html
http://www.sfrnet.org/rc/org/sfrnet/htm/Article/2004/mie-20041216-000000-08198/src/htm_fullText/fr/fiche%20extravasation.pdf
http://www.sfrnet.org/Data/upload/documents/CIRTACI/Fiche%20Allergie%2029%2009%202009.
pdf
http://www.chu-lyon.fr/web/2952
http://www.medecine.ups-tlse.fr/dcem1/immunologie/hypersensibilite%20DFGSM-3%202012%202013.pdf
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 58
http://ciriha.org/index.php/allergies-et-intolerances-2/classifications/classification-de-gell-et-coombs
http://devsante.org/base-documentaire/urgences/choc-anaphylactique
http://www.infirmiers.com/ressources-infirmieres/secourisme/causes-de-detresse-respiratoire.html
http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-l-arret-cardio-respiratoire-acr.html
http://www.ligueepilepsie.be/spip.php?rubrique44
http://allergo.lyon.inserm.fr/ALLERGIE_ALIMENTAIRE/6-
12_Traitement_choc_anaphylactique.pdf
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/Campus-reamedicale/cycle2/reanimation/download/01detresse.pdf
http://www.sfar.org/article/236/choc-anaphylactique
http://www.sfar.org/_docs/articles/Choc_Anaphylactique_SFAR_2010.pdf
http://www.sfar.org/_images/phototheque/affiche%20acr%20intra-hospitalier.pdf
http://www.sfar.org/_docs/articles/91-ac_rfe07.pdf
http://www.sfar.org/article/91/prise-en-charge-de-l-rsquo-arret-cardiaque-rfe-2006
http://www.sfar.org/acta/dossier/archives/mu07/html/mu07_04/urg07_04.htm
http://www.cfrc.fr/documents/brochure-arret-cardiaque-1-vie-3-gestes.pdf
http://www.cfrc.fr/index.php
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base/L-arret-cardiaque-la-
defibrillation
? Concernant la partie 4. sur le stress :
http://blog.mars-lab.com/Etudes/articlescientifiques/Presentation%20barometre%20SOS.pdf
http://blog.mars-lab.com/Etudes/Articlesgris/methodovat.pdf
http://ute.umh.ac.be/dutice/uv6a/index.php?html=module6a-1.htm
http://carnets2psycho.net/theorie/histoire9.html
http://www.stresshumain.ca/le-stress/quest-ce-que-le-stress/stresseurs.html
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/anx_biblios_science/a.biblio_bernard.html
http://liris.cnrs.fr/~cnriut08/actes/articles/129.pdf
http://www.gapsante.uottawa.ca/newSite/Articles-PDF/3-Lemyre.pdf
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/RSI/67/84.pdf
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 59
Biologie humaine - Anatomie - Physiologie, Santé de E.
Perilleux, D. Richard, B. Anselme, J.-M. Demont, P. Valet, Edité par
Nathan en 2002
? Concernant la partie 5. sur la gestion du stress
:
Baldine SAINT GIRONS, « RÉPÉTITION,
philosophie et psychanalyse », Encyclopædia Universalis
[en ligne],
Jean-François RICHARD, « THORNDIKE EDWARD LEE -
(1874-1949) », Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 16 mai 2015. URL :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/edward-lee-thorndike/
Marc RICHELLE, « CONDITIONNEMENT »,
Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 mai
2015. URL :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/conditionnement/
Jean-François RICHARD, « PAVLOV IVAN PETROVITCH -
(1849-1936) », Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 11 mai 2015. URL :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/ivan-petrovitch-pavlov/
Jean-François RICHARD, « EBBINGHAUS HERMANN -
(1850-1909) », Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 16 mai 2015. URL :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/hermann-ebbinghaus/
Pierre LECOCQ, « SKINNER BURRHUS FREDERIC - (1904-1990)
», Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le
16 mai 2015. URL :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/burrhus-frederic-skinner/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=htt
p%3A%2F%
2Fspiral.univ-lyon1.fr%2Ffiles_m%2FM152%2FFiles%2F194973_2014.ppt&ei=BG5TVYyoCMmisgGui4HYB
A&usg=AFQjCNFQykjIiEqHUxMtq6V01ZUSJIM35Q&bvm=bv.93112503,d.bGg
http://www.deboecksuperieur.com/resource/extra/9782804153861/STERN_-_Ch1.pdf
http://www.mosalingua.com/blog/2010/02/02/le-systeme-de-repetition-espacee-memoriser-et-ne-jamais-oublier/
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/formation-professionnelle,118/la-formation-des-salaries,1068.html
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CDoQFjAE&
url=http%3A%2F%
2Fwww.pole-emploi.fr%2Ffront%2Fcommon%2Ftools%2Fdownload_file.jspz%3Fmediaid%3D116469&ei=yx
ROVcfLJIHCUp_fgNAL&usg=AFQjCNGXWW7TSZEhZGB_RxMn4czCR2FnVw&bvm=bv.928
85102,d.d24
http://www.drees.sante.gouv.fr/la-drees,1979.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006914249&idSectionTA=
LEGISCTA000006190638&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150514
http://www.sante.gouv.fr/qu-est-ce-que-l-afgsu.html
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 60
http://www.irsn.fr/FR/professionnels_sante/reglementation/Documents/Decret-97-1057.pdf
https://www.afppe.net/Content.aspx?code=2342
http://cyrilpoujoulat.over-blog.com/article-11302274.html
http://www.urgentis.info/modulosite2/professions-medicales.htm
http://www.cesu04.fr/25+afgsu-1-2-les-contenus-de-cours.html
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDkQFjAE&url=htt
p%3A%2F%
2Feicn.chu-nancy.fr%2Fcesu%2Flivrets-afgsu-1%2Flivret-afgsu-1%2Fattachment_download%2Ffile&ei=3x1SVYHQLIb4UI-XgKAK&usg=AFQjCNGTq8olAvKm19o7601A1sArAx_DcQ&bvm=bv.92885102,d.d24
http://cfpps.chu-bordeaux.fr/Nos-formations/?num_action=g003
http://cfps.chu-clermontferrand.fr/CFPS/Pages/Catalogue/Centre_enseignement.aspx
http://www.chu-clermontferrand.fr/Documents/file/CFPS/Catalogue/CFPS%20Catalogue.pdf
http://www.chu-nice.fr/professionnel/vous-aider/centre-de-formation/catalogue
http://www.cidmef.u-bordeaux2.fr/sites/cidmef/files/DAKAR-Alaoui1
? Concernant la partie 5.4 sur le simulateur
:
http://assovirtuailes.free.fr/projets/histoire%20simu/01/projet.html
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-01/guide_bonnes_pratiques_simulation_sante_format2clics.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/simulation_en_sante_-_rapport.pdf
http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/simulation20has.pdf
http://docinsa.insa-lyon.fr/these/2004/silveira/06_chapitre_3.pdf
http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-11/simulation20cv20laerdal.pdf
http://www.epi.asso.fr/revue/dossiers/d12p080.htm
http://www3.chu-rouen.fr/Internet/Formation/CESU/simulation_medicale/
http://sofia.medicalistes.org/spip/IMG/pdf/la_simulation_medicale_luxe_ou_necessite.pdf
http://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/C_Assouline_simulation.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CDkQFjAEOAo&u
rl=http%3A%2F%
2Fwww.mapar.org%2Farticle%2Fpdf%2F1030%2FLa%2520simulation%2520a
m%25C3%25A9liore-t-elle%2520la%2520prise%2520en%2520charge%2520cliniques%2520des%2520patients%2520%3
F.pdf&ei=aThOVY6WHsKjU-PAgagN&usg=AFQjCNFfGCqBg1cW5Ps6JIVog-uD1KezcA&bvm=bv.92885102,d.d24
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 61
http://www.edu.upmc.fr/medecine/pedagogie/memoire/Memoires%202011/2011%20PDF/Tesniere.
pdf
http://www.chu-nice.fr/chu-de-nice/nous-connaitre/centres-d-excellence/centre-de-simulation
http://www.univ-
ag.fr/modules/resources/download/default/Services_communs/STICE/Simulateur.pdf
http://www.reseau-chu.org/fileadmin/reseau-
chu/docs/1863/Rapport_NOUVEAUX_OUTILS_DE_FORMATION_FINAL.pdf
http://www.chu-brest.fr/documents/10156/182531/Simulation+Dr+Huiban.pdf
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00787927/document
http://www.edu.upmc.fr/medecine/pedagogie/Docs%20pour%20memoires%202012/MEMOIRES%
202012/SIMULATION/pdf/Simulation_Ducros.pdf
http://www.ihedn.fr/userfiles/file/larecherche/rapports/45sn-armement/SN45_T1_2.pdf
http://www.cclin-sudouest.com/diaporamas/reso_ih_lim_161014/mprd_simulation_sante.pdf
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/c_7017/simulation-en-sante
http://portail.unice.fr/medecine/faculte/departements/centredesimulationmedicale
http://www.cidmef.u-bordeaux2.fr/sites/cidmef/files/DAKAR-Alaoui1
http://www.sofrasims.fr/medias/files/simulation-en-amerique-du-nord-annfar-2014.pdf
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 62
10. Annexes
Annexe 1 : Enquête exploratoire :
|
Mlle GENSOUS Julie - Etudiante
troisième
Lycée d'Etat HONORE ESTIENNE D'ORVES
Section DTS Imagerie Médicale et Radiologie
Thérapeutique
06050 Nice CEDEX
04.93.97.12.00
|
|
|
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de ma troisième année de formation
DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique je dois
réaliser un projet de mémoire de fin d'études.
Le thème que j'ai choisi concerne la prise en charge des
situations d'urgence par le manipulateur en électroradiologie
médicale.
Sommes-nous capable en tant que manipulateur de prendre en charge
efficacement et rapidement une situation d'urgence ?
Pour commencer mon mémoire j'ai mis en place
l'enquête exploratoire suivante qui sera soumise à trois
manipulateurs de votre service de scanner.
ENQUETE EXPLORATOIRE
Question n°1 : Quelle est votre définition
d'une situation d'urgence ?
Question n°2 : Etes-vous souvent confronté
à une de ces situations d'urgence ?
- Arrêt circulatoire
- Détresse respiratoire
- Crise d'épilepsie / tétanie
- Crise de panique / spasmophilie
- Réaction allergique grave (type oedème de
Quincke)
Question n°3 : Pensez-vous savoir y réagir
efficacement et rapidement ?
Question n°4 : Pensez-vous être suffisamment
formé à réagir à ce type de situations ?
Question n°5 : Comment, selon-vous, pouvez-vous vous
améliorer ?
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 63
Annexe 2 : Echelle de Holmes et Rahe :

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 64
Annexe 3 : Questionnaire d'enquête :
La réaction du MERM face à une situation
d'urgence en imagerie médicale
Etudiante manipulatrice de 3eme année en
électroradiologie du lycée Estienne d'Orves à Nice, je
réalise un questionnaire d'enquête dans le cadre de mon
mémoire de fin d'études.
Ce travail porte sur la réaction du MERM face à
une situation d'urgence et mon hypothèse de recherche est la suivante :
le simulateur améliore la gestion du stress du MERM lors de la prise en
charge d'un patient en situation d'urgence. Pour cela, j'ai besoin d'interroger
des professionnels afin de recueillir diverses informations.
Ce questionnaire est anonyme et s'adresse aux MERM travaillant
en imagerie médicale (conventionnel, interventionnel, scanner, IRM et
médecine nucléaire).
Je tiens à préciser que les MERM travaillant en
radiothérapie ne font pas partie de la population ciblée, je vous
demande donc de ne pas répondre à ce questionnaire.
Vos réponses sont importantes et elles me permettront
d'approfondir et d'enrichir mes analyses.
Je vous remercie du temps consacré à remplir ce
questionnaire.
1) Travaillez-vous dans une structure spécialisée
dans l'urgence ?
Oui
Non
2) Dans quelle spécialité travaillez-vous ?
Radiologie conventionnelle Radiologie interventionnelle
Scanner
IRM
Médecine nucléaire
3)
Depuis combien de temps travaillez-vous ?
Moins d'1an
Entre 1 an et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10ans
4) Cochez les situations que vous jugez comme des situations
d'urgence.
Syncope (malaise vagal)
Crise de spasmophilie
Crise d'épilepsie
Extravasation
Choc anaphylactique
Détresse respiratoire
Arrêt cardio respiratoire
Si non, pourquoi :
5) Cochez celles que vous avez rencontrées au cours de
votre carrière.
Syncope (malaise vagal)
Crise de spasmophilie
Crise d'épilepsie
Extravasation
Choc anaphylactique
Détresse respiratoire
Arrêt cardio-respiratoire
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 65
6)
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 66
Pensez-vous être capable de prendre en charge efficacement
toutes les situations proposées précédemment ?
Oui
Non
Si non, précisez la ou lesquelles vous pose
problème :
7) Sur une échelle de 1 à 5 à quel niveau
évaluez-vous votre stress lorsqu'un patient fait une syncope ?
1 2 3 4 5
Détendu En panique
La question 8 ne s'applique pas au MERM travaillant en
radiologie conventionnelle.
8) Sur une échelle de 1 à 5 à quel
niveau évaluez-vous votre stress lors d'une extravasation de produit de
contraste ?
1 2 3 4 5
Détendu En panique
9) Sur une échelle de 1 à 5 à quel
niveau évaluez-vous votre stress lorsqu'un patient fait un arrêt
cardio-respiratoire ?
1 2 3 4 5
Détendu En panique
10) Avez-vous passé la formation AFGSU ?
Oui Non
11) Depuis combien de temps ?
Moins d'1 an
Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 4 ans
Supérieur à 4 ans
12) Avez-vous suivi d'autres formations sur la prise en charge
des situations d'urgence ? Oui Non Si oui, la ou lesquelles :
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 67
13) Avez-vous suivi une formation sur la gestion du stress ?
Oui
Non
14)
Savez-vous qu'il existe des formations, accessibles aux MERM,
utilisant un simulateur médical ?
Oui Non
15) Existe-t-il un centre de simulation médicale dans
votre ville ?
Oui
Non
Ne sait pas
Si oui, dans quelle ville exercez-vous ? :
16) Avez-vous déjà suivi une formation utilisant
le simulateur médical ?
Oui Non
17) Si oui, quelles situations vous ont été
présentées lors de cette formation ?
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 68
18) Grâce à cette formation, vous sentez-vous plus
rassuré quant à la prise en charge d'une future situation
d'urgence ?
Oui Non
19) Selon vous, quels sont les intérêts d'une
formation par simulateur ?
GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 69
20) Selon vous, est-ce que la formation par simulateur permet au
MERM de mieux gérer son stress lors d'une situation d'urgence ?
Oui
Non
Si non, pourquoi ?
Mots clés : urgence, stress,
répétition, formation, simulateur Keywords :
emergency, stress, repetition, training, simulator
Julie, Gensous
Titre : La réaction du MERM face
à l'urgence en imagerie médicale.
Title : The attitude of a radiographer
dealing with an emergency in medical imaging.
Résumé : Ce mémoire
aborde le thème de la réaction du MERM face à l'urgence en
imagerie médicale.En tant que personnel soignant médico-technique
en service d'imagerie (radiologie conventionnelle et interventionnelle,
scannographie, remnographie et médecine nucléaire) nous devons
accomplir, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires
jusqu'à l'intervention du médecin. Tous les MERM ne travaillent
pas dans un hôpital spécialisé dans l'urgence, cependant
ils rencontreront au moins une fois dans leur carrière ces situations
imprévues qui mettent en jeu le pronostic vital, ou non, du patient. Je
m'interroge sur l'impact que peuvent avoir des situations d'urgence en imagerie
médicale sur la réaction du MERM et sur la prise en charge de
celles-ci. Quelles sont ces urgences ? Quel est le facteur principal qui en
altère la prise en charge ? Quels sont les outils mis à notre
disposition pour apprendre à le gérer et à le minimiser ?
A l'aide d'un questionnaire fermé à choix multiple, je me propose
d'étudier les bénéfices que peuvent apporter la formation
sur simulateur, au MERM, face à l'urgence.
Abstract : This article deals with the
subject of the radiographer's attitude when dealing with emergency cases in
medical imaging. As medical and technical caregiver staff members in an imaging
department (conventional and interventional radiology, CT-scans, MRI and
nuclear medicine) we have to carry out, in emergency cases, the necessary
protective measures until the doctor's arrival. Not all radiographers work in
an emergency specialized hospital, however, they will meet at least once in
their careers these unforeseen situations that may prove to be life-threatening
for the patients involved. I wonder about the potential impact that medical
imaging emergencies may have on the radiographer's reaction and how those
emergencies are handled by the radiographers themselves. What kind of
emergencies do they have to deal with ? What is the main factor that affects
their management ? What tools are available to us to learn how to manage and
minimize its impact ? Thanks to a closed multiple choice questionnaire, I
intend to study the benefits that simulator training can provide to
radiographers in their handling of emergencies.
| 


