B : L'interdiction de tout soutien au terrorisme
Comme toute activité humaine, le terrorisme a besoin de
ressources pour réaliser ses objectifs : il s'agit de ressources
financières ou, plus généralement économiques. En
effet, la planification et l'exécution à long terme d'actes
terroristes nécessitent des fonds importants. Un moyen efficace de
combattre le terrorisme consiste donc à couper les canaux de
transmission de ces ressources. C'est pour dire la complexité qui
entoure le sujet du financement du terrorisme : celui-ci touche de près
des disciplines très variées telles que le droit, la finance
internationale, la fiscalité, ou encore la religion. Le système
Hawala est en une parfaite illustration. Répandu partout sur le
sous-continent asiatique, au Moyen-Orient et dans certaines régions de
l'Afrique, le système Hawala repose entièrement sur la confiance,
sur le sentiment général que les fonds verses à tel ou tel
fournisseur de services ou tel ou tel commerçant dans un endroit donne
seront verses à un destinataire spécifique se trouvant ailleurs.
Puisqu'il existe peu ou pas du tout de traces écrites de telles
transactions, il est extrêmement difficile de repérer les fonds
ainsi transférés. L'interdiction spécifiquement faite aux
Etats de soutenir le terrorisme a été expressément
formulée avant même la création des Nations Unies.
Rappelons qu'à la suite de l'attentat de Marseille de 1934, le Conseil
de la SDN avait adopté, le 10 décembre 1934, une
résolution dans laquelle il rappelait que « tout Etat a le devoir
de n'encourager ni de tolérer sur son territoire aucune activité
terroriste pour des fins politiques ». De même, l'article premier de
la convention de Genève du 16 novembre 1937 se lisait comme suit :
« Les Hautes Parties contractantes, réaffirmant le principe du
droit
cette qualification repose cependant sur des
considérations de faits établis sans beaucoup de recul et
constitue, par ailleurs, une solution dont la validité reste
confinée au seul cas d'espèce, la question de la qualification
générale du terrorisme n'étant en rien résolue.
Voir Yann JUROVICS, « Les controverses sur la question de qualification du
terrorisme », in Karine BANNELIER et al. Le droit
international face au terrorisme. Après le 11 septembre, p.101.
145 William A. SCHABAS et clémentine OLIVIER
reconnaissent pour leur part que les attentats du 11 septembre 2001 ont
été « généralisés » et «
systématiques » et que les victimes étaient « civiles
», sans toutefois se plier à la qualification de crimes contre
l'humanité proposée par certains auteurs. Op. cit. pp. 379 et
s.
146 Ibid. p. 387

70
Maliki Amadou
Malikiamadou007@ymail.com
Tel : 00227 80 69 11 21 /// 00229 66 25 14 60
international d'après lequel il est du devoir de tout
Etat de s'abstenir lui-même de tout fait destiné à
favoriser les activités terroristes dirigées contre un autre Etat
(...) ».
Toutefois, dans le droit conventionnel actuel relatif au
terrorisme, seules les conventions arabe, islamique et africaine interdisent
expressément aux Etats de soutenir le terrorisme, mais en prenant soin
d'exclure de leur objet les luttes de libération nationale. Les autres
conventions, notamment universelles, restent silencieuses sur ce point. Il faut
souligner cependant que ce « silence » est sans conséquence
dans la mesure où le principe de l'interdiction du soutien
étatique au terrorisme a été réaffirmé par
les organes politiques des Nations Unies. Donc, quel que soit l'importance
quantitative des institutions et des normes édictées, il est
évident que le succès de la lutte contre le financement du
terrorisme se situe au niveau national dans un contexte de coopération
internationale. En effet, les organisations internationales et
régionales peuvent adopter une série de textes pour freiner les
abus du système financier, mais leur ratification et mise en oeuvre
dépendent de la volonté de chaque Etat. La lutte contre le
financement du terrorisme ne peut par conséquent se dispenser des
mesures concrètes que chaque Etat est amené à prendre dans
son propre ordre juridique. Ce sont des mesures unilatérales ou
collectives prises en application des normes internationales relatives au
financement du terrorisme, telles que la convention de 1999, la
résolution 1373(2001) du conseil de sécurité et les neuf
recommandations spéciales du GAFI. Ainsi, En 2009, l'Office des
Nations-Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) estimait le trafic de
cocaïne en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale à 900 millions
de dollars147Une importante partie de ce trafic est
contrôlé par les groupes terroristes de la région
sahélienne qui financent le recrutement de nouveaux
éléments et l'achat d'armes par les bénéfices
générés par le trafic de cocaïne, de cigarettes et la
protection des réseaux et filières d'immigrants clandestins
subsahariens vers l'Europe mais également grâce à l'appui
financier que fournissait le régime de KADHAFI dans le recrutement, la
formation et l'encadrement des factions rebelles et de mercenaires dans le but
de déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Selon Alain ANTIL, « il
faudrait commencer par établir une vraie typologie des acteurs de ce
trafic car bien souvent, celle-ci est erronée. On pourrait ainsi
distinguer cinq catégories d'acteurs. Il existe tout d'abord des cartels
Latino-américains, qui sont des organisations criminelles
transnationales. Il y a également des mafias nigérianes qui sont
implantées partout. D'importants éléments de la diaspora
africaine vivant en Europe émergent, ce qui augmente le trafic par
avion. Les tribus ou factions présentes dans le Nord de la Mauritanie,
du Mali et du Niger
147« Les sources du financement des bandes armées
au sahel », Compagnie Méditerranéenne d'Analyse et
d'Intelligence Stratégique, 01 février 2013, p. 5.
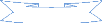
71
Maliki Amadou
Malikiamadou007@ymail.com
Tel : 00227 80 69 11 21 /// 00229 66 25 14 60
participent également à ces trafics. Enfin,
il existe aussi des mafias d'Etat qui ont les capacités de
sécuriser et d'organiser les trafics »148.
| 


