Paragraphe 2 : De l'identification des MPSI après le
11 septembre 2001
Le Conseil de sécurité n'a pas découvert
le terrorisme en 2001. En effet, depuis le milieu des années 1990, le
phénomène terroriste s'est amplifie, notamment avec la
constitution de réseaux transnationaux et le caractère de plus en
plus destructeur des attentats. Cela devient ainsi un problème de
sécurité internationale évident. Mais, les
premières résolutions du Conseil de sécurité sur le
terrorisme sont plutôt laconiques ; ce qui s'expliquait par le contexte
de la guerre froide dans lequel elles ont vu le jour. En d'autres termes, le
Conseil de sécurité refusait de qualifier les actes de terrorisme
de MPSI. Des prétentions de ce type ont été à
maintes reprises écartées par le Conseil de
sécurité. Il en a été ainsi par exemple des raids
israéliens à Beyrouth en 196885 ou à Tunis en
198586, ou encore des raids de représailles américains
en Libye suite à l'attentat contre la discothèque « La Belle
» à Berlin en 198687. Relève de cet ordre
d'idées la résolution88 (1970) qui contient deux
paragraphes relatifs aux détournements d'aéronefs pour faire
appel à toutes les parties intéressées afin que soient
libérés les passagers et membres d'équipage ; des propos
similaires figurent dans la résolution 618 (1988). Un petit pas est
franchi avec la résolution 635 (1989)89 dans laquelle, visant
les agissements illicites contre l'aviation civile, le Conseil de
sécurité se dit en préambule : « conscient des
répercussions qu'ont les actes de terrorisme sur la
sécurité internationale », ébauchant ainsi la
relation entre
85Résolution 263 (1968) du 31 décembre
1968.
86Résolution 573 (1985) du 4 octobre 1985.
87Un projet de résolution condamnant les
Etats-Unis fut présente par le Congo, le Ghana, Madagascar, Trinidad Et
Tobago et par les Emirats arabes unis. Soutenu par la Bulgarie, la Chine, La
Thaïlande et l'URSS, il se vit Opposer le veto américain,
britannique et français, ainsi que les votes défavorables de
l'Australie et du Danemark
88Voir également la résolution 638
(1989) ; voir aussi la position de l'URSS qui opposa son veto au projet de
Résolution S/13735 qui qualifiait la prise d'otages de
Téhéran de 1979 de « menaces continues a la paix et à
la Sécurité internationales »(S/PV.2191, §§ 44
-56).
89 Idem

47
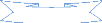
48

49
Maliki Amadou
Malikiamadou007@ymail.com
Tel : 00227 80 69 11 21 /// 00229 66 25 14 60
terrorisme et atteinte à la sécurité
internationale. Amorçant une prise en considération plus
générale, la Déclaration précitée du 31
janvier 1992 traite du terrorisme sous la rubrique « Respect des principes
de sécurité collective » et non sous la rubrique «
Rétablissement et maintien de la paix ». En effet, le terrorisme
n'a fait son entrée officielle dans les situations qualifiées de
MPSI qu'après la chute du mur de Berlin. Mais dans cette perspective, le
Conseil de sécurité a d'abord commence par une qualification au
cas par cas (A) avant de généraliser cette qualification au
lendemain des attentats du 11 septembre 2001 (B).
A : Au départ, une qualification au cas par
cas
Comme on vient de la démontrer, l'incapacité
dans laquelle le Conseil de sécurité s'est trouvé de
qualifier des actes terroristes de MPSI, tenait davantage au contexte de guerre
froide qu'à des considérations de nature juridique. Aussi,
à la fin de l'opposition Est/Ouest, le Conseil de sécurité
décidé d'intervenir pour prendre en charge une action efficace
contre le terrorisme, qu'il considère comme une menace contre la paix.
Cette intention est mise en pratique dans trois affaires
différentes90 :
- l'affaire de Lockerbie
Cette affaire trouve son origine dans l'attentat
perpétré contre un aéronef civil. En effet, le 21
décembre 1988, un avion de la Pan American Airlines (vol n°103),
assurant la liaison entre Londres et New York, explose en plein vol au-dessus
de Lockerbie (Ecosse) peu après son décollage. L'explosion cause
la mort de 270 personnes. Apres enquêtes, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni attribuent cette catastrophe à un acte terroriste d'agents
libyens, qui auraient agi sur ordre des hautes autorités de l'Etat
libyen. Le 27 novembre 1991, les Etats-Unis (pays d'immatriculation) et le
Royaume-Uni (lieu de l'explosion) ont, dans leur déclaration conjointe,
fait à la Libye les exigences suivantes :
- livrer toutes les personnes impliquées dans cet
attentat pour être jugées soit aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni
;
- accepter la responsabilité pour l'acte commis par ses
agents ;
-délivrer toutes les informations à sa
disposition concernant cette affaire ; et enfin
- verser des indemnités appropriées.
Devant le refus du gouvernement libyen d'extrader ses agents
impliqués, les Etats-Unis saisirent le Conseil de sécurité
qui adopta le 21 janvier 1992 la
90 Citées par A. MENDY
Maliki Amadou
Malikiamadou007@ymail.com
Tel : 00227 80 69 11 21 /// 00229 66 25 14 60
résolution 731 (1992), demandant à la Libye de
coopérer avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni dans leur
procédure judiciaire.
- l'affaire soudanaise
Le 26 juin 1995, alors qu'il se rendait à Addis-Abeba,
la capitale éthiopienne, pour assister au sommet de l'OUA, le
président égyptien, Hosni Moubarak, a été la cible
d'une tentative d'assassinat.
Cet acte terroriste est imputé à l'un des
principaux groupes islamistes égyptiens, le Gama-at-al Islamieh. Le
gouvernement soudanais est accusé de complicité par l'Ethiopie et
l'Egypte, puisque les trois individus suspectes d'avoir perpétré
cet acte terroriste auraient trouvé refuge au Soudan. Malgré
diverses demandes de l'OUA, le gouvernement soudanais a refusé de
collaborer à leur capture. L'Ethiopie et l'Egypte saisissent finalement
le Conseil de sécurité, qui adopte la résolution 1044
(1996) du 31 janvier 1996. Dans cette résolution, le Conseil,
après avoir condamne la tentative d'assassinat dont le président
égyptien a fait l'objet, « demande au gouvernement soudanais de se
conformer sans plus attendre aux demandes de l'organisation de l'Unité
africaine tendant à ce qu'il :
- prenne immédiatement des mesures afin d'extrader en
Ethiopie, pour qu'ils y soient traduits en justice, les trois suspects ayant
trouvé refuge au Soudan et recherchés pour la tentative
d'assassinat, conformément au traité d'extradition conclu en 1964
entre l'Ethiopie et le Soudan ;
- renonce à aider, soutenir et faciliter des
activités terroristes ainsi que donner asile ou refuge à des
éléments terroristes (...) »91.
En l'absence de réponse du gouvernement soudanais
à ces demandes, le Conseil de sécurité hausse le ton, en
« considérant que le refus de se conformer aux demandes
énoncées au paragraphe 4 de la résolution 1044 (1996) dans
lequel persiste le gouvernement soudanais, constitue une menace contre la paix
et la sécurité internationales »92. Suivant le
schéma adopte quelques années plus tôt contre la Libye, le
conseil de sécurité se place dans le cadre du chapitre VII de la
charte et exige du Soudan qu'il se conforme aux demandes formulées dans
la résolution 1044 (1996).
- l'affaire des Taliban de 1999.
Le 7 aout 1998, les ambassades américaines de Nairobi
(Kenya) et de Dar es-Salaam (République unie de Tanzanie) sont la cible
de deux attentats à la voiture piégée, à quelques
minutes d'intervalles. Ces attentats ont causé la mort de
91Résolution 1044, §4. a et b.
92Résolution 1054 (1996) du 26 avril 1996,
avant-dernier considérant du préambule.
Maliki Amadou
Malikiamadou007@ymail.com
Tel : 00227 80 69 11 21 /// 00229 66 25 14 60
centaines de victimes, blesse des milliers de personnes et
engendre des dégâts matériels importants. Ils seront
ultérieurement attribués à la mouvance du réseau Al
Qaida de Oussama Ben Laden. Sous l'impulsion des Etats-Unis, le Conseil de
sécurité adopte à l'unanimité la résolution
1189 (1998) du 13 aout 1998 aux termes de laquelle il condamne vigoureusement
ces attentats. Il engage tous les Etats et les institutions internationales
à apporter leur coopération ainsi que leur soutien et assistance
aux enquêtes en cours au Kenya, en République unie de Tanzanie et
aux Etats-Unis pour appréhender les auteurs de ces actes terroristes et
les traduire en justice sans délai. Dans le même temps, le Conseil
« engage tous les Etats à adopter (...), à titre
prioritaire, des mesures concrètes et efficaces en vue de la
coopération en matière de sécurité et de la
prévention de tels actes de terrorisme international et en vue de
traduire en justice et châtier les auteurs de ces actes
»93. Quelques jours plus tard, examinant la situation en
Afghanistan, le Conseil de sécurité adopte la résolution
1193 (1998) du 28 aout 1998 dans laquelle il se dit « profondément
préoccupé par la présence persistante de terroristes sur
le territoire Afghan et exige des factions afghanes qu'elles s'abstiennent
d'héberger et d'entraîner des terroristes et leurs Organisations
»94. Au mois de décembre de la même année,
le Conseil de sécurité constate « avec plus de
préoccupation que des terroristes continuent d'être accueillis et
formés et des actes de terrorisme organisés en territoire afghan,
en particulier dans les zones tenues par les Taliban »pour exiger que
« les Taliban cessent d'offrir un refuge et un entraînement aux
terroristes internationaux et à leurs organisations, et que toutes les
factions afghanes secondent l'action entreprise pour traduire en justice les
personnes accusées de terrorisme »95.
En définitive, ces trois affaires montrent que,
lorsqu'il estime nécessaire, le Conseil de sécurité
n'hésite pas à adopter des résolutions assimilant des
actes de terrorisme a une MPSI, et à mettre, le cas
échéant sur cette base, des sanctions à exécution.
Une véritable politique du Conseil de sécurité reste
cependant délicate à définir à partir de cette
pratique, qui est plutôt sélective. C'est que, dans tous les
domaines, la lutte contre le terrorisme dépend avant tout des conditions
politiques qui subordonnent l'adoption de résolutions à l'accord
des Etats disposant du droit de veto. Au-delà de ces remarques
générales, on peut toutefois tenter de dégager une
position de principe à partir de ces trois affaires : - les actes
terroristes qualifies de MPSI ont été clairement identifies ;
93Résolution 1189 (1998), §5.
94Précisons que, huit jours avant l'adoption
de la résolution 1193 (1998), les Etats-Unis procèdent a des
frappes de missiles de croisière contre une usine pharmaceutique au
Soudan et un camp d'entrainement d'Al Qaida en Afghanistan, en
représailles des attentats du 7 aout 1998.
95Résolution 1214 (1998) du 8 décembre
1998, §13.

50
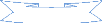
51
Maliki Amadou
Malikiamadou007@ymail.com
Tel : 00227 80 69 11 21 /// 00229 66 25 14 60
- les actes terroristes étaient liés à un
Etat détermine, qui refusait d'exécuter une résolution du
Conseil de sécurité (respectivement la Libye, le Soudan et
l'Afghanistan) ; et enfin
- le recours à la force armée n'a pas
été décidé alors que dans le jargon des Nations
unies, la formule signifie que le recours à la force armée n'est
pas exclu96.Cette ligne de conduite a disparu avec le tournant
particulier que prend la lutte contre le terrorisme au lendemain des attentats
du 11 septembre 2001. Ceux-ci ont conduit en effet le Conseil de
sécurité à généraliser la qualification de
MPSI à tout acte de terrorisme.
| 


