
 |
Gestion des risques environnementaux dans le projet Camwater phase II à Douala.( Télécharger le fichier original )par Daniel ESSAPO UNIVERSITE DE DOUALA-CAMEROUN - MASTER PROFESSIONEL EN ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMNT DURABLE 2013 |
7 INTRODUCTIONL'Agence de Développement de Douala (A2D) est l'institution qui a servi de plate-forme pour la réalisation de cette étude. Elle est née à l'initiative de tous les acteurs de développement de la ville de Douala. C'est le résultat d'un partenariat Public/Privé/Société Civile. La présence de cette institution au coeur de plusieurs projets clés de développement de la ville de Douala en témoigne l'importance. Nous passerons ici en revue les missions de l'A2D telles que définies dans son cahier de charge et ses atouts pour le développement de la ville de Douala. Nous ferons en suite une présentation sommaire du projet CAMWATER Phase II pour lequel A2D a participé comme étant un des acteurs majeurs. 1- ORGANIGRAMME, MISSIONS ET OBJECTIFSL'Agence de Développement de Douala (A2D) a été créé en 2002 sous la forme d'une association régie par la Loi 90/053 du 19 décembre 1990. Elle est enregistrée le 17 avril 2003 sous le N° 228/L/019/BAPP avec une évolution recherchée vers la déclaration d'utilité publique. La raison principale derrière la création de l'Agence de développement de Douala (A2D) est l'élaboration des réflexions stratégiques pour le développement durable de la métropole de Douala. La Communauté Urbain de Douala (CUD), le Port Autonome de Douala(PAD), le Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM), la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat du Cameroun(CCIMA) et la Fédération Nationale des petites et moyennes entreprises (FNAPE) sont les institutions qui se sont associées pour créer l'A2D. Par son slogan « Pour le mieux vivre de ses habitants » l'A2D a développé une philosophie qui voudrait que tous les efforts de toutes les composantes de la société puissent être mis ensemble pour bâtir une grande métropole. C'est donc avec cet esprit que l'A2D assure la stimulation de la ville de Douala pour un développement durable. 8 1.1- Organigramme de l'A2DMembres Fondateurs
Organes de Couvernance Assemblée Générale Membres
Associés(Partenaires) ONG et Associations Economiques, Environnementales L'Agence dispose de trois (3) organes de gouvernance qui sont: l'assemblée générale, le conseil de surveillance et le bureau exécutif ? L'Assemblée Générale est composée de tous les membres et elle se réunit au moins une fois par an. 9 ? Le Conseil de Surveillance est présidée par le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbain de Douala. Il est composé de deux (02) qualités de membres répartis en 24 sièges. Leur mandat est de trois (03) ans renouvelables une fois. ? Le Bureau Exécutif est fait de trois membres qui sont le président exécutif, le directeur et un conseiller nommés par le Conseil de Surveillance. Les comptes de L'Agence sont audités tous les ans par un Commissaire aux Comptes. ? Le Personnel : l'agence de développement de Douala est composé d'une équipe de 6 personnes majeures (Un Président du bureau exécutif, Un Directeur, 3cadres chargés d'études, une assistante de direction et un comptable) cette équipe bénéficie régulièrement de l'apport des stagiaires académiques dans les domaines liés au développement de la ville.A2D dispose également d'une base de données des experts de la ville dans tous les domaines et peut faire appel à ces experts en cas de besoin. Grace à ces partenaires elle utilise un personnel volontaire pour la réalisation de ces différentes tâches. Ici on peut noter des étudiants volontaires de IPD (Institut Panafricain pour le développement) et JCAD (Jeunes Chercheurs Associés pour le Développement), l'IRD (Institut de Recherche pour le développement [France]) et AIRES - SUD tous des partenaires de l'Agence de Développement de Douala.
Figure 2 : Structuration du personnel de l'Agence de Développement de Douala 10 1.2- Sa Mission :L'Agence de Développement de Douala a pour missions : + Promouvoir et accélérer le développement économique, environnemental, social, culturel et touristique dans la ville de Douala. + Activer diverses réflexions sur les actions à générer pour augmenter le taux de développement de la ville et réduire la pauvreté. + Faire de la ville de Douala un pôle de croissance économique compétitif au niveau national, régional et international. 1.3- Ses Objectifs :L'A2D s'est fixé certains objectifs à atteindre qui sont: + Organiser, traiter et fournir des informations sur la ville de Douala à ses membres associés et à d'autres acteurs du développement en ce qui concerne les activités économiques, environnementales, sociales, culturelles et touristiques. + Jouer le rôle de médiateur et de lien entre l'administration (gouvernement), la population locale, les opérateurs économiques et d'autres partenaires au développement des secteurs public et privé ainsi que ceux de la société civile. + Agir comme conseiller auprès de la Communauté Urbaine de Douala ainsi que d'autres institutions dans le domaine de la gestion urbaine. 2- ACTIVITES ET ATOUTS2.1 Les Activités de l'A2D :L'Agence de Développement de Douala déploie ses activités sur trois axes stratégiques qui sont : le développement local, la visibilité de la ville de Douala à l'échelle internationale et les études et gestion des projets. A travers le développement local l'A2D s'active dans la création d'un réseau intra-quartier des unités communautaires de développement, le renforcement des capacités des institutions et des groupes vulnérables ainsi que l'amélioration du potentiel socio culturel. Dans sa tâche de valorisation de l'image de la ville de Douala à l'échelle internationale, l'A2D se lance dans des projets de Marketing Urbain, Promotion Economique, et la prospection et l'accueil des investisseurs et la coopération décentralisée. 11 Dans le domaine de la gestion des projets, en tant qu'acteur majeur du développement de la ville, l'A2D intervient dans les domaines suivants : + Assistance et conseil ; + Gestion et animation de programmes ; + Suivi et évaluation de projet ; + Facilitation, représentation et coordination ; + Vision prospective de la ville 2.2 Les Atouts de l'A2D :L'agence de Développement de Douala a pour atouts : + Elle est reconnue comme la seule plate-forme de partenariat public/privé/société civile dans la ville de Douala + Elle bénéficie de la haute confiance des populations et des autorités locales + Elle a une forte capacité de mobilisation populaire + Elle est une Plate-forme de coordination et d'accompagnement des initiatives de développement + Elle a une forte possibilité de mobilisation des fonds dans le cadre de la Responsabilité Sociétale + des Entreprises (RSE) + Elle est un Fédérateur des partenaires au développement (VSO, Banque mondiale, ONUDI). 3- MOYENS LOGISTIQUESL'A2D dispose de locaux modernes régulièrement assurés situer à l'immeuble du Cercle Municipal de Bonanjo, Rue Vallée des Ministres. Les locaux sont divisés en trois parties qui sont : un secrétariat avec salle d'attente, un bureau pour le directeur, un open space pour les chargés d'études, une salle de réunion de 15 places .l'A2D peut également disposer d'une salle de réunion de 50 et 300 places. Tous ces bureaux sont équipés d'ordinateurs avec connexion internet. L'agence dispose aussi de 3 imprimantes et d'un photocopieur. L'A2D est le gestionnaire du site internet de la ville de Douala.
12 Photographies : 1,2 et 3 :
Le secrétariat avec salle d'attente et le open space
pour les chargés Cliché: ESSAPO Daniel (Stage Août 2013) 4- FINANCES ET PARTENAIRES4.1- Les Finances :Les ressources financières de l'Agence de Développement de Douala proviennent des Contributions des membres fondateurs (CUD, PAD, GICAM, CCIMA, FENAP) ; des produits de prestations issues de ses différentes activités ; de sa contribution dans des projets. 4.2- Les Partenaires :L'A2D à de nombreux membres associés ou partenaires qui facilitent ses activités. Ces membres sont les suivants : les conseils de lotissement, les entreprises industrielles partenaires, les organisations syndicalistes, les médias et les institutions socio-culturelles, les institutions de recherche, les organismes financiers, les institutions coutumières et religieuses et les organisations non gouvernementales (ONG).Il est important de noter que l'A2D dispose d'une base de données importante des associations, organismes internationaux et nationaux avec qui elle travaille pour un seul but « le développement de Douala » 13 5- LES REALISATIONS5.1- Le Projet de Renforcement et Amélioration de la Qualité de l'Eau Potable à Douala (Camwater Phase II)Dans le cadre du projet de Renforcement et Amélioration dans l'Alimentation en Eau Potable à Douala dans la Phase II qui consiste à augmenter la production et l'alimentation de l'eau potable de la ville de Douala de 150 000m3 / jour à 250 000m3, l'A2D a été mandatée pour assurer la médiation sociale. Afin de mener à bien la mission qui lui a été assignée, elle a dans son cahier de charge l'obligation d'assurer les taches suivantes : + La visibilité du projet sur le plan environnemental, social et économique (marketing durable). + La résolution des conflits socio-culturels entre les populations riveraines pendant et après les travaux de pose des canalisations. + Les concertations privées et publiques avec les autorités locales (audience foraine) + Les sensibilisations et informations journalières des populations riveraines. 5.2-Les Autres RéalisationsL'A2D depuis sa création a déjà réalisé plusieurs projets de développement dans la métropole de Douala, à savoir: + La mise en place d'un centre de documentation ayant pour but de développer l'observatoire de la gouvernance locale, d'élaborer des outils d'aide à la décision, de mettre à la disposition des populations des documents spécialisés sur la ville de Douala. + Projet « CINEMA EN PLEIN AIR » qui a pour objectif promouvoir la culture et l'éducation, par l'information et la sensibilisation des populations à travers le cinéma et promouvoir les activités de loisir. + Projet de « CHAMPIONNAT DE FOOTBALL » A2D - Intercommunal avec pour mission : d'élaborer un programme de dialogue citoyen pour accompagner le processus de décentralisation, sensibiliser sur l'éducation à la citoyenneté par des Organisations de la Société Civile(OSC),favoriser l'ancrage territorial, créer une interrelation entre les collectivités locales, assurer une meilleure connaissance des mairies ou communes d'arrondissements et promouvoir le développement participatif à travers un partenariat public-privé-société civile. 14 CONCLUSIONIl apparait donc que les activités définies dans le cahier de charge de l'A2D, institution au centre de la médiation social du projet majeur d'adduction d'eau potable à Douala qui consiste à l'amélioré l'offre de 150 000m3 / jour à 250 000m3 est remarquable. Son engagement pour le marketing durable de la ville au plan sociale, économique et écologique apporte une confirmation de son slogan : « Pour le mieux vivre des habitants !». Cette philosophie qui voudrait faire appel à l'effort commun par la notion de « participation collective » serait alors une évidence que l'A2D adhère à la démarche qui favorise le partenariat Université-Entreprise dans le cadre de la formation des jeunes en vue du développement durable de la ville de Douala.
15 INTRODUCTIONDéfini comme étant une période pendant laquelle quelqu'un exerce une activité temporaire dans une entreprise en vue de sa formation (dictionnaire LAROUSSE), le stage est le moyen par excellence pour les jeunes de développer les compétences professionnelles à travers la mise en pratique du bagage théorique acquis en milieu académique. Pour ce qui nous concerne (étudiant en cours de formation), il sera important de ressortir dans ce chapitre les grandes lignes du cadre professionnel qui nous permettrait de s'habituer au travail en entreprise afin d'acquérir des connaissances pratiques dans le domaine de l'Environnement et du Développement Durable. Il comporte cinq parties à savoir : les termes de référence du contrat d'apprentissage, le cadre d'apprentissage, l'exposé des acquis professionnels, les difficultés rencontrées, la discussion et les perspectives. 1- LES TERMES DE REFERENCES DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE1.1- Exposé des MotifsDans un contexte de crise d'insertion socio-professionnelle des diplômés de l'enseignement académique présentant plusieurs déficits techniques et déontologiques d'une part, de crise d'insertion socio-professionnelle des diplômés de l'enseignement technique présentant des déficits des connaissances théoriques et déontologiques d'autre part, il était capital pour les gouvernants du secteur de l'enseignement supérieur au Cameroun d'instituer un Partenariat Université-Entreprise. Cette innovation partenariale est à l'origine d'une réponse à la demande des entreprises qui étaient encore obligées de parfaire la formation du recruté avant de l'exploiter, alors que ce dernier devrait être directement opérationnalisable. Ce partenariat prévoit la mise en place des formations en entreprise par les académiciens ou les universitaires, de même que des périodes de formation à l'université des personnels des entreprises. Le partenariat université-entreprise a été révolutionné par le développement de deux types de formation à savoir : la formation continue universitaire et la formation universitaire par alternance. C'est dans le cadre de ce partenariat que le stage professionnel prend tout son sens dans la 16 mesure où l'entreprise accueille le stagiaire comme quelqu'un qui vient contribuer à son développement. C'est pourquoi des allocations de stage lui sont attribuées dans la mesure du possible. L'université devient dès lors un levier du développement de l'entreprise et de l'économie nationale. 1.2-L'Objet du ContratDans le cadre de l'institutionnalisation d'une plate-forme pour la formation des jeunes diplômés et l'encadrement des étudiants stagiaires pour leur professionnalisation dans les entreprises, l'A2D a pris en son sein des jeunes volontaires désirant développer des compétences dans le domaine du développement communautaire. C'est donc à travers cette opportunité que nous avons intégrés cette institution afin de contribuer activement à son développement à travers ces différents projets, notamment celui du volet Médiation Sociale du Projet Camwater Phase II. Ledit projet a servi de base pour notre mémoire d'étude sur la gestion des risques environnementaux en vue d'un développement durable. 1.3-But et Objectif du stage :? Se familiariser au travail en entreprise et à la culture d'un environnement professionnel ? Participer activement à la vie quotidienne de la structure d'accueil ? Développer des compétence et aptitudes professionnelles en matière de gestion de l'environnement et médiation sociale. ? Identifier un problème au sein des activités d'A2D et proposer des mesures de régulation 1.4- Les Engagements des Parties ContractantesIl est fondamental de souligner que lors de l'intégration en entreprise comme stagiaire de l'Agence de Développement de Douala, un cadre règlementaire bien défini qui déroule le cahier de charge du jeune professionnel nous a été transmis. Ledit document était articulé sur deux axes majeurs à savoir : l'Engagement de la structure d'accueil et l'Engagement de l'apprenti stagiaire. 17 1.4.1- Engagement de la Structure d'AccueilL'Agence de Développement de Douala s'est engagée à : > Affecter l'apprenti dans le service correspondant à ces besoins de formation identifiable à partir des objectifs. > Faire bénéficier au stagiaire d'un appui matériel en terme d'outil nécessaire pour lui permettre de finaliser dans les délais son mémoire de fin de formation professionnelle ; > Affecter un encadreur professionnel pour suivre régulièrement les activités du stagiaire ; > Garantir et assurer la transmission des connaissances théoriques (10 à 20%), des compétences techniques (80 à 90%) et des principes déontologiques (50%) à l'étudiant. > Mettre à la disposition du stagiaire dans la mesure du possible, une allocation de stage pour frais de déplacement. 1.4.2- Engagement de l'Apprenti Stagiaire L'apprenti stagiaire s'est engagé à : > Apporter des solutions concrètes aux problèmes identifiés en entreprise dans son domaine de spécialisation. > Produire un rapport de stage innovateur pour le développement de l'entreprise ; > Respecter strictement les horaires de travail (sept heures par jours soit 35 heures par semaine). Le travail commence à 8 heures du matin et se termine à 15 heures l'après- midi sauf cas de force majeure ; > Etre respectueux des bonnes moeurs, du règlement intérieur de l'institution et de la hiérarchie ; > Etre toujours correctement habillé. 2- LE CADRE D'APPRENTISSAGE2.1- l'Apprentissage au Plan AcadémiqueEn milieu académique, l'apprentissage a permis la rédaction d'un rapport de stage démontrant les acquis au sein de cet environnement professionnel, mais aussi la rédaction de deux mémoires, l'un pour l'année de pré-spécialisation (Master1) et l'autre pour la spécialisation (Master 2) .Pour ces mémoires, nous avons bénéficié d'un double encadrement académique et professionnel. Au plan académique, M. MEVA'A ABOMO, PhD en Géographie nous a fait bénéficier de son expérience depuis notre première année de formation en Environnement et Développement Durable où il nous a assisté pour la rédaction de notre mémoire pour le Master I sur La gestion des eaux pluviales de ruissellement à Douala et d'un article dans le même domaine. Nous continuons à bénéficier de son 18 expérience pour la rédaction de ce mémoire de Master II intitulé : Gestion des risques environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II à Douala. 2.2- l'Apprentissage au Plan ProfessionnelAu plan professionnel, le stage effectué à l'A2D a été fructueux. Nous avons bénéficié de l'encadrement de M. BELIBI Henri chargé d'études à l'Agence de Développement de Douala (A2D). Son expérience dans le management des projets, et sa transdisciplinarité dans la gestion des activités de développement communautaire nous a été d'un support indispensable. Nous continuerons à bénéficier de son expertise pour nos travaux de recherche. 3- EXPOSE DES ACQUIS PROFESSIONNELS3.1- Le Déroulement du Stage :C'est dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet de référence en matière d'eau potable au Cameroun qu'il a semblé important pour la société CAMWATER d'intégrer les principes de « Participation et de collaboration » pour cette réalisation structurante en milieu urbain qu'est CAMWATER Phase II à Douala. D'où la nécessité du concept de médiation sociale développé et intégré au projet par l'Agence de Développement de Douala(A2D) qui nous a permis de participer sur le terrain en qualité d'Agent Sensibilisateur. En effet, c'est grâce au partenariat Académico-Professionnel que le recrutement et l'intégration des jeunes stagiaires a permis à l'A2D de renfoncer son effectif. Cette initiative de sa direction consistait également à solliciter des associations enregistrées dans leur base des données comme éléments sur le terrain dans le cadre de ce projet. Ainsi, l'Association pour la Solidarité des Forestiers et Environnementalistes (ASFE) a été mandatée pour assurer le volet sensibilisation, information des populations riveraines et sécurisation des sites pendant la pose des canalisations lors de la phase II du projet. Les équipes d'ASFE ont été renforcées par les recrues (stagiaires d'A2D) conformément à l'objectif défini lors de leur convention. Le déroulement du stage était rythmé par les activités de terrain du projet. Ainsi, les équipes des agents sensibilisateurs au sein des quels nous étions intégré ont eu à passer un an sur le terrain .Nos activités démarrent le vendredi 09 Août 2013 par la formation des agents sensibilisateurs sur les opérations de terrain et les techniques de médiation sociale 19 (sensibilisation, information, concertation, identifications des obstacles potentiels et sécurisation des différents sites des travaux). Après cette phase qu'on peut qualifier de formation théorique, dès le Lundi 12 Août 2013 c'est la première descente au Carrefour Nelson Mandela dans la Municipalité de Douala III. Elle marque le début effectif des d'activités des agents sensibilisateurs. Elle se terminera le vendredi 08 Août 2014. La période du Lundi 09 Décembre 2013 au Vendredi 7 Février 2014, est celle qui marquera le début de la pose des canalisations sur le tracé Carrefour AGIP au Rond-Point Deido devant AFLO. Pendant cette période a été également effectuée la sensibilisation des populations riveraines dans cette partie de la ville. Une descente dans le département du Moungo nous permettra d'observer et de comprendre les activités développées à la station de captage et de traitement de Yato afin de mieux cerner le déroulement du projet. Il en sera de même le long des berges du Wouri plus spécifiquement sur la traversée vers Deido de l'autre côté du pont afin d'observer le déroulement des travaux de construction du pont-tuyau qui constitue dans cette partie de la ville un joyau architectural et technique. Par ailleurs, dès la fin des activités des agents sensibilisateurs du projet à Douala en Août, les mois allant de septembre 2014 à fin - Juillet 2015 seront consacrés à la mise en forme du mémoire. Tableau 1 et 2 programme de stage : les différentes activités des agents sensibilisateurs dans le cadre de la médiation social du projet CAMWATER Phase II Tableau 1 :
20 Tableau 2 :
3.2- La Réalisation des Tâches Pendant le Stage Professionnel (action sur le terrain)Dans le cadre de la sensibilisation des populations riveraines il était important pour l'agent sensibilisateur d'aborder les populations avec beaucoup de sérénité, de respect mutuel et avec un esprit de compréhension afin de mieux passer le message. Ici nos articulations étaient faite de manière simple et dans un dialogue informel afin d'amener les riverains à comprendre que notre présence sur le terrain consistait à les informer de l'effectivité des travaux de pose des canalisations pour le compte du projet majeur d'adduction d'eau potable dans la ville. Aussi, il était important pour eux de savoir exactement où le tracé des canalisations devait passer afin de prendre des mesures de précaution pour éviter tout désagrément. Pour cela nous étions accompagnées par des topographes de la CGCOC entreprise qui exécute les travaux. Ainsi, on pouvait savoir l'itinéraire exact et communiquer la bonne information aux riverains. Cet aspect consistait
DEGRE DE REALISATION DES ACTI VI TES EN POURCENTAGE 100 40 90 80 70 60 20 50 30 10 0 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi JOURS DE LA SEMAINE Rapport d'activités Identification des obstacles Sécurisation Concertation Sensibilisation et informaton 21 également à donner des conseils aux riverains notamment à ceux qui avaient des bâtiments sur le tracé. Nous étions aussi chargés d'instruire les différents propriétaires des détails sur les termes de référence du projet, les procédures administratives à entreprendre pour ceux qui n'étaient pas encore dédommagés... En ce qui concerne les concertations, on devait rencontrer les chefs de groupement dès notre arrivée dans un site. Cette activité particulièrement délicate était coordonnée par le représentant de l'A2D. Il était question pour nous de signaler notre présence sur leurs territoires. Le but ici était de nous faciliter la rencontre avec les chefs de quartiers, de blocks, et autres autorités de la zone d'exécution des travaux pour l'encadrement des populations. Afin de renforcer la sécurité dans les sites des travaux, on était souvent appuyé par les forces de maintien de l'ordre au niveau des grandes zones d'habitation et pour canaliser la circulation sur les axes routiers particulièrement encombrés à cause des travaux. Figure 3: Démontrant le Chronogramme hebdomadaire des taches des agents Sensibilisateurs
Figure 4: ESTIMATION DE LA MOYENNE D'EXECUTION DES DIFFERENTES TACHES SUR LE TERRAIN PAR SEMAINE 20% 5% 45% 25% 5% sensibilisation et information concertation sécurisation identification des obstacles rapport d'activités 22 La figure 3 montre que : parmi les activités les plus sollicitées et effectuées par semaine, la sensibilisation et l'information viennent en premier lieu. Cette activité varie de 35% notamment le vendredi à 50% le mardi. Elle est généralement effectuée en moyenne pendant 3 à 4 heures de temps. La sécurisation est également importante au vue des 2 à 3 heures de temps consacrées pour cette activité à raison de ses 25 à 35 % selon le chronogramme hebdomadaire. L'identification des obstacles est effectuée en début de matinée dès notre arrivée sur le terrain afin de sonder la zone d'intervention avant la mise en oeuvre de la pose des canalisations. Les rapports d'activité le Vendredi viennent clôturer la longue semaine d'activités. La figure 4 fait état de la moyenne générale selon nos estimations du temps dépensé pour chaque activité sur le terrain. Ici la sensibilisation et l'information des populations riveraines qui sont une activité majeure des agents de médiation sur le terrain sont les plus importantes. Vient ensuite la sécurisation des sites des travaux. La rédaction des rapports en fin de semaine permet de noter les éléments les plus importants du travail effectué pour en rendre compte à notre superviseur au niveau de l'A2D. L'identification des obstacles, et la concertation avec les autorités administratives et traditionnelles locales constituent respectivement 5% des activités définies dans le
cahier de charge des agents
23 Photographie 4 : l'Equipe
des agents sensibilisateurs du projet CAMWATER Phase II
Photographies 5 et 6 : Agents sensibilisateurs lors d'une réunion de coordination en fin de semaine Source : stage d'Aout 2013 ;
Photographies 7 et 8 : Concertation entre stagiaires dans la sensibilisation des
populations riveraines et (7) : Agent
24 Photographies 9 et 10 : Clichés 1 et 2 démontrant l'agent sensibilisateur Daniel ESSAPO en dialogue avec les populations riveraines le long du tracé de pose des canalisations sur l'axe Carrefour AGIP au Rond-Point Deido à Douala Premier. Source : STAGE- Enquête de terrain, Février 2014 ; 3.3- Les Acquis ProfessionnelsL'étude sur « la gestion des risques environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II à Douala » nous a permis de développer des compétences professionnelles au travers des différentes activités entreprises pendant notre période du stage à savoir : + L'adaptation au travail dans un milieu professionnel (travail de bureau) + L'adaptation au travail de terrain (à l'extérieur de l'entreprise) + L'acquisition des procédures techniques de médiation sociale (sensibilisation, concertation et information du public...) + L'apprentissage de la rédaction des rapports d'activité des équipes sur le terrain + Les procédures de transmission des documents de liaison entre institutions partenaires du projet + La traduction Français -Anglais et Anglais
-Français de certains documents + L'observation des processus dans la production de l'eau potable à grande échelle + L'observation des procédures dans la pose des canalisations pour un projet d'adduction d'eau potable. + Indentification des risques potentiels et obstacles pour le projet (analyse environnementale) 25 Sur le plan personnel, cette expérience a développé en nous les compétences suivantes : + [a capacité de s'exprimer en public + L'Amélioration de l'écriture (rédaction des rapports) en langue Française + [a capacité à travailler sous pression et dans des conditions défavorables en milieu externe (sur le terrain pendant la saison de pluies). + [a capacité à transmettre à la hiérarchie la bonne information et comprendre les autres (les riverains rencontrés sur le terrain) + La capacité d'observer l'environnement d'un oeil professionnel + [a capacité de travailler en équipe (collaboration) 4- LES PROBLEMES AU SEIN DE L'ENVIRONNEMENT DE STAGE4.1- Identification des problèmes de l'entreprise (A2D)L'Agence de Développement de Douala fait face à un manque de personnel environnementaliste. [a pertinence des projets qui impactent grandement l'environnement obligerait l'A2D d'intégré dans son personnel des experts en gestion de l'environnement. On note aussi que le personnel à des lacunes en Anglais. Cette difficulté les contraint à faire appel à un traducteur (à l'extérieur de l'entreprise) pour la traduction des documents importants et confidentiels. 4.2-Identification du problème de l'étudeL'étude a identifié le fait qu'il existe une prise en compte partielle du système de gestion des risques environnementaux. Ce phénomène est caractérisé par : l'absence de la norme ISO 3100 version 2009 portant sur les lignes directrices du management des risques au sein du projet ; une passivité dans l'application de la réglementation en vigueur par les acteurs institutionnels du duopole Santé-Environnement et les actions irrationnelles des populations riveraines le long des canalisations d'eau potable. 5- DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES5.1- DiscussionsCette expérience « Académico-Professionnelle » a été particulièrement importante pour le développement du future jeune cadre, ingénieur de conception dès l'accomplissement de notre formation professionnelle en Environnement et Dévelopment Durable. Elle a permis de mettre en vue les valeurs cultivées d'abord en milieu académique par la maîtrise des théories, modèles, concepts et notions clés dans le secteur de l'environnement, notamment 26 l'analyse des écosystèmes, la gestion des ressources naturelles, l'assainissement des zones urbaines et le développement humain, le développement durable (l'analyse économique, social et écologique),la gestion et l'évaluation des projets de développement, les méthodologies de recherche et de rédaction scientifique ... Ensuite en milieu professionnel, elle a permis la caractérisation du « modèle de l'ingénieur en environnement » plein d'humilité et déterminé à avancer dans une démarche de formation continue. Certaines difficultés ont été rencontrées pendant de la période de stage. Ces difficultés sont académiques et professionnelles. Au plan académique, la difficulté a été au niveau de la recherche des éléments théoriques pour construire l'étude. La complexité du problème d'étude et la rareté de la
littérature sur la thématique « gestion des
risques 5.2- Perspectives Il serait bénéfique pour l'A2D dans une perspective durable d'introduire dans son cahier de charge la réalisation des études environnementales afin d'avoir à sa disposition de la ressource humaine compétente et dynamique dans le but de diversifier son champ d'action conformément au développement durable qui prend en compte non seulement les aspects économique et social mais aussi écologiques. CONCLUSIONCe chapitre sur le contrat d'apprentissage nous a permis de s'immerger dans l'environnement de stage qui constitue le cadre professionnel de référence de cette étude. Il nous a également permis de comprendre l'importance de l'engagement des co-contractants que sont A2D délégué par CAMWATER pour gérer la médiation sociale dans le cadre de ce projet structurant d'une part et le stagiaire que nous sommes qui devait apprendre avec beaucoup d'humilité d'autre part. Ainsi, par notre comportement, nous devrions baliser le chemin pour d'autres futurs stagiaires dans le cadre du partenariat Université-Entreprise pour la formation de futurs cadres en Environnement et Développement Durable. 27 EUXIEM PARTI DEUXIEME PARTIEETUDE DE CAS : PROTOCOLE DE Il est question ici de faire une reconstitution de la démarche utilisée et les moyens de recours permettant d'atteindre les résultats. Les travaux dans cette partie seront focalisés sur : les aspects théoriques d'une part et la méthodologie de recherche d'autre part.
28 INTRODUCTIONDans le domaine de la recherche, la théorie peut être comparée à une lampe torche qui nous éclaire le chemin pour nous permettre de savoir où est ce que nous allons et où est ce que nous mettons les pieds pour ne pas tomber. Dans ce chapitre sur les aspects théoriques de notre étude de cas, nous allons rassembler les composantes théoriques qui guiderons notre travail à savoir : le contexte de l'étude, la délimitation de l'étude, la revue de littérature, la construction de l'objet d'étude et enfin l'intérêt de l'étude. 1- CONTEXTE DE L'ETUDE1.1- Justification Académique de la Recherche Professionnelle et Harmonisation des Perceptions Notionnelles1.1.1- Justification Académique de la Recherche ProfessionnelleCette recherche est réalisée dans le cadre du système Licence-Master Doctorat (LMD) issue du partenariat Université-Entreprise. Elle a pour finalité l'obtention d'un Master Professionnel en Environnement et Développement Durable, spécialité : Surveillance Environnementale, Prévention et Gestion des Risques et Catastrophes, Mention Géographie à l'université de Douala. 1.1.2- Harmonisation des Perceptions NotionnellesAfin d'apporter un éclairage sur certaines notions qui encadrent le sujet d'étude à savoir : « la gestion des risques environnementaux dans un projet d'adduction d'eau potable en milieu urbain » nous nous sommes proposé de définir les termes suivants : L'Environnement: le dictionnaire des définitions dans sa version 2011 définit l'environnement selon des approches comme étant: ? l'ensemble des éléments naturels ou artificiels, qui entourent un système défini, que ce soit un individu, une espèce, une entité spatiale, un site de production, un contexte politique, économique, culturel, sécuritaire... ; 29 ? l'ensemble des échanges (prélèvements, rejets, ...) entre un anthropo système et les écosystèmes du milieu considéré ; ? l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie d'un système défini (individu, espèce...) Dès lors, il apparaît nettement que la dénomination générique Environnement, rassemble une multitude de thèmes (eau, air, sols, déchets, milieux naturels, paysage, bruit, énergie, aménagement de l'espace, sécurité...), concernant de nombreux secteurs (Industrie, agriculture, collectivités locales, santé publique) et de multiples niveaux d'interventions (étude, conseil, expertise, contrôle, exploitation, ingénierie, maîtrise d'oeuvre...). Gestion Environnementale : la gestion environnementale est l'ensemble des mesures ou des procédures dédiées au système environnemental fondé sur le développement durable. La gestion environnementale est la stratégie par le biais de laquelle sont organisées les activités humaines nuisant à l'environnement, dans le but de parvenir à une qualité de vie convenable (Le dictionnaires des définitions, version 2011). L'Eau Potable1 : elle est définie comme étant toute eau de surface, souterraine ou de source qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, peut être consommée sans danger pour la santé. Par exemple l'eau produite à Yato (l'eau du fleuve Moungo) est rendue potable après un traitement physico-chimique. Adduction d'Eau Potable : c'est un processus de dérivation des eaux pour l'amener dans un point donnée dans le but d'alimenter ce point en eau potable. (GEOFOR, 2010) Le Risque : en référence à la norme ISO / IEC Guide 73, le risque est défini comme étant la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement et de ses conséquences négatives. Gestion des risques et Catastrophe : processus de recours systématique aux directives, compétences opérationnelles, capacités et organisation administratives pour mettre en oeuvre les politiques, stratégies et capacités de réponse appropriées en vue d'atténuer l'impact des aléas naturels et risques de catastrophes environnementales et technologiques qui leur sont liées. Définition de l'Eau Potable, Selon le Décret du Premier Ministre N° 2001 /163 / PM du 08 Mai 2001 Réglementant les périmètres de protection autour des points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables. 30 1.2-Contexte GénéralTrouver l'eau nécessaire pour nourrir une population en augmentation galopante est le véritable défi concernant cette ressource vitale. La croissance du nombre d'habitants, principalement en Asie, va très vite rendre les besoins en eau de ce continent supérieurs aux ressources locales. Incapable d'assurer son autosuffisance
alimentaire, il ne pourra En 2050, la population mondiale pourrait être de 9 milliards d'individus, selon l'estimation courante des démographes. Après cette date, la population devrait cesser de croître (sauf en Afrique) et même commencer à décroître. En prenant comme hypothèse 9 milliards d'individus consommant chacun 250 l/j, la quantité totale d'eau nécessaire pour satisfaire les besoins domestiques représenterait 825 km3 d'eau par an (1 km3 est égal à 1 milliard de m3 et 1 m3 équivaut à 1 000 litres), soit 0,7 % de la pluie qui tombe chaque année sur les continents, ou encore 6 % de la fraction de l'eau dite récupérable qui s'écoule dans les rivières et dans les nappes souterraines. Mais cette eau ainsi « utilisée » ne disparaît pas puisqu'elle est, pour l'essentiel, rejetée dans le milieu naturel, et peut éventuellement être réutilisée plus en aval. Clairement, la planète ne manquera jamais d'eau « domestique », comme l'affirme Ghislain de MARSILY(2010). L'enjeu autour du phénomène de l'approvisionnement en eau potable porterait sur les effets des changements climatiques (la pénurie d'eau dans la zone méditerranéenne et celle de l'hémisphère sud du lac Tchad), la distribution effective dans les ménages d'une eau de qualité et les risques environnementaux. Une bonne ingénierie de l'aménagement devrait donc être mise sur pied comme un des moyens ultimes de régulation afin de respecter et de conserver les écosystèmes naturels ;
gérer de manière cohérente et patrimoniale
les En effet, si l'eau est une ressource vitale et rare dans certaines parties du globe terrestre depuis plusieurs décennies, la nécessité de gérer l'environnement où cette ressource provient est toute aussi importante car le risque devient capital pour l'espace et la ressource. 31 La gestion des risques serait donc une approche large, intégrée et structurée. Son objectif premier est la protection de la santé humaine. Les risques environnementaux deviennent alors un facteur déterminant dans les espaces où cette eau est produite. Dans la perspective de garantir sa potabilité pour préserver la santé humaine et la qualité des écosystèmes en général, il est indispensable de déterminer des stratégies de gestion des risques environnementaux spécifiques au système d'approvisionnement en eau potable à l'échelle mondiale (BOLDUC, 2003). Le management des risques liés à l'énergie, l'eau et l'environnement devient pour ce millénaire un des aspects à donner une importance capitale pour assurer un développement durable et un équilibre mondial. Car ils se hissent en tête de liste des facteurs handicapants tout développement socio-économique. Les pays du nord l'ont déjà compris et intégré dans leurs plans d'action. En France par exemple, à l'issue du sommet de Rio, la notion de précaution comme fondement pour le développement durable est associée à la Charte de l'Environnement de 2005 et donne à la gestion de l'environnement une place première notamment quand elle est liée aux ressources en eau dans une interaction non limitée et dynamique, surtout quand l'homme est au centre de ce système. La notion de précaution suppose un niveau de confort matériel déjà relativement élevé. C'est par exemple le cas de la France où elle a été choisie pour encadrer l'utilisation de l'eau. A Douala au Cameroun, compte tenu du niveau de développement encore relativement bas, nous préférons utiliser la notion de « prudence » qui nous imposerait moins de contrainte par rapport à la notion de précaution qui suppose beaucoup plus de moyen et un contexte économique et budgétaire plus rigoureux. La ville de Douala au Cameroun, pays de la sous- région CEMAC, notre espace d'étude, ressort d'un contexte plus ou moins particulier en Afrique Sub-Saharien. En effet, généralement caractérisé par un climat équatorial humide, son littoral met en exergue de grands espaces marécageux où les mangroves et autres milieux végétaux sont vivement abattus pour le besoin de chauffage et pour en faire des zones d'habitation pour les citoyens à faible revenu de la métropole économique. Ce phénomène est donc ici un instigateur du flux de mobilité dans l'espace territorial (migration des zones rurales pour la zone urbain de Douala capitale économique du Cameroun). La croissance démographique serait donc le facteur primordial dans la prise en compte des ressources naturelles de base dont l'eau potable pour le développement d'une ville à la dimension de Douala. Il est par conséquent urgent, dans la politique gouvernementale, de mettre au premier plan la nécessité de résoudre 32 les problèmes de carence en eau potable en milieu urbain Camerounais. Des projets structurant comme celui de CAMWATER en sa phase II à Douala sont donc exécutés pour améliorer l'accessibilité des populations, notamment les ménages de la ville à l'eau potable afin de partir de 35% à environ 81.6 % à la fin de la réalisation du projet CAMWATER Phase II selon le Plan Directeur d'Urbanisme de la ville horizonné à 2025. Associer à cela une prise en compte lente des risques socio-écologiques liés au problème d'approvisionnement en eau potable, le facteur « risque environnemental» devient pour cette ville en voie d'émergence une préoccupation particulière des gouvernants. 1.3- Contexte ScientifiqueLes Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été adoptés en septembre 2000 à New York lors du Sommet du Millénaire des Nations unies. Parmi ces objectifs l'accès à l'eau potable n'apparait que discrètement parmi ceux du chapitre consacré à l'environnement. Ils visent à diviser par deux le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2015.Au Cameroun cet objectif n'a pas été atteint. En répondant à la question : Combien d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable ? MARSILY. G et BERTRAND, J. (2011) soulignent qu'en 2000, environ 1,1 milliards d'êtres humains n'avaient pas accès à un point d'eau potable proche de chez eux, 3 milliards n'avaient pas de robinet d'eau chez eux, et 2,6 milliards ne disposaient pas de l'assainissement. Le problème n'est pas technique, mais financier. Les Nations unies estiment que, chaque année, environ 1,7 million d'individus meurent de diarrhée (dont 45 % en Afrique sub-saharienne, 40 % en Asie du Sud-est et 15 % dans le reste du monde). La plupart de ces diarrhées sont dues à l'insalubrité de l'eau (pollution bactérienne). Les enfants sont les plus touchés. La diarrhée est la deuxième cause de mortalités, après les infections aiguës des voies respiratoires (2 millions de morts), et avant la malaria (0,9 million), la rougeole (0,4 million) et le sida (0,35 million). François MEUNIER (2001) dans son analyse de la problématique de l'adduction d'eau potable en Limousin, région Française, démontre le fait que le thème de l'eau potable longtemps sous-évalué, est devenu tout à fait fondamental, tant au niveau économique, qu'au niveau environnemental. En effet, il s'agit d'un sujet très actuel, avec l'instauration de normes de potabilité de plus en plus rigoureuses depuis 1992, et les consommateurs de mieux en mieux informés deviennent de plus en plus exigeants. La problématique limousine concernant la question de l'eau potable est particulièrement spécifique à cette région, car les sources 33 d'eaux sont abondantes mais sa gestion s'avère délicate. Les sources largement utilisées pour ravitailler les usagers, présentent en général de faibles réserves et de faibles débits, car le sous-sol, constitué essentiellement de roches primaires imperméables et très résistantes, ne permet pas la constitution d'importantes réserves souterraines en eau. Les communes limousines doivent aussi gérer d'autres handicaps comme l'augmentation de la consommation d'eau malgré une baisse générale de la population, et des disponibilités financières souvent faibles, rendant difficiles l'entretien, la rénovation ou le renforcement des réseaux. Pour J.F MATTEI (1996), « Les risques, et notamment ceux qui sont involontaires, semblent être de moins en moins acceptés socialement. Nos concitoyens exigent naturellement une protection contre la mort, mais aussi contre la maladie et l'inconfort. Dans ces conditions, l'impact sur la santé fait désormais l'objet d'une exigence accrue ». Ceci entraine la nécessité de la prise en compte du couple Santé-Environnement dans les programmes d'adduction d'eau potable. Jean-Claude JACQUIOT (2010), dans un exposé répond à la question de savoir : qu'est-ce que l'analyse des risques. De son approche basée sur les travaux de M. Périlhon du CEA de Grenoble, il ressort que : le risque est un ensemble de quatre éléments indissociables à savoir : le Danger, la Probabilité, la Gravite et l'Acceptabilité. Le développement de l'analyse du risque dans ses travaux est caractérisé par 5 étapes qui sont : ? Traiter le Danger par identification des processus, c'est-à-dire l'enchaînement des événements issus des systèmes sources du danger et pouvant conduire à des Evènements Non Souhaitables (ENS) ; ? Représenter l'enchaînement des événements conduisant au danger ; ? Déterminer la Gravité (impacts) des ENS sur les cibles ; ? Déterminer l'acceptabilité par la négociation avec tous les acteurs concernés par la cible. ? Neutraliser les risques par la recherche de toutes les barrières de prévention et de protection qu'il est possible d'identifier pour éviter la production des ENS et leur enchaînement. Marc SANER, dans son guide d'introduction sur l'évaluation scientifique des risques de santé au Canada, met en exergue l'utilisation des sciences naturelles dans la prise de décisions. L'objectif premier du guide vise à exposer ces concepts dans le contexte de leur utilisation. Les évaluations scientifiques réalisées requièrent des aptitudes techniques sophistiquées ainsi qu'un système complexe de collaboration entre chaque intervenant des 34 secteurs public et privé. Dans le cadre du présent document, ce processus est appelé évaluation des risques et l'utilisation de cette information technique lors de la prise de décisions serait la gestion des risques. Le terme gouvernance du risque est utilisé pour les questions liées à la communication des risques, la participation du public et la responsabilisation. Le document aborde trois questions fondamentales représentant les éléments de base d'un système de gestion des risques : « Qui est à risque? », « Quelle est la cause des risques? » et « Quelle est l'approche de Santé-Environnement au Canada relatif aux risques? ».Dans le cadre de notre étude, c'est la population de Douala qui est à risque ; c'est la pratique des acteurs et des populations riveraines qui est la cause des risques environnementaux du réseau d'eau potable ; pour la gestion des risques environnementaux du secteur de l'eau potable, on devrait aboutir à la mise en commun des efforts entre les Ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire. Les travaux de Joseph ZAYED ont été établit sur le thème : « Perception de risque et principe de précaution ». La scientificité de ses travaux dans la partie évaluation s'articule sur deux aspects à savoir : la gestion des risques et le processus décisionnel. Cette approche a permis d'aboutir à une formule pour calculer le risque. Risque = Mesure du danger X Fréquence d'exposition au danger ZAYED dans ce même travail de réflexion détermine 6 principales étapes dans la gestion du risque à savoir : l'Identification ; l'Analyse ; la Planification ; le Suivi ; le Contrôle et la Communication. Si Mohamed BEN MASSOU (2010), pour un éclairage des idées dans le domaine, développe le cycle de la gestion des risques et catastrophe selon un modèle en trois phases : la phase préventive (l'avant-crise), la phase réactive (pendant la crise) et la phase d'apprentissage (l'après-crise). L'Amélioration globale du niveau de vie dans les pays dits « développés » conduit les hommes à refuser de plus en plus le risque. Nos sociétés en voie de développement exigent encore un niveau de sécurité qui devrait être en constante augmentation pour mieux appréhender le risque. Ainsi, des situations considérées comme dangereuses aujourd'hui ne l'étaient pas forcément dans le passé. Par ailleurs, les situations de risque ne sont pas perçues de façon identique dans toutes les sociétés. Dans leur ouvrage : « Introduction à l'environnement et au Développement durable » l'UVED propose une lecture de la thématique risque en plusieurs étapes. Après avoir présenté les bases théoriques de la notion 35 de risque, elle détaille différentes situations de risques en prenant deux points de vue opposés, d'une part « la planète face à l'homme » et d'autre part « l'homme face à la planète ». Dans les deux cas, qu'elle soit à l'origine ou confrontée à des risques, notre société a développé des outils et des politiques publiques qui encadrent et facilitent la prévention et la gestion des risques. Simon MONGEAU-DESCOTEAUX, dans son approche de l'analyse des méthodes, techniques et outils pour réaliser des évaluations environnementales rapides en réponse aux situations d'urgence ,met en exergue le fait que pour minimiser les impacts environnementaux de leurs actions, les principaux donateurs de l'aide publique au développement ont instauré des processus d'évaluation d'impacts environnementaux applicables à leurs activités de développement et de coopération afin de mieux encadrer leurs actions à l'international. L'aide internationale ne se limite cependant pas qu'aux programmes de développement et de coopération, elle comprend également des programmes d'assistance humanitaire. Ces programmes sont davantage sollicités en situation de crise, comme les guerres, les inondations et les tremblements de terre. La planification des interventions et la gestion des opérations doivent être immédiates et efficaces afin de répondre rapidement aux besoins des populations affectées. Au regard de cette situation, plusieurs questions surviennent : les méthodes d'évaluations environnementales rapides utilisées par ces organismes humanitaires permettent-elles d'atténuer efficacement les impacts générés par la relocalisation des populations lors de situation d'urgence? Ces techniques sont-elles performantes? Y-a-t-il lieu de proposer des améliorations? Afin de répondre à ces interrogations, le présent essai compare et évalue les diverses méthodes d'évaluations environnementales rapides dans le but d'identifier des améliorations possibles. 1.4- Contexte ProfessionnelAu point de vue professionnel, la gestion des risques environnementaux dans la réalisation du projet majeur d'adduction d'eau potable en milieu urbain est indispensable. Elle est au centre des enjeux politico-économiques pour le financement de l'investissement et met en mouvement la coopération internationale. Pour la réalisation et le suivi, le management de l'environnement d'un projet comme celui-ci exigerait une certaine expertise pour appréhender les risques écologiques, sociaux et sécuritaires autour des infrastructures et du réseau. Il met en exergue l'importance de l'intégration du couple santé-environnement dans les activités des travaux publics pour une préservation de la qualité de vie des citoyens dans les espaces urbains comme Douala. Les slogans comme « zéro accident » dans les 36 chantiers de construction des infrastructures et du réseau en veillant aux consigne HSE ou encore « santé pour tous » dans la mise en oeuvre des pratiques sanitaires dans les quartiers seraient donc pour ce type de projet une vitrine de la qualité de vie qu'on souhaiterait avoir pour les infrastructures dans une ville en voie d'émergence comme Douala. 2- DELIMITATION DE L'ETUDEAfin de mieux cerner le sujet d'étude, nous avons opté de faire une délimitation sur cinq axes majeurs à savoir : une délimitation épistémologique pour définir le courant dans lequel cette étude est basée ; une délimitation conceptuelle afin de mettre en exergue le cadre logique de notre démarche ; une délimitation thématique pour comprendre les items développées, notamment la gestion du risque, l'environnement immédiat du projet et le système d'adduction d'eau potable en milieu urbain avant pendant et après le projet ;une délimitation temporelle dans le but de déterminer le temps ou la période d'étude particulièrement pour la descente sur le terrain pour la collecte des données et enfin une délimitation spatiale pour maitriser l'espace d'étude . 2.1- Délimitation EpistémologiqueCette étude s'inscrit dans le courant de « la Nouvelle Géographie ». Celle-ci met en exergue la transversalité des démarches déductives et inductives à certain niveau à l'instar des sciences sociales et des sciences dures qui servent toutes à la confrontation des phénomènes réels autorisant une interprétation de l'espace. Cette étude serait alors fondée sur une idéologie qui considère : « la géographie comme une science nomothétique », comme l'estiment R. Brunet , R. Ferras et al (1992)1 1La géographie comme science nomothétique : étude des similarités, de l'ordre dans le processus et de l'unité des phénomènes. Exemple étude des mécanismes spatiaux généraux, géographie générale, analyse spatiale. Reference :Roger Brunet ,Robert Ferras et Hervé Théry, Les mots de la géographie : Dictionnaire critique, Montpellier Paris, Reclus-La Documentation fran aise, coll. Dynamiques du territoire , 1992, p.470 ; (ISBN 2-11-002852-1) p. 459 37 2.2- Délimitation Conceptuelle et ConceptualisationLa délimitation conceptuelle de cette recherche sur la gestion des risques environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II s'est focalisée sur quatre axes qui constituent les dimensions de l'étude à savoir : la politique de gestion des risques environnementaux, les pratiques des acteurs en matière de gestion des risques, les impacts des pratiques des acteurs sur l'environnement immédiat et la stratégie intégrée (le modèle de régulation du problème identifié). « Parce que la performance d'un système managérial serait généralement au centre du succès d'une activité, d'un projet ou d'un programme », il est important de définir le cadre d'analyse du processus de gestion environnementale du projet majeur d'adduction d'eau potable à Douala. La politique de gestion ici définit une vision globale de CAMWATER Phase II en faisant ressortir la valeur que ledit projet a attribuée au volet environnemental, notamment en ce qui concerne la gestion des risques. Ceci nous permet de mettre en exergue les orientations cette gestion au plan politico-économique, socio-écologique et sécuritaire. Cette dimension de l'étude induit la description de l'état de l'environnement avant, pendant et après la réalisation des travaux dans les sites. « Parce que les activités humaines tiennent une place importante dans la mise en valeur ou la modification des milieux de vie », leur influence est tant-tôt positive, tant-tôt négative. Deux groupes d'acteurs ont particulièrement retenu notre attention à savoir : les acteurs institutionnels (les acteurs gouvernementaux et les parties prenantes du projet) et les acteurs locaux (les autorités traditionnelles et les populations riveraines). « Parce que les impacts des différents acteurs sur le projet varient en fonction des activités de chacun », leur évaluation permettra de contrôler et de suivre l'évolution du phénomène diagnostiqué en vue de poser les bases d'un modèle de régulation susceptible de réduire l'occurrence des risques environnementaux au niveau du projet ou d'autres projets similaires. « Parce que l'élaboration d'une stratégie est un moyen de réduire l'occurrence d'un évènement dangereux », cette dimension de l'étude nous permettra d'apporter des solutions aux problèmes initialement identifiés au sein du projet. Ainsi, la mise en oeuvre d'un Plan de Gestion des Risques Environnementaux (PGRE) serait un apport important pour le projet. 38 Tableau ... : CONCEPTUALISATION DE LA GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX POUR LE PROJET CAMWATER PHASE II Thème Dimension Attribut Variable Indicateur
39 2.3- Délimitation ThématiqueAfin d'aboutir à des analyses effectives, nous avons structuré le sujet d'étude sur la gestion des risques environnementaux en différents axes thématiques à savoir : ? La politique de gestion des risques environnementaux ? Les pratiques des acteurs relatives à la gestion des risques environnementaux ? Les impacts des pratiques des acteurs du projet sur l'environnement immédiat ? Elaboration d'une Stratégie Intégrée: Plan de Gestion des Risques Environnementaux (PGRE) 2.4- Délimitation TemporelleLa validité des données obtenues dans les résultats de l'étude vont de la période d'Août 2013 (période de descente sur le terrain des agents sensibilisateurs) à Décembre 2014 (période officielle de fin du projet). 2.5- Délimitation SpatialeDouala capitale économique, ville située dans le littoral du Cameroun est l'espace majeur de cette étude. Sur le plan localisation géophysique du milieu d'étude, Douala a pour coordonnées géographiques 04002' de latitude Nord et 09042' de longitude Est. Elle se trouve à 40km de la mer. C'est une ville d'estuaire : l'estuaire du fleuve Wouri. Sa fonction portuaire et son industrialisation qui en découle expliquent l'accroissement rapide de sa taille et de sa population qui était de 458000 habitants en 1976 et estimée à environ 2 millions en 2000. Grâce à sa croissance progressive, elle est estimée à 2.6 millions selon le dernier Recensement de la population au Cameroun. Figure 5: Cartographie de Douala en 1925
Source : Archive CUD ,2000 Figure 6 : Cartographie de Douala : « la tache urbaine » années 2000
Source : Archive CUD, 2004 Figure 7: La Métropole de Douala et ces six Communes d'arrondissement
Source : CUD, PDU-POS 2011 40 41 Sur le plan spécifique de notre milieu d'étude « Douala », la délimitation spatiale est faite sur deux grands axes routiers dont l'axe carrefour AGIP au Rond-Point Deido dans la municipalité de Douala Premier et l'axe majeur allant à Ouest du pays par Bonaberi dans la municipalité de Douala IV en traversant le fleuve Wouri sur le pont reliant Deido et Bonaberi. Ces axes nous permettront d'avoir une meilleure couverture spatiale de certaines zones sensibles du projet CAMWATER Phase II à Douala : ? La périphérie de la station de captage et de l'usine de traitement. ? Les emprises des routes et des rues où sont enterrés les canalisations et tuyaux d'alimentation de l'eau potable. ? La périphérie des châteaux d'eau, des forages complémentaires et du « pont tuyau » qui traverse le fleuve Wouri. Figure 8 : La ville de Douala : Délimitation des Municipalités
Source : CUD, DEPUDD 2012 42 3- LA REVUE DE LITTERATURECet exercice de documentation nous a ouvert l'esprit et permis à partir des expériences développés au niveau de la communauté internationale et dans certains pays, d'appréhender les problèmes de gestion de l'environnement, la gestion des risques plus particulièrement leurs rapports avec l'adduction d'eau potable. Ainsi, nous passeront tour à tour en revue : ? La vision de la communauté internationale : les questions de gestion environnementale et l'eau potable comme ressource naturelle ? Les orientations évolutives de la gestion des risques de l'environnement ? Les expériences Euro-Africaines dans la réalisation des projets d'adduction d'eau. ? La démarche Camerounaise dans la mise en oeuvre d'une stratégie Santé- Environnement pour le Programme de développement des zones urbaines. ? La stratégie de la ville de Douala face à la problématique de la gestion de l'environnement et l'approvisionnement en eau potable. 3.1- La Vision de la Communauté International : les questions de GestionEnvironnementale et l'Eau Potable comme Resource Naturelle :L'Union Mondiale pour la Nature IUNC (2000) relève l'importance du volet « environnement et écosystèmes » de la Vision mondiale de l'eau. Le document insiste sur la nécessité de changements fondamentaux dans l'attitude et le comportement des êtres humains envers l'eau douce et les écosystèmes qui en dépendent, si l'on veut arriver à garantir une sécurité environnementale, sociale et économique. La « Vision » présente le cadre théorique des interactions-clés entre les êtres humains et la nature et propose un plan d'action composé de six objectifs principaux allant de la gestion durable des ressources naturelles aux questions de gestion publique, de la communication et du savoir-faire.
Il s'agit ici d'un document Stephan Rist (Helvetas 2001) estime que: « if this drinking water system fails, then the whole community is a failure ». Son étude relève que si les formes de gestion de nouvelles infrastructures pour l'eau potable, comme par exemple des « comités de l'eau » mis en place par l'aide internationale, ne correspondent pas à la structure de gestion du village, l'infrastructure ne peut pas être durable. L'étude propose un système de gestion adapté au mode de fonctionnement local : des bureaux communaux, représentés par des personnes 43 connues et appréciées de la population sont mis en place. Les chefs de cantons associés à la médiation sociale pour la sensibilisation et la résolution des conflits avec la population de Douala dans le cadre du projet CAMWATER Phase II devraient s'inspirer de ces propositions de Stephan Rist. Car même en milieu urbain si les populations ne s'impliquent pas, les infrastructures comme le pont-tuyau de Bonaberi, les différents châteaux d'eau de Nyala, Koumassi ou encore Logbessou ...ne peuvent pas durer. Guerquin François et al, (Conseil Mondial de l'Eau 2003) : Préparé à l'occasion du 3e Forum Mondial de l'Eau, ce rapport présente l'inventaire des efforts de la communauté internationale pour convertir la « Vision Mondiale de l'Eau » en actions. Il s'appuie sur quelques 3000 actions (disponibles sous forme de base de données sur Internet), conçues pour améliorer la gestion de l'eau au niveau local, régional, national ou international. Ces actions sont issues d'exemples de bonnes pratiques, de projets de recherche appliquée, d'études, de campagnes de sensibilisation, de politiques ou de réformes institutionnelles et législatives. Il s'agit d'un complément au « Rapport Mondial sur la mise en valeur de l'eau dans le monde » et à la « Boîte à outils pour la gestion intégrée des ressources en eau ». Le Conseil Mondial de l'Eau (CME ,2003) explique qu'en ce qui concerne les problèmes de financement, il s'agit de dépenses lourdes suivant les types d'utilisation de l'eau. Par exemple, la collecte et le traitement des eaux usées, l'irrigation, les eaux industrielles, les eaux domestiques ainsi que les questions connexes de gestion des ressources, de prévention des crues, de sauvegarde de l'environnement etc. S'agissant particulièrement des pays en développement, le CME estime qu'un doublement du volume financier est nécessaire pour atteindre les objectifs du millénaire relatifs à l'eau et l'assainissement. La situation financière serait encore plus difficile pour les pays Africains comme le Cameroun qui était coincé à l'époque par les plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque Mondiale. Le pays ne pouvait entreprendre aucun projet majeur, même dans le domaine vital de l'eau potable. D'après le document « LA VILLE, ACTEUR DE DEVELOPPEMENT » issue des actes du séminaire international de la Coopération Technique Belge à Bruxelles du 18-19 Décembre 2007 mettant en grandes lignes l'exposé de David Satterthwaite de l'International Institute for Environment and Development (IIED), Royaume-Uni. L'exposant dans ces travaux insiste sur le fait que « La nécessité de se concentrer davantage sur les services de base en milieu urbain est incontestable pour deux raisons. La première est l'ampleur et la rapidité de la croissance de la pauvreté en milieu urbain - en particulier en Afrique et en 44 Asie. La seconde raison, directement liée à la première, est l'ampleur et la rapidité du retard engrangé par la fourniture de ces services dans les zones urbaines - notamment la distribution d'eau, l'assainissement, le drainage, les soins de santé et l'existence d'écoles. Bien souvent, la moitié, voire plus, de la population des centres urbains n'a pas accès à ces services ». C'est bien le cas de l'eau potable à Douala qui a motivé la mise en oeuvre du projet CAMWATER Phase II. Il existe donc une cohésion parfaite entre notre étude de cas et l'idée illustrée par David Satterthwaite dans son exposé à Bruxelles dans le cadre des activités de la Coopération Technique Belge (CTB). Au canada, Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, institution Québécoise met sur pied une politique adoptée le 19 février 2008 par son conseil d'administration. Cette politique est plutard publiée dans un document intitulé Politique relative à l'environnement et au développement durable. Il définit des objectifs fondamentaux dans la mise en oeuvre du respect de l'environnement et l'application du développement durable. Ici on peut souligner: la création des formations et l'animation des activités de sensibilisation à la protection de l'environnement et au développement durable, encourager dans la mesure du possible la concertation et les partenariats avec les organismes municipaux, régionaux et nationaux pour le développement des actions visant la protection de l'environnement. Elle a également initié l'instauration de pratiques de gestion environnementale notamment la réduction de la consommation de l'eau tout en respectant les besoins des utilisateurs et en prévenant la contamination pour en protéger la qualité, améliorer constamment les pratiques de gestion et d'utilisation des matières dangereuses de façon à éliminer ou à contrôler les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces éléments sont pour notre étude une base vitale dans la compréhension de la thématique définie. Car ils démontrent l'enjeu d'une gestion environnementale et son apport pour le développement d'une communauté comme celle du Cégep au Canada et de la ville de Douala au Cameroun. La Banque Africaine de Développement (BAD) dans sa démarche de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) en 2010 souligne le fait que, le secteur de l'eau est scensé subvenir à des besoins sociaux, environnementaux et économiques. Devant la pénurie croissante de l'eau exacerbée par l'explosion démographique et l'urbanisation, la mauvaise affectation des ressources, la dégradation de l'environnement et la mauvaise gestion des ressources en eau, le Groupe de la Banque et ses pays membres régionaux (PMR) font face à de nouveaux défis qui requièrent une nouvelle approche de la gestion des ressources en eau. Pour le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) : 45 ? L'eau doit être considérée comme un bien économique, social et environnemental ; ? les politiques et options guidant la gestion des ressources en eau doivent être analysées dans un cadre global ; elles visent essentiellement à promouvoir un développement efficace, équitable et durable à travers une gestion intégrée des ressources en eau. Le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) lors de sa douzième session extraordinaire à Nairobi, du 20-22 février 2012 rend compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique et stratégie du Programme des Nations Unies pour l'environnement dans le domaine de l'eau pour la période 2007-2012 adoptée par le Conseil d'administration dans sa décision 24/16 A du 9 février 2007. Il fournit des informations sur les activités menées conformément à la politique et stratégie depuis la vingt-cinquième session du Conseil d'administration, et les enseignements tirés de sa mise en oeuvre. Utilisant la politique et la stratégie dans le domaine de l'eau, le PNUE a mené de nombreuses activités en vue de promouvoir l'adoption de la démarche éco-systémique pour la gestion de l'eau afin d'améliorer la sécurité hydrique et les conditions de vie des êtres humains. Ici nous pouvons noter certains principaux résultats atteints au cours de la période 2009-2011. Ils sont présentés ci-après conformément aux volets de la stratégie : évaluation, gestion et coopération. En ce qui concerne les objectifs du volet évaluation de la politique et de la stratégie dans le domaine de l'eau, il a été recommandé de : fournir une base de connaissances permettant d'élaborer, de gérer, de suivre et d'évaluer les programmes relatifs aux ressources en eau et d'encourager l'intégration de la gestion durable des ressources en eau dans les politiques et processus de ces développements ; renforcer la sensibilisation et informer les parties prenantes (y compris le public) sur les questions et préoccupations relatives à l'eau comme étant une ressource ; évaluer les menaces, les tendances et les problèmes émergents qui pourront exiger que des mesures soient prises à l'avenir. En définitive, à travers le PNUE, le PNUD et la BAD, associés aux autres institutions internationales, nous constatons que la communauté internationale affiche une préoccupation constante pour les problèmes de l'eau d'une part et de l'environnement d'autre part. Elle n'a pas encore mis en exergue un plan cadre bien défini en ce qui concerne la gestion du risque environnemental lors de la mise en oeuvre des projets d'adduction d'eau. Elle énonce 46 cependant les orientations et laisse les choix politique et stratégique au niveau de la responsabilité de chaque Etat. 3.2- Les Orientations Evolutives de la Gestion des Risques de l'EnvironnementToute situation, toute activité peut produire un événement profitable ou dommageable. Le risque est défini par la probabilité de survenue de cet événement et par l'ampleur de ses conséquences. Il peut être appliqué à une personne, une population, des biens, l'environnement ou le milieu naturel. En 1921, Frank Knight a proposé une distinction qui fait référence entre le risque et l'incertitude : à un risque peuvent être assignées des probabilités mathématiques mais pas à une incertitude. Dans certains domaines, on ne prend en compte que les conséquences négatives, que les pertes et pas les gains : on parle alors de risque aryétique. Le risque est une notion importante notamment dans les domaines de l'industrie, de l'environnement (risques industriels, risques majeurs), de la finance, du droit, de la santé, et bien sûr des assurances. Parallèlement à la prise de décision, la gestion du risque consiste en l'évaluation et l'anticipation des risques, ainsi qu'à la mise en place d'un système de surveillance et de collecte systématique des données pour déclencher les alertes. La science qui étudie les risques industriels et naturels est la cindynique, selon la définition proposée en 1987 (Congrès Sorbonne - Paris). En 2004, dans « Le Risque, cet inconnu », Georges Jousse a proposé le terme « riscologie » pour l'étude générale et scientifique des risques quels qu'ils soient (Cf. Georges Jousse, Traité de riscologie - La science du risque). En Novembre 2009, la nouvelle norme internationale ISO 31000 en management des risques fut publiée avant d'être rapidement adoptée en norme française par l'AFNOR sous NF ISO 31000 /2010. Cette norme propose des principes et des lignes directrices du management des risques ainsi que les processus de mise en oeuvre au niveau stratégique et opérationnel. La norme est structurée en trois parties, à savoir les principes, le cadre d'organisation et le processus de management. Les principes répondent à la question pourquoi fait-on du management des risques. Le processus d'intégration de ces principes se fait ensuite à deux niveaux : le niveau décisionnel et le niveau opérationnel. Le cadre d'organisation explique comment intégrer via le processus itératif de la roue de Deming (Plan-Do-Check-Act), le management des risques dans la stratégie de l'organisation (conduite stratégique). Le processus de management précise comment intégrer le management des risques au niveau opérationnel de la stratégie de l'organisation (conduite opérationnelle). Ce processus itératif est bien connu des « Risk-manager ». 47 D'après l'Université Virtuelle de l'Environnement et du Développement Durable (UVED, 2010), Une première approche théorique de la notion de risque peut se faire par l'analyse historique de la prévention et la gestion des risques. L'histoire ancienne ou récente comporte en effet de nombreuses catastrophes naturelles (inondations, cyclones, tsunamis) ou accidents technologiques (marées noires, accident de Bophal, AZF...), et fait ainsi apparaître la diversité des situations de risques, mais aussi ses points communs. Le risque est ainsi défini comme étant le croisement d'un danger (événement redouté), de sa probabilité d'occurrence (plus simplement : sa fréquence), de sa gravité (nombre de personnes mises en danger) et de son acceptabilité par la société. Différentes méthodes ont été développées pour caractériser les différents types de risques, permettant ainsi de mieux les appréhender et de mieux les prévenir. Cette approche théorique des risques, centrée sur des accidents ou catastrophes, ne doit pas faire oublier par ailleurs l'existence de risques diffus. Le risque de maladies ou de problème de santé humaine suite à l'utilisation des pesticides dans les systèmes de productions agricoles est un sujet qui devient aujourd'hui de plus en plus d'actualité. En prenant par ailleurs du recul sur cette notion de risque, un aspect apparaît comme particulièrement important : pour pouvoir analyser et prévenir correctement les risques, il faut disposer de données et des connaissances de bonne qualité et pouvoir identifier et quantifier les incertitudes qui existent sur les connaissances scientifiques. Ces différents éclairages théoriques sur la notion de risque en font donc ressortir la complexité. Afin de mieux appréhender cette notion sous ses différents aspects, nous pouvons ainsi regarder plus attentivement les relations entre la planète et l'homme. L'UVED (2010), souligne le fait que : la prévention et la gestion des risques se base d'une part sur des outils de politique publique, et d'autre part sur des outils de prévision, de cartographie, d'analyse et de gestion. D'un point de vue juridique, les politiques publiques de gestion des risques environnementaux font principalement partie du droit de l'environnement (de la charte de l'environnement à des circulaires ministérielles). Ces politiques publiques visent principalement à l'identification et l'évaluation des risques, à la gestion des risques au sens de la protection civile, et des questions de responsabilité et d'indemnisation des dommages. Il existe aussi des outils économiques, en particulier des outils assuranciels qui doivent être pris en compte dans la gestion économique des dommages. De manière plus générale, les politiques de développement durable attachent une part importante à la question des risques, principalement inspirés par des principes directeurs comme le principe de 48 précaution. Pour compléter ces outils de politique publique, des outils techniques pour la prévention et la gestion des risques peuvent être mobilisés. Les systèmes d'information géographiques, par exemple, sont des outils particulièrement intéressants pour mettre en oeuvre les politiques de gestion des risques naturels, souvent basées sur des plans de prévention et de politiques d'aménagement du territoire. Cependant, en fonction des cas, la prévention et la gestion des risques peuvent prendre des formes très différentes. Quelques exemples sectoriels permettent d'illustrer cela : ? La gestion des milieux côtiers, qui nécessite la mise en place d'une gouvernance forte entre les acteurs locaux du territoire sous l'encadrement de l'Etat. ? Les questions de santé environnementale interrogent à la fois l'écologie, la toxicologie, l'épidémiologie, la médecine et la sociologie. Elles approchent la question des risques sous l'angle sanitaire, à l'échelle d'une vie humaine. ? La maîtrise du climat et l'adaptation climatique passent quant à elles par des politiques publiques de très long terme (plusieurs dizaines d'années), ou se mélangeront des enjeux climatiques, énergétiques, économiques et humains. Si Mohamed BEN MASSOU (2010), souligne le faite que les notions de risque et de catastrophe représentent un thème des plus controversé qui soit. Elles désignent une réalité bien évidente associée au désordre et au chaos mettant en cause ce qui est établi dans son ordre normal. Le rapport du PNUD de 2004 montre que des milliards de personnes dans plus de 100 pays sont périodiquement victimes d'un phénomène de type catastrophe. Notamment des inondations. Ce même rapport démontre que le risque et la catastrophe restent inévitables pour l'humanité. D'où la nécessité pour les pays et les organisations d'établir un plan efficace et objectif en vue de maîtriser les crises. La gestion des risques et des catastrophes se base habituellement sur des considérations assez formelles qui constituent une référence à la majorité des questionnements. L'instrumentalisation des connaissances scientifiques, techniques et pragmatiques à des fins de recherche en matière de crise, permet de faciliter le passage de l'expertise à la décision. Ainsi, la gestion des risques et des catastrophes peut se faire selon un modèle en trois phases : La phase préventive (l'avant-crise), la phase réactive (pendant la crise) et la phase d'apprentissage (l'après-crise). L'application de ces trois phases importantes dans la gestion des risques et catastrophes est également prise en compte dans le cadre du Projet CAMWATER Phase II à travers son 'étude d'impact environnemental, son étude de faisabilité déterminant l'état des lieux et permettant d'avoir une vision anticipée de 49 ces impacts sur l'environnement immédiat et les signes avant-coureurs des risques environnementaux et des dangers potentiels. D'après le Deuxième Plan National Santé-Environnement (PNSE) en République Française, le thème de santé-environnement définit les « aspects de la santé humaine et des maladies qui sont déterminées par l'environnement. Cela se réfère également à la théorie et à la pratique de contrôle et d'évaluation dans l'environnement des facteurs qui peuvent potentiellement affecter la santé ». Si les risques majeurs sont relativement bien identifiés par les populations comme une menace pour leur vie et leurs biens, les risques de santé liés à l'environnement sont souvent moins perceptibles. La thématique santé-environnement a néanmoins pris beaucoup d'importance au sein de la société française, et sensibilise aujourd'hui un nombre croissant de citoyens et, avec eux, les pouvoirs publics. Ces risques, de par leur diversité, leur nouveauté et le manque de connaissance qui peut les caractériser, sont difficiles à qualifier, à quantifier et donc à gérer. Pour de nombreux risques de santé liés à l'environnement, les connaissances sont encore parcellaires, incertaines, voire inexistantes. L'apparition des effets sanitaires de certains produits est parfois différée, rendant difficile l'identification des liens de cause à effet. L'exemple de l'amiante, un matériau amplement utilisé dans les BTP jusqu'en 1997, est particulièrement éloquent : en 2006, plus de 6700 personnes souffrant de maladies professionnelles liées à l'amiante étaient reconnues par la sécurité sociale, contre un peu moins d'un millier dix ans plus tôt. 3.3- Les Expériences Euro- Africaines dans la Réalisation des Projets d'Adductiond'Eau KAM Oleh (1998), démontre le fait que, la question d'eau potable se pose avec beaucoup d'acuité en milieu rural en Afrique. L'Etat initie des projets d'approvisionnement en eau potable pour palier au double problème de déficit et d'insalubrité. Mais dans la plupart des cas, ces actions de développement se sont soldées par des échecs. Les infrastructures de Haute Valeur Ajoutée (HVA) sont abandonnées par les communautés rurales qui continuent toujours de faire usage de l'eau des puits et marigots. Ses travaux proposent une analyse des causes et des échecs des projets d'approvisionnement du milieu rural en eau potable dans le cadre des projets Nord-Est et TANDA en Côte d'Ivoire. L'analyse est construite à l'articulation de deux grands types de facteurs explicatifs. D'une part, la non-participation des populations rurales à l'installation des infrastructures hydrauliques, et d'autre part la non prise en compte des réalités socioéconomiques et culturelles des communautés 50 rurales bénéficiaires. La problématique soulevée par KAM Oleh en 1998 bien qu'elle porte sur le milieu rural nous semble intéressante dans la mesure où le projet CAMWATER Phase II comporte aussi un volet semi-urbain notamment dans la zone périphérique de Massoumbou où il développe des forages. En plus l'alimentation en eau potable des quartiers non urbanisés comme Mambanda, Village, Soboum et autre rejoint les problématiques du milieu rural. La Banque Européenne d'Investissement (BEI 2012), met en avant son constat qui spécifie que « Un approvisionnement sûr et fiable en eau et la protection des ressources hydriques sont essentiels à la vie des êtres humains et aux écosystèmes. Souvent, la qualité de l'eau et des services d'assainissement est médiocre et les ressources hydriques sont gérées de manière non durable sur les plans économique et écologique ». Les projets dans le secteur de l'eau sont donc essentiels pour la protection de l'environnement et la promotion des collectivités durables. En Moldavie par exemple, sur la partie nord-est du vieux continent, 45 % seulement de la population a actuellement accès à une eau potable. Les eaux usées sont souvent rejetées sans être traitées et de nombreuses personnes doivent consommer de l'eau en bouteille en raison de la pollution fréquente des puits. Grâce au projet pour lequel la BEI a accordé un prêt de 10 millions d'EUR, quelque 200 000 habitants des villes de Ceadir-Lunga, Floresti, Hincesti, Leova, Orhei et Soroca, ainsi que des villages voisins, pourront bénéficier du systèmes d'approvisionnement en eau potable de meilleure qualité. Ce prêt accordé au titre du programme d'investissement dans le secteur de l'eau mené à l'échelle du pays contribuera également à la protection de l'environnement et à la réduction des risques pour la santé publique par la mise en place d'un processus approprié de traitement et d'élimination des eaux usées. Le projet devrait permettre d'améliorer sensiblement la situation environnementale du Prout et du Dniestr et, partant, de la mer Noire. En outre, une meilleure efficacité énergétique pourra être obtenue en procédant au remplacement des équipements devenus obsolètes, tels que les pompes à eau. Le Mozambique en Afrique Australe a bénéficié dans les quartiers très défavorisés des faubourgs de Maputo, la réalisation d'un projet d'adduction d'eau afin d'assurer un meilleur accès à l'eau potable grâce à un prêt de 31 millions d'EUR de la BEI visant à améliorer l'approvisionnement en eau par une augmentation de la production et de l'efficacité du réseau local de distribution. Aujourd'hui, un demi-million d'habitants ont, pour la première fois, accès au réseau d'approvisionnement en eau. 51 Les conditionnalités imposées par l'Union Européenne rendent souvent très difficiles leurs prêts. C'est ainsi que le Cameroun a choisi les prêts de Exim Bank China qui sont plus souples et « gagnant- gagnant » pour le financement du projet CAMWATER Phase II. Toutefois, nos municipalités peuvent s'inspirer de l'exemple de la Moldavie pour le volet assainissement. Car tant qu'on ne mettra pas à Douala un système moderne de « Tout à l'égout » ou qu'on ne multipliera pas des systèmes d'assainissement des eaux usées avant de les verser dans la nature, celles-ci constituerons toujours des dangers pour le réseau d'eau potable. Car les risques de pollution de celle-ci seront toujours présents partout où les tuyaux seraient cassés. 3.4-La Démarche Camerounaise dans la Mise en OEuvre d'une Stratégie Santé-Environnementale pour le Programme de Développement des Zones UrbainesLe Cameroun s'est activé dans le domaine de la gestion de l'environnement en 1996 et a développé sa loi sur les eaux en 1998. Avant cette date, le gouvernement se limitait au contrôle « Comodo-Incomodo » des établissements classés dangereux comme certaines industries, qui utilisent des produits toxiques, inflammables, la dynamite etc... Les problèmes environnementaux étaient confondus avec l'assainissement et relevaient du ministère de la santé publique dans le cadre du Service d'Hygiène Mobile et Prophylaxie (SHMP). Seize ans après en matière de politique il existe encore des lacunes, notamment dans la gestion du risque environnemental. KAMGHO TEZANOU (2008), souligne-le fait que l'eau et l'assainissement sont des éléments essentiels de la vie et leur acquisition reste encore problématique au sein des sociétés africaines en général et au Cameroun en particulier. La question de l'eau pose un double défi, tant pour la gestion durable des ressources que pour l'accès des populations pauvres. Le manque de systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et autres services d'infrastructure entrave considérablement la croissance économique, le commerce et la lutte contre la pauvreté en Afrique. L'objectif de ses travaux était de faire une évaluation a mis parcours de « l'OMD 7 » en rapport avec l'accès à l'eau et à l'assainissement afin que des actions ciblées soient prises en compte par les pouvoirs publics du Cameroun pour l'atteinte de celui-ci à horizon 2015.La pertinence de cette étude était circonscrite au tour de l'évaluation du niveau actuel d'accessibilité à l'eau potable et à l'assainissement, l'analyse de la politique du pays en la matière pour voir à quel niveau elle on se situe , mesurer le gap entre le niveau actuel et la cible de 2015 et la recherche des contraintes pour l'atteinte de cet 52 OMD ainsi que la proposition des mesures concrètes à prendre pour l'atteinte de cet objectif. Kamgho Tezanou fait alors un bilan du système en place à travers le rôle des stratégies nationales dans la promotion de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Il va plus loin en soulignant le fait que il serait urgent de favoriser une gestion plus rationnelle des ressources naturelles dont (l'eau) et d'améliorer l'efficacité des projets d'eau au Cameroun. Les conclusions de cette étude nous semblent d'actualité puis qu'en fin 2014 les OMD dans le secteur de l'eau potable ne sont pas toujours atteints et pour ce qui nous concerne le projet CAMWATER Phase II viendrait en poursuite de l'objectif de cette stratégie. Le Plan D'Action National de Gestion Intégrée Des Ressources en Eau (PANGIRE) de Décembre 2009 fait un état des lieux du secteur de l'eau et de l'environnement au Cameroun. Ledit document a été réalisé sous la conduite des opérations du Global Water Patnership Cameroon, dans le cadre du programme Patnership for Africa's Water Development (PAWD) et sous la tutelle du Ministère de l'Energie et de l'Eau (MINEE). L'objectif général de cette étude est de faire une analyse diagnostique de l'eau et l'environnement dans les différents bassins hydrographiques du Cameroun. De manière spécifique, le travail vise à : identifier et cartographier les zones humides et les zones à écologie fragile ; identifier et analyser les défis liés à l'eau tels que la désertification et les inondations ; identifier et analyser les effets de l'anthropisation (urbanisation, industrialisation, exploitation minière, agriculture, déforestation, élevage, pêche, travaux publics, énergie, barrages, conflits armés et guerres, voies de communications et transports, tracé de Pipelines, etc.) sur les ressources en eau ; identifier et examiner l'impact de la variabilité et du changement climatique sur les ressources en eau ; identifier et analyser les mesures prises par l'Etat camerounais face aux risques liés à l'eau, et au changement climatique ; élaborer et hiérarchiser les problèmes liés à la protection et à la conservation des ressources en eau au Cameroun. Pour mener à bien ce travail, la démarche méthodologique adoptée a consisté à la recherche documentaire et cartographique, au traitement et à l'analyse des informations obtenues et enfin à l'identification et à la hiérarchisation des problèmes de ressources en eau au Cameroun. Des descentes sur le terrain ont été effectuées dans différentes régions du Cameroun et auprès des diverses structures en charge de la gestion de l'eau. Plusieurs ateliers de travail ont été aussi organisés de manière participative aux fins d'enrichissement des rapports et la hiérarchisation des problèmes liés aux ressources en eau dans différents bassins versants du Cameroun. Les informations recueillies (documentaire et cartographique) ont été 53 ainsi validées par l'équipe GIRE et rassemblées par bassin hydrographique. La finalité est de prendre en compte les problèmes hiérarchisés afin que le Gouvernement par le Ministère de tutelle (MINEE) associé à d'autres ministères concernés dans le cadre d'un travail de réflexion sectoriel puissent trouver des solutions à chaque problème défini. Malgré les dispositions réglementaires précitées, de nombreuses lacunes subsistent d'une part au niveau de l'observation des règles d'hygiène à cause de la vétusté des textes qui sont largement dépassés et n'ont aucun effet contraignant et d'autre part, aux difficultés rencontrées par les agents chargés des inspections de l'hygiène publique, des agents assermentés (contrôle qualité de l'eau) en vue d'amener les contrevenants à répondre de leurs actes illicites conformément aux textes en vigueur. Il est par exemple regrettable de constater que dans les quartiers d'habitat sauvage, les distances entre les puits (source d'eau) et les points d'assainissement des eaux usées, réseaux d'égouts et autres (latrine et WC) ne sont généralement pas respectés (05m à 10m). Ceci a des conséquences importantes sur la qualité de l'eau. L'environnement est alors marqué par la prédominance des maladies hydriques (choléra, dysenterie, amibes, diarrhées ...). Il est également important de souligner le fait que le cadre institutionnel, législatif et réglementaire de la gestion du secteur de l'eau et de l'assainissement manque relativement d'efficacité à cause de la diversité des acteurs institutionnels et des préoccupations parfois contradictoires des uns et des autres. C'est la raison qui aurait amené le législateur camerounais à opter pour une politique sectorielle de la gestion de cette ressource naturelle. Toutefois, il est évident de constater aujourd'hui qu'en plus de cette dispersion sectorielle des énergies pour la gestion de l'eau, la décentralisation de ce qu'on appelait jadis le « Service d'Hygiène Mobile et Prophylaxie » qui était géré par le Ministère de la santé publique est actuellement confié aux communes sans une organisation adéquate et une délégation de moyens financiers suffisants. Ceci est une entorse grave à la politique nationale de gestion du système d'assainissement des eaux et de l'environnement dans son sens général car, pour ce cas précis, le mot décentralisation ne devrait pas être un simple slogan politique mais une stratégie de rapprochement effective des décisions administratives près des administrés. Ainsi les projets de développement dans un secteur sensible comme celui de CAMWATER Phase II qui vise à améliorer la quantité et la qualité de l'eau de boisson dans les zones urbaines et périurbaines de Douala a du mal à s'intégrer dans l'esprit des populations notamment quand il s'agit d'expliquer qu'il faudrait assainir les trottoirs et 54 autres emprises des routes sur le tracé des nouvelles canalisations pour renfoncer le réseau d'eau existant et maintenir ces espaces très propres. Un rapport sectoriel des Ministères de l'Environnement et la Santé Public de Janvier 2010 intitulé : Rapport de l'Analyse Situationnelle et Estimation des Besoins dans le Domaine de la Santé et l'Environnement au Cameroun, démontre le fait que en prenant en compte séparément les deux secteurs, on constate que certains plans nationaux de développement sanitaires considèrent les questions de l'environnement, alors que dans le Plan National de Gestion de l'Environnemental (PNGE) les problèmes de santé ne sont pas abordés de manière explicite. Cela traduit davantage l'absence de lien formel entre les deux secteurs au plan administratif. Cette situation est d'autant plus paradoxale que la santé est tributaire de déterminants environnementaux. Dans ce contexte, l'Analyse de la Situation et l'Estimation des Besoins (ASEB), outil de diagnostic de l'OMS qui a permis d'énumérer bon nombre de déterminants environnementaux et sanitaires, apparait comme une réponse à l'interface Santé-Environnement et justifie actuellement une prise de conscience du Gouvernement. De plus en plus, de nouvelles lois, décrets et arrêtés existants tant au niveau de la santé que de l'environnement justifient une véritable mobilisation nationale et la volonté des pouvoirs publics à prendre en compte les problèmes conjoints Santé-Environnement. Ceci traduit l'engagement du Cameroun à s'arrimer aux exigences internationales en matière de développement, de préservation de l'environnement et de promotion de la santé. Ainsi, le pays est partie prenante dans plusieurs conventions, traités, accords et déclarations telle que celle de Libreville qui est à la base du rapport suscité. Néanmoins, la faiblesse de l'intégration Santé-Environnement prend une toute autre ampleur lorsqu'on analyse les documents transversaux comme le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté(DSRP) et le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi(DSCE). L'Analyse Stratégique d'Estimation des Besoins (ASEB) a établi que ces documents ne prennent pas simultanément en compte les problèmes de Santé-Environnement. De ce fait, on note une évolution cloisonnée des programmes qui en découlent. Il souligne notamment par le biais d'un constat les difficultés rencontrées dans le développement du secteur Santé-Environnement tels que l'absence de textes d'application dans certains cas, l'inopéralisation de certains organismes crée pour aider l'Etat, l'irrespect des textes existants, l'insuffisance de communication de masse, l'insuffisance en ressources humaines et l'insuffisance de plaidoyers. 55 En définitive, les forces et les faiblesses du lien Santé-Environnement au Cameroun ont amené le Groupe National de Travail(GNT) à proposer comme priorités nationales, les actions suivantes: Mettre en place une alliance stratégique Santé-Environnement comme base d'un plan d'action concertée (Action prioritaire 1) ; Assurer l'intégration des objectifs Santé-Environnement en mettant en oeuvre les programmes prioritaires intersectoriels en vue d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (Action prioritaire 2) ; Développer les capacités nationales, pour mieux prévenir les maladies liées à l'environnement à travers l'établissement ou le renforcement des institutions s'occupant de la santé et de l'environnement (Action prioritaire 3) ; Soutenir l'acquisition et la gestion des connaissances sur le concept Santé-Environnement par la promotion de la recherche appliquée au niveau local, la coordination des publications scientifiques et techniques afin d'identifier les déficits de connaissance, la définition des priorités de recherche, et le soutien à l'éducation et à la formation (Action prioritaire 4) ; Mettre en place et renforcer les systèmes de surveillance de Santé-Environnement pour identifier les effets et risques conjoints, afin de mieux les gérer (Action prioritaire 5) enfin Promouvoir l'équilibre dans l'allocation des ressources budgétaires nationales en faveur des programmes Santé-Environnement (Action prioritaire 6). La Stratégie Nationale D'Assainissement Liquide d'Août 2011, a été préparée par le Gouvernement du Cameroun grâce à un financement du Fonds fiduciaire du Programme « Partenariat sur l'Eau » administré par la Banque mondiale. Ce rapport résume les conclusions des diagnostics des aspects techniques institutionnels et financiers qui sont disponibles sur demande. Les propositions principales de la Stratégie ont été validées au cours de deux ateliers nationaux en octobre 2010 et janvier 2011. Elle a pour objectif d'augmenter le taux de couverture nationale de 34% en 2010 à 57% en 2020. Cette amélioration ne sera pas simplement une contribution à la qualité de la santé publique des populations camerounaises, mais aussi et surtout un pas important pour le cadre de vie et l'environnement de ces populations. Dans les grandes lignes de la stratégie, un rappel de l'évolution dans l'alimentation en eau potable est fait. Elle précise que en zone urbaine, selon les données du Joint Monitoring Program (JMP) /WHO, le taux de couverture aurait évolué de 77% de1990 à 92% en 2008 se traduisant par une augmentation de la population desservie de 3.8 millions à près de 10.0 millions. Mais en 2008, seulement 25% de la population urbaine était alimentée par branchement particulier, une proportion comparable à celle de 1990. En zone rurale, le taux 56 de couverture serait passé de 31% à 51% entre 1990 et 2008. Le Gouvernement a engagé depuis 2005 une réforme du secteur de l'alimentation en eau potable en zone urbaine (paragraphe 26). En zone rurale, l'alimentation en eau est assurée par des puits et forages équipés de pompes à motricité humaine et par quelques 370 réseaux de distribution ruraux en cours de réhabilitation (systèmes « Scan water »). Les communes sont depuis 2010 maîtres d'ouvrage et exploitent des installations qui ne font pas partie du périmètre de concession de CAMWATER, sauf accord de cette dernière. Ces installations demeurent cependant dans le domaine de l'Etat. Dans son volet Organisation et Fonctionnement du Secteur de l'Assainissement Liquide, la stratégie souligne le fait que le document de « Stratégie pour la Croissance et l'Emploi » (DSCE) élaboré par le Gouvernement en 2009 dans le cadre de sa politique de réduction de la pauvreté précise comment les « Objectifs du Millénaire pour le Développement - OMD » doivent être atteints. Le DSCE prévoit de « réaliser à l'horizon 2019 l'ensemble des OMD » et plus particulièrement en matière d'assainissement « d'assurer un environnement durable en réduisant de moitié la proportion de la population n'ayant pas accès à l'eau potable, en améliorant sensiblement l'habitat, en intégrant les principes de développement durable dans les politiques nationales et en inversant la tendance actuelle de la déperdition des ressources environnementales » Les OMD devaient être atteints en 2015 ! La projection du gouvernement à 2019 impliquerait donc un retard de quatre ans qui risque d'être dommageable sur les autres secteurs du développement économique et social. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet D'Assainissement des Eaux Usées au Cameroun dans son Rapport final de Mai 2011, avait pour objectif d'établir un processus de sélection environnementale et sociale qui permettra aux structures chargées de la mise en oeuvre du Projet de pouvoir identifier, évaluer et atténuer les impacts environnementaux et sociaux potentiels des activités du projet au stade de planification et de l'exécution. Le CGES est conçu comme étant un mécanisme d'identification préalable des impacts environnementaux et sociaux des investissements et activités dont les sites/localisations sont inconnus avant l'évaluation du projet. Il se présente donc comme un instrument permettant de déterminer et d'évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels. En outre, le CGES devra définir le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les dispositions institutionnelles à prendre avant, pendant et après la mise en oeuvre du projet et la réalisation des activités pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. 57 Selon certaines précisions faites par Geofor en 2012, lors de la conception et de l'exploitation des infrastructures d'alimentation en eau potable, l'opérateur doit tout mettre en oeuvre pour conserver la qualité de l'eau depuis la sortie du site de production jusqu'au robinet de l'usager. D'où la nécessité d'une gestion prudentielle. Aussi, la nature du revêtement des cuves de stockage d'eau potable constitue un problème majeur, en particulier sa résistance, sa compatibilité avec les caractéristiques de l'eau et, plus important encore, sa conformité sanitaire. A la base, le revêtement de la cuve doit répondre aux critères suivants pour qu'il puisse préserver la qualité de l'eau stockée :étanche à l'eau, faible rugosité, faible porosité, forte compacité, résistant à l'abrasion, entretient facile . Les Agences de l'Eau dans la fiche pays : Cameroun de Mars 2013, font une analyse sur les principaux outils de programmation existants en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement au Cameroun. Cette analyse indique que depuis 2005, le Cameroun s'est doté d'un Plan d'Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE), cadre de référence élaboré suivant les principes de gestion intégrée des ressources en eau. En ce qui concerne l'hydraulique rurale, une politique nationale définissant des principes d'intervention a été élaborée avec le soutien financier de l'Agence Française de Développement (AFD). En l'absence de ressources financières suffisantes, ce document n'a cependant pas initié de réforme notable du secteur. La lettre de politique sectorielle d'hydraulique urbaine, élaborée en 2007, définit les engagements des autorités en matière d'hydraulique urbaine. L'intervention de la République populaire de Chine et notamment d'Exim Bank of China arrivent donc à point nommé dans un contexte où le Gouvernement du Cameroun cherchait les voies et moyens pour augmenter la fourniture en eau potable à la ville de Douala. D'où le projet CAMWATER Phase II qui nous occupe dans cette étude. Selon le Rapport Annuelle de 2013 du Projet de Développement des secteurs Urbains et de l'approvisionnement en Eau (PDUE), le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) publie dans son site internet des remarques pertinentes à prendre en compte .En effet, il ressort de ce rapport de 2013 les conclusions suivantes : Avec un taux d'engagement financier d'environ 63,84% (85,22% pour le volet urbain et 33,06% pour le volet eau) et un taux de décaissement sur l'ensemble du projet (financement d'origine + financement additionnel) évalué à 47,63% (59,07% pour le volet urbain et 33,06% pour le volet Eau), contre 40,69% en fin 2012, le projet atteint ainsi un taux sensiblement égal aux prévisions. Le processus de passation des marchés est en cours pour de nombreux contrats relatifs aux activités des composantes 1 et 3, ce qui permettrait d'atteindre 58 le taux d'engagement de 95% au premier trimestre 2013. Ainsi, en fin 2013, l'on pourrait juger de modérément satisfaisant le niveau d'avancement global du PDUE. Par ailleurs, il est à souligner que, la situation d'exécution du partenariat public-privée du secteur de l'eau reste toujours préoccupante. En effet, après six ans de mise en oeuvre de cette composante, le taux d'engagement des fonds à elle alloués n'est que de 36,60% au 31 décembre 2013, pour un taux de décaissement de 33,06%. L'exécution de cette composante en 2013 n'a pas permis de réduire le gap entre les résultats atteints et les objectifs escomptés. La mise en oeuvre de cette composante accuse un retard, aussi bien en ce qui concerne les branchements et les réhabilitations que les extensions des réseaux. Des mesures urgentes s'avèrent indispensables pour, non seulement accélérer l'exécution des activités, mais aussi assurer l'équilibre financier du secteur. En ce qui concerne le volet eau, le nombre de branchements réalisés par l'opérateur CDE depuis le début du projet est de 18 854 branchements en fin 2013, pour l'ensemble du pays dont 4660 branchements en 2012, 4606 branchements en 2011, 5494 en 2010, 4094 branchements en 2009 (ce qui représente moins de la moitié de l'objectif de 2009 et 2013). Le niveau d'avancement de cette composante est à cet effet, jugé modérément insatisfaisant par la banque. 3.5- Stratégie de la ville de Douala face à la problématique de la gestion de l'environnement et l'approvisionnement en eau potable :« Agenda 21 Local de la ville de Douala » qui cadre avec les objectifs du plan de développement de la ville pour 2025 s'appuie sur les objectifs du millénaire et de l'Agenda 21 pour le développement document mondial produit à la sortie du sommet de la terre à Rio le 14 juin 1992. En s'inspirant du PROGRAM AGENDA 21 adopté lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de Rio de Janeiro en son chapitre 28, article 28.3, 3qui prescrit «qu'il faudrait que toutes les collectivités locales instaurent un dialogue avec les habitants, les organisations locales et les entreprises privées afin d'adopter un programme Action 21 à l'échelon de la collectivité. La concertation et la recherche d'un consensus permettraient aux collectivités locales de s'instruire au contact des habitants et des associations locales, civiles, communautaires, commerciales et industrielles, et d'obtenir l'information nécessaire à l'élaboration des stratégies les plus appropriées ». La CUD s'est engagé « dans une démarche de développement durable motivée par quatre raisons : une conscience du devoir de faire face à des enjeux internationaux de 59 première urgence ; une volonté de répondre à des enjeux locaux et de satisfaire certaines aspirations profondes d'un nombre croissant de nos concitoyens ; la nécessité de répondre aux obligations et incitations de l'État, en particulier pour les pays et les agglomérations; la perspective de tirer des bénéfices directs et indirects de la démarche ». Plusieurs motifs ont servi d'arguments à la ville de Douala qui, au niveau de la Communauté Urbaine a décidé de procéder à l'élaboration d'un tel projet : ? Donner de la cohérence et de la lisibilité à l'action municipale, en examinant tous les dossiers, en se posant les questions sur leur pérennité, et sur leur impact en matière économique, sociale et environnementale ; ? Légitimer, voire institutionnaliser des pratiques existantes, en particulier au travers des communes, associations, chefferies, représentants des collectivités... ; ? Fédérer l'action des citoyens de la métropole de Douala autour d'un projet partagé. Ainsi, les élus espèrent répondre à la demande exprimée par la population pour faire face aux problèmes de la pénurie en eau potable. Dans le cadre de l'Agenda 21 de la ville de Douala, l'étude a relevé que pour que l'action soit effective et que la mise en oeuvre de la démarche pour la gestion des risques environnementaux au sein du projet soit réalisable , il faudra : la mobilisation des acteurs ; faire un diagnostic du territoire basé sur le développement durable ; définir une stratégie locale de développement durable ; proposer des mesures correctrices ; mettre en oeuvre des actions ; faire une promotion ; pérenniser et établir un suivi-évaluation permanent ; Lutter contre les causes et les effets du changement climatique ; protéger la biodiversité et préserver les ressources en eau ; agir pour un environnement respectueux de la santé ; intégrer les populations les plus sensibles et améliorer leurs conditions de vie ; sensibiliser, informer, éduquer au développement durable et développer de nouvelles formes de gouvernance ; développer les coopérations internationales et la solidarité nord-sud. Tous ces thèmes ont été abordés dans l'Agenda 21 de la ville de Douala. Ce document démontre la complexité du système de gestion de l'environnement à Douala et la nécessité de le rendre durable « pour les générations futures sans compromettre les opportunités des générations actuelles ». L'approche de l'Agenda 21 local de Douala sur les aspects relatifs à la gestion du risque environnemental et l'eau potable comme ressource naturelle met en exergue cinq facteurs déterminants susceptibles de contribuer activement à une gestion durable de l'eau potable et de l'environnement en général à Douala. Ces facteurs sont : 60 ? La Réduction de la consommation de l'eau des parcs et jardins. ? La Réduction de la consommation de l'eau dans les bâtiments et infrastructures de la ville. ? La Prévention et réduction du risque écologique. ? [a Généralisation de l'accès à l'eau potable. ? [a Réglementation de l'utilisation des puits et forages. Afin de réduire la consommation de l'eau des parcs et jardins, il est question ici avant tout de réduire les prélèvements d'eau dans les nappes profondes pour que les eaux destinées à l'arrosage soient plus disponibles. Il est important d'adopter un mode d'arrosage économe. Les mesures proposées sont : de mettre en place des bassins au sein des parcs et jardins pour réduire l'utilisation de l'eau du réseau courant de la CDE ; créer des points de captage sur les cours d'eau urbains existants lorsque la qualité de leur eau peut permettre l'arrosage des plantes ou d'utiliser celle de la nappe phréatique en créant des puits. Pour ce qui est de la réduction de la consommation d'eau dans les bâtiments et infrastructure de la ville, il est question de mettre en place les moyens de détection des fuites d'eau dans les bâtiments et autres installations publiques ; créer des points de puisage et les indiquer par une signalétique spécifique et réduire considérablement la réalisation des forages profonds pour des besoins de « Car Wash » et d'utilisations autres que la consommation ménagère et industrielle. La prévention et la réduction du risque écologique facteur important à prendre en compte insiste sur le fait que il serait urgent d'inventorier par cartographie les différentes zones à risque ainsi que le type de risque à survenir afin de proposer un plan global de restructuration des zones à risque et des site écologiques fragiles dans la ville. La généralisation de l'accès à l'eau potable pour être effective à Douala devrait prendre en compte les aspects tels que : l'accompagnement de tous les acteurs dans la modernisation et l'extension du réseau d'adduction d'eau potable à l'ensemble de la ville de Douala, la facilitation du processus d'abonnement en vue du branchement des ménages au réseau d'adduction d'eau, la réactivation des projets d'accès à l'eau pour tous à travers la réouverture des bornes fontaines publiques dans les quartiers populaires et difficiles d'accès. Associer à l'accès à l'eau potable, la réglementation dans l'utilisation des puits et forage. Il serait question ici d'appliquer la règlementation sur la gestion des forges, assurer le suivi de la redevance liée au prélèvement de l'eau, placer des compteurs dans les forages des grandes 61 industries pour mesurer les prélèvements à taxer et fixer selon les types d'activités des quotas annuels ou mensuels de prélèvement au-delà desquels des pénalités seront fixées. Elaborée en Décembre 2009, la Stratégie de Développement de la ville de Douala et de son aire Métropolitaine comportait certains axes majeurs d'intervention des municipalités de l'aire métropolitaine, des différents partenaires- institutionnels de développement, des privés et de la société civile - visant à : renforcer l'attractivité et la compétitivité de la ville de Douala ; à créer les conditions de la croissance d'un pôle économique sous-régional compétitif, capable d'attirer les investisseurs et promouvoir de nouvelles activités ; améliorer la gouvernance urbaine à travers notamment un cadre institutionnel rénové et adapté au contexte ; améliorer les conditions de vie des populations pauvres notamment à travers l'accès aux besoins primaires (eau, électricité, éducation...).associer à cela la dynamisation du secteur informel dans le sens d'une augmentation des bénéfices individuels et collectifs qui peuvent en être tirés par des mesures d'accompagnement appropriées. Une attention particulière serait également portée aux dysfonctionnements qui entravent l'accès des populations à la sécurité foncière et favorisent en conséquence la précarité de l'habitat. Pour y'arriver, les axes stratégiques consistaient à un ensemble d'actions d'amélioration des équipements et des infrastructures (en intégrant ceux déjà en cours ou envisagés), des mesures réglementaires et d'amélioration de la gouvernance. Cette stratégie se situe dans le cadre général des efforts faits par le Cameroun pour réduire la pauvreté tel que présentés dans le rapport final de la CUD faisant le bilan de 2007 à 2012. Le Rapport final du « Plan Directeur d'Urbanisme de Douala à l'horizon 2025 » a été préparé par le Groupe Huit / AS Consultants1 en synergie avec l'équipe de la Direction des Etudes de la Planification Urbaine et du Développement Durable (DEPUDD) de la Communauté Urbaine de Douala. Les diagnostics, orientations et recommandations déroulés dans ce document sont issues de plusieurs missions sur le terrain (organisées entre novembre 2010 et février 2012) et la revue de nombreuses études : les Documents Stratégiques du Gouvernement, la Stratégie de développement de la Ville de Douala et de son aire métropolitaine, le Schéma directeur d'assainissement, le Plan directeur des déplacements, l'Etude sur la valorisation du patrimoine culturel, le Schéma directeur portuaire, le Schéma directeur ferroviaire, le Schéma d'aménagement et d'urbanisme (1983) ... L'élaboration du PDU a également bénéficié des remarques formulées par les Autorités et les représentants de la population ayant participé aux principales « réunions de restitution ». 62 En définitive, sur le plan global, les cinq thématiques de la revue de littérature définies par l'étude pour explorer le modèle de gestion de l'environnement, le management des risques et l'eau comme ressource naturelle dans une approche transversale et pluridisciplinaire de la gestion des programmes et projets de développement en milieu urbain examinés ici de manière sommaire, reflèteraient la pertinence et l'opportunité de notre travail. A cet effet, la revue de littérature avait pour objectif de mettre à vue les politiques et pratiques des acteurs du domaine pour mieux comprendre à quel type de répercussion le monde, l'Afrique, le Cameroun et Douala plus particulièrement on doit faire face si le volet environnement est toujours aussi marginalisé et si des actions promptes des institutions concernées ne sont pas effectuées afin de réguler et d'améliorer l'accès à « la vie par l'eau potable » indispensable pour le bienêtre des citoyens. Cette approche est circonscrite dans un système de gestion caractérisé par une forte disparité et incongruité dans les pratiques des acteurs. C'est la raison pour laquelle la revue de la documentation des institutions internationales, nationales et académiques (scientifiques) nous montre combien il serait urgent de continuer la réflexion à tous les niveaux pour garantir et sécuriser d'avantage l'approvisionnement des populations en qualité et quantité d'eau potable par la maitrise du couple Santé-Environnement indispensable pour la vie. On peut donc dire qu'il existe bel et bien une base juridique solide pour la gestion de l'eau au Cameroun et qui est conforme à la volonté et aux aspirations de la communauté internationale. Mais est-ce à dire qu'il y a lieu d'affirmer que notre pays applique rigoureusement toutes ces lois et politiques, notamment en ce qui concerne la gestion de l'environnement, l'assainissement et la gestion des ressources en eau, l'hygiène du milieu pour la santé des citadins et la sécurité des aliments ... ? Il y a lieu d'en douter de par la prévalence accrue des maladies hydriques dans nos cités, la persistante des ventes illicites des eaux aux qualités douteuses, l'augmentation du taux de population qui non pas accès à l'eau potable, les pratiques à risque dans le cadre de la mise en oeuvre d'un réseau d'alimentation en eau potable et bien d'autres problèmes non négligeables. Cependant, on ne peut pas dire que rien n'a été fait au plan politique pour faire face à la situation au Cameroun et notamment à Douala. Le projet CAMWATER Phase I et II en est une preuve audacieuse et convaincante. 63 4- CONSTRUCTION DE L'OBJET D'ETUDE4.1- ProblématisationCette étude est fondée sur un questionnement sur l'environnement dans l'exécution d'un projet d'adduction d'eau potable en milieu urbain. Notre démarche comprend cinq parties à savoir : le constat, le référentiel, l'exposition du problème de recherche ; le débat autour des enjeux et l'identification des items du problème de recherche. 4.1.1- ConstatEn effet, l'étude révèle une complexité du problème qui se situe au niveau du développement des infrastructures d'eau potable adéquates pour une ville en développement rapide, caractérisée par une croissance démographique soutenue et des problèmes d'assainissement avec pour conséquence une prévalence importante des maladies hydriques souvent causées par la consommation des eaux souillées ou de qualité douteuse (PDU, 2011). Associer à cela, des actions irrationnelles des populations riveraines des canalisations qui souvent par des actes de vandalisme cassent les tuyaux d'alimentation en eau potable, développent des pratiques non-sanitaires autour des points d'approvisionnement en eau... ; des pratiques des acteurs du projet souvent négligentes des aspects santé et sécurité au travail et des institutionnels du secteur de l'eau passives dans l'application de la réglementation en vigueur. Le constat s'étend également sur une certaine absence de la rigueur dans l'application de la norme ISO : 31000 version 2009 portant sur les lignes directrices du management des risques en entreprise. Ce qui expliquerait la passivité dans la mise en oeuvre des mesures opérationnelles de gestion du risque. Tout ceci augmente le capital risque environnemental au sein dudit projet. 4.1.2- RéférentielComme référentiel, nous nous sommes focalisé sur l'exploitation des documents internationaux tels que les normes ISO : 31000 versions 2009 portant sur les lignes directrices du management des risques en entreprise, ISO 14001 et 9001 version 2008 sur le Management Environnemental et la Qualité respectivement mais aussi sur la norme ISO 18001 portant sur la Santé et Sécurité au Travail. 64 A cela nous avons associé des documents nationaux tels que le Plan de Gestion Intégrée des Resource en Eaux (PGIRE), la stratégie de la ville de Douala pour l'implémentation du trio « Sécurité-Santé-Environnement » à l'instar du PDU et l'Agenda 21 de la ville. Enfin pour mettre en évidence le contexte scientifique de cette étude, des articles et mémoires soutenus dans divers universités relevant du domaine Santé-Environnement plus particulièrement ceux qui concernent la gestion environnementale dans l'adduction d'eau potable ont retenu particulièrement notre attention. 4.1.3- Problème de RechercheIl repose sur deux paradigmes : le pourquoi des choses et le comment des choses tel que préconiser par MADELEINE GRAWITZ (1993) dans « Méthode des sciences sociales ». Des 8 types de problèmes de recherches élaborées par GRAWICH, nous nous sommes focalisé sur le 3ème portant sur le problème de l'étude de cas. Projet structurant de grande envergure dans le secteur de l'eau au Cameroun, CAMWATER Phase II à Douala dans le but d'augmenter la capacité d'offre en eau potable de 150 000m3 / jour à 250 000m3 /jour repose sur une base Sécurité-Santé-Environnement à remettre en cause. En fait le « trio » met en exergue le « facteur risque » au sein du projet au plan politique, économique, écologique, sociale et sécuritaire. Cette étude pose dès lors le problème de : gestion des risques environnementaux dans un projet d'adduction d'eau potable dans une ville du littorale Camerounais comme Douala. 4.1.4- Débat Autour des EnjeuxLe risque étant défini comme la probabilité d'occurrence d'un événement et de ses conséquences négatives (Norme ISO / IEC Guide 73) est le phénomène majeur qui précède le danger. Autrement dit, le risque met en exergue les signes avant-coureurs d'un évènement dangereux sur l'environnement. Son management a pour objectif premier de protéger la santé humaine (BOLDUC, 2003). Dans le cadre de la réalisation des projets de développement, notamment ceux du secteur de l'approvisionnement en eau potable, le trio « Santé-Sécurité -Environnement » prend de plus en plus d'importance. Il convoque un certain équilibre entre les aspects économique, social et écologique au niveau des espaces où sont réalisés ces projets. 65 Les phénomènes anthropogènes sont généralement pour la majorité des situations l'instigateur des risques sur l'environnement. Ils déterminent la contribution des pratiques des acteurs des projets sur l'environnement immédiat. Par conséquent, il s'avère que la composante de l'écosystème est la plus vulnérable. « Nos concitoyens exigent naturellement une protection contre la mort, mais aussi contre la maladie et l'inconfort. Dans ces conditions, l'impact sur la santé fait désormais l'objet d'une exigence accrue » MATTEI, J-F (1996). L'importance et l'enjeu autour de cette thématique de : gestion du risque s'est vue proposée le terme « riscologie » pour les études générales et scientifiques des risques par Georges JOUSSE en 2004. La pertinence de son concept a élargi son champ d'action par des théories politique, économique, mathématique, sociale, industrielle et technique qui désormais se sont centrées sur l'environnement qui englobe toutes ces disciplines. Cette science de gestion des risques a donc servi d'inspiration pour la mise en oeuvre d'une norme ISO : 31000 sur les principes et les lignes directrices du management des risques ainsi que les processus de mise en oeuvre au niveau stratégique et opérationnel. Du point de vue de l'entreprenariat, elle propose un cadre organisationnel, un processus de management, une conduite stratégique et opérationnelle pour la prise en compte du risque dans les institutions. C'est une approche globale. Le développement d'un cycle de gestion des risques et catastrophes en trois phases établit par Si Mohamed BEN MASSOU (2010), met en exergue une approche dynamique de suivi du risque par des phases de prévention, de réaction et d'apprentissage. Ainsi, les risques environnementaux seront gérés avec beaucoup plus d'efficacité. La mise en oeuvre d'un système de prévention des risques basé sur des outils tel que des cadres de politique de gestion, des cartographies et autres techniques d'analyse appuyées par de solides bases juridiques faciliteront l'identification, la classification, l'évaluation et le suivi opérationnel des risques (UVED,2010) La prise en compte des risques environnementaux pour ce qui est des projets d'adduction d'eau potable est indispensable car elle serait un facteur déterminant dans la réduction de l'occurrence de certains dangers tels que la pollution des eaux produites et distribuées à la population, la prévalence des maladies hydriques, la collision des réseaux aéro-souterains ... Dans la perspective de garantir la potabilité pour préserver la santé humaine et la qualité des écosystèmes en général, il est indispensable de déterminer des stratégies de gestion des risques environnementaux spécifiques au système d'approvisionnement en eau potable à l'échelle mondial (BOLDUC, 2003). 66 La problématique de la gestion du risque environnemental deviendrait donc un sous Àensemble de l'approvisionnement en eau potable et l'enjeu d'une question de conscience des acteurs et des populations bénéficiaires. 4.1.5- Identification des Items du Problème de rechercheQuatre items du problème de recherche ont été identifiés à savoir : > La politique de gestion des risques environnementaux. > Les pratiques des acteurs en la matière. > Les répercussions des pratiques des acteurs sur l'environnement immédiat. > La stratégie intégrée. 4.2- Les Questions de Recherche :Il est question de présenter les différentes questions qui serviront d'axes thématiques pour la réalisation de notre étude. Pour se faire, nous avons distingué deux types de questions : la question principale et les questions spécifiques. 4.2.1- Question Principale :La gestion des risques environnementaux contribue-t-elle à l'atteinte des objectifs du projet CAMWATER Phase II à Douala? 4.2.2- Questions Spécifiques :> Existe-t-il une politique de gestion des risques environnementaux pour le projet CAMWATER Phase II ? > Les pratiques des acteurs concourent-elles à réduire l'occurrence des risques environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II? > Quels sont les impacts des pratiques des acteurs sur l'environnement immédiat des sites du projet? > L'élaboration d'une stratégie intégrée régulera-t-elle le phénomène de risque environnemental au sein du projet CAMWATER Phase II ? 4.3- Hypothèses de Recherche4.3.1- Hypothèse Principale :La gestion des risques environnementaux contribue considérablement à l'atteinte des objectifs du projet CAMWATER Phase II. 67 Hypothèses Spécifiques : > l'Application de la politique de gestion des risques est un facteur contraignant du système de management environnemental au sein du projet. > Les pratiques des acteurs sont un facteur déterminant dans la réduction de l'occurrence des risques environnementaux au sein du projet. > l'Impact des pratiques de certains acteurs sur l'environnement immédiat contribue à la naissance des risques environnementaux au sein du projet. > La mise sur pied d'une stratégie intégrée est un moyen de réguler le risque environnemental au sein du projet. 4.4- Les Objectifs de l'Etude :4.4.1- L'objectif Principal :Analyser le système de gestion des risques environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II à Douala. 4.4.2- Les Objectifs Spécifiques :> Evaluer le cadre politico-institutionnel du management environnemental des risques au sein du projet CAMWATER Phase II. > Examiner les pratiques des différents acteurs dans la gestion des risques environnementaux avant, pendant et après le projet. > Spécifier les conséquences qu'ont les pratiques des acteurs sur l'environnement immédiat du projet > Modéliser un Plan de Gestion du Risque Environnemental (PGRE) pour le projet .global d'adduction d'eau potable à Douala. 68 Tableau 3 : Synthèse des questions, hypothèses et objectifs de recherche
69 5- INTERET DE L'ETUDE
? Faire comprendre le bien-fondé de la notion de prudence environnementale et le management des risques environnementaux à travers la stratégie intégrée (PGRE) définie dans cette étude pour des programmes de développement tel que celui de l'alimentation en eau potable et bien d'autres encore. 5.2- Intérêt Professionnel? Permettre une meilleure visibilité de la ville de Douala par le projet principal d'adduction d'eau potable de CAMWATER en concordance avec les objectifs du millénaire où le besoin de réguler le déficit en eau potable est primordial. ? Permettre la valorisation de la médiation sociale et ses nombreuses actions (sensibilisation, information, identification des obstacles, concertation publique ...) développées dans le cadre de ce projet par A2D pionnière dans le domaine à Douala dans le cadre des projets structurants de grande envergure. CONCLUSIONA travers la revue de littérature de cette étude, il apparait que la gestion des ressources naturelles comme l'approvisionnement en eau potable, est effectivement au centre des préoccupations des communautés humaines au niveau mondial, Africain, et même Camerounais. Elle fait l'objet de nombreux travaux qui mettent en exergue le couple Santé-Environnement et orientent les efforts de la recherche vers la complexité des risques environnementaux liés à la mise en oeuvre des projets de développement. Ces risques varient en fonction des aspects financier, technique et industriel. Dans cette optique, les aspects théoriques ci-dessus étudiés nous ont permis d'avoir une vue large et une meilleure compréhension de l'objet d'étude afin d'élaborer une méthodologie de recherche adéquate, susceptible de nous permettre d'obtenir des résultats fiables. 70 CHAPITRE II : LA METHODOLOGIE DE RECHERCHEINTRODUCTIONDès lors qu'on parle de la recherche, la première idée qui vient à l'esprit est celle de la méthode et la première question que nous nous posons est de savoir comment allons-nous procéder pour pouvoir avancer. Ainsi, nous partons des constations empiriques qui en Géographie situent la recherche des explications par rapport à l'espace et par rapport au temps (Beaujeu, Garnier J). Pour obtenir de bons résultats dans le cadre de cette étude, cette approche nous a semblé utile et nous a servi de guide lors de nos descentes sur le terrain pour collecter des données fiables. Dans ce chapitre, tout en évitant des spéculations intellectuelles, nous allons présenter simplement d'abord le cadre le cadre général de notre méthodologie, en suite notre méthodologie de collecte des données et enfin notre méthodologie d'analyse des données. 1- LE CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL DANS LE MODEL CLASSIQUE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE1.1- Courant Méthodologique : Model Classique de Recherche ScientifiqueEn remontant l'histoire de la pensée humaine, on observe plusieurs courants méthodologiques qui ont traversé la recherche de la connaissance, la recherche du savoir, bref la recherche de la vérité susceptible de s'imposer à tout le monde à travers l'espace et le temps. Généralement définie comme étant « la manière scientifique de raisonner ou d'opérer dans la réalisation d'une étude », la méthodologie encore appelée « science de la méthode » induit un dualisme paradigmatique « basé sur une démarche hypothético-déductive qui relève un paradigme quantitatif et une démarche empirico-inductive, qui procède d'un paradigme qualitatif », (Chevrier, 1992 : 53). Ces deux types de raisonnement sont au centre de l'activité de la recherche philosophique, théologique, scientifique ou technologique. Notre sujet d'étude sur la gestion des risques environnementaux dans un projet d'adduction d'eau potable en milieu urbain, nous amène à l'utilisation de la démarche empirico-inductive. Suivant cette approche, l'empirisme considère que la connaissance se fonde sur l'accumulation d'observations et de faits mesurables, dont on peut extraire des lois générales par un raisonnement inductif, allant par conséquent du concret à l'abstrait. 71 L'Inductivisme serait alors une méthode scientifique qui obtient des conclusions générales à partir de prémisses individuels. Il s'agit de la méthode scientifique la plus courante, qui se caractérise par quatre étapes basiques : l'observation et l'enregistrement de tous les faits ; l'analyse et la classification des faits ; la dérivation inductive d'une généralisation à partir des faits ; et la vérification. Cela signifie qu'après une étape initiale d'observation, d'analyse et de classification des faits, une hypothèse se présente pour résoudre le problème. L'Empirico-induction : est donc cette méthode de recherche qui vise une compréhension de phénomènes individuels et sociaux observés sur leurs terrains spontanés (par observation participante et entretiens), en prenant prioritairement en compte les significations qu'ils ont pour leurs acteurs eux-mêmes et donc en vivant ces phénomènes aux côtés des acteurs, comme un acteur parmi d'autres selon des procédures méthodiques qui garantissent la significativité des situations observées et comparées et qui exploitent consciemment les relations intersubjectives entretenues au sein du groupe, notamment celles où le chercheur est impliqué. (Philippe Blanchet, partie A, 1.1) 1.2- Cadre Théorique de la Recherche ProfessionnelleLe cadre théorique de cette recherche sur la gestion des risques environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II à Douala est essentiellement empirique c'est-à-dire en fait basé sur nos expériences concrètes vécues sur le terrain, avec les réalités du terrain. Ces expériences sont pour la plus part soutenues par une base théorique qui définit des concepts clé pour l'encadrement du sujet d'étude. Nous nous sommes focalisé sur la « prudentiellité » qui voudrait que le management environnemental au sein d'un tel projet soit fait avec beaucoup de tact et de méthode afin de garantir de l'eau potable à la population de Douala. Cet aspect nous amène à y'intégrer les notions comme la prévention et la protection afin de capitaliser la prudence dans la gestion du risque d'une telle ressource naturelle (l'eau potable produite à Yato et acheminée à Douala par des canalisations dans les différents châteaux de la ville pour la distribution dans les ménages). 1.3-Méthode de Recherche GénéralePour piloter cette recherche, nous avons opté pour la démarche utilisée en géographie. Celle-ci comporte quatre étapes, à savoir : l'observation ; la description ; l'analyse ; et l'interprétation. En effet, l'observation directe et indirecte du phénomène par une veille constante sur les opérations de terrain et les répercutions quelles ont sur l'environnement des sites du 72 projet est remarquable. La description a permis d'identifier les différents risques environnementaux en mettant en exergue le contexte dans lequel ils sont déterminés et diagnostiqués .Elle a également permis l'élaboration du Plan de Gestion des Risques Environnementaux (PGRE) par la stratégie intégrée caractérisée par une matrice de directives opérationnelles et une charte pour la gestion des risques dans un tel projet. L'analyse a permis de classifier les différents scénarii à risques en faisant ressortir le degré de significativité de chaque risque sur l'environnement. Elle a aussi permis d'évaluer l'action de chaque acteur lié au projet en mettant en exergue les conséquences de leur agissement sur l'écosystème des différents sites. Enfin, l'interprétation a permis de tirer la substance des données obtenues afin de légitimer et de montrer l'importance d'un tel sujet. 73 2- LES METHODES ET TECHNIQUES DE COLLECTE DES DONNEES 2.1- Collecte des Données QualitativesLa qualité et la fiabilité des données obtenues sur le terrain sont vitales pour le développement de cette étude sur « la gestion des risques environnementaux au sein du projet phare d'adduction d'eau potable à Douala ». L'actualisation des données dans le but de ressortir en temps réel la politique environnementale du projet, notamment l'aspect « gestion des risques », les pratiques des acteurs et leurs répercussions sur l'environnement immédiat sont faites par des techniques telles que la documentation, l'observation, l'entretien...afin d'analyser et d'interpréter le phénomène avec tact et justesse. 2.1.1- l'EchantillonnageL'échantillonnage est une opération de sélection d'un échantillon en vue de réaliser une étude statistique. Pour notre étude nous avons utilisé l'approche non-probabiliste où le choix de « l'aspect » notamment l'individu ou le groupe d'individus à enquêter est arbitraire. Au plan qualitatif par rapport au critère initial du sujet d'étude (gestion des risques environnementaux), nous avons opté pour un échantillonnage de commodité. Celui-ci est basé sur l'accessibilité de l'enquêteur aux informations liées au sujet d'étude. 2.1.2- La Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP)Sur le plan qualitatif, nous avons opté pour la Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP) développée dans le cadre de la recherche en Sciences Humaines par Meva'a Abomo de l'Université de Douala. Elle consiste à s'informer et à produire la connaissance par l'implication des populations riveraines du projet et des personnes ressources parties prenantes. Il s'agit en fait d'une étude dynamique des groupes humains dans des espaces donnés face à une thématique donnée : la gestion des risques environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II à Douala. Trois techniques essentielles nous ont permis d'obtenir des éléments qui serviront d'indicateurs pour la gestion des risques environnementaux au sein du projet à Douala, notamment dans les municipalités de Douala IVème et Douala Ier. Ces techniques sont : ? La recherche documentaire ? Les observations directes (insitu) et indirect sur les conséquences déjà perceptibles de certaines actions sur le terrain. ? Les entretiens (semi-direct et direct) avec l'appui d'une guide (conducteur). 74 A travers la recherche documentaire, il était question d'avoir des connaissances théoriques sur la gestion de l'environnement ( analyse environnementale) notamment en évaluant les politiques de gestion mises sur pied et en analysant l'effectivité des réalisations des différents acteurs sur le terrain en ce qui concerne le management de l'environnement immédiat lors de la mise en oeuvre du projet à Douala. Elle nous a également permis d'avoir une description globale du projet CAMWATER Phase II. Cette technique nous a enfin servi de guide pendant la revue de la littérature. Le dépouillement des archives (rapports, articles, documents de liaison, mémoires...) dans les institutions Publiques, Parapubliques, et les Organisations de la Société Civile liées au projet pour les Etudes d'Impact Environnemental, les audits, les évaluations, la médiation sociale nous ont permis de cerner un certain nombre de causes qui génèrent les risques dans l'environnement qui entoure la station de captage et de traitement de l'eau du projet ainsi que toutes les autres infrastructures liées à la distribution de cette eau potable à Douala. La technique de l'observation dynamique a été la plus utilisée. Elle a permis d'être en activité sur le terrain, de passer et de repasser plusieurs fois au niveau des mêmes sites à différents moments de la journée. Trois types d'observations ont été utilisés : ? L'observation direct (insitu) qui consistait à descendre sur le terrain afin d'entrer en contact avec les phénomènes et les acteurs du projet. Elle nous a permis de nous mettre dans la peau d'un acteur comme agent sensibilisateur et médiateur social. ? L'observation indirecte nous a permis de décrypter certains faits, notamment les répercussions des pratiques des acteurs du projet sur l'environnement immédiat à travers des photographies, des cartes géographiques des sites, les rapports des techniciens et articles publiés dans les journaux. ? L'observation participante, souvent associée à l'observation directe, nous a permis de nous infiltrer dans certains quartiers des zones d'intervention. Ainsi, nous avons pu avoir les opinions des populations riveraines concernées grâce aux échanges informels et aux Audiences Foraines. Les entretiens semi-dirigés nous ont permis de collecter des données à partir des échanges avec certaines personnes ressources issues des institutions parties prenantes du projet. Les entretiens dirigés basés sur un guide conducteur élaboré au préalable pour la circonstance nous ont permis d'obtenir des informations fiables sur le projet. 75 2.2- Collecte des Données QuantitativesDe façon complémentaire l'approche quantitative a été associée aux aspects qualitatifs. Ceci afin d'apporter une valeur ajoutée à l'étude. Elle nous a permis d'obtenir certaines données chiffrées (statistiques) des points de livraison et d'abonnement au réseau d'eau potable dans la ville, la capacité de renforcement du réseau existant, la distance en mètre linéaire du tracé de pose des canalisations dans l'arrondissement de Douala I. Elle a également permis d'identifier et de déterminer la fréquence d'occurrence des Scenarii à risques pendant les activités de pose des canalisations d'eau potable . 2.2.1- Echantillonnage des sites d'investigationDes six municipalités que comporte la ville de Douala à l'exception de l'ile de Manoka, notre choix s'est porté sur deux (2) Communes d'Arrondissement pour constituer nos sites d'investigation. Ces Communes sont : Douala 1er et Douala 4eme (Bonaberi). Vu la superficie de ces espaces urbains, nous nous sommes focaliser sur les zones où devrait passer les travaux de pose des canalisations pour le projet d'adduction d'eau potable dans la ville. A Douala 1er, la zone cible était le Carrefour Agip au Rond-Point Deido sur une distance linéaire de 2685m. A Douala 4eme la zone cible était celle de Bonaberi cimetière sur le point d'embranchement pour le quartier Mambanda où ont été effectué certains travaux de réhabilitation du réseau d'eau potable qui désert cette partie de Bonaberi. Le choix de ces sites a porté sur trois critères à savoir : ? L'accessibilité aux sites des travaux par l'enquêteur (étudiant chercheur) en termes de coûts financiers pour les déplacements pendant toute la période consacrée à la collecte des données sur le terrain. ? La qualité ou le type de travaux à effectuer dans le projet en fonction du milieu. Sur l'axe Agip au Rond-Point Deido, il était question d'élaborer un réseau souterrain qui traversera les trois grands carrefours que comporte cet axe linéaire. Les travaux ici étaient essentiellement constitués de la pose des canalisations d'eau potable sur un site géographiquement fragile à cause de son bas niveau, du sol argileux et la nappe phréatique élevée. Ce qui amène cette zone à être très sensible aux inondations. Sur le site de Bonaberi cimetière, démographiquement dense et caractérisé par une précarité sanitaire accrue, les travaux du projet à ce niveau étaient uniquement faits de la réhabilitation du réseau existant. Ici il était question de joindre l'ancien réseau d'eau 76 potable qui alimentait le quartier Mambanda au nouveau réseau établi par le projet CAMWATER Phase II. ? L'importance des sites des travaux pour le développement de la ville. L'axe Agip au Rond-Point Deido à Douala 1er, au point de vue transport urbain est caractérisé par trois grands carrefours qui desservent toute la ville. Le réseau d'eau établi dans ce projet devait également suivre cet axe pour une meilleure dissémination des tuyaux d'eau potable dans la ville. Le Pont-tuyau sur le fleuve Wouri, important pour le développement d'un réseau d'eau potable durable devait relier la station de captage et de traitement de Yato en passant par Bonaberi pour alimenter la ville de l'autre côté du fleuve. La nouvelle route Bonaberi sur la national « numéros 3 » allant vers le Sud-Ouest et Ouest en passant par le département du Mungo où est située la station de Yato dans l'Arrondissement de Dibombari est une zone essentielle pour l'eau potable qui est utilisée dans la ville de Douala. 2.2.2- Sondage AléatoirePascal Ardilly dans son livre intitulé « Les Techniques de Sondage » relève que : « dans les études quantitatives, le sondage trouve son fondement théorique en la notion de représentativité. On suppose que tout sous-ensemble représentatif est susceptible d'être l'objet d'une étude indirecte de la population dont il est tiré ». En se basant sur ces propos d'Ardilly, notre plan de sondage couvre les variables suivantes : les acteurs institutionnels du projet (les acteurs gouvernementaux, les parties prenantes du projet et les autres acteurs de la ville) ; les acteurs locaux du projet (les autorités traditionnelles et les populations riveraines).Nous avons opté pour un sondage aléatoire « simple » en choisissant au hasard les personnes avec qui nous avons eu des entretiens au niveau des différents sites. Toutefois, nous avons tenu compte du degré d'implication des différents acteurs du projet en matière de gestion des risques et de protection de l'environnement ainsi que des scénarii à risques auxquels ils sont exposés au sein du projet. Le sondage ici est fait de manière direct, c'est à dire que : l'enquêteur va lui-même administré le guide d'entretien à partir des informations sondées. Notre démarche pendant le sondage aléatoire sera basée sur le « comportement » de chaque type d'acteur du projet et sur les différentes pratiques dans la gestion des risques environnementaux. 77 3- LES METHODES ET TECHNIQUES D'ANALYSES DES DONNEES3.1-Analyse des données qualitatives3.1.1- Le Diagramme de Cause à EffetCette analyse a permis d'établir un « diagramme poisson » notamment appelé le diagramme de cause à effet (Ishikawa). Il s'agit d'un outil conçu par Kaoru Ishikawa (1915 - 1989). Ishikawa était un ingénieur japonais qui a travaillé pour Nissan et qui fit partie de la Juse, l'Organisation des ingénieurs et des scientifiques japonais dans laquelle se retrouvaient pour échanger leurs idées de grands noms de la gestion de la qualité tels que Deming, Taguchi ou encore Juran. Le diagramme d'Ishikawa permet d'analyser les grandes catégories de causes pour parvenir à un effet particulier. Il est particulièrement bien adapté à la gestion des risques qui font partie de la gestion des projets. Les catégories de causes commencent toutes par la lettre M, ce qui permet de les mémoriser facilement : Machines: il s'agit du matériel nécessaire au projet, des locaux éventuels, les gros outillages, cette catégorie requière un investissement ; Main d'oeuvre: le personnel qui participe au projet, interne et externe mais qui travaille pour le projet ou qui est lié à l'objectif du projet ; Méthodes: les procédures existantes, les modes d'emploi utilisées ; Matières : tout ce qui est consommable et utile au projet ou à l'objectif du projet, les matières premières, le papier, l'électricité, l'eau ; Milieu : l'environnement physique et humain pouvant influer sur le projet, les conditions de travail, le parking, les espaces verts ... On y ajoute parfois une sixième catégorie, celle des Mesures pour tout ce qui peut être quantifié donc mesuré pour parvenir à l'effet escompté. Ce diagramme permet de visualiser toutes les causes d'un problème donné et peut servir de base de planification des actions à mener pour résoudre chacune des causes. Il permettra alors d'avoir une vision générale des problèmes et leurs impacts qui ont instigué la mise en oeuvre de ce projet. 3.1.2- La Théorie de l'Amélioration Continue (PDCA)L'étude a également permis de définir une démarche extrapolée de la théorie de « l'Amélioration Continue » par le concept de la « roue de Deming » afin de mettre en exergue le model anglais du Plan-Do-Check-Act (PDCA) qui consiste à faire une analyse des pratiques des acteurs à travers des politiques urbaines, le cas de Douala en ce qui concerne le volet environnemental des projets comme celui de CAMWATER Phase II. Cette démarche aura pour finalité : de définir des procédures dans la mise en oeuvre d'une politique environnementale pour ce projet. 78 Figure 9 : Schéma démontrant le PDCA
ACT CONTINIOUS CHECK PLAN DO Source: Image de Wikipédia Commons cc- 3.1.3- Le SWOT AnalysisL'Analyse ou matrice SWOT qui est une méthode ou un outil anglais d'analyse stratégique d'entreprise pouvant être utilisé dans le domaine du marketing, de la gestion des projets et programmes pour une entreprise ou un produit. SWOT constitue les initiales pour : Strengths (forces); Weaknesses (faiblesses) ; Opportunities
(opportunités) et Threats 3.2- Analyse des données quantitatives 3.2.1- Le Diagramme de ParetoPour la classification des risques en fonction de leurs fréquences d'occurrence, l'étude a opté pour l'approche développée par Vilfredo Pareto, économiste italien, qui avait fait une étude sur la répartition des richesses en Italie mettant en évidence que 80 % des richesses étaient détenues par 20 % de la population. Cette observation est aujourd'hui connue sous le nom de loi des 80/20 ou principe de Pareto. Figure 10: Vilfredo PARETO, économiste italien, « 20% des causes sont responsables de 80% des Conséquences »
79 Source : Image domaine public-Wikipédia L'élaboration du diagramme de Pareto a donc permis de hiérarchiser les problèmes (identifier et classifier le risque impactant l'environnement immédiat du projet) en fonction du nombre d'occurrences et ainsi, définir des priorités dans le traitement des problèmes. Cet outil quantitatif met en évidence les 20% de causes sur lesquelles il faut agir pour résoudre 80 % du problème. Il sera utile pour déterminer sur quels leviers on doit agir en priorité pour améliorer de façon significative la situation au sein du projet. Tableau 5: Résumant les méthodes, techniques et outils de collecte et analyse des données en fonctions des dimensions de l'étude.
80
4- DIFFICULTES RENCONTREES4.1- Difficultés rencontrées lors de la collecte des données? Très peu de documentations spécialisées dans la gestion des risques environnementaux sur la réalisation des projets d'adduction d'eau potable. ? Difficulté à l'accessibilité de certaines données importantes du projet gardé par CAMWATER le porteur du projet et CGCOC l'exécuteur en raison de certaines directives administratives. ? Moyens logistiques : coûts élevés des déplacements pour l'étudiant chercheur sur les différents sites des travaux lors des nombreuses descentes sur le terrain ; difficulté d'achat du matériel didactique adéquat pour l'enquête de terrain (appareil de photographie, petit magnétophone...) 81 ? Réaction hostile de certains groupes de personnes enquêtées notamment les populations riveraines. 4.2- Difficultés rencontrées lors de l'analyse des données? Manque d'outil spécialisé pour l'analyse des impacts des pratiques des acteurs en matière de gestion des risques environnementaux. D'où notre effort d'adaptation de la Matrice de Léopold pour évaluer les impacts environnementaux. ? Manque d'un cadre légal et réglementaire spécifique à la gestion des risques au sein du projet. D'où notre effort pour l'élaboration d'une proposition de charte de gestion des risques environnementaux pour les adductions d'eau potable en milieu urbain et peri-urbain. ? Les données retenues pour l'analyse proviennent surtout de deux sites majeurs du projet à savoir Agip au rond-point Deido et Bonaberi cimetière à cause des difficultés financières qui ne nous ont pas permis d'aller tout le temps sur les rives du fleuve Moungo. 5- CHRONOGRAMME DE RECHERCHE
82 CONCLUSIONIl apparait donc que la méthodologie de recherche développée dans ce chapitre pour cette étude est basée pour l'essentiel sur l'approche empirique couramment utilisée en Géographie et qui a servi de socle à la collecte et à l'analyse des données. En raison du contexte spécial de l'étude, de sa thématique et de sa durée (une année), cette méthodologie a semblé doublement avantageuse. En effet elle nous a donné l'occasion de passer plusieurs fois sur les sites des travaux pour approfondir nos observations. Elle nous a aussi donné de participer effectivement aux travaux en tant que agent de la médiation sociale. A cela, nous avons ajouté l'utilisation d'autres outils d'appréciation scientifiques comme le Diagramme de cause à effet, le Diagramme de Pareto, le PDCA(principe de l'amélioration continue), et le SWOT analysis qui nous ont permis d'approfondir l'analyse des données. Nous sommes arrivés à constater que le management d'un concept comme celui des risques environnementaux autour d'un projet d'eau potable en milieu urbain est délicat et requiert une certaine ouverture d'esprit et de l'humilité. Mais l'utilisation des méthodes et techniques de recherche avec beaucoup de patience, de concentration et d'attention nous a permis d'avancer petit à petit en respectant les canaux scientifiques. 83 TROISIEME PARTIEETUDE DE CAS : LES RESULTATS Cette partie du mémoire est consacrée à la vulgarisation des résultats obtenus au cours de la recherche. Elle est développée en quatre dimensions à savoir : la politique de gestion des risques environnementaux ; les pratiques des acteurs au sein du projet ; les impacts des pratiques des acteurs sur l'environnement immédiat ; et la stratégie intégrée. 84 CHAPITRE I : POLITIQUE DE GESTION DES
RISQUES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les Variantes « 5M » |
Les indicateurs des causes et des effets du risque environnemental au sein du |
|
projet CAMWATER Phase II |
|
|
M 1 |
? La dégradation du milieu physique dont le relief, la végétation et la destruction des écosystèmes mineurs pendant la pose des canalisations ont accentué le niveau d'érosion des sols et le glissement de terrain dans les sites marécageux du projet. Ce qui a favorisé entre autres les inondations dans certaines zones de la ville. Par exemple au niveau du carrefour « Trois morts » en face de l'Eglise de Jérusalem sur l'axe Carrefour Agip- Feux Rouges Bessengué. ? La dégradation du milieu humain par l'intensité du trafic urbain aux heures de pointe ; les conflits des personnes (populations riveraines et les équipes de réalisation du projet) ; la destruction des habitats et autres bâtiments sur le tracé et les emprises des voiries lors de la pose des canalisations ont accentué le désordre urbain à Douala pendant les travaux favorisant ainsi l'occurrence des accidents de circulation dans ces endroits. Par exemple
l'axe Rond-point |
|
M 2 MOYEN |
? L'approvisionnement en ressources pour le financement du volet environnemental qui est un aspect important dans la mise en oeuvre d'un système de gestion des risques manque pour le projet.
La mobilisation des afin de mettre à disposition des fonds pour recruter le
personnel adapté au suivi du projet, le contrôle, des audits afin de
maintenir la qualité de |
|
M 3 MANAGEMENT |
? L'augmentation des mesures sécuritaires par une meilleure définition du volet environnemental qui prend en compte l'assainissement des sites, la santé du personnel au sein des équipes sur le terrain et les populations riveraines, la biodiversité (planter les arbres). Ceci
pourra considérablement |
99
|
M 4 |
? L'élaboration d'un modèle de régulation capable de réduire les impacts sur |
|
MESURE |
l'environnement immédiat des différents sites des travaux. Il prendra en |
|
D'ATTENUATION |
compte les règlements en vigueur sur lesquels il se basera et développera des procédures adéquates dans la mise en oeuvre d'une gestion préventive des risques au sein du projet. |
|
? La mise à jour des outils de programmation et de gestion des risques |
|
|
M 5 |
environnementaux dans les différents sites des travaux par le développement |
|
MAINTENANCE |
d'un système de surveillance et d'amélioration continue (police environnementale) |
Figure 12: Schéma démontrant les étapes dans la mise en oeuvre d'une Gestion Intégrée du
Risque

Source : Schéma
tiré du document «Cadre de gestion intégrée du
risque» Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada
www.tbs-sct.gc.ca
100
Tableau 7 : Identification des Risques Techniques
|
Type d'Acteur |
Type d'Activité |
Les Scénarii à Risques |
|
? Risque d'électrocution des manoeuvres au contact avec le réseau électrique (haute tension) dû au non identification des lignes |
||
|
L'exécuteur du projet |
Pose des canalisations le |
électriques au-dessus et en dessous (réseau |
|
CGCOC |
long du tracé et construction |
souterrain) dans les emprises du tracé lors de |
|
des infrastructures (pont- |
la pose des canalisations dans les sites des |
|
|
tuyau et châteaux d'eau) |
travaux. |
|
|
? Risque d'accident des manoeuvres exposés aux engins (risques liés à la manutention mécanique) dû au manque des EPI et autres équipements de signalétique sécuritaire lors des opérations journalières. |
||
|
? Risque de chute des manoeuvres dû aux activités en hauteur (construction du pont-tuyau et château d'eau). |
||
|
? Risque lié au bruit émis par les engins lors de la pose des canalisations (pollution sonore) causant des sérieux dommages sur la santé des manouvres réduisant les capacités d'ouïe |
101
Tableau 8 : Identification des Risques Socio-Ecologiques
|
Type d'Acteur |
Secteur d'Activité |
Les Scenarii à Risques |
|
Le promoteur du projet CAMWATER |
Gestion globale du projet. |
? Risques liés à l'organisation du travail (porteur du projet) par exemple : travail dans l'urgence ; lacune dans la communication ; travail aux heures et condition climatique inadaptées ; recrutement du personnel inadapté et planning connus tardivement. |
|
Le partenaire de médiation sociale A2D |
Gestion des conflits sociaux au sein du projet |
? Risques de conflit socio-culturels entre les populations riveraines et les membres d'équipes d'exécution des travaux sur le terrain dû à l'incompréhension des termes de références du projet par la Société civile. |
|
Les autres acteurs locaux liés au projet (Eneo, Camtel, CUD, CDE...) |
Le développement de leurs activités dans la ville notamment par la mise en oeuvre de leurs différents réseaux dans les sites |
? Risques de pollution de l'eau et explosion liés aux interventions des entreprises extérieures (méconnaissance des risques liés aux Co-activités) notamment une cohabitation accrue et la cohésion des différents réseaux sur le même tracé. |
|
La société civile et les populations riveraines |
Assure la cohésion sociale et l'intégration des notions de participation, responsabilité citoyenne et valorisation de l'environnement au sein du projet |
? Risques liés au manque d'hygiène des populations riveraines : pollution de l'eau potable issue du réseau d'eau de la CDE dû aux canalisations d'eaux défectueuses. ? Risques de glissement de terrain dû aux vibrations causées par les engins (Poquelin) dans les zones marécageuses à sol argileux. |
102
DU PROJET
Il est question ici de définir les différentes classes des risques environnementaux dans le cadre du projet CAMWATER Phase II. Au vue de nos observations comme acteur sur le terrain (agent sensibilisateur) nous avons relevé trois grandes variables qui permettront la classification des risques au sein du projet. Ces variables sont : la gravité, l'intensité et la fréquence d'occurrence des risques environnementaux dans les sites des travaux. La classification des risques environnementaux dans le cadre du projet est faite en deux phases. La première consiste à classifier les risques techniques en fonction de ces variables définies (gravité, intensité et fréquence d'occurrence) d'une part et la seconde consistera à classifier les risques socio-écologiques en fonction de ces mêmes variables d'autre part.
Afin de mettre en exergue la gravité de chaque type de scenario à risque, l'étude a relevé certains indicateurs de la gravité des risques potentiels dans les sites des travaux. Ces indications sont : les risques inacceptables caractérisés par la prise immédiate des mesures de régulation définies par « la couleur rouge » signe de danger permanant (situation de crise). « La couleur jaune » autres indicateurs ressort les risques inacceptables à long terme. Elle est caractérisée par la prise des mesures à court terme et la recherche des mesures durables (situation précédent la crise caractérisée par les signes avant-coureurs). Le risques « acceptables » caractérisés par une bonne utilisation des équipements de protection individuelle définie par « la couleur verte » met en exergue les scenarii significatifs ayant des impacts dont le projet peut certainement s'en passer (moins dangereux pour l'environnement du projet).
Légende : Indicateur de la gravité des risques environnementaux
|
Risques inacceptables (scénario critique) = Très grave Risques inacceptables à long terme = Moins grave Risque « acceptable » = Grave à court terme |
103
Type de Scenarii à Risques
|
GRAVITE DU RISQUE |
Risque lié au |
Risque de chute |
Risque d'accident |
Risque d'électrocution |
|
Très importante |
Importante
Incapacité
temporaire
Moins important
Sans
incapacité
|
Peu importante Incident |
||||
|
Peu probable |
Possible |
Fort possible |
A attendre |
|
|
PROBABILITE |
||||
104
|
Type de Scenarii à Risques |
||||
|
GRAVITE DU |
Risque de conflit socio-culturel et Risque lié à l'organisation du travail par le porteur du projet |
Risque de |
Risque lié au |
Risque de pollution et |
|
Très importante |
||||
|
Importante Incapacité |
||||
|
Moins important |
||||
|
Peu importante |
||||
|
Peu probable |
Possible |
Fort possible |
A attendre |
|
|
PROBABILITE |
||||
Le tableau 1 démontre la classification des risques techniques au sein du projet. Il ressort le fait que le risque lié au bruit émis par les engins (pollution sonore) est peu important pour le projet. Il en est de même de son impact malgré le fait qu'à long terme le bruit nuise à la santé.
Par contre, le risque de chute des manoeuvres dû aux activités en hauteur dans le cadre de la construction du pont-tuyau et le risque d'accident des manoeuvres exposés aux engins (risque lié à la manutention mécanique) sont relativement importants pour le projet à
105
cause de leur gravité caractérisée par leurs impacts sur l'environnement du projet. Ces risques peuvent donc être qualifiés de risque technique à gravité moyenne. Le risque d'électrocution des manoeuvres au contact avec le réseau électrique (haute tension) et autres réseaux dont celui des télécommunications (fibre optique) sur le tracé est relativement le plus important. Il est qualifié de risque très important ou encore « risque critique » par sa gravité déterminée par « l'occurrence d'une mort d'homme », notamment pour le contact des manoeuvres avec le réseau électrique haute tension.
Le tableau 2 qui classifie les risques socio-écologiques en fonction de leurs gravités, met en exergue le fait que le risque de conflit socio-culturel entre les équipes d'exécution du projet et les populations riveraines sont régulés par « la médiation sociale » faite par l'A2D et le risque lié à l'organisation du travail par le porteur du projet CAMWATER (travail dans l'urgence ; lacune dans la communication ; travail aux heures et condition climatique inadaptées ; recrutement du personnel inadapté et le planning connu tardivement) sont des risques acceptable car leurs impacts ne sont pas contraignants pour le déroulement du projet.
Egalement, les risques « Santé - Ecologique » déterminés par le manque d'hygiène des populations riveraines qui par leurs activités quotidiennes finissent par casser les tuyaux de distributions de l'eau potable et en même temps utilisent cette même eau dégradée pour des besoins domestiques et le glissement de terrain dû aux vibrations causées par les engins comme le poquelin respectivement font ressortir le degré de gravité de ces scénarii particulièrement importants (gravité moyenne). Associer à ces scénarii, celui susceptible de causer des explosions et une pollution à grande échelle dû à la cohabitation accrue de différents réseaux sur le tracé. Celui-ci est le plus important car ses conséquences vont au-delà de l'environnement immédiat du projet. Il serait donc important pour ce cas de mettre sur pied des mesures pertinentes, efficaces et effectives à long terme afin d'éviter toute occurrence de ces incidents négatifs.
Il est question aux cours de la classification des risques ici de faire une estimation du degré d'intensité de chaque type de scenario à risques dans les différents sites des travaux. Ici l'état du milieu où sont effectués les travaux est un élément déterminant à prendre en compte. Cette classification sera faite en deux parties : le risque technique et le risque socio-écologique dans les deux sites où notre étude est effectuée à savoir l'axe carrefour Agip au
106
Rond-Point Deido et une partie de Bonaberi Nouvelle Route dans la zone de déviation pour le quartier Mambanda venant du pont sur le Wouri sur environ 5000m.
Légende des différents types de scénarii à risques techniques
|
Scénario A = Risque d'électrocution Scénario B = Risque lié à la manutention mécanique Scénario C = Risque de chute Scénario D = Risque lié au bruit |
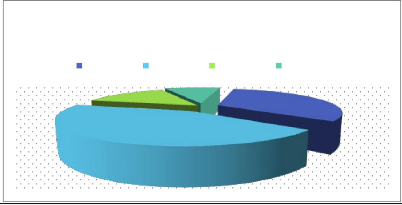
figure 13: Graphique démontrant l'intensité des scénarii à risques techniques dans la zone de Bonaberi Nouvelle Route
(Cimétière)
Scénario A Scénario B Scénario C Scénario D
44%
15% 10%
33%
Le site de Bonaberi cimetière, une des zones cibles de l'étude au travers du graphique développé plus haut fait état d'une inconstance de l'intensité des scénarii à risques techniques au sein du projet. Ici, les variantes A, B, C, D déroulent les types de scénarii à savoir : le risque d'électrocution des manoeuvres au contact avec les réseaux souterrains électriques, les risques liés à la manutention mécanique dû à l'exposition aux engins sur les sites ; le risque de chute des manoeuvres dû aux activités en hauteur ; les risque liés au bruit émis par les engins (pollution sonore) respectivement. Les données obtenues par une estimation vive sur le chantier, instigué par une observation insitu du déroulement des activités révèle que : les 20% d'intensité du scénario provoquant un accident électrique sont causés par la présence de la haute tension souterraine qui alimente la zone de Mambanda en énergie électrique. Ce réseau électrique serpente les emprises de la voie principale et peu facilement entrer en
107
collision avec le réseau d'eau établi par le projet CAMWATER Phase II au niveau du carrefour Mambanda sur environ 5000m. La justification des 50% du scénario B (risque lié à la manutention mécanique) est déterminée par des pratiques à risque des manoeuvres qui travaillent généralement sans avoir au complet leurs équipements de protection individuelle (EPI). Cet acte de négligence de ces acteurs met en exergue une probabilité élevée en termes d'intensité dans occurrence d'un accident mécanique dans le site. Par contre les 20% qui soulignent le risque de chute en hauteur dans le cadre de la pose des canalisations est dû à la technique utilisée par la CGCOC (l'exécuteur du projet) qui expose les manoeuvres en les faisant monter sur la grue pour ajuster le tuyau sur le tracé et le lubrifier. Ce qui les expose à d'autres réseaux en hauteur favorisant ainsi l'occurrence d'un accident. Enfin les 10% détermine un risque peu probable sur le chantier, sauf si il est très intense dans une longue durée .Ce qui pourrait provoquer des problèmes de santé notamment la mauvaise fonction de certains s'organes de sens comme l'ouï.

Figure 14: Graphique demontrant l'intensité des risques techniques sur l'axe Carrefour Agip à Rond-Point Deido
Scénaris A Scénaris B Scénaris C Scénaris D
40%
15% 5%
40%
L'axe carrefour Agip au Rond-Point Deido, l'un des sites majeurs de cette étude de cas fait ressortir par cette analyse graphique, l'intensité des scénarii à risque technique au sein du projet. Elle démontre que : les scénarii de type A (les risques électriques) sont très intense soit un pourcentage de 40%. Ceci est dû au fait que le milieu est très urbanisé. Il est caractérisé par des infrastructures de haute qualité architecturale notamment des bâtiments comme les locaux de la gare ferroviaire dont l'entrée est sur le tracé ; la Société des Dépôt Pétrolier du Cameroun (SCDP), l'immeuble où est situé l'agence de la BICEC aux Feux Rouges Bessengué, la Boulangerie Meno au Rond-Point Deido parmi tant d'autres. Ces infrastructures sont tous alimentées par des réseaux électriques et de télécommunications qui occupent les emprises des trottoirs afin d'être acheminés dans ces bâtiments. Il est à
souligner que ces différents réseaux au vue de leurs densités et inorganisation (occupation sauvage de l'espace souterrain) augmentent la probabilité d'une éventuelle collision avec le réseau d'eau potable établi par la CAMWATER au cours de ce projet. Les 40% des risques lié à la manutention mécanique des acteurs techniques du projet démontrent le niveau d'intensité de l'occurrence d'un accident issu d'une telle activité, notamment dans les carrefours Agip, Feux Rouge Bessengué et Rond-Point Deido. Ceci est dû au fait que le désordre urbain qui favorise la densité du trafic impacte l'activité de ces techniciens notamment aux heures de pointe. Ce qui peut causer une manoeuvre technique mal exécutée, causant des dommages sérieux dont un accident mécanique dans le périmètre d'exécution des travaux.
Par contre les risques de chute en hauteur, ressortent d'une intensité moins importante (15%) que pour les précédents. La présence de la sécurité nationale (police) chargée de la protection des biens et des personnes lors d'un tel projet, associée aux efforts fournis par la CUD pour l'embellissement des points importants de la ville, notamment les carrefours qui lient les grands axes et les quartiers phares de la ville (Bonapriso, Bonanjo, Akwa et Deido ) par des carrefours tels que Agip, Feux Rouge Bessengué et Rond-Point Deido réduit la présence des obstacles aériens (banderoles et fils électriques) disposés d'une manière sauvage afin de faciliter les opérations qui nécessite de prendre de la hauteur pour la pose des canalisations.
Enfin, les 5% qui sont adjoints aux risques liés aux bruits, démontrent que la pollution sonore dans cette partie de la ville n'a pas une importance capitale pour l'environnement immédiat du projet, étant donné que ces axes sont en eux-mêmes très brouillants en journée. Ceci implique que l'intensité du risque environnemental sonore est relativement faible à court terme.
Légende des différents types de scénarii à risques Socio-Ecologiques
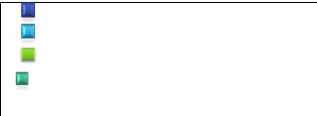
Scénario A = Risque de pollution et explosion Scénario B = Risque lié au manque d'hygiène Scénario C = Risque de glissement de terrain
Scénario D = Risque de conflit socio-culturel et risque lié à l'organisation du travail
108
Fig 15: Graphique démontant
l'intensité des risques Socio-
Ecologiques
dans la zone de Bonaberi Nouvelle Route
(Cimetière)

10%
20%
30%
40%
Scénario A Scénario B Scénario C Scénario D
109
La prise en compte des risques socio-écologiques dans un projet d'adduction d'eau potable en milieu urbain est très importante. Elle déterminera la pertinence, l'efficacité du projet face aux obstacles rencontrés (impacts) et efficience au vue des objectifs définis dans les termes de références dudit projet. C'est le cas de celui de CAMWTER Phase II à Douala où nous avons observé les différentes activités par une présence active en quantité d'agents sensibilisateurs du volet médiation sociale dans les chantiers de Bonaberi cimetière à Douala IV et Agip au Rond-Point Deido à Douala I. Cette présence nous a permis de faire une estimation en pourcentage des scenarii à risques socio-écologiques afin d'établir une classification des risques potentiels sur l'environnement du projet. Les différents scénarii ont été regroupés en quatre grandes classes à savoir : la classe pour le scénario de type « A » qui ressort les risques pouvant provoquer une explosion ou encore une pollution dans l'environnement immédiat ; celui de type « B » démontre les risques liés au manque d'hygiène ; le scénario de type « C » fait ressortir les risques de glissement de terrain et enfin le scénario de type « D » met en exergue les risques de conflits socio-culturels.
Il serait donc important de souligner qu'à Bonaberi cimetière par exemple, les scénarii de type « A » en termes d'intensité sont évalués à 20%. Ceci est dû aux faits que cette zone est
démographiquement forte et donc les différents
réseaux d'énergie électriques,
de
télécommunication et bientôt de gaz industriel
alimentant les usines du quartier Mambanda (zone MAGZI) sont organisés
dans les emprises des voiries de manière désordonnée (sans
un plan d'aménagement des sols).Ceci peut facilement causer de graves
accidents de chantier dû
110
à la collision des différents réseaux sur le même tracé provoquant ainsi des explosions et une pollution accrue de l'air et de l'eau et même du sol à certains niveau.
Les 40% d'intensité du risque lié au manque d'hygiène est capital et prédominant dans cette partie de la ville. Ceci est lié à la précarité du milieu physique et humain de Bonaberi au lieu-dit Mambanda. Les travaux effectués à l'entrée de ce quartier afin de renforcer le réseau existant nous a permis de confirmer cette hypothèse. Les populations généralement de classe faible pour la majorité font ressortir la difficulté liée à l'accès à l'eau potable. Les puits utilisés ici pour la plupart sont non conformes aux normes instituées par l'administration du génie rural et hydraulique villageoise notamment en ce qui concerne leur profondeur. Car ici la nappe phréatique est superficielle et l'eau des puits est menacée par le péril fécal. Les pratiques non-citoyennes qui impliquent des casses des tuyaux d'alimentation de l'ancien réseau établi par la défunte SNEC ont augmenté le risque sanitaire dû à la pollution de l'eau potable. Ceci est à l'origine de la prévalence des maladies hydriques dans ce quartier tel que le choléra, la dysenterie et les amibes ...
Il nous a été donné de remarquer que : cette zone pendant la mise oeuvre du renforcement du réseau d'eau potable a fait état d'une situation écologiquement précaire à cause de l'occurrence de l'intensité et de la régularité des glissements de terrain notamment pendant la saison des pluies. Cette situation est aggravée par la pression des populations et leurs activités sur le sol callimorphes (sol argileux). Cette zone est géographiquement fragile et très marécageuse. Elle a causé beaucoup de difficultés à l'équipe d'exécution des travaux. Le risque relativement important pour les ouvriers et les populations riveraines pourrait être estimé à 30% soit environ 1/3 des risques socio-écologiques dans le site des travaux à Bonaberi.
Enfin, la justification des 10% restant dans cette zone est due à la présence des agents sensibilisateurs qui quotidiennement informent et sécurisent le périmètre d'exécution des travaux sur le chantier. Ceci détermine une réduction de l'occurrence des conflits socioculturels. La concertation entre l'équipe de médiation et les autorités traditionnelles (chefs de quartiers et chefs de blocks) participe également à cet effort. Le risque de conflit entre les populations et les membres du projet sur le terrain devient relativement faible en raison des mesures de précaution prisent par les agents sensibilisateurs.
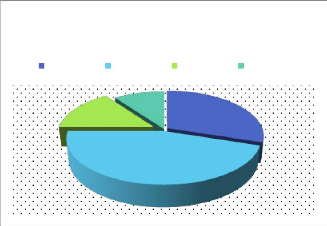
Figure 16: Graphique démontrant
l'intensité des
risques Socio-Ecologiques sur l'axe Carrefour
Agip
à Rond-Point Deido
Scénario A Scénario B Scénario C Scénario D
15%
10%
45%
30%
111
A Douala Ier sur l'axe carrefour Agip au Rond-Point Deido en passant par le carrefour feux rouges Bessengué, la zone est très urbanisée. Elle a permis une classification de l'intensité des risques sociaux et écologiques ainsi qu'il suit : 30% de risques ont liés à l'intensité de la probabilité d'occurrence d'une éventuelle explosion ou encore une pollution du type aérien lors de l'exécution des travaux. Ceci est dû en raison de la densité des réseaux souterrains et aériens des différents opérateurs de la ville dont ENEO pour l'électricité et CAMTEL pour les télécommunications et plus récemment la société Gaz du Cameroun. Il est donc fort possible que si des mesures adéquates ne sont pas prises de manière prompte, une collision de ces réseaux peut se réaliser lors de différentes opérations de ces acteurs sur le terrain (extention ou maintenance des réseaux par exemple).
Les risques liés au manque d'hygiène sont de 45%. C'est remarquable. En effet le caractère cosmopolite de la ville de Douala trahit le contexte en dévoilant les contraintes de l'approvisionnement en eau potable qui augmentent le capital-risque des composantes santé-environnement au sein du projet. Ce risque pourrait être revu à la hausse si les travaux sont effectués en saison de pluie entre le carrefour Agip et le carrefour « trois morts » sur une distance linéaire d'environ 1500m à 2500m en raison de l'état marécageux de cet endroit.
La fragilité de cette partie de l'axe Agip au Rond-Point Deido particulièrement au niveau de l'église de Jérusalem induit le fait qu'un risque potentiel de glissement à cause du terrain est probable en raison de la qualité du sol argileux et sensible à une forte pression des vibrations causées par les engin et autres activités qui agressent le milieu édaphique. On
112
pourrait donc évaluer à 15% l'intensité de la probabilité d'occurrence d'un tel scénario sur l'environnement social et écologique du projet.
Il est a relevé une constance de 10% au niveau de l'intensité des risques de conflits socio-culturels aussi bien à Bonaberi à Douala IV qu'à Douala I entre Agip et Deido. Cette constance est causée par l'effectivité du volet médiation sociale au cours du projet notamment dans ces zones. La sensibilisation et les concertations démontrent une communication effective et font ressortir une certaine compréhension de l'intérêt du projet par la population riveraine qui progressivement l'adopte avec l'appui de l'Administration qui s'active à tout mettre en oeuvre pour que ces populations vivent dans des meilleures conditions.
La Méthode Pareto : Pour l'application du diagramme de Pareto » dans cette étude, il est question de faire une classification des risques environnementaux en fonction de leurs degrés d'occurrence. Elle est faite en deux parties. La première consistera à faire une classification des risques techniques et la seconde les risques socio-écologiques sur l'axe carrefour Agip au Rond-Point Deido sur une distance linéaire de 2685m. Le tableau initial qui constitue « l'Etape 1 » de la méthode de Pareto est à l'origine des données obtenues dans les étapes 2 et 3. Il est défini en fonction de la fréquence d'occurrence de chaque scénario à risque sur l'axe Agip au Rond-Point Deido. L'obtention des différentes fréquences d'occurrence de chaque scénario est faite sur la base de nos observations directes sur le terrain.
En effet, pendant la réalisation des travaux de pose des canalisations dans le site, pour chaque action réalisée par un acteur susceptible d'engendrer un risque, nous notions sur notre tableau de fréquence construit à cet effet. Il était donc question ici de mettre en exergue la probabilité d'occurrence d'un scénario à risque technique ou socio-écologique. Après plusieurs passages sur l'itinéraire choisi pour avoir confirmation du risque du scénario observé. Ainsi par exemple pour les risques d'électrocution dans les tranchées où se croisent les canalisations d'eau potable et les câbles du courant électrique haute tension, nous avons relevé 09 points critiques. La même méthode a été utilisée pour tous les autres scénarii à risque technique et socio-écologiques. D'où les travaux ci-dessous (Etape 1 de Pareto).
113
Pour l'Etape 2 de Pareto, les fréquences d'occurrence sont classées par ordre décroissant et l'évaluation des pourcentages de chaque scénario à risque est calculée ainsi qu'il suit :
|
Pourcentage La Somme de chaque scenario X 100 La somme totale des scénarii à risque |
Le pourcentage cumulé est calculé ainsi qu'il suit : la classe initiale étant maintenue, tout se
passe comme si on part de zéro (0) et la progression se fait par une addition du pourcentage cumulé de la classe de haut avec le pourcentage simple de la classe du bas.
-Pour l'Etape 3 de Pareto c'est le montage graphique à savoir la construction de l'histogramme et la courbe de variation du pourcentage de chaque type de scénario et leur pourcentage cumulés respectivement.
? Etape 1 :
|
Type de scénario |
Manifestation du type de scénario à |
Fréquence d'occurrence |
|
risque technique |
||
|
A |
Risques d'électrocution |
09 |
|
B |
Risques liés à la manutention mécanique |
12 |
|
C |
Risque de chute |
04 |
|
D |
Risque lié au bruit (pollution sonore) |
02 |
NB : Total de Fréquences d'Occurrence des Risques Techniques = 27
(09+12+04+02=27)
114
? Etape 2 :
|
Type de scénario |
Manifestation du type de scénario à |
Fréquence |
Pourcentage (%) |
Pourcentage Cumulé |
|
risque technique |
d'occurrence |
|||
|
B |
Risques liés à la manutention mécanique |
12 |
44,45% |
44,45% |
|
A |
Risques d?électrocution |
09 |
33,34% |
77,79% |
|
C |
Risque de chute |
04 |
14,81% |
92 ,06% |
|
D |
Risques liés au bruit (pollution sonore) |
02 |
07,40% |
100% |
Total = 27 Etape 3 :
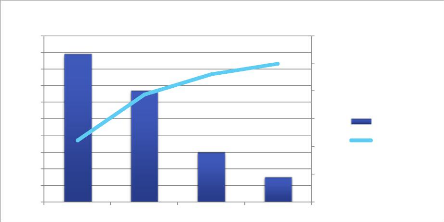
45%
40%
25%
20%
50%
35%
30%
15%
10%
0%
5%
scénario B scénario A scénario C scénario D
44,45%
Figure 17: Diagramme de Pareto démontrant la fréquence
d'occurence des risques techniques
44%
77,79%
33%
92,06%
15%
100%
7%
40,00%
80,00%
60,00%
20,00%
0,00%
120,00%
100,00%
Fréquence en % % Cumulé
Le diagramme de Pareto sur les risques techniques a permis de hiérarchiser les problèmes (scénarii à risques) en fonction de leurs fréquences d'occurrence et ainsi de définir les priorités dans le traitement des problèmes. Autrement dit cet outil met en évidence les 20% de causes sur lesquelles il faut agir pour résoudre 80 % des problèmes techniques sur le chantier. Il a démontré que la priorité pour CAMWATER et ses partenaires du projet sera de résoudre les risques significatifs qui comptent pour environ 80% des risques techniques à
115
savoir : le risque lié à la manutention mécanique et le risque d'électrocution et autres phénomènes liés au contact de l'énergie électrique dans le chantier.
d'Occurrence :
? Etape 1 :
|
Type de scénario |
Manifestation du type de scénario à |
Fréquence d'occurrence |
|
risque technique |
||
|
A |
Risques de pollution et explosion |
05 |
|
B |
Risques liés au manque d'hygiène |
28 |
|
C |
Risques de glissement de terrain |
15 |
|
D |
Risques de conflit socio-culturel |
24 |
NB : Total de Fréquences d'Occurrence des Risques Socio- Ecologiques= 72
? Etape 2 :
|
Type de scénario |
Manifestation du type de scénario |
Fréquence |
Pourcentage (%) |
Pourcentage Cumulé |
|
à risque socio-culturel |
d'occurrence |
|||
|
B |
Risques liés au manque d'hygiène |
28 |
38,89% |
38,89% |
|
D |
Risques de conflits socio-culturels |
24 |
33,34% |
72,23% |
|
C |
Risques de glissement de terrain |
15 |
20,83% |
93,06% |
|
A |
Risques de pollution et explosion |
05 |
06,94% |
100% |
Total = 72
Etape 3 :

Figure 18: Diagramme de Pareto démontrant la fréquence d'occurence des risques socio-écologiques
45%
40%
25%
20%
35%
30%
15%
10%
0%
5%
scénario B scénario D scénario C scénario A
38,89%
39% 33%
72,23%
93,06%
21%
100%
7%
40,00%
80,00%
60,00%
20,00%
0,00%
120,00%
100,00%
Fréquence en %
% Cumulé
116
Le diagramme de Pareto pour les scénarii à risques socio-écologiques, révèle que les scénarii de type B et D à savoir : les risques liés aux manques d'hygiène et les risques de conflits socio-culturels respectivement comptent pour environ 80% des problèmes socio-écologiques rencontrés sur le terrain. Ceci est en raison des pratiques sanitaires qui ne respectent pas les règles d'hygiène du milieu par les populations riveraines et la pression des activités urbaines exercées sur le sol (espace réservé à la pose des canalisations). Ceci augmente la probabilité des éventuelles cassures des tuyaux d'alimentation de l'ancien réseau. En outre, l'obligation de la libération des trottoirs occupés par les populations sur l'emprise du tracé réservé au réseau d'eau potable a été l'instigateur d'importantes discussions et conflits à répétions dans les sites des travaux.
Tableau 11 : Synthèse des Risques Environnementaux sur l'axe Agip au Rond-Point Deido
|
Degré de Risque |
Type de Risque |
Les Scénarii |
|
SIGNIFICATIF |
Risques Techniques |
+ Risques liés à la manutention mécanique + Risques d'électrocution et autres phénomènes liés au contact de l'énergie électrique. + Risques de chute |
|
Risques Socio-Culturels |
+ Risques liés au manque d'hygiène + Risques de conflit socio-culturel + Risques de glissement de terrain |
|
|
PEU SIGNIFICATIF |
Risques Techniques |
+ Risques liés au bruit (pollution sonore) à courte -durée. |
|
Risques Socio-Culturels |
/////////////////////////////////////////////// |
117
Il est important de souligner que « il n'existe pas de risque 0 ». Il existe très peu de risque environnemental moins important dans le projet CAMWAETR Phase II. Ceci est en raison du fait que tous les scénarii à risques dans le cadre du projet ont des impacts considérables sur l'environnement immédiat. On peut donc conclure que le risque environnemental négligeable pour ce projet n'existe presque pas.

Degré en %
40,00%
80,00%
70,00%
60,00%
20,00%
50,00%
30,00%
10,00%
0,00%
Etape A: scénario de déclenche ment des pratiques
Début (Phase 1) Milieu (Phase 2) Milieu (Phase3) Fin (Phase 4)
Figure 19: Cycle d'Evolution des Risques Environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II
0,50%
75% 75%
Dégré d'Evolution en %
Etape B:
manifestations des risques
Temps
Etape C: Détermination des mesures d'appaisements
20,00%
Les trois étapes qui ressortent l'évolution du risque environnemental dans le projet, caractérisent les aspects clés du projet à savoir : le cadrage (étude de faisabilité), la mise en oeuvre et la période post-projet (après la mise en oeuvre). L'étape A défini les actions émisent par la CAMWATER, ses partenaires et l'Etat Camerounais sur le plan environnemental qui ont instigué des manifestations favorisant l'occurrence des risques dans la mise en oeuvre du projet.
L'étape B par contre démontre « le seuil » de l'occurrence des risques environnementaux dans le projet. Elle est caractérisée par la fréquence et la gravité de l'occurrence des risques accidents techniques ayant entrainé par exemple la mort d'un ouvrier par électrocution survenu en Novembre 2013 sur le chantier d'Akwa Nord à Bonamoussadi ; les fréquentes
118
glissements de terrain « à petite échelle » dans la zone de Village à Mboko lors de la pose des canalisations et au carrefour « trois morts » sur l'axe Agip au Rond-Point Deido.
Enfin l'étape C qui définit la prise en compte de l'occurrence d'une crise et la mise en oeuvre des mesures de régulation pour réduire le risque. Cette phase s'étend jusqu'à la période après le projet. Cette étape définit le cadre pour l'élaboration d'une stratégie intégrée comme celle que nous nous proposons de mettre sur pied dans cette étude.
Nous pouvons donc définir notre model stratégique comme suit :
Stratégie Intégrée = Prévention + Protection
Stratégie Intégrée = Réduction de la fréquence d'occurrence du risque (Prévention) + Réduction de la gravité du risque (Protection)
Figure 20 : Schéma basé sur une Technique de l'Ingénierie dans la Gestion des Risques

Source : Nandrianina ANDRIANARISON ÀAMADOU, (2000)
119
L'Etat du Cameroun par l'intermédiaire de la Cameroon Water Utilities Cooperation, maître d'ouvrage qui détient son autorité pour le projet de renforcement et amélioration de l'alimentation en eau potable à Douala, a instauré la prise en compte sérieuse de tous les aspects liés à la dégradation de l'environnement au sein du dit projet. Le volet environnemental du projet, malgré le fait qu'il ne soit pas strictement structuré, défini son champ d'action sur deux dimensions à savoir : la préservation de la biodiversité le long du tracé de la pose des canalisations et la gestion des conflits sociaux externes entre les populations riveraines et l'exécuteur des travaux. D'où l'implémentation au sein du projet d'une politique environnementale et sociale spécifique qui prend en compte les aspects Hygiène, Qualité et Sécurité (HQS) mais aussi la gestion des risques de l'environnement du projet.
La théorie de l'Amélioration Continue à travers le modèle Anglo-saxon du Plan-Do-Check-Act (PDCA) qui signifie en langue Française : Planifier, Mettre en oeuvre, Contrôler et Agir, pour les besoins de cette étude a considéré les normes ISO 31000,14001 et 9001 qui définissent les lignes directrices destinées à fournir un guide ou une assistance générique à une institution (organisme, entreprise ou communauté) en vue de la mise en oeuvre d'un système de management des risques et la gestion de l'environnement et de la qualité respectivement. Dans le cadre de cette étude, afin d'élaborer une politique environnementale et sociale pour le management des risques au sein du projet, il était question de : définir uniquement les procédures dans la mise en oeuvre de chaque processus. Ici l'attribution des rôles et la responsabilité des acteurs dans leurs champs d'action respectifs est établie afin d'instaurer les mesures d'amélioration du système. Les quatre dimensions du PDCA constitueront donc les axes majeurs de la politique environnementale et sociale du projet CAMWATER Phase II.
120
Tableau 12: Démonstration du model PDCA
dans l'élaboration des procédures pour la
mise en oeuvre de
la politique environnementale et sociale du projet CAMWATER Phase
II
|
Les Axes du model PDCA |
Les procédures dans la mise en oeuvre d'une politique environnementale et |
|
sociale pour la gestion des risques |
|
|
PLAN |
+ La définition du promoteur du projet (CAMWATER) sur sa vision du volet environnemental et social et la gestion des risques (engagement de la direction) + L'élaboration par le promoteur des objectifs et cibles envisagés pour la réalisation du projet. + La définition du cadre réglementaire et législatif au sein du projet. + La définition des actions à mettre en oeuvre
(identification et classification + La définition des secteurs d'intervention (HSE, analyse qualité, médiation sociale, travaux publics, communication, GRH...) + la définition des critères pour le recrutement des ressources compétentes. + La définition des rôles et responsabilité de chaque acteurs (le promoteur CAMWAETR, l'exécuteur CGCOC et les partenaires parties prenantes du projet (CDE, A2D, BETA Consult, CUD...) |
|
DO (Mettre en oeuvre) |
+ Etablir un système de développement des compétences (formation des acteurs et du personnel recruté au sein du projet sur la Santé, la gestion de l'environnement, la Sécurité au travail, la prévention et gestion des catastrophes) + Etablir une stratégie de communication interne et externe relative aux aspects environnementaux et la gestion des crises au sein du projet. + Etablir des procédures techniques par secteur d'intervention (gestion des risques et catastrophe, communication environnementale, gestion de la qualité de l'eau issue du projet et résolution des conflits sociaux...) + Etablir un plan de crise qui sera utilisé seulement
lors des situations |
|
CHECK |
+ L'élaboration des procédures et des indicateurs de mesurage et suivi des pratiques des acteurs parties prenantes du projet. + Définir un système de détermination des performances et de contrôle des opérations sur le chantier (externe) + Etablir des audits internes-externes et l'évaluation de la conformité des processus relatifs aux dispositions prévues dans le cahier de charge du projet. |
|
ACT |
+ La mise sur pied d'une revue de direction qui aurait pour objectif : débattre sur les résultats de l'audit interne du projet,
l'évaluation des activités + La proposition des mesures correctives par voie d'une recommandation afin d'améliorer la politique établie |
121
On peut donc dire que la diversité des 'informations qui ressortent de ce chapitre témoigne la complexité de l'activité de « management des risques environnementaux» notamment dans leur dimension politique au sein du projet. L'état des lieux des différents sites du projet avant, pendant et après la mise en oeuvre de la pose des canalisations sur l'axe carrefour Agip au Rond-Point Deido et la zone de cimetière à Bonaberi Nouvelle Route est remarquable. Les analyses faites sur l'aspect orientation dans la gestion du risque se sont portées, d'une part sur le management de l'environnement politique et économique pour la conception et le financement afin de déterminer les enjeux autour du projet CAMWATER phase II. Ici tout est focalisé sur les attentes des citadins qui vivent dans une situation de stress hydrique constante mais aussi dans une précarité sanitaire accrue. D'autre part, le management de l'environnement écologique, social et sécuritaire a permis d'avoir une idée du contexte dans lequel le projet était réalisé et suivi. Suite à l'identification et la classification des scénarii à risque au plan technique et socio-écologique le degré de significativité des différents scénarii à risque a été établi. Ceci a permis de développer des procédures suivant le model PDCA qui met en exergue la théorie de l'amélioration continue afin de définir un guide pour la gestion des risques au plan environnemental et social pour le projet.
Pour répondre à la question de savoir si il existe une politique de gestion des risques environnementaux au sein du projet, il nous a été donné de constater des actions allant dans ce sens comme la médiation sociale et d'autres sur le chantier malgré le fait qu'elles ne soient pas bien structurées pour réduire au maximum l'occurrence des accidents de travail et la dégradation des espaces de vie dans les endroits où le projet est passé. On peut mentionner entre autres : la décision de l'administration du projet de dévier le tracé face aux obstacles pouvant causer des dommages importants sur l'environnement ; la médiation sociale pour palier au problème de conflit entre les populations riveraines et l'exécuteur du projet ainsi que le sondage des sites avant la pose des canalisations...
En définitive, on peut dire que de par l'analyse du système environnemental du projet, l'hypothèse selon laquelle : l'application de la politique de gestion des risques est un facteur contraignant du management environnemental au sein du projet serait une réalité. Le manque d'un plan structurel de gestion spécifique des risques environnementaux serait donc la principale lacune du système managérial du projet CAMWATER Phase II.
122
Les activités anthropogènes sont généralement au centre de la dégradation de l'environnement .Ceci impliquerait que les pratiques des acteurs du projet seraient à l' origine de l'occurrence du risque environnemental. Compte tenu de l'importance des actions posées par les institutions parties prenantes du projet phare d'adduction d'eau potable à Douala, il nous a semblé nécessaire de savoir quelles sont les pratiques des acteurs qui contribueraient à réduire l'occurrence des risques environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II. Il est question dans ce chapitre de mettre en exergue les pratiques de ces acteurs par secteur d'activité et de procéder à une analyse qui nous permettrait de voir le degré d'implication de chacun d'eux dans la gestion des risques environnementaux au sein du projet. Notre démarche consiste à mettre à contribution tous les acteurs importants notamment le promoteur du projet et ses différents partenaires dans la réalisation des ouvrages, les Organes de Gouvernance Locale (OGL), et les populations riveraines le long du tracé de pose des canalisations.
Le MINMEE a joué un rôle capital dans la phase qui a précédé la mise en oeuvre du projet. Il a été la cheville ouvrière du projet de renforcement et amélioration dans l'alimentation en eau potable à Douala dans ces phases I et II. Il a permis en association avec la CAMWATER de finaliser le choix de CGCOC entreprise des travaux public Chinoise et EXIME BANK of China comme exécuteur du projet et bailleur de fonds respectivement. Ceci a été facilité par le fait que M. Basile ATANGANA KOUNA ancien Directeur Général de la CAMWATER et devenu Ministre des Mines de l'Eau et de l'Energie. Il a donc suivi ce dossier de prêt pour qu'il soit finalisé dans les délais prévus par le Gouvernement.
Sur le plan spécifique en ce qui concerne la thématique de cette étude, le MINMEE est l'institution étatique majeure sur laquelle repose le projet d'adduction d'eau potable à
123
Douala. Pour cela il a joué le rôle de coordinateur général pour le compte du gouvernent et l'autorité de l'Etat a été déléguée à CAMWATER pour la mise en place des infrastructures de production d'eau potable dans les zones urbaines et péri-urbaines. Pour cette raison sur le plan de la supervision, le MINMEE s'assure de la qualité des travaux effectués par le porteur du projet et veille à ce que la mise en oeuvre se fasse en respectant la réglementation Camerounaise, c'est-à-dire en fait, sans accidents majeurs, en préservant les valeurs culturelles et sociologiques du milieu où est effectué le projet et en réduisant le risque d'une dégradation de l'environnement tout le long du tracé des canalisations de la phase II du projet.
Afin de mettre en exergue les efforts du MINHDU, le ministre Jean-Claude MBWENTCHOU recommande certains mesures importantes à prendre par les acteurs du Projet de Développement des secteurs Urbains et de l'approvisionnement en Eau (PDUE). Dans son propos, il dit : « J'invite les Comités de Développement des Quartiers à bien vouloir continuer leurs actions de développement pour la pérennisation des ouvrages mis en place par le Projet. J'exhorte également les magistrats municipaux à s'approprier tous les outils d'orientation et de décision mis en place en vue d'améliorer leurs capacités de planification et de programmation. Il s'agit plus précisément de la stratégie nationale de développement du sous-secteur urbain, des stratégies de développement des villes de Yaoundé, Douala, Bamenda, Maroua et Mbalmayo, des programmes d'investissement et d'entretien prioritaires des infrastructures, équipements et services urbains des Communes d'Arrondissement de Yaoundé 3, Yaoundé 4 et Douala 2, des fichiers du contribuable, des fichiers d'assainissement des comptes en cours d'élaboration, etc. »1
1-Entretien donné à la CRTV par M. Jean-Claude MBWENTCHOU, Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, par ailleurs Président du 8ème Comité de pilotage de la Coordination du Projet de Développement des secteurs Urbains et de l'approvisionnement en Eau (PDUE), le vendredi 28 mars 2014 au Hilton Hôtel à Yaoundé.
124
Ces outils instigateurs d'un développement urbain mentionné par le Ministre
MBWENTCHOU parmi tant d'autres sont capitaux dans la définition de la démarche du
Cameroun vers le développement des villes durables
notamment dans son volet
environnemental. Il serait donc urgent de mettre
sur pied des stratégies environnementales
qui permettront la valorisation et l'accès
à ces ressources naturelles (plus particulièrement
l'eau
potable) par le PDUE en conformité avec le plan d'action gouvernemental
et les objectifs du millénaire. Cet aspect est en phase avec le
projet CAMWATER Phase II qui vise non seulement a augmenté la
quantité en eau potable de 150,000 M3 / Jour à 250,000
M3 / Jour, mais aussi à améliorer la qualité
des services pour une eau fiable (potable) et surtout promouvoir la
protection de l'environnement dans lequel cette eau est
produite et distribuée (de la source de captage au verre du
consommateur).
L'action menée par le MINATD est celle d'une administration de proximité. Ceci s'explique à travers la descente majeure du représentant du Ministre en la personne de M. Nasri BEYA, le Préfet du Wouri. Sa présence la plus remarquée était celle qui a accompagné la cérémonie de présentation du plan de développement de CAMWATER le 22 Août 2013. Ladite cérémonie s'est terminée par un tour dans les différents chantiers du projet dont les sites de pose des canalisations, les sites de constructions des châteaux d'eaux, le pont-tuyau sur le fleuve Wouri.
Nous relevons que dans une interview consécutive à cette visite, le préfet a interpeller les populations de Douala et particulièrement celles sur le tracé de pose des canalisations à plus d'engagement personnel pour faciliter la mise en oeuvre du projet. Cette intervention est venue en soutien des activités mener par A2D dans le cadre de la médiation sociale de ce projet. L'interpellation du préfet s'adresse également aux autorités traditionnelles pour une forte mobilisation afin de susciter en leurs populations des actions citoyennes et beaucoup de civisme. Mettant en exergue l'importance socio-écologique du projet, le préfet insista pour
que l'entreprise CGCOC exécuteur des
travaux prenne en compte les aspects
environnementaux dans la mise
en oeuvre des opérations.

125
Photographies 19 et 20 :
Cérémonie de présentation du plan de développement
de CAMWATER le 22
Août 2013 démontrant l'interview
donnée aux médias par M. Nasri BEYA préfet du Wouri ;
M.
William SOLO DG de CAMWATER et Dr. Fritz NTONE NTONE
Délégué auprès de la Communauté
Urbaine
de Douala
Source : Médiation Sociale 2013, Cliché : Essapo Daniel

Photographie 21 : Descente
de M. le sous-préfet de l'Arrondissement de Douala 3eme sur
le site de
construction du château d'eau de Nyala accompagné de
M. le chef de projet CAMWATER PHASE II
et Mme. Le Directeur de l'A2D
responsable de la médiation sociale
Source : Médiation Sociale 2013, Cliché : A2D
126
En ce qui concerne la Communauté Urbaine de Douala, il est important de souligner que la ville ne dispose pas encore d'un plan d'action spécifique pour la mise en oeuvre des procédures environnementales au sein des projets importants de développement de la ville comme celui de l'alimentation en eau potable. Toutefois, ses actions s'appuient sur la loi cadre N° 96/12 du 5 Août 1996 portant sur la gestion de l'environnement et l'arrêté N° 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. Afin d'améliorer la qualité des infrastructures urbaines et l'état de l'environnement dans le but d'augmenter le potentiel économique et social et de préserver l'écologique dans la ville, la CUD a mis en oeuvre un programme annuel de plantation des arbres. Ces outils d'aide à la décision validés par les conseils municipaux des six arrondissements sont aujourd'hui intégrés dans le programme de développement de Douala. A titre d'exemple, nous pouvons mentionner : la Stratégie de Développement de la Ville de Douala et de Son Aire Métropolitaine, « l'Agenda 21 local de la ville de Douala », le Plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Douala. Ces trois programmes qui sont des outils d'aides à la décision instituée entre 2008 et 2012 démontrent la motivation des gouvernants de la ville de Douala pour l'amélioration des conditions de vie des populations.
Cette étude ressort une certaine complexité du système à travers les politiques instituées. Il nous a donc semblé nécessaire de faire une « SWOT Analysis » qui est une démarche anglaise qui signifie: Strenght-Weaknesses-Opportunity-Treats (Force, Faiblesse, Opportunité et Contraintes). L'objectif de cette démarche est de faire une analyse des contours des trois politiques mentionnées plus haut à savoir : l'Agenda 21 local de Douala, la Stratégie de développement de la ville de Douala et de son aire métropolitaine et le Plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025.
127
Tableau 13 : SWOT Analysis des Politiques de la ville de Douala Sur La Gestion Du
Risque Environnemental Et L'eau Potable Comme Ressource Naturelle
|
TYPE DE POLITIQUE |
Strength |
Weaknesses |
Opportunity |
Threats (contrainte /menace) |
|
Cette politique est l'une |
Elle a manqué de faire |
Elle a permis la |
Le manque des fonds |
|
|
Agenda 21 Local |
des premières du genre |
un état des lieux |
valorisation des actions |
pour réaliser toutes les |
|
de la ville de |
comme stratégie de |
exhaustif de |
émises par la CUD |
mesures implémentées |
|
Douala |
développement en milieu urbain en Afrique sub- |
l'environnement à Douala par les |
dans la lutte contre la pauvreté et |
afin de restaurer l'environnement et la |
|
saharien conformément |
territorialités |
l'amélioration des |
qualité de l'eau potable |
|
|
aux résolutions du sommet |
(arrondissements) afin |
conditions de vie des |
dans les zones |
|
|
de la terre de Rio en |
de déterminer les aspects |
populations de Douala |
périurbaines et les |
|
|
1992.Elle souligne |
les plus significatifs des |
afin d'être en phase |
quartiers précaires de |
|
|
certains axes majeurs ou l'action doit être accentuée (protection de la biodiversité, gestion des eaux usées et eau potable) |
différentes municipalités pour hiérarchiser le besoin des populations. |
avec les OMD. |
la ville de Douala. |
|
|
Cette politique est |
Elle a tendance à avoir |
Elle met en exergue un |
Le manque de |
|
|
globalisante. Elle regroupe |
une orientation plus |
vaste chantier pour les |
dynamisme dans le |
|
|
en son sein plusieurs |
économique que sociale |
investissements futurs |
processus de |
|
|
autres dont l'agenda 21 de |
et écologique. Les |
dans le domaine de |
développement traduit |
|
|
la ville et le PDU. Elle fait |
indicateurs économiques |
l'industrie mais aussi |
par un faible suivi et |
|
|
Stratégie de |
état de la vision de Douala |
ont de l'ascendance sur |
dans des projets socio- |
évaluation à mi- |
|
développement de |
pour être une ville |
la pertinence de la |
environnementaux |
parcours par les |
|
la ville de Douala |
émergente en 2035 en |
qualité du milieu |
comme l'adduction |
institutions concernées |
|
et de son aire |
faisant ressortir les |
(aspects |
d'eau potable et autres |
et la lassitude des |
|
métropolitaine |
grandes lignes des |
environnementaux |
gouvernants dans le |
|
|
différents programmes et projets de la ville. |
relatifs à la dégradation des écosystèmes et la perte des ressources naturelles) |
respect des délais. |
128
|
Strength |
Weaknesses |
Opportunity |
Threats (contrainte /menace) |
|
|
Il est une amélioration |
Il a manqué d'instaurer |
Au point de vue des |
||
|
continue du SDAU de |
les directives ou des |
investissements, il a |
Institués depuis déjà |
|
|
Plan Directeur |
1983. Il a réussi à faire un |
procédures |
permis d'associer la |
près de cinq ans, les documents jumelés |
|
d'Urbanisme à |
état des lieux exhaustif de |
environnementaux |
société civile et les |
PDU-POS qui à |
|
l'horizon 2025 |
la ville notamment par son potentiel environnemental. |
spécifique à la mise en oeuvre des différents |
partenaires nationaux et internationaux |
l'origine devaient |
|
Il sert de guide pour la |
projets encours relatif à |
comme l'AFD dans la |
servir de vitrine pour la |
|
|
CUD dans la planification |
la gestion des ressources |
mise en oeuvre des |
ville à travers son plan |
|
|
des études et des projets |
en eau notamment ceux |
actions importantes |
d'action, accusent une |
|
|
de développement à long |
de l'adduction d'eau, |
dans la ville |
défaillance dans leur mise en oeuvre. Bon |
|
|
terme, notamment l'eau |
gestion des eaux |
contribuant au bien- |
nombre de projets sont |
|
|
potable. |
pluviales et eaux usées |
être des populations de |
encore à la phase de |
|
|
conformément à la norme ISO 14001. |
Douala. |
faisabilité et d'autres pas encore lancés. |
||
|
Cette lenteur notoire du système en place est une contrainte pour |
||||
|
Douala qui envisage être durable en 2025. |
Il y'a donc lieu de dire que à travers cette analyse des politiques locales, dont notre cas est celui de la ville de Douala, la gestion de l'environnement dans son ensemble est devenue au fil des années un volet incontournable pour le développement durable des métropoles. La prise de conscience progressive de certains gouvernants et l'implication accrue de la société civile ces cinq dernières années, pour l'assainissement du cadre de vie des populations est remarquable.
Malgré cette vision du développement beaucoup reste encore pour espérer amener la ville de Douala a un seuil économiquement, écologiquement et socialement durable d'ici 2025 selon son plan.
129
Au terme du contrat d'affermage qui lie l'Etat avec la CAMWATER pour le service public de l'alimentation en eau potable des centres urbains et périurbains, cette dernière est responsable des ouvrages de captage, de forage et de potabilisation de l'eau ainsi que de la mise en place des infrastructures majeures de distribution conformément aux normes de l'OMS et de l'ANOR. Dans le cadre du projet CAMWATER phase II, c'est le cas de la station de captage et de traitement de Yato dans l'arrondissement de Dibombari département du Moungo, des grandes canalisations qui transporte l'eau traité à travers l'arrondissement de Douala IV, le pont-tuyau qui traverse le fleuve Wouri , les châteaux d'eau de Bonaberi, Koumassi, Nyala, Logbessou et les forage complémentaire de Deido et de Massoumbou

Photographies 22 et 23 : Visite du DG de la CAMWATER dans le cadre du projet aux agricultures de la zone de Yato dans le Mungo
Source : Projet CAMWATER Phase II, Juillet 2013, Cliché : A2D
De ces clichés, il ressort l'action dynamique de la direction de la CAMWATER pour une bonne marche du projet. Elle démontre une responsabilité avérée de l'entreprise à travers la présence sur le terrain de M. William SOLO, son Directeur Général. Ainsi, elle permettra aux populations de cette localité de se sentir impliqués dans le cadre du projet par leurs pratiques environnementales compatibles pour une promotion de « l'économie verte » et de la préservation de la biodiversité qui consiste à réduire des actions non-écologiques sur les rives du fleuve Moungo.
130
Le contrat d'affermage lie également la CDE à la CAMWATER pour le service public de l'alimentation en eau potable des centres urbains et périurbains. En effet, c'est cette société partenaire de la CAMWATER qui est chargée de la distribution de l'eau potable produite à Yato dans toute la ville de Douala jusqu'aux robinets des consommateurs.
Ledit contrat défini sur le plan juridique le droit d'exploitation des moyens de production, de transport et de distribution, qui font partie du patrimoine de l'Etat. Celui-ci dans son Article 5 donne mandat à la CDE de produire, de transporter et de distribuer de l'eau potable sur toute l'étendue du territoire affermé.
M. Brahim RAMDANE, le Directeur général de la CDE lors d'une communication interne en Juin 2012 dit que « la performance en matière de gestion dans le secteur de distribution en eau potable est un résultat ultime de l'ensemble des efforts de chaque employé de la CDE. Ceci consiste à faire les bonnes choses, de la bonne façon, rapidement, au bon moment, au moindre coût pour produire les résultats répondant aux besoins et aux attentes des clients et plus généralement les parties prenantes de l'entreprise. Ceci nous permettra d'attendre les objectifs fixés ». Ces mots déterminent l'engagement de la direction de la CDE à travailler avec dynamisme et efficacité pour le développement d'un Cameroun émergent en conformité avec l'OMD 7 relatif à l'approvisionnement en eau potable. Pour cela, elle s'est donné des objectifs afin de contribuer activement à la lutte contre le choléra et autres maladies hydriques. Ces objectifs pour la période 2008 et 2013 visaient à d'améliorer les branchements en eau potable de près de 60% soit un total d'environ 5000 branchements d'eau potable, la pose de 10 000 compteurs, l'utilisation de 100% de la capacité de production et l'amélioration du rendement commercial de 5 points au moins.
Gérard NGAUSS NDOUNG, Chef de Division Gestion Prévisionnelle des Ressources Humaines (GPRH) spécifie le fait que « selon un constat, il existe au sein de la CDE un déficit du personnel technique et une surpopulation du personnel administratif notamment dans les services de la qualité et de l'exploitation. Ceci a un impact considérable sur la sécurité du réseau dans certains quartiers de la ville dû au manque de personnel qualifiés sur le terrain sur qui on pourrait compter pour booster une certaine amélioration de la qualité de l'eau dans les ménages ».
En 2012, dans la mouvance le la réalisation du projet CAMWATER Phase I et la faisabilité de la phase II, la CDE a mis sur pied trois grandes formations pour ses cadres du
131
pôle industriel afin de renfoncer les capacités du personnel. Ces formations avaient pour objectif majeur de contribuer à l'amélioration des compétences des acteurs du service de l'eau potable au Cameroun notamment dans le volet distribution de cette ressource. La formation du personnel en qualité sous le thème « Analyse bactériologiques des eaux traitées et des eaux brutes » en Juin 2012 , celle de Mai 2013 sur l'assurance qualité (norme ISO 17025) et celle de Juillet de la même année pour le service de l'exploitation sur les technologies des réseaux de distribution ont permis une certaine amélioration de la qualité de l'eau , du système de gestion du réseau et d'avoir des connaissances sur la conceptualisation d'un réseau de distribution durable d'eau potable.
Toutefois, nous avons remarqué une certaine faiblesse au niveau du service rendu aux clients à cause de l'insuffisance des effectifs du personnel technique sur le terrain face à l'étendue et l'agrandissement du réseau grâce aux nouveaux branchements. [a dégradation de la potabilité de l'eau dans le réseau reste donc une préoccupation majeure de la CDE et de CAMWATER qui détient l'autorité de l'Etat dans le domaine de l'eau potable.
Grâce à l'axe « développement local » décliné en actions par le dialogue citoyen et l'économie sociale solidaire, le rapprochement des citoyens des services publics, des opérateurs économiques et de la société civile, le développement des projets communautaires et le marketing territorial pour un développement durable encouragés par le Gouvernement, la CAMWATER a sollicité A2D pour assurer le dialogue social du présent projet. A2D est donc l'organisme de médiation dans le projet de renforcement et d'amélioration de la qualité en eau potable dans la ville de Douala. Il s'agit :
? d'Informer les populations sur ce vaste programme des désagréments qui seront causés par les travaux ; les sensibiliser à avoir un comportement citoyen vis-à-vis des équipements qui seront installés.
? d'Impliquer toutes les parties prenantes dans ce processus de préservation de la ressource en eau par la gestion environnementale et sociale.
[a principale fonction sociale de cette mission étant d'analyser et de prévenir tout conflit entre les parties et minimiser les effets négatifs issus des travaux, comme principales sources de blocages du projet.

132
Photographies 24 et 25 :
Information et concertation de l'équipe d'A2D avec
les autorités publiques
administratives pour la sécurisation
des chantiers. Source : Rapport d'activité de
terrain médiation
sociale Août 2013, Cliché
: A2D

Photographies 26 et 27 :
Concertation, échanges et arrêtés des résolutions
avec les
concessionnaires AES-SONEL, CAMTEL et partenaires À
CAMWATER, CGCOC À A2D,
Source :
Médiation sociale Août À septembre 2013,
Cliché : A2D

Photographie 28 :
Concertation et médiation avec les chefs traditionnels, les groupes
impliqués et
les leaders d'opinion pour la libération des
emprises des travaux de stockage à NYALLA et
LOGBESSOU.
Source : Médiation sociale,
Cliché : A2D

133
Photographies 29 et 30 :
Dialogue et Négociation avec les propriétaires des services de
distributions
des produits pétroliers implantés sur
l'emprise des travaux de pose de canalisation. Source :
Médiation sociale Septembre- Octobre 2013,
Cliché : A2D

Photographie 31 : Suivi
régulier des travaux de pose des canalisations sur les différents
itinéraires de
la ville. Concertation entre Mme le Directeur
d'A2D et un représentant de CGCOC exécuteur
du
projet. Source : Médiation
sociale 2013, Cliché : A2D
La CGCOC, maître d'ouvrage de ce projet majeur d'approvisionnement en eau potable à Douala a été la cheville ouvrière de la phase technique. C'est cette entreprise chinoise qui a construit les infrastructures du réseau : les châteaux d'eau de la ville, le réseau de canalisation souterrain et aérien notamment le pont-tuyau sur le fleuve Wouri (un joyau architectural). Sur le plan technique de l'étude, pour ce qui est de son implication comme acteur du projet, la CGCOC a joué un rôle déterminant dans la sécurisation des biens et des personnes dans les différents sites où ont été exécutés les travaux.
Elle s'est assuré particulièrement de la présence effective des équipements de protection individuelle (EPI) pour ses techniciens et les autres acteurs sur le terrain notamment les agents sensibilisateurs. Egalement, les équipements de sécurisation des chantiers ont été
134
produits par elle (balises rouge et blanche de sécurité, panneaux de signalétiques etc..). Ceci avec pour objectif de réduire ou d'éviter au maximum l'occurrence des évènements dangereux au sein du projet.

Photographies 32 et 33 : Les panneaux signalétiques matérialisant la présence du chantier de CAMWATER (32) et la présence du réseau souterrain du gaz industriel à côté du tracé de pose des canalisations d'eau potable (33). Source : Enquête de terrain 2014, Cliché : ESSAPO Daniel.
Il est à souligner que CGCOC pour les besoins de sécurité, a eu à faire de nombreuses déviations face aux obstacles non identifiés lors des sondages et études d'impacts avant la mise en oeuvre du projet. Par exemple la forte présence du passage du réseau de gaz dans la zone industrielle de Bassa et la haute tension souterraine par endroit sur l'axe Agip au Feux rouges Bessengué. Ceci a causé, des imprévus financiers énormes pour l'entreprise Chinoise. Car pour certaines déviations, il fallait passer les canalisations par le milieu de la chaussée en cassant le bitume.
Toutefois malgré son engagement pour la bonne marche du projet, on a noté une certaine prise des risques de certains de ses manoeuvres qui par négligence allaient au contact du réseau électrique rencontré dans le chantier sans être assez équipés pour faire face au risque. Résultat : la perte tragique d'un de leurs personnels manoeuvres de l'équipe B qui a travaillé sur l'axe Akwa Nord à Bonamoussadi au mois d'Octobre 2013, mort électrocuté.

135
Photographies 34 et 35: La pose des
canalisations sur l'axe Agip au Rond-Point Deido au niveau
du
carrefour « Trois morts » zone marécageuse, riche en
réseau souterrains, favorable aux
risques
d'électrocution. Source :
Enquête de terrain Février 2014, Cliché
: ESSAPO Daniel.

Photographie 36 : Les ingénieurs de la CGCOC exécuteur du projet CAMWATER Phase II en plein sondage des réseaux souterrains dans la zone industrielle de Bassa avant la pose des canalisations d'eau potable sur le site. Source : Enquête de terrain Avril 2014, Cliché : ESSAPO Daniel.
L'étude s'est focalisée sur deux acteurs qui nous ont semblé importants dans la gestion des risques environnementaux. Ces acteurs sont AES SONEL devenue ENEO et CAMTEL, tous des artisans du développement global de la ville de Douala. Ces deux opérateurs l'un pour l'électricité (ENEO) et l'autre pour les télécommunications (CAMTEL) ont particulièrement suivi le projet de fond en comble c'est à dire, leur présence effective ont été remarquées lors des réunions de concertation administrative avant et pendant la réalisation du projet.
136
Dans le cadre de la gestion des risques pour ce qui est des opérations techniques, ces acteurs ont joué un rôle capital dans la sécurisation environnementale des sites des travaux par le déploiement de leurs techniciens des réseaux. Nous avons noté une forte présence de CAMTEL notamment sur l'axe lourd Aéroport à Yassa et Yassa à Nyala dans la partie Est de la ville et l'axe Agip au Rond-Point Deido plus au centre-ville. Par contre ENEO a été très actif dans la zone industrielle notamment pour la sensibilité et la vulnérabilité de cette zone riche en potentiel énergétique (haute tension).
Il était question pour ces acteurs de mettre à la disposition du projet des guides pour faciliter le sondage des différents réseaux souterrains avant la pose des canalisations. Leur présence était donc indispensable dans la mise en oeuvre des opérations dans les différents sites. Cette participation de ces acteurs locaux près du maître d'oeuvre a permis un respect strict du plan du réseau des différents opérateurs ainsi que le tracé défini pour le projet par le maitre oeuvre du projet CAMWATER Phase II.
Toutefois, nous avons remarqué une certaine difficulté dans l'agencement des activités de ces acteurs pour une symbiose parfaite au niveau des zones où il fallait absolument établir le réseau d'eau potable ou ceux des télécommunications et de l'électricité étaient déjà installés. Ici un sérieux problème de leadership de ces institutions s'est fait remarquer. Par exemple dans la zone industrielle de Bassa au niveau de PROMETAL et BIOPHARMA sur l'axe Bâti Bois, nous avons noté de fréquents conflits entre les agents d'ENEO qui étaient en pleine opération d'installation de leur ligne d'haute tension et ceux du projet CAMWATER. Ces évènements ont notamment eu un impact considérable pour ce qui est du délai d'exécution des travaux du projet CAMWATER Phase II qui a accusé quelques semaines de retard par rapport aux objectifs définis pour les opérations dans cette zone.

Photographies 37 et 38 : démonstration de la présence des réseaux souterrains sur le tracé :
ligne haute tension pour ENEO et fibre optique pour CAMTEL.
Source : Enquête de terrain Avril 2014, Cliché : ESSAPO Daniel

137
Photographies 39 et 40 Les différentes concertations entre les Agents sensibilisateurs du volet médiation sociale du projet CAMAWTER Phase II en orange et les responsables ENEO sur le terrain.
Source : Enquête de terrain, Avril 2014, Cliché : ESSAPO Daniel
Hors mis les conflits générés par l'implantation des différents réseaux dans les emprises des trottoirs pour ces différents opérateurs, le problème de lenteurs dans le déploiement des techniciens de ENEO, CAMTEL et même CDE pour une prompte réhabilitation de leurs réseaux en cas de collision et autres actions pouvant provoquer des risques d'accident dans les différents sites des travaux, Il y'avait une communication pas très bien établie entre ces acteurs malgré toutes les rencontres dans le cadre du projet d'eau potable à Douala. Ainsi, comme la ville de Douala est en développement et qu'il y'aura toujours des travaux d'infrastructures, l'institutionnalisation d'une plate-forme de concertation sous l'autorité et la coordination de la CUD s'impose.
Les pratiques des autorités traditionnelles, acteurs qui constituent une partie indispensable de la société civile dans le cadre de ce projet ont joué en rôle important. En effet, les autorités traditionnelles ont canalisé toutes les actions développées dans les quartiers pour assurer la bonne marche du projet. Leurs rôle d'instigateur du civisme et des bonnes pratiques citoyennes qu'elles ont su mener auprès des populations a servi de relais pour le volet médiation sociale du projet assuré par l'A2D. L'adhésion des chefs de groupements ou de cantons, des chefs de quartiers, des chefs de block et des leaders d'opinions au plan civique a été un indicateur capital de la cohésion totale entre le promoteur du projet et les bénéficiaires que sont les populations riveraines de ces zones pour l'approvisionnement en eau potable.
138
Sur le terrain dès l'arrivée des équipes d'exécution du projet dans les différents sites des travaux pour la pose des canalisations, la prise de contact avec les autorités traditionnelles a toujours été un déterminant du succès des opérations dans ces zones. L'échange entre les différentes chefs et les équipes du projet a toujours été un producteur des informations importantes sur la zone d'exécution des travaux. L'historique de la zone et la géographie physique et humaine des sites que les chefs présentaient aux équipes des ouvriers donnaient une valeur ajoutée au projet en valorisant l'autorité de ces chefs auprès de leurs populations. Ceci traduit une application parfaite du concept de « participation collective » que voudrait développer l'A2D dans les projets de développement comme CAMWATER Phase II. C'est par exemple le cas de Mboko, Village, Nyala châteaux, Ndogpassi I et II, Logbessou, et Bonantoné où les différentes rencontres avec les chefs de ces zones ont facilité l'organisation des audiences foraines par l'A2D pendant lesquelles les chefs ont réalisé de fortes mobilisations de leurs populations pour des campagnes d'information et sensibilisation des riverains du projet.

Photographies 41 et 42 : l'Implication des autorités traditionnelles et locales dans le cadre du projet d'adduction d'eau potable à Douala. Source : Enquête terrain 2013-2014, Cliché : ESSAPO Daniel.
Pour ce qui est des populations riveraines, leurs pratiques sont marquées par deux tendances. La première est celle qui démontre une adhésion massive des populations au tour du projet facilitant ainsi l'action préventive visant à poser des actes citoyens pour éviter l'occurrence d'un éventuel accident sur les différents sites. Ici l'action principale des populations était de libérer les trottoirs, les emprises des routes où passe le tracé. Le déguerpissement de ces populations impliquait la destruction de leurs baraques et kiosques pour les commerçants et les lieux d'habitations (maison) pour les autres habitants de ces zones. Ainsi le respect des codes sécuritaires des zones de travaux publics était remarquable.
139
La seconde tendance des pratiques des populations riveraines était largement le contraire de la première. Ici le refus de libérer les emprises des routes et les trottoirs pour la plupart des commerçants était remarquable. Ceci avait un impact considérable pour le projet, car il fallait avoir beaucoup de tact de patience et de méthode pour amener ces populations à comprendre l'importance de la mise en oeuvre d'un tel projet, les raisons du choix des sites pour implanter les réseaux ainsi que la nécessité pour elles de quitter les lieux temporairement ou définitivement.
D'autres pratiques négatives ont également été remarquées. Par exemple celles qui sont associées aux pratiques non civiques comme les casseurs des tuyaux de distribution d'eau potable dans les quartiers afin de recueillir de l'eau pour les ménages. Cette activité est généralement pratiquée par les populations non abonnées au réseau de distribution CDE. Il nous a été aussi signalé que celle-ci trafiquent également les compteurs d'eau. Enfin nos observations nous ont permis de remarquer des conditions non hygiéniques et non indiquées pour les lieux où on s'approvisionne en eau potable. La distance entre les réseaux d'égouts, les fosses sceptique, les latrine et les puits d'eau dans les concessions.

Photographies 43 et 44 : Pratiques de
certaines populations riveraines à l'issue de la destruction
d'un
tuyau de distribution d'eau en zone marécageuse sur l'axe Agip À
feux rouge Bessengué.
Source
: Enquête de terrain Janvier 2014, Cliché
: ESSAPO Daniel.
Nous constatons à l'issue de ce chapitre que : la diversité des pratiques effectuées par les acteurs du projet CAMWATER Phase et la Direction Générale de CAMWATER a constamment stimulé les travaux par ses multiples descentes sur le terrain. Ceci démontrerait tout son engagement pour les atteintes de ses objectifs à savoir : améliorer l'offre en eau potable à Douala en contribuant de façons durable au développement de la ville. Ceci a eu pour conséquence la réalisation du projet dans les délais, sans avenant, et avec efficacité.
CAMWATER a piloté le projet en tant que maître d'ouvrage et l'application du principe de « participation collective » lui a permis de faire appel à d'autres acteurs
140
internationaux (CGCOC entreprise des travaux publics Chinoise) et locaux (A2D médiateur
social....).Ces acteurs associés aux maître de la
ville (la CUD) et aux autorités
traditionnelles... ont
démontré chacun à son niveau, comment dans son champ
d'action elle a contribué à préserver l'environnement du
projet en réduisant les risques socio-écologiques et techniques.
L'analyse faite ici a également permis de relever certaines pratiques
des acteurs pas toujours écologiquement louables, notamment celles des
populations riveraines dans certains sites des travaux à savoir : le
vandalisme qui cause la cassure des canalisations, le refus de libérer
la chaussé... .Ceci démontre les difficultés du
système en place face aux risques environnementaux
socio-écologiques qu'il faudrait réduire pour assurer le
bien-être des citadins de la métropole économique de
Douala. Mais ces pratiques seraient contrôlables et maîtrisables
par la médiation sociale.
En effet, notre hypothèse selon laquelle : les pratiques des acteurs sont un facteur déterminant dans la réduction de l'occurrence des risques environnementaux au sein du projet, serait confirmée grâce à la médiation sociale qui dans son sens large impliquait la sensibilisation, l'information, la sécurisation et la prévention. Elle améliore le système de management environnemental pour le projet. Cette contribution pertinente faite par les acteurs majeurs du projet à savoir CAMWATER, A2D, CGCOC et soutenue par la CDE, la CUD, les autorités traditionnelles et la société civile marque un impact considérable pour la
réduction des risques environnementaux dans le projet
d'adduction d'eau potable
CAMWATER Phase II à Douala. Cette
expérience pourrait être exportée et reproduite ailleurs
pour des projets similaires.
141
L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT
Quand on fait allusion aux conséquences qu'ont les
pratiques des acteurs sur
l'environnement immédiat du projet, il nous
vient à l'esprit l'hypothèse selon laquelle l'Impact des
pratiques de certains acteurs contribue à la naissance des risques
environnementaux au sein du projet.
Il sera donc question dans ce chapitre de mettre en vue les répercussions des différentes actions ou activités des acteurs du projet sur l'environnement immédiat. Ici notre regard est focalisé sur trois types d'impacts à savoir : les impacts écologiques, sociaux et économiques. Nous porterons nos analyses sur une évaluation faite à partir d'une adaptation de la matrice de Léopold sur chaque type d'impact afin de ressortir les aspects positifs et négatifs.
? La Matrice de Léopold
De manière globale, cette matrice permet de faire une analyse directe des éléments d'un projet en faisant ressortir les effets positifs ou négatifs d'une action sur l'environnement. En effet, elle met en relations les activités du projet et ses impacts potentiels sur les éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés. Elle peut aussi permettre d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation. Nous pouvons donc dire qu'elle permet une présentation compréhensible des impacts des pratiques opérées par les différents acteurs sur l'environnement du projet. Toutefois, on note au sein de cette matrice certains inconvénients notamment l'entendue de son échelle de cotation et le fait qu'elle ne tient pas toujours compte des aspects temporels et spatiaux.
Pour cette étude, vu la complexité de la matrice originale de Léopold, nous avons choisi d'en faire une adaptation en fonction des éléments du projet. Cette version révisée de la matrice de Léopold nous permettrait de faire une évaluation des impacts des pratiques des acteurs sur l'environnement des sites des travaux afin de ressortir les conséquences des risques environnementaux potentiels.
142
Tableau14: EVALUATIONS DES IMPACTS DES PRATIQUES DES
ACTEURS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
IMMEDIAT : ADAPTATION DE LA
MATRICE DE LEOPOLD
|
EVALUATION DES |
||||||||
|
Catégorie des
Eléments |
Type d'Activité au Sein du |
Inventaire des Scenarii à Risques projet |
Les Acteurs Concernées |
Impact à |
Impact à |
|||
|
Ecologique |
-Pose des canalisations le long du tracé et construction des infrastructures (pont- tuyau et châteaux d'eau) |
-Dégradation des Ecosystèmes des sites des travaux (glissement de terrain, perte de la biodiversité, pollution de l'air et de l'eau) |
-Le promoteur du
projet |
|||||
|
-Restauration des Ecosystèmes (réhabiliter le cadre de vie des différents sites à leur état initial ; déviation de l'itinéraire du tracé face aux potentiels obstacles) |
||||||||
|
Social |
-Gestion des conflits sociaux au sein du projet ; -Le développement de leurs activités dans la ville notamment par la mise en oeuvre de leurs différents réseaux dans les sites ; |
-Risque de conflit socio-culturel entre les populations riveraines et les membres des équipes d'exécution des travaux sur le terrain ; - Cohabitation accrue et cohésion des différents réseaux sur le même tracé. |
-Le partenaire de médiation sociale A2D ; -Les autres acteurs du projet (ENEO, CAMTEL) ; |
|||||
143
|
-Assure la cohésion sociale et l'intégration des notions de participation, responsabilité citoyenne et valorisation de l'environnement au sein du projet |
- Risque lié au manque d'hygiène des populations riveraines (développement des maladies hydriques) Et -Vandalisme des populations sur les infrastructures et le réseau d'eau |
-La société civile et les populations riveraines |
|||
|
-Promotion du développement communautaire (participation collective de la société civile à côté de l'administration pour la réalisation du projet) ; - conscientisation de la population sur les problèmes d'eau potable en milieu urbain ; |
|||||
|
Economique |
-Gestion globale du projet (volet politico-économique) |
-Risque lié à l'organisation du travail (travail dans l'urgence ; lacune dans la communication ; travail aux heures et conditions climatiques inadaptées ; recrutement du personnel inadapté et planning connus tardivement) |
Le promoteur du projet et L'exécuteur du projet |
||
|
- La mise en symbiose des actions développées par les différents acteurs du projet (amélioration considérable du potentiel industriel de ces entreprises) |
Pour ce qui est des impacts écologiques, il est important de souligner le fait que certaines actions posées par les acteurs majeurs du projet à savoir la CAMWATER et la CGCOC ont eu des conséquences positives. Leur engagement pour réduire la dégradation de l'environnement pendant les opérations de pose des canalisations est la raison principale de l'avantage Eco-systémique des travaux. Ils ont notamment permis la restauration de l'écosystème après la pose des canalisations. En effet, il s'agit de la décision prise par le porteur du projet et l'exécuteur des travaux de réhabiliter le cadre de vie des différents sites et de les rendre à leur état initial. C'était une démarche pertinente qui a valu au projet les félicitations des curieux et des passants.
Dans le même cadre, afin de préservé certains espaces d'une destruction massive à cause de la pose des canalisations, la décision de CAMWATER et de la partie technique de modifier l'itinéraire était un exemple d'une décision et d'une responsabilité écologique remarquables. Par exemple sur l'axe aéroport - Yassa au niveau du « village de la sculpture » situé au quartier « Village » il était question d'éviter tous les arbres plantés devant les différentes boutiques. Plus pertinent encore, ils ont permis d'éviter les arbres plantés sur la bande séparation des deux voies de l'axe Yassa - Nyala (route des chinois) quand il était question de faire des jonctions pour les différents réseaux qui vont alimenter les quartiers de cette zone. Ces décisions écologiquement admirables étaient un exemple pour les futurs projets de ce calibre dans la ville de Douala.
Il n'était pas facile de poser les canalisations dans les zones marécageuses. La sensibilité du sol très poreux, les pressions exercées par les engins de travaux publics sur ce sol sont des exemples qui ont favorisé la destruction de l'espace de vie à ce niveau (glissement de terrain). Ceci a rendu la réhabilitation du milieu particulièrement difficile et très chère pour le maître d'oeuvre qui a pour la plupart des cas acheté du sable pour remblailler ces espaces dégradés par les activités liées au projet. Il était également important de souligner que la pose des tuyaux à ce niveau était très contraignante pour les manoeuvres dans le cadre de ces opérations. D'autres exemples de cette nature ont
145
également été observés au niveau des axes tel que Saint-Michel à l'aéroport, carrefour « trois morts » sur l'axe Agip Rond-Point Deido, Mboko à village ...

Photographies 45 et 46 :
Les sites des travaux à sol marécageux : destruction de
l'écosystème
pendant les travaux. Source
: Enquête de terrain 2013- 2014, Cliché
: ESSAPO Daniel.
Sur le plan social, les actions posées par CAMWATER et son partenaire de médiation social A2D ont permis une promotion du développement communautaire. Ceci à travers une participation collective de la société civile à côté de l'Administration pour la réalisation de ce projet de développement urbain. On a noté une forte implication des jeunes à travers une occupation temporaire pour ceux qui ont été des stagiaires et ceux qui ont été recrutés comme agents de sensibilisation pour la médiation sociale. On pourrait alors dire que cette initiative sociale dans le cadre d'un projet de développement comme celui de CAMWATER Phase II à Douala est un exemple à suivre car cette implication de la jeune génération aux actions de développement de la communauté était de nature à promouvoir en eux le sens de responsabilité citoyenne.
Associer à cela les actions de médiation sociale qui ont permis une conscientisation de la population sur les problèmes d'eau potable en milieu urbain en mettant l'accent sur des dangers comme le « cholera » et autres maladies hydriques afin de réduire potentiellement l'occurrence de ces maladies dans la société. Cette conscientisation aura également permis à ces populations de s'impliquer d'avantage à l'avenir dans des projets du même genre.
Ces travaux ont également permis une viabilisation de l'espace urbain par l'amélioration de la structure urbanistique de la ville à travers des équipements et des
146
infrastructures de qualité indispensables pour une ville en voie d'émergence comme Douala. Par exemple le Pond-Tuyau sur le fleuve Wouri et les différents châteaux d'eau réhabilités pour certains et nouvellement construits pour d'autres dans la ville.
Pour ce qui est des aspects négatifs, on peut évoquer les pratiques des populations riveraines pendant et après le projet qui en raison d'un manque de suivi les amènent à vandaliser les biens publics : à casser les canalisations de distribution d'eau potable, frauder les compteurs d'eau, refuser de s'abonner au réseau établi, refuser de libérer les emprises des routes réservées pour les opérations relatives à l'approvisionnement en eau potable dans la ville... Mais nous devons avouer que ni l'Etat, ni CAMWATER ne peuvent pas mettre un gendarme derrière chaque citoyen pour l'amener à respecter le bien public comme les canalisations d'eau potable qui sont une propriété collective de tous les citadins.
La mise en symbiose des actions développées par les différents acteurs du projet, a valu sur le plan économique une amélioration considérable du potentiel industriel de ces entreprises qui se répercute sur l'économie globale de la ville. Il y a donc depuis l'ouverture des vannes pour l'alimentation de la berge Est du Wouri qui s'étend sur la ville de Douala le 10 Décembre 2014, une certaine amélioration dans la productivité du secteur de l'industrie moteur de l'économie de la métropole. Ceci est un avantage majeur pour les industries abonnées au réseau CDE et pour la santé des ménages dont le coût va certainement diminuer grâce à la consommation de l'eau potable.
Nous avons noté au cours du projet une baisse dans la rentabilité économique de certaine zone de la ville en raison d'une perturbation temporaire au niveau du secteur des transports. Les embouteillages causés la pose des canalisations sur les axes clés de la ville comme Agip au Rond-Point Deido en passant par Feux rouge Bessengué, la route des Chinois à Nyala, carrefour Nelson Mandela à Village, la zone industrielle de Bassa etc...ont été des facteurs de déstabilisation du cycle économique de la ville notamment pendant les heures de pointe.
147
Associer à cela, les fréquentes coupures d'électricité et des communications en raison des interventions importantes dans les zones sensibles de la ville pour établir le réseau d'eau, notamment quand -il s'agissait de joindre des canalisations entre l'ancien et le nouveau réseau ou encore quand -il y'avait collision entre ces différents réseaux pendant le projet. Cet aspect a eu un impact fort sur le plan économique et difficile à gérer pour les commerçants et les autres entrepreneurs de la ville. Mais, il faut le dire : « on ne peut pas faire des omelettes sans casser les oeufs » !
A travers cette adaptation de la matrice de Léopold pour faire une évaluation des répercussions des pratiques des acteurs sur l'environnement immédiat, nous constatons une variété des effets positifs et négatifs au sein du projet.
Pour ce qui est des impacts positifs, nous pouvons mentionner entre autre la restauration des écosystèmes des sites du projet, la promotion du développement communautaire par tous les acteurs concernés par le projet y'compris les populations riveraines, la viabilisation de l'espace urbain ...
Toutefois, nous notons beaucoup plus d'impacts négatifs. Ici on peut citer : le glissement de terrain, la perte de la biodiversité, la pollution de l'air et de l'eau, les conflits socio-culturels entre les populations riveraines et les membres des équipes d'exécution des travaux sur le terrain, le vandalisme des populations sur les infrastructures et le réseau (cassure des tuyaux de distribution d'eau potable)...
L'objectif de ce chapitre qui était de spécifier les conséquences qu'ont les pratiques des acteurs sur l'environnement immédiat du projet serait donc atteint et l'hypothèse selon laquelle l'Impact des pratiques de certains acteurs contribue à la naissance des risques environnementaux au sein du projet pourrait être validée.
148
LE PLAN DE GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX (PGRE)
Dans le but de trouver une solution au problème de gestion des risques environnementaux dans la mise en oeuvre d'un projet d'adduction d'eau potable en milieu urbain notamment à Douala, nous nous somme posé une question fondamentale qui est de
savoir si : l'élaboration d'une stratégie
intégrée régulera le phénomène de
risque
environnemental au sein du projet CAMWATER Phase II . La
réflexion à ce niveau nous a amenés à
modéliser un plan qui pourrait contribuer à réduire
l'occurrence des risques environnementaux au sein dudit projet.
Dans cette démarche, nous nous sommes proposé d'élaborer une stratégie intégrée appelée : Plan de Gestion des Risques Environnementaux (PGRE). Cet outil de régulation est développé en cinq grandes parties à savoir : le Cadre Politico-Institutionnel ; la Matrice des Directives Stratégiques et Opérationnelles ; le Cadre Législatif et Règlementaire ; le Capital Humain et les Dispositions Finales. La quinarisation de notre stratégie intégrée permettra d'avoir une vue globale de la valeur ajoutée que se propose d'apporter le PGRE sous forme d'une vision environnementaliste pour l'exploitation de l'eau potable en milieu urbain et l'orientation durable du système de gestion sur le plan politique, économique, écologique, social et sécuritaire.
En considérant les forces et les faiblesses que nous avons observées dans la réalisation du projet CAMWATER Phase II, le cadre politico- institutionnel apporte une réforme majeure sur le plan structurel au niveau de la CAMWATER, institution principale du secteur de l'approvisionnement en eau potable au Cameroun, afin d'assurer la prise en compte des contraintes dans la gestion des risques environnementaux pour un projet d'eau potable en milieu urbain. Cette démarche s'articule autour de « deux unités opérationnelles ». Celles-ci devraient être créées au sein de CAMWATER pour la prévention (les études et le contentieux environnemental et social) et pour la protection (la sécurisation des infrastructures et du réseau de distribution). Il est à souligner que l'unité de protection est celle qui mettra en place une « police environnementale ».des infrastructures et du réseau.
149
La coordination des opérations de gestion des risques environnementaux sera exclusivement faite par la Division de Gestion des Risques et de Protection Environnementale des Infrastructures et du Réseau (DGRPEIR) placée sous l'autorité d'un chef de division dépendant d'un Directeur Technique sous l'autorité suprême du Directeur Général de CAMWATER. Il aura pour mission le management des activités des unités de prévention et de protection dont dépendent quatre cellules techniques et stratégiques à savoir : la Cellule des Etudes d'Impacts et de la Recherche de l'Innovation Environnementale et la Cellule de Gestion du Contentieux Environnemental et Social d'une part ; la Cellule de Sécurisation Environnementale des Infrastructures et la Cellule de Sécurisation Environnementale du Réseau d'autre part.
Cette unité sera constituée de deux cellules à savoir : la cellule des études d'impacts et de recherche de l'innovation environnementale ; et la cellule de gestion du contentieux environnemental et social. Ces deux cellules travaillent en symbiose afin de prévenir l'occurrence de tout éventuel risque environnemental et social dans la mise en oeuvre d'un projet d'adduction d'eau potable en milieu urbain et péri-urbain.
2.1.1- La Cellule des Etudes d'Impacts et de la Recherche de l'Innovation Environnementale. (CEIRI)
Elle aura pour objectif majeur de :
? Développer un cadre de recherche pour une meilleure gestion des aspects environnementaux susceptibles de booster les performances de CAMWATER en tant que détenteur de l'autorité de l'Etat dans le contrat d'affermage avec la CDE en vue de protéger la potabilité de l'eau que cette société distribue à la population.
? D'identifier les signes avant-coureurs du risque environnemental avant la mise en oeuvre d'un projet d'adduction d'eau potable dans les différents sites sur l'étendue du territoire national où CAMWATER aura à développer un projet d'adduction d'eau potable. Cette étude sera faite en renforcement des EIE dudit projet pour confirmation des données.
150
> La CEIRI prendra part dans les concertations en tant que conseil pour la détermination des partenaires environnementaux (bureau d'étude, ONG, Organisme International...) pour la mise en oeuvre ou le suivi des projets ;
> Elle déterminera, en association avec le service responsable de la qualité, le choix des outils permettant une meilleure surveillance des chantiers ;
> Elle assurera la valorisation des capacités du personnel (formation continue, séminaire) en matière de gestion du risque environnemental en interne (au sein du projet) et en externe en collaboration avec le service de la communication et le service de Gestion des Ressources Humaines (GRH).
> Assurer un meilleur management des conflits socio-culturels et écologiques au sein du projet d'adduction d'eau potable
> Mettre sur pied et gérer un cadre de « médiation sociale » effectif qui assurera la sensibilisation, l'information et la concertation avec les autorités locales, les chefs traditionnels, les populations riveraines et les partenaires du projet pour une bonne exécution du cahier des charges des entrepreneurs engagés dans le projet.
> Promouvoir au sein du projet la notion de « participation collective » afin d'assurer l'hygiène et la salubrité dans les emprises pour une gestion prévisionnelle de la pollution par les eaux de pluie de ruissèlement qui sont un danger potentiel pour l'eau potable.
> Participer dans les EIE pour le compte de la CAMWATER dans la mise en oeuvre du dédommagement des personnes touchées par le projet avant le début des travaux.
et du Réseau. (USIR)
Le personnel de cette unité sera essentiellement mobile, parce que projeté sur le terrain au moment de la mise en oeuvre des infrastructures et prépositionnés au niveau des agences de la CDE en tant que police environnementale du réseau pour la sécurisation de la potabilité de l'eau. Elle comprend deux cellules : la cellule de sécurisation des infrastructures et la cellule de sécurisation du réseau.
151
Elle aura pour objectif d'assurer la surveillance environnementale de toutes les infrastructures de production et de stockage de l'eau potable au Cameroun. Il en sera ainsi de :
? Veiller et protéger l'environnement où sont établis les stations de captage et de traitement, les forages, les châteaux d'eau, le pont-tuyau.
? Protéger physiquement ces infrastructures avec la collaboration des forces de maintien de l'ordre et de la sécurité et même les forces de défenses prépositionnés en cas des menaces comme celles que nous imposent les terroristes de Boko Haram.
? Conduire sur le terrain les équipes d'évaluation environnementale des infrastructures (audit interne et externe)
? Suivre les opérations de construction des infrastructures en association avec les services techniques commis à cet effet.
(Police Environnementale)
L'autorité de l'Etat que la CAMWATER assume dans le cadre du contrat d'affermage avec la CDE lui confére juridiquement le rôle de police administrative pour la sécurisation de la potabilité de l'eau que la CDE est chargée de distribuer à la population. Comme la CDE est chargée de la réparation des incidents qui peuvent survenir au réseau, elle se trouve implicitement dans la situation de juge et partie et ne saurait s'empresser de réparer ces incidents, même mineurs comme les cassures des tuyaux d'alimentation, parce qu'elle n'est pas venue au Cameroun pour faire de la charité mais du « business ». Il est donc question pour elle de maximiser ses bénéfices et non de perdre de l'argent pour réparer les incidents d'origine externe comme les cassures des tuyaux d'alimentation des maisons qui ne compromettent pas de façon substantielle ses activités, donc ses bénéfices.
La sécurisation du réseau devrait donc être une activité partagée entre la CAMWATER et la CDE. Les agents de CAMWATER prépositionnés au niveau des agences CDE reçoivent les plaintes des clients et repèrent les incidents sur le réseau comme les cassures des tuyaux, les avaries des compteurs, les baisses de pression etc... avec la collaboration des clients, consommateurs et des populations. Ils les répercutent immédiatement auprès des chefs d'Agence CDE, de préférence à l'aide d'un GPS (Global
152
Positionning System) en temps réel pour éviter les contestations et les palabres inutiles- Dès lors, grâce à l'autorité de l'Etat qu'ils détiennent, ils doivent faire pression sur le chef d'Agence CDE pour que les incidents relevés soient urgemment réparés. Grace au GPS, les Directions Générale et Régionale de CAMWATER seront aussi informées en temps réel de ce qui arrivent au réseau chaque jour à travers le territoire national et pourront évaluer la rapidité avec laquelle la CDE intervient pour réparer ces incidents. Ceci permettra aussi à la CAMWATER d'évaluer la performance de chaque agent commis dans le rôle de police environnementale du réseau pour le maintien de la potabilité de l'eau. Ainsi, la CDE se sentira dans l'obligation de mettre au niveau de chaque agence une Unité Technique d'Intervention Rapide (UTIR) pour réparer au jour le jour les incidents qui arrivent au réseau comme les cassures des tuyaux qui affectent la potabilité de l'eau. Pour le moment, ce n'est pas le cas.
Nous précisons que faire exécuter ce travail par un sous-traitant allonge inutilement la chaine d'intervention de la CDE et dilue sa responsabilité. Il serait nécessaire que cette unité légère d'intervention rapide relève directement de l'autorité du chef d'Agence CDE pour que la chaîne de commandement soit maitrisée et efficace.
Les Agents de la police environnementale de CAMWATER prépositionnés au niveau de chaque Agence CDE seront également chargés de faire des contrôles inopinés de la qualité de l'eau en faisant des prélèvement au niveau des ménages. Ils soumettront à des tests de contrôle de qualité des échantillons prélevés au niveau de la Direction Régionale. Ce suivi des activités de la CDE nous semble nécessaire pour la maîtrise de la potabilité de l'eau que nous consommons. Car « la confiance n'exclut pas le contrôle ! ».
Enfin, s'il est établi que c'est une tiers personne qui a cassé un tuyau d'eau par agression volontaire ou par incident de parcourt, il serait important d'établir une échelle de sanctions en vue de l'application du principe « pollueur-payeur ».
153
Figure 21:
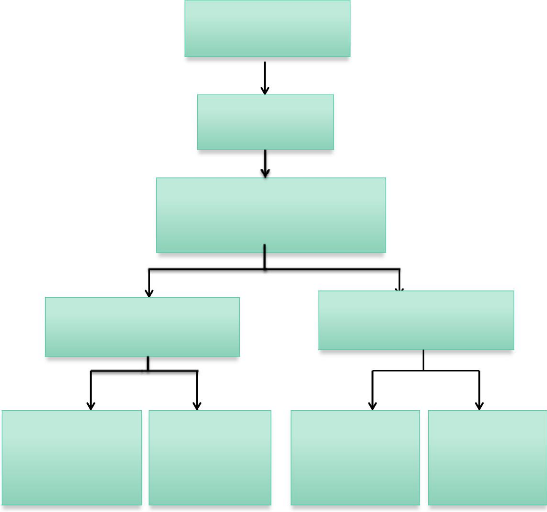
CELLULE DE
CELLULE DE
L'INOVATION
ENVIRONNEMENTALE (CEIRI)
CELLULE DES ETUDES
D'IMPACTS ET DE
RECHERCHE DE
DU CONTENCIEUX
ENVIRONNEMENTAL ET
CELLULE DE GESTION
SOCIAL (CGCES)
INFRASTRUCTURES (CSEI)
SECURISATION
ENVIRONNEMENTALE DES
SECURISATION
ENVIRONNEMENTALE
DU RESEAU (CSER)
UNITE DES ETUDES ET DU CONTENTIEUX ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (UECES)
UNITE DE SECURISATION DES
INFRASTRUCTURES ET DU RESEAU(USIR)
DIRECTION GENERALE DE LA CAMWATER
DIRECTION
TECHNIQUE DE RATTACHEMENT
DIVISION DE GESTION DES RISQUES ET DE
PROTECTION
ENVIRONNNEMENTALE DES
INFRASTRUCTURES ET DU RESEAU (DGRPEIR)
PROPOSITION D'UN ORGANIGRAMME OPERATIONEL
154
Tableau 15 : Synthèse de la Gestion des Risques au sein du Projet CAMWATER Phase II à Douala suivant les six étapes de Joseph ZAYED
|
IDENTIFICATION |
ANALYSE |
PLANNIFICATION |
SUIVI |
CONTROLE |
COMMUNICATION |
|
L'Identification des |
L'Analyse des risques |
La mise sur pied d'une |
Le suivi consiste à la |
Le contrôle met en |
Le modèle de |
|
risques est faite en deux |
des différents scénarii |
planification durable de |
mise en pratique des |
exergue le plan d'action |
communication dans la |
|
parties : |
et leur orientation par |
la gestion des risques a |
activités des |
de la POLICE |
gestion des risques au |
|
les outils tel que |
permis l'élaboration |
structures crées |
ENVIRONNEMENTALE |
sein du projet |
|
|
-La première consiste à |
l'ISHIKAWA, le |
d'une stratégie |
notamment l'unité de |
corps d'agents |
CAMWATER Phase II |
|
faire une identification par |
PDCA, le SWOT et le |
intégrée appelé : Plan de |
Protection pour la |
environnementalistes |
définit la création d'une |
|
l'approche des scénarii à |
PARETO dans le but |
Gestion des Risques |
gestion des |
prépositionnés au sein des |
Plate-Forme de |
|
savoir : les scénarii à |
de ressortir de degré de |
Environnementaux |
infrastructures et du |
agences de la CDE. |
concertation (Médiation |
|
risque technique et les |
significativité des |
(PGRE).Ledit plan |
réseau (Police |
Ils seront chargés de |
sociale) entre le porteur |
|
scénarii à risque socio- |
différents risques a |
définit la création de |
Environnementale). |
recevoir les plaintes des |
du projet, les différents |
|
écologique. |
permis de déterminer |
trois structures |
consommateurs sur les |
partenaires, les autorités |
|
|
les répercussions des |
opérationnelles à |
cassures des tuyaux |
traditionnelles , la société |
||
|
-La seconde met en |
actions opérées par les |
savoir :L'unité de |
d'alimentation et de faire |
civile et les populations |
|
|
exergue l'orientation de la |
différents acteurs du |
Prévention ;et l'unité de |
des prélèvements au sein |
riveraines dans la zone |
|
|
gestion des risques au |
projet au plan |
Protection intégrées au |
des ménages pour un |
de la station de captage |
|
|
plan de l'environnement |
Economique, Social et |
sein de la |
contrôle de qualité de la |
et de traitement de Yato |
|
|
politique, économique, écologique, social et sécuritaire. |
L'Agence de |
potabilité de l'eau. |
ainsi que dans les autres parties de la ville. |
||
|
Régulation du Secteur de l'Eau |
|||||
|
Potable(ARSEP). |
155
Afin d'amélioré le PGRE (Plan de Gestion des Risques Environnementaux) pour une perspective durable, nous proposons en appui aux mesures définies dans le cadre directif qui porte la création des unités de prévention et de protection les l'aspect suivant :
? la responsabilité environnementale du réseau devrait être partagée entre CAMWATER qui détient dans le domaine l'autorité de l'Etat et la CDE qui gère le réseau. Ainsi, un service de police environnementale pour la sécurisation des infrastructures et du réseau (SPESIR) devrait être créé au niveau de la CAMWATER. Il devrait assurer la surveillance quotidienne du réseau. Ses agents seront prépositionnés dans chaque agence de la CDE.
C'est eux qui seront chargés de recevoir les plaintes et les déclarations des populations et des consommateurs sur les incidents, notamment les cassures des tuyaux d'alimentation, les avaries des compteurs, les insuffisances de la pression qui ne parviendrait pas à alimenter le premier étage d'une maison sans suppresseur, alors que la convention avec les consommateurs prévoit que la pression doit pouvoir propulser l'eau potable à dix mètres, soit environ trois étages. Ces agents de police environnementale seront aussi chargés avec l'aide des clients ou des populations concernées de la localisation des points où il y a des incidents et en tiendront informer le responsable local de la CDE pour les réparations.
La mise en place au niveau de la CAMWATER d'un Service de Police Environnementale pour la Sécurisation des Infrastructures et du Réseau (SPESIR) d'eau potable constituerait donc pour nous une urgence pour faire face aux multiples risques environnementaux qui menacent tous les jours la potabilité de l'eau distribuée par la CDE. Grace à ce service, à travers CAMWATER, l'Etat continuera à assurer quotidiennement la garantie de la potabilité de l'eau distribuée dans les réseaux urbains.
Comme il y a en ce moment deux sociétés la CAMWATER et la CDE qui s'occupent de manière complémentaire d'un même objectif à savoir la fourniture de l'eau potable dans nos villes , des incompréhensions et même des conflits pourraient survenir dans l'accomplissement de leurs cahiers de charges respectifs notamment avec l'institution éventuelle de la police environnementale pour la sécurisation des infrastructures et du réseau tel que suggéré dans cette étude. Pour anticiper à cette situation, à l'instar de l'Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité (ARSEL), La création d'une Agence de Régulation du Secteur de l'Eau Potable (ARSEP) nous semble nécessaire pour les arbitrages entre CAMWATER et CDE. La présence de cette Agence ARSEP permettrait au MINEE de se
156
consacrer d'avantage à ses taches régaliennes de conception des projets et de recherche des financements
Pour ce qui est de la gestion de l'environnement de la station de captage et de traitement Yato on observe une intense activité agricole qui impliquerait une menace de pollution accrue de l'eau du fleuve Moungo par l'épandage aérien des produits phytosanitaires et par les eaux usées des usines de SOCAPALM exploitée par Bolloré et larguées dans la nature sans un traitement préalable. Elles créent des mares nauséabondes qui menacent la santé des populations dans l'Arrondissement de Dibombari:
? Le management d'une telle promiscuité commanderait la mise en place d'une PLATE-FORME légère de concertation pour l'évaluation périodique de la situation. Elle comprendrait un représentant du ministère de l'agriculture, un représentant du ministère de l'environnement, un représentant du ministère de la santé, un représentant de la CAMWATER, un représentant de l'ANOR et un représentant des planteurs pour vérifier la conformité des produits phytosanitaires utilisés et garantir la potabilité de l'eau à tout moment sans affecter les activités agricoles. Cette Plate-Forme pourrait placé sous la présidence de l'autorité administrative en l'occurrence le sous-préfet de Dibombari se réunira deux fois l'an au début et au milieu de la saison agricole.
Pour ce qui est des contrôles inopinés des uns et des autres en rapport avec leurs compétences respectives :
? Un cadre environnementaliste relevant de la CAMWATER et spécialisé dans la surveillance environnementale donnera à tout moment l'alerte, compte tenu de la mission de police administrative dévolue au service public de l'eau qui est délégué à cette société !
Au plan social, pour faire face à cette situation des réseaux souterrain et aérien sur les emprises des routes et le tracé prévu pour l'installation du réseau d'eau potable nous pensons que :
? Un Plate-Forme de concertation entre tous les acteurs sous la coordination de la Communauté Urbaine de Douala (CUD) est nécessaire avant que l'un d'eux entreprenne de creuser les tranchées pour mettre en place un réseau de câbles ou de tuyaux. Ainsi les autres seront avertis et sensibilisés sur l'itinéraire envisagé. Ils prendront donc ensemble des dispositions pour éviter les incidents sur les différents
157
réseaux. Pour éviter ces incidents ENEO et CAMTEL devraient mieux surveiller le chronogramme de vie de leurs poteaux en bois et trouver un « modus-vivendi » mieux assumé avec les câblo-opérateurs sous la coordination de la CUD ou des mairies d'Arrondissements.
Dans le domaine Santé-Environnement, pour faire face à cette situation qui traduit un manque d'hygiène publique :
? Les Communes d'Arrondissement Décentralisés (CAD) devraient entreprendre chacune dans son aire territorial une Campagne d'implantation des toilettes publiques.
Pour ce qui est de l'activité industrielle dans la zone de Yato et ses environs caractérisées par la présence de nombreuses carrières de latérite qui aurait un certain impact sur l'eau capté à la station de traitement :
? Le Sous-Préfet de Dibombari associé au maire et les chefs traditionnels devraient engager de toute urgence une action concertée avec les Délégués de l'environnement et des travaux publics du littorale pour définir la conduite à tenir.
Au plan sécuritaire pour la protection des infrastructures et du réseau, il nous semble indispensable et urgent de:
? prépositionner les forces de maintien de l'ordre et de sécurité aux pieds de ces ouvrages dont le « Pont-Tuyau » est un véritable joyau industriel et technologique, pour leur surveillance permanente nuit et jour. Ici, une petite embarcation armée de la Marine Nationale devrait patrouiller nuit et jour sur le plan d'eau avec des moyens d'observation adéquates pour prévenir tout risque de sabotage.
? CONTRIBUTION AU PHENOMENE DE« CONTINUUM URBAIN-RURAL »
Afin d'améliorer l'offre en eau et garantir une certaine durabilité du réseau d'eau potable dans la partie Est de la métropole doualaise, nous proposons l'exploitation de la Dibamaba comme source pour la construction d'une autre station de traitement d'eau. Celle-ci permettra d'implanter un château d'eau à Massoume au nord de la Dibamba pour alimenter cette zone notamment Zusa-Bassa, Bayi ... mais aussi renfoncer le réseau d'eau alimentant Japouma et ces environs.
Le phénomène de « continuum urbain-rural » devrait donc être prise en compte afin de rendre le réseau d'eau potable durable à Douala afin qu'elle puisse garantir une offre en eau de qualité et de quantité bien au-delà de 2030 comme initialement prévu par le projet CAMATER phase II.
158
CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Il serait question ici de faire la proposition d'une charte de gestion des risques environnementaux pour les adductions d'eau potable en milieu urbain et péri-urbain. Elle comporterait : l'Exposé des Motifs et le Projet de Charte.
Cette charte est motivée par la prévalence élevée du désordre urbain et la négligence de l'assainissement dans nos villes. Par exemple, les caniveaux transformés en poubelles sont bouchés ; les eaux usées débordent et se rependent partout. Ces pratiques volontaires ou non polluent l'environnement et exposent le réseau sensible de l'eau potable à des contaminations microbiennes, bactériennes et par des éléments chimiques dangereux que charrient les eaux de pluies de ruissellement qui se mélangent à l'eau potable au niveau des points de cassure des tuyaux, hélas très nombreux dans les quartiers.
Tout ceci met en exergue l'existence des risques environnementaux qui menacent les réseaux d'eau potable dans nos villes et impose l'importance de considérer le couple Santé-Environnement comme étant une nécessité à prendre en compte dans la conception et la mise en oeuvre des adductions d'eau potable en milieu urbain.
A cela, il faut ajouter le vandalisme qui menace même de détruire les infrastructures d'eau potable que l'Etat a acquis au prix d'énormes sacrifices. D'où la nécessité de la sécurisation des infrastructures et du réseau d'eau potable et l'institution d'une Plate-Forme de concertation impliquant les municipalités et tous les partenaires du secteur de l'eau potable et les autres acteurs dans nos villes.
? La charte de gestion des risques environnementaux des adductions d'eau potable en milieu urbain, est un document de référence fédérateur de toutes les décisions de l'Etat prises dans le domaine Santé-Environnement en vue de garantir la potabilité de l'eau distribuée en ville.
? Il est institué au niveau de chaque Communauté Urbaine ou de chaque ville bénéficiant d'une adduction d'eau potable, une plate-forme de concertation comprenant outre la
159
CAMWATER et les sociétés d'affermage du secteur de l'eau potable, les acteurs du milieu urbain à savoir les mairies d'Arrondissement, les représentants locaux des ministères de la Santé et de l'Environnement, des opérateurs des secteurs de l'Electricité, des Télécommunication et du Gaz. En tant que de besoin, les chefs traditionnels des cantons concernés seront invités à participer aux réunions de la plate-forme.
? La plate-forme est présidée par le Délégué du Gouvernement ou son représentant ; ou le Maire de la Commune d'Arrondissement concerné ou son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'une société d'affermage ou un acteur du milieu urbain veut entreprendre de creuser des tranchées en vue de l'enfouissement des canaux, des tuyaux ou des câbles dans les emprises des routes urbaines. Le secrétariat de la plate-forme est assuré par le représentant de la CAMWATER.
? La plate-forme peut s'adjoindre pour ses travaux toute personne jugée nécessaire en raison de ses compétences. La participation aux travaux de la plate-forme est gratuite. Toutefois l'organisation matérielle de la réunion incombe au partenaire du secteur de l'eau potable ou à l'acteur du milieu urbain qui en a provoqué les travaux. Le lieu et l'objet de la réunion doivent être précisés dans la lettre portant convocation de la plate-forme. Cette lettre de convocation sera accompagnée d'un plan détaillé du tracé des trachées que l'acteur concerné voudrait entreprendre. Pour ce qui concerne la ville de Douala l'A2D sera associée aux travaux.
? Au cours de la réunion, l'acteur urbain ou la société d'affermage qui a provoqué les travaux de la plate-forme devra donner aux autres membres de la commission toutes les explications nécessaires pour que les tranchées qu'il envisage entreprendre ne causent pas de dommages aux autres infrastructures déjà en place dans les emprises des routes urbaines.
? Les modifications du tracé peuvent être recommandées par la commission dans l'intérêt de la sauvegarde des infrastructures qui existent déjà dans les emprises. Toutefois, ces
modifications ne devraient pas entrainer une augmentation des
coûts financiers
incompatibles avec le budget prévisionnel du
projet. Si c'est le cas, la commission devrait aider à trouver un
compromis entre le porteur du projet et l'exécuteur des travaux. Ce
compromis pourrait donner lieu à un avenant aux travaux initiaux qui ne
devraient pas compromettre leur exécution ou en rallonger de
manière inconsidérée le délai de livraison.
? La municipalité bénéficiaire de l'adduction d'eau devra veiller à ce que les emprises des routes où sont enterrés les canaux et les tuyaux d'eau potable soient toujours maintenues
160
dans un parfait état de propreté. Les mairies d'Arrondissement doivent construire les toilettes publiques dans les emprises des routes le long des itinéraires où sont enterrés les canaux et les tuyaux d'eau potable.
? « Faire ses besoins » au bord de la route est une source de pollution de l'environnement des canalisations et des tuyaux d'eau potable qui expose celles-ci à des contaminations par les eaux de pluie de ruissèlement au niveau des points de cassure. La police municipale doit interpeller, verbaliser et sanctionner toute personne qui « fait ses besoins » au bord de la route. Une délibération des grands conseillers de la communauté urbaine ou des conseillers municipaux fixera le montant des amandes consécutives à ces sanctions. Indépendamment des poursuites judiciaires tout acte de vandalisme sur les infrastructures et le réseau d'eau potable sera également sanctionné conformément à la réglementation en vigueur.
? Avant, pendant et après les travaux sur le réseau d'eau potable, la CAMWATER qui est le détenteur délégué de l'autorité de l'Etat dans le secteur de l'eau potable en milieu urbain et péri-urbain devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la potabilité de l'eau que les sociétés d'affermage livrent à la population soit toujours conforme aux normes de l'OMS et de l'ANOR.
? Des campagnes de prélèvement seront régulièrement organisées dans les quartiers par CAMWATER avec la collaboration des mairies d'Arrondissement en vue de contrôler systématiquement la potabilité de l'eau et de garantir à la population la consommation d'une eau incolore, inodore, sans saveur et sans danger pour la santé. Tous les incidents relevés seront portés à la connaissance de la société d'affermage qui exploite le réseau en vue de leur remédiation.
? Après le passage des travaux, pour le réseau d'eau potable et les autres réseaux qui occupent les emprises des routes urbaines, le Délégué du Gouvernement ou le Maire d'Arrondissement concerné devra veiller à ce que l'environnement soit restauré par le porteur du projet et l'exécuteur des travaux.
? Le Ministre de l'Energie et de l'Eau, le Ministre de l'Environnement, le Ministre de la Santé, le Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation doivent veiller, chacun en ce qui le concerne à l'exécution du présent projet de charte qui sera enregistré publié, puis inséré au journal officiel en Français et en Anglais.
161
L'opérationnalisation d'un plan de gestion dans un domaine innovant comme celui du management des risques environnementaux du secteur de l'eau potable en milieu urbain, nécessite une ressource humaine de qualité. Au Cameroun, les spécialistes des études environnementales et du développement durable ne courent pas encore les rues. Avec la création récente du Ministère de l'Environnement de la Protection de la nature et du Développement Durable, le secteur est envahi par les anciens diplômes de l'Ecole Nationale des Eaux et Forêts de Mbalmayo. Il apparait donc que les premiers spécialistes issus de la filière Environnement et Developpement Durable de l'Université de Douala devraient objectivement être appelés à constituer le socle de base de cette profession dans notre pays.
En considérant le cadre du projet d'adduction de l'eau potable à Douala CAMWATER Phase II comme référence, les objectifs, les critères généraux de sélection, la classification, les valeurs et les avantages des personnels qui seront impliqués pour la mise en oeuvre du plan de gestion des risques environnementaux au niveau de CAMWATER et des sociétés d'affermage seraient les suivants :
? Améliorer le système de gestion des risques environnementaux dans le cadre d'un projet d'eau potable en milieu urbain
? Développer la ressource humaine compétente pour les opérations de prévention des risques environnementaux et de protection des infrastructures et du réseau
? Contribuer au développement socio- économique de la ville par la création des emplois notamment pour les jeunes diplômés de ce secteur innovant qu'est l'environnement et le développement durable.
? Vu la complexité et l'exigence de rigueur des tâches à accomplir, il serait souhaitable pour le personnel d'encadrement d'avoir au moins un diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine concerné. Car la sécurisation de la potabilité de l'eau que la population consomme relève d'une responsabilité régalienne stratégique de l'Etat. Les diplômes requis seraient donc les suivants :
162
> PhD, Master, Bachelor, Licence, DEUG, HND, BTS ou tout autre diplôme reconnu équivalent dans le domaine.
> Bonne maîtrise de l'une des deux langues officielles (Français, Anglais) ; maîtrise moyenne de l'autre langue
> Avoir une formation initiale ou s'intéresser aux questions environnementales et au développement durable pour les autres agents de terrain.
4.3- Classification de la Ressource : Elle se fera conformément :
> Au Niveau d'Education ;
> A l'Expérience Professionnelle ; > Au Domaine de Spécialisation ;
Elles s'apprécieront conformément :
> A la Compétence Professionnelle ;
> Au Respect de la Hiérarchie et de la Discipline ;
> A l'Objectivité et l'Impartialité ;
> A l'Honnêteté.
> Ils seront établis conformément au code du travail et à la convention collective régissant le secteur industriel de l'eau potable au Cameroun.
L'élaboration d'une stratégie intégrée comme celle du PGRE (Plan de Gestion des Risques Environnementaux) pour le projet CAMWATER Phase II serait en fonction du contexte politique, économique, écologique social et sécuritaire sur le quel est fondé le projet. Il nécessite une gestion prudentielle, c'est à dire en fait, beaucoup de tact et de méthode.
Il est question ici de faire ressortir les opportunités et les menaces de cette stratégie. Ceci permettrait au décideur à savoir : l'Etat du Cameroun à travers le MINMEE et la
163
CAMWATER d'apprécier la pertinence du PGRE ses forces et ses faiblesses et surtout son caractère innovant
> Pour l'Etat, le PGRE serait une innovation dans le secteur de l'eau potable et de l'aménagement urbain au Cameroun. Il pourrait alors être un exemple d'une stratégie de développement pour les projets similaires dans la sous-région sous la composante Santé-Sécurité-Environnement en accordance avec l'OMD 7 sur la gestion des ressources en eau.
> Pour CAMWATER, le PGRE apporterait une meilleur organisation lors des opérations de terrain notamment pour ce qui est des différents sondages des sites des travaux, la détection des points de cassures des tuyaux dans la ville, les équipes d'intervention sur le terrains (police environnementale envisagée dans la stratégie)...
> Pour les institutions concernées par le contrat d'affermage (CAMWATER et CDE), le PGRE fait une proposition importante dans l'optique de réguler tout éventuel conflit ou mal entendu. Elle consiste en la mise sur pied d'une Agence de Régulation du Secteur de l'Eau Potable (ARSEP).
> Pour l'A2D, pionnier de la médiation social au sein des projets de développement à Douala, le PGRE permettrait d'avantage d'intégrer dans ces services des opportunités de consultation sur la gestion des risques et autres aspects liés aux crises environnementales dans les projets similaires. Ceci lui permettrait de pouvoir intervenir dans les concertations « public-privé » pour la mise en oeuvre des projets à caractères socio-écologiques.
La véritable menace pour cette stratégie est celle de la « mal gouvernance ». Celle-ci induirait les aspects suivants :
> La mauvaise gestion du personnel concerné notamment l'emploi des personnes non compétentes à des postes stratégiques et techniques.
> Le déploiement rapide des ressources financières nécessaires pour l'opérationnalisation des structures proposées dans le PGRE notamment l'unité de Prévention, l'unité de Protection, l'Agence de Régulation (ARSEP) et les différentes Plate-Forme de concertation.
164
? La passivité des gouvernants à l'application des différentes recommandations stratégiques et opérationnelles formulés dans le PGRE.
? Le développement accrue des fléaux sociaux tel que la corruption, le pillage des fonds réservés au projet, le vandalisme des populations riveraines sur les infrastructures et le réseau ...
Notre stratégie intégrée qui définit l'élaboration d'un Plan de Gestion des Risques Environnementaux (PGRE) articulé en cinq axes dont : le cadre politico-institutionnel, la matrice des directives stratégique et opérationnelle, le cadre législatif et juridico-règlementaire, le capital humain et les dispositions finales fait une démonstration d'un modèle de régulation pouvant contribuer à réduire les risques environnementaux au sein des projets de développement comme celui de l'adduction d'eau potable en milieu urbain au Cameroun.
Le PGRE propose donc la création de trois structures stratégiques et opérationnelles à savoir : l'unité de prévention, l'unité de protection (police environnementale) et l'Agence de Régulation du Secteur de l'Eau Potable (ARSEP). En appui à ces structures, une plate-forme de concertation pour la coordination de la médiation sociale. Au plan légal et réglementaire la mise en oeuvre d'un projet de charte sur la gestion des risques environnementaux. Ledit plan propose également un guide de sélection des ressources humaines compétentes pour ce domaine (ressources administratives et techniques) et relève les opportunités et les menaces probables pour l'opérationnalisation de cette stratégie.
Le PGRE nous amènerait donc à valider notre hypothèse selon laquelle : la mise sur pied d'une stratégie intégrée permettra de réguler le risque environnemental au sein du projet.
165
A travers cette étude, nous avons porté nos efforts de réflexion sur la Gestion des risques environnementaux au sein d'un projet structurant de grande envergure à Douala : le Projet CAMWATER Phase II. Le but de ce projet est de pallier à l'insuffisance de l'eau potable fournie quotidiennement à la capital économique du Cameroun, conjointement par CAMWATER et la CDE en vue d'en faire passer la quantité de 150,000m3/jour à 250,000 m3/jour.
Après avoir défini la notion de risque qui est « la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un évènement et de ses conséquences négatives » (Norme ISO/IEC Guide 73), nous avons cherché à comprendre sur le plan environnemental, quels en sont ceux auxquels le projet est exposé. Pour se faire, nous avons choisi les méthodes de recherche utilisées en géographie telles que l'observation directe, la recherche documentaire, les entretiens libres et semi-dirigés et les entretiens dirigés avec l'aide d'un conducteur. A cela nous avons ajouté les analyses par les approches de :
? Ishikawa qui nous a permis de construire un diagramme de cause à effet ;
? PDCA (Plan-Do-Check-Act) pour l'application du principe de l'amélioration continue
? SWOT (Strength- Weaknesses- Opportunity-Treats) qui est un outil anglais d'analyse stratégique ;
? Le Diagramme de Pareto basée sur la loi de 80/20, à savoir que 20% des causes produise 80% d'effets.
Il est apparu pour ce projet que les risques sont multiples et variés. Ils sont liés à l'environnement politique et économique pour sa conception et son financement. Ainsi, il a fallu que le Cameroun sorte des griffes du FMI et de la Banque Mondiale en se libérant des plans d'ajustements structurels pour qu'il puisse trouver un partenaire à savoir la République Populaire de Chine pour l'accompagner à la réalisation de ce projet. Ils sont aussi liés à l'environnement écologique (les contraintes du terrain), social (les pratiques des acteurs et des populations riveraines) et sécuritaire (la protection physique du réseau et des infrastructures des risques permanents ou conjoncturels comme ceux des mouvements terroristes à l'exemple de Boko Haram).
166
Après avoir mis en exergue les risques environnementaux autour du projet CAMWATER Phase II, nous nous sommes posé la question de savoir si la gestion de ces risques contribue à l'atteinte des objectifs du projet à savoir l'amélioration de la quantité et la qualité de l'eau potable que la CDE livre quotidiennement à la ville de Douala.
Nos hypothèses de travail sur la pollution éventuelle de l'eau potable transportée dans toute la ville par les tuyaux de distribution ont été confirmées par l'existence par -ci, par-là dans les quartiers des points de cassures de ces tuyaux soit par les populations riveraines, soit par les véhicules lorsque les tuyaux traversent les routes en terre dans les quartiers. Ces points de cassures constituent les portes d'entrée de la contamination par les eaux de pluie de ruissellement qui charrient toute sorte de saleté dont les microbes, les bactéries, et même des éléments chimiques dangereux.
Notre revue de littérature et nos questions spécifiques sur l'existence d'une politique de gestion des risques environnementaux propre à ce projet à travers les pratiques des acteurs et des populations riveraines et le caractère contraignant du système de management au sein du projet nous ont permis de faire une évaluation du cadre politico- institutionnel existant en vue de répondre plus efficacement à l'objectif principal de notre étude à savoir la gestion prudentielle des risques environnementaux afin de garantir la quantité et la potabilité de l'eau que consomme quotidiennement les citadins de Douala, par des mesures de sécurité adéquates. Parmi ces mesures, nous avons suggéré entre autres : la création au sein de CAMWATER d'une Division de Gestion des Risques et de Protection Environnementale des Infrastructures et du Réseau (DGRPEIR) qui comprend deux unités opérationnelles à savoir : l'Unité des Etudes et du Contentieux Environnemental et Social (UECES) et l'Unité de Sécurisation des Infrastructures et du Réseau (USIR). Nous avons aussi suggéré la création d'une Agence de Régulation du Secteur de l'Eau Potable (ARSEP) qui s'interposerait entre la CAMWATER et la CDE en vue des arbitrages futurs comme l'ARSEL dans le secteur de l'électricité. Nous proposons aussi l'institutionnalisation systématique des prélèvements dans les quartiers de la ville pour un contrôle régulier de la potabilité de l'eau que la CDE y livre tous les jours aux ménages.
Enfin, nous avons tenté de faire l'esquisse d'une proposition de charte pour la gestion des risques environnementaux de l'eau potable en milieu urbain basée sur le duopole Santé-Environnement et sur les textes législatifs et réglementaires de la République. L'Exposé des
167
motifs serait la synthèse de toutes les carences que nous avons relevées çà et là dans cette étude.
Nous ne doutons pas que si toutes les propositions faites seraient prises en compte et implémentées par le Gouvernement et ces partenaires que sont la CAMWATER et la CDE, il y aurait une amélioration substantielle des conditions de vie des populations par l'alimentation en eau potable en qualité et en quantité suffisante jusqu'en 2025 comme envisagé dans le plan de développement urbain de la ville de Douala, et même au-delà. On réduirait ainsi au maximum la consommation des eaux douteuses (sachet d'eau et autres) par la population. On apporterait aussi une contribution significative dans la lutte contre les maladies hydriques.
Il apparait donc en définitive, comme le déclare si bien Mme Michaëlle JEAN, secrétaire générale de la Francophonie lors de son toast au Palais de l'Unité de Yaoundé le 14 Avril 2015 : « l'environnement est au coeur de toutes les stratégies de Développement ».
Ainsi, dans une ville comme Douala, capitale économique du Cameroun et même de la zone CEMAC, où la concentration humaine et les activités socio-économiques sont importantes, il n'est pas facile de creuser les tranchées partout le long des routes sans contrarier les gens, sans frustrer les petits commerçants qui construisent leurs baraques sur les trottoirs et les vendeurs à la sauvette dont les étales débordent souvent sur les chaussées. Dans un tel contexte, de simples campagnes de sensibilisation ne suffisent plus. Pour éviter les émeutes, il a fallu mettre en place une véritable structure de « médiation sociale » avec la collaboration de l'A2D. A tous les niveaux, l'Etat a été interpellé et le gouvernement a réagi rapidement et avec efficacité. Grâce à la coopération « Gagnant-Gagnant » avec la République Populaire de Chine, Exim Bank of China a décaissé 52 Milliards de FCFA pour financer le projet et l'entreprise CGCOC de la Chine a construit les infrastructures avec une maîtrise admirable, sans avenant, et en respectant le délai contractuel de livraison : 4 ans !
Dans le contexte d'un monde globalisé, l'impératif de performance impose de la part des professionnels des études environnementales et du développement durable que nous voulons être, beaucoup de curiosité et d'humilité, un éveil intellectuel permanant et une formation continue en vue d'acquérir une certaine transdisciplinarité progressive. Car les risques environnementaux impactent beaucoup de domaines et prouvent que dans la vie, tout est lié par l'environnement. Les habitants de la ville de Douala forment donc un tout avec leur milieu de vie et l'eau qu'ils consomment est un déterminant majeur pour leur santé. Il
168
serait donc important de penser que « la mise sur pied des mesures de prévention comme celles développées dans la stratégie intégrée de cette étude ainsi que l'application stricte des loi et des règlement de la République à tous les niveaux et la mise en oeuvre des moyens de protection (police environnementale) modélisés dans cette étude de cas pour assurer la potabilité de l'eau serait un impératif » ! Ces aspects incomberaient donc à l'Administration du MINMEE, à la CAMWATER et à la CDE acteurs du secteur de l'eau ainsi qu'aux populations, premiers utilisateurs de cette ressource vitale. Pour tout dire, le maintien de la potabilité de l'eau en milieu urbain serait une question de civisme et un devoir citoyen pour tous.
170
1- OUVRAGES Bachelard. G (1938) : La Formation de l'esprit scientifique, Vrin, p.14
Brunet .R , Ferras .R et Théry .H,(1992) Les mots de la géographie : Dictionnaire critique, Montpellier / Paris, Reclus-La Documentation française, coll. Dynamiques du territoire , p.470 ; (ISBN 2-11-002852-1) p. 459
Grawitz. M (1993) : « Méthode des sciences sociales », 9eme Edition ; Dalloz, Paris
Karim Samoura (2008) : Evaluation des impacts sur l'environnement, analyse critique des outils et méthodes ; Geiger, Canada p.20
Kouam G. R, Mpakam .H, Ayonghe Ndonwy et al (septembre 2006), Gestion intégrée des ressources en eau et objectifs du millénaire pour le développement en Afrique : Cas du Cameroun, no2 -volume 7, dossier spécial - l'Afrique face au développement durable p.58-66
Meva'a Abomo. D, Fogwe Z.N, et Fouda. M (2015) : Urbanisation et Développement humain au Cameroun, Volume1, Edition Universitaire Européenne, Heinrich-Böcking-Str. 6-8,66121 Saarbrücken, Deutschland/Allemagne
Omar Aktouf (1987) : Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction à la démarche classique et une critique, Sainte-Foy, Montréal, Les Presses de l'Université du Québec, 213 pp.
Si Mohamed Ben Massoud (2010) : Introduction sur la gestion des risques et des catastrophes ; colloque national de la recherche dans les IUT à Angers TS08B - Disaster Risk Management.13p
Talom. S, Tapoko. H (2012) : Perception du Développement Durable -Mise en oeuvre de l'agenda 21 par le Cameroun, volume 1, Aedev
2- ARTICLES
Assako Assako R.J (1999), Critique de la politique urbaine du Cameroun : instruments, résultats et évaluation, in : Revue de Géographie du Cameroun. Vol. XIV, no1p.53-67
Guerquin. F et al (2003) : Actions pour l'eau dans le monde : faire jaillir l'eau pour tous, 163p.
Kamgho Tezanou B.M (2008), L'accès à l'eau potable et à l'assainissement au Cameroun : situation actuelle, contraintes, enjeux et défis pour l'atteinte de l'OMD 7.
Kaufmann. C(2007) : L'accès à l'eau potable et à l'assainissement en Afrique, Centre de Développement de l'OCDE, Repère N° 41.
Stephan Rist. (Helvetas 2001): Social Processes and Drinking Water Systems À Insights from a Learning Society, 64p
171
3- MEMOIRES ET THESES SOUTENUS
Brou Edoh Komenan.G.A (2009) : Politique environnementale et développement durable en Côte d'Ivoire, Mémoire de Maitrise, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/Unité Universitaire d'Abidjan.
Kam Oleh (1998): Problématique de la gestion des infrastructures d'hydrauliques dans les projets d'approvisionnement du milieu rural en eau potable, Doctorat en Sociologie, Institut d'Ethnosociologie, Université de Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire.
Mongeau-Descoteaux. S (Janvier 2011) : Méthodes, Techniques et Outils pour Réaliser des Évaluations Environnementales Rapides en Réponse aux Situations d'Urgence, Essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement en vue de l'obtention du grade de Maître en environnement (M. Env.), Université de Sherbrooke, Québec, Canada.
Satterthwaite. D, (Décembre 2007) : La Ville, Acteur de Développement : Défis à relever pour soutenir le développement urbain durable, International Institute for Environment and Development (IIED), Royaume-Unis.
4- DOCUMENTS INSTITUTIONELS
Banque Africaine de Développement (BAD 2010) : Gestion Intégrée des Ressource en Eau (GIRE).
Banque Européenne d'Investissement (BEI), rapport annuel de 2012 : Secteur de l'eau, le financement de projets d'adduction d'eau, d'assainissement et de protection contre les inondations.
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet D'Assainissement des Eaux Usées au Cameroun, (Mai 2011) : Rapport final.
Conseil Mondial de l'Eau (CME ,2003), Partenariat Mondial pour l'Eau : Rapport du Panel mondial sur le financement des infrastructures de l'eau, 72p.
CUD (2010 a) : Agenda 21 Local de la ville de Douala
CUD (2010 b) Direction des Etudes de la Planification Urbaine et du Développement Durable (DEPUDD) : Rapport final du Plan Directeur d'Urbanisme de Douala à l'horizon 2025 de novembre 2010 et février 2012.
CUD (Décembre 2009) : Stratégie de Développement de la ville de Douala et de son aire Métropolitaine
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (février 2008) : Politique relative à l'environnement et au développement durable.
Geofor (2012) : prospection technique pour la mise en oeuvre d'un projet d'adduction d'eau potable en milieu urbain.
172
GHK, Technopolis (January 2008): Evaluation on EU Legislation À Directive 85/337/Eec (Environmental Impact Assessment, EIA) and Associated Amendments, Final Report
Lemsioui. A (février 2012) : La prévention et la gestion des risques au Maroc, Ministère de l'Energie, des Mines de l'Eau et de l'Environnement, Royaume du Maroc.
Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire : Rapport National de Progrès des Objectifs du Millénaire pour le Développement Année 2012
Ministère de l'Energie et de l'Eau (Décembre 2009) :Plan D'Action National de Gestion Intégrée Des Ressources en Eau (PANGIRE)
Ministère de l'Energie et de l'Eau (Août 2011) : Stratégie Nationale D'Assainissement Liquide, Programme de Partenariat sur l'Eau au Cameroun.
Ministères de l'Environnement et Ministère de la Santé Public (Janvier 2010), Rapport sectoriel : Analyse Situationnelle et Estimation des Besoins dans le Domaine de la Santé et l'Environnement au Cameroun
Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain : Projet de Développement des secteurs Urbain et de l'approvisionnement en Eau (PDUE) Rapport Annuelle de 2013
Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivité Locales République du Sénégal : Manuel de procédures environnementales et sociales pour le développement local
OCDE (Septembre 2003) : Les risques émergents au XXIe siècle, un projet du Programme de l'OCDE sur l'avenir.
Programme des Nations Unies pour l'Environnement (février 2012) : Mise en oeuvre de la politique et stratégie du Programme des Nations Unies pour l'environnement dans le domaine de l'eau pour la période 2007-2012
Spaeter .S et Moisan. F (Janvier 2002) : La gestion des risques environnementaux et la responsabilité environnementale, Projet de recherche IFE/BETA, Rapport final Année 2001.
Union Mondiale pour la Nature UICN (2000) : Vision de l'Eau et de la Nature, Stratégie mondiale de conservation et de gestion durable des ressources en eau au 21ème siècle, 66p.
United Nation: Flash Environmental Assessment Tool (FEAT) - User Guide
Zayed .J : Perception du risque et principe de précaution, Université de Montréal, Canada, 90
pp.
173
5- WEBOGRAPHIE
AFNOR - NF ISO 31000 /2010, norme international en management des risques
Agence de l'Eau : fiche pays, (PS-Eau), Cameroun de Mars 2013. Bachelet. R (2010) : Gestion des Risques
Christian Hoffmann (Avril 2013), Conduire un diagramme de Pareto
Depelteau .F : La Démarche d'une Recherche En Sciences Humaines (IRSP- Synthèse du livre en version numérique)
Georges Jousse (2004) : Le Risque, cet inconnu.
Le Jalle .C, Desille .D et al : Relever le défi de l'assainissement en Afrique, une composante clé de la gestion des ressources en eau, programme Solidarité Eau (pS-Eau) pour le
Partenariat Fran ais pour l'Eau (PFE), plateforme des acteurs fran ais du secteur de l'eau intervenant à l'international, www.partenariat-francais-eau.fr et www.pseau.org.
Lux innovation G.I.E (2008), Diagramme d'ISHIKAWA
Meva'a Abomo. D (2006a), De l'abondance des ressources en eau a la rareté de l'eau
potable, un indicateur pertinent de la crise des villes littorales du sud : l'exemple de Douala au Cameroun., Communication à la 7ème conférence International ville / Management portant
sur : « Gestion démocratique des bien collectifs », CIDEGEF, A.U.F., CUD., Université de Douala 22-24 nov.2006 Douala (http:/ www.cidegef.refer.org/douala/mevaa 2.pdf)
Meva'a Abomo .D (2013), La gouvernance urbaine des eaux de pluie entre contrainte et opportunité de développement urbain à Douala (Cameroun),Communication no 00338, 8ème
conférence internationale NOVATECH , du 24-27 Juin, Lyon-France .pp.9-10
Moen. R, Norman. C (October 2011): Evolution of the PDCA Cycle.
Muller .M : Comment la GIRE contribuera à l'accomplissement des OMD, www.gwpforum.org.
Nadeau. A : Méthode Empirico Inductive (dernière édition le 2011-07-12 19:23:07 )
Plan National Santé-Environnement (PNSE) en République Française de 2010, Deuxième conférences sous le thème : Santé-Environnement face au défi du changement climatique.
Université Virtuelle de l'Environnement et du Développement Durable (UVED, 2010), Une première approche théorique de la notion de risque : analyse historique de la prévention et la gestion des risques
www.eauxpotables.com www.cemex.com www.mémoireonline.com www.camwater.cm
Www. Le dico des définition.com
174
SOMMAIRE
DEDICACE i
REMERCIEMENTS... ii
LISTE DES FIGURES iii
LISTE DES TABLEAUX iv
ABREVIATIONS v
RESUME viii
ABSTRACT ix
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : L'EVIRONNEMENT DE STAGE 6
CHAPITRE I : PRESENTATION DE L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DE DOUALA 7
Introduction 7
1- ORGANIGRAMME, MISSIONS ET OBJECTIFS 7
1.1-Organigramme 8
1.2-Missions 10
1.3-Objectifs 10
2- ACTIVITES ET ATOUTS... 10
2.1-Activités 10
2.2-Atouts 11
3- MOYENS LOGISTIQUES 11
4- FINANCES ET PARTENAIRES 12
4.1-Finances 12
4.2-Partenaires 12
5- LES REALISATIONS 13
5.1-Le Projet CAMWATER Phase II 13
5.2-Les Autres Réalisations 13
Conclusion 14
CHAPITRE II : CONTRAT D'APPRENTISSAGE 15
Introduction 15
1-LES TERMES DE REFERENCES DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE 15
1.1- Exposé des motifs 15
1.2- L'Objet du contrat 16
1.3- Le But du stage 16
1.4- Les Engagements des parties contractantes 16
1.4.1- Engagement de la structure d'accueil 17
1.4.2-Engagement de l'apprenti stagiaire 17
175
2- LE CADRE D'APPRENTISSAGE 17
2.1- l'Apprentissage au Plan Académique 17
2.2- l'Apprentissage au Plan Professionnel 18
3-EXPOSE DES ACQUIS PROFESSIONNELS 18
3.1-Le déroulement du stage 18
3.2-La Réalisation des tâches au sein du stage (sur le terrain) 20
3.3- L'Expérience professionnelle acquise 24
4- LES PROBLEMES AU SEIN DE L'ENVIRONNEMENT DE STAGE 25
4.1- Identification des problèmes de l'entreprise (A2D) 25
4.2-Identification des problèmes de l'étude 25
5- DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES. 25
5.1- Discussion 25
5.2- Perspectives 26
Conclusion 26
DEUXIEME PARTIE: LE PROTOCOLE DE RECHERCHE 27
CHAPITRE I : LES ASPECTS THEORIQUES DE L'ETUDE DE CAS 28
Introduction 28
1-CONTEXTE DE L'ETUDE 28
1.1-Justification Académique de la recherche professionnel et Harmonisation des perceptions
notionnelles 28
1.2- Contexte Général 30
1.3-Contexte Scientifique 32
1.4- Contexte Professionnel 35
2-DELIMITATION DE L'ETUDE 36
2.1-Délimitation Epistémologique... 36
2.2- Délimitation Conceptuelle et Conceptualisation 37
2.3- Délimitation Thématique...39
2.4- Délimitation Temporelle 39
2.5- Délimitation Spatiale... 39
3-LA REVUE DE LITTERATURE 42
3.1-La vision de la communauté internationale : les questions de gestion environnementale et l'eau potable comme ressource naturelle....42
3.2-Les orientations évolutives de la gestion des risques de l'environnement 46
3.3-Les expériences Euro-Africaines dans la réalisation des projets d'adduction d'eau 49
3.4-La démarche camerounaise dans la mise en oeuvre d'une stratégie Santé-Environnement pour le
Programme de développement des zones urbaines 52
3.5-La stratégie de la ville de Douala face à la problématique de la gestion de l'environnement et
l'approvisionnement en eau potable 59
176
4- CONSTRUCTION DE L'OBJET D'ETUDE 63
4.1-Problématisation 63
4.1.1- Constat 63
4.1.2- Référenciel 64
4.1.3-Problème de recherche 65
4.1.4-Débat autour des enjeux du problème de recherche 65
4.1.5-Identification des items du problème de recherche 66
4.2-Questions de Recherche 67
4.3-Hypothèses de Recherche 67
4.4-Objectifs de l'Etude 68
5-INTERET DE L'ETUDE 70
5.1- Intérêt Scientifique 70
5.2- Intérêt Professionnel 70
Conclusion 70
CHAPITRE II : LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE... 71
Introduction 71
1-LE CADRE METHODOLOGIQUE GENERALE DANS LE MODEL CLASSIQUE DE
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 71
1.1- Courant Méthodologique du Model Classique de Recherche Scientifique 71
1.2- Cadre Théorique de la Recherche Professionnelle 72
1.3-Méthode de Recherche Générale 72
2-LES METHODES ET TECHNIQUES DE COLLECTE DES DONNEES 74
2.1-Collecte des données qualitatives 74
2.1.1- l'Echantillonnage 74
2.1.2 La Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP) 74
2.2-Collecte des données quantitatives 76
2.2.1- Echantillonnage des sites d'investigation 76
2.2.2- Sondage aléatoire 77
3-LES METHODES ET TECHNIQUES D'ANALYSES DES DONNEES... 78
3.1-Analyse des données qualitatives 78
3.1.1- Le Diagramme de Cause à Effet(Ishikawa) 78
3.1.2-La Théorie de l'Amélioration Continue (PDCA) 78
3.1.3-Le SWOT Analysis 79
3.2- Analyse des données quantitatives 79
3.2.1-Le Diagramme de Pareto 79
4-
177
DIFFICULTES RENCONTREES 81
4.1- Difficultés rencontrées lors de la collecte des données 81
4.2- Difficultés rencontrées lors de l'analyse des données 82
5- CHRONOGRAMME DE RECHERCHE 82
Conclusion 83
TROISIEME PARTIE : RESULTATS DE L'ETUDE DE CAS 84
CHAPITRE I : POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
DANS LE PROJET CAMWATER PHASE II 85
Introduction 85
1- ETAT DES LIEUX DES SITES DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET 85
1.1-Avant la mise en oeuvre du projet dans les sites 86
1.2- Pendant la mise en oeuvre du projet dans les sites 87
1.3-Après la mise en oeuvre du projet dans les sites 89
2-LES ORIENTATIONS DE LA GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX AU
SEIN DU PROJET 90
2.1- Les risques de l'environnement politique 91
2.2-Les risques de l'environnement économique 92
2.3-Les risques de l'environnement écologique... 93
2.4- Les risques de l'environnement social... 95
2.5-Les risques de l'environnement sécuritaire 96
3- IDENTIFICATION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX DANS LES SITES DU
PROJET 97
3.1-Identification des Risques Environnementaux 101
3.1.1- Les scénarii à risque technique 101
3.1.2-Les scénarii à risque socio-écologique 102
4- CLASSIFICATION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX DANS LES SITES DU
PROJET 103
4.1-Classification en fonction de leur gravité 104
4.2-Classification en fonction de leur intensité 106
4.3-Classification en fonction de leur fréquence d'occurrence 113
5-DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE DE GESTION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX POUR LES PROJETS DE CAMWATER 120
5.1-Mise en OEuvre des Procédures de Gestion des Risques Environnementaux pour le projet
CAMWATER Phase II 120
Conclusion 122
178
RISQUE ENVIRONNEMENTAL AU SEIN DU PROJET CAMWATER PHASE II 123
Introduction... 123
1-LES ACTEURS GOUVERNEMENTAUX... 123
1.1-Le Ministère des Mines de l'Eau et de l'Energie (MINMEE) 123
1.2-Le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) 124
1.3-Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MINATD) 125
1.4-La Communauté Urbaine de Douala (CUD) 126
2-LES PARTIES PRENANTES DU PROJET 130
2.1-Le Porteur de Projet : (CAMWATER)... 130
2.2-La Camerounaise Des Eaux (CDE) 131
2.3-L'Agence de Développement de Douala (A2D)... 132
2.4-La CGC Oversees Construction Group Co (CGCOC) 134
3-LES AUTRES ACTEURS DE LA VILLE (ENEO et CAMTEL)... 136
4-LES AUTORITES TRADITIONNELLES 138
5-LES POPULATIONS RIVERAINES 139
Conclusion 140
CHAPITRE III : LES IMPACTS DES PRATIQUES DES ACTEURS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT... 142
Introduction 142
1- IMPACTS ECOLOGIQUES DES PRATIQUES DES ACTEURS 145
1.1-Impacts Ecologiques Positifs 145
1.2-Impacts Ecologiques Négatifs 145
2- IMPACTS SOCIAUX DES PRATIQUES DES ACTEURS... 146
2.1-Impacts Sociaux Positifs 146
2.2-Impacts Sociaux Négatifs... 147
3- IMPACTS ECONOMIQUES DES PRATIQUES DES ACTEURS 147
3.1-Impacts Economiques Positifs 147
3.2-Impacts Economiques Négatifs 147
Conclusion 148
CHAPITRE IV : ELABORATION D'UNE STRATEGIE INTEGREE: PLAN DE
GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX (PGRE)... 149
Introduction 149
1-CADRE POLITICO-INSTITUTIONNEL 149
2-MATRICE DE DIRECTIVES STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES 150
2.1-Les Opérations de Prévention : Unité des Etudes et du Contentieux Environnemental et Social.
(UECES) 150
2.2-Les Opérations de Protection : Unité de Sécurisation des Infrastructures Et du Réseau. (USIR) 151
179
3-CADRE LEGISLATIF ET JURIDICO-REGLEMENTAIRE 158
3.1-Charte de Gestion des Risques Environnementaux pour les Adductions d'Eau Potable en Milieu
Urbain et Péri-Urbain 158
4-CAPITAL HUMAIN... 161
4.1-Objectifs 162
4.2-Critères Généraux de Sélection 162
4.3-Classification de la Ressource 162
4.4-Valeurs 163
2.5-Rémunération et autres Avantages pour Soutenir la Motivation 163
5-DISPOSITIONS FINALES 163
5.1- Opportunité 163
5.2- Menace 164
Conclusion 164
CONCLUSION GENERALE 166
BIBLIOGRAPHIE 170
TABLE DES MATIERES... 174
GLOSSAIRE 180
ANNEXE 184
180
+ L'Eau : nom courant attribuée au corps moléculaire de formule chimique H2O (2 atomes d'Hydrogène et 1 atome d'Oxygène) sous sa forme liquide. Il est universellement qualifié comme étant un liquide transparent, sans saveur, ni odeur. (Dictionnaire Larousse)
+ l'Eau Potable : Selon le Décret du Premier Ministre N° 2001 /163 / PM du 08 Mai 2001 Réglementant les périmètres de protection autour des points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables, l'eau potable est définie comme étant toute eau de surface, souterraine ou de source qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, peut être consommée sans danger pour la santé. Par exemple l'eau produite à Yato (l'eau du fleuve Moungo) est rendue potable après un traitement physico-chimique.
+ L'Environnement: le dictionnaire des définitions dans sa version 2011 définit l'environnement selon des approches comme étant:
> l'ensemble des éléments naturels ou artificiels, qui entourent un système défini, que ce soit un individu, une espèce, une entité spatiale, un site de production... ;
> l'ensemble des échanges (prélèvements, rejets, ...) entre un anthropo système et les écosystèmes du milieu considéré ;
> l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie d'un système défini (individu, espèce...)
Dès lors, il apparaît nettement que la dénomination générique Environnement, rassemble une multitude de thèmes (eau, air, sols, déchets, milieux naturels, paysage, bruit, énergie, aménagement de l'espace, sécurité...), concernant de nombreux secteurs (Industrie, agriculture, collectivités locales, santé publique) et de multiples niveaux d'interventions (étude, conseil, expertise, contrôle, exploitation, ingénierie, maîtrise d'oeuvre...).
+ Gestion : le terme gestion réfère à l'ensemble des procédures effectuées pour résoudre un problème ou réaliser un projet. Il vient du mot Latin « gestio », qui signifie l'action de gérer ou d'administrer. Il consiste à prendre des mesures conduisant à la réalisation d'une affaire ou d'un souhait quelconque. (Le dico des définitions, version 2011)
+ Gestion Environnementale : la gestion environnementale est l'ensemble des mesures ou des procédures dédiées au système environnemental fondé sur le développement durable. La gestion environnementale est la stratégie par le biais de laquelle sont organisées les activités humaines nuisant à l'environnement, dans le but de parvenir à une qualité de vie convenable. (Le dico des définitions, version 2011).
+ L'Approche Prudente ou l'Analyse Prudentielle : selon Légifrance l'approche prudente est définie comme la méthode d'étude de l'évolution d'un milieu naturel qui tient compte de l'état des sciences et des techniques et procède par extrapolation des lois connues en retenant par principe les hypothèses les plus pessimistes, de façon à préserver l'environnement.
+ Le Risque : en référence à la norme ISO / IEC Guide 73, le risque est défini comme étant la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement et de ses conséquences négatives.
+ Gestion des risques et Catastrophe : processus de recours systématique aux directives, compétences opérationnelles, capacités et organisation administratives pour mettre en oeuvre les politiques, stratégies et capacités de réponse appropriées en vue
181
d'atténuer l'impact des aléas naturels et risques de catastrophes environnementales et technologiques qui leur sont liées.
+ Évaluation des risques : méthodologie pour déterminer la nature et l'étendue des risques à travers une analyse des risques potentiels et l'évaluation des conditions existantes de la vulnérabilité qui, associées, pourrait affecter les populations, établissements, séries de subsistance. (UNISDR, 2009)
+ Vulnérabilité : les caractéristiques et les circonstances d'une communauté ou d'un système qui le rendent susceptible de subir les effets d'un danger. (UNISDR Terminology reference Document ,2009).
+ Aléa : un phénomène dangereux, une substance, activité humaine ou condition pouvant causer des pertes de vies humaines, des blessures ou d'autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des pertes de moyens de subsistance et des services, des perturbations socio-économiques, ou des dommages à l'environnement.( Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes,2009)
+ Évaluation Environnementale Stratégique : processus officiel d'analyse
systématique des effets environnementaux de politiques, plans, programmes de développement et d'autres actions stratégiques proposées. Le processus étend les objectifs et principes de l'Étude d'Impact Environnemental au-delà du niveau du projet et si des alternatives majeures sont encore possibles. (Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes Rapport Annuel de 2005)
+ Personne Affectée par le Projet (PAP) : toute personne affectée de manière négative par le projet. Par conséquent, il s'agit de personnes qui du fait du Projet perdent des droits de propriété, d'usage, ou d'autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), des cultures annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément toutes déplacées du fait du Projet. (Stratégie d'Evaluation d'un Projet de Développement, France 2008)
+ Adduction d'Eau Potable : c'est un processus de dérivation des eaux pour l'amener dans un point donnée dans le but d'alimenter ce point en eau potable. (GEOFOR, 2010)
+ La Renouvelabilité des Ressources : c'est un processus qui implique la surveillance
des ressources naturelles renouvelables - telles que les sols,
l'eau des nappes
phréatiques et la biomasse - cette surveillance est
utilisée de manière à ne pas les éliminer, ne pas
les dégrader, ou tout au moins ne pas diminuer leur caractère
renouvelable pour les générations futures (Institut des
ressources mondiales, 1992).
+ Pollution des Eaux :selon L'Agence Française de L'Eau , la pollution de l'eau est l'introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques de l'eau et de créer des risques pour la santé de l'homme, de nuire à la faune et la flore aquatique, de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation normale des eaux.
+ La Durabilité de l'Eau : ce phénomène comprend une série d'exigences connexes, telles que la garantie de l'eau nécessaire au maintien de la santé humaine et la préservation des écosystèmes par la protections et le renouvellement des ressources en eau, et des améliorations institutionnelles en termes de planification, la résolution des conflits et la gestion équitable causée par l'intervention Humaine active (Institut des ressources mondiales, 1992).
182
? Le Développement Durable : selon le rapport Brundtland « le développement durable est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Il contient en son sein deux concepts clés : le concept de besoins, en particulier les besoins essentiels des pauvres dans le monde auxquels une priorité absolue devrait être accordée, et l'idée des limitations imposées par l'état de l'organisation technologique et sociale sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et futurs ».
? Développement Urbain : il se définit comme étant « un processus de changement dans l'environnement bâti qui favorise le développement économique tout en conservant les ressources et en protégeant l'intégralité des personnes de la collectivité et de l'écosystème » (Richardson, 1989). Selon cette définition un développement urbain doit permettre une urbanisation productive, non polluante et non ségrégative.
? Aménagement du territoire : le processus entrepris par les autorités publiques afin d'identifier, d'évaluer et de décider des différentes options possibles pour l'utilisation des terres, y compris l'examen de l'aspect économique à long terme, des objectifs sociaux et environnementaux, des implications pour les différentes communautés et groupes d'intérêt, ainsi que de la formulation et la promulgation de plans qui décrivent les utilisations autorisées ou acceptables (Cadre d'Action de HYOGO, 2005)

UNIVERSITE DE DOUALA
FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINE
DEPARTEMENT DE GEOGRAPHIE
Master Professionnel en Environnement et Développement Durable (MAPEDD)

183
GUIDE D'ENTRETIEN
Afin d'obtenir des donnée fiable et respecter les canaux de la démarche scientifique dans la collectes des donnée, il était évident pour nous de mettre à contribution certains acteurs impliqué dans le cadre du projet CAMWATER Phase II à Douala. Pour ce faire, nous avons élaboré un guide d'entretien simple de cinq questions que nous avons posées aux acteurs qui nous semblent impliqués dans les problèmes d'eau potable à Douala. C'est questions sont :
? Question 1 : Est-ce que le problème de déficit d'eau potable à Douala constitue une préoccupation pour vos activités ?
? Question 2 : La gestion du risque environnemental est-t-elle un facteur important à prendre en
compte pour votre institution acteur du secteur d'approvisionnement en eau potable à Douala ? Question 3 : Qu'est-ce que vous faites concrètement pour faire face aux problèmes causés par le
déficit d' eau potable et la gestion des risques dans votre environnement ?
? Question 4 : Quelles difficultés rencontrez-vous pour l'accomplissement de votre cahier de charges ?
? Question 5 : Quelles seraient vos propositions pour une meilleur gestion du risque environnemental dans le secteur d'approvisionnement en eau potable à Douala ?
184
PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET DE RENFORCEMENT ET AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU POTABLE A DOUALA (CAMWATER PHASE II)
> Secteur d'Intervention, Objectifs Et Impacts - Secteur d'Intervention :
Secteur de l'eau : alimentation en eau potable en milieu urbain et péri-urbain. - L'Objectifs du projet :
Augmentation de la production et de l'alimentation de l'eau potable de la ville de Douala de 150 000m3 / jour à 250 000m3.
- Impacts du projet :
+ Améliorer les conditions de vie des populations de Douala par l'alimentation en eau potable en quantité et en qualité jusqu'en 2030 ;
+ Apporter une contribution importante dans la lutte contre le choléra et autres maladies hydriques issues de la consommation de l'eau insalubre ;
+ Réduire au maximum la consommation des eaux douteuses (sachet d'eau et autres) par les populations.
> Le Porteur du Projet : La CAMWATER
Dans le souci de restructurer le cadre institutionnel de la fourniture de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, le Gouvernement Camerounais en 2005 a mis en place un partenariat public- privé constitué de deux entreprises complémentaires et non concurrentielles : la Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) et la Camerounaise Des Eaux (CDE) en remplacement de la Société National des Eaux du Cameroun (SNEC).
Créée par le décret numéro 2005/494 du 31 Décembre 2005 du Président de la République et placée sous la tutelle technique du Ministère de l'Eau et de l'Energie et du Ministère des Finances, la CAMWATER a pour objectif la gestion pour le compte de l'Etat des biens de droit affectés au service public de l'eau potable en milieu urbain et périurbain. Mais ce n'est que le 02 Mai 2008 que la CAMWATER a effectivement démarré ses activités.
Elle a pour principales missions :
+ La planification, la réalisation d'études, la maitrise d'ouvrage, la recherche et la gestion des financements pour l'ensemble des infrastructures et ouvrages nécessaires au captage et à la distribution de l'eau potable ;
+ La construction, la maintenance et la gestion des infrastructures de production, de stockage, et de transport de l'eau potable ;
+ Le contrôle de qualité de l'exploitation du service public de la distribution de l'eau potable et des autres missions confiées aux sociétés chargées de l'exploitation du service public de l'eau potable ;
+ En coopération avec les sociétés d'exploitation, l'information et la sensibilisation des usagers du service public de l'eau potable et celui de l'assainissement liquide en milieu urbain et périurbain ;
+ Gérer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, qui se rattachent directement ou indirectement aux objectifs définis ci-dessus ou de nature à favoriser leur développement.
185
> Le Financement: L'Exim Bank of China
De par la coopération étroite entre la République du Cameroun et la République Populaire de Chine, les relations conviviales entre ces deux pays ont valu au Cameroun de bénéficier de Exim Bank of China un appui financier de prêt de 52 milliards de Francs CFA pour la réalisation d'un projet hydraulique de très haute qualité. Ce projet de développement matérialise les termes d'une « coopération gagnant-gagnant » entre les deux pays qui s'affirme et se diversifie au jour le jour.
> Les Partenaires Internationaux et Locaux : - LA CGCOC :
Afin de valoriser l'investissement fait par la Chine, la mise en oeuvre du projet a été attribuée à une entreprise chinoise la CGC Oversees Construction Group Co., Ltd par sa succursale du Cameroun (CGCOC Cameroun Ltd) qui est une entreprise des travaux publics reconnue à l'échelle mondiale pour ces travaux de grande qualité.
La CGCOC dans le cadre du projet est le principal responsable dans la réalisation de tous les travaux techniques issus du projet. En tant que maitre d'oeuvre, elle a pour mission de construire un réseau souterrain de canalisation des eaux et un « pont-tuyau » qui traverse le Wouri pour amener l'eau de la station de captage et de traitement de Yato (fleuve Moungo) jusqu'aux différentes stations de stockage (châteaux d'eau) de la ville. Ici elle assure les travaux de pose des canalisations sur l'ensemble du réseau prévu et la construction des châteaux pour le stockage de l'eau par zone. Elle est également mandatée pour la mise en oeuvre des différents travaux de réhabilitation du réseau existant afin d'assurer une durabilité des infrastructures hydrauliques urbaines dans la ville de Douala et des autres villes du pays.
- La Camerounaise Des Eaux (CDE)
La Camerounaise Des Eaux est une société de droit camerounais créée en décembre 2007 par un groupement d'entreprises marocaines dont l'Office National de l'Eau et de l'Electricité (ONEE), Delta holding, NOVEC et Medz en vue de gérer les services de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'eau potable en République du Cameroun sur la zone d'affermage constituée de 110 centres urbains et périurbains. Elle intervient en lieu et place de la défunte Société Nationale des Eaux du Cameroun(SNEC). La CDE intervient donc dans le cadre d'un partenariat public - privé entre pays du sud, aux côtés des principaux acteurs nationaux que sont le Ministère de l'Energie et de l'Eau et la Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER).
La CDE s'emploie à assurer un service public dans une perspective de développement durable, à assurer la continuité de l'alimentation en eau potable en améliorant ainsi la qualité du service rendu aux clients et les performances des ouvrages de production, de transport, de distribution, et l'environnement de travail à travers la mise en place de nouvelles méthodes de travail à forte valeur ajoutée technologique axées sur la formation des ressources humaines. L'entreprise travaille également à accroître le taux d'accès à l'eau potable.
Elle a pour mission :
+ D'assurer la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'eau potable sur le périmètre affermé ;
+ D'assurer la réalisation des travaux d'entretien et de réparation de tous les biens affectés à l'exploitation du service affermé
+ D'assurer la réalisation conformément aux termes du contrat d'affermage des travaux d'extension ou de réhabilitation
+ L'amélioration de l'accès à l'eau potable pour renforcer le taux de desserte.
186
Afin d'édifier une culture d'entreprise fédératrice de l'ensemble du personnel, bénéfique à sa clientèle et porteuse de résultats, la CDE promeut les trois valeurs suivantes qui fondent et guident les actions communes et individuelles dans l'entreprise :
+ La Bonne Gouvernance, pour en finir avec des méthodes de gestion archaïques et mettre la CDE sur la voie de la performance et du succès
+ Le Professionnalisme, parce qu'au sein de l'entreprise se trouvent des femmes et des
hommes de valeur capables de redonner à l'activité toutes ses lettres de noblesse
+ La Qualité de Service, de par son métier et ses engagements contractuels, tels sont le devoir et la responsabilité de cette entreprise vis-à-vis de ses clients.
- L'Agence de Développement de Douala (A2D)
Dans le cadre du projet de Renforcement et Amélioration dans l'Alimentation en Eau Potable à Douala dans la Phase II, l'A2D a été mandatée pour assurer la médiation sociale. Afin de mener à bien la mission qui lui a été assignée, elle a dans son cahier de charge l'obligation d'assurer les taches suivantes :
+ La visibilité du projet sur le plan environnemental, social et économique (marketing durable).
+ La résolution des conflits socio-culturels entre les populations riveraines pendant et après les travaux de pose des canalisations.
+ Les concertations privées et publiques avec les autorités locales (audience foraine) + Les sensibilisations et informations journalières des populations riveraines.
- Beta Consult
Béta Consult est une SARL créée en 1995. La Dénomination de la structure " Béta Consult " vient de l'abréviation de Bureau d'Etudes Economiques et Techniques d'Afrique.
Béta Consult est un bureau d'études techniques, économiques et financières, totalement indépendant de toute entreprise des Travaux Publics, de tout fabriquant ou de tout intérêt commercial. Il fournit ainsi des services indépendants de qualité dans le seul et unique intérêt du client.
Par la qualité des experts qu'il mobilise, par ses références et celles de ses partenaires techniques, Béta Consult peut constituer des équipes ayant une compréhension culturelle et des connaissances techniques correspondant à pratiquement chaque situation. Ses équipes pluridisciplinaires lui permettent d'intervenir dans les projets les plus complexes en assurant à la convenance de ses clients tout ou partie des missions soumises.
Un partenariat d'assistance et de collaboration technique qui lie Béta Consult à certains groupes internationaux d'ingénierie lui permet de disposer à tout moment de toute compétence technique non disponible sur le marché local et d'accéder aux différents logiciels informatiques, techniques ou de gestion développés par ces groupes.
Dans le cadre du projet de Renforcement et Amélioration dans l'Alimentation en Eau Potable à Douala de CAMWATER, BETA CONSULT a été mandaté pour assurer le contrôle qualité et l'évaluation des travaux sur le plan technique. Cet aspect lui a été confié pour la qualité de ses services et ses expériences passées dans le cadre de la mise en oeuvre des projets hydrauliques à l'échelle locale, nationale et même continentale notamment dans :
+ L'élaboration d'un Plan de Développement Hydraulique (PDH).
+ L'Inventaire et étude des ressources et des sites.
+ L'Identification et qualification des besoins.
+ L'Etude de faisabilité et les études techniques.
+ L'Assainissement en eau.
+ La mise en oeuvre des barrages et la protection contre les inondations.
+ L'Aménagement des périmètres irrigués.
187
? La Mise en OEuvre et le Bénéficiaire - La Mise en oeuvre du Projet:
La CAMWATER dans le souci d'améliorer les infrastructures en eau afin de satisfaire les besoins de ses consommateurs a établi un processus innovateur qui consistait à réhabiliter et construire des infrastructures durables pour l'alimentation en eau potable à l'échelle nationale. C'est dans ce cadre qu'elle a mis en oeuvre la Phase Première du Projet de Renforcement et Amélioration dans l'Alimentation en Eau Potable dans la ville de Douala.
Cette phase du projet initialement consistait à construire une usine de production d'eau d'une capacité de 100 000m3/ jour à côté de celle de 50 000m3 / jour. Ces ouvrages sont fonctionnels depuis 2010 dans le département du Moungo à Yato sur les berges du fleuve Moungo. Sur le plan financier, la première usine était évaluée à 18 Milliard FCFA dont 7 Milliard FCFA sur fonds propres de CAMWATER et les 11 FCFA Milliards restant par un prêt de L'Exim Bank China.
Pour ce qui est du projet dans sa phase deux, sous un financement de 52 Milliards FCFA, il consiste à mettre sur pied un réseau souterrain de canalisation d'eau du centre de production de Yato au (fleuve Moungo) pour la ville de Douala. Une partie ici avait déjà été réalisée avec la réhabilitation du château d'eau de Bonaberi pour l'alimentation de la partie Ouest et Sud-Ouest de la ville de Douala de l'autre côté du pont du Wouri il y `à bientôt deux ans. La majeure partie de la phase II du projet consistait de faire traverser ces canalisations souterraines de l'autre côté du Wouri par la construction d'un « pont-tuyau aérien ». De l'autre côté des berges du Wouri, il sera question de construire 3 châteaux d'eau dont un à Koumassi à Douala I, le deuxième à Nyala à Douala III et le troisième à Logbessou à Douala V. Ces châteaux d'eau seront reliés à un réseau inter-connectif par des canalisations d'eau souterraines le long des axes routiers clés de la ville tel que le Boulevard Leclerc, l'axe carrefour AGIP au Rond-Point Deido, l'axe Aéroport à Village à Yassa et de Yassa au Château de Nyala sans oublier l'axe St Michèl à l'Aéroport, de Akwa nord à Bonamoussadi et Maképé jusqu'à Logbessou ..... Ce réseau de canalisations fera environ 54 kilomètres de conduite d'eau dans son ensemble.
- Le Bénéficiaire :
Le peuple Camerounais et l'ensemble des 3 millions de citadins de la ville de Douala sont les potentiels bénéficières de ce projet aux ouvrages de qualité durable pour assurer un développement véritable du secteur de l'eau en milieu urbain et péri-urbain dans la région du littoral et au Cameroun en général.
Les cinq municipalités qui constituent la ville de Douala à l'exception de l'ile de Manoka (Douala VIème) sont également les bénéficiaires de ce projet. C'est ainsi que les chefs des Cantons Bell, Akwa, Bassa et Bakoko ont été associés au projet afin de faciliter les négociations avec les populations concernées par la médiation sociale.
188
RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
1- Cadre Législatif :
? Rappel des lois relatives à la gestion environnementale dans le secteur de l'approvisionnement en eau potable :
La loi N° 96/12 du 5 Août 1996 portant sur le cadre relatif à la gestion de l'environnement stipule dans les articles 5 et 6 respectivement que : les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones urbaines et les zones rurales. (1) toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de leur compétence, de sensibiliser l'ensemble des populations aux problèmes de l'environnement. (2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement. L'article 26 souligne le fait que l'administration chargée de la gestion des ressources en eau dresse un inventaire établissant le degré de pollution des eaux continentales, en fonction des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire est révisé périodiquement ou chaque fois qu'une pollution exceptionnelle affecte l'état de ces eaux.
La loi N° 98-005 du 14 Avril 1998 portant régime de l'eau stipule dans son article 2, - (1) L'eau est un bien du patrimoine commun de la Nation dont l'Etat assure la protection et la gestion et en facilite l'accès à tous. (3) La gestion de l'eau peut, en outre, faire l'objet de concession ou d'affermage, suivant des modalités fixées par un décret d'application de la présente loi. Elle va plus loin en précisant dans l'article 7- (1) En vue de protéger la qualité de l'eau destinée à l'alimentation, il est institué un périmètre de protection autour des points de captage, de traitement et de stockage des eaux. (2) Les terrains compris dans les périmètres de protection sont déclarés d'utilité publique. Ladite loi souligne dans son article 12 que le contrôle de la qualité des eaux de consommation est assuré, à tout moment, par les personnels des Administrations chargées respectivement de l'eau et de la santé publique, assermentés et commissionnés à cet effet. La présente loi définie les responsabilités et les sanctions dans ses articles 14 et 15 respectivement. Il est à souligner ici que : Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale et nonobstant les vérifications effectuées par les Administrations chargées du contrôle, est responsable civilement, sans qu'il soit besoin de prouver une faute, toute personne qui a causé un dommage corporel ou matériel résultant de la mauvaise qualité des eaux d'alimentation qu'elle distribue (extrait de l'article 14). Pour ce qui est des sanctions pénales il est à retenir qu'est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) de FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui : offre de l'eau de boisson au public sans se conformer aux normes de qualité en vigueur.
La loi fédérale n°64/LF/23 du 13 Novembre 1964 portant protection de la santé publique. Cette loi pose les bases des règles de la salubrité des centres urbains et lieux habités, des immeubles et de leurs dépendances, des lieux publics et privés, des lotissements, des établissements dangereux, insalubres et incommodes. L'article 2 de cette loi pose les bases de l'assainissement au Cameroun en stipulant que « les travaux d'assainissement tels que les adductions d'eau potable, les drainages, les assèchements, la création des égouts peuvent faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique
189
entraînant les effets prévus par les textes applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique » .
Ces trois lois majeures développées plus haut servent de socle pour le Plan de Gestion des Risques Environnementaux (PGRE) que nous proposons. Elle est également soutenue par une multitude de décrets dans le secteur de l'environnement, la santé public, et les mine-eau et énergie.
2- Cadre Réglementaire
? Rappel des Décrets et Arrêté du secteur Environnement- Santé - Sécurité et Eau
Le décret n°68/59/COR du 30 Avril 68 relatif à la construction, pose les bases de la réglementation camerounaise en matière d'eau et d'assainissement. Il contient des dispositions en matière de distribution d'eau potable, d'évacuation des eaux pluviales, des eaux usées et des matières fécales ainsi que celles liées aux ordures ménagères ;
Le décret N° 2001 /164 / PM du 08 Mai 2001 Précise les modalités et conditions de prélèvement des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales. Dans l'articulation de l'autorisation de prélèvement des eaux, article 5 - (1) il est stipulé que toute personne désirant implanter et/ou exploiter une installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant le prélèvement des eaux de surface ou souterraines à des fins industrielles ou commerciales, adresse une demande d'autorisation au Ministère en charge de l'eau. Pour ce qui est du contrôle des installations de prélèvement les articles 18 et 19 respectivement mentionnent le fait que toute installation de prélèvement des eaux à des fins industrielles ou commerciales doit être dotée d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés. Ledit dispositif doit être conforme à un modèle approuvé et agréé par le ministre chargé de l'eau, après avis de l'administration chargée du contrôle des instruments de mesure. L'exploitant ou le responsable d'une installation de prélèvement des eaux doit noter, mensuellement, sur un registre spécialement ouvert à cet effet : les volumes prélevés ; le nombre d'heures de prélèvement ; l'usage et les conditions d'utilisation des eaux prélevées ; les variations éventuelles de la qualité des eaux prélevées ; les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le captage des eaux, notamment les arrêts de prélèvement.
Le décret N° 2001 /163 / PM du 08 Mai 2001 Réglementant les périmètres de protection autour des points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables. L'acte d'autorisation de prélèvement fixe et détermine, le cas échéant, les modalités d'établissement dans le quelle les ouvrages de captage, de traitement et de stockage des eaux peuvent être atteints par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de façon suffisante ou sans qu'il soit possible de récupérer le polluant de façon efficace (article 4 alinéa 1). L'Article 8 stipule que le Ministre chargé de l'eau peut, sur proposition de l'autorité administrative territoriale compétente, interdire le captage des eaux de surface ou souterraines, pour l'un des motifs dûment constatés ci-après : risque de tarissement du cours d'eau ou de la nappe d'eau ; pollution évidente du cours d'eau ou de la nappe d'eau ; risque pour la santé publique et cause d'utilité publique. Plus loin, l'Article 11 dans son alinéa : 1 dit que la surveillance et le contrôle du respect des mesures de protection des points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables sont effectués par les agents assermentés de l'administration chargée de l'eau ou des autres administrations concernées, dûment commissionnés à cet effet. L'Alinéa 2 : stipule que les agents assermentés visés à l'alinéa précédent procèdent à
190
tout examen, contrôle et enquête, et recueillent tous les renseignements nécessaires. Ils peuvent notamment : Procéder au prélèvement des échantillons d'eau ou de matière, aux fins d'analyse par un laboratoire agréé ; avoir accès aux installations en cause pour effectuer tout contrôle jugé nécessaire et rechercher et constater, sur procès-verbal régulièrement établi les infractions.
Le décret N° 2005/493 du 31 décembre 2005 portant modalités de délégation des services de l'eau potable et de l'assainissement liquide en milieu urbain et périurbain, précise les modalités de fonctionnement desdits services. Dans les grandes lignes de ce décret, notre attention s'est portée sur l'article 3 qui stipule que : « Le service public de l'eau potable est confié par l'Etat, dans le cadre de conventions de délégation de gestion de service public, à : Une société à capital public , société de patrimoine, responsable de la gestion des biens et droits affectés au service de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, et qui est chargée de la construction, de la maintenance et de la gestion des infrastructures de captage, de production, de stockage et de transport de l'eau potable ». Il est également important de souligner la pertinence de l'article 5 qui dit que : « dans le périmètre de la SNEC tel qu'il existe à la signature du présent décret et dans ses éventuelles extensions, le service public de production et de distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain est confié par l'Etat, dans le cadre d'un contrat d'affermage et d'un cahier des charges et pour une période initiale de dix (10) ans, à une société anonyme dont le capital est détenu en totalité ou au minimum aux deux tiers par des personnes physiques ou morales de droit privé ». Les activités de la CAMWATER et la CDE s'inscrivent dans le cadre de ce texte.
Toute aussi important que ceux mentionnés plus haut, les décrets et l'arrêter suivant ont également un rôle capital pour la mise en oeuvre effective du PGRE :
? Décret N°2005/0577/PM du 23 février 2005 sur les modalités de
réalisation des Etudes d'Impact Environnemental ou sa version révisée de 2013.
? Décret N° 99/818/PM du 09 novembre 1999 - fixant les modalités
d'implantation et d'exploitation des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes
? ARRETE N° 039 /MTPS /IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.

