_
P a g e |
DÉDICACE
A mes très chers parents Denis MIHALI et Sifa KALYONGO.
BYAOMBE MIHALI Germain
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Ass2 : assistant deuxième
mandat
LTA : Lettre de transport aérien
Art. : Article
RTNC : Radio Télévision
Nationale Congolaise
FPI : Fonds de promotion de l'industrie
DGI : Direction générale de
l'impôt
SONAS : société nationale
d'assurance
BCC : Banque centrale du Congo
CIF : cost insurance fees
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
COG : Commission OGEFREM
DGDA : Direction Générale des
Douanes et D'accises
DGRAD : Direction Général des
Recettes Administratives
DPNK : Direction Provincial du Nord-Kivu
FONER : Fonds National pour l'Entretien
Routier
ISC : Institut Supérieur de Commerce
OCC : Office Congolais de Contrôle
OFIDA : Office de Douanes et Accises
OGEFREM : Office de Gestion de Fret
Multimodal
RDC : République Démocratique
du Congo
TFC : Travail de fin de cycle.
P a g e |
REMERCIEMENTS
Pour parvenir à la fin de notre cycle bien des gens
nous ont aidés pour la réalisation de ce travail, en fournissant
des efforts personnels sans l'aide des autres on ne pourrait pas arriver
à la fin de notre travail.
Tout d'abord nous remercions DIEU pour sa Grâce qu'il
continu à déverser en nous et pour le souffle de vie qu'il
continu à nous accorder du jour le jour et que sans ce souffle de vie
nous n'aurons pas pu réaliser ce travail.
Nos remerciements s'adressent à toutes les
autorités académiques de l'Institut Supérieur de Commerce
de Goma, particulièrement à celles de la Section douanes et
accises pour leurs sincères encadrements.
A notre Directeur, l'Ass2 NIYIBIZI BAZIMENYERA
Casimir pour avoir accepté de diriger ce travail malgré ses
multiples tâches.
Je remercie mes oncles pour leur soutien financière et
morale et tient à remercier particulièrement Liévin
SHAMAMBA, Papy KALYONGO, et Lucien RAMAZANI.
A nos frères et soeurs : Jacques WAKILONGO, Ricette
MIHALI, Rachel LUSHEMBE, Jonathan NTUMBA, Dynah KAHAMBU, Maël GASHAMBA,
Julie KALEMI, Fidel KAMPARA pour leur soutien moral.
Nous ne pouvons pas terminer cette page sans remercier les
camarades étudiants et amis avec qui nous avons partagé des
moments dur et de bonheur tout au long de notre parcours académique.
Nous ne pouvons nommer ici toutes les personnes qui, de
près ou de loin, nous ont aidées et encouragées, mais nous
les en remercions vivement et nous leur sommes très reconnaissants.
BYAOMBE MIHALI Germain
0.INTRODUCTION
0.1 État de la question
Étant donné que le champ d'investigation
scientifique est limité et évolutif dans le fonds et formes,
toute question qui se poserait pour y apporter solution apparait comme une
goutte d'eau dans l'océan des chercheurs scientifiques.
Nous ne sommes pas les premières personnes à
traiter sur ce genre de sujet ou de faire les recherches sur ce sujet et
rappelons que plusieurs auteurs en ont parlés, à savoir :
- KISANGA RIZIKI ABINA1(*), dans son mémoire portant
sur l'analyse de performance de recouvrement des recettes non fiscales
encadrées par la DGRAD/NK de 2005 à 2007 ; est partie de
plusieurs questions et nous avons choisi la suivante :
?Quelles sont les causes du déficit mobilisation des
recettes par la DGRAD/NK ? et après analyse elle a abouti à la
conclusion suivante, dans la mobilisation et la canalisation des recettes non
fiscales, il a constaté que les notes de perception en souffrance
étaient nombreuses.
Ce qui explique que sur le maximum de des recettes
prévues en 2006 seul 59,8% ont été encaissées ;
soit un mali de 40,2% et en 2007 seul 17,8% ont été
réalisés grâces au recouvrement des notes de perception en
souffrance de SUPERCEL (paiement avec pénalité).
- KABUYA BAHATI2(*), dans son TFC portant sur l'analyse du partenariat
entre la DGDA et les services connexes dans la mobilisation de recettes
douanières est partie sur base de questions suivantes :
?Comment la DGDA procède-t-elle pour la liquidation, le
recouvrement et la perception des commissions pour le compte de l'OGEFREM ?
?Le protocole d'accord entre ces deux services est-t-il
respecté par ces derniers ?, après analyse il a abouti aux
conclusions suivantes :
ï Les marchandises déclarées et faisant
objet du trafic frontalier sont assujetties au paiement de la commission
OGEFREM sur leur valeurs en douane.
ï Il avait remarqué que les deux
établissements ne respectent pas le protocole, l'OGEFREM ne pas
ténu au courant de certaines situations à son niveau.
?UWIMANA KARABONEYE3(*) dans son TFC portant sur
l'étude de partenariat entre la
DGDA et autres services cas de l'OCC Goma, quand à
celle s'est posé les questions suivantes :
?Les clauses de partenariat sont-elles respectées ou
non, comment alors règles-t-on les litiges éventuels ?
?Quelles est l'évolution des recettes de l'OCC et la
DGDA pendant la période de l'étude ? ; elle a conclu en disant
que :
ï Les litiges dans l'exécution des accords entre
les deux car la perfection n'est pas garantie ;
ï Les recettes de l'OCC avec ses partenariats seront plus
importantes qu'avant ces accords.
0.2 Problématique
La problématique est l'ensemble des questions
posées dans une branche scientifique en vue d'une recherche des
solutions à ses questions4(*). Il est vrai qu'aucun n'ignore que les entreprises ou
établissements à porte feuille sont devenus boiteux pendant
qu'ils jouent un rôle important dans la bonne gouvernance de la RD Congo.
Certains mesures tendent également à
alléger les tâches administratives des entreprises publiques
prisent sous formes de lois, ordonnances, ordonnances-lois, décrets,
arrêtes, circulaires misent en place pour créer un bon climat des
affaires en RD Congo. Certains documents de couverture du fret sont de
portée internationale, il s'agit de la lettre de voiture
(bon de transport), la lettre de transport aérien
(LTA), connaissement (cargo) et manifeste (fret). Ces documents sont
émis par les compagnies de transport et continuent une preuve de prise
en charge et de transport.
Au sein de chaque structure les administrateurs en charge des
services publics ont pour devoir de bien maîtriser les procédures
en vigueur, et veiller à leur application.
En effet, notre travail tourne autour de quelques questions de
recherche suivantes :
? Quel est la part des recettes du FONER dans les recettes
totales des services connexes de la douane ?
?Comment ont évolués les recettes issues des
services connexes pendant la période d'étude ?
? Quel est le service qui contribue plus dans les recettes des
services connexes ?
0.3 Hypothèse
D'après Madeleine GRAWITZ, l'hypothèse est une
proposition de réponses aux questions posées dans la
problématique5(*).
Selon le ROBERT, l'hypothèse6(*)est une proposition relative
admise provisoirement avant d'être soumise au contrôle de
l'expérience.
Nous référant aux questions posées
ci-haut dans la problématique, les hypothèses ci-après ont
été formulées :
1) La part du FONER dans les recettes totales des services
connexes de la douane serait de 50%,
2) Avec nos suppositions, les recettes issues de services
connexes ont évoluées à la hausse pendant la
période de notre étude,
3) Le service qui contribue plus dans les recettes des
services connexes serait le FONER
0.4 Objectifs du travail
0.4.1 Objectif global
L'objectif global est d'étudier le fonctionnement des
services connexes de la douane.
0.4.2 Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
? Savoir l'évolution des recettes de services connexes ;
?Savoir l'apport de chaque service dans les recettes totales
des services connexes de la douane.
0.5 Choix et intérêt du sujet
Le choix apporté à ce sujet dans le cadre de cet
ouvrage scientifique n'est pas un fait hasardeux mais il est sanctionné
par le simple fait que les services connexes de la Douane à Goma sont
des établissements publics et importants dans les domaines de douanes
pour la bonne gouvernance de l'État.
Quant à l'intérêt du sujet nous le verrons
sur trois niveaux : oL'intérêt personnel, cette étude est
une condition pour l'obtention de notre diplôme de graduat en douanes et
accises à l'ISC/Goma, et participe au renforcement de notre formation
scientifique ;
o Intérêt général, amener une
petite lumière aux scientifiques pour savoir comment certains services
connexes ont fonctionnés durant la période et servir aux futures
chercheurs qui s'intéresseront à l'étude des autres
services.
o Pour les services connexes, contribué à la
mise en oeuvre des nouvelles méthodes pour la parfaite maximisation de
recettes.
0.6Méthodologie et technique
Selon le ROBERT, la
méthodologie7(*) est
l'étude des méthodes scientifiques et techniques.
La méthode selon Jean Louis LAUBET est l'ensemble des
opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et
d'expliquer la réalité étudiée.8(*)
La méthode est l'ensemble de démarches
raisonnées, suivies pour parvenir à un but.
Selon Roger PINTO, la méthode est comme un ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
atteindre les vérités qu'elles poursuivent, et les
démontrées, et les vérifiées9(*).
- La méthode quantitative (approche statistique) : cette
méthode nous a aidé d'analyser les données
récoltées en utilisant les outils statistique et informatique :
tableau, pourcentage et graphique.
La technique est un outil qui permet au chercheur de
récolter et dans une certaine mesure de traiter les informations
nécessaires à l'élaboration d'un travail10.
Ainsi, nous avons recouru à la technique documentaire :
consistant à la lecture d'un certain nombre d'ouvrages et documents
relatifs à notre sujet ; et à la récolte des
données.
0.7 Délimitation du travail
Notre travail est délimité dans le temps et dans
l'espace, pour produire enfin un travail digne et précis.
Nous avons préférés la période
allant de 2013-2017 enfin de bien faire notre étude parfaitement.
Quant à l'espace considérons la province du
Nord-Kivu, la ville de Goma
0.8 Subdivision du travail
En dehors de l'introduction et la conclusion, le
présent travail est subdivisé en trois chapitres ; le premier
chapitre porte sur les approches conceptuelles du travail, le deuxième
parlera sur la présentation des services connexes de la Douane, et le
troisième qui est le dernier portera sur la présentation des
données et leurs interprétations.
CHAPITRE PREMIER : APPROCHES CONCEPTUELLES DU
TRAVAIL
I.1 DÉFINITION DES CONCEPTS CLÉS
I.1.1 SERVICE
Un service est une prestation qui consiste en « la mise
à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle »
ou en « la fourniture d'un travail directement utile pour l'usager, sans
transformation de matière ».
Fournir un service correspond à une production
économique de nature particulière puisqu'elle ne consiste pas en
la fourniture d'un bien tangible à un client.
Les services étant consommés dans le même
temps nécessaire pour les produire sont considérés comme
n'étant pas « stockables ».
Christopher Lovelock10(*) distingue quatre grandes catégories de service
(ou de prestation). Il les différencie d'une part par la nature de la
prestation : l'action concrète, tangible qui fait physiquement quelque
chose ou bien l'action psychologique, intellectuelle, immatérielle ; et
d'autre part, par l'objet du service, ce sur quoi il porte : des personnes
(leur corps ou leurs esprit) ou des choses (tangibles ou intangibles comme les
chiffres).
Les services concrets rendus aux personnes : les
coiffeurs, les transports de personnes, les soins médicaux et
chirurgicaux, etc. ;
Les services concrets portant sur des choses ; le
transport de fret, le nettoyage à sec, la réparation automobile,
le dépannage domestique ou professionnel, etc.
Les services abstraits s'adressant à l'intelligence
ou au sens : enseignement, divertissement ;
Les services portant sur des entités intangibles,
numériques : compte bancaire, crédit, assurances.
I.1.1.1 LA GESTION DE LA PRODUCTION DES SERVICES
La production de services est devenue l'activité de
production principale des économies développées. Cela
s'accompagne de spécificités dans la gestion de la production qui
sont liées elles-mêmes aux caractéristiques de cette
production qui est principalement immatérielle, non stockable,
réunissant simultanément consommation et production ce qui
implique le plus souvent une participation du client à la production.
Les particularités de l'analyse de la valeur, le caractère
précaire de l'innovation dans les services.
La part des services (représentée grosso modo
pour les raisons évoquées ci-dessus par le « secteur
tertiaire ») augmente tant en chiffre d'affaires qu'en effectif
employé dans la production, la consommation finale et la consommation
intermédiaire.
I.1.1.2 TYPOLOGIE DES SERVICES
On distingue les services marchands, qui sont
facilement procurable sur le marché, et les services non
marchandsdont l'obtention s'opère dans des cadres et selon des
règles plus spécifiques.
a.Services non marchands
Les prestations de ces services ne sont pas
délivrées contre rémunération (régime de la
gratuité totale ou du paiement d'une contribution symbolique, ou par
intervention d'un tiers payant).
Justice ; maintien de l'ordre public (forces de l'ordre) ;
défense nationale ; éducation nationale et université ;
santé publique ; services sociaux et organismes caritatifs.
b.Services marchands
La prestation de ces services est obtenue moyennant un prix,
généralement fixé librement par le marché :
écoles et organismes privés de formation ; services financiers,
de banques ou d'assurances conseil ou de services informatiques ;
télécommunications ; transports. c. Services publics
Un service public est « une activité
d'intérêt général, assurée sous le
contrôle de la Puissance publique par un organisme public
bénéficiant de prérogatives lui permettant d'en assurer
les obligations et relevant de ce fait en tout ou partie d'un régime de
droit administratif»11(*) .
Ce sont les activités jugées utiles par et pour
la collectivité et qui sont assurées dans un cadre particulier.
Ce qui signifie qu'elles peuvent être exercées même lorsque
les critères de simple rentabilité financière devraient
conduire à leur abandon13 .
d.Services privés
Dans les pays développés les plus tertiaires (on
parle parfois d'économie post industrielle), les
services représentent jusqu'à 70 % de la production nationale
(PIB) et sont devenus leur principal moteur de croissance économique.
Cette évolution peut toutefois être
légèrement relativisée par le fait que les entreprises
industrielles externalisent une partie de leur processus de production en
faisant appel à des prestataires qui sont classés dans les
entreprises de services mais qui participent à la production
industrielle.
I.1.2 CONNEXES12(*)
Étymologiquement le mot « connexe » vient du
latin « connexus », participe passé de «
connectere » qui signifie « lier » ;
de « cum » qui veut dire «
avec » et « nectere »
signifie « lier » ; c'est-à-dire que connexe veut
dire lier avec.
Le mot connexe veut tout simplement dire une liaison entre une
ou plusieurs choses du même genre.
I.1.3 COMMISSION13(*)
Le mot commission vient du latin «
commissionis, de committere » qui veut
dire confier une charge ou une mission à quelqu'un pour qu'il
fasse quelque chose à votre place.
La commission peut aussi signifier la gratification plus ou
moins régulière rétribuant celui qui a permis la
conclusion d'une affaire par son influence.
I.1.3.1 Sortes de commissions
 Commission internationale d'enquête : nom des
diverses organismes destinés à faciliter le règlement des
conflits internationaux,
Commission internationale d'enquête : nom des
diverses organismes destinés à faciliter le règlement des
conflits internationaux,
 Commission d'office : désignation d'un avocat
par son bâtonnier ou le président d'une cour ou un tribunal, pour
assister à titre gratuit un prévenu ou un accusé devant
une juridiction répressive,
Commission d'office : désignation d'un avocat
par son bâtonnier ou le président d'une cour ou un tribunal, pour
assister à titre gratuit un prévenu ou un accusé devant
une juridiction répressive,
 Commission rogatoire : acte par lequel un juge
d'instruction charge à un autre juge de procéder à
certaines opérations de l'institution,
Commission rogatoire : acte par lequel un juge
d'instruction charge à un autre juge de procéder à
certaines opérations de l'institution,
 Commission d'examen : ensemble des examinateurs
chargés de faire subir les épreuves aux candidats,
Commission d'examen : ensemble des examinateurs
chargés de faire subir les épreuves aux candidats,
 Commission de visite : ensemble des experts
chargé de visiter les bâtiments et de constater qu'ils ont la
solidité, etc.
Commission de visite : ensemble des experts
chargé de visiter les bâtiments et de constater qu'ils ont la
solidité, etc.
La personne qui agit pour le compte de son client ou le
commettent (patron) mais en son nom est appelée commissionnaire.
« Commissionnaire en douane : personne
ou société dont l'activité consiste à accomplir
pour autrui les formalités de douane,
« Commissionnaire de transport :
intermédiaire entre voiturier et l'expéditeur, qui se
charge d'assurer l'ensemble des diverses opérations de transport.
« Etc.
I.2 APPROCHES THÉORIQUES
I.2.1 DOUANE
La douane est souvent utilisée dans un double sens, il
exprime à la fois un impôt
(impôt de douane), un service de
l'État (administration de douane). Pour mieux comprendre, la
douane, la douane a un rôle économique celui de favoriser les
importations ou de protéger une production nationale. Le droit de douane
est un instrument permettant à la politique douanière d'un pays
de jouer son rôle économique. On distingue le droit de douane
spécifique qui est un prélèvement d'un montant fixé
par unité de bien importé et le droit de douane ad valorem qui
est une part de la valeur du bien importé14(*). La politique douanière
est l'ensemble des mécanismes et des facteurs d'ordre juridique, des
textes légaux et réglementaires, matériel qui
caractérisent le système douanier d'un pays, définis et
appliqués dans la finalité de contrôler l'activité
économique d'un pays par rapport au reste du monde15(*).
I.2.1.1 Historiques de la Douane
vHistorique de la douane dans le monde16(*)
Dans sa substance, la douane se ramène à un
mécanisme fiscal complexe, sans doute le plus ancien de par la nature de
prélèvement qu'il opère. Quoique ses origines ne soient
pas formellement établies, l'activité douanière remonte
dans certaines régions anciennes à premières heures de
l'ouverture des nations au commerce mondial.
En effet, les prélèvements douaniers ont
constitués de tous temps une taxe imposée sur les marchandises
franchissant la frontière d'un État, d'une province ou d'un fief,
dans le cadre d'une transaction commerciale.
Asakura H.17(*) pour sa part pense que :" les origines de la douane
se confondent de ce fait avec celle du commerce international, l'auteur
continue en disant que deux conditions doivent être réunies pour
qu'il y ait douane, à savoir l'existence du commerce d'une part et celle
de l'autorité publique d'un souverain ou d'un chef d'autre part". C'est
ce qui distingue le prélèvement douanier du pillage et de la
piraterie.
Dès lors, la douane tire son origine des
différents bureaux de la civilisation humaine qui sont: la
Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce, le bassin
méditerranéen. On peut penser que ce sont ces régions qui
ont vu naître la douane avec le développement du trafic maritime.
vHistorique de la douane au Congo18(*)
La douane a été créée au Congo par
la loi coloniale belge du 20/11/1914, sous l'appellation de
"l'Office de Douane Coloniale", au fil du temps les
bases juridiques actuelles de l'organisation douanière ont
été posées par le décret du 29/01/1949 et
l'ordonnance du 06/01/1950.
Après l'accession du pays à
l'indépendance, tous les services disséminés sur
territoire national ont été réunis sous une direction
unique dénommée "Direction de Douanes et
Accises «rattaché au ministère des finances.
Les personnel de cette direction relevait ainsi de l'autorité directe du
secrétaire général aux finances, régit par le salut
général de la fonction publique.
L'Office de douanes et accises en sigle OFIDA a
été créée par l'ordonnance présidentielle
n° 079/144 du 15/05/1979 entant qu'une entreprise publique jouissant de la
personnalité juridique. En 2008, est intervenue la réforme des
entreprises publiques de portefeuille qui par 4 différentes lois
préconise des nouvelles dispositions partant à la loi de la
transformation des entreprises publiques, désengagement de l'État
ainsi l'organisation des établissements publics et la gestion de
portefeuille de l'État. Il s'agit respectivement des lois n° 08/007
du 07/07/2008 portant disposition générale relative de
désengagement de l'État des entreprises à porte feuille
n° 08/009 du 07/07/2008 réglementant les dispositions applicables
aux établissements publics et n° 08/010 du 07/07/2008 relative
à l'organisation et à la gestion du porte feuille de
l'État.
C'est dans ce processus global de réforme qu'est
née en terme de décret n° 09/43 du 03/12/2009 portant
création de la "Direction Générale des Douanes
et Accises" en sigle "DGDA",
préalablement transformée par le décret n° 09/12 du
24/04/2009 en un simple service public doté de l'autonomie de gestion
mais sans personnalité morale.
I.2.1.2 MISSIONS DE LA DOUANE
Le nouveau rôle de la douane permet la facilitation des
échanges, la simplification et l'harmonisation des procédures en
matière de commerce international.
A. Missions de la douane
La douane étant un service public oeuvrant par la
croissance économique, le bien être de la population et la
protection de la société par l'application de la
législation douanière accisiennes et connexes, travaille avec le
gouvernement, l'institution nationale et internationale ainsi que les
opérateurs économiques dans le but de créer un
environnement favorable aux commerces et aux investisseurs.
Comme administration douanière est un service ayant
soit exclusivement des attributions en matière douanière, le
décret n°09/43 du 03/12/2009 portant création et
organisation de la DGDA confié à celle-ci 19 missions
regroupées en 8 catégories:
a)Mission de percevoir les droits de douane
La mission de percevoir les droits de douanes est celle qui
consiste à la douane de percevoir pour le compte du trésor
public, les droits de douane sur les marchandises importées et
exportées sur le territoire de la RDC.
Pour y arriver, il faut trois éléments
essentiels :
ï La valeur de la marchandise
ï L'origine de la marchandise ?Espèce tarifaire.
b)Mission de percevoir les droits d'accises
La douane a aussi la mission de percevoir pour le compte du
trésor public à l'occasion de la production locale et des 14
produits désignés par l'ordonnance loi n° 007/2012 du
21/09/2012 portant code des accises.
?Procédures
1°) Dépôt au début de chaque mois au
bureau de la douane de rattachement une déclaration de travail (art. 47
code des accises),
2°) Dépôt à la fin de chaque mois au
bureau de douane de rattachement de relevé des matières
premières et produits finis (art. 48 code des accises),
3°) Dépôt aux plis tard le 2ème jour
de l'expiration de la décade d'une déclaration des produits
d'accises (art. 50 point 1&2 du code des accises),
4°) Enregistrement de la déclaration d'accises
(art. 53 point 1 du code des accises),
5°) Contrôle de la déclaration des produits
d'accises (art. 55 point 1 du code des accises),
6°) Liquidation des droits (art. 61 du code des accises),
7°) Paiement des droits d'accises (art. 64 et 66 du code
des accises).
c)Mission de surveillance des frontières
La douane fait la surveillance des frontières en visant
de:
Ø Lutter contre le blanchissement des capitaux,
Ø Lutter contre les terrorismes,
Ø Protéger l'espace économique national,
Ø Lutter contre l'appauvrissement de la couche d'ozone.
d)Mission de recherche et répression des
infractions aux législations douanières, accisiennes et connexes
Cette mission consiste pour la douane à lutter contre
toute validation de la législation douanière, accisienne et
connexe prévue par la législation en vigueur.
e)Mission du commerce extérieur
L'objectif principal de la douane à ce niveau est
d'aider les exportateurs nationaux de devenir plus riches enfin de faire face
aux commerces extérieurs. Pour y arriver la douane utilise quelque
mesures comme :
ï Lutter contre la contrefaçon,
ï L'intégration économique,
ï La promotion de la collaboration avec les
administrateurs étrangers
f)Mission d'élaboration de statistique du
commerce extérieur
La douane communique avec les services comme :
- Parlement,
- Mission de santé,
- Ministère des affaires étrangères,
- Fédérations des entreprises du Congo,
- Ministère de l'économie,
- Les investisseurs, etc.
g)Mission de former les agents aux techniques modernes
des douanes et accises
Parmi les techniques modernes de la douane il y a :
ï La gestion des risques,
ï Le contrôle à posteriori
h)Missions de représenter les services connexes
aux frontières
La douane est la représentante des services connexes
à la frontière et c'est la douane de percevoir pour le compte des
services connexes et ces derniers payent des commissions à titre de
service rendu à la douane.
DEUXIÈME CHAPITRE : PRÉSENTATION DES
SERVICES CONNEXES
La douane collabore avec d'autres organismes et à cet
effet elle s'occupe de la perception et du recouvrement de certaines taxes,
commissions, redevances ou rémunérations pour le compte de ces
organismes et contrôle l'applicabilité des documents
émanant des organismes publics.
Cela dans le souci d'améliorer le climat des affaires mais
aussi de réduire le temps d'immobilisation des marchandises et
d'accomplissement des formalités douanières, cet ainsi que la
DGDA a signé plusieurs protocoles d'accords avec les différents
organismes ou services connexes à la Douane à savoir le FONER,
l'OCC, l'OGEFREM, la RTNC, le FPI, la DGRAD, la DGI, la SONAS, la
BCC...19(*)
Et nous dans ce travail nous allons nous intéresser
plus sur l'OGEFREM, le FPI, la DGRAD, la DGI, le FONER, et enfin la RTNC.
II.1 Le Fonds National d'Entretien Routier (FONER)22
La RDC sort de conflits successifs qui ont
désarticulés son économie, ses ressources et
détruit ses infrastructures de base, l'insuffisance et
l'intégralité et l'intégralité chronique des
budgets nationaux alloués au secteur routier constituent la cause
majeure de la dégradation généralisée des routes.
Le délabrement très avancé des infrastructures routier
rend malaisée la circulation des personnes et biens à travers le
pays. La loi n°08/006-A du 07 juillet 2008 portant création du
Fonds National d'Entretien Routier en sigle FONER offre
à l'Etat congolais l'opportunité de remplir le devoir que la loi
impose les dispositions de l'article 59 de la constitution et cette loi donne
au FONER les missions suivantes :
* D'établir d'impôts en matière
d'exploitation routière conformément à l'article 174 de la
constitution,
* Favoriser la contribution aux charges publiques de toute
personne vivant en RDC,
* Maximiser les recettes nationales en vue de répondre
aux besoins de développement,
* Collecter les ressources nécessaires au financement
des dépenses liées à l'entretien et à la protection
des routes et voirie urbaine d'intérêt national.
Le FONER donne mandat à la DGDA de constater, liquider,
ordonner et percevoir en son compte et à son nom la redevance sur
carburant terrestre et lubrifiants importés et mise à
consommation en RDC, droit de péages sur les véhicules à
immatriculation étrangère franchissant la frontière de la
RDC.
II.2 L'Office de Gestion de Fret Multimodale (OGEFREM)
a.Historique
Avant les textes juridiques l'OGEFREM n'existait pas, et pour
faire l'existence de
l'OGEFREM, il a plu au Président MOBUTU SESE
SEKO KUKU NGWENDU WA ZA
BANGA de signer l'ordonnance
présidentielle n° 80-256 du 12 novembre 1980 et à la
signature de ce dernier, l'entreprise publique fut créée sous le
nom de « OFFICE ZAIROIS DE GESTION DU FRET MARITIME
« en sigle « OGEFREM ». L'OGEFREM est
soumis au pouvoir des autorités de tutelle voir ordonnance
n° 80-256 du 12 novembre 1980 à son article 1 alinéa 2. La
raison de cette ordonnance est une raison économique nationale et
internationale.
L'OGEFREM doté d'une personnalité juridique est une
institution publique de l'Etat. Son siège social se trouve à
Kinshasa (Article 3, alinéa 2 de l'ordonnance n° 80-256 du 12
novembre 1980).
L'OGEFREM a connu l'évolution, et en 2009 le premier
ministre Adolphe MUZITO a signé le décret
n° 09/63 du 03 décembre 2009 fixant le statut
d'établissement public à
l'OGEFREM, le nom de l'OFFICE ZAIROIS DE GESTION DU FRET
MARITIME fut changé en OFFICE DE GESTION DU FRET
MULTIMODAL. La gestion de moyens et les voies de transport est la
cause du multimodal.
b.Missions générales
Au terme de l'ordonnance présidentielle n° 80-256
du 12 novembre 1980, l'OGEFREM a pour mission de :
ï Négocier avec les conférences maritimes
en vue de déterminer un taux de fret applicable dans la
république ;
ï Chercher les voies et moyens pour améliorer la
vie des chargeurs ;
ï Simplifier les formalités dans le secteur de
transport maritime.
Apres la transformation de l'OGEFREM par le décret
n° 09/63 du 03 décembre 2009, cet office a pour mission de, d' :
ï Assurer la régularisation de l'accès du
fret national partout en RD Congo,
ï Déterminer le prix de transport,
ï Chercher les voies et moyens pour former et informer
les chargeurs,
ï Mettre en place les mécanismes de suivi des
marchandises bout en bout,
ï Gérer les données de transports nationaux
et internationaux,
ï Aider les opérateurs d'obtenir le prix le plus
bas avec rapidité et sécurité.
c.Structure organique
Ci-dessous la structure de la Direction Provincial du
Nord-Kivu :
ü Direction
ü Sous-direction de Goma
ü Sous-direction de Béni
A la sous-direction de Goma, on a :
ï La sous-direction administrative et financière
ï La sous-direction des activités techniques
La sous-direction administrative et financière est
subdivisée en 2 services que voici :
oService administratif oService financier
Dans chaque service, il y a des bureaux,
* Voici les bureaux du service administratif :
- Bureau administratif
- Bureau médico-social
- Bureau protocole et accueil
* Voici les bureaux du service financier
- Bureau recouvrement
- Bureau Comptabilité
- Bureau trésorerie
La sous-direction des activités techniques est
subdivisée en 2 services que voici :
ï Service Guichet Unique
ï Service Facilitations et Assistance aux Chargeurs
Chaque service à des bureaux ;
* Voici les bureaux du service Guichet Unique :
- Bureau import ;
- Bureau liaison ;
- Bureau export.
* Voici les bureaux du service facilitations et Assistance aux
Chargeurs :
- Bureau Facilitations ;
- Bureau Assistance aux Chargeurs.
Le principe était que la DGDA devrait percevoir pour le
compte de l'OGEFREM une commission de 0,5% de la valeur CIF plus la TVA y
relative sur toutes marchandises ayant empêtré la voie maritime.
Actuellement, le concept est devenu très large et il est
donc passé de la voie maritime au transport multimodal
c'est-à-dire que la DGDA est autorisé de percevoir pour le compte
de l'OGEFREM quel que soit le mode de transport utilisé (routier,
ferroviaire, lacustre, maritime, aérien,...).
II.3 Le Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI)
La DGDA perçoit pour le compte et au nom du FPI la Taxe
pour la Promotion de l'Industrie (TPI) est perçu sur tous les biens et
marchandises importées et cette taxe est de 2% de la valeur CIF
majoré de droit de douane.
II.4 La Direction Générale des Recettes
Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation (DGRAD)20(*)
a.Création
La DGRAD a été créée par le
décret-loi n°058 du 27/12/1995, elle sera chargée de la
perception des recettes non fiscales en assurant l'ordonnancement et le
recouvrement après constatation et liquidation par les services
d'assiettes ou générateurs des recettes, cette structure
jouissant d'une autonomie administrative des finances, ce pendant elle n'a pas
de personnalité juridique.
b.Missions
Les dispositions du décret n°058 du 27/12/1995
portant création, organisation et fonctionnement de la DGRAD
précise que la mission principale est l'ordonnancement et recouvrement
des recettes non fiscales dues au Trésor Public. Par contre, les
différentes administrations appelées services
générateurs ou services d'assiettes s'occupant sur base des
modalités et des taux fixés par les textes légaux et
règlementaires de la constatation et de la liquidation des recettes.
À ce titre, l'établissement les notes de taxation de débit
ou factures pour les droits dus, le gouvernement donne à la DGRAD une
assignation minimale à atteindre au cours de chaque année
budgétaire, le législateur a renforcé le pouvoir de cette
régie financière en lui donnant l'ordre de procéder
à un ordonnancement d'office de constatation et liquidation par le
service, poser d'actes et pour autant les faits générateurs d'une
recette prévue par là où la réglementation est
établie, ceci par la loi n°05/008 du 31/03/2005 modifiant et
complétant la loi n°04/015 du16/07/2004 fixant la nomenclature des
actes générateurs des recettes.
c.Structure organique
La DGRAD est constituée de :
ï Direction de l'Administration et des services
généraux qui comprend à son tour la direction des
études et du contentieux, direction de contrôle et de
l'ordonnancement des recettes administratives, judiciaires et de participation,
direction de recouvrement
et de suivi des régimes d'exception, direction de
contrôler et de l'ordonnancement des recettes domaniales, direction
administrative et des services généraux.
ï Direction des études et contentieux qui
comprend la division des études, de la législation et de la
réglementation, la direction juridique et des contentieux.
ï Direction du contrôle des recettes
administratives, judiciaires et de participation à son tour elle
chargée de contrôler les titres de perceptions et toutes les
opérations de constatation et de liquidation des recettes
administratives, judiciaires et de participation ; établir les notes de
perceptions ; gérer la documentation de l'assiette des dossiers
individuels des assujetties.
ï Direction des recettes domaniales
ï Direction de recouvrement et du suivi des
régimes d'exception
La DGDA perçoit pour le compte et au nom de la DGRAD des
recettes non fiscales, l'instruction n° 001/DG/DGDA/DGA.T/DSTI/DRT du
30/01/2015 fixe les modalités relatives a la perception par la DGDA des
recettes non fiscales encadrées par la DGRAD, ces recettes sont des
secteurs ci-après : commerce extérieur, culture et art,
agriculture, hydrocarbure, santé publique, mines, ressources
hydrauliques et électricité, postes,
télécommunications, nouvelle technologie de l'information et
communication.
II.5 L'office Congolais de Contrôle (OCC) :
L'Office Congolais de Contrôle, OCC en sigle est un
établissement public à caractère technique et
scientifique. En 1963 le contrôle à l'importation et à
l'exportation était régi par la réglementation de change,
cependant, les contrôles techniques visant la sécurité dans
les milieux de travail revêtaient déjà un caractère
obligatoire.
C'était le 30/11/1973 que dans le cadre des grandes
décisions prises pour établir la république du Zaïre
dans ses droits et légitimes et renforcer son indépendance
économique, le chef de l'Etat à interdit à la
Société Générale de Surveillance d'exercer les
activités de contrôle sur le territoire congolais.
Pour la création de l'Office tels sont les
ordonnances-lois qui ont été signés :
? L'ordonnance-loi n°74/013 du 10/01/1974, portant
création d'une institution de droit public dénommée «
Office Zaïrois de Contrôle en sigle OZAC » destiné
à repondre des activités de la Société Congolaise
dissoute,
? L'ordonnance-loi n°74/014 du 14/07/1974, modifiant et
complétant la loi n°73/009 du 05/01/1973 portant disposition
particulière sur le commerce et rendant obligatoire, ce sous la
responsabilité de l'OZAC que le contrôle avant expédition
et au debarquement des exports et des imports Zaïroise. Ces
ordonnances-lois ont été complétés par
l'ordonnance-loi n°78/219 du 05/05/1978, avec la 3ème
république l'OZAC devient OCC le 17/05/1997.
L'OCC a pour mission de :
? Contrôler tous les produits fabriqués
localement,
? Contrôler la qualité de toutes marchandises et
produits à l'import ou à l'export au niveau du Guichet Unique,
? Essayer ou analyser les échantillons des produits
importés,
? Contrôler la technique de tous les appareils,
? Certifier la qualité des produits autres que les
matières précieuses
L'OCC Nord-Kivu est dirigée par un Chef de Direction
Provincial et son Adjoint et les différentes divisions et leurs
services, notamment :
 Division administrative et financière : service
administratif, facturation, trésorerie, comptabilité, budget et
recouvrement.
Division administrative et financière : service
administratif, facturation, trésorerie, comptabilité, budget et
recouvrement.
 Division exploitation : service import, d'export,
d'émission des documents et statistiques, commissariat d'avaries,
Guichet Unique et Hydrocarbure.
Division exploitation : service import, d'export,
d'émission des documents et statistiques, commissariat d'avaries,
Guichet Unique et Hydrocarbure.
 Division métrologie et contrôle technique :
service d'électricité, pression et lavage, navigation
intérieure, métrologie et environnement.
Division métrologie et contrôle technique :
service d'électricité, pression et lavage, navigation
intérieure, métrologie et environnement.
 Division laboratoire : service de traitement et gestion
d'échantillon, produit cosmétique et pharmaceutique,
microbiologie, agro-alimentaire et non alimentaire, et produit
cosmétique,...
Division laboratoire : service de traitement et gestion
d'échantillon, produit cosmétique et pharmaceutique,
microbiologie, agro-alimentaire et non alimentaire, et produit
cosmétique,...
 Division coordination des agences : service suivi
administratif et financier et suivi exploitation.
Division coordination des agences : service suivi
administratif et financier et suivi exploitation.
La DGDA liquide, ordonnance et perçoit en son nom et
pour le compte de l'OCC les frais «
OCC (FLABO)» et la TVA y relative dus a l'occasion de
l'importation ou l'exportation. Ces frais comprennent : les frais de
contrôle relatifs aux prestations liées à l'inspection ;
les frais d'analyse de laboratoires engagent, le cas échéant,
pour les opérations d'essais.
II.6 La Direction Générale de l'Impôt
(DGI)21(*)
a.création
La direction générale de l'impôt, DGI en
sigle est un service public déconcentrée au sein du
Ministère des finances, créé par le décret
n°17/2003 du 02/03/2003 tel que modifié et complété
par le décret n°011/43 du 22/11/2011, elle est dotée d'une
autonomie administrative et financière, elle est placée sous
l'autorité directe du Ministère ayant les finances dans ses
attributions.
b.Missions
La DGI exerce dans le cadre des lois et règlements en
vigueur toutes les missions et prérogatives en matière fiscale
relèvent du pouvoir central, en l'occurrence celles relatives à
l'assiette, au contrôle, au recouvrement, et au contentieux des
impôts, taxes, redevances et prélèvements à
caractère fiscal. A cet effet, la DGI est chargée
d'étudier et de soumettre à l'autorité compétente
les projets de lois, des décrets, et d'arrêtés en la
matière, elle est consultée pour tout projet d'investissement
à un régime fiscal dérogatoire et exerce ses
compétences sur toute l'étendue du territoire national.
c.Structure organique
la DGI est dirigée par un Directeur Général,
assisté par deux Directeur Général Adjoints,
nommés, relevés et le cas échéant,
révoqués de leurs fonctions par le Président de la
République sur proposition du gouvernement
délibérée en conseil des Ministres. Elle comprend une
Administration centrale, une Direction des grandes entreprises et une Direction
urbaine de la ville.
ï L'administration centrale : est composée
de la Direction Générale et des Directions centrales comme la
Direction des ressources humaines, de la gestion budgétaire, de
l'informatique, des études ; statistiques et communication, de la
législation, de l'assiette fiscale, de la recherche et du recouvrement.
ï Directions des entreprises : en sigle DGE est
chargée de la gestion de l'ensemble des opérations fiscales des
entreprises, personnes physiques ou morales, dont le chiffre d'affaires annuel
est supérieur à 2000 000 000 fc.
ï Direction urbaine : chargée des
tâches non dévolues à l'administration centrale et à
la direction des entreprises. Elle dispose des services opérationnels
comme le centre des impôts et centre des impôts
synthétiques. Ces services sont des interlocuteurs fiscaux uniques pour
les contribuables relevant de leur gestion.
Elle est chargée de la vérificationfiscale, elle
propose, suite aux manquements constaté, les mesures disciplinaires et
les reformes de nature à améliorer l'organisation et le
fonctionnement des services ; sa commission est de 1% sur la valeur CIF.
II.7 La Radio Télévision Nationale (RTNC)
La DGDA perçoit pour le compte et au nom de la RTNC la
taxe de l'audiovisuelle sur les appareils récepteurs d'émissions
audiovisuelles à l'import, une redevance de 0,5% sur la valeur CIF,
convention signée mardi 28 février 2017 dans l'Hôtel Invest
de la voix du peuple à Lingwala (Kinshasa).
CHAPITRE TROISIÈME : PRÉSENTATION,
ANALYSE DES DONNÉES ET INTERPRÉTATION DE RÉSULTATS
Au-delà de la littérature et la
présentation du milieu d'étude, ce chapitre portera sur le
fonctionnement des services connexes de la douane.
Il s'agit d'étudier comment les services connexes
parviennent à avoir leurs commissions par la DGDA et voir combien
rapporte les services connexes de la Douane.
III.1 MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL
III.1.1 Collecte des données
Pour obtenir les données de ce travail, nous avons
utilisé la technique documentaire qui a consisté à tirer
ces données des archives de la DGDA. Ces données sont
constituées des différentes recettes réalisées par
les différents services connexes de la Douane.
III.1.2 Analyse des données
Les données de ce travail sont numériques
c.à.d. chiffrées. Leurs analyses se feront par l'usage de la
méthode quantitative (approche statistique) en utilisant la formule
suivante :
?Ratio de structure :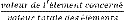 X 100%
X 100%
Dans nos analyses, nous utiliserons aussi des graphiques.
P a g e | 25

III.2 PRÉSENTATION DE DONNÉES
Tableau n° 1 : Présentation de recettes
réalisées par les services connexes de la Douane
|
N°
|
Administrations
|
RECETTES RÉALISÉES
|
|
|
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
TOTAL
|
|
1
|
OGEFREM
|
Goma ville
|
361 350 971,00
|
823 373 388,71
|
388 637 866,00
|
343 015 981,00
|
499 472 453,00
|
2 415 850 659,71
|
|
Goma aéro
|
621 713,00
|
4345524,29
|
727 440,00
|
127531
|
122 281,00
|
5 944 489,29
|
|
s/ total
|
361 972 684,00
|
827 718 913,00
|
389 365 306,00
|
343 143 512,00
|
499 594 734,00
|
2 421 795 149,00
|
|
2
|
FPI
|
Goma ville
|
973 533 942,00
|
1 912 884 573,85
|
1 019 166 270,00
|
872 048 207,00
|
1 323 135 620,00
|
6 100 768 612,85
|
|
Goma aéro
|
28 288 904,00
|
10 095 646,15
|
41 794 706,00
|
14 279 335,00
|
59 038 937,00
|
153 497 528,15
|
|
s/ total
|
1 001 822 846,00
|
1 922 980 220,00
|
1 060 960 976,00
|
886 327 542,00
|
1 382 174 557,00
|
6 254 266 141,00
|
|
3
|
DGRAD
|
738 346 104,00
|
2 593 882 881,00
|
511 186 938,00
|
980 522 524,00
|
853 978 187,00
|
5 677 916 634,00
|
|
4
|
DGI
|
624 450 793,00
|
1 529 052 934,00
|
809 554 178,00
|
504 216 511,00
|
1 335 287 405,00
|
4 802 561 821,00
|
|
5
|
SONAS
|
2 945 575,00
|
121 132 051,00
|
107 881 240,00
|
116 651 024,00
|
6 091 617,00
|
354 701 507,00
|
|
6
|
FONER
|
Péage
|
580 940 045,00
|
862 689 125,00
|
464 194 210,00
|
459 416 565,54
|
449 908,00
|
2 367 689 853,54
|
|
p. pétroliers
|
2 325 952 758,00
|
6 142 511 922,00
|
3 119 427 093,00
|
3 404 252 415,00
|
6 600 747 502,00
|
21 592 891 690,00
|
|
lubrifiants
|
7 025 443,00
|
8 577 769,00
|
569 873 101,00
|
635 351 330,00
|
2 735 813,00
|
1 223 563 456,00
|
|
Charge
|
14 852 796,00
|
19 349 613,00
|
1 592 712,00
|
24 279 171,00
|
693 673 302,00
|
753 747 594,00
|
|
s/ total
|
2 928 771 042,00
|
7 033 128 429,00
|
4 155 087 116,00
|
4 523 299 481,54
|
7 297 606 525,00
|
25 937 892 593,54
|
|
7
|
BCC
|
49 444 435,00
|
106 120 303,00
|
63 988 707,00
|
40 574 759,00
|
215 587 467,00
|
475 715 671,00
|
|
8
|
RTNC
|
9 194,00
|
745 766,00
|
1 446 934,00
|
1 788 944,00
|
4 031 734,00
|
8 022 572,00
|
|
TOTAL
|
5 707 762 673,00
|
14 134 761 497,00
|
7 099 471 395,00
|
7 396 524 297,54
|
11 594 352 226,00
|
45 932 872 088,54
|
Source : Archives de l'inspection des recettes du
trésor DGDA/ Nord-Kivu Goma
III.3 ANALYSE DE DONNÉES ET INTERPRÉTATION
DES RÉSULTATS
Tableau N°2 : structure des recettes
réalisées par les services connexes
|
SERVICES
|
RECETTES RÉALISÉES
|
FRÉQUENCE
(Parts)
|
|
1
|
OGEFREM
|
2 421 795 149,00
|
5,27%
|
|
2
|
FPI
|
6 254 266 141,00
|
13,62%
|
|
3
|
DGRAD
|
5 677 916 634,00
|
12,36%
|
|
4
|
DGI
|
4 802 561 821,00
|
10,46%
|
|
5
|
SONAS
|
354 701 507,00
|
0,77%
|
|
6
|
FONER
|
25 937 892 593,54
|
56,47%
|
|
7
|
BCC
|
475 715 671,00
|
1,04%
|
|
8
|
RTNC
|
8 022 572,00
|
0,02%
|
|
Total
|
45 932 872 088,54
|
100,00%
|
Source : Effectué par nous même
à partir du tableau N°1
Commentaire : partant de ce tableau, nous
constatons que la DGDA a perçue un montant total de services connexes de
45 932 872 088,54fc au cour de notre période d'étude ; dont 2 421
795 149,00fc pour l'OGEFREM soit 5,27%, et 6 254 266 141,00fc pour le FPI soit
13,62% ; et 5 677 916 634,00fc pour la DGRAD soit 12,36% ; et 4 802 561
821,00fc pour la DGI soit 10,46% ; et 354 701 507,00fc pour la SONAS soit 0,77%
; et 25 937 892 593,54fc pour le FONER soit 56,47% ; et 475 715 671,00fc pour
la BCC soit 1,04% ; et 8 022 572,00fc pour la RTNC soit 0,02%.
Graphique N°1 : parts de services
5.27
%
13.62
%
%
12.36
%
10.46
%
0.77
56.47
%
%
1.04
0.02
%
OGEFREM
FPI
DGRAD
DGI
SONAS
FONER
BCC
RTNC
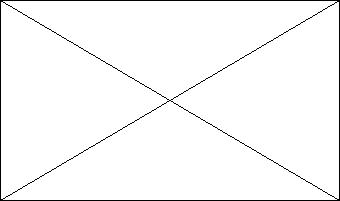
Source : Effectué par nous même
à partir du tableau n°2
Commentaire : partant de ce graphique, nous
constatons que la majorité des recettes issues des services connexes est
dominée par le FONER avec 56,47% ; suivit par le FPI avec 13,62% ; en
suite la DGRAD avec 12,36% ; en suite la DGI avec 10,46%, en suite l'OGEFREM
avec 5,27% ; en suite la BCC avec 1,04% ; en suite la SONAS avec 0,77% et en
fin la RTNC avec 0,02%.
Graphique N°2 : évolution des recettes
issues des services connexes
y = 503,494,190.65x + 7,676,091,845.75
0.00
2,000,000,000.00
4,000,000,000.00
6,000,000,000.00
8,000,000,000.00
10,000,000,000.00
12,000,000,000.00
14,000,000,000.00
16,000,000,000.00
2013
2014
2015
2016
2017
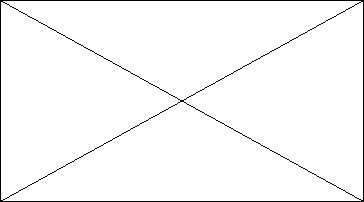
Source : effectué par nous même
à partir du tableau N°1
Commentaire : à la lecture de ce
graphique, nous constatons que les recettes ont évoluées à
la hausse comme indique la courbe de tendance générale y = 503
494 190,65x + 7 676 091 845,75 ayant une allure ascendante. Ceci s'explique par
une forte augmentation des importations durant la période
d'étude.
Graphique n°3 : part des bureaux dans les recettes
de services connexes de la Douane
0.00
5,000,000,000.00
10,000,000,000.00
15,000,000,000.00
20,000,000,000.00
25,000,000,000.00
30,000,000,000.00
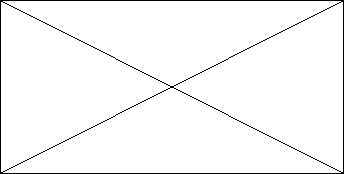
Source : effectué par nous même à partir
du tableau N°1
Commentaire ; partant de ce graphique,
constatons que c'est le FONER qui génère la majeure partie des
recettes réalisées les services connexes de la Douane, en suite
la FPI, la
DGI, l'OGEFREM et puis le reste des services connexes. Ceci
s'explique par une forte déclaration du carburant terrestre et les
péages sur les véhicules à immatriculation
étrangère.
III.4 DISCUSSION DES RÉSULTATS
1.KABUYA BAHATI, dans son TFC portant sur l'analyse du
partenariat entre la DGDA et les services connexes dans la mobilisation de
recettes douanières ; il avait constaté que :
- Les marchandises déclarées et faisant objet du
trafic frontalier sont assujetties au paiement de la commission OGEFREM sur
leur valeurs en douane.
- Il avait remarqué que les deux établissements
ne respectent pas le protocole, l'OGEFREM ne pas ténu au courant de
certaines situations à son niveau.
2. KISANGA RIZIKI, dans sa mémoire portant sur
l'analyse de performance de recouvrement des recettes non fiscales
encadrées par la DGRAD/NK, elle avait constatée qu'il y avait une
augmentation de 17,8% en 2007 par rapport à l'année 2006
où il y avait un taux de maximisation de 59,8%.
3. UWIMANA KARABONEYE, dans son TFC portant sur l'étude
de partenariat entre la DGDA et autres services cas de l'OCC Goma, elle avait
abouti que les recettes de l'OCC sont plus importantes à partir de
l'exécution de l'accord et les litiges entre la DGDA et l'OCC n'est pas
une perfection qui garantit l'évolution.
Partant de l'étude de nos
prédécesseurs et après la réalisation de notre
recherche, nous constatons que le FONER qui est un service connexe de la Douane
générant plus de recettes dans l'ensemble des recettes de
services connexes de la Douane avec un taux de 56,47%. Et constatons
l'écart entre le FONER et le FPI qui est de 42,85% pour dire que le
FONER réalise cet écart suite à une forte importation des
produits pétroliers et le péage sur les véhicules portant
immatriculation étrangère.
Ce résultat va dans le sens de
complémentarité de nos prédécesseurs.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail qui a
porté sur : « l'étude comparative de recettes des services
connexes de la Douane dans la ville de Goma de 2013 à 2017 »
Pour bien aborder notre sujet, nous sommes partis de questions
suivantes :
1) Quel est la part des recettes du FONER dans les recettes
totales des services connexes de la douane ?
2) Comment ont évolués les recettes issues des
services connexes pendant la période d'étude ?
3) Quel est le service qui contribue plus dans les recettes
des services connexes?
Eu égard aux questions soulevées, nous avons
émis les hypothèses suivantes :
1) La part du FONER dans les recettes totales des services
connexes de la douane serait de 50%,
2) Avec nos suppositions, les recettes issues de services
connexes ont évoluées à la hausse pendant la
période de notre étude,
3) Le service qui contribue plus dans les recettes des
services connexes serait le FONER
Pour vérifier nos hypothèses, nous nous sommes
servis de méthode quantitative (approche statistique) soutenue par la
technique documentaire.
A l'issue de nos investigations, nous avons abouti aux
résultats suivants :
v la majorité des recettes issues des services connexes
est dominée par le FONER avec 56,47% ; suivit par le FPI avec 13,62% ;
en suite la DGRAD avec 12,36% ; en suite la
DGI avec 10,46%, en suite l'OGEFREM avec 5,27% ; en suite la
BCC avec 1,04% ; en suite la SONAS avec 0,77% et en fin la RTNC avec 0,02%. Ce
qui confirme notre première et troisième hypothèse.
v les recettes ont évoluées à la hausse
comme l'a indiqué la courbe de tendance générale ayant une
allure ascendante. Ceci confirme notre deuxième hypothèse.
Toute oeuvre humaine est susceptible de contenir certaines
imperfections. Une certaine dose d'erreurs pourrait s'être glissée
en dépit de tous les soins et toute la rigueur scientifique
attachée à ce travail. Nous sollicitons l'indulgence de nos
lecteurs et restons attentifs à leurs remarques et suggestions qui nous
permettront sans l'ombre d'un doute de parfaire nos futurs travaux
scientifiques.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
? M.GRAWITZ et PINTO, méthodes de recherche en
sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris 1996 ;
? Asakura H, histoire de la douane et tarif douanier,
Bruxelles, OMD, 2003 ;
? Symphorien KASINDI, le management des entreprises
étatiques et paraétatique à l'épreuve de la
motivation des besoins de ressources humaines, éd. Pangolin, 2012
?J. Louis LAUBET, Initiation aux méthodes de recherche en sciences
sociales,
L'harmattan, Paris, 2000.
? Christopher Lovelock, marketing des services,
paris, publi-Union, 1999
II. COURS, MÉMOIRE ET TRAVAUX FIN DE CYCLE
? Thomas GAHAMANYI, politique économique et
douanière, cours inédit, G3 D&A, ISC/Goma, 2018
? Rodain MUFUKU MUFUKU, franchise et exonération,
cours inédit, G3 D&A, ISC/Goma, 2018
? Patrick MUJANAMA, législations connexes, cours
inédit, G3 D&A, ISC/Goma,
2018
? UWIMANA KARABONEYE, étude de partenariat entre la
DGDA et autres services cas de l'OCC Goma, TFC inédit, ISC/Goma,
2015
? KISANGA RIZIKI, analyse de performance de recouvrement des
recettes non fiscales encadrées par la DGRAD/NK, Mémoire
inédit, ISC/Goma, 2008
? KABUYA BAHATI, analyse du partenariat entre la DGDA et les
services connexes dans la mobilisation de recettes douanières, TFC
inédit, ISC/Goma, 2015
III. WEB GRAPHIE
? www.google.com
? www.douane.gov
? www.leganet.cd
? www.memoireonline.com
? www.dgi.gouv.cd
TABLE DES MATIERES
DÉDICACE
.................................................................................................................................
i
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
..................................................................................................
ii REMERCIEMENTS
.................................................................................................................
iii
0.INTRODUCTION
...................................................................................................................
1
0.1 État de la question
.............................................................................................................
1
0.2 Problématique
...................................................................................................................
2
0.3 Hypothèse
.........................................................................................................................
3
0.4 Objectifs du travail
...........................................................................................................
3
0.5 Choix et intérêt du sujet
....................................................................................................
4
0.6 Méthodologie et technique
...............................................................................................
4
0.7 Délimitation du travail
......................................................................................................
5
0.8 Subdivision du travail
.......................................................................................................
5
CHAPITRE PREMIER : APPROCHES CONCEPTUELLES DU
TRAVAIL
..................................................................................................................................
6
I.1 DÉFINITION DES CONCEPTS CLÉS
........................................................................... 6
I.1.1 SERVICE
....................................................................................................................
6
I.1.2 CONNEXES
...............................................................................................................
8
I.1.3 COMMISSION
...........................................................................................................
8
I.2 APPROCHES THÉORIQUES
..........................................................................................
9
I.2.1 DOUANE
...................................................................................................................
9
DEUXIÈME CHAPITRE : PRÉSENTATION DES SERVICES
CONNEXES ..................... 15
II.1 Le Fonds National d'Entretien Routier
.......................................................................... 15
II.2 L'Office de Gestion de Fret Multimodale
..................................................................... 16
II.3 Le Fonds de Promotion de l'Industrie
............................................................................ 18
II.4 La Direction Générale des Recettes
Administratives, Judiciaires, Domaniales et de
Participation.............................................................................................
......................................................19
II.5 L'office Congolais de Contrôle
.....................................................................................
20
II.6 La Direction Générale de l'Impôt
..................................................................................
22
II.7 La Radio Télévision Nationale
......................................................................................
23
CHAPITRE TROISIÈME : PRÉSENTATION, ANALYSE DES
DONNÉES ET
INTERPRÉTATION DE RÉSULTATS
..................................................................................
24
III.1 MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL
.............................................................................
24
III.2 PRÉSENTATION DE DONNÉES
..............................................................................
25
III.3 ANALYSE DE DONNÉES ET INTERPRÉTATION DES
RÉSULTATS ................ 26
III.4 DISCUSSION DES RÉSULTATS
..............................................................................
29
CONCLUSION
........................................................................................................................
30
BIBLIOGRAPHIE
...................................................................................................................
32
* 1 KISANGA RIZIKI, analyse de
performance de recouvrement des recettes non fiscales encadrées par la
DGRAD/NK, Mémoire inédit, ISC/Goma, 2008
* 2 KABUYA BAHATI, analyse du
partenariat entre la DGDA et les services connexes dans la mobilisation de
recettes douanières, TFC inédit, ISC/Goma, 2015
* 3 UWIMANA KARABONEYE,
étude de partenariat entre la DGDA et autres services cas de l'OCC Goma,
TFC inédit, ISC/Goma, 2015
* 4 LE ROBERT, DICOROBERT,
Montréal, Canada, 1994, p 900
* 5 GRAWITZ M. Méthodes
en sciences sociales, Dalloz, Paris, 6ème éd., 1984,
p.408
* 6 Le ROBERT, dictionnaire
français, DICO ROBERT, 1994, Montréal, Canada, page 574
* 7 Le ROBERT, dictionnaire
français, DICO ROBERT, 1994,Montréal, Canada, page 721
* 8 J. Louis LAUBET, Initiation
aux méthodes de recherche en sciences sociales, L'harmattan, Paris,
2000, p. 120
* 9 R. PINTO, les
méthodes de recherche dans les sciences sociales, 4ème
éd., Dalloz, Paris,1971, p.p. 288-289 10 Ibid.
* 10Christopher Lovelock,
marketing des services, Paris, publi-Union, 1999
* 11 Dictionnaire de
l'économie et de sciences sociales, CD Échaude maison, Nathan,
Paris, 1993 13Op.cit.
* 12 www.google.com
* 13 Grand Larousse en 5
volumes, tome 2 : chondrifié/fougère, libraire Larousse, 1989, pg
708
* 14 DESS Thomas Gahamanyi,
politique économique et douanière, cours inédit,
G3D&A/A, ISC/Goma, 2018, p 33
* 15 Op.cit., p 9
* 16
www.douane.gov.ma/web/guest
* 17 Asakura H, histoire de la
douane et tarif douanier, Bruxelles, OMD, 2003, p 11
* 18 Symphorien KASINDI, le
management des entreprises étatiques et paraétatique à
l'épreuve de la motivation des besoins de ressources humaines,
éd. Pangolin, 2012
* 19 Ass MUJANAMA Patrick,
législation connexes, cours inédit, G3 D&A/A, ISC/Goma, 2018,
p 4 22
www.leganet.cd
* 20
www.memoireonline.com
* 21
www.dgi.gouv.cd



