1. - Contexte géologique du bassin
sénégalo-mauritanien
Les formations géologiques faisant l'objet d'une
exploitation pour la production de granulats sont en général des
roches massives (basalte, grès, calcaire, silexite, etc.) issues du
bassin sénégalo-mauritanien. Ce bassin est le plus occidental et
le plus étendu des bassins sédimentaires de la marge Atlantique
africaine. Il est constitué par des terrains tabulaires
méso-cénozoïques et s'est individualisé au Trias
à la suite de la séparation des plaques africaine et
américaine.
Le bassin sénégalo-mauritanien est relativement
calme. Seule la partie occidentale (Cap-Vert et région de Thiès
(Fig. 22)) a été affectée par des phénomènes
tectoniques et des épisodes volcaniques localisés le long de
failles généralement orientées NE-SW ou E-W. Ces
perturbations sont certainement liées à la tectonique cassante
due au rifting atlantique et qui aurai engendré des zones de faiblesse
sensibles aux contre-coups des phases orogéniques ultérieures.
La couverture sédimentaire, épaisse à
l'ouest, est recouverte en grande partie par une vaste couverture sableuse et
un faciès d'altération du Cénozoïque. Cette
couverture sédimentaire a servi d'encaissant et de substratum aux laves
tertiaires et quaternaires.
1.1. - Les formations basaltiques
La partie occidentale du bassin
sénégalo-mauritanien a été le siège d'un
important volcanisme vers la fin du Tertiaire sur l'ensemble du Cap Vert et du
Plateau de Thiès, et au quaternaire sur la presqu'île de Dakar.
Le premier épisode volcanique fini-tertiaire a lieu
entre l'Oligocène et le Miocène supérieur. Il se manifeste
par des épanchements de basalte dans la presqu'île du Cap-Vert
(Cap Manuel, Gorée, Fann) et des intrusions de laves dans la
région de Thiès correspondant à des dykes (Diack,
Sène Sérère), ou à des filons tectoniques (Keur
Mamour, Ravin des voleurs, Thiéo, Bellevue, Sandock, Fouloume). Le
volcanisme tertiaire est donc essentiellement fissural.
Le second épisode volcanique a eu lieu au Quaternaire.
Il se présente en deux ensembles volcaniques :
- un ensemble volcanique inférieur constitué
d'une coulée de dolérites intercalée dans les sables de la
base du quaternaire. Il affleure le long de la bordure littorale de Fann
à Ouakam,
- un ensemble volcanique supérieur qui
représente le « volcanisme des Mamelles ». Il est
constitué par plusieurs coulées successives de basanite, de
basanite doléritique et d'une coulée terminale de
dolérite, mais également de produits pyroclastiques formés
de tufs, de pierres ponces, de scories et de bombes (Dia, 1982).
Le basalte est une roche magmatique effusive très
commune. C'est une roche microlitique, comportant des plagioclases, et des
pyroxènes, accompagnés selon les cas d'olivine,
d'hypersthène, de magnétite, d'ilménite ; il peut s'y
ajouter, en faible pourcentage, soit du quartz, soit des
feldspathoïdes.
Trois types de faciès ont été
identifiés à Diack (Dia, 1982) :
- un faciès à grain fin, majoritaire,
représenté essentiellement par des basanites. Il a une structure
microlitique porphyrique à phénocristaux de pyroxène et
d'olivine, dans une mésostase riche en verre et en microlites de
plagioclase, de microcristaux de pyroxène et d'olivine,
- un faciès à grain moyen, moins abondant que
le faciès précédent. La structure est doléritique
intersertale avec pourcentage élevé de plagioclase en lattes
englobant des pyroxènes et/ou des olivines en phénocristaux ou en
microcristaux ;
32
- un faciès à gros grain,
représenté par une roche grenue entièrement
cristallisée, sans mésostase interstitielle. La structure est
grenue pegmatitoïde contenant de nombreuses lattes de plagioclase et des
cristaux de pyroxène.
1.2. - Les formations calcaires
Les formations calcaires du bassin
sénégalo-mauritanien sont d'age Crétacé
supérieur à Paléocène et sont présentes dans
une grande extension dans la Presqu'île du Cap Vert et le Plateau de
Thiès.
Le Paléocène affleure à l'Est et
à l'Ouest du horst de Ndiass dans la falaise de Thiès et à
Dakar. Pendant le Paléocène, l'environnement de
sédimentation devient de plus en plus calcaire et se caractérise
par le développement de récifs formés de calcaires,
d'agiles calcaires et de marnes. A la fin du Paléocène le horst
de Ndiass a commencé à émerger et un relief karstique se
développe à partir des calcaires Paléocène.
L'analyse des sondages (Dramé, 2004)
exécutés dans les carrières calcaires de Bandia où
les matériaux de l'étude ont été
prélevés montre une lithologie constituée essentiellement
de calcaire gréseux, de calcaire lumachellique, de calcaire à
entroque, de calcaire coquillier, de calcaire crayeux et de calcaire
altéré.
1.2.1. - Le calcaire gréseux
Ce calcaire a une couleur jaunâtre avec un aspect
massif et très dur. Vu au microscope, il a une texture de type «
wackstone ». Les éléments figurés sont principalement
constitués de minéraux de quartz et d'éléments
biogènes (algues vertes, fragments de lamellibranches et de bryozoaires,
des débris de gastéropodes recristallisés en calcite, des
plaques d'échinodermes) pris dans une matrice micritique.
1.2.2. - Le calcaire lumachellique :
très fossilifère, blanchâtre, massif, et dur. Les
éléments figurés sont arrondis et brisés attestant
un transport. La texture est de type « packstone ». Les bioclastes
sont des fragments de mollusques associés à des débris de
gastéropodes et des plaques d'échinodermes. La porosité
intergranulaire est remplie par de la micrite.
1.2.3. - Le calcaire à entroque :
à pâte fine. La texture est de type « packstone » avec
parfois une tendance « wackstone ». Les bioclastes sont
essentiellement des plaques d'échinodermes cimentées par la
micrite.
1.2.4. - Le calcaire coquillier : calcaire
massif, parfois cristallin, avec des débris coquilliers brisés,
corrodés ou épigénisés en calcite. La texture est
de type « packstone » avec une phase de liaison micritique. Les
éléments biogènes sont des algues, des fragments de
lamellibranches, de mollusques, des gastéropodes, des miliolidés,
des plaques d'échinodermes et de bryozoaires.
1.2.5. - Le calcaire crayeux : calcaire non
coquillier, peu ou pas fossilifère, avec un aspect tendre et friable. Il
s'intercale dans le calcaire cristallin. La texture est de type « mudstone
» à rares plaques d'échinodermes. La phase de liaison est
constituée essentiellement de micrite.
1.2.6. - Le calcaire altéré : il
est au sommet des couches calcaires. Il se présente sous forme de blocs
emballés dans une matrice à argile noire parfois
latéritisée.
1.3. - Les silexites
Ce sont des roches hypersiliceuses se présentant sous
forme de rognons ou groupées en passés
plus ou moins
horizontaux dans les niveaux phosphatés de la région de
Taïba. Ces niveaux
33
phosphatés se sont formés à partir du
Paléocène pour se développer ensuite à la base de
l'Eocène. L'Histoire du gisement est divisée en deux grandes
étapes : une étape d'accumulation sédimentaire et une
étape de transformation des dépôts initiaux (Pannatier,
1995 in Gaye, 1995). On a successivement :
- le dépôt des argiles du mur (attapulgite)
à l'Yprésien,
- le dépôt de la première couche
phosphatée à l'Eocène moyen. Ce niveau, associé
à une sédimentation carbonatée, est subdivisé en
deux membres : les phosphates hétérogènes à la base
et les phosphates homogènes au sommet ;
- le dépôt des argiles bariolées du toit
(associées à des sables, des grès et des silex) au dessus
de la couche phosphatée, à la fin de l'Eocène moyen ;
- le dépôt d'une seconde couche phosphatée de
l'Eocène supérieur à l'Oligocène inférieur
;
- de l'Oligocène au Mio-Pliocène, une
émersion des couches provoque une forte altération. Cette
altération de type latéritique a provoquée la formation
des phosphates alumino-calciques et alumineux sauf en quelques endroits
où le dépôt reste intact sous forme de phosphate
tricalcique.
Dans les phosphates hétérogènes, les
particules phosphatées sont le plus souvent des coprolithes, des rudites
(lithoclastes et bioclastes) associées à une fraction
phosphatée arénitique ou lutitique. Les silex y sont très
abondants où ils sont en bancs décimétriques ou en rognons
volumineux.
Dans les phosphates homogènes, les particules
phosphatées sont des arénites et des lutites souvent
altérées et riches en concressions d'oxydes de fer. Les silex
sont le plus souvent en rognons ou en galets
Les silex sont issus d'une silicification secondaire par
remplacement de matériel initial et reconcentration à partir d'un
stock de silice biogène. Il se présente
généralement sous forme de blocs à coeur sombre et
à cortex blanc.
La nature du minéral siliceux néoformé
dépend souvent de la composition du milieu ambiant : - Quartz en milieu
siliceux,
- Calcédoine (silice plus ou moins fibreuse) en milieu
riche en ions alcalins ou alcalino- terreux ;
- opale (silice riche en eau) dans un milieu riche en phyllithes
(argile).
Un échantillon d'un tout-venant de silexite montre que la
roche est constituée de (Diémé, 1991 in Gaye,
1995):
- 91 % de silex,
- 6 % d'induré phosphaté ;
- 3 % de fines à éléments phosphatés
et argileux.
L'observation au microscope optique révèle que les
silex sont composés de 30 à 40 % d'opale, et 60 à 70 % de
calcédoine.
La prédominance de la calcédoine s'explique par sa
stabilité chimique plus grande que celle de l'opale.
Les relations entre ces deux minéraux montrent que l'opale
s'est cristallisée la première, puis la calcédoine
cristallise par épigénisation de l'opale.
34
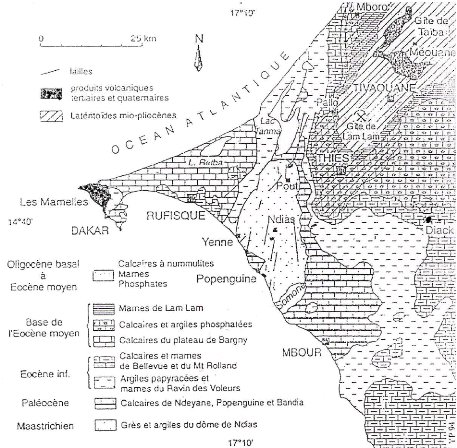
Fig. 22. - Carte géologique de la
presqu'île du Cap Vert et du Plateau de Thiès
35



