|
(U.F.R. LAC)
Département de Lettres modernes
Mémoire de master en Sciences du langage et
Stratégies
Parcours : Grammaire française
LA TEMPORALITÉ NARRATIVE : L'ORDRE TEMPOREL DANS
LE ROMAN LE CRIME PARFAITD'AdamaAmadé
SIGUIRÉ
Thème :
Présenté et soutenu parSous la
direction de
Jean Marie OUÉDRAOGO M. Youssouf
OUÉDRAOGO
Professeur titulaire
et la codirection de
M. Sénon KANAZOÉ
Maîtrede conférences
Année universitaire 2019-2020
DÉDICACE
À
MA TRÈS CHÈRE
MÈRE
REMERCIEMENTS
Avant tout développement sur cette expérience
académique, il apparaît opportun de commencer ce mémoire
par des remerciements à ceux qui nous ont beaucoup appris au cours de ce
parcours, et surtout à ceux qui ont eu la gentillesse de nous
accompagner d'une manière ou d'une autre.
Nospremiers remerciements les plus distingués sont
destinés à :
· M.Youssouf OUÉDRAOGO, pour m'avoir
encadré et pour tout ce qu'il fait pour nous qui sommes des
étudiants en Science du Langage et Stratégie parcours
grammaire,
· M. KANZOÉ Sénon,pour son encadrement
fructueux, pour sa disponibilité, pour toutes ses remarques et tout
l'appui qu'il m'a donné pour l'élaboration de ce
mémoire.
Qu'ils veuillent trouver ici l'expression de notre
respectueuse considération et notre profonde admiration pour toutes
leurs qualités scientifiques et humaines.
Merci enfin aux camarades avec qui nous avons cheminé
tout au long de l'année, pour la « Co-motivation ».
À tous, nous disons sincèrement merci.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE
2
CHAPTITRE I : APPROCHE THÉORIQUE
ET CONCEPTUELLE
5
CHAPITRE II. PRÉSENTATION ET
ANALYSE DU CORPUS D'ÉTUDE
32
CHAPITRE III : PORTÉE DE LA
TEMPORALITÉDANS LE ROMAN LE CRIME PARFAIT
54
CONCLUSION GÉNÉRALE
62
_Toc83360499
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le temps. Quelle notion ! « Qu'est-ce en effet que le
temps ? », se demande Saint Augustin (1964 : 396). Le temps
« n'est-il d'abord, et au moins, un mot ? », déclare
Etienne Klein.(2004 :67) « Qui serait capable de l'expliquer
facilement et brièvement ? Qui peut le concevoir, même en
pensée, assez nettement pour exprimer par des mots l'idée qu'il
s'en fait ? Est-il cependant notion plus familière et plus connue dont
nous usions en parlant ?», rétorque Saint Augustin
(1964 : 396).
Ces d'interrogations montrent bien la difficulté de
cerner cette notion, et que chaque tentative en vue d'en trouver une
définition claire, nette et précise semble être un coup
d'épée dans l'eau.
De prime abord, le concept de temps apparaît certes
intelligible et a l'air facile à cerner : « Si personne ne me
le demande, je le sais » soutient Saint Augustin (1964 :396),
mais ce n'est pas évident car la complexité s'impose dès
qu'on cherche à lui conférer une signification : « Si on
me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Pourtant, je
le déclare hardiment, je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas
de temps passé ; que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps
à venir ; que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps
présent. Comment donc, ces deux temps, le passé et
l'avenir, sont-ils, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est
pas encore ? Quant au présent, s'il était toujours
présent, s'il n'allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas
du temps, il serait l'éternité. Donc, si le présent, pour
être du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvons-nous
déclarer qu'il est aussi lui qui ne peut être qu'en cessant
d'être ?», ajoute-t-il. (1964 : 396)
En effet, définir la nature du temps constitue l'un des
plus difficiles problèmes de la réflexion philosophique. Certes,
le concept est le même, mais les approches définitoires sontriches
et variées, et ce, selon le domaine et la visée de chercheur. Le
temps, cette sibylline notion quiparaît être composé
d'instants perpétuellement différents, garde toujours ses secrets
malgré toute tentative visant son élucidation. Chacun a
essayé de lui conférer une définition répondant
à ses recherches, visées et ambitions, mais aucune
définition n'a reçu jusqu'ici, chez les savants commechez les
philosophes, un acquiescement général.
Dans le présent travail, le point sera mis sur
l'étude de la temporalité, définie comme étant
« le temps vécu par la conscience, celui dont elle
fait l'expérience et qui déploie, à partir du
présent (seul moment que saisisse une attention opérante), un
passé qui est fait de rétentions comme acquis et comme
appoint pour l'action (mais c'est le présent qui somme et
interprète ce qui fut actuel et ne l'est plus) et un futur qui est fait
de protentions, c'est-à-dire de projets, de possibilités
nouvelles (mais c'est encore le présent qui anticipe l'avenir, en
fonction de ses souvenirs et de ses prises), et plus particulièrement
sur l'ordre temporel du récit.
Le roman est le lieu par excellence de l'épanouissement
et de la maîtrise du temps.
Constitué d'un récit caractérisé
par son double aspect temporel permettant ainsi l'existence des anachronies
narratives, et relatant une histoire selon un système de narration qui
lui est propre, l'auteur peut faire varier à sa guise la
représentation des événements et l'ordre dans lequel ils
se sont déroulés et ce, en mettant l'accent sur le temps du
récit.
De ce fait, la représentation du temps dans un
récit pose toujours de nombreux problèmes dus, selon Todorov,
à la dissemblance entre la temporalité de l'histoire et celle du
discours.
Pour mettre en évidence sa pensée, Todorov
(1966 :125) dit :
« Le temps du discours est, dans un certain sens,
un temps linéaire, alors que le temps de l'histoireest
pluridimensionnel. »De plus, il ajoute :
« Dans l'histoire, plusieurs
événements peuvent se dérouler en même temps ; mais
le discours doit obligatoirement les mettre à la suite l'un de l'autre ;
une figure complexe se trouve projetée sur une ligne droite. C'est de
là que vient la nécessité de rompre la succession
naturelle des événements même si l'auteur voulait la suivre
au plus près. » Mais l'auteur peut ne pas rompre
l'enchainement des événements et essaye de trouver cette
succession naturelle, mais bien « il utilise la déformation
temporelle à certaines fins esthétiques. »
Indépendamment de tout devoir de référer,
le récit de fiction ne dépend que de l'actenarratif qui
l'instaure en imposant l'affirmation d'un règne qui n'obéit
qu'à ses lois et sa proprelogique. De ce fait, le temps de
l'écriture et le temps des événements racontés ne
se superposent que rarement. Le narrateur se trouve en totale liberté de
choisir l'ordre de disposition des événements, et il peut manier
comme il lui plaira la temporalité de son histoire, cette
dernière qui constitue donc l'un des ressorts essentiels de
l'élaboration du récit.
Ainsi, la lecture du roman le crime parfaitne nous a
pas laissé indifférent au regard de la temporalité
narrative. Cette construction temporelle a prévalu au choix de cette
oeuvre comme corpus d'étude.
Étudier l'ordre temporel du Le crime parfait
d'Adama Amadé SIGUIRÉ, nousramène à analyser
le roman en le soumettant aux différents travaux et théories
portant sur la temporalité et plus principalement la théorie
narratologique de Gérard Genette afin de mieux comprendre le rapport de
temporalité.
Pour Genette (1972 :292), la notion d'ordre est capitale
dans le processus de la compréhension d'un quelconque récit, et
il la définit de la manière suivante : « C'est
étudier le rapport entre la suite des événements telle
qu'elle est présentée dans le récit (le texte) et l'ordre
dans lequel ces événements se sont produits dans le monde
raconté. »
Cette définition que donne Genette concernant cette
notion mène d'une manière logique vers une autre interrogation
d'importance qui est la suivante : quel rapport existe-t-il entre les
évènements racontés dans un roman et l'ordre dans lequel
ces évènements sont racontés ?
Les questions qui découlent de cette question
globalisante sont les suivantes :
Ø Comment se manifeste le temps dans le roman ?
Ø Quelle est la structure narrative du roman Le
crime parfait ?
Ø Quels sont les mouvements temporels dans le roman
?
Pour parvenir à répondre à ces
interrogations soulevées, nous émettons l'hypothèse de
recherche selon laquelle dans les productions littéraires, la
temporalité se manifeste de plusieurs manières. Chaque
écrivain décide de raconter l'histoire suivant une organisation
temporelle qui lui est propre.
Dès lors, les hypothèses secondaires sont les
suivantes :
Ø L'histoire est racontée suivant une structure
temporelle bien déterminée ;
Ø L'histoire est racontée suivant un ordre
temporel bien défini ;
Ø Cette structure et ce procédé temporel
auraient une valeur significative et répondraient aux principes
d'écriture du moment.
Une telle étude vise des objectifs d'ordre
général et spécifique. De façon
générale, l'objectif de cette étude temporelle est
depouvoir mener une analyse générale sur le temps dans le
récit afin d'identifier les interactionsentre les
évènements et leurs successions.
De manière spécifique il s'agit d'étudier
la temporalité narrative du roman et d'interpréter cette
configuration temporelle.
Pour ce faire, nous avons d'abord lu le document et fait des
recherches connexes sur le thème afin de pouvoir bâtir un travail
scientifique et utile pour d'autres études. C'est après cette
cueillette d'informations relatives au thème d'étude que nous
avons élaboré ce travail.A la seule fin de mettre en
évidence cet objectif, il convient de signaler que cette analyse se
divise en trois chapitres intitulés respectivement :Approche
théorique et conceptuelle,présentation et analyse du corpus,
interprétation des données de l'analyse.
Dans le premier chapitre, il s'agira de clarifier le concept
`'temps''selon différentes acceptions, puis la notion
d'ordre temporel.
Le deuxième chapitre de ce travail sera
consacré, d'une part, à la présentation de l'auteuret,
d'autre part, àl'analyse des données recueillis dans le corpus.
Quant au troisième chapitre, il sera question
d'analyser la portée de la structure narrative dans Lecrime
parfait.C'est d'ailleurs le plus important dans ce travail.
CHAPTITRE I : APPROCHE THÉORIQUE ET
CONCEPTUELLE
L'étude de la temporalité narrative, dans
l'oeuvre nécessite au préalable une lumière sur les
notions fondamentales y afférentes. Il s'agit essentiellement de la
notionde structure et d'ordre temporel. Mais comment pouvons-nous
aborder l'ordre temporel d'un roman,sans parler de temps ?
I. La
notion de temps
« Vous avez certainement observé ce fait
curieux, que tel mot, qui est parfaitement clair quand vous l'entendez ou
l'employez dans le langage courant, et qui ne donne lieu à aucune
difficulté quand il est engagé dans le train rapide d'une phrase
ordinaire, devient magiquement embarrassant, introduit une résistance
étrange, déjoue tous les efforts de définition
aussitôt que vous le retirez de la circulation pour l'examiner à
part, et que vous lui cherchez un sens après l'avoir soustrait à
sa fonction momentanée ? Il est presque comique de se demander ce
que signifie au juste un terme que l'on utilise à chaque instant avec
pleine satisfaction. Par exemple : je saisis au vol le mot Temps. Ce mot
était absolument limpide, précis, honnête et fidèle
dans son service, tant qu'il jouait sa partie dans un propos, et qu'il
était prononcé par quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Mais
le voici tout seul, pris par les ailes. Il se venge. Il nous fait croire qu'il
a plus de sens qu'il n'a de fonctions. Il n'était qu'un moyen, et le
voici devenu fin, devenu l'objet d'un affreux désir philosophique. Il se
change en énigme, en abîme, en tourment de la
pensée. » Paul Valéry (1945 : 132)
Ce propos est significatif de l'embarras où nous nous
trouvons chaque fois que se présente à notre esprit l'une ou
l'autre des grandes notions qui caractérisent le propre de l'homme : par
exemple l'amour, le désir, la mort. Le Temps fait assurément
partie de ces repères qui, parce qu'ils sont cardinaux, sont difficiles
à définir. Il fait partie de ce qu'on appelle « les
catégories fondamentales » du texte romanesque. Il permet comme
l'espace d'organiser nos perceptions en une représentation du monde. En
effet, de la même manière qu'on ne peut imaginer un texte
romanesque sans narrateur, sans indication spatiale etc. de la même
manière, on ne saurait imaginer un roman qui échappe à
tout ordre temporel. Dans un roman, il y a toujours une suite
d'événements enchaînés depuis un début
jusqu'à une fin. Ainsi, nous allons présenter quelques approches
marquantes qui ont été proposées pour cerner cette
notion.
I.1. Le temps
phénoménologique
Le romancier Claude Simon, dans son discours de
réception du prix Nobel de littérature (1986 : 25),
évoque le trouble magma d'émotions, de souvenirs, d'images qui se
trouvent en lui lorsqu'il est devant sa page blanche. Ce magma constitue, avec
la langue, le seul bagage de l'écrivain :« c'est que l'on
écrit (ou ne décrit) jamais quelque chose qui s'est passé
avant le travail d'écrire, mais bien ce qui se produit [...] au cours de
ce travail, au présent de celui-ci ». Pour Claude Simon,
l'écriture n'a qu'un seul temps, le présent. Mais n'est-ce pas
là le cas de toutes les activités humaines ? Le temps, disait
Kant, ne nous attend pas hors de nous, déjà tout organisé
; c'est notre conscience au contraire qui le déploie, à partir de
sa présence au monde, en présent du futur, présent du
présent et présent du passé. Telle est la conscience
intime du temps, pour un phénoménologue comme Husserl : nous
percevons quelque chose, voilà le présent; mais ce présent
est parfois orienté vers l'attente, l'anticipation, et le futur
apparaît. Ou c'est le passé qui se constitue, lorsque nous
maintenons, aux marges de la conscience, ce qui vient d'avoir lieu : le
passé immédiat qui sert de socle au souvenir et à la
remémoration.
I.3. Le temps anthropologique
Quelques considérations d'André Leroi-Gourhan
vont permettre de prolonger ces propos. Pour cet anthropologue (1965 :
95), la conscience du temps puise son origine dans l'épaisseur de la vie
sensitive. Ainsi, l'alternance du sommeil et de la veille, de l'appétit
et de la digestion fournissent au temps son substrat rythmique viscéral;
quant à la succession du jour et de la nuit, des saisons chaudes et des
saisons froides, elle offre la rythmicité complexe et élastique
d'un temps à l'état sauvage. Mais les rythmes naturels sont
partagés par toute la matière vivante. Pour qu'ils se
transforment en temps, il faut d'abord que l'homme les capture dans un
dispositif symbolique. Ainsi, pour Leroi-Gourhan (1965 : 139), le fait
humain par excellence est peut-être moins la création de l'outil
que la domestication du temps et de l'espace. Cette domestication
apparaît de façon organisée avec les sociétés
agricoles, lorsque le rythme des labours et des récoltes trouve son
pendant dans un symbolismetemporel qui divinise le mouvement du soleil et des
astres. Parallèlement, des spécialistes du temps (1965 :
145) apparaissent : prêtres, dès lors que la marche normale de
l'univers repose sur la ponctualité des sacrifices; ou soldats, qui ont
besoin de s'appuyer sur un réseau rythmique rigoureux,
matérialisé par les sonneries de trompes. Dans les
sociétés développées contemporaines, chacun est
requis d'être un tel spécialiste: nul n'échappe au temps
objectivé des horloges, qui ne compose avec personne, ni avec rien, pas
même avec l'espace, puisque l'espace n'existe plus qu'en fonction du
temps nécessaire pour le parcourir. Cet espace-temps surhumanisé
signe le triomphe de l'espèce humaine. Triomphe ambigu, cependant, car
ne sommes-nous pas en train de retrouver ainsi l'organisation des
sociétés animales les plus parfaites, celles où l'individu
n'existe que comme cellule (1965 : 186)?
I.4. Le temps objectif
Le temps des horloges, dont Leroi-Gourhan craint qu'il ne
finisse par nous avaler tout entier, est une acquisition tardive de
l'humanité. Fondé sur l'observation immémoriale du jeu des
forces cosmiques : alternance du jour et de la nuit, trajet visible du
soleil, phases de la lune, saisons du climat et de la végétation,
etc. (Benveniste, 1974 : 71), le temps objectif inscrit l'ordre cosmique
dans un comput qui le rend disponible pour l'organisation de la vie en
société. Ce temps socialisé se concrétise, poursuit
le linguiste, sous la forme d'un calendrier. Le temps calendaire
systématise la récurrence observable des phénomènes
astronomiques en créant un répertoire d'unités de mesure
correspondant à des intervalles constants (jour, mois, année); il
organise ces segments temporels dans une chaîne chronique où les
événements se disposent selon un ordre de succession
avant/maintenant/après. Enfin, tous les calendriers procèdent
d'un moment axial qui fournit le point zéro du comput: un
événement si important qu'il est censé donner aux choses
un cours nouveau (naissance de Jésus Christ ou du Bouddha;
avènement de tel souverain, etc.). La société des hommes
n'est pas pensable hors des contraintes qui président à
l'invention du temps calendaire: sans les repérages fixes et immuables
du calendrier, note encore Benveniste (1974 : 72), tout notre univers
mental s'en irait à la dérive [et] l'histoire entière
parlerait le discours de la folie.
I.5. Le temps linguistique
Le calendrier fixe le temps chronique; toutefois, ce temps
objectivé reste étranger au temps vécu tel que le
décrit par exemple la philosophie phénoménologique. Or,
affirme Benveniste, c'est par la langue que se manifeste l'expérience
humaine du temps. Le temps linguistique n'est en aucune façon le
décalque d'un temps défini hors de la langue, mais correspond
à l'institution d'une expérience en propre : Ce que le temps
linguistique a de singulier est qu'il est organiquement lié à
l'exercice de la parole, qu'il se définit et s'ordonne comme fonction du
discours (1974 : 73). À ce titre, il est tout entier centré
autour du présent, défini comme le moment oùle locuteur
parle. Par exemple, l'adverbe maintenant ne désigne rien
d'autre que le moment où le locuteur dit maintenant. Comme l'explique
Benveniste, le présent se renouvelle ou se réinvente chaque fois
qu'un individu fait acte d'énonciation et s'approprie les formes de la
langue en vue de communiquer. Le présent linguistique est ainsi le
fondement de toutes les oppositions temporelles. En effet, la langue ne situe
pas les temps non-présents selon une position qui leur serait propre,
mais ne les envisage que par rapport au présent. Le présent,
défini par sa coïncidence avec le moment de l'énonciation,
trace une ligne de partage entre, d'une part, un moment qui ne lui est plus
contemporain et, d'autre part, un moment qui ne lui est pas
encorecontemporain. En ce sens, le passé constitue
l'antériorité du moment de l'énonciation, et le futur sa
postériorité. C'est ce qui fait dire à Benveniste
(1974 : 74) que la langue ordonne le temps à partir d'un axe, et
celui-ci est toujours et seulement l'instance de discours.
II. LES
TYPES DE TEMPS DANS L'UNIVERS ROMANESQUE
La création romanesque donne à considérer
deux types de temps. On peut retenir :
II.1 Les temps externes
Le temps externe à l'oeuvre, c'est l'époque de
vie du romancier d'une part, et celle du lecteur d'autre part, de même
que la période « historique » que couvre l'histoire du roman
c'est-à-dire la période pendant laquelle l'action est
censée s'être déroulée.
- Le temps de l'écrivain est une
époque qui peut influencer un écrivain. En outre, la
rédaction d'un roman peut s'étendre sur plusieurs années.
Les conceptions que le romancier se fait de la vie, du sujet de
l'écriture peuvent considérablement se modifier avec le temps.
- Le temps du lecteur: à l'instar du
romancier, c'est le temps qui influence, conditionnele lecteur dans sa lecture.
- Le temps historique: l'époque de la
fiction peut être contemporaine de l'écrivain ou non (roman
historique, roman de sciences fiction). Ce sont les temps
référentiels, c'est-à-dire les temps auxquels nous renvoie
la lecture du texte.
La prise en compte dans une étude de la
temporalité externe est importante quand on veut faire de l'histoire
littéraire ou de l'histoire des mentalités ou en
littérature comparée, quand on veut comprendre la fortune (le
destin) d'un roman. La temporalité externe est aussi importante dans
l'interprétation d'un roman.
II.2. Les temps internes
Les temps internes sont les temps qui sont
insérés dans l'oeuvre elle-même. Il s'agit du temps de la
fiction, de la narration et de la lecture.
- Le temps de la lecture
C'est celui que met le lecteur à lire un récit.
Il est à la fois dépendant et indépendant. En effet, il
est proportionnel à l'épaisseur de l'ouvrage, mais peut varier
selon la vitesse de lecture de chacun (étude psychologique).
- Le temps de la fiction, de la diégèse
ou de l'histoire
On l'appelle aussi le temps raconté. Il
représente la durée du déroulement de l'action. Plusieurs
formules implicites ou explicites sont utilisées dans le texte narratif
pour indiquer la succession des événements et donner, rendre
sensible la fuite du temps: le vieillissement des personnages, la
transformation des lieux, souvent les allusions, etc. Certains récits
ont un référent avéré, ils se donnent pour
finalité de relater des événements du monde, passés
ou présents. Ce sont les récits factuels, tels que nous
les rencontrons dans les livres d'histoire ou dans la presse quotidienne. Le
journaliste, l'historien ne peuvent pas raconter n'importe quoi: leurs
récits dépendent logiquement de la réalité dont ils
rendent compte. Tout autre est le cas du romancier: sans doute celui-ci
peut-il, comme l'historien, évoquer des lieux ou des personnages
existants), mais il n'est pas soumis comme lui au critère d'exactitude.
Le récit de fiction échappe à la juridiction du
vrai et du faux et ne dépend que de l'acte narratif qui l'institue.
Indépendant à l'égard de tout devoir de
référer, le récit de fiction offre dès lors un
terrain d'expérimentation fécond pour éprouver les vertus
de la schématisation narrative en général. Pour Michel
Butor (1975 : 9), le roman n'est pas autre chose que « le laboratoire
du récit, alors que le texte véridique a toujours l'appui, la
ressource d'une évidence extérieure, le roman doit suffire
à susciter ce dont il nous entretient ». Et c'est ainsi
qu'à ses yeux « la recherche de nouvelles formes romanesques
joue [...] un triple rôle par rapport à la conscience que nous
avons du réel, de dénonciation, d'exploration et
d'adaptation. » (1975 : 10)
- Le temps narratif
On l'appelle aussi temps du récit ou temps racontant.
La durée d'une fiction (histoire) peut être d'une journée,
et celle-ci peut être racontée en 400 pages. Une tranche de vie ou
plusieurs tranches de vie (plusieurs générations) peuvent
être racontées en 100 pages. Le temps narratif est
différent du temps de la fiction. Sa détermination n'est pas
aisée car il ne faut le confondre ni avec le temps de l'écriture
ni avec celui de la lecture. Le temps narratif se mesure conventionnellement en
longueur de pages : c'est la longueur d'un texte nécessaire à la
relation d'un évènement.Comme une feuille de papier, la
temporalité narrative se présente sous deux faces
indissolublement liées. D'un côté, le temps narratif est
déterminé par la nature linéaire du signifiant
linguistique. Contrairement aux peintres, qui peuvent donner à voir les
choses et les gens d'un coup, dans la coexistence simultanée de
l'espace pictural, les romanciers sont tributaires de la nature
consécutive du langage: ainsi, c'est très progressivement que le
lecteur voit apparaître devant l'oeil de son esprit les lieux et les
personnages du roman dont il tourne les pages une à une. Telle est la
première face du temps narratif: c'est le temps du récit
(tR), déterminé par la succession des mots sur la page. Ce
temps racontant (en allemand, on parle d'Erzählzeit) se
repère par le décompte d'unités de texte: nombre de
lignes, de pages, de chapitres, etc. L'autre face de la temporalité
narrative, c'est le temps raconté (erzählte Zeit, en
allemand).
II. 3 Les temps verbaux
« Le récit pour s'inaugurer, se maintenir, se
développer comme un monde clos, suffisant, constitué, exige
à la fois local (localité) et temporalité. Il doit dire
quand, il doit dire où. L'événement narratif ne se propose
que muni de toutes ses coordonnées. Sans données temporelles,
spatiales (conjointes à d'autres) le message narratif ne peut être
délivré. »À travers ces mots de Charles Grivel
(1973 : 115), on peut se rendre compte de la place qu'occupent les
structures spatio-temporelles dans la construction des récits. Pour
l'élaboration de ces derniers, l'auteur possède nombre de
matériels et de techniques qui vont lui permettre de ficeler son oeuvre
le plus parfaitement possible, dont la langue,
Jean Dubois et alii (2007 :
270)« Système de signes dont le fonctionnement repose sur
un certain nombre de règles, de contraintes. Elle est donc un code qui
permet d'établir une communication entre un émetteur et un
récepteur. »,
qui est un moyen inéluctable, et la source de toute
création littéraire ; de ce fait, elle est, comme le note Barthes
(1953 : 17):
« Comme une nature qui passe entièrement
à travers la parole de l'écrivain. [...] Elle est comme un cercle
abstrait de vérités hors duquel seulement, commence à se
déposer la densité d'un verbe solitaire. »
À cet effet, l'auteur durant l'élaboration de
son oeuvre, pour donner beaucoup plus d'intelligibilité à son
histoire, prend la liberté de jouer sur le facteur verbal de cet
instrument : la langue, tout en ayant l'audace d'opérer des
bouleversements chronologiques et temporels dans son récit. Qu'est-ce
qu'un verbe ?
II.3.1 Notion de verbe
Dérivant du latin verbum, le verbe,
considéré par Georges Duhamel(1934-39) comme
« l'âme d'une langue »,autrement dit, le mot
par excellence, est un mot qui exprime un dynamisme (action, état,
devenir), c'estun mot doté d'une conjugaison et d'une grande
variété de formes, servant à désigner une action,
un état, une sensation, un processus. Selon le LAROUSSE, c'est une
catégorie grammaticale qui regroupe l'ensemble des formes
composées d'une base lexicale et d'un certain nombre d'affixes
pertinents variant en nombre, en personne, en temps dont la fonction syntaxique
est de structurer les termes de l'énoncé, et dont le rôle
sémantique est de décrire les actions, les états, les
modifications relatifs aux éléments auxquels
réfèrent les noms sujets.
Le point commun entre ces différentes
définitions, est que le verbe fait montrer toujours des faits
(actions, changements d'états, etc.) que nous situons dans un temps
où ces faits occupent une certaine durée et une certaine date,
décrivant, ainsi, la réalité dans ces deux dimensions :
l'espace et le temps ; ce qu'on appelle procès.
II.3.2 Le procès
Le procès d'un verbe est l'ensemble des sèmes
propre au verbe. En effet, un verbe ne dénote pas toujours une action
(chanter, manger, parler), mais peut indiquer un état (être,
devenir), un résultat (savoir) ou toute autre notion (il est par exemple
difficile de parler d'action ou d'état dans : il pleut,
faute d'actant implicite).
Dans un sens général, la notion de procès
rassemble donc, pour éviter toute équivoque, l'action,
l'état, du verbe. Toutefois, dans un sens restrictif, on dit d'un verbe
qu'il indique le procès quand il exprime une action
réalisée par le sujet. (Verbe d'action), par opposition notamment
aux verbes exprimant un état (verbe d'état). C'est ce qu'indique
un verbe quand il réalise une action posée par le sujet de la
proposition.
Jean Dubois et alii (2007 :380).« On dit d'un
verbe qu'il indique un procès quand il exprime une action
réalisée par le sujet de la phrase, [...]. Certains englobent
sous le nom de procès toutes les notions (action et état) que le
verbe peut affirmer du sujet. »
Exemple : « Nous mangeons
du riz. »
II.3.3 Le prédicat
Un prédicat, c'est l'élément
central de la phrase, autour duquel s'organise la fonction des autres
éléments de l'énoncé.Dans la phrase de base, c'est
le syntagme verbal par rapport au syntagme nominal sujet : Le chien
aboie.
Le rôle des prédicats est de décrire le
procès du sujet S dans un temps t puis ce qu'il
advient dans un autre temps t + n :
Pour Jean Michel Adam(1984 : 90), la transformation des
prédicats au cours d'un procès est obligatoire pour qu'il y ait
récit. La place qu'occupe le verbe dans la langue est plus
qu'importante. Ce point nodal connaît sa pleine floraison dans les
univers romanesque dont les auteurs en usent pour s'assurer de
l'évolution de l'intrigue romanesque et son ancrage dans un temps tel,
et, de plus, donner sens, rythme et signification à l'histoire. Le sens
plénier du verbe ne se saisit que lorsqu'il est associé à
la représentation que lui confère le sujet : dans ce cas on parle
d'aspect.
II.3.4 L'aspect
Dans le grand dictionnaire de Linguistique etsciences du
langage, Jean Dubois et alii (2007 : 53) définit l'aspect de
la manière suivante :
« L'aspect est une catégorie grammaticale
qui exprime la représentation que se fait le sujet parlant du
procès exprimé par le verbe (ou par le nom d'action),
c'est-à-dire la représentation de sa durée, de son
déroulement ou de son achèvement. [...] L'aspect se
définit, par exemple, par l'opposition en français entre
l'accompli (perfectif ou parfait) et le non-accompli (ou
imperfectif) ».
De ce fait, dans un récit, c'est cet aspect qui nous
permet de départager entre l'imparfait (imperfectif, non-accompli,
inachevé, qui présente le procès de l'intérieur),
et le passé simple (perfectif, accompli, achevé, qui
présente le procès de l'extérieur
II.3.5 L'opposition
imparfait/passe simple
Le passé simple s'oppose à l'imparfait sur la
ligne du temps avec une action ponctuelle.
II. 3.5- 1.L'opposition
aspectuelle entre imparfait et passé simple
Le passé simple et l'imparfait s'opposent sous la
catégorie de l'aspect. L'aspect indique de quelle manière on
envisage le procès dénoté par un verbe. Le passé
simple est un temps perfectif, en ce qu'il saisit le procès de
l'extérieur, dans sa globalité, à la manière d'un
point apparu à un momentdonné. L'imparfait, en revanche, est un
temps imperfectif. Il présente le procèsde
l'intérieur, dans son déroulement, sans lui assigner de bornes
temporellesévidentes. Lorsqu'on utilise l'imparfait, on signale que le
procès est en coursau moment choisi comme point de repère, mais
on ne donne pas d'indicationquant à son achèvement. Si le
passé simple est donc limitatif, l'imparfait peutêtre dit
non limitatif.
Excepté le côté aspectuel, le couple
imparfait/passé simple joue un autre rôle
d'importance dans la construction romanesque. Cette fois c'est la mise en
relief.
II.3.5- 2. La mise en relief
La mise en relief est une notion linguistique inventée
par Harald Weinrich. Pour lui il y a mise en relief quand il y a alternance de
deux temps tels que le passé simple et l'imparfait. L'imparfait sert
à la description du second plan, du décor en quelque sorte,
tandis que le passé simple est privilégié pour les actions
du premier plan.
Dans son oeuvre Le temps(1973 : 114), Harald
Weinrichdépartage ces deux temps en mettant l'accent sur les deux
notions d'arrière-plan et de premier plan :
« L'imparfait est dans le récit le temps de
l'arrière-plan, le Passé simple le temps du premier plan
»
Autrement dit, le passé simple permet d'asseoir dans le
récit, au premier, plan tout ce qui est action, péripétie
et événement qui font progresser l'intrigue, tandis que
l'imparfait joue le rôle d'un canevas, d'une ossature, sinon de tout ce
qui constitue le fond sur lequel se détachent les
événements marquants exprimés par le passé simple,
et qui permet, en revanche, de dessiner la toile de fond, ou ce que H.
Weinrichdésigne sous le concept d'arrière-plan.
II.3.5- 3. L'imparfait de
rupture
Il faut noter que l'usage narratif de l'imparfait ne se limite
pas exclusivement à l'exercice d'une fonction d'arrière-plan.
L'imparfait peut en effet s'introduire au terme d'une série de formes
perfectives pour, si l'on veut, faire progresser le récit. Il faut
préciser, cependant, qu'il a alors pour rôle spécifique de
signifier la clôture soit d'un épisode du récit,
soit du récit lui-même. Il est souvent accompagné d'un
complément circonstanciel qui lui assure son inscription temporelle. Tel
est l'imparfait de rupture (ou imparfait historique). Son emploi est courant
dans la seconde moitié du XIXe siècle, particulièrement
dans les contes et nouvelles de Maupassant. Ainsi, dans La Ficelle, le
personnage d'Hauchecorne cherche désespérément à
prouver son innocence dans une affaire de vol de portefeuille:
« Il ne rencontra que des incrédules.Il
en fut malade toute la nuit.Le lendemain, vers une heure de
l'après-midi, Marius Paumelle [...] rendaitle portefeuille et son
contenu à Maître Houlbrèque, de Manne
ville. »
L'imparfait marque bien ici la clôture d'un
épisode narratif, mais non celle du récit. En effet, la reddition
du portefeuille par Paumelle ne suffit pas à laver Hauchecorne des
soupçons de la rumeur publique, ce qui finit par le conduire à la
folie et à la mort.
II.3.6L'aspect
itératif
L'aspect itératif indique la
répétition d'un
procès.
Il s'oppose au
semelfactif, qui
dénote une action ponctuelle, qui ne se produit qu'une fois.
Dans son acception la plus courante, il est marqué par
des éléments extérieurs au
syntagme
verbal du
type chaque jour, toutes les semaines... Cet aspect
ne peut se retrouver qu'avec certains
temps comme
le
présent de
l'indicatif (« Tous les jours je vais à
l'école ») ou au
passé avec
l'
imparfait (« Tous
les jours j'allais à l'école »).
Dans le cas de l'
imparfait, on parle
dès lors d'imparfait d'habitude ou imparfait itératif,
cette nouvelle
valeur prenant le pas
sur la valeur
sécante de
ce temps. Ainsi on peut dire : Tous les jours, jusqu'à
midi, j'allais à l'école. Ce qui est impossible dans
un
contexte différent
étant donné la valeur non sécante qu'induit la borne
temporelle finale jusqu'à midi, incompatible avec la
valeur sécante inhérente à l'imparfait.
Pour certains grammairiens, l'itération n'est
qu'une
valeur que peuvent
prendre certains
verbes conjugués
à certains temps. C'est le cas de l'imparfait itératif,
mais aussi, par exemple, du
passé
composé (ici dans un contexte
où longtemps signifie « souvent »
et non « pendant une grande longueur de temps »
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire,
du fait que la longueur de l'action est sentie comme incompatible avec le
passé composé). « Longtemps, je me suis
couché de bonne heure. »
Les aspects marquant une répétition de l'action
sont les aspects fréquentatif, duplicatif,
multiplicatif(qui ne sont pas du tout des
synonymes d'itératif).
On peut en déduire que l'itératif ne serait qu'une valeur
liée au temps utilisé (comme ci-dessus).
-
L'aspect fréquentatif est un aspect adverbial. L'
adverbe (ou le
complément
circonstanciel) indique le nombre de fois que se réalise le
procès : souvent, jamais, toujours, une, deux, trois fois,
ainsi que ne... pas, qui indique, à l'instar
de jamais, une « fréquence
zéro »
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Aspect_it%C3%A9ratif
- cite_note-Wilmet-1.
- Les
aspects duplicatifs et multiplicatifs sont
des aspects formels, liés aux affixes :
* le
préfixe -`'
re `'a une
fonction duplicative intermittente : refaire ou redire bissent
le procès á-ù, mais remplir,
rentrer ou revenir [...] sont les quasi
doubletsd'emplir, entrer ou de venir,
empreints d'une vague idée de
succession : remplir = «combler un
vide», rentrer, revenir = «entrer/venir
après être sorti/parti de chez soi».
*les
infixes aill- (ex. crier/criailler),ass- (ex. rêver/rêvasser),
el-(ex. craquer/craqueler),
[...] -ill- (fendiller), -in- (pleuviner), -nich- (pleurnicher), -och- (bavocher),
on (chantonner), -ot- (clignoter),
ouill- (mâchouiller) répètent le
procès á-ù.
Cetaspect multiplicatif n'est pas sans rappeler le
pluriel
interne.
II.3.7le passé
composé
Le passé composé a plusieurs valeurs dans un
récit parmi lesquelles on retient :
II.3.7- 1. Valeur d'accompli/
d'inaccompli/ d'antériorité
Le passé composé se caractérise d'abord
par son aspect accompli. De manière générale, on
parle d'aspect accompli lorsque le procès se présente
comme achevé au moment qui sert de repèretemporel : on envisage
alors le résultat du procès à ce moment-là. Comme
l'écrit le linguiste Oswald Ducrot (1995 : 689):
« L'aspect est [...] accompli si le procès est
antérieur à la période dont on parle, si on veut signaler
sa trace dans cette période ». L'opposition de
l'accompli et du non accompli est manifestée en
français par l'opposition des formes composées et des formes
simples. Il existe, pour chaque forme simple d'un verbe, une forme
composée, qui allie un auxiliaire et un participe passé. De ce
point de vue, le passé composé est un accompli du
présent.(Il a été un grand professeur,
aujourd'hui il est à la retraite).
Une difficulté naît cependant du fait que le
passé composé n'est pas uniquementutilisé avec sa valeur
aspectuelle d'accompli du présent. Il comporte également une
valeur temporelle d'antériorité (qui n'est pas toujours
clairement distincte de la précédente). Ainsi, un
énoncé comme `'J'ai lu le Crime Parfait'' pourra, selon
le contexte, faire jouer la valeur d'accompli: il mettra alors l'accent sur
l'état résultant du procès et ses conséquences pour
l'actualité du locuteur (J'ai lu le Crime Parfait), je peux
maintenant commencer à rédiger mon mémoire). Il pourra,
d'autre part, insister sur la valeur temporelle d'antériorité
(J'ai lu le Crime Parfaitl'été dernier, et je n'ai pas
aimé).
II.3.7- 2. Un temps peu
narratif
Cette particularité du passé composé peut
aider à saisir les raisons pour lesquelles on a souvent
caractérisé ce tiroir verbal par son
incapaciténarrative. L'écrivain Marcel Pagnol
(1976 : 61)le dit joliment : « Le passé
composé, [...] c'est un temps imprécis, médiocre,
bête et mou. »
Nous avons été réveillés
par la fusillade...Bon. Et alors ? L'histoire est finie avant d'avoir
commencé. Tandis que Nous fûmes réveillés
par la fusillade...Tu vois? Tu as dressé l'oreille. Tu attends la
suite.
Au-delà des jugements esthétiques personnels de
l'écrivain, il faut retenir de ce propos l'opposition entre, d'une part,
le caractère relativement statique de la narration au
passé composé, et, d'autre part, le caractère
dynamique de la narration au passé simple. Le passé
simple présente un procès et induit l'attente du procès
suivant. Il participe à la création d'un effet de chaîne:
il est orienté, dit Roland Barthes, vers une liaison logique avec
d'autres actions, d'autres procès [...]; soutenant une équivoque
entre temporalité et causalité (1972 : 27-28), l'usage du
passé simple donne à penser que la succession temporelle
obéit à des relations de cause à effet. Le passé
composé ne peut, quant à lui, complètement faire oublier
sa valeur d'accompli du présent. Son emploi tend dès lors
à faire porter l'accent non tant sur le procès lui-même que
sur l'état qui en résulte. Ce caractère
résultatifprésente le procès dans un relatif isolement: on
considère davantage ses effets sur l'actualité du locuteur que
son lien temporel et/ou causal avec d'autres procès. Même une
suite de verbes au passé composé peine à créer un
réel effet de chaîne: la narration ressemble davantage à
une juxtaposition d'états coupés les uns des autres qu'à
un enchaînement d'actions solidaires.
II.3.8.Le présent
Dans les récits, la composition verbale ne se confine
pas uniquement en l'utilisation de l'imparfait et de passé simple ; mais
bien le présent est aussi employé dans presque toutes les
constructions romanesques. Avec ses différentes acceptions, le
présent constitue donc un carrefour, voire un rond-point en
étoile, à partir duquel découlent tous les autres
temps.
Dans son ouvrage Institutionesgrammaticae,
Priscien(VIII, 51) définit le présent de la manière
suivante :
« On appelle temps présent celui dont une
partie a passé et dont une partie est à venir. Comme en effet le
temps qui se déroule, tel un fleuve, suivant un cours instable, il ne
peut guère avoir de point [d'arrêt] dans le présent, i. e.
dans l'instant. »
Donc, le présent constitue le centre de gravité
d'un tel ou tel événement, il est le point essentiel, principal,
sinon primordial autour duquel s'organise l'ensemble de l'action. Dans sa
fonction de base, le présent est le temps de l'énonciation qui
indique la coïncidence entre le procès et le moment de
l'énonciation.
On distingue plusieurs valeurs du présent de
l'indicatif.
II.3.8- 1. Présent
d'énonciation
Ce présent exprime un fait ou une action qui se
déroule au moment où l'on parle. C'est
le présent d'énonciation.
« Je tonds la pelouse. »
Dans sa valeur de base, le présent indique la
coïncidence du procès dénoté par le verbe avec le
moment de l'énonciation. Cette valeur est notamment activée
lorsque le narrateur d'un récit, abandonnant un temps l'histoire qu'il
raconte, témoigne de ses émotions actuelles.
II.3.8- 2 Le présent
de description
On utilise le présent pour la
description, c'est le présent de description.
« Le ciel s'assombrit, l'orage n'est pas
loin. »
II.3.8- 3 Le présent
d'habitude
Le présent souligne l'habitude, un fait qui se
répète, c'est le présent d'habitude.
« Tous les matins, je me lève à 7
heures pour aller au collège. Chaque matin, je bois un
café. »
II.3.8-4Le présent du
passé récent
Le présent de l'indicatif peut indiquer une
action qui vient d'avoir lieu.
« Je vais de chez ma soeur à
l'instant. »
II.3.8- 5.Le présent du
futur proche
Le présent de l'indicatif est aussi utilisé pour
une action qui va bientôt avoir lieu.« Je viens de terminer mon
travail »
II.3.8- 6 Présent
gnomique
Le présent ne se limite pas à la
désignation du strict moment de la parole : il peut fort bien
élargir sa couverture temporelle. On parle de présent de
véritégénérale (ou présent
gnomique), lorsque l'énoncé acquiert une valeur omni
temporelle. Cette valeur est souvent renforcée par des syntagmes
nominaux qui dénotent non plus des individus particuliers, mais bien des
classesd'individus. Le présent de vérité
générale est souvent convoqué lorsque le narrateur
propose, par le biais d'un discours didactique, un commentaire de l'action.
« Je savais que la terre est
ronde ».
La rondeur de la terre est considérée comme une
vérité générale car la terre était, est et
restera ronde.
II.3.8-7 Présent
historique
Il est employé dans les récits
historiques. « Charlemagne devient empereur en l'an
800. »
Ce présent peut dans certains cas jouer un rôle
proprement narratif et commuter de façon ponctuelle avec le passé
simple. On parle alors de présenthistorique. Le recours
à ce procédé, s'il est fréquent dans la tradition
narrative, reste utilisé avec parcimonie au sein d'une constellation
où dominent par ailleurs les temps classiques du récit
(passé simple et imparfait). On le rencontre à des endroits
stratégiques, lorsqu'il s'agit d'exacerber le caractère
dramatique des actions et des événements
représentés. Ainsi Chateaubriand, dans René,
ménage soigneusement l'accès à la scène clé
de son récit (la prise de voile d'Amélie, la soeur du
héros), en faisant d'abord alterné présent et temps du
passé:
« Au lever de l'aube, j'entendis le premier son
des cloches... Vers dix heures, dans une sorte d'agonie, je me traînai au
monastère. [...] Un peuple immense remplissait l'église. On me
conduit au banc du sanctuaire; je me précipite à genoux sans
presque savoir où j'étais, ni à quoi j'étais
résolu. Déjà le prêtre attendait à l'autel;
tout à coup la grille mystérieuse s'ouvre, et Amélie
s'avance, parée de toutes les pompes du monde. »
Mais lorsque le passage atteint son sommet dramatique,
après qu'Amélie ait avoué à René sa passion
incestueuse, le présent historique s'impose seul:
À ces mots échappés du cercueil,
l'affreuse vérité m'éclaire; ma raison s'égare, je
me laisse tomber sur le linceul de la mort, je presse ma soeur dans mes bras,
je m'écrie: Chaste épouse de Jésus-Christ, reçois
mes derniers embrassements à travers les glaces du trépas et les
profondeurs de l'éternité, qui te séparent
déjà de ton frère! Ce mouvement, ce cri, ces larmes,
troublent la cérémonie: le prêtre s'interrompt, les
religieuses ferment la grille, la foule s'agite et se presse vers l'autel; on
m'emporte sans connaissance.
II.3.8-8 Présent de
narration
Une conception traditionnelle veut que le présent de
narration soit exclusivement équivalent fonctionnel du passé
simple. Or, s'il est incontestable qu'une majorité des occurrences
constituent effectivement des variantes expressives du passé simple, il
est difficile de ne pas remarquer que ce temps se substitue également
à l'imparfait, avec la même fonction expressive. Le présent
de narration porte un signifié fonctionnel profond, qui correspond
à sa charge expressive. Celle-ci est diversement modulée en
contexte, selon le type du verbe et selon la fonction qu'il assume dans le
récit :
-En tant qu'équivalent du passé simple, il
amène généralement une dramatisation de l'action;
-En tant qu'équivalent de l'imparfait, il rapproche du
premier plan des faits qui autrement resteraient confinés au fond de la
scène.
Quelles sont les propriétés du présent
narratif responsables de cette charge expressive, qui lui est inhérente?
Elles sont au nombre de deux, et elles sont, selon nous, toutes deux
fondées sur le décalage entre le sémantisme prototypique
du présent et l'emploi contextuel atypique du présent de
narration : la première propriété, stable, consiste dans
le caractère actualisant du présent, et la deuxième, qui
ne se manifeste que lorsque le présent s'érige en
équivalent fonctionnel du passé simple, est son aspect
sécant.
· Quant à l'effet d'actualisation produit par le
présent de narration, il a trait aux propriétés
systémiques et, par ce biais, prototypiques, du présent : il est
généralementsoutenu que le présent marque la concomitance
du procès-verbal avec un point d'actualité, quelle que soit la
situation chronologique de celui-ci par rapport au point d'énonciation,
thèse qui conduit parfois à refuser au présent de
narration toute spécificité stylistique. Cependant, les
théoriciens qui raisonnent ainsi semblent oublier que l'effet
actualisateur du présent est dérivé de ses emplois
prototypiques, qui en font un temps concomitant au point d'énonciation.
Il s'ensuit que, dans la structure profonde, un conflit entre
temporalités est sous-jacent à toute occurrence du présent
de narration. Ce conflit est la source de la charge expressive propreà
l'effet actualisateur du présent narratif.
· Quant à l'aspect sécant du présent
de narration, il provient également des propriétés
prototypiques du présent actuel : l'aspect sécant est
fondamentalement celui de tout présent, lequel se compose de deux
parcelles temporelles juxtaposées, appelées dans la terminologie
guillaumienne (1929 : 51-52) « chronotype alpha » et le «
chronotype oméga », le premier étant «
prélevé sur le futur », c'est-à-dire sur « le
temps qui vient..., chronotype virtuel et incident », le second
étant « prélevé sur le passé,
c'est-à-dire sur du temps qui a existé effectivement et s'en
va..., chronotyperéel et décadent.C'est cet aspect
fondamentalement inaccompli qui fait le pittoresque du présent de
narration lorsqu'il se substitue au passé simple, dont l'aspect est par
définition global, non sécant, ne permettant pas la distinction
entre inaccompli et accompli. Ce conflit entre deux aspectualités
engendre un effet stylistique complémentaire, renforçant celui de
l'actualisation expressive.
Depuis cinquante ans, le présent de narration s'est
solidement implanté dans les habitudes romanesques. Il constitue
dorénavant une alternative parfaitement reçue aux récits
construits à partir du passé simple.
II.3.8 Les indicateurs
temporels
Les relations temporelles ne sont pas seulement
signifiées par les différentstiroirs verbaux, mais
également par des indicateurs temporels - adverbes,locutions
adverbiales, compléments circonstanciels, etc.On distingue:
-les expressions
déictiquesdu type aujourd'hui, maintenant, demain, la
semaine prochaine, qui ne livrent leur référent que par le biais
d'un renvoi aux paramètres de la situation d'énonciation. Elles
proposent un repérage contextuel;
-les expressions anaphoriquesdu type
ce jour-là, à ce moment-là, lelendemain, la semaine
suivante, qui prennent pour repère un point du temps fixé au
préalable dans le texte ou dans l'énoncé. Elles proposent
un repérage contextuel, qui fait référence
à un élément apparu précédemment dans la
chaîne verbale;
-les dates ou événements
historiques notoires (Le 15 septembre 1840,vers six heures du matin;
depuis la mort de Louis XIII), qui proposent un ancrage chronologique
absolu, à l'inverse des indicateurs précédents,
qui sont relatifs à un repère. Il est rare qu'un
récit s'en tienne à un seul type de repérage: ainsi, un
repérage contextuel initial (Il y a deux semaines) sera souvent suivi
d'une série de repérages contextuels secondaires (la veille, le
lendemain).
II.3.9. La double
référence temporelle des récits
On a vu, dans les sections qui précèdent,
comment se pose la question du rapport entre le temps du récit racontant
et celui de l'histoire racontée. Il s'agit, à présent, de
s'interroger sur les rapports qu'entretiennent le temps de l'histoire
racontée et celui de l'acte de narration. Comme le
relève Genette(1972 : 228), il est quasiment impossible, pour un
narrateur, de ne pas situer [l'histoire qu'il raconte] dans le temps par
rapport à [son] acte narratif, puisqu' [il doit] nécessairement
la raconter à un temps du présent, du passé, ou du
futur.Selon la position temporelle qu'occupe l'acte narratif par rapport
à l'histoire racontée, on distinguera les narrations
ultérieure, antérieure, simultanée
et intercalée.
Un récit peut comporter ainsi une double
référence temporelle. Il peut y avoir premièrement
une temporalité relative à la diégèse,
c'est-à-dire aux actions et événements de l'histoire
racontée. Cette temporalité peut se présenter dans son
autonomie, comme dans cette phrase: « Dix ans avant cette
l'indépendance, le territoire burkinabé n'était
pas une République »
Ici, le repérage temporel est d'abord absolu (au
début de l'année 1960), puis contextuel (dix ans avant
cette époque), mais il n'implique pas de référence
explicite à l'acte producteur du récit. Examinons maintenant le
cas plus complexe de l'incipit de Notre-Dame de Paris:
« Il y a aujourd'hui trois cent quarante-huit
ans, six mois et dix-neuf jours que les Parisiens s'éveillèrent
au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la
triple enceinte de la Cité, de l'Université et de la Ville. Ce
n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé le souvenir que le
6janvier 1482. »
S'il offre bien une datation absolue (le 6 janvier
1482), le texte s'ouvrecependant sur un repérage contextuel qui,
par le biais de l'adverbe aujourd'hui, implique une
référence explicite au moment de la narration. On pourrait,
à ce stade, généraliser le propos et dire que tout
narrateur laisse, lorsqu'il raconte, des traces de son acte de narration dans
le texte. Dans le cadre d'un récit, ces traces ne peuvent
s'interpréter que par référence à une situation
narrative - c'est-à-dire au fait qu'un narrateur raconte une
histoire à un narrataire dans un certain espace-temps. Il estpossible,
pour le narrateur, de se déplacer dans cet espace-temps: tel est le cas
chaque fois qu'il renvoie à un moment antérieur ou
postérieur de son acte de narration, notamment par le biais
d'expressions comme `'Nous avons vu il y a peu que... `'Ou encore
`'Nous raconterons tout à l'heure comment...''
À la temporalité de l'histoire racontée,
il faut donc ajouter une seconde temporalité, relative cette fois
à l'énonciation narrative. Un double système de
repérage se met en place, l'un qui repose sur l'espace-temps des
événements de l'histoire racontée, l'autre sur
l'espace-temps de la narration et de la lecture (Molino,Molino-Lafhail,
2003 : 264)
III. LA TEMPORALITÉ
DANS UN RÉCIT
La première chose à faire quand on parle de
temporalité, c'est de définir celle-ci. C'est tout simple,
vraiment. On définit sous le terme
« temporalité » tout ce qui relève
du caractère du temps et de son écoulement. Dans le cas du
récit, on en distingue deux sortes : le temps des
événements et le temps du récit.
III.1. Temps du
récit/temps des évènements
Le temps des événements est le
temps que dure l'intrigue du point de vue des personnages. Par
exemple, si l'histoire se passe pendant deux années de la vie d'un
personnage, alors le temps des événements est de deux ans.
Le temps du récit correspond au nombre
de pages ou de lignes nécessaires pour faire tenir le temps des
événements. Par exemple, si les deux
années d'histoire sont écrites en 20 pages, alors 20 pages est le
temps du récit.
Ces deux éléments sont constamment liés
dans le roman. Ils sont répartis selon la configuration suivante :
III.2. Ladurée
Nul récit sans rythme: chez Balzac par exemple, des
scènes très dramatiques succèdent à de longues
descriptions statiques; parfois aussi, le temps passe à toute vitesse
(cinq ans après cette scène...), avant de se déployer
à nouveau dans d'autres scènes, dans d'autres descriptions... Le
récit isochrone (à rythme constant) n'existe pas plus
que le récit synchrone, rigoureusement chronologique.
III.2.1 La vitesse du
récit
Un récit n'est pas seulement actions et
péripéties, mais également peintures etfresques qui ont
pour rôle de moduler le tempo de la narration. En revanche, dans la
mesure où raconter c'est toujours faire le choix de mettre en saillance
tel fait plutôt que tel autre, cela signifie que, nul récit sans
rythme. Dans son oeuvre Poétique des textes, (Nathan Université,
1992, p, 134) Jean Milly déclare:
« La vitesse d'un récit est une notion
difficile à cerner. [...] . Dire qu'un récit à une vitesse
constante si le rapport entre la longueur des segments du texte, mesurés
en pages et en lignes, et la durée des événements de
l'histoire, mesurée en temps des horloges, est constant. [...] .
À partir de là, on peut parler d'accélération quand
il s'écoule davantage de temps de l'action pour un même nombre de
pages, et de ralentissement quand moins de temps de l'action s'écoule
dans le même espace textuel. »
Pour mesurer ces variations de rythme (ou
anisochronies), Genette introduit cette notion de vitesse:
« On entend par vitesse le rapport entre une mesure temporelle et une
mesure spatiale [...] : la vitesse du récit se définira par le
rapport entre une durée, celle de l'histoire, mesurée en
secondes, minutes, heures, jours, mois et années, et une longueur :
celle du texte, mesurée en lignes et en pages. » (Genette
1972 : 123). Ces rapports peuvent se réduire à quatre formes
canoniques : la scène et le sommaire d'une part; la
pause et l'ellipse d'autre part.
III.2.2 La scène
La scène est un moment
où le temps de l'événement et le temps du récit se
passent au même moment. C'est par exemple le cas dans un dialogue. Ce que
vous lisez prend le même temps à lire que ce que les personnages
disent. C'est la même chose par exemple dans une scène d'action,
tout se passe devant vous et aucun élément n'est caché.
En effet, le terme de scène appartient au langage du
théâtre. Par analogie, on parlera de scène narrative
lorsqu'un récit présente des personnages qui dialoguent (ou
monologuent). Dans ce cas, on peut dire qu'il y a une certaine
égalité entre le temps du récit et le temps de l'histoire;
on se rapproche de l'égalité qui lie une scène au
théâtre ou au cinéma et la scène réelle que
la première est censée représenter (Molino et
Lafhail-Molino, 2003 : 269). Dans le récit classique, la
scène (tR = tH) alterne régulièrement avec le sommaire
(tR<tH).
Dans la scène, l'auteur raconte en détail
l'action qui se déroule. Il fait parler les personnages, décrit
le décor, l'ambiance. Elle permet donc de ralentir le rythme du
récit. L'auteur donne l'illusion au lecteur que le temps du récit
reproduit fidèlement le temps de l'histoire. tR= tH
Illustration : le temps de
l'histoire(tR) = au temps du récit (tH)
LE TEMPS DE L'HISTOIRE
LE TEMPS DU RECIT
III.2.3 La pausenarrative
La pause narrative(tR = n; tH = 0),
correspond à une interruption de la temporalité des
événements qui continuent en revanche de se dérouler dans
le temps du récit.
Elleconsiste ainsi à marquer un temps d'arrêt
dans le récit. L'action est donc suspendue, le temps que l'auteur
opère une description, un commentaire.
LE TEMPS DE L'HISTOIRE (tH)
LE TEMPS DU RECIT (tR)

Elle provoque un effet de ralentissement. Contrairement au
dialogue qui marque une équité entre le récit et
l'histoire, la description introduit un ralentissement, au niveau de l'histoire
et une sorte d'excroissance au niveau du texte, c'est-à-dire l'action
s'interrompe pour céder place à la description jouant le
rôle de pause narrative.
La pause commentative permet au narrateur
d'intervenir en personne dans son récit, par exemple pour donner son
avis, porter un jugement sur son personnage, ou encore pour proposer une
information sur un élément factuel ou culturel.
« Écrire, soutient Proust, (t,
III : 902), est pour l'écrivain une fonction saine et
nécessaire dont l'accomplissement rend heureux », mais
écrire un récit, particulièrement un récit
littéraire, est bel et bien un acte d'extrême
ambigüité, car l'écriture selon Juge Barthes (P,
31):
« N'est nullement un instrument de
communication, elle n'est pas une voie ouverte par où passerait
seulement une intention de langage. C'est tout un désordre qui
s'écoule à travers la parole, et lui donne ce mouvement
dévoré qui le maintient en état d'éternel
sursis. »
Pour ce faire, l'écrivain, conscient de la
gravité de cet acte et voulant communiquer son message au lecteur, y
déploie tout son génie. Ainsi pour écrire vite son
récit et lui donner un rythme accélérer,
l'écrivain, à travers son narrateur, condense les
événements et incruste l'histoire de résumés
d'actions sans en détailler tous les faits : c'est le sommaire,
c'est-à-dire « la narration, en quelques paragraphes ou
quelques pages de plusieurs journées, mois ou années d'existence,
sans détails d'actions ou de paroles.» écrit
Genette (1972 : 130)
III.2.4 Le sommaire.
LE TEMPS DE L'HISTOIRE
LE TEMPS DU RECIT
Le sommaire est un moment où
le temps du récit est plus court que celui de l'événement.
C'est un résumé. Par exemple, dans l'histoire, on décrit
brièvement ce qui s'est passé sur deux ou trois jours de voyage
d'un ou des personnages sans rentrer réellement dans le récit.
C'est un sommaire.
Il est le contraire de la scène : il s'agit
d'accélérer le rythme du récit en résumant les
événements de l'histoire (en général des actions
secondaires). Le sommaire constitue ce que l'on pourrait appeler le tissu
conjonctif du récit: il prend en charge, en les résumant de
manière plus ou moins synthétique, les moments de transition et
les informations nécessaires à la compréhension de
l'intrigue, préparant ainsi le terrain pour les scènes, où
se concentre traditionnellement tout l'intérêt dramatique et
pathétique du récit.
« Le jour peinait encore à se lever quand
il rentra de l'enterrement. »
Dans cette phrase, le sommaire est apparent. La cause en est
claire : l'enterrement est un acte qui dure, certes, dans le temps, mais le
narrateur ne lui a cédé qu'une seule phrase. Donc dans ce cas, on
parle d'un événement qui comprend plusieurs actions que le
narrateur résume en une seule phrase, et si l'on se réfère
aux formules mathématiques on en aura la suivante : TR
<TH qui est réservée au sommaire (Genette).
Si le sommaire rend plus rapide le rythme de la narration,
l'ellipse de son côté présente le « degré
ultime de l'accélération » déclare Yves Reuter
dans son oeuvre L'analyse du récit (2007 : 61).
III.2.5 L'ellipse
LE TEMPS DE L'HISTOIRE
DU RECIT
LE TEMPS
L'ellipse correspond lui aussi à
un temps du récit beaucoup plus court que celui de
l'événement. L'ellipse se contente simplement de donner une
nouvelle zone temporelle aurécit, sans mentionner ce qui s'est
passé pendant ce laps de temps. Si l'on reprend l'exemple du dessus,
vous écrivez simplement que les personnages allèrent d'un point A
à un point B, sans mentionner ce qu'ils ont fait pendant le voyage.
On peut considérer l'ellipse comme une forme
radicalisée du sommaire: elle permet, un peu à l'image des
entr'actes au théâtre, de sauter du temps inutile... ou de
souligner, par contraste, l'importance de ce qui est passé sous silence.
L'auteur choisit de passer sous silence certains moments de l'histoire ; cela
permet de faire des bonds dans le temps et donc d'accélérer le
rythme du récit.
1 Gérard Genette, (1972). « Discours du
récit », in Figures III. Paris: Seuil, p. 78.
IV.NOTION D'ORDRE TEMPOREL
Un récit quel qu'il soit recèle en
général plusieurs types de relations temporelles que l'on peut
répertorier sous trois parangons majeurs qui sont respectivement :
relation d'ordre, relations de durée et relation de fréquence.
Chacune de ces trois relations pèse fort sur l'univers romanesque et
permet ainsi à l'histoire de rythmer son cours. Pour donner un sens
beaucoup plus hermétique à son récit, l'auteur se permet
de jouer sur ce facteur qui lui permet en retour d'en dresser une assise la
plus solide qui soit à son récit.
Étudier l'ordre temporel d'un récit,
résume Genette (1972 : 78), c'est confronter l'ordre de disposition
des événements ou segments dans le discours narratif à
l'ordre de succession de ces mêmes événements ou segments
temporels dans l'histoire, en tant qu'il est explicitement indiqué par
le récit lui-même, ou qu'on peut l'inférer de tel ou tel
indice indirect. On pourrait penser que la tendance spontanée des
conteurs et romanciers est de faire coïncider l'ordre des
événements racontés et l'ordre de leur présentation
narrative (récit synchrone, ou ab ovo). Or, c'est le
contraire qui est vrai: la majorité des récits ne respectent pas
l'ordre chronologique: ils sont anachroniques, soit qu'ils racontent
avant (dans R) ce qui s'est passé après (dans H) - anticipation,
ou prolepse; soit qu'ils racontent après (dans R) ce qui s'est
passé avant (dans H) - rétrospection, ou analepse.
L'étude de l'ordre implique donc une confrontation de
l'ordre de l'histoire (chronologique et irréversible) avec l'ordre
adopté par le narrateur pour raconter cette même histoire. En
d'autres termes, il s'agit de comparer la disposition des
événements dans l'histoire référentielle et la
disposition de ces mêmes évènements dans la narration.
On peut postuler que les événements
narrés (histoire) suivent, à la manière du temps
référentiel, un ordre impératif, un ordre chronologique.
Le récit lui n'est pas soumis à la règle impérative
de l'ordre du temps. Il peut commencer n'importe où et aller n'importe
où.
1- Le récit peut être parfaitement
chronologique, c'est-à-dire qu'il peut respecter l'ordre de l'histoire.
Cas très rares (contes, mythes, etc.)
2- Le récit peut s'ouvrir sur la mort du personnage ou
son adolescence ou son âge mûr avant de raconter, à la
suite, sa naissance, sa vieillesse.
Les évènements peuvent coïncider. Il y a
donc isochronie narrative. Lorsque le récit ne suit
pas, à la manière de l'histoire référentielle, un
ordre chronologique, on parle d'anachronies narratives queG.
Genette (1972 :90) propose de définir de la manière
suivante :
« Toute anachronie constitue par rapport au
récit dans lequel elle s'insère - sur lequel
elle se greffe - un récit temporellement second,
subordonné aupremier. »
Elles sont de 2 sortes: l'anachronie rétrospective ou
analepse (le retour en arrière ou flash-back) et l'anachronie
prospective ou prolepse (l'anticipation):
IV.1.L'ordre linéaire
Le premier cas, c'est l'ordre
linéaire. Celui-ci est tout simple. Le récit commence au
début (la croix rouge dans le schéma) et va jusqu'à la fin
de l'intrigue sans quitter sa ligne temporelle de vue. Cela correspond à
la majorité des histoires : elles commencent par le début et se
terminent par la fin.
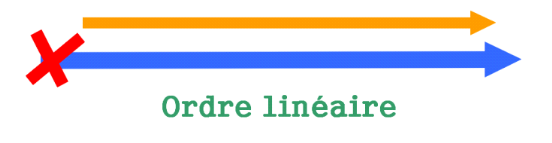
IV.2. L'anticipation ou
prolepse
Le deuxième cas, c'est l'ordre in
mediasres. L'auteur annonce à l'avance un
événement qui va avoir lieu plus tard dans la narration
(contraire de l'analepse). L'histoire peut commencer au milieu de l'intrigue,
généralement dans un prologue où l'on découvre le
personnage principal dans une situation compliquée (1). L'histoire
retourne ensuite au tout début de l'intrigue (2) et se déroule
ensuite linéairement (3) jusqu'à l'événement
décrit au début du texte. On découvre ensuite ce qui se
passe après.

Les anticipations, ou prolepses, se rencontrent moins
fréquemment que les retours en arrière. Les récits qui s'y
prêtent le mieux sont les Mémoires ou les autobiographies tant
réelles que fictifs. Ici, le narrateur, en racontant ce qui s'est
passé, connaît évidemmentl'avenir et fait parfois usage de
ce savoir.
Considérons l'exemple suivant:
« La raison du plus fort est toujours la
meilleure »
Ici, le narrateur annonce qu'il va bouleverser l'ordre de
présentation chronologique des événements. Il annonce
déjà la fin en tout début de récit.
Cette prolepse a une fonction d'annonce ; elle concoure
à établir la cohérence à long terme du
récit. De façon plus générale, en disant maintenant
(dans R) ce qui adviendra plus tard (dans H), la prolepse fait peser sur le
récit un certain poids destinal. L'intérêt du lecteur se
déplace: la fin (misérable) de l'histoire lui étant
connue, ce n'est plus le désir simple de savoir la suite qui le meut,
mais une curiosité plus complexe, et sans doute plus
mélancolique: celle de connaître les rouages inflexibles d'une
intrigue de prédestination.
IV.3.Le retour en
arrière, le flash-back ou l'analepse
Le troisième cas, c'est l'ordre de type
récit picaresque. Le récit picaresque retrace la vie
d'un personnage de ses débuts à son ascension sociale, du point
de vue du personnage lui-même des années plus tard. De ce fait,
l'histoire commence à la fin, à une époque où le
héros est heureux (1). Il y a généralement un prologue
où celui-ci explique ce que le lecteur va lire, puis le récit
redémarre au début de l'intrigue (2) et suit ensuite une
continuité linéaire (3) jusqu'à la fin.

Une analepse, c'est le retour en arrière dans le temps,
la déchronologie, ou encore toute évolution après coup
d'un événement antérieur au point de l'histoire où
l'on se trouve, et qui joue, le plus souvent, la fonction explicative,
permettant ainsi de donner de l'information et d'éclaircissement sur des
situations passées. L'auteur revient ainsi sur un épisode
passé de l'histoire afin de mieux expliquer l'action ou afin de
compléter le portrait d'un personnage. L'analepse suspend le rythme du
récit. Les récits de façon générale usent
beaucoup d'analepses.
L'analepse ou la prolepse peut être interne ou externe.
Les anachronies narratives peuvent aider à
définir certains genres. Leur principale caractéristique est
qu'elle montre que le narrateur connaît bien l'histoire qu'il raconte.
Comme toutes les composantes narratives, analepse et prolepse ne sont pas
fortuites. Elles jouent diverses fonctions dans le texte narratif:
- L'analepse peut avoir une fonction
explicative: elle comble dans ce cas une lacune du récit. Elle peut
aussi avoir une fonction rythmique.
- La prolepse, elle, peut avoir une fonction
prédictive. Dans tous les cas, elle brise pour un temps l'effet de
suspens tant entretenu par le narrateur.
Pour découvrir les anachronies narratives, il importe
de bien noter les changements de temps verbaux et les époques qu'ils
traduisent: les adverbes de temps, les conjonctions de coordination, la mise en
page, les marques graphiques; les indications temporelles.
Pour chaque anachronie narrative, on peut déterminer ce
qu'on appelle la portée et
l'amplitude.
- La portée c'est la distance
temporelle qui sépare le moment de l'histoire où le récit
s'interrompt et le moment de l'histoire où commence l'anachronie.
- L'amplitude, elle, désigne la
durée de l'histoire couverte par le récit anachronique. C'est le
temps couvert par la digression.
Ce ne sont bien sûr pas les trois seuls qui existent.
On retrouve parfois par exemple des textes sans intrigue ou avec une intrigue
à reconstruire (comme dans les hypertextes papiers ou en ligne par
exemple, ou dans Les livres dont vous êtes le
héros !), ou alors avec des allers et retours du passé
au présent (le premier tome
du Sorceleur d'AndrejSapkowski, par exemple, en est un
très bon exemple). De plus, ces ordres de récits sont très
classiques, c'est à vous de vous amuser par la suite à les
modifier et à en faire quelque chose de nouveau.
IV.4. La fréquence
La récursivité est l'un des caractères
fondamentaux de l'art narratif. L'auteur, maître de son récit, a
toujours le choix de mettre au premier plan tel ou tel événement
et ce selon le degré d'importance. Dans cette intention, il est
très fréquent dans les productions romanesques de constater la
redondance de certains événements ou segments narratifs
constituant ainsi l'un des aspects foncier et intrinsèque de la
temporalité narratives. Par ailleurs, « un énoncé
narratif, selon Genette (1972 : 145), n'est pas seulement
produit, il peut être reproduit, répété une ou
plusieurs fois dans le même texte. » Donc, de cette
faculté de répétition des événements
contés se découle quatre types de relations comme le souligne
Genette dans Figures III (1972 :146) :
« Très schématiquement, on peut
dire qu'un récit, quel qu'il soit, peut raconter une fois ce qui s'est
passé une fois, n fois ce qui s'est passé n fois, n fois ce qui
s'est passé une fois, une fois ce qui s'est passé n
fois. »
On distingue ainsi, troisrelations possibles respectivement
à la définition de Genette dans figures III :
- le mode singulatif : le narrateur raconte une fois
ce qui s'est passé une fois (ou n fois ce qui s'est passé n
fois). Typique du récit d'action. (tR=1; tH=1)
- le mode répétitif consiste à
raconter plusieurs fois ce qui s'est passé une fois.
Typique du roman épistolaire du XVIIIe (pour montrer
les différences psychologiques), ou de nombreux romans contemporains
(pour relativiser la vérité des choses). (tR=n; tH=1).
- le mode itératifconsiste à raconter
une fois ce qui s'est passé plusieurs fois. Il évoque l'habitude
et la monotonie. Le mode itératif en est exprimé en
général à l'imparfait. (tR=1; tH=n).
CONCLUSION PARTIELLE
L'analyse de cette partie qui est l'approche conceptuelle,
nous a permis d'une part de clarifier les termes qui entretiennent des
relations avec la temporalité narrative. On a ainsi abordé la
notion de temps où on a élucidé les différents
types de temps puis les temps verbaux dans l'univers romanesque. D'autre part
l'analyse a permis de voir les mouvements temporels possibles dans un roman.
Tous ces éléments vus dans ce chapitre permettront de bien
appréhender la temporalité narrative qui constitue l'objet de
notre étude dans le Crime Parfait d'Adama Amadé
SIGUIRÉ.
CHAPITRE II. PRÉSENTATION ET ANALYSE DU CORPUS
D'ÉTUDE
Avant d'aborder le travail proprement dit de notre recherche,
nous avons jugé utile au premier abord de dire en quelques lignes qui
est Adama Amadé SIGUIRÉ, quelles sont
ses productions sur la scène littéraire. Ensuite, nous
procéderons à la présentation du corpus d'analyse. Ce
second point nous permettra de présenter les personnages du corpus et
d'achever par un résumé. Enfin, ce chapitre sera clos par
l'analyse du corpus qui est d''ailleurs la principale de toutes les parties.
I. Présentation de
l'auteur et de l'oeuvre
Cette partie sera consacrée à la
présentation de l'auteur et sonoeuvre.
I.1 Présentation de
l'auteur
Nous aborderons la biographie de l'auteur, ses principes et
procédés stylistiques et narratifs.
I.1.1 Biographie et
bibliographie
Notre corpus pour l'élaboration de cette étude
est, stricto sensu, le roman le crime parfait d'Adama
Amadé SIGUIRE édité par les éditions Déclic
en 2015.
En effet, Adama Amadé SIGUIRE, écrivain
professionnel, professeur certifiéet conférencier sur les
thèmes relatifs à la lecture, aux principes de relations humaines
et à l'éducation, est né le 31/12/1981 à Silga dans
le Yatenga. Il a marqué la littérature burkinabé et
africaine par ses six romans et ses quatre essais :
v Les romans
- La folie de l'adolescence,Ouagadougou,
Céprodif, 2012 ;
- Le Triomphe de
l'amour,Ouagadougou,Céprodif, 2013 ;
- Le Crime Parfait, Paris, Déclic,
2015 ;
- Le Procès de l'amour, lesÉditions la
République, 2017 ;
- Heureuse victime de l'amour, lesÉditions la
République, 2017 ;
- Épitres aux épigones ou leçons de
vie,les Éditions la République,2017 ;
v Les essais
- Blaise Compaoré, le règne d'un ange :
paroles d'un insurgé, Paris, Déclic, 2016 ;
- Burkina Faso, de la transition à la
trahison : L'analyse d'un résident,Paris, Déclic,
2016 ;
- Yacouba Sawadogo, de la terre rouge du Zaï au tapis
rouge de Stockholm, le parcours d'un combattant, les Éditions la
République, 2019 ;
- Thomas Sankara, le messie de l'Afrique ou le
repère d'une génération, les Éditions la
République, 2020.
I.1.2 Principes
esthétiques de l'auteur
Adama Amadé SIGUIRÉa défini ses
conceptions de l'art narratif en particulier dans
la Préface du roman. Pour lui, « l'homme a
du génie et de l'imagination. Entre le burlesque du 17e
siècle et le réalisme du 19e siècle jugé
immoral », il trouve le juste milieu. C'est dans un style
fantastique et moqueur et avec des mots ramassés dans les poubelles de
l'histoire, que le jeune écrivain relate les péripéties
d'un pouvoir en manque de souffle. Pour lui, le romancier doit tout mettre en
oeuvre pour produire l'effet qu'il poursuit c'est-à-dire
l'émotion de la simple réalité, et pour dégager
l'enseignement artistique qu'il veut tirer, c'est-à-dire la
révélation de ce qu'est véritablement l'homme contemporain
à ses yeux. Car dit-on que « les grands artistes sont
ceux qui imposent à l'humanité leurs illusions
particulières ». De l'écriture artiste,
SIGUIRÉ adhère à l'idéal
d'un « roman objectif » à la
recherche du réalisme Ainsi, il cite Émile Zola (1980-1902) en
ces terme : « J'ai pris dans la vie réelle tous les
faits qu'elle contient ; j'ai choisi çà et là des
documents nécessaires. J'ai rassemblé en une seule histoire,
vingt histoires de sources différentes ; j'ai donné à
un personnage les traits de plusieurs individus. Ainsi, j'ai écrit un
roman où tout est vrai, où tout a été
observé d'après nature ». (P, 4) Dans ce sens, le
réalisme est une vision personnelle du monde qu'il (le romancier)
cherche à nous communiquer en la reproduisant dans un livre et pour
ce faire le romancier effectue, à partir de sa personnalité, un
choix dans le réel. « La profession d'écrivain est
la seule qui est vraiment comptable avec les inspirations et les aspirations de
notre existence », déclare-t-il. (p, 4)
I.1.3 Procédés
stylistiques et narratifs
L'art de SIGUIRÉ est fait d'équilibre entre le
récit des péripéties, les descriptions limitées et
fonctionnelles, et le jeu entre discours direct/ discours
indirect / discours indirect libre. Il est aussi marqué par
l'utilisation de phrases plutôt courtes avec une ponctuation expressive
et de paragraphes, qui donnent une mise en page aérée. La langue,
quant à elle, est soutenue dans le récit et dynamique dans le
discours direct, recherchant même le pittoresque en transcrivant les
paroles d'emprunt dans les langues locales.
À titre d'illustration, l'extrait du discours d'un
élève lors de la tentative d'enlèvement du corps de
Juliette pour la morgue évoque ces emprunts.
« C'est l'hôpital du `' babiè'', du
`' fafôrô'', du `' mayindga'' et du makindé'' »
(p,34)
I.2 Présentation de
l'oeuvre.
Nous présenterons l'ouvre en le résumant pour
une meilleure compréhension du contenu.
I. 2.1 Résumé de
l'oeuvre
Le Crime Parfait, d'Adama Amadé
SIGUIRÉ provient d'une ferme volonté qui touche non seulement le
sens mais aussi la raison. Ilrelate l'histoire d'un peuple, le Bantou qui est
une république bananière et prétendument
démocratique aux milles vices et à la moindre vertu située
au Nord de la république du Zandem dans le continent Afronègre.
Cette République n'existe nullement sur aucune carte dans ce monde, mais
plusieurs pays de ce monde surtout en Afrique pourraient porter ce nom de
Bantou.
« D'ailleurs où se trouve la
république de Bantou ? [...] La république du Bantou,
voilà une donc une république fictive qui ressemble à bon
nombre de républiques en Afrique. Et les Bantoutois, ce serait[...] son
lecteur qui se plaint de l'absurdité de la vie, ce seraient ces millions
d'inconnus en Afrique qui souffrent de la misère et finissent par mourir
du paludisme, du choléra, ou de la tuberculose. La Bantoutoise, ce
serait la tente de l'écrivain qui n'arrive pas à se soigner au
dispensaire du village. Ce serait cette fille qui a contracté une
grossesse en classe de sixième alors qu'elle n'avait que treize ans. Ce
serait cette femme à la cuisse légère qui est à
l'assemblée Nationale non par mérite, mais parce qu'elle a
plusieurs fois détaché illicitement son pagne qu'elle ne prend
jamais soin de bien nouer » (p, 10)
C'est dans cette république qui sent la
démocratie et en souffre au même moment qu'une jeune fille de
vingt ans a été assassinée une nuit devant l'entrée
principale du lycée national jules Ferry. Juliette Kabèga livrait
ses seins, son sexe et ses fesses au ministre de la Famille et du
Bienêtre Social de la république du Bantou. Mais le commanditaire
du crime est loin d'être la personne qui a été
inculpée, jugée et emprisonnée à vie. C'est
après six longues années que le visage du criminel a
été démasqué. Le crime parfait est donc
organisé en quatre grandes parties.
La première partie, qui comporte troischapitres, traite
de l'assassinat de la jeune fille Juliette, qui a conduit à
l'arrestation et à la condamnation du ministre de la Famille et du
Bienêtre social. La deuxième partie structurée en deux
chapitres, traite de la fin du système, du tripatouillage
constitutionnel et de l'organisation des élections
présidentielles. Quant à la troisième et dernière
partie, elle contient deux chapitres qui relatentles dessous du crime et du
jugement qui a conduit à l'arrestation du vrai commanditaire et à
la libération d'Abdoul Kader Zampou.
II. ANALYSE DU
CORPUS
Cette analyse va nous conduire dans le vif de
notre thème d'étude. Pour ce faire nous avons structuré ce
grand point en deux axes dont le premier consacre l'étude temporelle et
le deuxième l'étude des mouvements temporels.
II.1 Étudetemporelle
Dans le roman Le Crime Parfait, nous nous rendons
compte que le temps se manifeste à travers moult indicateurs temporels
et des temps verbaux dont nous ferons mention.
II.1.1 la manifestation du temps
dans le roman
L'usage spécifique qu'en fait l'auteur de son temps lui
permet d'inscrire son roman dans une telle ou telle orientation. Ainsi, dans le
crime parfait, le temps se manifeste sous plusieurs aspects.
II.1.1.1 Les indicateurs
temporels
Dans le crime parfait, on relève plusieurs
indicateurs temporels qui permettent de situer les évènements sur
une ligne du temps. Ils sont de plusieurs sortes. Nous pouvons
retenir :
ü Les expressions déictiques
Nous avons relevé plusieurs expressions parmi
lesquelles nous retiendrons :
« Maintenant, les choses ont
changé dans la république du Bantou. » (p, 141)
« Maintenant, le régime
dictatorial du président Zami Zama a pris fin. » (p,
144)
« Aujourd'hui il est connu
partout ». (p, 147)
« Je t'enverrai demain à
la maison d'arrêt et de correction pour que tu rendes visite à
Papa. » (p, 152)
Ces expressions ne livrent leur référent que par
le biais d'un renvoi aux paramètres de la situation
d'énonciation.
ü Les expressions
anaphoriques
Plus de vingt-sept expressions de types anaphoriques ont
été répertoriées. Celles-ci prennent pour
repère un point du temps fixé au préalable dans le texte
ou dans l'énoncé. En d'autres termes, elles reprennent un autre
énoncé antérieurement. Nous avons :
« Je l'ai trouvé très belle
ce jour-là » (p, 73)
« Ce jour-là, le jeune
officier s'est longuement entretenu avec Julienne, la femme de son
oncle » (p, 154)
« Cela fait déjà
cinq ans que le professeur Abdoul-Kader Zampou croupit à la maison
d'arrêt et de correction de Jouvantou. » (p, 83)
« J'ai beaucoup pleuré ce
jour-là. » (p,
145)
« Lelendemain matin, à huit
heures, la télévision et la radio d'Etat retransmettent en direct
la proclamation des résultats depuis le siège du conseil
constitutionnel. » (p, 132)
ü Les dates ou événements
historiques notoires
Ces dates où évènements historiques sont
légion dans le Crime Parfait et proposent un ancrage
chronologique absolu, à l'inverse des indicateurs
précédents, qui sont relatifs à un repère.
Nous avons les exemples suivants :
« Elle est domiciliée au secteur 48 de la
ville de Jouvantou. Les deux inculpés connaissent les mêmes chefs
d'accusation : Complicité de meurtre, tentative d'assassinat, et
assassinat de Juliette Kabèga le 13 avril
20... » (p, 168)
« Il est vingt heures. Trois
coups de feu viennent de retentir à l'entrée principale du
lycée national Jules Ferry de Jouvantou. » (p, 13)
« Il est presque vingt-deux
heures. Le directeur général de l'enseignement
secondaire vient de se mettre au lit. Sa journée a été
laborieuse. » (p, 16)
II.1.1.2 Usage narratif des
temps verbaux
Dans cette partie, il sera question d'analyser les temps
verbaux employés dans le roman.
a- Le procès
Les procès sont visibles dans le roman.
« Il (Abdoul-Hamid) a
enquêté sur les circonstances du crime. »
(p, 144)
Dans la phrase ci-dessus, c'est l'association du pronom
« il » renvoyant à Abdoul-Hamid et
du verbe « a enquêté » qui
forme, donc, le procès parce que le verbe, dans ce cas, exprime une
action. (Enquêter) effectuée par le
sujet (Abdoul-Hamid) dans un temps
désigné par l'auxiliaire avoir (a)
conjugué au présent accompagné du participe passé
indiquant le passé composé et dans un espace (ici
dans la république du Bantou).
b. Le prédicat
Pour des descriptions, l'auteur construit des phrases avec des
prédicats.
« C'est sur les cendres d'un pouvoir dictatorial
que le président Zaki Zaka fera pousser difficilement les plants verts
de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est donc sous un ciel
dégagé que s'installe un président élu par le
peuple au suffrage universel. » (p, 136)
Dans ce passage, on décrit la fin du régime
dictatorial en l'instant t + n du président Zami Zama et
l'avènement d'une nouvelle ère de souffle de la démocratie
dans la République du Bantou.
c. L'opposition aspectuelle
entre l'imparfait et le passé simple
Plusieurs cas d'opposition concernant l'imparfait et le
passé simple ont été repéré. À la
page 14 : « Elle se destinait à des
études de droit et rêvait de vêtir la toge
de magistrat ou de l'avocat. Le gardien dit aux
élèves. »
Plus loin à la page 53:« Elle
faisait la classe de troisième. Il (Éric)
était élève en classe de terminale.
Éricétait élève brillant. Il
décrocha son baccalauréat la même
année et entra à
l'université. »
Dans ces deux passages (pp, 14-53), les procès
(se destinait, rêvait, faisait, était)
sontimperfectifs car ils sont présentés de l'intérieur,
dans leurs déroulements. Leurs durées sont inaccomplies, mais ils
sont en cours. Tout au contraire, (dit, décrocha,
entra) sont des procès perfectifs, limitatifs, parce
qu'ils sont saisis de l'extérieur, dans leur globalité, leur
totalité. Leur déroulement est achevé et accompli.
d. La mise en relief
Plusieurs cas de mise en relief à travers l'opposition
du passé simple et de l'imparfait ont été relevés.
Nous avons retenu quelques passages illustratifs :
« Ce fut un coup de foudre le
premier jour qu'ils s'étaient rencontrés.
C'était lors d'une Kermesse organisée par les
élèves du lycée. » (p, 53)
Dans le passage ci-dessus, l'usage du passé simple ne
s'est pas fait d'une manière hasardeuse et aléatoire, mais au
contraire son usage est évident et assuré dans la mesure
où il met en exergue les circonstances dans lesquelles les deux
époux se sont connus.
Par contre, dans les exemples ci-après le point sera
mis non pas sur les actions du personnage mais plutôt sur l'ossature de
ces actions, autrement dit il est question ici de faire montrer la trame
narrative ou l'arrière-plan de ces événements en question
:
« Les conseillers politiques avaient dit que
cette limitation des mandats serait sans effet sur le règne de Zami
Zama. La limitation de mandat répondait à la
circonstance et permettait aux petits diplômés de
continuer à rêvasser pendant que Zami Zama jouissait du
pouvoir. » (p, 86)
« Jecroyais que ce métier
était noble, je croyais qu'il exigeait
une intelligence au-dessus de la bêtise, je me trompais
énormément.
En effet, dans ce passage, l'imparfait laisse montrer la toile
de fond des péripéties, le tissu principal dans lequel
s'élaborent les actions des personnages, donnant ainsi un
arrière-plan à l'histoire romanesque.
e. L'imparfait de
rupture
L'imparfait de rupture est manifeste dans le roman. Nous
avons retenu quelques emplois :
« Trois jours après
l'assassinat de Juliette, il m'a dit que Juliette était
à la banque deux jours avant l'assassinat. » (p,167)
« Les policiers de la compagnie
républicaine de sécurité tuent trois prétendus
voleurs. Titraient certains journaux. » (p,
40).
« Trois paisibles citoyens abattus par les
éléments de l'officier de police Paul Zalo.
Titraient d'autres journaux. Paul a failli pleurer quand il
avait lu les journaux qui avaient relaté les faits. » (p.
40)
f. L'imparfait
itératif
Plusieurs occurrences de l'aspect itératif sont
contenues dans le roman. L'auteur présente la répétition
d'un procès dans le passé comme dans les cas suivants :
« Éricse rendait souvent
dans la famille de la jeune fille » (p. 62)
« Juliette vendait ainsi son
charme au ministre à prix d'or. Elle lui livrait son
sexe, ses seins et tout le reste de son corps. Ce même sexe et ces
mêmes seins étaient offerts à Éric de temps en
temps ». (p.59)
« C'était lui qui leur
donnait de l'argent pour battre la campagne électorale.
Quand ces soi-disant opposants perdaient les élections
présidentielles, Zami Zama les nommait à des
postes ministériels. Il envoyait certains à
l'assemblée nationale. » (p. 109)
« Il y a de cela dix ans, instituteur, un
infirmier ou un professeur pouvait se payer deux bouteilles de
bière au moins chaque semaine. »
Les procès ont chacun plusieurs occurrences. Cette
valeur itérative ne repose pas seulement sur le procès
(se rendait, vendait, livrait, donnait, perdait, nommait, envoyait,
pouvait), mais aussi sur des termes qui indique
letemps(souvent, de temps en temps, quand, Il y a cela dix ans)
qui corroborent le caractère itératif du
procès.
g. Usage narratif du
passé composé
Dans cette partie, nous allons analyser l'usage du
passé composé dans le roman en trois points. Il s'agit :
« C'est sur elle qu'on a
tiré » (p,14)
« Je l'ai vu prendre sa
moto. » (p, 14)
« C'est Juliette, ils l'ont
tué » (p, 14)
« Ceux qui t'ont
assassiné sont des lâches. » (p, 15)
« Le général a
retrouvé sa lucidité » (p, 16)
« Beaucoup de faits m'ont
étonné depuis le début des
évènements, dit le capitaine de la gendarmerie » (p,
167).
Le passé composé a été
utilisé moult fois par l'auteur dans ce roman sous une autre forme qui
montre que l'action est antérieure au moment du récit. On pourra
retenir quelques-uns pour l'analyse.
« Elle lui a donné quatre
enfants » (p, 16)
« Iln'a pas voulu
s'essayer » (p, 20)
Il a passé quinze années
à les transmettre aux jeunes » (p, 20
« Ila opté être
éducateur alors qu'il n'avait que vingt-cinq ans » (p,
20)
« J'ai été
condamné pour un crime que je n'avais pas commis. J'ai
fait six années en prison » (p, 169)
Ici l'auteur présente dans le récit des
procès qui sont antérieurs à la période où
l'on parle. On note une insistance sur la valeur temporelle
d'antériorité.
L'opposition de l'accompli et du non accompli
est manifestée dans le roman par l'opposition des formes
composées et des formes simples. Il existe, pour chaque forme simple
d'un verbe, une forme composée, qui allie un auxiliaire et un participe
passé.
h. Le
présent
L'étude du présent se fera en plusieurs parties
selon la forme employée. Ainsi, nous avons relevé dans le corpus
d'étude :
h.1 Le présent
d'énonciation
L'auteur emploie le présent d'énonciation ou
présent d'actualité pour présenter les faits qui se
déroulent ou qui sont valables au moment où on exprime. On peut
relever des cas dans le roman :
« Toutes les salles se vident,
c'est le mois d'avril » (p, 13)
« Le proviseur est surpris de
cette réaction » (p, 16)
« Le soleil se lève ce
matin dans la ville de Jouvantou » (p, 48)
Ce présent peut être aussi assimilé
à des scènes de dialogue entre les personnages. Ce qui le
traduit, c'est le temps de discours :
- Comment vas-tu mon
capitaine ?
- Je vais bien maitre
Zampou.
- Alors, tu viens chez moi sans
me prévenir. Tu sais que les juges et les avocats ne
sont pas de bons amis. Et toi, tu es aussi un gendarme. Moi,
je meméfie des gendarmes.
- Et pourtant, les juges et les avocats
sont les produits d'une même faculté de
droit.
- Tu sais mon capitaine [...], nos
points de vue diffèrent souvent » (p,
164)
Est rapportée dans ce passage de la page 164, une
scène de dialogue entre le jeune officier Abdoul Hamid qui
enquête sur la mort de Juliette et sa cousine Safoura, jeune avocate et
fille d'Abdoul Kader Zampou. Donc c'est un discours dans lequel un Je
s'adresse à un Tu, hic et nunc qui permet ainsi d'ancrer
cet énoncé dans la situation d'énonciation.
h.2 Le présent du
passé récent
Plusieurs cas d'usage ont été constatés
dans le roman.
« Il est presque vingt-deux
heures, le directeur général vient de se mettre
au lit » (p, 16)
« C'est le proviseur du lycéeJules Ferry
qui vient de m'appeler » (p, 17)
« Cela fait déjà trois jours que
la république de Jouvantou est
paralysée » (p, 18)
« La jeune avocate vient de quitter
son cabinet. » (p, 163)
Dans ces passages avecl'emploi formé du verbe
« venir » conjugue au présent +
« de » + le verbe à
l'infinitif, l'auteur annonce des évènements ou des
actions qui ne sont pas en cours mais qui viennent de se produire au moment
où l'on parle.
h.3Le présent du
futur proche
Ce temps est employé par l'auteur pour traduire des
actions qui vont se produire dans un futur proche. Ces actions ne se sont pas
encore produites, mais elles se produiront selon le plan du récit. Comme
le cas des phrases suivantes :
« La situation va se
compliquer » (p, 17)
« Un pouvoir vieux de trente-sept ans
va prendre définitivement fin au grand bonheur de tout
un peuple. » (p, 126)
h.4Le présent
gnomique
Dans le roman, on retrouve des phrases au présents qui
expriment des vérités morales, des faits généraux
d'expériences, des maximes. Comme:
« Le soleil se lève ce matin
sur la ville de Jouvantou. » (p, 48)
Dans ce passage, c'est une vérité
générale que le soleil se lève tous les matins pas
seulement sur Jouvantou mais dans toutes les localités.
Plus loin encore aux pages 98 et 170, on a :
« La victoire appartient au peuple
libre et déterminé » (p, 170)
« Le changement est la nature
de la démocratie tout comme la métamorphose est la nature des
êtres vivants. » (p, 98)
Ici, on peut dire que le fait est toujours valable pour tout
peuple, déterminé à remporter la victoire et à
garantir sa liberté.
h.5 Le présent de
narration
On relève dans le roman de nombreux présents
insistant sur la mise en mouvement inaugurant un segment narratif important,
tels que :
« Il est vingt-deux heures, trois coups de feu
viennent de retentir à l'entrée principale du lycée Jules
Ferry de Jouvantou, la capitale démocratique du Bantou. La femme du
gardien fait un saut brusque. Elle repousse la main de son mari qui est sur son
dos. L'étreinte s'arrête là. La femme parle à son
mari. »
Dans cetincipit, le temps dominant, celui qui donnera
le ton à la suite du récit est le présent. Le récit
est conduit au présent et à la troisième personne. Ce qui
estplus étrange, du moins pour un lecteur habitué aux
récits traditionnels: il a la sensation que l'énonciation
narrative est presque parfaitement contemporaine des événements
narrés. Ainsi, l'incipit, avec sa syntaxe
démantelée, semble le fait d'un narrateur soucieux de restituer
au plus justel'immédiateté du vécu.
Considérons également ces passages:
« Le directeur général de
l'enseignement secondaire descend de sa voiture. Il se
dirige calmement vers le groupe d'élèves. Il est
vraiment décidé. Les élèves
peuvent le tuer cette nuit pour se venger s'ils le
désirent. Il ne va pas
reculer. » (p, 20)
« Un autre commandant est nommé à
la tête de la police criminelle. Il promet au ministre
de trouver l'assassin de Juliette en soixante-douze heures. Il se
met au travail. » (p, 78)
Dans ces deux passages, on peut voir nettement la
précellence du présent sur les autres temps de
référence du récit à savoir l'imparfait, le
passé simple et le passé composé. C'est une technique
qui, utilisée dans les constructions romanesques, tend à abolir
la distance temporelle entre le moment de la narration et le moment de
l'histoire racontée. C'est d'ailleurs ce temps qui prédomine dans
le crime parfait.
II.2 LESMOUVEMENTS TEMPORELLES DANS
LE ROMAN
Pour mesurer ces variations de rythme (ou
anisochronies), l'auteur du crime parfait a utilisé
ces quatre formes canoniques : la scène, le
sommaire, la pause et l'ellipse.
II.2.1 La scène
Des scènes, le crime parfait en abonde. Nous
avons ce monologue tenu par le commissaire dans son bureau.
« Quelle République
démocratique ! [...]. On m'ordonne de trouver des preuves dans
soixante-douze heures pour prouver la responsabilité, sinon la
culpabilité d'un ministre dans un crime. Ces preuves, on me demande de
les inventer de toutes pièces. J'en ai déjà fait. C'est
d'ailleurs pour agir ainsi qu'ils m'ont nommé à ce poste
stratégique. Mais pour cette fois-ci, je n'en peux plus. Que Dieu me
pardonne ! Je leur donne ma tête. Qu'ils en usent comme bon leur
semble ». (p, 69)
Le crime parfait déploie également
plusieurs séquences dialogiques entre les personnages.
- Bonjour monsieur le ministre.
- Bonjour monsieur le commissaire. Mais souffrez que je
vous dise que je ne suis plus ministre.
- Mais tout de même professeur, un ministre garde
toujours son titre honorifique, même s'il n'est plus au
gouvernement.
- Vous vous êtes un bon littéraire mon
commissaire. Vous avez bien retenu vos leçons en grammaire.
- Effectivement, monsieur le ministre je suis venu pour
poursuivre l'enquête sur l'assassinat de Juliette Kabèga.
[...](p, 73)
Dans ce passage, la conversation se fait entre le commissaire
chargé de l'enquête sur l'assassinat et le ministre Abdoul Kader
Zampou afin de situer la responsabilité du ministre dans le crime.
On relève aussi, ce passage qui traduit la scène
de conversation entre le professeur Zaki Zaka avec le président du
bureau de vote.
- « Soyez le bienvenu, mon
professeur. »
- « Merci beaucoup
Flaubert. »(p.120)
On peut également relever le dialogue entre le jeune
capitaine Abdoul Hamid Zampou et sa cousine Safoura, la fille du ministre
Abdoul Kader Zampou.
- Comment vas-tu, mon capitaine ?
- Je vais bien, maître Zampou.
- Alors tu viens chez moi sans prévenir. Tu sais
bien que les juges et les avocats ne sont pas de bons amis.
- Et pourtant les juges et les avocats sont les produits
des mêmes facultés de droit.
- Tu sais, mon capitaine, nos points de vue
diffèrent souvent.
- Tu sais ma soeur, je ne suis pas venu pour te faire
rire. Peut-être le contraire. [...] (p, 164).
Dans ces scènes, l'auteur fait parler des personnages.
Ce qui donne l'illusion que le temps de l'histoire reproduit le temps du
récit.
Donc ces scènes narratives mettant sur pied
d'égalité récit et histoire, donnent à penser une
certaine immédiateté des faits, autrement dit le lecteur sent
qu'il y a un certain synchronisme entre les actions étalées et le
moment de leurs narrations.
Dans d'autres scènes, l'auteur raconte en détail
l'action qui se déroule. On peut relever :
« Je suis content de vous souhaiter la
bienvenue, dit-il aux journalistes. Nous tenons à vous informer notre
position par rapport à la situation nationale. Zami Zama est à la
fin de son mandat. Il doit partir. C'est la constitution et la
démocratie qui exigent son départ. C'est la volonté des
enseignants, des infirmiers, des journalistes, des magistrats, des agents des
impôts.» (p, 98)
Ici l'auteur marque une pause pour donner des détails
sur le contenu du discours du leader politique de l'opposition Zaki Zaka
pendant la campagne électorale.
II.2.2 La pause
Dans le passage suivant, l'auteur marque une pause pour faire
intervenir un élève qui s'adresse à l'officier Paul Zalo
pour décrire l'hôpital national Zami Zama :
« Enlever son corps pour l'envoyer dans la
morgue de quel hôpital ? Dites-le-nous ! Là-bas c'est la
merde. C'est le désordre. C'est un bordel. C'est un dépotoir. Les
corps ne sont pas gardés. On les vole même souvent. »
(p, 34)
Quelques lignes après, il ajoute (p, 34) :
« Nous avons appris que là-bas, pour voir
un médecin généraliste le patient débourse quinze
mille francs et si le médecin est spécialiste, le même
patient débourse vingt-cinq mille francs [...] C'est l'hôpital de
la république pourrie. C'est l'hôpital du gaspillage, de la
décadence morale, c'est l'hôpital du `' babiè'', du `'
fafôrô'', du `' mayindga'' et du makindé''
[...] »
Dans ces passages, l'auteur marque une pause pour
décrire l'état de l'hôpital dans lequel le corps de
Juliette sera apporté.
Observons également ce passage:
« Edouard Zampou repartira à
l'université retrouver sa chaire de professeur en linguistique
appliquée. Ça sera une belle leçon pour lui. Il sera
hué par les étudiants dans les amphithéâtres
surchauffés. Ils l'insulteront et se moqueront de lui. Il donnera cours
à plus de mille étudiants qui ne l'écouteront d'ailleurs
même pas et se moqueront de sa présence. [...] Il pourra se
contenter des pauvres étudiantes en linguistique et en lettre moderne.
Elles, elles exigent le minimum. Elles veulent seulement des notes de
complaisance qui leur permettront de ne pas faire les sessions de rattrapage
qu'elles trouvent fatigantes. Aussi, veulent-elles quelques sommes d'argent qui
leur permettront de payer leurs tickets au restaurant universitaire. Et les
notes de complaisance et l'argent des tickets de restauration, un professeur
titulaire peut leur offrir cela. » (p, 58)
Dans ces passages, le fil d'actions est brisé laissant
ainsi place à des descriptions jouant le rôle de pauses narratives
qui donnent un cadre général au tissu événementiel
du roman.Autrement dit on sent que rien ne se passe au niveau de l'histoire
générale du roman.
II.2.3 Le sommaire.
Le roman Le Crime Parfait détient bien de
sommaires où les actions sont réduites en des simples
résumés révélant la substantifique moelle de
l'événement romanesque comme :
Le procès a eu lieu.(p, 78)
Cette phrase résume tout le procès. Un
procès en temps normal dure plusieurs jours. Pourtant ici le temps qu'a
duré le procès a été condensé en une seule
phrase.
« C'est un long procès.
Débuté à huit heures, il a pris fin à quatorze
heures ce jour-là. »(p, 78)
Considérons également ce qui suit :
« Pendant trente-sept ans Zami Zama a tout
donné aux fonctionnaires de la république du Bantou. Il a
payé les salaires et leurs indemnités, il leurs a donné
des voitures. Il les a laissés piller les ressources de la
république. Ils ont volé et détourné les deniers
publiques pour construire des villas, acheter des voitures, entretenir leurs
nombreuses maitresses. » (p, 88)
Ainsi, les actions de Zami Zama pendant trente-sept ans de
règne, sont résumées en quelques lignes.
« Ainsi, la loi est votée ».
(p, 98)
Ces cinq mots résument tout le processus et la
durée du vote de la loi sans détails.
Tous ces exemples sont considérés comme des
sommaires par le fait qu'ils condensent l'information et résument les
actions sans rentrer dans les détails minutieux ; des sommaires qui
donnent l'allure d'une histoire un peu accélérée.
II.1.4 L'ellipse.
Dans le crime parfait, des phrases comme :
« Quelques années après son
arrivée au pouvoir, il a peint son pouvoir en or en utilisant la
démocratie comme pinceau » (p, 46)
« Cela fait déjà trois jours que
la république de bantou est paralysée. » (p,
53)
« Cela fait déjà cinq ans que le
professeur Abdoul Kader Zampou croupit en prison à la maison
d'arrêt et de correction de Jouventou. » (p, 83)
« Cela fait plus de deux semaines que Juliette
Kabèga, élève en classe de terminale lettres et
philosophie au lycée nationale Jules Ferry de Jouventou, a
été assassinée. »(p,73)
« Cela fait déjà dix jours que la
campagne électorale est lancée dans le pays. »
(p, 108)
« Soixante-douze heures se sont
déjà écoulées depuis la fermeture des bureaux de
vote. » (p, 128)
« Cela fait six ans que Abdoul Kader Zampou
mène clandestinement ses enquêtes sur les circonstances de
l'assassinat de Juliette Kabèga. » (p, 143)
Sont des ellipses manifestes, puisque le narrateur passe sous
silence des actions et événements dans le récit alors
qu'ils ont eu lieu dans l'histoire.
1 Gérard Genette, (1972). « Discours du
récit », in Figures III. Paris: Seuil, p. 78.
II.2. La
récursivité dans le roman(la fréquence)
Grosso modo, le récit dans le roman Crime
Parfait, considéré soit globalement ou en prenant
séparément les histoires racontées à savoir celle
de l'assassinat et celles concernant le tripatouillage de la constitution et de
l'organisation des élections, raconte une fois ce qui s'est passé
une fois : c'est un récit singulatif. Dans tous les
cas, le narrateur ne fait que raconter et suivre le cours des
péripéties particulières sans y revenir.
III. L'ORDRE TEMPORELLE DU `'LE CRIME PARFAIT `'
Dans cette partie, nous allons analyser les prolepses, les
analepses les distorsions temporelles dans le roman.
III.1Les Analepses
Sous quelle manière, les analepses se manifestent-elles
dans le romanLe Crime Parfait ?
Le crime parfait s'ouvre sur la mort d'une jeune
fille assassinée devant le lycée de la république Bantou.
Il faut attendre la fin du règne du président dictateur, et
l'instauration de la démocratie par le nouveau président, pour
découvrir les antécédents de cette scène initiale
mouvementée. Le début in mediasresest suivi de retour en
arrière (ou analepse) à fonction explicative.
« Juliette vendait ainsi son charme au ministre
à prix d'or. Elle lui livrait son sexe, ses seins et tout le reste de
son corps. Ce même sexe et ces mêmes seins étaient offerts
à Éric de temps en temps. »(p, 59)
En l'occurrence, cette analepse est complète :
elle restitue, ab ovo, la relation entre l'assassinée et les
présumé accusés. Laquelle relation qui fait ipso facto
soupçonner les deux prétendus amants.
D'un point de vue fonctionnel, on peut ajouter que l'analepse
évoquée à l'instant est complétive; elle
permet de récupérer une information manquante.
Il en va de même lorsqu'au moment d'introduire un
nouveau personnage (ou de retrouver un personnage perdu de vue), le
récit propose un résumé de sa biographie.
C'est ainsi que l'auteur revient sur le directeur de
l'enseignement secondaire avec ces détails :
« C'est en toute âme et conscience qu'il a
déposé ses valises à l'école Normale
Supérieure. Deux années plus tard, il sortait de cette
école après son succès au Certificat d'Aptitude
Professionnelle à l'Enseignement Secondaire, Option philosophie. Il est
affecté au lycée Jules ferry. Il a donc choisi d'être
éducateur [...] » (p, 20)
Aussi, pour parler du jeune officier qui a eu la charge
d'enlever le corps de la jeune fille à la morgue, l'auteur est revenu
sur son portrait.
« L'officier Paul Zalo est un jeune
Garçon très intelligent. Il a beaucoup appris. Il a lu beaucoup
de livres. Il connait l'étymologie du mot police. » (p,
27)
Dans le crime parfait,le narrateur fait un brusque
retour en arrière pour nous dresser une image d'Abdoul-Kader Zampou, le
ministre incarcéré pour l'assassinat de Juliette.
« Abdoul Kader Zampou était un politicien
pragmatique. Il est intelligent. Il proposait des solutions fiables. C'est
à vingt-six ans qu'il a soutenu une thèse de doctorat
d'État à l'université de Jouventou. Il est
élevé au grade de docteur en droit avec mention très
honorable et les félicitations des membres du jury. »(p,
140)
Il y aaussi ce retour en arrière pour parler du
ministre Abdou Kader Zampou qui avait déjà fait six mois en
prison.
« C'est dans une cellule de quatre mètres
carrés qu'il a appris la fin du régime de Zami Zama. Ce
régime pour lequel il a travaillé pendant plus d'une
décennie. Il s'est engagé tôt dans la politique. Il fut
recruté professeur d'université alors qu'il n'avait que
vingt-huit ans. Il a fréquenté des amphithéâtres de
Jouvantou pendant cinq ans avant d'être nomméconseiller politique
du président Zami Zama. Trois années plus tard il est
nommé ministre de la justice. »(p, 140)
Dans le crime parfait, l'auteur revient
également en arrière pour raconter une scène qui eut lieu
entre le ministre Abdoul Kader et son épouse.
Un jour, las de supporter les accusations de son
épouse, le Ministre chargé du bienêtre social avait eu ce
courage de lui dire :
« Tu sais Julienne, je t'aime beaucoup. Cela
fait vingt ans que tu es mon épouse. Souviens-toi de notre
première rencontre. C'était lors d'une conférence sur le
leadership animée par un jeune écrivain très dynamique et
pragmatique. » [...]Le ministre avait dit toute la
vérité à son épouse.(p, 147)
En définitive, toute l'ossature de cette histoire est
érigée d'un va-et-vient (enchaînement alterné) entre
le récit et les portraits des personnages. À chaque fois qu'on
évoque un personnage, on y revient sur son portrait.
III.2La prolepse
Des cas d'anticipation ont été relevés
dans le Crime Parfait. Considérons les passages suivants:
« Il prendra trois jours pour chercher les
preuves de la culpabilité du ministre. Il ne fera que son travail. Et
ces preuves s'il les trouve, il fera un rapport circonstancié au
ministre de l'intérieur. S'il ne les trouve pas, il lui fera parvenir
son rapport dans lequel il mentionnera : « résultat
de l'enquête infructueux. Nous continuons nos investigations ».
Le conseil des ministres le limogera ».(p, 70)
« Un pouvoir vieux de vingt-sept ans va prendre
définitivement fin au grand bonheur de tout un peuple. Ce sera la fin du
césarisme et de la république bananière. Le peuple se
réveillera et exigera des comptes à ceux qui ont plongé le
pays dans le marasme économique pendant près de quatre
décennies. Le peuple leur demandera de quel droit ils ont scellé
l'avenir d'une nation pendant trente-sept ans. »(p, 126)
Dans ces passages, le narrateur annonceà l'avance les
évènements ultérieurs. Ainsi, dans Le crime
parfait, la fin du régime du président dictateur Zami Zama
est annoncée dès la troisième page du deuxième
chapitre: l'évocation anticipée de la chute du président
pèse comme une fatalité sur les scènes qui suivent.
III.3 La distorsion
temporelle
Dans Le crime parfait,la constatationla plus
apparente est la discontinuité temporelle du récit. Donc dans le
roman, le fil dutemps est rompu et la rupture chronologique est flagrante.
L'auteur du crime parfaita utilisé, dans
l'élaboration de son roman, une technique créatrice quiest au
goût du jour chez les auteurs contemporains. La technique de
l'intermittence, de discontinuité et de saut qui fait bien sentir les
ruptures.Adama Amadé SIGUIRÉ s'inscrit dans la modernité
en adaptant le discours narratif aux fluctuations de la vie intérieure.
Il fait un détour, via la conscience d'Abdoul-Kader Zampou vers le
passé. Sa rencontre avec son épouse Julienne à la page
147.
« Tu sais Julienne, je t'aime beaucoup. Cela
fait vingt ans que tu es mon épouse. Souviens-toi de notre
première rencontre. C'était lors d'une conférence sur le
leadership animée par un jeune écrivain très dynamique et
pragmatique. » [...] (p, 147)
Puis nous revenons au présent, mais cette fois-ci
à travers une nouvelle conscience d'Abdoul-Hamid :
« Abdoul-Hamid a la conscience troublée
depuis qu'il avait eu cet entretien avec la femme de son oncle. » (p,
148)
Le roman est érigé par une
périodicité.Autrement dit, un contraste entre deuxrécits
de temps différents. Le premier récit est celui de l'assassinat
de la jeune fille qui est leprincipal et un second qui est celui où l'on
décrit ce qui se passeavant, pendant et après les
élections, (et qui est la conséquence du premier récit) et
c'est tout le roman qui est ficelé sur ce canevas. Àchaque fois
qu'on fait un pas en avant dans l'espaceet dans le temps :
« Zami Zama se prépare pour se faire
élire président de la république du bantou pour la
sixième fois.Seulement, il fait face à plusieurs obstacles. Selon
la constitution de Bantou, Zami Zama doit partie. Il est à la fin de son
dernier mandat. Il ne peut plus se faire élire. Zami Zama ne comprend
rien de tout cela. »(p, 83)
On se retrouve obligéde faire le même pas mais
cette fois en arrière, donc vers un autreespace et un autre temps :
« Le pouvoir de Zami Zama a connu beaucoup de
crises et de révoltes. La dernière révolte sociale a
été déclenchée par la mort de Juliette
Kabèga. Bien avant la mort de Juliette, cinq années auparavant,
une grande crise a secoué le régime de Zami Zama et a fait
trembler Zami Zama lui-même. Un étudiantavait été
assassiné dans le campus de l'université de Jouvantou.la
révolte a été indescriptible. [...] La crise a
secoué le pays pendant six mois. »(p, 84)
Donc Le crime parfaitc'est la discontinuité
temporelle, une juxtaposition de scènes narrativesimpliquant temps et
espaces différentsqui montre la distorsion. Avec une tellestructure
chronologique, la coupure du temps est sentie pleinement comme si on a affaire
à deux histoires de temps complètement différents les
pouvant lire séparément.
III.4Temps du récit : les
récits en rupture dans Le crime parfait
Subséquemment à sa texture un peu
singulière, le récit dans le romand'Adama SIGUIRÉ,Le
Crime Parfait, est ficelé de telle manière qui laisse penser
à la rupture. Pourquoi rupture ? La réponse en est simple : c'est
une oeuvre contenant deux récits de caractères différents
chacun de l'autre avec des personnages et des espaces également
différents.
En premier lieu, sur le plan de péripéties,
d'événements, les deux récits relatent deux histoires
différentes dont la première est la conséquence de la
deuxième.
- Dans le récit premier on raconte l'histoire de
l'assassinat de la jeune fille qui a déclenché le courroux du
monde scolaire :
« Juliette, si tu es morte, dis-le-nous. Non !
Nous sommes à deux mois du baccalauréat. Le BAC aura lieu avec
toi, autrement il n'aura pas lieu. [...]Aucune autorité politique ne
viendra ici. Nous allons aller les trouver dans leur sommeil et les
brûler vif. »(p, 15)
C'est la gestion de la crise, suite à cet assassinat,
et la recherche d'un dénouement favorable pour permettre au
président dictateur de sauver son fauteuil, qui est relaté
à travers ce premier récit.
- Dans le récit second, il y a une autre histoire qui
se déploie. Il s'agit du tripotage constitutionnel ;
« Zami Zama se prépare pour se faire
élire président de la république du Bantou pour la
sixième fois. Seulement il fait face à la plusieurs
obstacles ? Selon la constitution de la république du Bantou, Zami
Zama doit partir. [...] Le nombre de mandat est limité. Et voilà
que Zami Zama est à la fin de son mandat. Il doit quitter le pouvoir,
selon la constitution qu'il a fait voter lui-même. [...] La loi portant
non-limitation du nombre de mandat présidentiel est vite votée
par l'assemblée nationale de la république. » (p,
83)
Etdes élections présidentielles dans la
république du Bantou.
« La campagne électorale bat son plein
dans la république du Bantou. Les villes sont inondées d'affiches
et autres messages des candidats. » (p, 106)
En deuxième lieu, le roman présenteplusieurs
espaces dissemblables dans lesquels se déroulent les scènes
desdites histoires. L'auteur procède donc à des ruptures pour
décrire ces espaces :
- Les espaces dans l'histoire de l'assassinat, des espaces de
concertations :
« Le directeur général de
l'enseignement secondaire et les trois responsables du lycée sont
partis ? C'est le vaste salon de la maison du directeur
général qui les accueille cette nuit. » (p, 22)
Un espace laissant voir un lieu de refuge pour les trois
responsables afin de se mettre à l'abri de la vindicte scolaire.
- Des espaces de travail :
« C'est dans sa maison que se trouve son bureau
et son laboratoire de recherche. Il n'y a pas de place pour s'assoir à
l'université, en dehors de l'amphithéâtre surchauffé
dans lequel il donne ses cours. Par contre un ministre de la république
a un cabinet climatisé dans lequel il peut faire beaucoup de
choses. » (p, 25)
On note également la description des espaces donnant
lieu au dégout, au mépris provoquant ainsi
répugnance, répulsion et écoeurement :
« Enlever son corps pour l'envoyer dans la
morgue de quel hôpital ? Dites-le-nous ! Là-bas c'est
la merde. C'est le désordre. C'est un bordel. C'est un dépotoir.
Les corps ne sont pas gardés. On les vole même
souvent. » (p, 34)
- L'espace dans l'histoire des élections
présidentielles. Cet espace représenté est un espace en
ébullition, animé et envahi par les partis politiques en
campagne.
« Les villes du pays sont inondées
d'affiches et autres messages des candidats. » (p, 106)
- L'espace de meeting du président
sortant :
« C'est à la place Charles de Gaule, dans
la capitale de Bantou, que Zami Zama a tenu son dernier meeting de campagne
électorale. » (p, 110)
- L'espace du meeting de l'opposition :
« C'est à Dantou, dans la capitale
économique de la république du Bantou, situé à plus
de deux cents kilomètres de Jouvantou, la capitale, que l'opposition a
tenu son dernier meeting électoral. » (p, 111)
Outre la description des espaces, la description des
personnages dans le roman `' le Crime parfait'' représente,
elle aussi, une autre rupture. Les deux récits dans le roman en question
sont véhiculéspar plusieurs personnages que l'auteur a pris le
soin de décrire. En effet,
- Le président Zami Zama,qui représente la
république, joue un rôle au sein de l'univers romanesque. Ce
président qui aspire s'éterniser au pouvoir, joue dans le roman,
le rôle de dictateur :
« Le président Zami Zama est un homme
fort. Il se reconnait ainsi. D'ailleurs, dès son arrivée au
pouvoir, on l'appelait « l'homme fort de la république de
Bantou.» Il est arrivé au pouvoir par le crépitement des
armes. Il a pris le pouvoir dans un bain de sang. » (p, 46)
Il a dirigé le pays pendant des
décennies :
« Cela fait déjà d'ailleurs
trente-deux ans que le président Zami Zama est au
pouvoir. » (p, 47)
- L'officier Paul Zalo, qui a la charge d'enlever le corps de
Juliette joue le rôle de négociateur au regard de ses
qualités professionnelles.
« L'officier Paul Zalo est un jeune
Garçon très intelligent. Il a beaucoup appris. Il a lu beaucoup
de livres. Il connait l'étymologie du mot police. »(p,
37)
Ce jeune officier dont l'histoire donne la charge d'affronter
avec son équipe, les élèves doit tout faire pour
réussir la négociation :
« Le jeune officier de police âgée
à peine de vingt-cinq ans, prend le courage de risquer sa vie. Il avance
vers le groupe des élèves. Il reçoit des jets de pierres
et des injures. Les élèves menacent de le brûler vif.
Malgré cela, l'officier de la compagnie républicaine de
sécurité avance. À cinq mètres du groupe des
élèves, il s'arrête : « Je suis venu pour
qu'on échange. Vous savez je suis jeune comme vous. » (p,
30)
Toutes ces oppositions que le roman met en exergue montrent
clairement une certaine distorsion au niveau de la structure
générale de l'univers romanesque nous permettant ainsi de parler
du récit en rupture.
CONCLUSION PARTIELLE
L'étude de ce chapitre a consisté, d'une part,
à la présentation de l'auteur et de son roman et, d'autre part
à l'étude de corpus. Le premier point a relevé que Adama
Amadé SIGUIRÉ, l'auteur du roman corpus est un écrivain
très actif et engagé. Il compte à son actif six romans et
quatre essais. Quant à l'étude du corpus, elle a permis
d'analyser la temporalité dans le roman d'étude. Nous retiendrons
que la narration dans le roman estaccélérée. Le roman est
bâti selon un système verbal dominé par le présent
et le couple imparfait/passé simple qui font progresser l'histoire, et
présentant l'histoire selon un mode de narration singulatif.Le narrateur
donne beaucoup plus d'importance aux péripéties età la
description.Ce qui pèsent sur la vitesse de la narration (les pauses
narratives dans le roman sont de moindre importance devant les sommaires et les
ellipses qui donnent une allure accélérée à la
narration).
Ce chapitre nous a permis de confirmer l'hypothèse
selon laquelle la temporalité se manifeste dans le roman le Crime
Parfait. Cette temporalité manifeste aurait une valeur très
significative que nous évoquerons dans le chapitre suivant.
CHAPITRE III : PORTÉE DE LA TEMPORALITE DANS LE
ROMAN LE CRIME PARFAIT
Le présent chapitre qui est dans une logique
complémentaire des deux précédents,nous permettra
d'interpréter les différents résultats du chapitre
précédent. Notre objectif dans ce troisième chapitre est
de mettre en évidence l'effet recherché par l'auteur en utilisant
telle ou telle technique d'emploi temporel dans « Le Crime
Parfait ».
Autrement dit, tout emploi ou structure temporel dans l'oeuvre
a une signification d'où l'importance d'une interprétation
appropriée.
Il s'agira de ce fait de donner un sens de manière
personnelle aux différents emplois temporels. Dans un second temps,
d'interpréter les écarts d'usage temporel puis terminer par des
recommandations. Ainsi, quelle interprétation pouvons-nous faire des
résultats obtenus ?
I. Valeurs narratives des temps verbaux
dans le crime parfait
La manière de faire usage des temps verbaux dans un
roman est porteuse de signification. Qu'en est-il dans Le crime
parfait ? Cette partie nous conduira à la réponse
à cette question.
I.1. Valeur du
prédicat
Le rôle des prédicats est de décrire
l'état du sujet S dans un temps t puis ce qu'il
advient dans un autre temps t + n :
« C'est sur les cendres d'un pouvoir
dictatorial que le président Zaki Zaka fera pousser difficilement les
plants verts de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est donc
sous un ciel dégagé que s'installe un président élu
par le peuple au suffrage universel. » (p, 136)
Dans ce passage, on décrit la fin du régime
dictatorial en l'instant t + n du président Zami Zama et
l'avènement d'une nouvelle ère de la démocratie dans la
république du Bantou.
La place qu'occupe le verbe est plus qu'importante. Ce point
nodal connaît sa pleine floraison dans le roman. SIGUIRÉ en usent
pour s'assurer l'évolution de l'intrigue romanesque et son ancrage dans
un temps tel, et, de plus, donner sens, rythme et signification à
l'histoire.
I.2. Valeur de l'opposition
passé simple/imparfait
À la page 53, le narrateur revient sur les
circonstances de rencontre entre Éric et Juliette.
« Ce fut un coup de foudre le
premier jour qu'ils s'étaient rencontrés.
C'était lors d'une Kermesse organisée par les
élèves du lycée. »
« Il était une heure du matin quand les
deux tourtereaux quittaient le bar. Ils
s'engouffrèrent dans la voiture. Quand l'officier
démarra la voiture, une explosion se produisit. La
voiture prit feu. Son habileté et sa
dextérité militaire lui permirent de se sauver
et de sauver la vie de sa future épouse, mais la voiture
resta irrécupérable. » (p,
150)
L'auteur alterne le passé simple et l'imparfait dans le
récit, pour donner une fonction contrastive et permettre d'opposer deux
plans distincts.
Le passé simple installe au premier plan les
événements et les actions qui se succèdent et font
progresser le récit. L'imparfait, en revanche, dessinent la toile de
fond (ou l'arrière-plan) de cette trame narrative.
L'auteur en usepourasseoir dans le récit, au premier
plan, tout ce qui est action, péripétie et
événement qui font progresser l'intrigue, tandis que l'imparfait
joue le rôle d'un canevas, d'une ossature, sinon de tout ce qui constitue
le fond sur lequel se détachent les événements marquants
exprimés par le passé simple, et qui permet, en revanche, de
dessiner la toile de fond, ou ce que H. Weinrich désigne sous le concept
d'arrière-plan. Ainsi l'usage alterné, dans le Crime
Parfait, de ces deux temps met en contraste le récit et permet d'en
montrer une certaine dissonance :
« C'est pendant que les investigations
judiciaires sur les circonstances de l'explosion du véhicule du
magistrat militaire se poursuivaient que le même
officier fut victime d'une attaque à main
armée. » (p, 151)
Donc dans le passage ci-dessus, l'usage du passé simple
ne s'est pas fait d'une manière hasardeuse et aléatoire, mais au
contraire son usage est évident et assuré dans la mesure
où il met en exergue les circonstances dans lesquelles Abdoul Hamid a
subi une tentative d'assassinat.
Par contre, dans les exemples ci-après le point sera
mis non pas sur les actions du personnage mais plutôt sur l'ossature de
ces actions, autrement dit il est question ici de faire montrer la trame
narrative ou l'arrière-plan de ces événements en question
:
« Le capitaine Abdoul Hamid
était parti en mission à Dantou et il
revenait à Jouvantou. Il était pressé de
retourner dans la capitale car plusieurs dossiers judiciaires
l'attendaient. Il roulait donc à vive
allure sur une voie bitumée très étroite et mal
entretenue. » (p, 151)
En effet, dans ce passage, l'imparfait laisse montrer la toile
de fond des péripéties, le tissu principal dans lequel
s'élaborent les actions des personnages, donnant ainsi un
arrière-plan à l'histoire romanesque.
I.3. Valeur du
présent
Avec ses différentes acceptions, le présent
constitue dans le Crime Parfait un carrefour, voire un rond-point en
étoile à partir duquel découlent tous les autres temps.Il
constitue donc le centre de gravité des événements, il est
le point essentiel, principal, sinon primordial autour duquel s'organise
l'ensemble de l'action. Dans sa fonction de base, le présent est le
temps de l'énonciation qui indique la coïncidence entre le
procès et le moment de l'énonciation.
« Prends tes flèches et
n'oublie pas ta hache.» (p, 13)
« Enlever le corps pour l'envoyer dans la morgue
de quel hôpital ? Dites-le-nous ! Pas dans
celle du centre hospitalier universitaire [...] » (P, 34)
Dans ces passages, l'auteur emploie le présent pour
présenter des faits qui sont valables au moment où il parle. Ces
faits se sont déroulés en effet, pendant que l'équipe de
la compagnie républicaine voulait enlever le corps de la jeune fille
assassinée pour la morgue.
Outre son rôle d'énonciation, le présent
est identifié dans le Crime Parfait sous un autre cas de figure
à savoir le présent historique ou le présent
de narration. Adama SGUIRÉ a opté pour le présent
dans la narration des évènements dans le roman. Ainsi plusieurs
cas de présent de narration ont été relevés.
« Il est vingt heures, trois coups de feu
viennent de retentir à l'entrée principale du
lycée national Jules Ferry » (incipit, p, 13) ;
« Le ministre chargé de l'administration
adresse des correspondances aux leaders des différents
partis » (p, 102)
« Il est dix-huit heures trente minutes ce jeudi
soir. Le président de la commission électorale
décide d'assumer ses responsabilités »
(p,129)
Dans ces trois passages, on peut voir nettement la
précellence du présent sur les autres temps de
référence du récit à savoir l'imparfait, le
passé simple et le passé composé. Cette technique
utilisée par SIGUIRÉ dans la construction du roman, a pour
intérêt d'abolir la distance temporelle entre le moment de la
narration et le moment de l'histoire racontée, autrement dit, le lecteur
sent qu'il n'y a pas de déphasage entre l'action et le moment de sa
narration, ce qui permet, d'ailleurs, au présent temps de discours de
devenir un temps du récit par excellence. En effet, le présent,
commutant avec le passé simple, joue dans ce cas un rôle purement
narratif, et met les faits en relief tout en les actualisant ; par
conséquent la totalité de l'instance énonciative se
déplace au moment des événements afin qu'ils appartiennent
au présent de l'interlocution et que le lecteur ait l'impression
d'assister en direct à l'histoire.
Dans leCrime Parfait,on relève plusieurs
occurrences du présent historique permettant la création d'effets
stylistiques particuliers, proches de l'hypotypose. L'hypotypose, qui peint les
choses de manière si vive qu'elle les met en quelque sorte sous les
yeux. De même, ce présent historique vise à produire une
impression d'immédiateté, en donnant à voir les
faits comme s'ils étaient contemporains de leur énonciation par
le narrateur et/ou de leur réception par le lecteur.
On relèvera également des cas de présent
qui traduisent une vérité générale.
« Malgré tout, les journalistes
sont majoritairement titulaires de
baccalauréat » (p, 66)
Ce présent, ici, a une valeur omni temporelle. On sait
que partout pour aller à l'école de journalisme et sortir
journaliste, il faut au minimum le baccalauréat.
« Le changement est la nature
de la démocratie tout comme la métamorphose est
la nature des êtres vivants. » (p, 98)
Pour dire qu'en démocratie, l'alternance est un
principe infranchissable.
I.4. Valeur des indicateurs
temporels
Plusieurs catégories d'indicateurs temporels sont
employées dans le crime parfait. Chaque catégorie
à une valeur dans le roman.
Ainsi, on a primo, les expressions déictiques
et anaphoriques qui situent le contexte:
« Maintenant, le régime
dictatorial du président Zami Zama a pris fin. » (p,
144)
« Aujourd'hui il est connu
partout ». (p, 147)
« Je l'ai trouvée très belle
ce jour-là » (p, 73)
Ces expressions proposent un repérage contextuel.
Secundo, on a les dates historiques,
«Elle est domiciliée au secteur 48 de la ville
de Jouvantou. Les deux inculpés connaissent les mêmes chefs
d'accusation : Complicité de meurtre, tentative d'assassinat, et
assassinat de Juliette Kabèga le 13 avril
20... » (p, 168)
Ces dates historiques proposent un ancrage chronologique.
I.5. Valeur du passé
composé
Le passé composé a plusieurs valeurs parmi
lesquelles nous pouvons retenir
Ø Valeur d'accompli
À la page 14, il est question d'un
procès antérieur à la période dont on
parle, et on veut signaler sa trace dans cette période. C'est la valeur
accomplie du passé composé.
« C'est sur elle qu'on a
tiré »
Ø Valeur
d'antériorité
À la page 167le narrateur met en exergue la valeur
temporelle d'antériorité du procès.
« Beaucoup de faits m'ont
étonné depuis le début des
évènements, dit le capitaine de la
gendarmerie »
I.6. Valeur de l'imparfait
Itératif
« Éricse rendait souvent
dans la famille de la jeune fille » (p. 62)
L'auteur, en employant cette forme d'imparfait, a voulu
souligner l'aspect fréquentatif de l'action. Cela traduit des actions
répétées.
II. LA PORTéE DE L'ORDRE
TEMPOREL DANS LE CRIME PARFAIT
II.1- Portée des
scènes
Le crime parfait présente plusieurs
scènes narratives mettant sur pied d'égalité récit
et histoire, donnant à penser à une certaine
immédiateté des faits, autrement dit le lecteur sent qu'il y a un
certain synchronisme entre les actions étalées et le moment de
leurs narrations. Ainsi ce fait illusionne le lecteur en lui permettant de
s'imaginer impliqué dans l'histoire à l'image des scènes
théâtrale où toutes les actions se passent sous les yeux de
ceux qui les regardent.
À la page 103,« une vive discussion
commence entre les organisateurs et les policiers. Les jeunes s'agitent. Ils
insultent les policiers. Ceux-ci ne sont pas non plus venus pour entendre
raison. Ils sont là pour interdire une marche illégale. Les
élèves et les étudiants se déchainent sans la
permission des organisateurs de la marche. Ils foncent sur les
policiers... »
L'auteur raconte en détail l'action qui se
déroule.
Il fait parler les personnages,
« Militants et militantes,je suis
désormais convaincu. Les élèves et les étudiants,
dispersés dans les quatre coins du pays, m'ont envoyé des
messages. Ces messages disent presque la même chose. Les
élèves et les étudiants me demandent de mettre en place le
protocole qui se chargera de mon investiture à la présidence de
la république. » (p, 113)
Il décrit le décor, l'ambiance, à la
page 119,
« C'est à onze heures trente minutes que la
voiture Mercedes 250 C du professeur Zaki Zaka s'est garée à
l'école primaire Silaye située dans un quartier populaire de la
capitale. Le professeur ZakiZaka est inscrit au bureau de vote n°2. Il est
accompagné par plusieurs leaders de l'opposition politique. Dès
son arrivée, les journalistes bloquent le passage. Ils veulent lui
arracher quelques mots. »
Ceci permet donc à l'auteur de ralentir le rythme du
récit. Il donne l'illusion au lecteur que le temps du récit
reproduit fidèlement le temps de l'histoire. tR= tH
II.2- Portée des
pauses
Elle provoque un effet de ralentissement.
Àtravers les pauses, l'auteur met en cause l'illusion
romanesque.Cela lui permet d'intervenir en personne dans son récit, par
exemple pour donner son avis, porter un jugement sur son personnage.
À la page 45, « en période de paix les
élèves et les professeurs ne sont pas de bons amis. Les
élèves disent que les professeurs n'aiment pas le travail. Aussi,
manquent-ils de savoirs approfondis, ils se plaisent dans les à priori
et font de l'à-peu-près ».
L'auteur étant un enseignant, et connaissant les
élèves, marque une pause pour commenter la relation qui
prévaut entre élèves et enseignant en temps de paix.
Certaines pauses marquées dans le roman proposent de
compléter des informations sur des éléments factuels ou
culturels.
« Aujourd'hui je donne raison à
l'écrivain français Jean Jacques Rousseau qui disait dans son
ouvragelettre écrite de la montagne, huitième
lettre : « la pire des lois vaut encore moins que le
meilleur maitre ; car tout maitre a des préférences, mais la
loi n'en a jamais'' ». (p, 150)
On résume en disant que dans le crime parfait,
on assiste à plusieurs pauses qui permettent à l'auteur de faire
des descriptions afin d'apporter plus de détails. Cela permet sans doute
au lecteur de mieux fixer sa compréhension
II.3- Portée des
ellipses
L'ellipse a une fonction déterminante dans le roman.
Ainsi, le recours aux ellipses est très important dans la construction
événementielle de l'oeuvre le Crime Parfait, permettant
ainsi à l'écrivain de faire appel à l'esprit et
l'imagination de lecteur pour l'appréhension de l'histoire, car «
même si le propos de l'auteur, soutient Sartre, est de donner la
représentation la plus complète de son objet, il n'est jamais
question qu'il raconte tout, il sait plus de choses encore qu'il n'en
dit.(Jean-Paul Sartre, Situation II, éd,
électronique)
II.4 -Portée des
analepses
L'auteur de « lecrime parfait »,
en commençant par l'assassinat de Juliette avant de revenir sur les
dessous du crime, les motivations du crime, et même sur le vrai auteur du
crime, déplace l'intérêt du lecteur : la conséquence
de l'histoire lui étant connue, ce n'est plus le désir simple de
savoir la suite qui le meut, mais une curiosité plus complexe, et sans
doute plus mélancolique: celle de connaître les rouages
inflexibles d'une intrigue de prédestination.
II.5- Portée des
prolepses
L'usage des prolepses est une technique très
intelligente qui permet de capter l'attention du lecteur dès le
début et le frustrer pour le forcer à progresser dans l'histoire.
Les prolepses, dans le crime parfait, ont une
fonction d'annonce; elles concourent à établir la
cohérence à long terme du récit. De façon plus
générale, en disant maintenant (dans R) ce qui adviendra plus
tard (dans H), l'auteur fait peser sur le récit un certain poids
destinal.
« Un pouvoir vieux de vingt-sept ans va prendre
définitivement fin au grand bonheur de tout un peuple. Ce sera la fin du
césarisme et de la république bananière. Le peuple se
réveillera et exigera des comptes à ceux qui ont plongé le
pays dans le marasme économique pendant près de quatre
décennies. Le peuple leur demandera de quel droit ils ont scellé
l'avenir d'une nation pendant trente-sept ans. » (p, 126).
En définitive, le crime parfait est
caractérisé par des va-et-vient. Cela n'est pas anodin, mais
d'une importance capitale. Ce sont ces retours en arrière dans le
récit qui nous donnent à voir une meilleur lisibilité et
compréhension du l'histoire. Si le narrateur n'a pas eu recours à
ce type de technique, le lecteur ne saurait jamais bien connaitre certains
personnages et même les antécédents du crime qui ont
motivé le forfait. Avec un tel usage du temps, le récit perd sa
linéarité, le fil du temps rompu se brise et se retourne, nous
permettant ainsi de considérer le roman comme un roman à temps
anachronique.L'analepsepermet de faire des retours dans le passé tandis
que la prolepse permet de faire des anticipations
sur l'avenir. L'auteur utilise donc ces figures pour caser les indices sur
l'intrigue dansl'histoire de manière discrète. Cette
déformation temporelle est utilisée à des fins
esthétiques.
CONCLUSION PARTIELLE
Nous pouvons retenir de cette partie que le choix de l'auteur
d'employer tel ou tel temps verbal, les distorsions temporelles, l'option pour
une telle structure temporelle s'interprètent sur plusieurs plans.
D'abord il y a le souci de respecter certaines règles
d'écriture propre au siècle présent ou encore de respecter
les règles en matière de normes grammaticales. Il y a aussi quele
changement des temps dans les textes versifiés obéit à un
certain nombre de tendances, qui assurent sa fonctionnalité
narrative.
Notons également la recherche de l'esthétique.
En effet, l'auteur, dans sa logique en optant pour cette formule, vise à
émerveiller le lecteur à travers cette technique
d'écriture qui lui est spécifique.
CONCLUSION GÉNÉRALE
L'étude que nous avons menée sur la
temporalité narrative et sur l'ordre temporeldu récit dans
le roman, le Crime Parfaitd'Adama Amadé SIGUIRÉ, nous a
permis de faire une approche définitionnelle de certaines notions
clés, d'analyser le corpus et d'interpréter le choix de l'auteur
pour cette construction temporelle du récit.
Afin de mener à bien cette analyse, notre plan est
composé de trois chapitres intitulés respectivement : la Notion
du temps et d'ordre temporel, de l'étude de la temporalité
narrative et la portée de cette temporalitédans
l'oeuvre.
le premier chapitre à savoir l'étude notionnelle
du temps et d'ordre temporel, a consisté dans un premier temps,
àla définition du temps selon les différentes acceptions.
Dans unsecond temps il a été question d'étudier les
différents temps verbaux dans l'univers romanesquepuis terminer par
l'étude de la temporalité dans un récit. Cela nous a
permis d'aborder en détail la structure temporelle et le concept d'ordre
temporel dans un récit.
Le second chapitre de notre étude a porté sur
l'analyse du corpus. Dans ce chapitre nous avons
d'abordprésenté l'auteur et son oeuvre à travers un bref
résumé de l'oeuvre et dela bibliographie de l'auteur. Nous avons
également relevé les procédés narratifs dominants
dans le roman avant d'aborder le second point qui porte sur l'étude de
la temporalité dans le dit roman. Pour ce faire, dans le premier
élément, nous avons vu qu'il était possible de
résumer la vie d'un personnage en quelques phrases. On a aussi, pour
l'étude du corpus, procédé à l'étude
temporelle qui nous a permis derelever les différents temps verbaux
employés dans le roman afin de permettre une évolution
cohérente du récit. Dans le second élément, nous
avonsanalysé les différents mouvements temporels dans le corpus.
Cela a permis de releverque dans le récit il y a quatre mouvements
temporels, qui composent la durée, la pause, la scène, le
sommaire et l'ellipse.L'analyse de la récursivité dans le roman a
permis de relever que le roman LeCrime Parfait,raconte une fois ce qui
s'est passé une fois. Ce qui nous a amené à conclure que
c'est un récit singulatif.
Troisièmement, la recherche nous a amené
à étudierl'ordre temporeldu Crime Parfait.Ilest ressorti
que l'histoire racontée dans le crime Parfait n'est pas
isochronique. Elle est plutôt anachronique. Deux sortes d'anachronies
narratives ont été de ce fait relevées. On a, primo, les
analepses ou retour en arrière (flash-back) où l'auteur
opère des descriptions ou complète une information en vue de
combler une lacune du récit. Secundo, les prolepses ou anachronies
prospectives ou encore anticipations où l'auteur fait une projection en
avant; anticipe sur l'histoire en annonçant dès l'entame la mort
de Juliette avant de revenir par la suite sur les circonstances qui ont
motivé le forfait. Ainsi, il est ressorti que les histoires
véhiculées par Lecrime Parfait présente des
anachronies ;ce qui a provoqué en deuxième lieu la
distorsion temporelle, car dans ce roman, le narrateur ne cesse un instant de
faire des retours en arrière pour savoir ce qui se passe dans l'histoire
de l'assassinat. Secundo, nous avons relevé une autre anachronie, cette
fois c'est une anachronie qui s'inscrit dans l'ordre spatial. Ainsi à
l'image de la distorsion de la structure narrative du roman, le système
spatial, lui aussi, est en disjonction apparente. Le roman présente, en
effet, deux espaces d'ordre différents : d'un côté il
y a les espacesdans l'histoire de l'assassinat qui sont des espaces traduisant
la peur, le dégout, et souvent paradisiaque, sinon
féérique. De l'autre côté, il y a les espacesdans
l'histoire des élections qui sont des espacesbouillants, animés.
Le troisième chapitre a porté
surl'interprétation des résultats de l'analyse.Cette
étude a été fait en deux autres points à savoir la
valeur de l'usage des temps verbaux et la portée de la structure
temporelle dans le roman. Pour le premier point nous avons vu que chaque temps
employé avait une valeur dans le récit. Nous avons
également vu que l'auteur a préféré raconter
l'histoire au présent afin de ne pas créer une distanceentre le
moment de narration et le moment de l'histoire racontée.
Au deuxième point, il a été question
d'interpréter la portée de la structure temporelle du roman.
Au bout du compte, l'étude du temps du récit
dans l'oeuvre de Adama Amadé SIGUIRÉLe Crime
Parfait,nous a conduit à déceler la portée de la
donnée temporelle sur le tissu événementiel du
récit et, en même temps l'influence, de cette même
donnée temporelle sur le processus de la remémoration qui sert de
son côté l'Histoire en tant que telle. La portée de cette
construction temporelle a une valeur incommensurable car elle répond
à un besoin esthétique ou d'ordre normatif. Elle permet une
lisibilité et une meilleure compréhension de l'histoire. Cela
dit, à partir d'un fragment d'un temps vécu, l'auteur du
romanLe Crime Parait, a pu reconstruire et réécrire un
fragment d'histoire, pas comme le font les historiens et spécialistes de
ce domaine mais sous une forme poétique atténuant ainsi les faits
et les rendant plus esthétiques tout en conscientisant la nouvelle
génération.
Toutefois, des études ultérieures dans ce sens
pourront approfondir cette recherche en poussant plus loin la recherche dans
les moindres détails.
BIBLIOGRAPHIE
L'OEUVRE ÉTUDIÉE :
- SIDUIRÉ Adama Amadé (2015), le crime
parfait. Paris : Déclic. 175 p.
LES OUVRAGES :
- ADAM Jean-Michel(1984), Le
récit.Pari :PUF. p.3
- ACHOUR Christiane, BEKKAT Amina (2002),dans Clefs pour la
lecture des récits in
« Convergences critiques II »,
Monaco : Tell. 167 p.
- BAUDELAIRE Charles (1885), l'Art romantique, IV,
5.Paris : électronique. 431 p.
- BARTHES Roland (1972), L'écriture du roman, in Le
degré zéro de l'écriture. Paris : Seuil. pp.
27-34.
- BENVENISTE Émile (1966), Les relations de temps dans
le verbe français, in Problèmes de linguistique
générale, t. 1. Paris: Gallimard, pp. 237- 250.
- BENVENISTEÉmile (1974), Le langage et
l'expérience humaine, in Problèmes de linguistique
générale, t. 2. Paris: Gallimard, pp. 67-78.
- BERGSON Henri (1958), Essai sur les données
immédiates de la science. Paris : PUF. 214 p.
- BREAL Michel (1897), Essai de
sémantique.Paris : Hachette. 341 p.
- BUTOR Michel (1964), Essais sur le
roman.Paris :Gallimard. 22 p.
- BRES Jacques (1999),L'imparfait dit narratif en tant que
lui-même, Cahiers de praxématique 32 :
87-117.Études romanes de l'Universitéd'Odense. Vol. 5. Odense:
Odense Univ. Press, 1973.
- BRES Jacques (2005), L'imparfait dit narratif.
Paris : CNRS Éditions. 251 p.
- DUCROT Oswald (1995), Temps dans la langue, in DUCROT, O. et
SCHAEFFER, J.-M, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du
langage. Paris: Seuil,pp. 682-696.
- DUHAMELGeorges (1934), Discours aux nuages, Paris:
I, Siècle. 255 p.
- Georges et Robert Le BIDOIS (1938), Syntaxe de
français moderne, Paris: Gallimard. 794 p.
- GENETTE Gérard (1972), « Discours du
récit », in Figures III. Paris : Seuil. 341 p.
- GUILLAUME Gustave (1929),Temps et verbe. Paris:
Champion. 230 p.
- GOSSELIN Laurent (1996), « Sémantique
de la temporalité en français », Louvain-la-Neuve
: Paris, éd.Duculot. 292 p.
- GOSSELIN Laurent (1999), « Le sinistre
Fantômas et l'imparfait narratif, Cahiers de praxématique
», Presses Universitaire de la
méditerranée. pp.19-42
- GOSSELIN Laurent (2005)« Temporalité et
modalité ». Bruxelles: De Boeck Paris,Duculot. 254 p.
- HARALDWeinrich, Le temps, 1973, trad. fr. de
Michèle Lacoste. Paris, Seuil, cité par KaempferJean, Micheli
Raphaël dans « temporalité narrative » 320 p.
disponible sur :
http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/tnarrative/
- JAUBERT Anna, PRAESENS Fingo(1998),« Le
présent des fictions ». In La ligne claire. Ed.
Annick ENGELBERT, et alii. Louvain-la-Neuve: Paris, Duculot, pp.
209-219.
- MARNETTE Sophie (1998),« Narrateur et points
de vue dans la littérature française
médiévale ». Berne (suisse): Peter Lang. 262 p.
- MELLET Sylvie (1980),« Le présent
historique ou de narration ».L'Information Grammaticale, n°
4,pp. 6-11.
- N'GUETTA Kessé Edmond, Cours de narratologie
licence II, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody,
Côte d'Ivoire. 42 p.
- PONS Jean (1997), « Le roman noir,
Littérature réelle, inLes temps modernes », n°595,
août, septembre, octobre. P. 7.
- REUTER Yves, Armand Colin (2009),
« L'analyse du récit ». Paris :
Amazon. 132p.
- RICOEUR Paul (1983),« Temps et
récit ». Paris: Seuil. 336 p.
- SCHÖSLERLene (1973),« Les temps du
passé dans Aucassin et Nicolette, L'emploi du passésimple, du
passé composé, de l'imparfait et du présent "historique"
de l'indicatif. » Odense UniversityPress, vol. n°8. p.
122.
- SERBAT Guy (1980),« La place du présent
de l'indicatif dans le système des temps ». L'Information
Grammaticale, n° 7, pp. 36-39.
- SOUTET Olivier (2006),« Vertige pascalien et
grammaire : l'imparfait pittoresque entre chronologie littéraire et
chronologie opérative ». In Langue littéraire
et changements linguistiques, Paris, Ed. Françoise. 546 p.
- TODOROV Tzvetan (1966), « Les
catégories du récit littéraire, in
Communications », 8. pp, 125-151.
- WEINRICH Harald (1973),« Le
temps », trad. fr. de Michèle LACOSTE. Paris: Seuil.320
p.
LES DICTIONNAIRES :
- Alain (R), 1991. Le grand Robert de la langue
française, 2e édition, Montréal : les
Dictionnaires Robert.1342 p.
- DUMERY Henry (2011), Temporalité,
Université de Paris-X-Nanterre, encyclopédie Universalis, Paris,
éd.
- DUBOIS Jean (2007), Grand dictionnaire de Linguistique
et Sciences du langage, Larousse.p.270.
- DUBOIS Jean et alii (2001). Dictionnaire
linguistique, Paris, Larousse. 576 p.
- MOLINÉ (1997). Dictionnaire de
rhétorique, Paris Librairie générale
française.352 p.
- Microsoft Encarta, éd, 2009.
- PRISCIEN, Institutionesgrammaticae, VIII, 51.
Encyclopédie Hachette. pp. 31-50
- PRISCIEN, « Présent », in
Institutionesgrammaticae, VIII, 51. EncyclopédieHachette,
éd, 2007.
MÉMOIRES DE MAITRISE
- KAMBOUÉLÉ Mourkoum (2018), Analyse
sociolinguistique des principauxregistres de langue et norme d'usage dans
«pays-là » de Samuel MILOGO.
Unité de Formation et de Recherche en Lettres, arts et Communication
(UFR.LAC) Université Pr Joseph Ki ZERBO, 83 feuilles.
- ZOUNGRAN Marc (2018), Les procédés
stylistiques et leurs fonctions dans le roman« les deux
maris », mémoire de recherche, Unité de
Formation et de Recherche en Lettres, arts et Communication (UFR.LAC)
Université Pr Joseph Ki ZERBO, 99 feuilles.
LES ARTICLES
- Verbe, Microsoft Encarta, éd, 2009.
- DUMERY, Henry, Temporalité,
Université de Paris-X-Nanterre, encyclopédie
Universalis, éd, 2011.
- TODOROV, Tzvetan, Les catégories du récit
littéraire, in « Communications », 8, 1966. pp, 125-151.
TABLE DES MATIÈRES
Dédicace
I
INTRODUCTION générale
1
CHAPTITRE I : APPROCHE THÉORIQUE ET
CONCEPTUELLE
5
I. La notion de temps
5
I.1. Le temps phénoménologique
6
I.3. Le temps anthropologique
6
I.4. Le temps objectif
7
I.5. Le temps linguistique
7
II. LES TYPES DE TEMPS DANS L'UNIVERS
ROMANESQUE
8
II.1 Les temps externes
8
II.2. Les temps internes
9
II. 3 Les temps verbaux
10
II.3.1 Notion de verbe
11
II.3.2 Le procès
11
II.3.3 Le prédicat
12
II.3.4 L'aspect
12
II.3.5 L'opposition imparfait/passe simple
13
II. 3.5- 1. L'opposition aspectuelle entre
imparfait et passé simple
13
II.3.5- 2. La mise en relief
13
II.3.5- 3. L'imparfait de rupture
14
II.3. 6 L'aspect itératif
14
II.3.7 le passé composé
15
II.3.7- 1. Valeur d'accompli/ d'inaccompli/
d'antériorité
15
II.3.7- 2. Un temps peu narratif
16
II.3.8. Le présent
17
II.3.8- 1. Présent d'énonciation
17
II.3.8- 2 Le présent de description
17
II.3.8- 3 Le présent d'habitude
17
II.3.8- 4 Le présent du passé
récent
18
II.3.8- 5. Le présent du futur proche
18
II.3.8- 6 Présent gnomique
18
II.3.8-7 Présent historique
18
II.3.8-8 Présent de narration
19
II.3.8 Les indicateurs temporels
20
II.3.9. La double référence temporelle
des récits
21
III. LA
TEMPORALITÉDANS UN RÉCIT
22
III.1. Temps du récit/temps des
évènements
22
III.2. Ladurée
22
III.2.1 La vitesse du récit
23
III.2.2 La scène
23
III.2.3 La pause narrative
24
III.2.4 Le sommaire.
25
III.2.5 L'ellipse
26
IV. NOTION D'ORDRE TEMPOREL
26
IV.1. L'ordre linéaire
27
IV.2. L'anticipation ou prolepse
28
IV.3. Le retour en arrière, le flash-back ou
l'analepse
29
IV.4. La fréquence
30
CONCLUSION PARTIELLE
31
CHAPITRE II. PRESENTATION ET ANALYSE DU CORPUS
D'ÉTUDE
32
I. Présentation de
l'auteur et de l'oeuvre
32
I.1 Présentation de l'auteur
32
I.1.1 Biographie et bibliographie
32
I.1.2 Principes esthétiques de l'auteur
33
I.1.3 Procédés stylistiques et
narratifs
33
I.2 Présentation de l'oeuvre.
34
I. 2.1 Résumé de l'oeuvre
34
II. ANALYSE DU
CORPUS
35
II.1 Étude temporelle
35
II.1.1 la manifestation du temps dans le roman
35
II.1.1.1 Les indicateurs temporels
35
II.1.1.2 Usage narratif des temps verbaux
36
a- Le procès
37
b. Le prédicat
37
c. L'opposition aspectuelle entre l'imparfait et le
passé simple
37
d. La mise en relief
38
e. L'imparfait de rupture
38
f. L'imparfait itératif
39
g. Usage narratif du passé
composé
39
h. Le présent
40
h.1 Le présent d'énonciation
40
h.2 Le présent du passé
récent
41
h.3 Le présent du futur proche
41
h.4 Le présent gnomique
41
h.5 Le présent de narration
42
II.2 LES MOUVEMENTS TEMPORELLES DANS LE
ROMAN
42
II.2.1 la scène
43
II.2.2 La pause
44
II.2.3 Le sommaire.
45
II.1.4 L'ellipse.
46
II.2. La récursivité dans le roman
(la fréquence)
46
III. l'ordre temporelle du
`'LE crime parfait `'
47
III.1 les Analepses
47
III.2 La prolepse
48
III.3 La distorsion temporelle
49
III.4 Temps du récit : les récits
en rupture dans Le crime parfait
50
Conclusion partielle
53
CHAPITRE III : PORTÉE DE LA
TEMPORALITE DANS LE ROMAN LE CRIME PARFAIT
54
I. VALEURS NARRATIVES DES
TEMPS VERBAUX DANS LE Crime Parfait
54
I.1. Valeur du prédicat
54
I.2. Valeur de l'opposition passé
simple/imparfait
55
I.3. Valeur du présent
56
I.4. Valeur des indicateurs temporels
57
I.5. Valeur du passé composé
58
I.6. Valeur de l'imparfait Itératif
58
II. LA PORTÉE DE L'ORDRE TEMPOREL DANS LE
CRIME PARFAIT
58
II.1- Portée des scènes
58
II.2- Portée des pauses
59
II.3- Portée des ellipses
60
II.4 - Portée des analepses
60
II.5- Portée des prolepses
60
Conclusion partielle
61
CONCLUSION GÉNÉRALE
62
BIBLIOGRAPHIE
64
| 


