|
ROYAUME DU MAROC GENDARMERIE ROYALE
ECOLE ROYALE DES OFFICIERS DE
GENDARMERIE
COURS DES OFFICIERS SUPERIEURS
20ème Promotion


LA COOPERATION
INTERNATIONALE DANS LE
DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE
TRAFIC DE STUPEFIANTS
|
|
|
Préparé par
LE CHEF D'ESCADRON NNANA NOAH Antoine Marie
|
|
|
Mai 2017
|
1
DEDICACES
2
Ce travail qui consacre la fin d'une longue période
de sacrifice est dédié
à la coopération
Cameroun-Maroc pour les efforts consentis dans la
formation des cadres et
officiers.
3
REMERCIEMENTS
Je remercie l'encadrement de l'Ecole royale des officiers de
gendarmerie et particulièrement au Colonel Major commandant ladite
Ecole, qui n'ont lésiné sur aucun effort pour nous faire
acquérir des connaissances nouvelles.
J'adresse ma profonde gratitude à l'ensemble de la
20ème promotion du Cours des Officiers Supérieurs de
Gendarmerie pour l'esprit de camaraderie et des liens d'amitié qui se
sont créés.
A ma famille et particulièrement à ma tendre
épouse Sandra Jessica, je vous dis merci pour tout le réconfort
moral.
Au Seigneur Dieu tout puissant qui nous donne la force d'aller au
bout de nos entreprises.
4
5
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION 7
DEFINITIONS 8
CHAPITRE I : PROCESSUS, IMPACT ET METHODES DE
CLASSIFICATION 9
I- DECOMPOSITION DU PROCESSUS 9
1.1. La production 9
1.2. Le Transport et l'acheminement 10
1.3. La Distribution 10
II- IMPACTS ET EFFETS 11
2.1. Economique 11
2.2. Sanitaire 11
2.3. Sécuritaire 12
III- INCIDENCE DE LA CLASSIFICATION, REPARTITION DE LA
PRODUCTION ET
DONNEES STATISTIQUES 14
3.1. Principes du contrôle 14
3.2. Espaces de production 15
3.3. Statistiques 16
CHAPITRE II : LE DROIT DES STUPEFIANTS AU NIVEAU
INTERNATIONAL 19
I- LES CONVENTIONS INTERNATIONALE 19
1.1. Origines et bases historiques 19
1.2. Les conventions antérieures à celle
de 1961 20
1.3. Les conventions en vigueur aujourd'hui
21
II- ORGANES INTERNATIONAUX 23
2.1. Les organes sous l'égide des Nations Unies
23
2.2. Les organes et institutions internationales
spécialisées 24
2.3. Organisations coordonnées 25
III- FACTEURS ENTRAVANT ET OBSTACLES A LA COOPERATION
26
3.1. Corruption 26
3.2. Liberté de circulation des fonds
26
3.3. Législations inadaptées 27
CHAPITRE III : TRAITEMENT DES INFRACTIONS RELATIVES AU
TRAFIC
INTERNATIONAL DES STUPEFIANTS ET LES SANCTIONS PREVUES
29
I- ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RELATIVES AU TRAFIC
DE
STUPEFIANTS 29
1.1. L'élément légal 29
6
1.2. L'Elément matériel 31
1.3. L'Elément moral 31
II- PROCEDURE ET SANCTIONS 32
2.1. Législation non répressive et
législation répressive 32
2.2. Sanctions pénales 33
2.3. Circonstances aggravantes 34
III- LES ENQUETES DILIGENTEES DANS LE CADRE DU TRAFIC DE
STUPEFIANT
ET L'ETABLISSEMENT DE PREUVES 34
3.1. Objectif d'une enquête judiciaire sur le
trafic de stupéfiant 35
3.2. Techniques d'investigation 35
3.3. La preuve 38
CONCLUSION 40
BIBLIOGRAPHIE 42
ANNEXES 44
7
INTRODUCTION
Face au fléau mondial de trafic de substances
illicites, la communauté internationale a reconnu que ce problème
ne pouvait être efficacement réglé que s'il était
abordé de manière collective. C'est dans ce sens que les
traités des Nations Unies relatifs au contrôle des drogues ont
énoncé un ensemble de règles de droit contraignantes et
imposent aux États d'adopter des mesures juridiques, administratives et
politiques pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.
L'intérêt du sujet est de comprendre et analyser
le fonctionnement des différentes législations internationales
que nous allons détailler, tout en évoquant les entraves au
contrôle mondial des stupéfiants.
La problématique se pose en terme suivants :
nous allons montrer dans quelle mesure le système mondial de
contrôle des drogues du fait de sa logique de prohibition est une
construction juridique basée sur la morale qui doit contribuer au
renforcement du système juridique pénal national des Etats, qui
met en oeuvre des techniques d'enquête, d'investigation et des
mécanismes de répression adaptés.
C'est ainsi que nous traiterons du système
international de contrôle des stupéfiant en présentant le
processus d'écoulement, l'impact et les méthodes de
classification des stupéfiants ; le droit des stupéfiants au
niveau international avant de présenter comment sont traitées les
infractions relatives au trafic des stupéfiants au niveau international
ainsi que les sanctions prévues.
En ce qui concerne les limites de notre sujet, elles sont
fixées par le cadre conventionnel et le fonctionnement du système
international de contrôle des stupéfiants, ainsi qu'à un
échantillon représentatif des législations nationales et
aux stratégies appliquées en marge de celles-ci.
La compréhension de cette problématique à
laquelle nous allons apporter quelques éléments de réponse
nécessite au préalable de définir certains termes
constitutifs de notre thème d'étude.
8
DEFINITIONS
Une drogue est une substance naturelle ou
artificielle en mesure de modifier la psychologie et l'activité mentale
des êtres humains. Ces effets sont appelés « psychoactifs
», d'où le nom de substances psychoactives. Cette définition
assez sommaire a le mérite de mettre l'accent sur un même
dénominateur commun à toutes les drogues : la capacité
d'altérer les états de consciences et le système
nerveux.
Il faut faire la distinction entre drogue et
stupéfiant qui désignent pourtant les
mêmes substances. Le terme drogue est généralement
employé dans les cadres médicaux et sanitaires alors que le terme
stupéfiant s'utilise dans le cadre législatif
stricto sensu. Ces substances dites psychoactives font l'objet d'une liste
établie et arrêtée par l'Organisation des Nations Unies,
cette liste est régulièrement actualisée.
Les textes législatifs se réfèrent en
revanche au terme de « stupéfiants », en tant que produits
ayant des effets de modification sur la conscience, et réserve le mot
drogue à l'usage de matières premières
végétales utilisées dans un but de plaisir ou
thérapeutique.
Le trafic de stupéfiants ou
narcotrafic désigne les échanges commerciaux
illégaux de substances psychotropes réglementées par les
différentes conventions de l'ONU (1961, 1971 et 1988).
9
CHAPITRE I : PROCESSUS, IMPACT ET METHODES DE
CLASSIFICATION
Le trafic illicite de stupéfiants se déroule
suivant un processus complexe mettant en réseau des systèmes de
production, de distribution dont la finalité est le blanchiment
d'argent.
La création de cette économie
souterraine a un impact négatif sur les plans sanitaires et
sécuritaires, mais également sur le développement durable.
Tous ces facteurs induisent la mise en oeuvre d'un système de
normalisation, de classification et de statistique indispensables à la
maîtrise des principes de contrôle domaines de
production.
C'est ainsi que nous présenterons successivement le
processus d'écoulement des drogues, leur impact et effet sur
l'économie, la santé et l'environnement avant de présenter
l'incidence de la classification et des données statistiques.
I- DECOMPOSITION DU PROCESSUS
Il n'existe pas de circuit homogène pour les
différents produits (cannabis, héroïne, cocaïne, crack,
ecstasy...), pour lesquels la production, la transformation et la distribution
obéissent à des logiques et à des fonctionnements
spécifiques.
Plusieurs conditions favorisent l'implantation d'un continuum
entre l'économie légale (formelle) et l'économie
souterraine (informelle). En fonction de la variabilité des produits et
des niveaux de distribution, on peut citer cinq phases : la production, le
transport, la distribution dont l'aboutissement est le blanchiment des sommes
récoltées.
1.1. La production
La production de drogue se caractérise
souvent par une forte spécialisation régionale car, les
cultivateurs ont eu tendance à pratiquer des mises en culture mixte,
mêlant sur de mêmes parcelles des cultures illicites et des
cultures licites.
Cependant, Les paysans producteurs ne perçoivent qu'un
faible pourcentage du revenu généré par ce trafic et ce
qui a suscité une spécialisation de ces cultivateurs vers la
transformation primaire des produits.
1.2. Le Transport et l'acheminement
Le parcours de la zone de production vers la zone
de consommation nécessite l'implication de nombreux
intermédiaires. Plusieurs étapes émergent :
la transaction entre le producteur et le trafiquant, le conditionnement de la
marchandise, puis la façon dont le trafiquant achemine le produit
jusqu'à un port ou un aérodrome, et enfin la manière dont
le produit traverse la frontière (Go slow et Go fast) jusqu'à la
distribution à des grossistes nationaux.
1.3. La Distribution
Elle est organisée en structure pyramidale
aboutissant à un modèle que l'on nomme « supermarché
» qui est un système de distribution en flux continu dans une
grande agglomération. L'analyse des carnets de
comptabilité établis sur 80 jours pour les gros dealers
(rabatteur), ou narcotrafiquants, qui s'occupent de transactions de plusieurs
kilogrammes, alors que les petits dealers, ou revendeurs de rue souvent usagers
eux-mêmes et s'occupent des transactions avec le consommateur final, il
s'agit du « trafic de fourmis »1. (Christian BEN LAKHDAR,
2016)
La finalité de ces activités est le
blanchiment d'argent qui est un processus servant à
dissimuler la provenance criminelle de capitaux afin de les réinvestir
dans des activités légales. Les techniques de blanchiment
d'argent, qui varient considérablement et sont souvent très
complexes, se déroulent généralement en trois
étapes : le placement, la dispersion et l'intégration,
entraînant des impacts et effets néfastes sur des secteurs
d'activités distincts.
10
1 Christian BEN LAKHDAR, 2016
11
II- IMPACTS ET EFFETS
Le trafic de stupéfiants est une
activité difficile à contrôler du fait que les
protagonistes représentés par les producteurs, les vendeurs et
les consommateurs usent de perspicacité pour éviter de se faire
déceler. Cette activité peut avoir un triple impact :
économique, sanitaire et sécuritaire.
2.1. Economique
L'impact économique du trafic illicite de
stupéfiants est estimé à 2,3 milliards d'euros
dominé par le cannabis. Celui-ci générerait
la moitié de ce marché (48%), suivi de près (en chiffre
d'affaires) par la cocaïne (38%). Il existe une volonté actuelle
par les institutions européennes d'introduire la production et le trafic
de drogue dans le calcul du PIB car, bien qu'illégal dans la
quasi-totalité des pays, il s'agit d'une activité qui participe
à la création de richesse2 (GROUSSIN, 2015).
L'infiltration du tissu économique par ces substances
généralement destinées à la grande consommation a
un impact négatif sur la santé des consommateurs.
2.2. Sanitaire
Selon l'Office des Nations unies pour la Drogue et
le Crime, 29 millions de personnes souffrent de troubles liés à
l'usage des drogues dans le monde3 (UNODC, Rapport
mondial sur les drogues , 2016). L'usage est une consommation de drogue(s) qui
peut selon les cas :
V' N'entraîner ni complication pour la
santé, ni trouble du comportement ayant des conséquences nocives
sur l'entourage. C'est le fait de l'usager occasionnel ;
V' Causer quelques complications de santé ou
troubles du comportement n'ayant pas de conséquences nocives sur
l'entourage. C'est le fait de l'usager modéré.
V' Provoquer des dommages physiques, affectifs,
psychologiques ou sociaux, pour le consommateur ou son environnement. C'est le
fait de l'usager intensif.
En effet, la drogue présente indubitablement des
caractéristiques qui la rendent dangereuse pour la santé et la
vie sociale de ses consommateurs : addiction, overdoses, maladies, repli sur
soi, licenciement, amendes et séjours en prison sont
2 GROUSSIN, 2015
3 UNODC, Rapport mondial sur les drogues , 2016
12
autant de conséquences négatives potentielles
qui réduisent le bienêtre de ses usagers réguliers et cause
un réel problème de sécurité.
2.3. Sécuritaire
Il y a lieu de noter qu'aujourd'hui, le trafic de
drogue est combiné à celui des armes, ce qui ne peut
qu'intéresser directement les terroristes comme source de financement.
Il existe donc un lien de plus en plus étroit entre le
trafic de drogues et le financement du terrorisme.
2.3.1. Les organisations criminelles et le blanchiment
d'argent
Les groupes criminels organisés restent, par ses
impacts, une menace pour la paix et la sécurité humaine, le
développement économique, social, culturel et politique à
l'échelle planétaire. Le trafic de la drogue permet d'obtenir les
fonds nécessaires pour organiser des actions terroristes4
(Luntumbue, 2012) . Les organisations criminelles se livrent ainsi à des
échanges transfrontaliers contribuant à rehausser
l'insécurité.
La majorité de criminels se livre au blanchiment
d'argent en vue de jouir de leur richesse au sein de l'économie
formelle. Cet argent et réinjecté dans d'autres activités
pour boucler le cycle de ce trafic. En se focalisant sur le blanchiment
d'argent dans un contexte international, les gains astronomiques issus de ce
genre de commerce sont, traditionnellement, destinés au financement des
conflits et avec la montée en puissance d'organisations terroristes.
2.3.2. La Gouvernance
L'argent de la drogue finance les conflits locaux et influence
souvent négativement la stabilité et le développement. Il
est évident que la corruption liée à la cocaïne a
été très préjudiciable pour la gouvernance dans des
pays affectés par ce fléau. Il existe souvent des relations entre
de hauts responsables du gouvernement et des forces de sécurité
et les cartels de la drogue, des liens étroits entre des acteurs
politiques et des groupes criminels qui jouent un rôle dans les
bouleversements politiques et militaires.
4 Luntumbue, 2012
13
2.3.3. L'Environnement
La production de drogue de synthèse nécessite
généralement le recours à des produits chimiques, dont un
bon nombre sont nocifs pour l'environnement lorsqu'ils y sont rejetés
sous forme de déchets, ce qui menace les écosystèmes
fragiles et les populations des territoires où les laboratoires sont
situés. Divers autres effets dommageables, comme la déforestation
et l'érosion, sont également associés à la culture
du cannabis, de la coca et du pavot à opium. Bien que ces dommages
environnementaux se fassent avant tout ressentir hors de l'Europe, ils peuvent
néanmoins y avoir un impact indirect par l'intermédiaire de la
migration, de la déstabilisation et du changement climatique.
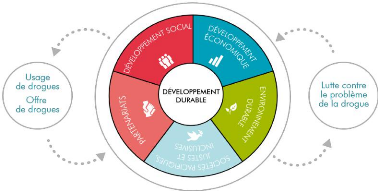
FIGURE 1 : LE PROBLÈME MONDIAL DE LA DROGUE ET
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
La nécessité de contrôler la circulation
de ces substances est liée aux dangers et risques sanitaires qu'elles
représentent. La difficulté à contrôler la
circulation des stupéfiants à l'échelle internationale est
liée à la masse financière que génère ce
marché. Il constitue une économie parallèle dont les
revenus ne sont pas négligeables. Il convient
dès lors de les classifier et d'établir des données
statistiques pour mieux les contrôler.
14
III- INCIDENCE DE LA CLASSIFICATION, REPARTITION DE LA
PRODUCTION ET DONNEES STATISTIQUES
Le contrôle de la production et des mouvements
de stupéfiants obéit à des normes universellement
établies et reconnues. Il semble indispensable de maîtriser les
principes de contrôle et les principaux espaces de production qui
permettent d'établir des données statistiques.
3.1. Principes du contrôle
Les substances stupéfiantes et psychotropes
sont soumises à un contrôle international en raison de leur
potentiel d'abus, de dépendance et de leur nocivité pour la
santé publique et le bien-être social.
L'évolution permanente et l'apparition de substances nouvelles ont
conduit à l'élaboration de techniques de la classification, et
d'un cahier de charges précis pour les Etats.
3.1.1. Modalités de classification
La convention de 1971 répartie les substances sont
réparties en quatre tableaux (ANNEXE I) allant des substances
constituant un risque particulièrement grave pour la santé en cas
d'abus et ayant une valeur thérapeutique très limitée ou
inexistante pour le tableau I à celles constituant un risque faible mais
non négligeable et ayant une valeur thérapeutique faible à
grande pour le tableau IV.
Cette classification qui détermine l'importance des
contrôles exercés, tant au niveau de leur fabrication et de leur
commerce que de leur distribution (licences, registres, statistiques,
autorisations d'exportation et d'importation) : plus les substances ont un
potentiel d'abus élevé, plus les contrôles exercés
sont contraignants.
Les listes de classement sont susceptibles d'actualisation,
après avis scientifique de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et sur décision de la commission des stupéfiants de
l'Organisation des Nations unies.
3.1.2. Obligations des États
Les conventions obligent les États parties à
prendre des mesures afin que les substances placées sous contrôle
soient utilisées exclusivement à des fins médicales ou
scientifiques. L'Organe international de contrôle des stupéfiants
(OICS) est chargé de la surveillance du respect par les États des
conventions internationales.
15
Les obligations des États sont rappelées par la
dernière convention, celle de 1988 qui dispose que « sous
réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux
de son système juridique, chaque partie adopte les mesures
nécessaires pour conférer le caractère d'infraction
pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a
été commis intentionnellement, à la détention et
à l'achat de stupéfiants et de substances psychotropes et
à la culture de stupéfiants destinés à la
consommation personnelle »5 (ONU, Convention contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988).
3.1.3. Mesures transitoires
La Convention contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes de1988, préconise une politique de
dépénalisation précise que « dans les cas
appropriés d'infractions de caractère mineur, les parties peuvent
notamment prévoir, au lieu d'une condamnation ou d'une sanction
pénale, des mesures d'éducation, de réadaptation ou de
réinsertion sociale, ainsi que, lorsque l'auteur de l'infraction est un
toxicomane, des mesures de traitement et de postcure » 6
En règle générale, qu'il soit important
ou non, isolé ou imbriqué dans d'autres structures, un
réseau de trafic de drogue est toujours organisé de la même
manière. Il comprend le fournisseur, les pourvoyeurs, les vendeurs, les
rabatteurs et les usagers.
3.2. Espaces de production
La production de la matière première
est On distingue cinq grands espaces de production :
? Le Croissant d'Or : Afghanistan, Irak, Pakistan. Il s'agit
d'une région riche en pavot à opium, à partir duquel est
obtenu la morphine et l'héroïne.
? Le Triangle d'Or : Myanmar, Laos, Thaïlande. La
production de pavot à opium mais avec une spécificité qui
réside dans les psychotropes, en particulier les champignons
hallucinogènes, et les amphétamines ;
5 ONU, Convention contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, 1988
6 (Article 3-4C)
16
? La zone andine : Bolivie, Colombie, Pérou. Ces trois
pays sud-américains représentent 98% de la cocaïne mondiale.
La surface de coca atteint 200 000 hectares dans cette région, dont la
moitié se situe en Colombie ;
? Le Maroc : le pays du Maghreb est spécialisé
dans la production de haschich, la résine de cannabis. Selon l'Organe
international de contrôle des stupéfiants (OICS), le Maroc
constitue environ 60% de la production mondiale de cannabis.
? Le Mexique : le pays est connu dans le milieu pour le
narcotrafic omniprésent et la guerre que se mènent les cartels de
la drogue.
3.3. Statistiques
Les données statistiques tirées du
rapport mondial sur les stupéfiants de 2016, publié par l'Office
nationale pour la lutte contre la drogue et le crime présentent la
situation de la consommation des différents types de substances par
continent.
3.3.1. AMERIQUE
Les Amériques demeurent les régions où
l'on consomme le plus de drogues illicites. Les taux de prévalence
annuelle de l'usage de cannabis (6,6 à 6,9 %), d'opioïdes (2
à 2,3 %), de cocaïne (1,1 à 1,2 %), de stimulants de type
amphétamine (0,9 à 1,1 %) et de substances du groupe de l'ecstasy
(0,5 à 0,6 %) restent supérieurs à la moyenne mondiale. La
consommation d'opioïdes délivrés sur ordonnance est plus
courante que celle d'héroïne.
3.3.2. ASIE
Outre le cannabis, la consommation d'opioïdes (en
particulier d'héroïne) et de stimulants de type amphétamine
est très préoccupante en Asie. La prévalence annuelle de
l'usage d'opiacés (héroïne et opium) y est comparable
à la moyenne mondiale. Alors que la consommation de cannabis et de
stimulants de type amphétamine est globalement en hausse, l'usage
d'opioïdes et d'ecstasy est jugé stable. Au Proche et au
Moyen-Orient, une augmentation de la consommation de drogues
synthétiques et de médicaments délivrés sur
ordonnance a également été signalée dans de
nombreux pays et territoires.
17
3.3.3. AFRIQUE
Nonobstant le caractère limité des
données récentes sur l'usage de drogues illicites en Afrique, la
drogue la plus couramment consommée dans la région reste le
cannabis, suivi par les stimulants de type amphétamine. Le taux de
prévalence annuelle de l'usage de cannabis est de 5,2 à 13,5 %.
L'augmentation du trafic de cocaïne via les pays côtiers d'Afrique
de l'Ouest entraîne une hausse de l'usage de cette drogue. On estime que
1,78 million d'usagers de drogues et que 221 000 usagers de drogues par
injection sont séropositifs au VIH7. (Chris Beyrer et al.,
2010)
3.3.4. EUROPE
Le cannabis, dont le taux de prévalence est de 5,2 %,
reste la substance la plus consommée en Europe, suivi par la
cocaïne, les stimulants de type amphétamine et les opioïdes
(héroïne principalement).
L'Europe occidentale et centrale demeure un marché
majeur de la cocaïne, le taux de prévalence annuelle de l'usage de
cette drogue étant d'environ 1,3 % dans la population
générale. Néanmoins, l'émergence rapide de
nouvelles drogues synthétiques et l'interaction croissante entre le
marché des «euphorisants» légaux et celui des drogues
illicites posent un problème majeur dans la région. Les
opioïdes restent les drogues les plus problématiques ; ce sont les
principales substances responsables des demandes de traitement liées
à l'usage de drogues, et ils constituent une cause majeure de
décès liés aux drogues en Europe.
3.3.5. OCEANIE
Les informations provenant d'Océanie concernent
principalement la situation et les tendances observées en Australie et
en Nouvelle-Zélande. En Océanie, les taux de prévalence
annuelle de toutes les drogues à l'exception de l'héroïne
(usage de cannabis : 9,1 à 14,6 %, usage d'opioïdes : 2,3 à
3,4 %, usage de cocaïne : 1,5 à 1,9 %, usage de stimulants de type
amphétamine : 1,7 à 2,4 %, et usage d'«ecstasy» : 2,9
%) restent nettement supérieurs à la moyenne mondiale.
7 Chris Beyrer et al., 2010
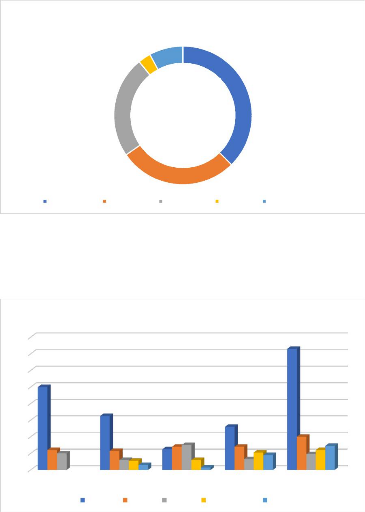
16
14
12
10
8
6
4
2
0
AFRIQUE AMERIQUE ASIE EUROPE OCEANIE
FIGURE II: PARTS DE MARCHES DES SUBSTANCES ILLICITES DANS
LE MONDE
Cannabis 38% Heroine 28% Cocaine 24% Ectasy 3%
Amphétamines 8%
FIGURE III: CONSOMMATION MONDIALE DE DROGUES
Cannabis Heroine Cocaine Amphétamines Ectasy
18
19
CHAPITRE II : LE DROIT DES STUPEFIANTS AU NIVEAU
INTERNATIONAL
La pénalisation des stupéfiants tire ses
origines de la guerre de l'Opium qui a opposé la Chine à
l'Angleterre au XIXe Siècle et surtout de l'avènement
de la consommation de cette substance aux Etats unies.
Il s'en suit l'institution de plusieurs conventions
visant à prohiber et plus tard réprimer l'usage des substances
considérées comme illicite et la création des organes
spécialisés charger de coordonner la mise en oeuvre de ces
conventions malgré des difficultés fonctionnelles
inhérentes.
Après une présentation de fondements de la
coopération internationale domaine de la lutte contre le trafic des
stupéfiants, nous étudierons sa structure avant de
d'évoquer les obstacles et entraves à cette
coopération.
I- LES CONVENTIONS INTERNATIONALE
Le Traité de Versailles qui constitue l'une
des premières codifications internationale, confie à la
Société de Nations la mission de contrôle de
l'exécution des mesures adoptées dans la lutte contre la drogue
constitue le précurseur des conventions contemporaines.
Ces dernières sont soumises à l'autorité d'organes et
organismes internationaux chargés de veiller à leur
application.
On peut distinguer de façon succincte, des conventions
antérieures à 1961 et des conventions en vigueur aujourd'hui.
1.1. Origines et bases historiques
Le contrôle du commerce des
stupéfiants tire son origine de la guerre de l'Opium entre la Chine et
l'Angleterre au XIXe Siècle. Les fumeries d'opium se sont
répandues en Asie de l'Est et du Sud-Est et une toxicomanie à
grande échelle s'est développée en conséquence En
effet, la Chine pour s'opposer à l'importation et à la
distribution par les britanniques de l'opium provenant de l'Inde sur son
territoire, va éditer plusieurs décrets prohibant le commerce de
cette substance.
20
C'est alors que ce développe un « marché
parallèle ». Suite à la saisie d'une cargaison de 20000
caisses d'opium par la Chine, elle se voit déclarer la guerre par
l'Angleterre qui la remporte et impose à nouveau l'ouverture des ports
chinois au commerce de l'Opium, la culture du Pavot et la cession de Hong Kong
(en 1858). Environ 5 à 20% de la population chinoise, soit 120 millions
de personnes est alors opiomane. Les flux migratoires de travailleurs chinois
vers les Etats Unies vont influencer les habitudes des travailleurs
américains8 (PHILIBERT, 2008).
Suite à des requêtes de syndicats auxquelles les
officiels américains sont réceptifs, il apparait un courant en
faveur de la prohibition de l'alcool et des drogues aux les Etats Unies. Ce qui
va permettre de développer un nouveau modèle basé sur
l'interdiction des produits et la criminalisation des usagers, imposant une
adhésion internationale. La première loi prohibitionniste est
mise en place en 1875 à San Francisco et proscrit l'usage de l'opium
dans les fumeries alors fréquentées par la communauté
chinoise. La Loi fédérale de 1887 interdit aux seuls chinois
d'importer de l'opium et la Loi fédérale de 1890 réserve
aux américains le droit de transformer l'opium9. (Christian
Bachmann, 1989)
En dehors des conséquences sanitaires, une des raisons
qui ont poussé les Etats Unies à devenir le chantre de la
prohibition internationale est que le commerce de ces substances dites
illicites auxquelles ils n'intervenaient qu'en tant que client, leur
échappait totalement. C'est la Conférence de Shanghai ouverte en
1909, qui consacre le socle de la prohibition des stupéfiants
intégré à la coopération internationale.
1.2. Les conventions antérieures à celle de
1961
De nombreuses conventions ont été
mises en place au cours du XXe S, renforçant sans cesse le
contrôle du commerce international des drogues de la production à
l'usage.
La convention de la Haye de 1912 vise toutes les drogues
connues et a une vocation universelle. Elle vise à rendre obligatoire
les ratifications de Shanghai et
8 PHILIBERT, 2008
9 Christian Bachmann, 1989
21
ne se limite plus à l'opium. Ce n'est que le
1er Janvier que cette convention entre effectivement en vigueur.
En 1925, la SDN organise une conférence à
GENÈVE qui va donner naissance à deux nouvelles conventions : une
convention sur la suppression du commerce et de l'usage de l'opium
préparé et une convention sur les trois grandes drogues
naturelles : l'opium brut, la coca et le cannabis et leurs
dérivés (héroïne, cocaïne et haschisch).
Cependant, deux courants s'opposent : celui de la réglementation et
celui de la prohibition.
Six autres Conventions voient le jour entre 1931 et 1953 pour
compléter ou amender les textes existants. Convention de GENÈVE
de 1931 étend le contrôle aux drogues manufacturées et
introduit la classification des drogues. La convention de BANGKOK de 1931
complète la convention sur l'opium préparé en
l'étendant aux domaines de l'extrême orient. La convention de
Genève de 1936 appuie la répression du trafic des drogues
nuisibles. Le protocole de LAKE-SUCCESS de 1946 a pour seul objet le transfert
des compétences de la SDN en matière de contrôle à
l'Organisation des Nations Unies10 (OICS, 2016). Le protocole de
Paris de 1948 met en place un système permettant d'intégrer les
nouvelles drogues et une procédure de veille par l'organisation mondiale
de la santé. Le protocole de New York de1953 étend le
contrôle international à la culture du pavot cependant il fait
exception sur sept pays qui sont autorisés à produire.
1.3. Les conventions en vigueur aujourd'hui
La convention unique de 1961 sur les
stupéfiants, modifiée par le protocole de 1972, comporte 183
signataires au 1er Novembre 2005, son objectif est de limiter la
production et le commerce de substances interdites figurant sur une liste
préétablie de stupéfiants. Cette convention
a un triple but de codifier les traités multilatéraux existants,
simplifier les organes internationaux et étendre le contrôle
à la culture des plantes destinées à produire les
stupéfiants. Ce texte fondamental abroge et remplace tous les
traités antérieurs. Elle est axée sur la répression
et s'applique à 120 plantes et substances naturelles ou
synthétiques classées dans quatre tableaux
numérotés de I à IV11 (Convention unique en
annexe).
10 OICS, 2016
11 Convention unique en annexe
22
Le protocole additionnel de 1972 renforce et étend les
pouvoirs de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants
(OICS) pour faire respecter la convention, car il peut directement interpeller
un Etat responsable de manquement en proposant une étude ou une
assistance technique ou financière.
La convention de Vienne de 1971 sur les psychotropes est
ratifiée par 179 signataires. Son objectif est de limiter la production
et le commerce des substances psychotropes synthétiques en
établissant une liste de ces substances. Cependant elle reconnait les
besoins sur le plan médical et en définit une politique de mise
en oeuvre. Elle s'applique à 111 substances classées en
hallucinogènes, amphétamines, barbituriques et
tranquillisants.
La convention de de Vienne de 1988 contre le trafic illicite
de stupéfiants et de substances psychotropes vise à combattre le
commerce illicite par diverses sanctions et mesures à différents
niveaux. Elle lutte également contre l'acquisition et la
détention de stupéfiants en tant qu'actes préparatoires
à la consommation. Elle a été ratifiée par 142
Etats et élabore des infractions englobant la fabrication, le recel de
précurseurs, le blanchiment, l'incitation au trafic et de façon
générale tous les actes liés au trafic. La
détention et l'acquisition de stupéfiants ou psychotropes
à des fins personnelles sont également
visées12. Cette convention renforce les procédures
pénales en ce qui concerne l'extradition, l'entraide judiciaire
internationale13 et instaure une procédure des «
livraisons surveillées »14. C'est le texte le plus
représentatif pour la coopération internationale pour la lutte
contre la drogue.
L'opium et le cannabis, ont longtemps été
consommés en Asie et, plus tard, en Afrique et en Europe ; il en est de
même pour la feuille de coca dans la sous-région andine et pour le
khat dans les pays de la région du golfe d'Aden. En outre, l'usage d'un
certain nombre de plantes hallucinogènes existe aussi depuis longtemps.
La consommation traditionnelle de drogue était dans une large mesure
limitée à des événements religieux et sociaux
spécifiques, ainsi qu'à certains usages médicaux. Cette
réalité a changé au XIXe siècle, lorsque l'opium a
commencé à générer une
12 Article 3
13 Article 7-9
14 Article 11 convention de de Vienne de 1988
23
activité économique importante. Plusieurs
organes internationaux agissent en synergie pour un contrôle
international optimal des stupéfiants.
II- ORGANES INTERNATIONAUX
Plusieurs organes interviennent dans le contrôle
international des stupéfiants. Il faut distinguer ceux qui
dépendent de l'ONU des autres institutions internationales
spécialisés.
2.1. Les organes sous l'égide des Nations Unies
2.1.1. La commission des stupéfiants
C'est l'une des six commissions du Conseil économique
et social, placée sous l'autorité de l'Assemblée
générale. C'est le principal organe de prise de décisions
au sein du système international des Nations unies pour le
contrôle des drogues. Cette commission est
constituée de 53 membres élus pour une durée de quatre
ans. Elle a pour mandat de superviser les efforts internationaux en
matière de contrôle de la consommation et des mouvements des
stupéfiants. Elle assiste le conseil économique et social pour la
surveillance de l'exécution des traités internationaux dans son
domaine de compétence.
2.1.2. L'organe international de contrôle des
stupéfiants (OICS)
C'est un organe d'experts indépendant et quasi
judiciaire qui a pour mission de s'assurer que les produits
réglementés par les différentes conventions sont
disponibles pour des usages à des fins médicales et
scientifiques. Il surveille l'application des mesures pour éviter un
détournement de ces produits et le cas échéant, il peut
avoir un rôle de conseil afin de remédier aux lacunes
constatées. Deux projets, à savoir le « Projet
cohésion » et le « Projet PRISM » ont été
lancés sous les auspices de l'OICS. Ces projets visent à aider
les gouvernements à lutter contre le trafic illicite/le
détournement des précurseurs chimiques et des drogues de
synthèse. Cet organe qui est constitué de treize membres avec
lesquels il collabore, dispose d'un panel de mesures répressives :
demande d'explication, injonction, recommandation d'embargo, publication
d'informations officielles.
2.1.3. Le programme des nations unies pour le
contrôle international des drogues (PNUCID)
Il fait partie de l'Office international de lutte contre la
drogue et le crime basé à Vienne et définit l'orientation
en matière de contrôle international des drogues, suit les
tendances en matière de production, de consommation et de trafic de
drogues et favorise l'application des traités relatifs au contrôle
des drogues. Il tient lieu de centre mondial de connaissances
spécialisées et d'informations sur le contrôle
international des drogues. Il constitue l'organe de coordination et de
coopération technique au niveau international.
Secrétariat Général
Conseil économique et social


24
Commission des
OICS PNUCID stupéfiants
FIGURE IV : ORGANIGRAMME SIMPLIFE SYSTEME ONUSIEN
CONTRE LA
DROGUE
2.2. Les organes et institutions internationales
spécialisées
2.2.1. L'Organisation internationale de la police
criminelle (OIPC-INTERPOL)
Cet organe a pour mission de coordonner l'action des polices
nationales, dans l'objectif de prévenir et de réprimer les
délits de droit commun ainsi que les crimes. Elle dispose de 138 bureaux
nationaux dans chacun des pays membres qui consacrent la moitié de leurs
activités à l'analyse du renseignement en matière de lutte
contre la drogue.
2.2.2. L'organisation mondiale des douanes
25
C'est une organisation intergouvernementale, qui a son
siège à Bruxelles en Belgique. Ses membres étant
répartis dans le monde entier, elle élabore des conventions
internationales, instruments et outils, notamment sur les substances illicites.
L'OMD gère en outre la nomenclature internationale des marchandises
appelée Système harmonisé (SH) et les aspects techniques
des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur
l'évaluation en douane et les règles d'origine.
2.2.3. L'organisation mondiale de la santé
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est la seule
agence traitant de toutes les substances psychotropes quel que soit leur statut
juridique. Son mandat dans le domaine de la consommation de substances
psychotropes comprend : La prévention et la réduction des
conséquences sanitaires et sociales de l'utilisation de substances
psychotropes ; La réduction de la demande de consommation non
médicale de substances psychotropes ; L'évaluation des substances
psychotropes afin de conseiller l'Organisation des Nations Unies (ONU) à
l'égard de leur contrôle réglementaire15.
2.3. Organisations coordonnées
D'autres initiatives moins globales regroupent les pays d'un
même continent ou d'une même sous-région. On peut citer
parmi les plus représentatives : L'Observatoire européen des
drogues et des toxicomanies (OEDT) créé en 1993 est une agence de
l'Union Européenne qui fournit des renseignements à
l'échelon européen en ce qui concerne les drogues, la
toxicomanie.
Le Pacte de Paris constitue une initiative de partenariat
regroupant 50 pays, ayant vu le jour à l'occasion de la réunion
ayant abouti à la déclaration de Paris. Cette initiative vise
à lutter contre le trafic d'opiacés afghans, la consommation et
les problèmes connexes dans les pays prioritaires touchés le long
des « routes du trafic ». Il réaffirme les engagements des
membres de la communauté internationale en faveur de la lutte contre le
trafic d'opiacés et renforce la coopération entre les
partenaires.
Malgré tout cet arsenal, plusieurs facteurs semblent
entraver la cohésion et le fonctionnement de la lutte contre le trafic
international de substances illicites.
15
https://onu-vienne.delegfrance.org/action-internationale-en-matiere-de-lutte-contre-la-drogue-1243
26
III- FACTEURS ENTRAVANT ET OBSTACLES A LA
COOPERATION
Il existe un risque d'infiltration des forces de
sécurité par des groupes criminels et, à plus ou moins
brève échéance, à leur contrôle par ces
derniers. Plusieurs facteurs peuvent ainsi contribuer à réduire
significativement les actions de lutte engagées notamment la corruption,
la difficulté en contrôler la circulation des fonds et
l'inefficacité des textes législatifs qui peuvent parfois
être contournés.
3.1. Corruption
L'autorité des gouvernements peut
être discréditée par la corruption des agents publics, des
policiers et du pouvoir judiciaire, ainsi qu'au niveau politique, ce qui a un
effet destructeur et permet au marché illégal de fonctionner plus
facilement. La corruption ou la coercition des professionnels du
secteur privé est également couramment pratiquée par les
groupes criminels afin de contourner la réglementation en matière
de blanchiment d'argent et mener leurs activités illégales au
sein de l'économie légale16 (Europol, 2016).
Les trafiquants établissent aisément des
relations avec des personnes influentes et soient capables de mettre en place
et de faire fonctionner des réseaux sociaux informels, ce qui leur
permet d'éviter de se faire repérer17 (Lacher,
2012).
Le développement et la stabilité sont mis
à mal dans les pays producteurs de drogue ou dans les pays de transit.
L'infiltration et l'affaiblissement potentiel des organes de contrôle des
frontières constituent de véritables menaces. La facilité
d'accès à l'argent de la drogue (et d'autres formes
d'activités relevant de la criminalité organisée) peut
exercer des pressions supplémentaires sur des systèmes politiques
vulnérables et accroître le risque de polarisation et de violence
dans le cadre des processus électoraux.
3.2. Liberté de circulation des fonds
D'une manière générale,
l'argent de la drogue provient de plusieurs sources : la production locale ou
la vente de stupéfiants importés ; le « rapatriement du
produit de la drogue » ; l'argent généré par les
passeurs de
16 Europol, 2016
17 Lacher, 2012
27
drogues ; et les bénéfices
générés par les activités secondaires liées
au trafic de drogues. Les trafiquants « emploient des moyens
complexes pour blanchir les capitaux produits par le trafic de
stupéfiants, notamment le recours à des avocats, à des
bureaux de change, à des échanges commerciaux, à des
passeurs, à des sociétés-écrans, à l'achat
de biens immobiliers, d'hôtels, de casinos.
Toutefois, il faut noter l'inefficacité du ciblage des
parrains de la drogue en l'absence de stratégies de suivi : «
cibler les principaux barons de la drogue n'est pas suffisant en soi :
inévitablement, ces derniers sont remplacés par l'un de leurs
subordonnés, le groupe se désintègre ou des groupes rivaux
absorbent sa part de marché.
3.3. Législations inadaptées
La circulation de nouvelles substances est souvent
favorisée par un vide législatif en ce qui concerne les nouvelles
variétés. Un nombre et des variétés
sans précédent de nouvelles substances psychoactives, souvent
vendues sous le nom de « sels de bain », d' « euphorisants
légaux » ou d'« engrais », apparaissent sur le
marché. Pour éviter d'être détectées, les
organisations de trafiquants de drogues ont toujours fait preuve d'un
extraordinaire degré de flexibilité dans l'adaptation de leurs
stratégies de fabrication. Parmi ces stratégies, on peut citer
l'utilisation de produits chimiques de remplacement, l'extraction de
précurseurs à partir de préparations pharmaceutiques et,
plus récemment, l'opération consistant à masquer les
précurseurs et l'élaboration de méthodes alternatives de
synthèse. Les évolutions constantes du processus de fabrication
illicite de substances synthétiques posent de nouveaux défis aux
autorités de contrôle des drogues à travers le monde. Les
organismes de réglementation de la plupart des pays ont des
difficultés à faire face à la rapidité de
l'évolution technologique et à la faculté d'adaptation des
criminels aux nouvelles technologies. De plus, Internet n'étant pas
réglementé au niveau international, il est difficile de
contrecarrer les opérations internationales des criminels
Les ravages causés dans le passé par les
stupéfiants ont contribué à leur pénalisation et
à l'adoption d'un système international de contrôle. Le
déroulement de ce processus a connu des difficultés, mais son
aboutissement a permis la mise en place de plusieurs conventions sous
l'égide des Nations unies. L'avènement de nouvelles technologies
de communication, notamment
28
Internet semble créer un nouveau marché
difficile à réglementer et à contrôler. Il parait
impératif de s'arrimer aux évolutions technologiques afin
d'apporter une réponse adaptée aux infraction relatives au trafic
international de stupéfiants.
29
CHAPITRE III : TRAITEMENT DES INFRACTIONS RELATIVES AU
TRAFIC INTERNATIONAL DES STUPEFIANTS ET LES SANCTIONS PREVUES
Si la Convention de New York sur les
stupéfiants prône une législation pénale rigoureuse
en la matière, elle ne vise cependant que des actes techniquement
accessoires à l'usage de drogue (exportation, importation, transport,
vente etc.), sous cette réserve qu'elle prohibe de manière
générale la détention de stupéfiants. Elle
laisse par là même toute liberté aux différents
législateurs quant à l'attitude à adopter face aux actes
principaux, c'est-à-dire essentiellement face à l'usage de
stupéfiants18. C'est pourquoi on peut rencontrer de nos jours
aussi bien des systèmes non-répressifs que des systèmes
répressifs. Il ne faudrait cependant pas croire que ces deux
procédés s'opposent ; certains aménagements permettent en
effet de les orienter tous deux dans le sens de la prévention.
La condition essentielle pour qualifier une infraction
à la législation sur les stupéfiants doit réunir
les éléments suivants : Elément légal ;
élément matériel, élément moral,
circonstances aggravantes, répression.
I- ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RELATIVES
AU
TRAFIC DE STUPEFIANTS
Les éléments indispensables qui doivent
constituer une infraction à la législation sur les
stupéfiants sont : l'élément légal,
l'élément matériel et l'élément
moral.
1.1. L'élément légal
Il repose sur trois bases légales : la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée
par le Protocole de 1972 portant
18 ONU, Article 33: Les parties ne permettront pas
la détention de stupéfiants sans autorisation légale,
1961
30
amendement de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 ; La convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et les
régimes constitutionnels, juridiques et administratifs
nationaux.
La convention sur les stupéfiants de 1961 reconnait
certes « l'usage médical de certaines
substances et élabore les dispositions pénales applicables sous
réserve des dispositions constitutionnelles de chaque partie
»19. Elle précise également «
l'ensemble des substances soumises au contrôle
international et leurs caractéristiques, ainsi que les
modalités de ce contrôle. Les substances sont inscrites dans
quatre tableaux (I, II, III, IV) ». Cette convention précise
les conditions d'extradition et de règlement des différends entre
deux ou plusieurs parties20.
La convention contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes précise les règles de livraison
surveillée. Elle préconise aux Etats de prendre les dispositions
nécessaires pour que les transporteurs commerciaux prennent des
précautions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de
transport ne servent à la commission des infractions relatives aux
stupéfiants21.
Le cadre légal commun à ces 2 convention dispose
du traitement à réserver contre le trafic illicite en mer, il
précise également les modalités d'utilisation des services
postaux, de transfert des procédures répressives et de
Règlement des différends.
Dans le cadre du trafic illicite par mer, une Partie qui a des
motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la
liberté de navigation conformément au droit international et
battant le pavillon ou portant une immatriculation d'une autre Partie se livre
au trafic illicite peut le notifier à l'État du pavillon,
demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est
confirmée, demander l'autorisation à cet État de prendre
les mesures appropriées à l'égard de ce navire.
19 Article 36 Convention unique sur les
stupéfiants de 1961
20 Article 30 Convention unique sur les
stupéfiants de 1961
21 Article 15 Convention contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes de 1988
31
« Les Etats doivent prendre toutes les dispositions
nécessaires pour éviter des trafics illicites de
stupéfiants dans les Zones franches »22 et par le
biais de l'utilisation des services postaux23.
1.2. L'Elément matériel
Il est constitué par le transport, la
détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de
stupéfiants.
V' Le transport : C'est le fait de
transporter des produits stupéfiants sans une autorisation de
l'administration. Le fait d'être trouvé porteur de
stupéfiants sur la voie publique caractérise à la fois le
délit de détention et celui de transport.
V' La détention : Elle s'applique
à toute personne en possession de stupéfiants. La
détention peut être retenue à l'encontre d'un individu si
les stupéfiants ne se
trouvent pas sur sa personne mais à quelques mètres
dans une cache.
V' L'offre : correspond à l'instant
qui précède la remise. L'acte matériel de remise n'a pas
encore eu lieu, on propose des stupéfiants.
V' La cession : signifie que le produit a
changé de mains. La transaction est déjà
réalisée.
V' L'acquisition : C'est le résultat
de l'offre ou de la cession pour celui qui reçoit le produit
stupéfiant.
V' L'emploi se distingue de l'usage, il
s'applique à toute utilisation de produits stupéfiants en dehors
de la consommation.
Tous ces éléments n'ont de valeur juridique que
s'ils sont associés à une intention coupable.
1.3. L'Elément moral
L'intention coupable est requise ; elle sera mise
en évidence aussi bien par les actes matériels que par le profit
tiré de ces actes. L'absorption ne serait donc pas
punissable si la personne consommait des stupéfiants à son insu
ou dans le cadre d'un traitement médical. Dans l'élaboration de
la chaîne répressive, l'incrimination est l'étape
première et fondatrice, qui permettra d'envisager une répression
effective.
22 (Art18)
23 (Art19)
32
C'est « le fait pour les Etats ou les organisations
internationales, par voie conventionnelle ou coutumière, de constituer
un comportement en infraction »24 (Salmon, 2001). L'incrimination est
indirecte lorsque la norme internationale ne fera que prohiber le comportement
dénoncé, laissant aux Etats toute faculté pour le
définir et le rendre punissable en droit interne. Par opposition,
l'incrimination est directe si la norme internationale prévoit, une
définition complète et précise du crime, ainsi que les
modalités de répression, qui s'imposent aux Etats.
Dans les deux cas, des mesures nationales d'exécution
seront requises, afin de rendre l'incrimination effective en droit national.
II- PROCEDURE ET SANCTIONS
Les dispositions pénales sont
précisées dans l'Article 36 de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 et précisent que, « Sous réserve
de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures
nécessaires pour que toute infraction à la législation sur
les stupéfiants soit punie lorsqu'elle est commise intentionnellement
».
2.1. Législation non répressive et
législation répressive
L'action non répressive consacre l'usage de
drogue comme simple délit civil alors que les législations
répressives confortent la règle morale condamnant l'usage de
stupéfiants. Partant de l'idée que les toxicomanes
sont des malades à l'égard desquels il ne serait pas
légitime de sévir, certains législateurs n'incriminent pas
au pénal l'usage occasionnel ou habituel de stupéfiants. Si dans
cette doctrine l'usage de stupéfiants ne constitue pas un délit
pénal, il présente néanmoins un caractère illicite.
Soucieux de se donner des armes pour contraindre les toxicomanes à
suivre une cure de désintoxication, les tribunaux de certains Etats ont
cependant jugé délictueux le fait de détenir des
stupéfiants, même pour son usage personnel25
(Ministère de la Justice, 2004).
Pour les législations répressives, le
délit d'usage de stupéfiant se définit rationnellement
comme le fait pour une personne d'absorber, par quelque moyen que
24 Salmon, 2001
25 Ministère de la Justice, 2004
33
ce soit, hors de toute prescription médicale, une
substance de nature à porter atteinte à son équilibre
psychique. Vu sous cet angle, le recours au droit criminel apparaît comme
un moyen de contraindre un malade à se soigner et s'inscrit dans la
continuité de l'action engagée au niveau international.
2.2. Sanctions pénales
Les infractions graves doivent être
passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou
d'autres peines privatives de liberté. Il faut
préciser que des sanctions complémentaires sont prévues
nonobstant les dispositions de la condamnation et de la sanction pénale,
il s'agit notamment de soumettre ces personnes à des mesures de
traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation et de
réintégration sociale. Les condamnations prononcées
à l'étranger pour ces infractions seront prises en
considération aux fins d'établissement de la récidive
qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers et seront
poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a
été commise, ou par la Partie sur le territoire de laquelle le
délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable
conformément à la législation de la Partie à
laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas
été déjà poursuivi et jugé.
Certains Etats ont instauré une sanction secondaire
représentée par l'Amende dont le calcul se fait
proportionnellement au volume de drogue détenue de manière
illicite. Les juridictions prennent comme référence de valeur,
non le cours officiel, mais le cours réel du marché quoiqu'il
s'agisse d'un marché illégal. C'est une application notable du
principe voulant que le droit criminel saisisse les faits à
l'état brut, sans les déformer en les faisant passer par un
filtre juridique.
Aussi la plupart de ces législations
subordonnent-elles, tant l'exercice des poursuites, que l'application des
sanctions, au refus par le prévenu de se soumettre à une cure de
désintoxication. Le régime de cette circonstance
exonératoire appelle deux observations. Tout d'abord, puisqu'elles sont
favorables à la défense, ces dispositions légales peuvent
être interprétées de manière extensive. D'autre
part, dans la mesure où elle constitue non une peine mais un traitement
médical, la décision de justice peut être accomplie dans un
établissement situé dans un pays étranger par exception au
principe de la territorialité des lois criminelles.
34
Enfin, dans un tel système il est clair que le
législateur peut incriminer tout à la fois, et le fait de se
procurer ou de détenir des stupéfiants pour son usage personnel,
et le fait de se procurer ou de détenir des instruments destinés
à faire usage de stupéfiants.
2.3. Circonstances aggravantes
Les circonstances aggravantes peuvent être
universellement reconnues et résident dans le fait que le trafic est
commis en bande organisée, autrement dit par une association de
malfaiteurs mais également la cession de drogue à un
mineur. Il s'agit de circonstances aggravantes qui pèsent
sur tous les auteurs, coauteurs et complices. Au demeurant, en scène
technique juridique on ne conçoit pas que l'usage de stupéfiant
soit considéré comme licite, et qu'une personne puisse être
condamnée pour l'avoir facilité. Seul le fait de se faire
délivrer des stupéfiants à l'aide d'une fausse ordonnance
peut alors logiquement être déclaré punissable.
Par ailleurs, il y a concours d'infractions si la personne qui
a fait usage de stupéfiants en est décédée.
III- LES ENQUETES DILIGENTEES DANS LE CADRE DU TRAFIC
DE STUPEFIANT ET L'ETABLISSEMENT DE PREUVES
Une enquête à propos des activités
illégales d'un réseau international de trafic de
stupéfiants ne peut réussir que si l'enquêteur est à
même d'identifier le rôle de chacun de ses membres, et ainsi
connaître ceux auprès desquels il lui sera possible de recueillir
les indices lui permettant d'orienter utilement ses investigations. Il
peut alors s'agir d'un transport, ou d'une importation à un passage
frontière ou encore de contrebande au regard des douanes. La
détection de l'usage de stupéfiants lors d'un contrôle
routier relève, de l'initiative des services de police et de
gendarmerie. L'usage peut être constaté à l'occasion d'un
contrôle d'identité sur la voie publique. Les infractions
relatives aux produits stupéfiants constituent l'une des formes de
criminalité.
3.1. Objectif d'une enquête judiciaire sur le trafic
de stupéfiant
35
Dans le cadre des enquêtes dépassants
les frontières des Etats, la convention des nations unies sur le trafic
illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988
prévoit des règles de saisine d'une partie par une autre par la
mise en oeuvre de mécanisme de coopération, notamment la
commission rogatoire internationale délivrée dans le cadre de
l'entraide judiciaire. La particularité de
l'exécution de cette commission rogatoire réside dans sa
transmission. En effet, cet outil pourrait être transmis par voie
diplomatique directement aux autorités judiciaires de l'Etat requis ou
à un réseau de police compétent, tel que l'Organisation
internationale de police criminelle (INTERPOL) dont le rôle et
l'efficacité sont reconnus par plusieurs conventions internationales.
Les modalités d'exécution restent la seule prérogative de
l'Etat requis conformément aux lois qui régissent le
fonctionnement de ses juridictions.
L'entraide judiciaire est un processus permettant aux
États de s'entraider pour recueillir des éléments de
preuve dans des affaires pénales26 (UNODC, Manuel sur
l'entraide judiciaire et l'extradition., 2016). La saisine se fait par le biais
d'une commission rogatoire internationale.
3.2. Techniques d'investigation
3.2.1. La saisine : Commission rogatoire
internationale
La commission rogatoire internationale en matière
pénale est un mandat relatif donné par l'autorité
judiciaire d'un Etat à une autorité judiciaire
étrangère afin qu'elle procède, en ses lieux et place,
à un ou plusieurs actes d'instruction spécifiés dans le
mandat. Il ne s'agit pas, comme en droit national, d'un mandat
impératif, mais d'une demande d'entraide qui peut être
refusée par la partie requise. Elle ne doit pas comporter de
délai d'exécution mais peut toutefois suggérer une
célérité. Elle doit réunir des conditions de fond
et de forme telles que fixées par l'article 14 de la Convention
d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 : Le
requérant (Etat, juridiction, juge) ; Le requis (Etat, autorité
judiciaire) En cas du moindre doute, il convient d'utiliser aussi la formule
« Toute autorité judiciaire compétente ». Les
faits déterminant la saisine et la demande d'investigation. Il convient
d'être précis et synthétique (un résumé
très court peut très bien précéder leur
description). Le résumé
26 (UNODC, Manuel sur l'entraide judiciaire et
l'extradition., 2016
36
doit mettre en relief d'une part les éléments
constitutifs, d'autre part le rôle des personnes concernées, et
situer les investigations demandées. Les dispositions suivantes doivent
également figurer dans la CRI : la description de la nature de
l'enquête ou de la procédure ; la description des
éléments de preuve recherchés ou de toute autre forme
d'entraide sollicitée (le cas échéant, une liste de
questions si l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'une personne
est demandée) ; le texte de la loi pénale applicable ; toutes
précisions utiles sur les formes spéciales que l'Etat
requérant souhaite voir appliquer.
En cas d'urgence, les modalités d'exécution
entraînent souvent le déplacement du juge mandant ou de ses
Officiers de Police Judiciaire et n'agissent qu'en qualité de
témoins aux actes posés par les autorités judiciaires dans
le pays requis sous peine de nullité de la procédure. Cette
urgence est limitée aux cas de détention, de disparition des
preuves ou des gens. Tout déplacement de l'Officier de police judiciaire
à l'étranger ne peut avoir pour objet que l'assistance, et non
l'exécution. Il doit avoir pour objectif l'accélération
des investigations, et le retour immédiat fréquent d'une copie
des pièces d'exécution.
3.2.2. Les perquisitions
En principe, la perquisition a lieu au domicile de la personne
mise en cause, sachant que les tribunaux donnent une définition
extensive de la notion de domicile, qui s'entend de tout lieu, que la personne
y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quel que soit
le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux.
« Les perquisitions relatives à des infraction à la
législation sur les stupéfiants ne sont pas soumises au respect
du cadre légal des horaires »27; de nuit, elle ne
pourra se faire que dans des locaux où l'on use de stupéfiants en
groupe ou dans ceux dans lesquels sont fabriqués, transformés ou
entreposés des stupéfiants.
« La perquisition ne peut se justifier que par la
recherche de la vérité au sujet d'une infraction sur laquelle est
faite une enquête » 28. « La perquisition
se fera donc dans un lieu où peuvent se trouver des objets dont la
découverte serait utile à la vérité. Mais ce lieu
n'est pas obligatoirement le domicile de l'auteur présumé
de
27 Article 706-28 du Code de Procédure
Pénale
28 Articles 56 et 94 du Code de Procédure
Pénale
37
l'infraction »29. La perquisition ne
peut porter que sur des objets qui ont un lien avec l'infraction, exemple : si
l'enquête porte sur un vol de mobylette, la police n'a pas le droit de
retourner les pots de fleurs.
« La perquisition doit se faire en présence de
la personne au domicile de laquelle elle est faite »30. En
cas d'impossibilité, elle sera invitée « à
désigner un représentant de son choix ». A
défaut, deux témoins seront requis par l'officier de police
judiciaire, lesquels ne devront pas relever de l'autorité de la personne
mise en cause. Ce sont souvent des voisins. Ce ne peuvent pas être des
policiers. Ces personnes doivent assister à toutes les
opérations. Il existe toutefois des dérogations
délivrées par l'autorité judiciaire ayant ordonnée
l'enquête.
Les perquisitions ainsi effectuées ne peuvent avoir
pour objet que la recherche et la constatation des infractions pour lesquelles
elles ont été autorisées. Toute constatation ou saisie
incidente serait frappée de nullité.
3.2.3. Les Auditions
Elles concernent essentiellement toute personne contre
laquelle il existe des indices graves et concordants de participation à
des faits susceptibles de constituer une infraction à la
législation sur les stupéfiants. L'audition doit se
dérouler dans les formes du CPP, notamment pour le mis en examen et le
témoin assisté, et donc préciser son statut exact, ce qui
peut entraîner la question de la présence de l'avocat. Il faut
prendre en considération les conséquences de
l'interprétariat dans la formulation des questions et des
réponses. La liste des questions doit être précise.
Les témoignages permettent d'expliquer les
constatations réalisées et ne prennent valeur de preuve que s'ils
sont répétés devant les juridictions de jugement.
Lorsque les nécessités de l'enquête ou de
l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne,
ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes, peuvent être
effectuées simultanément dans différents Etats.
Lorsqu'il est nécessaire d'avoir recours à un
interprète et que celui-ci se trouve dans l'impossibilité de se
déplacer, les enquêteurs ont la possibilité d'avoir
29 Article 96 du Code de Procédure
Pénale
30 Article 57 du Code de Procédure
Pénale
38
recours à son assistance pour les besoins d'une
audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation par l'intermédiaire
de moyens de télécommunications.
3.3. La preuve
Les agents des douanes et les officiers de police
judiciaire recueillent des éléments de preuve et localisent les
avoirs. Ils peuvent agir seuls ou au sein d'une équipe
d'enquêteurs spécialisés et, en fonction des lois et des
pratiques nationales, travailler sous la supervision des procureurs ou des
juges d'instruction ou en étroite collaboration avec eux.
Outre qu'ils rassemblent des informations accessibles au public et des
renseignements provenant des bases de données des douanes, de la police
ou d'autres organismes gouvernementaux, ils peuvent utiliser des techniques
d'enquête spéciales. Certaines techniques peuvent
nécessiter l'autorisation d'un procureur ou d'un juge (par exemple, la
surveillance électronique, la perquisition et la saisie, l'injonction de
produire des documents ou la surveillance de comptes) et d'autres non (par
exemple la surveillance physique, la collecte d'informations provenant de
sources publiques et l'audition de témoins).
L'observation de personnes suspectées
d'activités criminelles organisées est susceptible de fournir des
informations sur leur mode de vie, tandis que la surveillance
électronique peut révéler la participation de conseillers
financiers ou des mouvements d'espèces ou d'autres avoirs. Il faut
recueillir des éléments de preuve concernant non seulement
l'infraction principale mais aussi le produit de cette infraction. Les
comparses qui sont arrêtés, des informateurs et même les
médias peuvent être mis à contribution pour faciliter les
enquêtes contre le crime organisé. Les particularités de la
recherche de preuve s'attachent aux règles procédurales des
enquêtes relatives au trafic des stupéfiants en ce qui concernent
les interceptions téléphoniques, les investigations bancaires.
3.3.1. Interceptions téléphoniques
Les opérateurs de télécommunications,
pour répondre aux réquisitions des enquêteurs, peuvent
différer pendant une période prédéfinie, les
opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes
certaines catégories de données techniques.
39
3.3.2. Données informatiques
Lorsqu'il apparaît que des données
chiffrées empêchent les enquêteurs d'accéder aux
informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, la juridiction
saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale
qualifiée en vue d'effectuer les opérations techniques permettant
d'obtenir la version en clair de ces informations ou la convention
secrète de chiffrement utilisée. Les officiers de police
judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition, accéder, par un
système informatique implanté sur les lieux où se
déroule la perquisition, à des données intéressant
l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans
un autre système informatique même s'il est situé à
l'international, sous réserve des conditions d'accès
prévues par les engagements internationaux en vigueur, dès lors
que ces données sont accessibles à partir du système
initial ou disponibles pour le système initial.
3.3.3. Investigations bancaires
Les banques connaissent quasiment dans tous les pays les
titulaires ou du moins des bénéficiaires économiques des
comptes numérotés. Il convient d'être très
précis sur la période concernée, l'identité, le nom
de jeune fille, les alias..., mais ne pas oublier de demander la copie de la
signature, des procurations.
Il existe des logiciels qui aident à la mise en forme
et à la traduction des procédures : Le système
d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) francophone et
le logiciel anglo-saxon COMPENDIUM.
Les infractions liées aux drogues sont nombreuses, avec
des peines qui varient selon la gravité de l'infraction. L'infraction la
moins « sérieuse » (même s'il s'agit toujours d'une
infraction criminelle avec possiblement de lourdes conséquences en cas
de condamnation) est la possession. Pour qu'il y ait possession, il faut que la
personne ait la drogue sur elle, en sa "possession". Dès lors tous les
actes posés par l'officier de police judiciaire doivent converger vers
la démonstration de la possession de substances interdites par un
individu ou le groupe de personnes incriminés.
40
CONCLUSION
Le succès de la lutte contre le trafic de substances
illicites dépend essentiellement de la coopération
internationale, basée sur les conventions en la matière, les
traités, accords ou autres mécanismes d'entraide judiciaires.
Par ailleurs, il faut souligner l'importance de s'aligner aux
nouvelles technologies pour faire face à un fléau en
renouvellement permanent qui s'adapte mieux aux évolutions
contemporaines.
En effet, l'usage et le commerce des drogues est une
réalité, il en résulte que chaque officier de police
judiciaire sera un jour conduit à recueillir des renseignements à
ce propos ou interpeller un contrevenant ou à entreprendre une
procédure assimilée. Dès lors il importe qu'il ait
connaissance des différentes lois et règlements qui concourent
à cette mission à caractère judiciaire et de santé
publique.
Au cours des dernières décennies, la guerre
internationale contre la drogue a entraîné des crises de
santé publique, le recours à l'incarcération massive, de
la corruption et de la violence liée au marché noir. Les
gouvernements ont commencé à appeler à la mise en place
d'une nouvelle approche, et les réformes dans certains pays ont connu un
élan de changement sans précédent. Interpelée par
les dirigeants latino-américains, las de la guerre contre la drogue,
l'Assemblée générale de l'ONU envisage d'organiser une
révision du système de contrôle des drogues en 2016.
41
LISTE DES FIGURES
FIGURE I : LE PROBLÈME MONDIAL DE LA DROGUE
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
FIGURE II : PARTS DE MACHES DES SUBSTANCES
ILLICITES DANS LE MONDE FIGURE III : CONSOMMATION MONDIALE DES
DROGUES
FIGURE IV : ORGANIGRAMME SIMPLIFE SYSTEME ONUSIEN CONTRE
LA
DROGUE
42
BIBLIOGRAPHIE
Chris Beyrer et al. (2010, août 4). Time to act: a call for
comprehensive responses to HIV in people who use drugs. The Lancet, vol.
376, No. 9740 (1), p. 551 à 563.
Christian Bachmann, A. C. (1989). Le Dragon domestique. Deux
siècles de relations étranges entre l'Occident et la drogue .
Paris: Albin Michel.
Christian BEN LAKHDAR, N. L. (2016). Rapport
synthétique - L'argent de la drogue en France - Estimation des
marchés des drogues illicites en France . Paris: Mission
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites
Addictives (MILDECA).
Europol, O. e. (2016). Rapport sur les marchés des
drogues dans l'Union Européenne. P22. Lisbone: Agence sur les
drogues de l'UE.
GROUSSIN, M. B. (2015). Les entreprises criminelles de la
drogue : de la
professionnalisation du trafic à la
légalisation . Toulouse: Institut d'étude politique.
J., S. (2001). Dictionnaire de droit international public.
Bruxelles: Bruylant-AUF.
Kokoreff, M. (2011). L'ÉCONOMIE DE LA DROGUE : DES MODES
D'ORGANISATION AUX ESPACES DE TRAFIC. LES ANNALES DE LA RECHERCHE URBAINE
N°78, 10.
Lacher, W. (2012). Organized Crime and Conflict in the
Sahel-Sahara Region. Carnegie Endowment for International Peace.
Luntumbue, M. (2012, octobre 9). Criminalité
transfrontalière en Afrique de l'Ouest : Cadre et limites des
stratégies régionales de lutte. GROUPE DE RECHERCHE ET
D'INFORMATION SUR LA PAIX ET LA SECURITE (GRIP), p. 14.
Ministère de la Justice. (2004). Code pénal,
Moniteur belge. Bruxelles: Imprimerie de Deltombe.
OICS. (2016). Rapport de l'Organe international de
contrôle des stupéfiants pour 2016. New york: Organe
international de contrôle des stupéfiants .
ONU. (1961). Article 33: Les parties ne permettront pas la
détention de stupéfiants sans autorisation légale.
Convention de 1961 sur les stupéfiants . New York: ONU.
ONU. (1988, décembre 20). Convention contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Articles
2-3. Vienne.
PHILIBERT, M. (2008). le contrôle international des
drogues illustré par l'exemple de l'Europe : de la prohibition à
la réduction des risques. Lyon: Institut d'études politiques
de Lyon.
43
Richard Davenport-Hines, W. e. (2004). The Pursuit of
Oblivion. A Global History of Narcotics, 1500 - 2000. New York: W.W.
Norton & Company.
Salmon. (2001). Dictionnaire de droit international public,.
Bruxelles: Bruylant-AUF.
UNODC. (2012).
http://www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2012/July/nouvelle-
campagne-de-lonudc-la-criminalite-transnationale-organisee-brasse-870-milliards-de-dollars-par-an.html.
Récupéré sur
http://www.unodc.org/unodc.
UNODC. (2016). Manuel sur l'entraide judiciaire et
l'extradition. Vienne: Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime.
UNODC. (2016). Rapport mondial sur les drogues . Vienne:
Office des Nations Unies pour la Lutte contre la Drogue et le Crime.
WEBOGRAPHIE :
https://onu-vienne.delegfrance.org/action-internationale-en-matiere-de-lutte-contre-la-
drogue-1243
www.unodc.org
www.drogues.fr
44
ANNEXES
? ANNEXE I : CLASSIFICATION DES
STUPÉFIANTS, DES SUBSTANCES
PSYCHOTROPES ET DE LEURS PRÉPARATIONS AINSI
QUE
DES SUBSTANCES UTILISÉES POUR LEUR FABRICATION
? ANNEXE II : GUIDE EVALUATION D'UNE
ENQUETE
INTERNATIONALE/LISTE CONTROLE
? ANNEXE I : ENQUETE REACTIVE GENERIQUE
(TABLEAU DE BORD)
ANNEXE I
CLASSIFICATION DES STUPÉFIANTS, DES SUBSTANCES
PSYCHOTROPES ET DE LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE DES
SUBSTANCES
UTILISÉES POUR LEUR FABRICATION
|
STUPÉFIANTS ET SUBSTANCES
PSYCHOTROPES
|
PRÉCURSEURS
(SUBSTANCES UTILISÉES DANS
LA FABRICATION DES
STUPÉFIANTS
ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES)
|
|
Substances à haut risque en raison de la
gravité des effets nocifs que leur abus
est susceptible de
produire
|
Substances à risque en
raison des effets nocifs
que leur abus est susceptible de
produire
|
|
TABLEAU I
|
TABLEAU II
|
TABLEAU III
|
TABLEAU IV
|
|
Substances dépourvues de réel
intérêt en médecine et
soumises à régime
de prohibition
|
Substances présentant un intérêt en
médecine et
soumises à régime de contrôle
strict
|
Substances présentant un intérêt en
médecine et soumises à régime de contrôle
|
|
1) Stupéfiants du tableau IV de la Convention sur les
stupéfiants de 1961 et substances psychotropes du tableau
I de la Convention sur les substances psychotropes de 1971
2) Eventuellement substances d'autres tableaux des Conventions
citées ci-dessus
3) Eventuellement autres substances
|
1) Stupéfiants des tableaux I* et II de la
Convention
sur les stupéfiants de 1961
2) Substances psychotropes du tableau II de la Convention sur
les substances psychotropes de 1971
3) Eventuellement substances d'autres tableaux des Conventions
citées ci-dessus à l'exclusion des substances inscrites au
tableau I ci-contre
4) Eventuellement autres substances
|
1) Préparations du tableau III de la Convention sur les
stupéfiants de 1961
2) Substances psychotropes des tableaux III et IV de la
Convention sur les substances psychotropes de 1971
3) Eventuellement autres substances
|
1) Substances des tableaux I et II de la Convention
contre le
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988
2) Eventuellement autres substances utilisées dans
la fabrication des stupéfiants et des
substances
psychotropes
|
|
Groupe A : substances et
médicaments ne pouvant pas être prescrits pour une période
supérieure à sept jours
Groupe B : substances et
médicaments ne pouvant pas être prescrits pour une période
supérieure à soixante jours
|
Groupe A : substances et
médicaments dont le renouvellement de la délivrance est interdit
sans autorisation écrite du prescripteur
Groupe B : substances et
médicaments dont le renouvellement de la délivrance est possible
sauf indication contraire du prescripteur
|
|
Répression sévère du trafic illicite
|
Répression du trafic illicite
|
Même répression du trafic illicite que pour les
substances
des tableaux I et II
|
|
Incrimination de la détention pour consommation
personnelle
|
* A l'exception des substances figurant au tableau IV
|
ANNEXE II
GUIDE EVALUATION D'UNE ENQUETE INTERNATIONALE/LISTE
CONTROLE
|
THEME
|
SOURCE
|
CONTACT
|
TACHE ACHEVEE
|
|
1
|
COLLECTE
D'INFORMATIONS/DE PREUVES
|
Code de procédure pénale
Manuels de formation et directives concernant la manipulation des
preuves Dossiers des affaires closes pour insuffisance de preuves Notes des
agents concernant les incidents ou cahiers personnels des agents
Registres des éléments de preuve et des
pièces à conviction Registres des perquisitions
|
Officier chargé de la supervision des cahiers personnels
des agents de police
Procureurs
Personne chargée de la chambre forte
|
OUI
|
NON
|
|
|
|
2
|
IDENTIFICATION
|
Codes et protocoles d'identification
Matériel utilisé pour la présentation des
photographies des
suspects (albums ou logiciels)
Exemples de portrait-robot
Procédures applicables aux tapissages
|
Personne responsable de l'application des procédures
d'identification
Enquêteurs
Procureur
Avocat de la défense
|
|
|
|
3
|
VICTIMES ET TÉMOINS
|
Directives concernant le traitement des victimes et des
témoins Protocoles relatifs à la protection des témoins
|
Magistrats des juridictions pénales Procureurs
Responsables de la protection des témoins Services d'appui aux
|
|
|
|
4
|
TECHNIQUES CLANDESTINE
|
Directives et normes concernant les opérations de
surveillance clandestine
|
Magistrats des juridictions pénales Procureurs ;
Enquêteurs
Techniciens chargés des opérations de surveillance
clandestine Représentant de l'organe indépendant de
surveillance
|
|
|
|
5
|
INFORMATEURS
|
|
|
|
|
|
6
|
INTERROGATOIRES 5.9.1 Suspects
5.9.2 Victimes et témoins
|
Directives concernant les méthodes d'interrogatoire Visite
des salles d'interrogatoire
Directives concernant les visites après condamnation
Rapports indépendants d'inspection
|
Moniteurs des cours de formation aux méthodes
d'interrogatoire Procureurs ; Enquêteurs ; Membres du personnel de la
police qui prennent des dépositions ; Témoins. Techniciens
chargés des détecteurs de mensonge Représentant de toute
organisation indépendante de supervision
|
|
|
|
7
|
COOPÉRATION INTERNATIONALE
|
Accords avec des organisations internationales Exemples de
commissions rogatoires
Visite du bureau central national d'Interpol
|
Chef du service de liaison internationale Enquêteurs
locaux
Chef du bureau de coopération (entraide) internationale en
matière judiciaire) Directeur du bureau d'Interpol
|
|
|
Rassemblement des preuves
Au
moyen
D'interrogatoires de témoins,
de méthodes
clandestines?
Examen
criminologique
At
Visite des lieux du crime
Réception de
la
déclaration
Commission de l'infraction
Mise à jour
du dossier
de
l'affaire
L
INCULPATION DU SUSPECT
ANNEXE I I I
ENQUÊTE RÉACTIVE
GÉNÉRIQUE
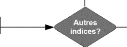
Autres indices?
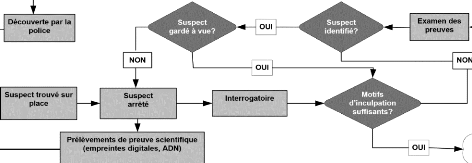
Examen des preuves
Suspect
gardé à vue?
Interrogatoire
Motifs
d'inculpation
suffisants?
1
Suspect arrêté
Suspect trouvé sur place
NON
Prélèvements de preuve
scientifique
(empreintes digitales, ADN)
Découverte par la police
A

Pas
.o
_0
dan tous les
systemes
Identification du procureur
m a e a 0
w
Établissement du
rapport
sur
l'infraction
Examen
(tri) de
l'affaire
Preuves
saisies
t
Preuves
conservées
Ouverture et examen du dossier de l'affaire
Affectation de
l'enquêteur
OUI
4
NON
Enquête
OUI
NON
| 


