1.8 Traitement du Paludisme
En 2004, le Cameroun a adopté une politique
thérapeutique basée sur la combinaison
Artésunate-Amodiaquine (ACT) pour le traitement du paludisme simple
(EDS-MICS, 2011). Cette dernière existe en quatre présentations ;
chacune correspondant à une tranche d'âge (PNLP,
2011).
Tableau II : Doses d'Antipaludéens selon
l'âge et le poids
|
Doses
|
Tranche d'âge
|
Posologie
|
|
3 comprimés dosés chacun à 25mg
d'artésunate + 67, 5mg d'amodiaquine.
|
Nourisson : 4,5kg-8kg ou âgé de 2-11 mois.
|
1 comprimé en une prise pendant 3 jours.
|
|
3 comprimés dosés chacun à 50mg
d'artésunate + 135mg d'amodiaquine.
|
Petit enfant 9 à17 kg ou âgé
de 1 à 5 ans.
|
1 comprimé en une prise pendant 3 jours.
|
|
3 comprimés dosés chacun à 100mg
d'artésunate + 270mg d'amodiaquine.
|
Enfant 18 à 35 kg ou âgé de 6 à 13
ans.
|
1 comprimé en une prise pendant 3 jours.
|
|
6 comprimés dosés chacun à 100mg
d'artésunate + 270mg d'amodiaquine.
|
Adolescent, Adulte 36 Kg ou âgé de 14 ans et
plus.
|
2 comprimés en une prise pendant 3 jours.
|
La quinine reste encore active sur la majorité des
souches plasmodiales existant au Cameroun et est par conséquent l'un des
antipaludiques indiqués dans la prise en charge des urgences, des cas
graves de paludisme y compris la femme enceinte. Il existe cependant
aujourd'hui d'autres options pour la prise en charge des formes graves du
paludisme telles que les formes parentérales des dérivés
de
NKAMEDJIE PETE PATRICK [17]
DETERMINANTS DE L'UTILISATION DE LA MILDA DANS LE
DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI.
l'artémisinine (l'artésunate et l'artémether
injectable) (PSNLP, 2011 ; EDS-MICS, 2011).
1.9 Moustiques et types de vecteurs
Le paludisme est transmis d'un être humain
paludéen à un autre (sain) par les piqûres de la femelle de
moustiques anophèles. Les moustiques vecteurs du paludisme sont tous
particulièrement actifs pendant la nuit entre 21 heures et 5-6 heures.
Les pics d'activité des anophèles africains vecteurs du paludisme
arrivent d'abord vers 1 heure du matin puis vers 5-6 heures; ces horaires sont
plus ou moins décalés selon les espèces vectrices, c'est
la variabilité interspécifique (Lundwall et al., 2005).
Le vol des anophèles est silencieux, insonore, et sa piqûre est
indolore et non urticante, le dormeur n'étant pas dérangé
par des bruits de vol (Pages et al., 2007). Les anophèles ont
besoin d'eaux propres et calmes pour la ponte et le développement de
cycle de vie depuis les oeufs jusqu'au stade d'adultes. Contrairement aux
anophèles, les autres types de moustiques peuvent vivre dans des eaux
sales et dans les ordures qui sont d'ailleurs fréquentes dans les
agglomérations humaines. Leur vol est brouillant et les piqûres
sont douloureuses. Malheureusement, il est difficile pour la population de
faire la distinction entre les anophèles et les autres types de
moustiques qui transmettent d'autres maladies, notamment la fièvre
jaune, la dingue, etc (Memain, 2010).
En Afrique Subsaharienne les espèces anopheliennes
ayant un intérêt médical ont la position
systématique suivante :
Règne : Animal
Embranchement : Arthropodes
Classe : Insectes
Sous classe : Ptérigotes
Ordre : Diptères
Sous ordre : Nématocères
Famille : Culicidae
Sous famille : Anophelinae
Genre :Anopheles
Sous genre : Cellia
NKAMEDJIE PETE PATRICK [18]
DETERMINANTS DE L'UTILISATION DE LA MILDA DANS LE
DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI.
1.9.1 Espèces du complexe Anopheles gambiae
Ces espèces ont une morphologie très semblable.
La différentiation à l'intérieur du complexe est
basée sur des critères cytogénétiques. Il comprend
huit espèces : Anopheles gambiae s.s. (sensus stricto) (Giles,
1902), Anophele sarabiensis (Patton, 1905), Anopheles
quadriannulatus A et B (Théobald, 1911), Anopheles bwambae
(White, 1985), Anopheles melas (Théobald, 1903),
Anopheles merus (Doenitz, 1902), Anopheles comorensis
(Brunhes, le Goff & Geoffroy 1997).
A. gambiae s.s. et A. arabiensis sont les
espèces les plus répandues en Afrique Subsaharienne et
constituent d'excellents vecteurs du paludisme. Les formes chromosomiques
d'A. gambiae s.s. sont regroupées en deux types
moléculaires : M et S.
Dans les régions de savane, les deux formes sont
différentiables par leurs réarrangements chromosomiques. Les
individus de forme «M» correspondent à la forme chromosomique
Mopti et ceux de «S» à la forme chromosomique Savane ou
Bamako. Dans un environnement aride, la forme M (temps de survie moyen 22,2 h)
est plus résistante que la forme S (temps de survie moyen 17,6 h) et les
femelles sont plus résistantes que les mâles (Lee et al.,
2009). La résistance à la dessiccation des espèces
anopheliennes jouerait un rôle important dans leur distribution
(Benedict et al., 2010). Les larves d'Anopheles se
rencontrent généralement dans les gîtes ensoleillés,
claires, turbides ou pollués (Zezé, 1991). Cependant elles sont
retrouvées de plus en plus dans les points d'eau ombragés,
à courant rapide et alcalin (Zézé, 1991) et les
rizières irriguées (koudou et al., 2007).
A.arabiensis est considérée comme une
espèce de savane sèche et de forêt boisée
clairsemée. Les Les gîtes larvaires sont identiques à ceux
d'A. gambiae (Sinka et al., 2007). Elle résiste plus
à la dessiccation que la forme S d'A. gambiae s.s. (Grey
& Bradley, 2005).
A. melas et A. merus sont des espèces
que l'on rencontre dans les eaux saumâtres du littoral Atlantique et de
l'Océan Indien d'Afrique. La zoophilie très marquée de ces
deux espèces fait d'elles de médiocres vecteurs du paludisme
humain (WHO, 1999).
NKAMEDJIE PETE PATRICK [19]
DETERMINANTS DE L'UTILISATION DE LA MILDA DANS LE
DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI.
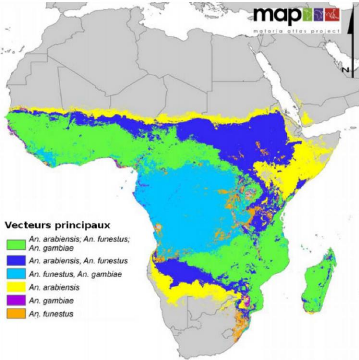
Figure 2. Répartition des vecteurs
principaux du paludisme en Afrique (Sinka et al., 2012).
A. bwambae se rencontre dans les eaux
marécageuses minéralisées d'origine géothermale de
la forêt de Semliki à la frontière de la République
Démocratique du Congo et de l'Ouganda. Bien qu'anthropophiles et bons
vecteurs du paludisme, les adultes de cette espèce ont rarement des
contacts avec l'homme (WHO, 1999).
A. quadriannulatus a une répartition
limitée en Ethiopie et sur l'île de Zanzibar. Elle n'intervient
pas dans la transmission du paludisme, car elle est zoophile stricte (WHO,
1999).
A. comorensis est une espèce proche d'A.
arabiensis et d'A. gambiae retrouvée essentiellement sur
l'archipel des Comores. Cette espèce, bien qu'agressive pour l'homme,
est sans importance médicale à cause de son extrême
rareté.
NKAMEDJIE PETE PATRICK [20]
DETERMINANTS DE L'UTILISATION DE LA MILDA DANS LE
DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI.
| 


