Key words
Ontology, semantic Web, OWL, RDF, RDFS, meta-data, e-learning,
learning document.

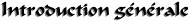
Introduction générale 1.

I. Introduction 3
II. Insuffisance du Web actuel 3
III. Web sémantique, quoi de nouveau ? 3
IV. Langage du Web sémantique 4
IV. 1. le World Wide Web Consortium (W3C) 4
IV.2. Architecture du Web sémantique 4
IV.3. Langage XML 5
IV.3.1. Document XML 6
IV.3.2. Document XML valide 6
IV.3.3. Espace des noms 8
IV.3.4. Feuilles de style 8
IV.3.5. Parseur XML 8
IV.3.6. Avantage de XML 9
IV.3.7. Limitations du XML 9
IV.4. Langage RDF et RDFS 10
IV.4.1. RDF (1999) 10
IV.4. 1.1. Définition d'URI (Uniform Ressource
Identifier) 10
IV.4.1.2. Syntaxe RDF 10
IV.4.2. RDFS (2000) 11
IV.5. Le langage OWL 12
IV. 5.1. Les ontologies 12
IV.5.2. Présentation du OWL 13
IV.5.3. Document OWL 13
IV.5.4. Structure d'une ontologie en OWL 14
IV.5.4.1. Espace de nommage 14
IV.5.4.2. En-tête d'une ontologie 15
IV.5.4.3. Eléments du langage 15
V. Travaux du Web sémantique et domaines d'application
22
V.1. Recherche d'information 22
V.2. l'adaptation /personnalisation 22
V.3. Intégration des sources de données
hétérogènes 23
VI. Conclusion 23

I. Introduction 24
II. Les ontologies 24
II.1. Historique sur l'ontologie 24
II.2. Notion d'ontologie 25
II.2.1. Différence entre ontologie et base de
connaissance 26
II.2.2. Différence entre ontologie et hiérarchie de
classes 27
II.3. Composantes d'une ontologie 27
II.4. Classification des ontologies 28
II.4.1. Typologie selon l'objet de conceptualisation 28
II.4.2. Typologie selon le niveau de détail de l'ontologie
29
II.4.3. Typologie selon le niveau de complétude 29
II.4.4. Typologie selon le niveau de formalisme 30
II.5. Principes de construction des ontologies 30
II.5.1. Principes 30
II.6. Processus de construction 31
II.7. Méthodologies de construction 32
II.7.1. Méthode de Uschold et King «1995 »
32
II.7.2. Méthode de Uschold et King «1996 »
33
II.7.3. Méthode de Bernaras et al «1996 » 33
II.7.4. Méthode SENSUS de Swartout et al «1997
» 33
II.7.5. Méthode de Assenac-Grilles et al «2000
» 33
II.7.6. Méthode de Bachimont «2000 » 33
II.7.7. Méthode OntoSpec de Kassel «2002 »
34
II.8. Environnements et outils de modélisation 34
II.8.1. ONTOLINGUA 34
II.8.2. ONTOSAURUS 34
II.8.3. ODE 35
II.8.4. PROTÉGÉ 35
III. Les ontologies pour le e-learning 35
III.1. Définitions 35
III.1.1. Objet pédagogique 35
III.1.2. Profil utilisateur 36
III.1.3. Plate forme de formation 36
III.2. Besoin des systèmes e-learning 36
III.2.1. Besoin en archivage et recherche 36
III.2.2. Besoin de partage 38
III.2.3. Besoin en réutilisation des objets
pédagogiques 38
III.2.4. Besoin en personnalisation et adaptation 39
III.3. Exemples de l'utilisation des ontologies 39
III.3.1. IMAT (Integrating Manuals And Training) 40
III.3.2. QBLS (Question Based Learning System) 40
III.3.3. VIUM (Projet de repérage et de visualisation du
modèle de l'apprenant) 40
IV. Conclusion 41
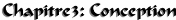
I. Introduction 42
II. Conception de l'ontologie de l'application 42
II.1. Choix d'une méthodologie de construction 42
II.2. Respect des principes de construction 43
II.3. Présentation de l'ontologie conceptuelle 44
II.3.1. Liste des concepts 44
II.3.2. Liste des attributs 48
II.3.3. Liste des relations 50
II.3.4. Représentation hiérarchique des concepts
53
II.3.5. Diagramme UML 54
II.4. Schéma résumant la phase de l'ontologisation
55
II.5. Diagramme des cas d'utilisation 55
III. Conclusion 57

I. Introduction 58
II. Cahier des charges 58
III. les outils et le langage utilisés 58
III.1. Java Server Pages 58
III.2. Tomcat 60
III.3. Protégé 61
III.4. Jena 61
IV. Implémentation 62
IV. 1. Edition de l'ontologie et génération du
code OWL 62
IV. 1.1. Choix d'un langage de spécification 62
IV. 1.2. Normalisation des noms de l'ontologie 63
IV.1.3. Les étapes de l'édition 63
IV. 1.4. Schéma résumant la phase de
l'opérationnalisation 72
IV.2. Exploitation de code OWL dans un programme JAVA 72
IV.2.1. Suivi de session 74
IV.2.2. Architecture de l'application développée
75
V. La démarche suivie pour l'annotation des documents
75
VI. Exécution de l'application 75
VI. 1. Images d'exécution de l'application 77
VI. 1.1 Annotation d'un module 77
VI. 1.2. Annotation d'un enseignant 78
VI.1.3. Annotation d'un document 79
VI. 1.4. Recherche de documents 82
VI.2. Intégration de l'application sur la plate forme
« Plone » 87
VII. Avantage de l'application 89
VIII. Conclusion 90
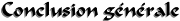
Conclusion générale 91

Fig I.1 : Exemple de représentation sous forme de graphe
11
Fig II.1 : Processus de construction d'une ontologie 32
FigIII. 1 : Représentation hiérarchique de
l'ontologie 53
Fig.III.2 : Diagramme de classes UML 54
Fig.III.3 : phase d'ontologisation 55
Fig.III.4: Diagramme des cas d'utilisation 56
Fig.IV. 1: Exemple d'un programme JSP 59
Fig.IV.2 : Exécution d'un JSP 60
Fig.IV.3 : La page d'accueil de site http://jena.sourceforge.net/
61
Fig.IV.4 : La documentation associé avec Jena 2-3 62
Fig.IV.5 : Lancement de Protégé 63
Fig.IV.6 : Choix de type de projet 64
Fig.IV.7 : Choix d'un espace des noms 64
Fig.IV.8 : Choix d'un langage 65
Fig.IV.9 : Page d'édition 65
Fig.IV. 10 : Création des classes 66
Fig.IV.11 : Les champs à remplir 66
Fig.IV.12 : Ajout d'une propriété 67
Fig.IV.13 : Spécification des contraintes de
cardinalité 67
Fig.IV.14: Ajout d'une relation 68
fig.IV. 15 : Ajout de la relation inverse 68
Fig.IV.16 : Enregistrement de projet 69
Fig.IV.17 : un fragment de code OWL généré
70
Fig.IV. 18 : Génération de la documentation 71
Fig.IV.19 : Documentation de l'ontologie 71
Fig.IV.20 : Phase de l'opérationnalisation 72
Fig.IV.21 : Installation de JDK 1.4.2 73
Fig.IV.22: Ajout de la librairie Jena 73
Fig.IV.23 : Ajout de JDK 1.4.2 74
Fig.IV.24 : Architecture de l'application 75
Fig.IV.25 : Installation de serveur Tomcat 76
Fig.IV.26 : Emplacement de l'application 76
Fig.IV.27 : Annotation d'un module 78
Fig.IV.28: Annotation d'un enseignant 78
Fig.IV.29 : Affectation d'un module à un enseignant 79
Fig.IV.30 : Saisie de login de l'enseignant 79
Fig. IV.3 1: choix d'un module 80
Fig.IV.32 : Choix de type de document à annoter 80
Fig.IV.33 : préparation à la
génération de formulaire d'acquisition des
métadonnées 81
Fig.IV.34 : Annotation d'un support de cours 81
Fig.IV.35 : écran de recherche de document 82
Fig.IV.36: Recherche d'un support de cours 82
|
Fig.IV.37: Recherche d'un support de cours (suite)
|
83
|
|
Fig.IV.38: Recherche d'un support de cours (suite)
|
.83
|
|
Fig.IV.39 : Recherche d'un support de cours (suite)
|
84
|
|
Fig.IV.40 : Recherche d'un support de cours (suite)
|
84
|
|
Fig. IV.41: Recherche d'un support de cours (suite)
|
85
|
|
Fig.IV.42 : Lancement de la recherche de l'URI
|
85
|
|
Fig.IV.43 : Résultat de la recherche
|
86
|
|
Fig.IV.44 : Espace administrateur
|
87
|
|
Fig.IV.45 : Espace enseignant
|
88
|
|
Fig.IV.46: Espace étudiant
|
89
|

| 


