Années 2018 - 2019
UNIVERSITÉ CLERMONT D'AUVERGNE
-
CLERMONT-FERRAND -
MASTER 2 -- PARCOURS DROIT CIVIL

MÉMOIRE DE MASTER EN DROIT
POUR UNE PUBLICITÉ EFFICACE
DES SÛRETÉS RÉELLES
MOBILIÈRES
- Directeur de mémoire -
Monsieur
Jean-François RIFFARD
Enseignant-Chercheur (Maître de
conférences) à l'université
Clermont
d'Auvergne.
PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS
al. Alinéa
art. Article
C. consom. Code de la consommation
CREDA Centre de recherche sur le droit des affaires de
la Chambre de commerce et d'industrie de Paris
CNUDCI Commission des Nations Unies pour le Droit
Commercial International
éd. Édition
Fasc. Fascicule
Gaz. Pal.Gazette du palais
Ibid. Ibidem, au même
endroit
Infra. Plus bas
J.-Cl. Encyclopédie
JurisClasseur
màj Mise à jour
n° Numéro
op. cit. Opere citato, dans l'ouvrage
cité
p. Page
Préc. Précité
Rép. Civ. Répertoire civil
Dalloz
Rép.
Com. Répertoire commercial
Dalloz
Rép. Imm. Répertoire de droit
immobilier Dalloz
Rép. Soc. Répertoire de droit des
sociétés Dalloz
RJTUM Revue juridique Thémis de
l'Université de Montréal
RTD civ. Revue trimestrielle de droit
civil
s. Suivant(s)
Supra Plus haut
th. Thèse
UCC Uniform commercial code
REMERCIEMENTS
D'aucuns décriraient le droit des
sûretés comme une matière aride, honnie des
étudiants, dont la sécheresse n'aurait d'égale que les
vents de poussières s'échappant des registres de publicité
légale. Comment les faire mentir ? La complexité de cette
discipline n'évoque point la traversée de verts pâturages.
Pourtant celui qui saura braver ce désert y découvrira le
défi intellectuel d'une vie et la satisfaction d'agir au service des
rouages sous-jacents de l'économie. C'est parce qu'il m'a ouvert la voie
vers cette aventure que mes premiers remerciements vont à monsieur
Jean-François RIFFARD.
Je tiens également à remercier chacun
des enseignants du master 2 droit civil, et particulièrement monsieur
Yannick BLANDIN dont la propension à critiquer sans concessions les
manquements du droit positif s'est avérée
communicative
SOMMAIRE
INTRODUCTION
- PREMIÈRE PARTIE -
LE CHOIX DE LA SUBSTANCE : VOCATION
D'UNE
PUBLICITÉ EFFICACE
TITRE 1 : LES PRÉREQUIS DE L'EFFICACITÉ
EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ.
Chapitre 1 : La non-incidence de la connaissance ou de
l'ignorance effective. Chapitre 2 : La distinction entre constitution et
opposabilité d'une sûreté Chapitre 3 : L'approche globale
et fonctionnaliste de la notion de sûreté. Chapitre 4 : La mise en
avant de l'inscription par simple avis.
TITRE 2 : DU RÔLE TRADITIONNEL DE LA
PUBLICITÉ, DU CONSTAT DE SES LIMITES ET DE SA NÉCESSAIRE
ÉVOLUTION.
Chapitre 1 : Informer les tiers, l'utilité
traditionnelle de la publicité. Chapitre 2 : Protéger les tiers,
le constat des limites de la publicité. Chapitre 3 : Neutraliser la
menace, la nécessaire évolution.
- SECONDE PARTIE -
LE CHOIX DU RÉCEPTACLE : LA GENÈSE DU
REGISTRE
EFFICACE
Titre 1 : Les propriétés d'un registre
efficace et les moyens de les développer.
Chapitre 1 : L'absolue nécessité d'un
registre informatisé. Chapitre 2 : Principes d'un registre
efficace
TITRE 2 : L'innovation technologique a
considéré : de la blockchain aux blockchains.
Chapitre 1 : L'apport de la technologie blockchain.
Chapitre 2 : Les blockchains.
Chapitre 3 : Ultime proposition, le registre
efficace.
INTRODUCTION
1. À la recherche d'une publicité
efficace. En théorie des jeux, on définit un jeu à somme
nulle1 comme le jeu où la somme des gains et des pertes des
parties est égale à zéro. Autrement dit ce qu'un joueur
gagne, il l'arrache à son adversaire. Le jeu de go ou le poker sont des
exemples de jeu à somme nulle. On peut aisément faire le lien
entre ce paradigme et la vision marxiste de l'économie qui suppose une
lutte des classes. Ce qu'une classe peut accaparer de la plus-value, elle le
dérobe nécessairement au détriment des autres. Partant de
ce postulat Karl Marx a fourni une théorie du droit2,
où le juridique ne serait que le champ de bataille où les classes
sociales luttent pour la domination ou l'émancipation.
Nous pensons que le droit est plus que cela. Bien
sûr, le droit ne peut jamais être totalement isolé de son
substrat politique dans la mesure où il est semblable à un
réseau de canaux chargé d'encadrer les flux économiques.
Toutefois, on ne saurait céder à un relativisme absolu, à
l'aune d'une analyse économique toutes les normes ne se valent pas. Peu
importe quel champ il irrigue, on reconnaît la qualité d'un canal
à la somme de ses pertes en eaux. C'est cette beauté technique
qui élève notre matière au-dessus des
considérations politiques. Penser le droit des sûretés
c'est jouer à un jeu à somme non nulle, c'est entrer dans la peau
de l'ingénieur hydraulicien qui objectivement minimise les pertes et
maximise les gains de chacun. Tel sera l'objet de notre étude,
grâce à la technologie blockchain et à un registre global
des sûretés mobilières3 nous tâcherons de
colmater les quelques fuites du droit positif français. Sans
égard pour les intérêts particuliers des prêteurs ou
des emprunteurs, nous viserons l'intérêt général via
une rationalisation des formalités obligatoires de
publicité.
2. Le rôle économique crucial des
sûretés et l'échec de leurs substituts financiers. Bien que
méconnu du grand public et relativement absent des débats
politiques, le droit des sûretés constitue le ressort
indispensable de l'économie. Un droit des sûretés efficace
a vocation à favoriser la confiance des prêteurs en leurs
capacités à recouvrer leurs fonds même en cas
d'insolvabilité. Or une économie de marché ne peut
fonctionner sans crédit, outil qui demeure le principal mode de
financement des entreprises.
Il faut cependant avouer que les sûretés
ne sont pas les seuls mécanismes juridiques prompts à
répondre à ce besoin. On peut évoquer la
titrisation4 un mécanisme qui n'a rien à voir avec la
notion de sûretés, et qui offre des opportunités de
financement considérables. Il
1À l'inverse, un jeu à somme non nulle
est un jeu où les parties peuvent modifier les gains ou les pertes
à distribuer en choisissant telle ou telle stratégie.
L'économie est le jeu à somme non nulle par excellence dans la
mesure où selon la stratégie adoptée par les agents
économiques, la somme des richesses produite à partager variera
considérablement.
2«S'il est vrai que le droit dans la
société bourgeoise est essentiellement fonctionnel dans la mesure
où il sert au maintien de la domination du capital sur le travail, il
est également vrai, et Marx lui-même ne peut qu'insister sur ce
fait, que le droit est un terrain d'affrontement» Stefano PETRUCCIANI,
«Les multiples dimensions de la critique marxienne du droit»,
Revue Droit & Philosophie, nov. 2018., n° 10, p.
18.
3Voir, Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international, « Guide de la CNUDCI sur la mise en place
d'un registre des sûretés réelles mobilières
», Vienne, 2014, consultable sur le site de la CNUDCI :
https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/Security-Rights-Registry-Guide-f.pdf
.
4La CNUDCI définit la titrisation comme «
un montage financier complexe qui permet à une entreprise de tirer parti
de la valeur de ses créances pour obtenir un financement en
transférant celles-ci à une entité ad hoc qu'elle
détient entièrement. Cette entité ad hoc émet alors
des titres sur les marchés financiers garantis par les flux de recettes
générés par les créances.», voir, Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international, « Guide
législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties »,
New York 2011, consultable sur le site de la CNUDCI :
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/f/LG_on_ST_French.pdf
.
suffit d'évoquer la titrisation
synthétique5 et le « Dérivé sur
événement de crédit6 » pour
générer un semblant de confusion avec le domaine des
sûretés personnelles. Cette confusion d'apparence doit toutefois
être dissipée rapidement par une ferme distinction. En effet,
toute garantie « contient en elle-même une
référence à une obligation principale qui doit être
garantie. Il ne peut y avoir de garanties que s'il y a une autre obligation
à garantir7 ». Or les dérivés sur
événement de crédit, via la titrisation
synthétique, deviennent des actifs librement cessibles et totalement
autonomes vis-à-vis de l'obligation supposément
garantie8.
Considérons la dette de Primus envers Secundus
pour un montant de 10. Rien ne s'oppose à ce que Tertius et Quartus se
décident à conclure une convention auprès de Secundus qui
stipulerait pour ce dernier l'obligation de débourser une somme totale
de 100 en cas de survenance d'un événement
prédéterminé, à savoir la défaillance de
Primus. Comment pourrait-on dès lors qualifier de sûreté un
mécanisme qui peut potentiellement aggraver la situation d'un
créancier en cas d'insolvabilité de son débiteur
?
Secundus, dans notre exemple, fait face aux
mêmes difficultés que certaines banques durant la crise des
subprimes9. Un événement qui a montré les
limites des dérivés de crédits, des mécanismes qui
tiennent plus du produit de spéculation que de la
garantie10.
Aujourd'hui, l'état du marché
obligataire est inquiétant11 et il semble d'ores et
déjà raisonnable de se montrer critique vis-à-vis des
créances titrisées issues de la « bulle
étudiante12» américaine ou des «
subprimes auto loans13 ».
Les produits financiers issus de la titrisation
synthétique, loin de juguler les risques, n'ont fait qu'aggraver la
crise. Pourtant l'économie ne peut pas se passer de crédits
garantis.
5« Par opposition aux titrisations classiques,
communément appelées « titrisations cash », les
titrisations synthétiques visent à un transfert du risque relatif
à un portefeuille de créances ou d'actifs sans qu'il en
résulte un transfert juridique desdites créances ou desdits
actifs. Ce transfert synthétique s'opère par le biais de contrats
dérivés communément appelés «
dérivés de crédit » : credit default swaps, total
return swaps, etc. », Xavier DE KERGOMMEAUX, « Titrisation »,
Répertoire de droit commercial, Dalloz, janv. 2010 (actualisation Janv.
2018). 6« Le contrat de dérivé sur événement
de crédit est la convention par laquelle une partie, le « vendeur
de protection » (Credit Protection Seller), s'engage envers une autre,
« l'acheteur de protection » (Credit Protection Buyer), à lui
payer une somme d'argent en cas de survenance d'un événement de
crédit (Credit Event) stipulé par les parties et relatif à
une dette souscrite par un tiers (un titre obligataire, une action, un
prêt, etc.). L'acheteur de protection verse au vendeur une prime, pour
contrepartie du risque qu'il assume. », Sébastien PRAICHEUX, «
Sûretés financières », Répertoire de droit
des sociétés, Dalloz, avr. 2019.
7M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et Ph.
PÉTEL, « Droit des sûretés », 9e éd.,
2010, Litec, no 425, (dans Sébastien PRAICHEUX, «
Sûretés financières », op. cit., paragr.
9).
8« L'avantage du dérivé de
crédit réside dans sa standardisation, sa cessibilité sur
le marché, son autonomie totale par rapport à la dette garantie
», Sébastien PRAICHEUX, « Sûretés
financières », op. cit., paragr. 9.
9Durant la crise financière de 2008, en plus de
faire face aux défauts de paiements massifs des ménages
américains les banques ont dû débourser d'importantes
sommes au profit des détenteurs de contrat dit de « credit default
swap ».
10« Le système financier mondial aurait pu
supporter les pertes (même lourdes) liées à la crise des
subprimes. Mais les établissements financiers et investisseurs du monde
entier ont découvert (ou ont fait semblant de découvrir) à
cette occasion que, via certaines opérations de titrisation dites «
synthétiques », le risque des subprimes leur avait
été largement redistribué et que, surtout, malgré
les notes satisfaisantes initialement attribuées par les agences de
notation aux titres émis dans le cadre de ces opérations, des
pertes parfois sévères étaient à craindre »,
Xavier DE KERGOMMEAUX, « Titrisation », op. cit., paragr.
13.
11« L'endettement des agents économiques
est à l'origine de la plupart des crises financières du XXIe
siècle » or cette auteur démontre que la politique des
principales banques centrales mondiales en réponse à la crise de
2008 favorise cet endettement. Valérie LELIEVRE, « BCE, BoJ, Fed :
pompiers et pyromanes », Revue de l'Union européenne,
Dalloz, 2019, p. 57.
12Valérie LELIEVRE évoque une «
bulle étudiante » qui traduit le très fort endettement
d'étudiants issus de familles modestes dans une période où
le crédit était « facile et pas cher »
ibid.
13Une expression qui désigne les crédits
automobiles à risques que Valérie LELIEVRE évoque parmi
d'autres exemples d'endettements problématiques. Ibid.
Comme le rappelle la CNUDCI, « des lois bien
conçues sur les opérations garanties peuvent offrir des avantages
économiques considérables aux États qui les adoptent,
notamment inciter des prêteurs et d'autres fournisseurs de crédit,
nationaux et étrangers, à octroyer des financements, promouvoir
le développement et la croissance des entreprises nationales
»14.
Dès lors, sans solution miracle, il
paraît sage de recommander une distribution raisonnée du
crédit assortie de sûretés conventionnelles qui ont fait
leurs preuves. Encore reste-t-il à choisir entre sûretés
personnelles et sûretés réelles.
3. Le choix entre sûretés réelles
et sûretés personnelles. Pour Dominique LEGEAIS, « La
sûreté réelle repose sur la technique de l'affectation
préférentielle ou exclusive d'un bien ou d'un ensemble de biens
au profit du créancier. [...] Un droit réel est ainsi
conféré au créancier sur un ou plusieurs biens. En cas de
défaillance du débiteur, le créancier peut saisir les
biens affectés en garantie pour exercer son droit de
préférence sur le prix15 ». On peut les
opposer aux sûretés personnelles qui selon le même auteur
sont des mécanismes qui consistent en « l'adjonction, au
rapport d'obligation principal, d'un rapport d'obligation supplémentaire
permettant au créancier d'exercer les poursuites contre le garant,
lequel est alors tenu pour un autre et dispose d'un recours contre celui-ci,
qui doit seul finalement supporter la
dette16».
Par bien des aspects, il apparaît que les
sûretés personnelles ne sont pas adaptées à la vie
des affaires. L'exemple du cautionnement est assez éclairant. Que ce
soit du point de vue du créancier garanti ou de la caution, cette
sûreté n'est jamais pleinement satisfaisante. Pourtant il est
assez courant de demander au dirigeant d'une société à
responsabilité limitée de se porter caution pour celle-ci. Alors
même qu'une telle convention fait perdre tout l'intérêt de
la forme sociale qui avait été choisie à dessein pour
placer un patrimoine personnel à l'abri des créanciers
professionnels17. Pire encore, il n'est pas rare qu'un conjoint soit
amené à prendre le même engagement.
On ne peut pas penser pratique plus inféconde,
car cette sûreté personnelle fait une piètre garantie en
matière de financement des entreprises. Si le créancier poursuit
les cautions en paiement, c'est en raison de l'insolvabilité du
débiteur principal. Or dans la majorité des cas, c'est justement
de la société (débitrice principale) que les cautions
gérantes extraient leurs revenus. Dès lors en plus de
bénéficier d'une sûreté dont la fiabilité a
été amoindrie par la loi et la jurisprudence, le créancier
s'expose à un « effet de domino », à une
« succession de défaillances18
».
Enfin en sus de leurs faiblesses propres et
au-delà de l'exemple du cautionnement, les sûretés
personnelles souffrent de la comparaison avec les sûretés
réelles. Autrement dit quel pourrait bien être
l'intérêt d'un droit de gage général sur le
patrimoine d'un garant dont tous les biens seraient grevés, même a
posteriori par des sûretés réelles ? C'est, car elles ne
supposent pas de droit de préférence, que les créanciers
garantis bénéficiaires de sûretés
14« Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », P1, paragr. 2.
15Dominique LEGEAIS, « Sûretés
», Répertoire de droit civil, Dalloz, janv. 2016
(actualisation mars 2019), Paragr. 18.
16Ibid., paragr. 30.
17« Du côté de l'entrepreneur, le
recours à une sûreté personnelle n'est pas plus
satisfaisant. Dans la majorité des cas, celui-ci souhaite éviter
une confusion des risques et placer ses biens personnels à l'abri des
créanciers professionnels. Pour ce faire, il procède à la
création d'une personne morale ou à un fractionnement de son
patrimoine pour isoler les dettes de l'entreprise. La constitution d'un
cautionnement contourne cette protection, puisque l'entrepreneur s'engage alors
sur l'ensemble de son patrimoine », Yannick BLANDIN, «
sûretés et bien circulant », thèse de
doctorat en droit, sous la direction d'Alain GHOZI, Paris, Université
Panthéon-Assas, 2014. 18À ce propos,Yannick BLANDIN, «
Sûretés et bien circulant contribution à la
réception d'une sûreté réelle globale »,
th. préc., Paragr. 3.
personnelles risquent d'être primés en
leurs droits sur tel ou tel bien particuliers par des créanciers
bénéficiaires de sûretés réelles.
À tout point de vue, les sûretés
réelles semblent plus adaptées au financement des entreprises.
C'est encore plus vrai quand on s'intéresse à des assiettes
marginales de sûretés réelles telles que les biens
circulants19 ou les biens immatériels20 qui
malgré des problématiques particulières en matière
de publicité et d'opposabilité recèlent un potentiel de
financement certain et inexploité.
4. Les sûretés réelles, des
mécanismes tributaires de la publicité. Malgré leurs
avantages sur les sûretés personnelles, les sûretés
réelles emportent une complication particulière qui est trop
souvent passée sous silence. Il s'agit de la publicité de ces
garanties, une étape cruciale du régime des sûretés
réelles qui est à même de devenir le grain de sable prompt
à enrayer toute cette féconde machinerie.
Si le sujet de la publicité des
sûretés réelles mobilières fait l'objet de cette
étude, c'est en premier lieu, car ces opérations constituent un
péril particulier pour les tiers. On comprend, par exemple, quel
intérêt le tiers acquéreur peut avoir à être
prévenu de leurs existences. S'il acquiert tel bien grevé, il
pourrait en effet pâtir d'un éventuel droit de suite. Dans le
même ordre d'idée, un créancier tiers à la
convention de sûretés pourrait pâtir d'une trompeuse
apparence de solvabilité du débiteur dont les nombreux biens
seraient déjà tous affectés en garantie.
Le créancier garanti, quant à lui, dans
un schéma digne de l'ouroboros à tout intérêt
à ce que les tiers soient informés de la constitution des droits
réels qui garantissent sa créance, car dans le cas contraire il
pourrait bien voir son avantage se fracasser contre la muraille de
l'inopposabilité (ou tout autre mécanisme créé pour
protéger les tiers de la menace des droits réels occultes). Tout
dépend de la solution que les différents ordres juridiques
apportent à la collision de ces intérêts divergents.
Cependant dans cette situation il faudra forcément sacrifier les
attentes légitimes d'un des protagonistes pour résoudre le
litige. C'est pour éviter un tel gâchis que le législateur
doit s'attacher à garantir une efficacité optimale de la
publicité des droits réels sur les biens meubles, un sujet qui
est le plus souvent négligé contrairement à la
publicité des droits réels sur les immeubles qui est bien mieux
encadrée.
5. Une problématique
généralisable à toute utilisation de droits réels
à titre de garantie. Partant de ce constat, la quête de
l'efficacité en matière de publicité des
sûretés réelles mobilières ne peut être faite
sans adopter une vision fonctionnelle et unitaire de la notion de
sûretés. Car ce qui justifie la nécessaire information des
tiers c'est l'utilisation de droit réel à titre de garantie. Or
cette difficulté n'a en somme rien à voir avec la qualification
formelle de sûretés que les différents législateurs
peuvent être amenés à donner à telle ou telle
garantie.
Les utilisations de droit réel accessoire, ou
même du droit de propriété à des fins de garantie ne
peuvent demeurer des opérations occultes, des pièges, dont les
tiers ne pourraient
19Yannick BLANDIN écrit à propos des
biens circulant : « Le bien circulant, catégorie
générique regroupant des biens que le professionnel
détruit, incorpore ou aliène et qui ont vocation à
être constamment renouvelés, constitue une richesse
considérable. »,Yannick BLANDIN, « Sûretés et
bien circulant, contribution à la réception d'une
sûreté réelle globale », th. préc.,
paragr. 1.
20Vanessa PINTO HANIA souligne la montée en
puissance de cette idée en rappelant, à propos des biens
immatériels, que « d'aucuns affirment qu'ils représentent
une richesse économique, une source de crédit fantastique pour
les débiteurs, et un gage de sécurité pour les
créanciers. », Vanessa PINTO HANIA, « Les biens
immatériels saisis par le droit des sûretés réelles
mobilières conventionnelles », Thèse de doctorat en
droit, sous la direction de Stéphane PIEDELIEVRE, Université
Paris-Est, 2011, p. 23.
que difficilement se prémunir faute de
publicité. En l'espèce, il semble pertinent de se ranger à
la conception de sûreté proposée par la CNUDCI21
elle-même inspirée par le security interest
américain22
se passer d'une approche globale en la matière
c'est favoriser l'éclatement des dispositions relatives aux
formalités obligatoires de publicité, alors même que seuls
une harmonisation et un regroupement de ces dispositions peuvent permettre une
amélioration de leurs lisibilités.
6. Définition de la publicité
légale en opposition à la publicité commerciale.
Émile DE GIRARDIN a posé une définition substantielle de
la publicité (une définition de la publicité par sa
substance, par son contenu, à savoir les qualités
nécessaires de l'information publiée). « Pour être
utile à celui qui la fait et commander la confiance de celui à
qui elle s'adresse, l'annonce doit être concise, simple, franche, ne
jamais porter aucun masque, marcher toujours droit à son but, la
tête haute [...] Tout commentaire s'il n'est pas nuisible est au moins
superflu ; tout éloge au lieu d'appeler la confiance, provoque
l'incrédulité ».
Pascal BEDER dans son ouvrage «
Publicité légale » nous fait remarquer que «
Près d'un siècle plus tard, la publicité légale
pourrait presque totalement répondre à cette
définition23». Là où la
publicité commerciale vise à susciter chez le consommateur
l'envie d'acquérir un bien, la publicité légale vise
à informer les tiers dans un intérêt général
de transparence de prévisibilité et donc par extension de
sécurité juridique.
La publicité légale selon Pascal BEDER
serait « une information dite « légale »,
diffusée sous la responsabilité de son
auteur24». Ainsi contrairement à la
publicité commerciale, qui est bien sûr facultative, la
publication de la publicité légale est une obligation à la
charge de son émetteur. Pour Alain SAYAG, la publicité
légale « suppose une divulgation obligatoire, c'est même
sa définition première25 ». Pascal BEDER
poursuit sa définition en ajoutant que « Le concept de
publicité légale est basé sur une information à
haute valeur juridique » à ce stade on peut arguer que c'est
cette « valeur » qui justifie le caractère obligatoire de la
publicité légale. Alain SAYAG a une formule pertinente à
ce sujet « par l'effet de l'obligation légale, l'information
fait l'objet, dès le départ, d'une sorte d'expropriation
d'utilité publique à la source26
».
En opposition à cette définition
substantielle de la publicité légale proposée par Pascal
BEDER (cet auteur définit la publicité légale en se basant
sur les caractéristiques de son
21Pour la CNUDCI, le terme « sûretés
réelles mobilières » « recouvre tout type de droit
réel constitué sur un bien meuble en garantie de
l'exécution d'une obligation. La notion de sûreté ne se
limite pas aux mécanismes de sûreté traditionnellement
reconnus par différents systèmes juridiques, tels que le gage, la
sûreté ou l'hypothèque. Elle recouvre tout type de droit
réel constitué à titre de garantie. À ce titre,
elle comprend le transfert de biens meubles, corporels ou la cession de biens
incorporels à titre de garantie, ainsi que la réserve de
propriété d'un vendeur pour garantir le paiement du prix d'achat
d'un bien ou le droit de propriété résiduel du bailleur
dans le cadre d'un crédit-bail », « Guide de la CNUDCI sur
la mise en place d'un registre des sûretés réelles
mobilières », paragr. 13.
22Dominique LEGEAIS en exprimant le regret de
l'absence fonctionnaliste des garanties au sein de la réforme de 2006,
évoque le modèle du « security interest »
américain. « Une forme d'hypothèque qui peut s'appliquer
à tous les biens mobiliers ou immobiliers ». Un modèle qui
selon lui « inspire les travaux de la Commission des Nations unies pour le
droit commercial international (CNUDCI) chargée de l'uniformisation des
différents droits des sûretés », Dominique LEGEAIS,
« Sûretés », op. cit., paragr. 46.
23Pascal BEDER, « Publicité légale
», Rép. Soc., oct. 2016. paragr. 1.
24Ibid., paragr. 2.
25Alain SAYAG, « introduction », dans CREDA,
« l'information légale dans les affaires : quels enjeux ? Quelles
évolutions ? », colloque du 1er mars 1994, actes consultables
à
http://www.creda.cci-paris-idf.fr/colloques/1994-information-legale-actes.html
26Ibid.
contenu, en fonction de la forme de l'information
publiée) il faut souligner le caractère fonctionnel de la
définition d'Alain SAYAG qui s'intéresse davantage au rôle
de ce mécanisme plus qu'aux caractéristiques de son
contenu27. Pour lui, la publicité légale est un
ensemble de règles « qui imposent à certaines personnes
de communiquer au public une information selon une forme et un support
déterminés. »
Dès lors, on constate que la publicité
légale est une notion polysémique qui peut faire
référence au message lui-même, apprêter selon des
exigences particulières d'informations des tiers ou faire
référence au corps de règle qui détermine les
modalités de cette exigence.
7. Distinctions entre trois différents types
de publicité légale. Il faut compléter ce portrait
général de la publicité légale en ajoutant qu'il en
existe de plusieurs types. Alain SAYAG en distingue trois.
« Les publicités légales qui
créent un droit28 » il cite l'exemple de
l'immatriculation qui fait naître la personnalité morale de la
société.
« Les publicités qui
n'entraînent aucun effet juridique en soi29 » tel
que le dépôt des comptes annuels au registre du
commerce.
Enfin la branche de la publicité légale
qui nous intéresse entre toutes : « les publicités
légales, qui rendent un droit préexistant opposable aux
tiers30 ». Nous bouderons l'exemple proposé par
l'auteur pour lui substituer celui de la publicité des droits
réels grevant des biens meubles à titre de garantie, en raison de
sa pertinence quant au sujet de notre étude. Affin de mieux cerner cette
publicité légale particulière un complément de
définition historique s'impose.
8. Historique de la publicité des droits
réels accordés aux créanciers à titre de garantie.
Il faut faire remonter l'histoire de la publicité des garanties
accordées aux créanciers à sa forme la plus simple, la
dépossession que d'aucuns qualifient de « publicité
matérielle31». Nous nous rangerons à cette
approche terminologique, car plus qu'une définition formelle, c'est
d'une définition fonctionnelle de la publicité légale dont
nous avons besoin pour l'optimiser dans son fonctionnement. Remarquons que la
dépossession comme méthode d'opposabilité pose des limites
évidentes à la poursuite de l'activité économique
du constituant. C'est à cause de ce dernier point que l'invention de
sûretés mobilières sans dépossession constitue un
réel progrès pour un ordre juridique.
Or la question de la publicité est devenue
prégnante dès la consécration des sûretés
sans dépossession, car c'est l'arrivée de cette innovation
juridique qui a introduit la problématique
27Ibid.
28Voir l'intervention d'Alain SAYAG lors du colloque
« l'information légale dans les affaires : quels enjeux ?
Quelles évolutions ? », préc.
29Ibid.
30Ibid.
31A. BENADIBA, « La publicité des
sûretés réelles au Québec : évolution ou
mutation ? », Revue du notariat, Éditions Yvon Blais,
2014, volume 116, n° 3, p. 333 et s., l'auteur parle de publicité
matérielle pour qualifier la pratique de la dépossession du
constituant au sein d'un contrat de gage. La dépossession ne pouvant
être qualifié d'« information dite « légale
», diffusée sous la responsabilité de son auteur » le
concept de « publicité matérielle » échappe au
champ de la définition proposé par Pascal BEDER. à
contrario l'exigence de dépossession au sein d'un gage en tant que
méthode d'opposabilité peut tout à fait être
interprété comme une « règle » qui impose la
communication d'une information par une formalité particulière
conformément à la définition de la publicité
légale selon Alain SAYAG. Il s'agit bien d'une publicité en tant
que méthode imposée visant à informer les tiers de
l'existence potentielle de droit réel grevant un bien (soit une
information à haute valeur juridique). Le tiers qui découvrira
que le constituant n'exerce plus d'emprise matérielle sur le bien ne
sera pas victime d'apparences trompeuses.
des droits réels occultes.
Quand on se penche sur la matière des
sûretés en droit romain on remarque d'abord la fiducia
cumcreditore un mécanisme caractérisé par son
exigence ad validitatem de dépossession et de transfert de
propriété. Plus tard, on remarque que les sûretés du
droit romain ont évolué pour devenir de moins en moins
contraignantes. Après la fiducia cumcreditor vint le pignus
où seule la dépossession du bien grevé entre les
mains du créancier garanti était nécessaire. Enfin, «
les Romains ont conçu une variété de pignus sans
dépossession qui allait progressivement se distinguer de celui-ci pour
devenir l'hypothèque32 ». À ce stade, nous
sommes à une période transitoire, l'ordre juridique romain par la
création de la sûreté sans dépossession a
découvert l'une des clés de ce que nous pourrions aujourd'hui
nommer un régime efficace des opérations garanties. Toutefois
malgré cette innovation juridique très en avance sur son temps il
« faut observer que l'hypothèque n'était soumise
à aucune mesure de publicité33». Nous avons
une sûreté mobilière sans dépossession, il ne nous
manque plus qu'un régime efficace pour en assurer la
publicité.
Hélas le moyen âge marque une sorte de
recule avec la règle les « Meubles n'ont pas de suite par
hypothèque » qui selon les interprétations34
établissait soit une restriction pure et simple de l'assiette de
l'hypothèque aux seuls biens meubles, soit une atteinte grave à
son efficacité en supprimant le droit de suite en matière
mobilière. C'est ainsi que commence une longue période de sommeil
pour le concept de sûretés réelles mobilières sans
dépossession35 et la question de leurs
publicités.
Le 19e siècle ne permit aucun
progrès sur ce point, le Code civil de 1804 « ne reconnaissait
comme seule sûreté mobilière que le gage avec
dépossession36». L'attente se prolongea et le
réveil en droit moderne du potentiel d'une sûreté
mobilière sans dépossession fut des plus timide37 au
sein du droit hexagonal là où certains droits étrangers se
montrèrent plus audacieux38.
L'attente s'est finalement achevée en 2006.
Année où l'on a pu s'amuser de la tendance de l'histoire à
se répéter quand, quasiment deux millénaires plus tard, le
législateur français a répété le geste des
juristes romains en supprimant l'exigence de dépossession
nécessaire à la constitution du contrat de gage.
Cette comparaison donne un éclairage
particulier à la vision du professeur LEGEAIS qui a écrit
à la suite de cette réforme « le nouveau gage sans
dépossession est assez proche par
32J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, « Droit
privé romain », 3e éd., 2009, Montchrestien, p. 299
(dans Christophe JUILLET, «Hypothèque», Répertoire
de droit immobilier, Dalloz, mai 2019.), paragr. 18.
33Christophe JUILLET,
«Hypothèque», op. cit., paragr. 19.
34« Dans les pays de droit écrit et les
pays de coutumes de l'ouest de la France, la règle n'interdit pas
l'hypothèque mobilière, mais la prive d'un droit de suite. Au
contraire, dans les autres pays de coutumes et en particulier dans la coutume
de Paris, la règle est comprise comme prohibant purement et simplement
l'hypothèque mobilière. », Christophe JUILLET,
«Hypothèque», préc., paragr. 23.
35La Loi du 9 messidor an III « consacre
l'interprétation de la règle « Meubles n'ont pas de suite
par hypothèque » qui était retenue par la Coutume de Paris.
Autrement dit, l'hypothèque mobilière est purement et simplement
interdite. », ibid.
36Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle »,
International and Comparative Secured Transactions Law Essays in honour of
Roderick A Macdonald, Spyridon V Bazinas and N Orkun Akseli, oct. 2017, p.
136.
37« Le législateur français choisit
dans un premier temps de ne reconnaître que ponctuellement de telles
sûretés sans dépossession, à travers des instruments
spéciaux et dans des domaines très spécifiques. »,
Jean-François RIFFARD, « Sûretés mobilières et
Stocks : ou l'Art et la Manière de résoudre la Quadrature du
Cercle », dans Spyridon V Bazinas, N Orkun Aksel, « International
and Comparative Secured Transactions Law Essays in honour of Roderick A
Macdonald », Hart publishing, oct. 2017, p. 137.
38Le législateur américain avait franchi
le pas dès 1952 avec le Security Interest 10 du Livre 9 de l'Uniform
Commercial Code (UCC Article 9), ibid.
son régime de
l'hypothèque39».
Quoi de plus normal quand on considère que
l'hypothèque, par la pensée des juristes romains, est
originellement née grâce à une antique soustraction de
l'exigence de dépossession à l'ancêtre du contrat de gage
qu'était le Pignus40 ?
9. Histoire croisée de la publicité
légale et de ses différents supports. Nous nous sommes
tournés vers le passé, avançons à présent
vers l'avenir. Quand on se demande comment communiquer au public une
information utile juridiquement, il faut obligatoirement se poser la question
de la technologie disponible à un instant T.
Le moyen le plus rudimentaire que l'on puisse se
figurer est l'oralité. Afin d'avertir les tiers, quoi de plus simple que
la parole ritualisée et la coutume. À ce propos le professeur
Alain SAYAG évoque l'avant 16e siècle où les «
les publicités légales prenaient forme de
cérémonial41 ». En guise d'exemple, il
évoque la cérémonie de l'abandon des biens se
déroulant traditionnellement sur les places publiques, mais on peut se
figurer que ce genre de publicité ritualisé existe depuis l'aube
des droits subjectifs. Évidemment, cette méthode de
publicité emporte de nombreux inconvénients, outre son
caractère contraignant qui exige un mode de vie en adéquation
avec le rythme des cérémonies et une forte cohésion
sociale, cette modalité d'information du public est soumise aux
aléas de la mutation que subit toute information transmise par le
bouche-à-oreille. Il s'agit donc d'une méthode de
publicité nécessairement faillible. Enfin, on peut lui reprocher
d'être attentatoire aux droits des personnes dans leur conception
moderne. Dans un registre voisin, l'auteur précité évoque
la publicité par les symboles avec « le bonnet vert du
failli42 ». Nul doute qu'une telle pratique ne saurait
correspondre aux standards actuels de la Cour européenne des droits de
l'homme en Europe.
Une tendance se dégage à l'aune de
l'histoire du droit, plus l'écriture est une pratique accessible plus
les systèmes juridiques on tendance à évoluer vers des
annonces légales écrites. Le point culminant de cette mutation
étant la démocratisation de l'imprimerie et l'essor des journaux
d'annonces légales.
Aujourd'hui, l'immense majorité de la
publicité légale est transcrite et diffusée grâce
à l'écriture alphabétique, mais est-ce réellement
ce langage le dernier maillon de la chaîne de l'évolution des
supports de la publicité légale ? Si l'on s'attache au
raisonnement d'Antoine GARAPON et de Jean LASSÈGUE, il n'en serait rien.
Dans leurs ouvrages « justice digitale43 », ils
nous expliquent comment l'écriture alphabétique qui a pour
objectif de figer la parole sur le papier est peu à peu
supplantée dans bien des domaines par l'écriture
numérique.
Cette écriture étrangère à
une grande majorité de la population semble être l'avenir de la
publicité légale.
La publicité via l'oralité a depuis
longtemps acquis un caractère anecdotique. Le registre papier et les
journaux d'annonce légale sont des modèles à bout de
souffle. Le registre purement informatique est un pas qui aurait
déjà dû être franchi. Enfin, l'avenir de la
publicité légale doit être recherché du
côté du langage numérique. Le développement
d'une
39Dominique LEGEAIS, « Sûretés »,
op. cit., paragr. 47.
40« À l'époque romaine, il
n'existait aucune restriction relative à l'assiette de
l'hypothèque, laquelle pouvait indistinctement porter sur des meubles ou
des immeubles, sur d'autres droits réels que la propriété
et même sur les droits de créance. », Christophe JUILLET,
« Hypothèque », op. cit., paragr. 19.
41Ibid.
42Ibid.
43À ce sujet, Antoine GARAPON et Jean LASSEGUE,
« Justice digitale : révolution graphique et rupture
anthropologique », Presses universitaires de France/Humensis, 11 avr.
2018.
blockchain44 visant à perfectionner
le registre du commerce et des sociétés marque cette nouvelle
étape du développement des supports de la publicité
légal.
10. Distinction entre deux efficacités
subjectives de la publicité. Il est possible d'opérer une
distinction entre publicité et opposabilité des droits
réels. L'opposabilité est la conséquence de la
publicité régulière des droits réels grevant des
biens à titre de garantie, le défaut de publicité est la
cause de l'inopposabilité de ces droits en tant que sanction incitative
et protection des tiers. Nous avons déjà défini la
publicité légale, définissons à présent la
notion d'inopposabilité. Pour se faire, « il convient de tenir
compte de la distinction entre opposabilité substantielle et
opposabilité probatoire45». La convention de
sûreté existe pour les parties comme pour les tiers, à
titre probatoire elle est opposable erga omnes46. Cependant, quant
à ses effets, faute de publicité régulière elle
demeurera sans effets vis-à-vis de « tous ceux dont la loi a
voulu protéger les intérêts47». Ainsi
un acte inopposable n'est pas remis en cause dans son existence, il faut juste
considérer que certains tiers sont protégés de ses effets
via le mécanisme de l'inopposabilité.
Le jeu des distinctions se corse quand on
évoque les formalités obligatoires de publicités et les
méthodes d'opposabilité. Et pour cause, ces notions
désignent les mêmes actes juridiques (dans la majorité des
cas l'inscription sur un registre). Toutefois, elles ne visent pas le
même point de vue. Via les formalités obligatoires de
publicité, on fait peser une contrainte sur les créanciers
garantis au profit de l'information des tiers. À l'inverse via les
méthodes d'opposabilité les créanciers garantis donnent
corps à leurs droits réels et les imposent au tiers dans le
réel juridique. P. BEDER nous rappelle qu'outre son rôle
informatif (du point de vue du tiers) les méthodes d'opposabilité
sont autant de moyens probatoires coûteux, mais utile pour le
créancier. Ainsi « Si un créancier désire
être garanti, il se doit de déclarer l'objet de sa créance
auprès d'un organisme doté du capital confiance nécessaire
et suffisant afin d'être capable, en cas de litige, de faire attester
juridiquement de la date et du contenu de la déclaration
déposée48 ».
On retrouve un sentiment de conflictualité. Les
tiers ont tout intérêt à ce que les
bénéficiaires des droits réels grevant des biens meubles
à titre de garantie soient astreints à de lourdes et exhaustives
formalités obligatoires de publicité au profit de leurs
informations. À l'inverse, les créanciers garantis ont besoin et
réclament des méthodes d'opposabilité simples et peu
coûteuses limitées aux informations absolument nécessaires
aux tiers et à la fourniture des preuves dont ils pourraient avoir
besoin en cas de litige.
Toutefois, bien que divergeant, ces
intérêts ne sont pas inconciliables. Car nous ne sommes pas en
présence d'un jeu à somme nulle où toute victoire d'une
des parties serait une défaite et une soustraction aux
intérêts de l'autre. Il est possible d'améliorer, de
rationaliser le système de la publicité
légale.
44Ce projet issu d'un partenariat entre la
société IBM et les greffes de différents tribunaux de
commerce a attiré notre attention, nous aurons prochainement l'occasion
de développer notre analyse de cette initiative.
45Guillaume ANSALONI, « Sur l'opposabilité
du gage sans dépossession de droit commun », La Semaine
Juridique Entreprise et Affaires,LexisNexis, n° 27, paragr.
8.
46Quiconque peut se prévaloir de la convention
comme une preuve ou un indice afin d'établir une vérité ou
une situation juridique qui peut avoir des conséquences en droit.
Guillaume ANSALONI donne cet exemple, « dans le cadre d'une action en
revendication exercée contre le possesseur, le contrat de vente sera
opposé par le revendiquant, non comme acte translatif de
propriété, mais comme un élément de preuve de
celle-ci », Guillaume ANSALONI, « Sur l'opposabilité du gage
sans dépossession de droit commun », préc.
47D. BASTIAN, « Essai d'une théorie
générale de l'inopposabilité »,Sirey, 1929, p.
322 s., et spéc. p. 325, « le droit d'invoquer
l'inopposabilité appartient à tous ceux dont la loi a voulu
protéger les intérêts et à eux seuls », (dans
Guillaume ANSALONI, « Sur l'opposabilité du gage sans
dépossession de droit commun », préc.).
48Pascal BEDER, « Publicité
légale », préc., paragr. 131.
11. l'optimisation de la publicité
légale d'opposabilité. L'efficacité que nous rechercherons
au cours de ce mémoire reviendra à se demander comment mieux
informer les tiers sans alourdir les obligations des créanciers
garantis. Ou comment réduire la charge des formalités
obligatoires de publicité pesant sur ces mêmes créanciers
sans pour autant sacrifier l'information des tiers ?
12. Annonce du plan. Tout au long de cette
étude, nous proposerons un modèle de publicité des
sûretés réelles mobilières théorique que nous
comparerons dans ses performances au droit positif français. Cette
méthode sera l'occasion d'évaluer les progrès qui ont
été apportés par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars
2006 relative aux sûretés tout en s'interrogeant quant à
d'éventuels perfectionnements inspirés par les travaux de la
Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial
international.
La conception de notre modèle de
référence de la publicité idéale se fera en deux
étapes. Nous rechercherons la quintessence de la publicité
légale. En évoquant ses missions, sa vocation, ses limites et les
prérequis juridiques ingrédient de son efficience nous
distillerons la substance de la publicité efficace (PARTIE 1). Enfin
pour maximiser la portée de nos efforts d'optimisation juridique nous ne
négligerons pas la question matérielle et technologique. Le
registre informatisé soutenu par une blockchain sera le creuset, le
réceptacle, dont les propriétés entreront en synergie avec
la publicité que nous choisirons de placer dans cet écrin (PARTIE
2).
- PREMIÈRE PARTIE -
LE CHOIX DE LA SUBSTANCE : VOCATION D'UNE
PUBLICITÉ EFFICACE
Le droit comparé nous offre des exemples
d'efficacité en matière de publicité des garanties
accordées aux créanciers. On pense évidemment aux travaux
de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (la
CNUDCI). En interrogeant certaines de ses recommandations, nous isolerons ce
qui fait, pour nous, figure de prérequis indispensable à
l'élaboration d'une publicité efficace des sûretés
réelles mobilières (Titre 1). Après quoi nous nous
interrogerons quant au rôle de la publicité au sein de notre ordre
juridique national, ce faisant nous évoquerons ses limites et nous
chercherons des pistes pour combler ses lacunes (Titre 2).
- TITRE 1 -
LES PRÉREQUIS DE L'EFFICACITÉ EN
MATIÈRE DE PUBLICITÉ DES
SÛRETÉS RÉELLES
MOBILIÈRES
La CNUDCI a à de nombreuses occasions
décrit ce qui, selon ses standards, s'apparenterait à un
régime idéal du droit des opérations garanti. Concernant
le sujet particulier de la publicité elle a émis plusieurs
recommandations qui nous semblent pertinentes. Il semble opportun de comparer
ces recommandations à l'état du droit positif en France afin de
déterminer si elles peuvent constituer un progrès en la
matière. Il sera d'abord question de la problématique de
l'incidence de la connaissance effective (chapitre 1), des méthodes
d'opposabilité efficaces supposant à notre sens un effet
automatique, dénué de tout élément subjectif.
L'opposabilité elle-même est en outre une notion qui doit
nécessairement être distinguée de l'étape de la
constitution d'une sûreté (chapitre 2). Ce point ne posera pas
particulièrement problème dans la mesure où le dogme
octogonal de l'autonomie de la volonté, dont les manifestations (force
obligatoire et effets relatifs des conventions) se marient bien avec la vision
de la CNUDCI. Plus ardue sera la tâche consistant à
défendre l'approche fonctionnaliste unitaire et globale (chapitre 3).
Toutefois, c'est un passage obligé, car la publicité efficace
dépend d'un droit des sûretés efficaces et est lourdement
handicapée par la prolifération de sûreté
spéciale aux régimes disparates que le droit français peut
connaître actuellement. Enfin, nous remettrons en cause la vocation
probatoire que la publicité peut avoir en droit français via
l'inscription par enregistrement de documents. En prônant l'inscription
par simple avis (chapitre 4) nous plaiderons pour une vision
particulière de la vocation d'une publicité efficace tout en
proposant une modification concrète et pratique de l'inscription en tant
que méthode d'opposabilité.
- CHAPITRE 1 -
LA NON-INCIDENCE DE LA CONNAISSANCE EFFECTIVE
La CNUDCI fait mention d'états où par
exception au principe du droit de suite, « un acheteur de biens
meubles corporels obtient ceux-ci libres de toute sûreté s'il les
achète de bonne foi49 ». Elle ajoute afin de
préciser cette notion que « Dans certains États,
l'acheteur est tenu de faire des recherches pour savoir si les biens sont
grevés d'une sûreté, tandis que dans d'autres il ne l'est
pas50 ». En somme, dans ces états décrits
par la CNUDCI la bonne foi d'un acquéreur, dont dépend la
question de savoir s'il peut ou non acquérir un bien libre de toute
sûreté, serait assimilée à sa connaissance d'une
éventuelle sûreté sur le bien en question. Nous
commencerons par nous éloigner de cette vision en soulignant le
caractère protéiforme de la notion de bonne foi grâce aux
débats doctrinaux entourant l'article 2276 du Code civil français
(Section 1). Puis nous rejoindrons la critique de la CNUDCI en plaidant pour
que connaissance présumée, connaissance effective et bonne foi
soit toutes trois écartées de la question de
l'opposabilité des sûretés mobilières (Section
2).
Section 1. L'épineuse distinction entre
connaissance de la sûreté et bonne foi au sens de l'article 2276.
La CNUDCI a vocation à proposer un droit
international efficace et uniforme via ses recommandations dont chaque
état est libre de s'inspirer à sa guise. En matière de
droit des sûretés, la documentation librement accessible de la
CNUDCI est une manne de « soft Law » dans laquelle chaque juriste
peut puiser pour mettre son propre droit national à l'épreuve.
Bien souvent, la CNUDCI évoquera des états qui adoptent telles ou
telles approches, telles ou telles visions, etc. Même si elle ne prend
pas la peine de les nommer, chacun pourra reconnaître un portrait plus ou
moins précis des ordres juridiques dans lesquels il s'est initié
au droit. En l'espèce, le critère de la bonne foi de
l'acquéreur nous évoque la vision de la publicité en droit
français.
Le droit positif français correspond-il
à la description sus-citée ? L'affirmative s'impose en
réponse à cette question et cela même si différentes
lectures de l'article 2276 s'affrontent sur le terrain de la distinction entre
connaissance de la sûreté et bonne foi de
l'acquéreur.
Pour certains auteurs, l'acquéreur de bonne foi
est une figure intouchable. Du fait de la règle, « en fait de
meuble possession vaut titre », ce tiers d'exception pourrait s'extraire
de toute règle de priorité et ne souffrir aucun concours quant
à ses droits sur la chose. Le rôle de la publicité serait,
selon cette interprétation, de faire peser sur lui une
présomption irréfragable de connaissance de la
sûreté. Dès lors que le créancier garanti aurait
observé les formalités obligatoires de publicité,
l'acquéreur étant irréfragablement présumé
connaître l'existence de la sûreté, il ne serait plus en
mesure d'invoquer sa bonne foi et la sûreté lui serait donc
opposable en tout état de cause. On remarque que ces auteurs, comme la
CNUDCI, assimilent la mauvaise foi d'un acquéreur à sa
connaissance d'une éventuelle sûreté. Ainsi pour Guillaume
ANSALONI « Dès lors que la publicité est accomplie et
que la connaissance du tiers est ainsi réputée, celui-ci ne
devrait en principe pas être admis à se retrancher derrière
son ignorance pour se prétendre être un possesseur de bonne foi au
sens
49« Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », p. 210, paragr. 74.
50Ibid.
de l'article 227651
».
À l'inverse, Romain BOFFA défend
l'idée que « bonne foi au sens de l'article 227952
du code civil et connaissance de la sûreté sont deux choses
clairement différentes53 ». Pour lui, « Le
possesseur qui ignore que son auteur n'est pas le propriétaire du bien,
mais qui a pu
avoir connaissance de la sûreté en
raison de sa publication ou qui en a réellement connaissance, doit se la
voir opposer54 ». Autrement dit selon cet auteur si
l'opposabilité
d'une sûreté dépend de la
connaissance que peuvent en avoir les tiers, cette même
connaissance ne doit pas être confondue avec la
bonne foi au sens de l'actuel article 2276. « Ainsi, lorsque la
sûreté est publiée, l'ayant cause se voit opposer la
sûreté, non parce qu'il
est de mauvaise foi au sens de l'article 2279 du
Code civil, mais parce que sa connaissance
de la sûreté est
établie55 ». Pour achever de se convaincre du
bien-fondé de cette vision il suffit de se demander de quel « titre
» il est question au premier alinéa de l'article 2276.
Quand on considère l'effet acquisitif de la
possession de meuble consacré par cette
disposition il paraît pertinent de parler
d'usucapion instantané du possesseur de bonne foi. Or qu'usucape
l'acquéreur de bonne foi dans le cadre de l'article 2276 sinon la
propriété du
meuble ? Ainsi on ne peut voir en cet article un
obstacle à l'opposabilité des sûretés dans
la
mesure où le créancier garanti, sauf
dans le cas des propriétés sûreté, ne vient pas
contester le statut de propriétaire du tiers acquéreur. Le
créancier garanti cherche seulement à faire valoir
son droit réel accessoire sur la chose de
l'acquéreur. Autrement dit, « la possession,
entendue
comme un pouvoir de fait sur une chose, permet
d'acquérir le droit correspondant aux prérogatives
exercées (...). L'exercice de ce pouvoir de fait est sans aucune liaison
avec
l'opposabilité de relations accessoires
préexistantes, dès lors qu'elles peuvent coexister avec le droit
acquis56 ». Or bien évidemment, un droit de
propriété peut coexister avec un droit réel accessoire
constitué par une sûreté réelle.
Ainsi nous rangerons-nous à l'approche de cet
auteur, en droit français c'est la connaissance par les tiers d'une
sûreté, fût-elle une connaissance présumée,
qui commande son opposabilité.
Il ne faut pas pour autant surestimer l'importance de
cette distinction éminemment octogonale. Si la CNUDCI ne fait pas de
différence entre bonne foi et connaissance ou
ignorance d'une sûreté, c'est parce
qu'elle renvoie dos à dos ces deux approches en leur adressant la
même critique. Une critique qui, bien qu'atténuée par le
système de la connaissance présumée que nous connaissons,
demeure une source de progrès à étudier.
Section 2. La présomption de connaissance de la
sûreté, un pis-aller à un véritable critère
objectif.
Si les éloges que la CNUDCI fait des
systèmes où la bonne foi de l'acquéreur fait échec
au droit de suite du créancier garanti sont rares, ils sont de
surcroît critiquables. Ainsi la CNUDCI souligne qu'« Un argument
en faveur de cette approche est que la notion de « bonne foi »
est connue de tous les systèmes juridiques et qu'elle a
déjà été très souvent
51 Guillaume ANSALONI, « Sur l'opposabilité
du gage sans dépossession de droit commun », préc., paragr.
18. 52Romain BOFFA écrit en 2007, c'est donc à l'ancien article
2279 qu'il fait référence. Aujourd'hui, la règle « en
fait de meubles possession vaut titre » loge à l'article 2276 du
Code civil (depuis le 19 juin 2008).
53Romain BOFFA, « L'opposabilité du
nouveau gage sans dépossession », Recueil Dalloz, 2007, p.
1161, paragr. 19.
54Ibid.
55Ibid. paragr. 14.
56Ibid. paragr. 12.
appliquée au niveau tant national
qu'international57 ». Nous émettons un doute
à ce sujet, en nous accordant à la démonstration de Romain
BOFFA, nous concluons que la notion de bonne foi est sujette à
interprétation. Dès lors, nous nous intéresserons qu'au
critère de la connaissance de la sûreté par le tiers, un
critère qui fait moins débat que la notion de bonne foi. Car si
la bonne foi est certes universellement partagée au sein des
différents ordres juridiques elle n'en demeure pas moins
protéiforme.
Démontrons brièvement pourquoi il faut
exclure la bonne foi du débat de l'opposabilité.
Interrogeons-nous. Pour être de mauvaise foi, suffit-il que l'on
contracte en pleine connaissance de l'existence d'une sûreté ou
faut-il nécessairement que l'on contracte en sachant que l'on bafoue une
interdiction d'aliéner stipulée par ladite
sûreté58 ? Évidemment, la réponse des
différents ordres juridiques ne sera pas unanime, la réponse
apportée par la CNUDCI relevant elle-même d'un parti pris
dommageable quant à un idéal d'harmonisation des droits des
sûretés.
Maintenant que nous avons mis la bonne foi à
l'écart, analysons le corps de la critique proposé par la CNUDCI.
En droit français un acheteur de biens meubles corporels obtient ceux-ci
libres de toute sûreté s'il n'avait pas connaissance de la
sûreté les grevant. Toutefois, cette situation d'apparence
intenable ne se présentera que rarement dans la mesure où
l'accomplissement des formalités obligatoires de publicité
emporte une présomption de connaissance de l'acte par les tiers. Cette
fiction bien commode est de la même veine que l'adage bien connu, «
nemo censetur ignorare lege », ainsi en France chaque
consommateur devrait avoir une connaissance exhaustive des formalités de
publicité affectant les biens qu'il achète.
Si l'on met de côté la pesanteur
économique écrasante que cette règle suppose59,
le fait que la publication d'une sûreté entraîne une
présomption de connaissance des tiers60 est sans doute un
progrès vers l'objectivité, étant donné que cette
disposition évite au moins de rechercher au cas par cas si untel
était au courant de la constitution d'une sûreté à
tel instant. Or c'est justement ce caractère subjectif, minimisé
par la présomption de connaissance, que la CNUDCI reproche aux
régimes des opérations garanties des états qui
procèdent ainsi : « Les règles de priorité qui
dépendent de la connaissance subjective peuvent compliquer le
règlement des conflits, rendant ainsi plus incertain le rang de
priorité des créanciers garantis et réduisant
l'efficacité du système61 ».
Toutefois si la règle de la publicité
emportant présomption de connaissance minimise
57« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », p. 210, paragr. 75.
58« Selon le Guide, l'acheteur de marchandises
dans le cours normal des affaires du constituant va prendre le bien libre de
toute sûreté, quand bien même elle lui serait opposable,
à moins qu'il n'ait eu connaissance au moment de la vente que celle-ci
violait les droits du créancier garanti », Jean-François
RIFFARD, « L'harmonisation internationale des droits des
sûretés mobilières : ne ratons pas le train ! »,
Revue de Droit bancaire et financier, LexisNexis, mars 2016, n°
2, dossier 11, paragr. 16.
C'est une critique que l'on put faire à la
CNUDCI. Bien qu'elle dénonce toute la subjectivité de l'exception
à l'opposabilité des droits réels qui reposent sur la
connaissance du tiers, elle n'a pas su totalement évacuer la notion de
bonne foi de son régime de la publicité des opérations
garanties. Nous reviendrons sur ce regrettable ajout plus tard dans nos
développements relatifs à la question de la priorité des
droits, grâce à la critique qu'en a fait Jean-François
RIFFARD. Voir infra., (note 245).
59On ne peut pas décemment attendre que chacun
se conforme à cette fiction. Bien plus raisonnable et pragmatique est la
règle de l'acquisition libre de tout droit réel dans le cadre du
cours normal des affaires. Une exception recommandée par la CNUDCI que
nous aurons largement l'occasion de détailler plus avant dans nos
développements.
60La publicité personnelle d'une
sûreté entraîne à minima une présomption de
connaissance de la sûreté par tous les ayants cause à titre
particulier du constituant. Autrement plus complexe est la question de
l'opposabilité de la sûreté aux sous-acquéreurs
successifs.
61« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », p. 225, paragr. 126.
les inconvénients de ce critère
éminemment subjectif, elle ne les supprime pas. On peut aisément
s'en convaincre en constatant que le texte prévoyant les
modalités de publicité des gages sans dépossession demeure
« silencieux sur le point de savoir si la connaissance effective du
gage par le tiers permet de remplacer le défaut d'accomplissement de la
publicité62 ». Un tel questionnement est, sans nul
doute, vecteur de conflit.
Voilà pourquoi il faut distinguer les
systèmes de publicité reposant sur la présomption de
connaissance des tiers dès l'inscription et les systèmes
où cette connaissance en tant que critère subjectif
problématique est tout simplement indifférente. Ainsi la CNUDCI
rappelle que « Le principe de la connaissance présumée
vaut uniquement dans un régime de priorité autorisant un tiers
qui n'a pas effectivement connaissance de l'existence d'une sûreté
à prendre le bien libre de cette dernière63
».
En nous rangeant aux recommandations de la CNUDCI,
nous considérons qu'un système efficace de la publicité
des sûretés réelles mobilière ne devrait pas se
référer à la connaissance (qu'elle soit effective ou
présumée) de la sûreté pour en conditionner
l'opposabilité et la priorité. L'inscription d'une
sûreté devrait avoir vocation à la rendre opposable
vis-à-vis de tous les tiers en mesure d'accéder au registre de la
publicité des sûretés réelles
mobilière.
Autrement dit dans un système de la
publicité idéale « la publication de la
sûreté doit avoir pour effet de la rendre opposable erga omnes et
le défaut d'accomplissement de cette formalité doit inversement
avoir pour effet de la rendre inopposable aux tiers le tout sans qu'il n'y ait
jamais à se poser la question de l'ignorance ou de la connaissance
effective de la sûreté par les tiers.64
»
62Romain BOFFA, « L'opposabilité du
nouveau gage sans dépossession », préc., paragr.
22.
63« Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », p. 156 paragr. 5.
64Pierre CROCQ, « Sûretés
mobilières : état des lieux et prospective », Revue des
procédures collectives, n° 6, LexisNexis, Nov. 2009, dossier
18, paragr. 20.
- CHAPITRE 2 -
LA DISTINCTION ENTRE CONSTITUTION ET OPPOSABILITÉ
D'UNE SÛRETÉ.
La CNUDCI retient trois approches pour décrire
les normes que les différents ordres juridiques peuvent avoir
vis-à-vis de la constitution des droits réels. « Selon
une première approche, une sûreté réelle
mobilière dûment constituée sur un bien non seulement
produit effet à l'égard du constituant, mais est aussi
automatiquement opposable à tous les tiers qui revendiquent un droit sur
le bien65 ». « Selon une deuxième
approche, la sûreté réelle mobilière ne produit
d'effet qu'à l'égard du constituant et un acte
supplémentaire (...) est exigé pour la rendre efficace à
l'égard des tiers qui revendiquent des droits sur le
bien66 ». Enfin selon une troisième approche «
une sûreté réelle mobilière produit
généralement effet à l'égard de toutes les parties
dès sa constitution, à l'exception des autres créanciers
garantis. Ainsi, aucun acte supplémentaire n'est nécessaire pour
la rendre opposable aux tiers hormis les autres créanciers
garantis67. »
Il est assez délicat de faire un rapprochement
entre le droit français et l'une de ces approches décrites par la
CNUDCI, car notre ordre juridique national manque d'une approche unitaire de la
question de l'opposabilité.
Ainsi, si certaines sûretés, tel le gage
de droit commun, sont aisément assimilables aux bénéfices
de la seconde approche (Section 2), on constate que des exemples comme celui de
la fiducie sûreté doivent être rattachés aux
défauts inhérents à la première approche (Section
1).
Section 1. La Fiducie sûretés et les
écueils de la première approche.
La première approche décrite par la
CNUDCI se caractérise par la confusion que certains États
opèrent entre constitution et opposabilité d'une
sûreté. On peut également parler de confusion entre
efficacité de la sûreté entre les parties et
efficacité de la sûreté à l'égard des
tiers.
En France, il existe bien un registre national des
fiducies cependant, ce registre n'a aucunement vocation à assurer la
publicité des droits des créanciers garantis. En effet, ce
registre n'est même pas accessible au public68. Dès
lors, on constate qu'une fiducie valablement constituée sur un bien
meuble a tous les défauts d'une sûreté occulte au regard de
la protection des intérêts de tout type de tiers. Elle est de
surcroît dangereuse pour le créancier garanti lui-même.
L'arbitrage qui doit forcément être opéré entre les
intérêts divergeant du créancier garanti et du tiers peut
très bien se solder par le sacrifice des intérêts du
créancier. Comme nous l'avons vu plus haut, il existe une voie
divergente en doctrine quant à la portée de l'article 2276 du
Code civil. En l'espèce si un fiduciant aliène un bien nonobstant
son affectation en garantie, le tiers acquéreur fera bien une
acquisition « a non
65« Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », p. 69, paragr. 2.
66Ibid., paragr. 3.
67Ibid., paragr. 4.
68« Sont autorisés à accéder
aux données mentionnées à l'article 2 les agents de la
direction générale des finances publiques chargés de la
mise en oeuvre du traitement individuellement désignés et
spécialement habilités à cette fin. », article 4 du
décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement
automatisé de données à caractère personnel
dénommé « Registre national des fiducies », accessible
en ligne sur le site de Légifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000021902741&categorieLien=id
domino » que la prescription acquisitive
de cet article a vocation à protéger dans l'intérêt
du commerce. En outre, l'argument de Roman BOFFA selon lequel la prescription
acquisitive d'un bien ne purge pas ce dernier des droits réels
accessoires préexistants est inopérant en matière de
propriété sûreté, car par définition le droit
ancien et le droit nouvellement acquis ne peuvent coexister en cette
hypothèse. Il apparaît que l'absence de publicité en
matière de propriété sûreté crée un
abîme d'insécurité juridique. Il semble difficile pour le
juriste d'assurer aux créanciers garantis qu'ils auront le dernier mot
en cas de litige si rien n'a été fait pour organiser la
publicité de cette sûreté. C'est pourquoi dès
l'apparition de ce dispositif Pierre CROCQ a recommandé de se passer
purement et simplement de la fiducie sûreté sans
dépossession69. Plus récemment Dominique LEGEAIS a
exprimé les mêmes réserves « Le
bénéficiaire de la fiducie-sûreté est donc sous la
menace des ayants cause du constituant pouvant se prévaloir de la
règle en fait de meuble, possession vaut titre lorsque la fiducie est
sans dépossession 70».
L'hypothèse où aucune formalité
obligatoire de publicité n'est envisagée est la pire, cependant
la CNUDCI rappelle qu'en l'absence de distinction entre constitution et
opposabilité d'une sûreté il ne peut y avoir de solutions
satisfaisantes. En effet, « Lorsque l'efficacité entre les
parties et l'opposabilité ne font l'objet d'aucune distinction, les
États, pour protéger les tiers, prévoient souvent de
nombreuses formalités contractuelles supplémentaires qui vont
bien au-delà de celles qui sont normalement requises pour qu'un contrat
produise effet entre ses parties71 ».
Raisonner ainsi revient à nier le rôle
particulier de la publicité pour la réduire à une simple
condition de forme alors qu'à l'inverse un régime efficace de la
publicité des sûretés réelles mobilière
devrait privilégier la voie du consensualisme chaque fois que celle-ci
est possible. L'impératif de la protection des tiers doit être
totalement déconnecté des questions de protections des
contractants qui bien souvent sont la raison d'être des contrats
solennels.
Section 2. L'exemple du droit commun du gage et les
attraits de la seconde approche.
On ne peut qu'être chagriné par les
difficultés posées par le peu de soin que le législateur a
accordé à la question de l'opposabilité des fiducies
sûreté quand on constate que le droit français a
très bien su établir une distinction entre constitutions et
opposabilité pour ce qui est du gage de droit commun.
Ainsi, l'article 2336 du Code civil dispose que «
Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant
la désignation de la dette garantie, la quantité des biens
donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature ».
Par cette lecture, il nous faut conclure qu'un gage qui ne ferait l'objet
d'aucune mesure de publicité serait tout de même contraignant pour
les parties en vertu du simple principe de la force obligatoire des conventions
légalement formé. Toutefois, le premier alinéa de
l'article 2337 du même code dispose que « Le gage est opposable
aux tiers par la publicité qui en est faite », il faut donc
admettre à contrario que le gage qui ne fait l'objet d'aucune
formalité de publicité est inopposable aux tiers.
69« l'opposabilité de la
fiducie-sûreté aux ayants cause du constituant est seulement
régie par le droit commun applicable aux mutations de biens meubles
corporels ou incorporels, ce qui a pour conséquence que la
fiducie-sûreté mobilière sera nécessairement, en
pratique, une fiducie-sûreté avec dépossession (ou
signification dans le cas d'une créance), cette dépossession
étant seule à même, en l'absence d'un système de
publicité, de protéger efficacement le créancier à
l'encontre des ayants cause de son débiteur ». Pierre CROCQ, «
Lacunes et limites de la loi au regard du droit des sûretés
», Recueil Dalloz, 2007, p. 1354.
70Dominique LEGEAIS, «
Fiducie-sûreté », J.-Cl., fasc. 10, 1er avr. 2011
(màj 12 juin 2017).
71« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », p. 70, paragr. 6.
La CNUDCI recommande72 ce type d'approche,
car elle permet d'une part à « faciliter la constitution d'une
sûreté sur un bien73 » tout en incitant
fortement le créancier garanti à protéger les tiers de sa
propre initiative en leur fournissant « un moyen peu coûteux et
fiable de déterminer si le constituant a grevé ce
bien74 ».
Ces arguments ayant vocation à emporter notre
conviction, nous suggérons que la distinction entre constitution et
opposabilité qui existe au sein du régime du gage de droit commun
soit étendue à tout le droit des sûretés national.
L'exemple des insuffisances de la publicité des propriétés
sûretés n'étant en définitive qu'un symptôme
du défaut d'harmonisation et d'approche globale en droit des
sûretés français.
72« Le Guide recommande de faire une distinction
entre les conditions requises pour qu'une sûreté produise effet
entre les parties et les conditions supplémentaires exigées pour
qu'elle produise effet à l'égard de tous les tiers », «
Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties
», p. 70, paragr. 7.
73Ibid.
74Ibid.
- CHAPITRE 3 -
L'APPROCHE GLOBALE ET FONCTIONNALISTE DE LA NOTION DE
SÛRETÉ.
Selon Étienne GENTIL, « L'un des
reproches qui est fait au régime des sûretés réelles
français est son caractère éclaté et disparate,
avec de nombreux types de sûretés différents, chacune sujet
à son propre régime, à sa propre documentation et à
ses propres règles de publicité et/ou
d'opposabilité75 ». Outre la première
remarque ici faite quant aux manques de lisibilité chroniques qui existe
en droit des sûretés français, le propos de cet auteur doit
attirer l'attention en raison du lien direct qu'il fait entre
l'éclatement de la matière et les difficultés que cela
implique vis-à-vis des formalités obligatoires de
publicité.
Ainsi apparaît-il qu'un système de la
publicité des sûretés réelles mobilières
gagnerait grandement en efficacité si l'ensemble de la matière
pouvait bénéficier d'une conception unitaire. Autrement dit, il
faudrait réunir sous un régime-cadre les différentes
garanties existantes afin de les soumettre à un ensemble de normes
communes et à des formalités obligatoires de publicité
harmonisée.
Partageant ce souhait, dans une certaine mesure, Pierre
CROCQ a pu regretter que le législateur n'ait pas su profiter de la
réforme de 2006 pour « adopter un droit commun de la
publicité applicable au moins à toutes les sûretés
réelles mobilières et, si possible, susceptible d'être
étendu, en respectant leurs particularismes, aux sûretés
sur les fonds ou aux sûretés sur certains meubles incorporels
».
Outre la simple question de la publicité,
Jean-François RIFFARD va plus loin et présente, « la
caractéristique commune d'être construits autour d'un
système unitaire de sûretés mobilières
conventionnelles76 » comme un préalable
nécessaire à toute harmonisation du droit des
sûretés avec les standards internationaux de modernité et
d'efficacité.
On remarque que ces deux auteurs sont tous deux
favorables à l'harmonisation bien qu'ils l'envisagent à des
degrés différents.
En optant pour une approche « purement
transsystémique », le groupe 6 de la CNUDCI, dont
Jean-François RIFFARD est membre depuis 2002, a donné naissance
à un modèle pragmatique et fonctionnel d'efficacité en
matière de sûreté mobilière. Ce modèle est
détaillé dans les divers documents de la CNUDCI que nous avons pu
citer au cours de cette étude. Lors du présent chapitre, nous
nous prononcerons en faveur d'un degré d'harmonisation maximale. Nous
nous intéresserons au champ d'application des recommandations de la
CNUDCI, à savoir le modèle « de la sûreté
unique dont le régime est suffisamment large et souple pour couvrir
l'ensemble des hypothèses de sûretés réelles
mobilières77».
Afin d'obtenir ce résultat : une
sûreté unique assortie de formalités obligatoires de
publicité invariable, Jean-François RIFFARD propose deux
méthodes. La première consiste en la consécration d'un
numerus clausus, la sûreté dont le régime est défini
par la loi, étant la seule reconnue78 (Section 1). La seconde
« englobante » et « téléologique
» fait appel à la « théorie
générale de ce qui constitue une sûreté
mobilière79» propre à la vision
75Étienne GENTIL, « problématique des
investisseurs finance et droit des sûretés », Revue
d'économie
financière, association d'économie
financière, 2018, n° 129, p. 106.
76Jean-François RIFFARD, « L'harmonisation
internationale des droits des sûretés mobilières : ne
ratons pas le
train ! », préc., paragr. 3.
77Ibid., paragr. 9.
78Ibid.
79Ibid. paragr. 4.
fonctionnaliste de la matière (Section 2). Elle
revient à lier inextricablement l'application du nouveau régime
à la fonction de sûreté, si bien qu'aucun mécanisme
futur naissant pour remplir cette utilité économique ne saurait
échapper à l'unité. La première approche est la
plus facile à mettre en oeuvre, là où la seconde,
malgré les difficultés qu'engendrent tout bouleversement
révolutionnaire, semble être la plus adaptée sur le long
terme.
Section 1. L'unification nationale, l'approche unitaire
par soustraction.
À la question : « Pour quelles
raisons, par exemple, un nantissement de fonds de commerce devrait-il
être nul s'il n'est pas enregistré dans les trente jours de sa
création80 (...) alors que ce n'est pas le cas pour d'autres
sûretés ?81 », le juriste peine à
fournir une réponse cohérente. Et pour cause, comme le fait
remarquer Étienne GENTIL « Ces différences de
régime ont des fondements essentiellement historiques
».
La sûreté spéciale semble
être la réponse toute trouvée du législateur
à chaque fois qu'une difficulté se présente en la
matière. Ainsi il faut rappeler que les gages et les nantissements
spéciaux « n'avaient été antérieurement
créés que parce que le gage supposait la
dépossession82».
Bien conscients de la nuisance que représente
cette prolifération de régimes spéciaux, même les
auteurs les plus modérés s'accordent à souhaiter la
suppression des mécanismes les plus archaïques. Ainsi l'association
Henri Capitant recommande de « tirer les conséquences de la
modernisation du droit commun du gage opérée en 2006 en
supprimant des régimes spéciaux rendus inutiles (warrant
hôtelier, warrant industriel, gage commercial, etc.)83
».
Toutefois, la soustraction ne suffit pas. Comme le
fait remarquer Jean-François RIFFARD, « C'est là une
démarche classique, et donc rassurante, mais qui présente le
risque de voir ce numerus clausus être par la suite contourné par
la pratique, voire remis en question par le législateur
lui-même84 ». Autrement dit, on aura beau obtenir de
haute lutte la suppression de tel ou tel mécanisme désuet, rien
n'empêchera le législateur d'en créer de nouveaux. En
effet, personne n'avait demandé la consécration du gage des
stocks avec dépossession et pourtant le législateur l'a fait. En
outre, la pratique a su démontrer son imagination en termes de
mécanisme de garantie inovant. Voilà pourquoi, la seconde
approche, apparaît comme une solution plus durable.
Section 2. L'unification globale, l'approche unitaire
par définition.
L'idée est de retenir une définition
basée sur la fonction de toutes sûretés. Dès lors,
tout mécanisme présent ou futur inventé pour servir de
sûreté ne pourrait qu'être soumis au régime
préexistant.
Cette approche, que l'on qualifiera de «
fonctionnelle est souvent évoquée comme étant
caractéristique du droit des sûretés réelles en
common law nord-américaine85 ». Adopter
80Articles L. 142-4 du Code de commerce : «
L'inscription doit être prise, à peine de nullité du
nantissement, dans les trente jours suivant la date de l'acte constitutif
».
81Étienne GENTIL,« problématique des
investisseurs finance et droit des sûretés », préc.,
p. 106.
82Pierre CROCQ, « Sûretés
mobilières : état des lieux et prospective », préc.,
paragr. 20.
83Michel Grimaldi, Denis Mazeaud, Philippe Dupichot,
« Présentation d'un avant-projet de réforme des
sûretés », Dalloz actualité, 3 Oct. 2017, accessible
en ligne :
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/presentation-d-un-avant-projet-de-reforme-des-suretes#.XVl_UOgzZY
84Jean-François RIFFARD, « L'harmonisation
internationale des droits des sûretés mobilières : ne
ratons pas le train ! », préc., paragr. 9.
85Yaëll EMERICH, «La nature juridique des
sûretés réelles en droit civil et en common law: une
question de tradition juridique? », RJTUM, 2010, n° 44-1, p.
99 et s.
cette approche suppose des bouleversements
conséquents en droit positif français. Se ranger à cette
vision de la matière c'est adopter une définition
particulière de la notion de sûreté, où il serait
moins question de mettre l'accent sur la qualification formelle d'une
transaction que sur son effet concret et sa fonction de garantie. À
l'inverse, le droit civil est souvent décrit comme la demeure d'une
approche essentialiste, notionnelle ou conceptuelle axée sur la nature
juridique de la transaction86.
Toutefois si la réforme peut paraître
ardue elle n'a rien d'impossible. Citons l'étude comparative de
Yaëll EMERICH qui nous met en garde contre la tentation de se fier
à une représentation caricaturale de l'opposition entre ces deux
approches. En effet, il faut bien admettre que l'opposition entre l'approche
fonctionnelle et l'approche conceptuelle n'est pas seulement une question de
tradition87. L'auteur fait remarquer que chaque système
juridique s'est frayé un chemin à travers ces deux types
d'approches88. Pour appuyer ses dires, elle évoque l'exemple
de la réforme du droit des sûretés québécois,
un système civiliste qui a su faire une place croissante à
l'approche fonctionnaliste89.
Pour en revenir aux déboires du droit
français, il suffit de s'intéresser à ses
problématiques de qualifications, qui sont récurrentes dans les
ordres juridiques qui privilégient une approche notionnelle.
Ainsi le droit français prête-t-il des
conséquences importantes à la qualité du constituant.
Avant 2006, si un droit réel sur chose fongible était
constitué par un commerçant, il fallait impérativement
soumettre cette opération garantie au régime du gage des stocks
prévu par le code de commerce. À l'inverse, la même
opération qui verrait un constituant non professionnel s'engager devait
être soumise au régime du gage sur chose fongible prévue
par le droit commun au sein du Code civil.
Cet exemple montre comment un ordre juridique peut
préférer attacher des conséquences juridiques à la
qualification particulière d'une opération garantie, plutôt
qu'à ses effets. Plus que la fin (garantir une obligation) c'est le
moyen (gage de droit commun, warrant, gage des stocks, etc.) qui conditionne
l'application de telle ou telle règle de droit.
Cette approche n'est pas dénuée
d'intérêt, on peut être tenté par cette idée
d'un droit des sûretés à la carte. Le législateur
pourrait par exemple considérer que le pacte commissoire est une
stipulation trop dangereuse qu'il faudrait écarter des
sûretés constituées par des
non-commerçants90. Trêve d'ironie, tel bien n'est pas
si différent de tel autre. D'aucuns diraient qu'il est fondamentalement
possible de soumettre les meubles corporels et incorporels à un seul et
même régime91. D'aucuns diraient que la
spécificité des stocks en tant que bien ne
86Ibid., même si dans son étude
Yaëll EMERICH prend l'exemple du droit civil québécois, par
bien des égards la description qu'elle en fait est transposable au droit
civil français.
87Yaëll EMERICH, «La nature juridique des
sûretés réelles en droit civil et en common law: une
question de tradition juridique? », préc., p. 140.
88Ibid.
89Ibid.
90En matière de gage sur stocks, l'ancien
article L527-2 du code de commerce prohibait tout pacte commissoire. Il a fallu
attendre l'ordonnance n° 2016-56 du 29 janvier 2016 relative au gage des
stocks pour que cette pratique soit autorisée par le droit
spécial du gage des stocks. Dans le même temps, le droit commun du
gage permettait une sûreté comparable au gage des stocks via le
gage sur chose fongible. À la différence, qu'étant
placé sous l'égide du droit commun, le gage sur chose fongible
permettait le recours à un pacte commissoire. Les constituants non
commerçants étaient donc moins protégés par le
législateur que les constituants commerçants. Ce paradoxe qui
appartient aujourd'hui à l'histoire du droit doit nous amener à
relativiser l'argument selon lequel une prolifération de régimes
spéciaux permettrait de répondre à des besoins
spécifiques. Bien souvent, une telle approche créait plus
d'incohérence que d'adaptabilité.
91Jean-François RIFFARD, « L'harmonisation
internationale des droits des sûretés mobilières : ne
ratons pas le train ! », préc., paragr. 11.
justifie pas que l'on succombe à la «
tentation du régime spécial
»92.
Selon la CNUDCI, « l'ensemble des
opérations qui font naître un droit sur tout type de bien en
garantie de l'exécution d'une obligation (c'est-à-dire qui
remplissent une fonction de sûreté) devraient être
considérées comme des opérations garanties et
régies par les mêmes règles ou tout du moins, par les
mêmes principes93 ». Nous ajouterons qu'au rang de
ces principes communs doit obligatoirement figurer une unique formalité
obligatoire de publicité.
Permettre qu'il existe des sûretés qui ne
disent pas leur nom en dehors de la définition retenue par un ordre
juridique peut revenir à les soustraire purement et simplement aux
formalités obligatoires de publicité. Ou à minima, cela
revient à détacher l'obligation de publicité des garanties
accordées aux créanciers de la notion de sûreté. Or
on ne comprend pas pourquoi un régime efficace de la publicité
des sûretés réelles mobilières devrait souffrir de
cette complexification inutile alors même que toutes les
opérations reposant sur l'affectation d'un meuble à la garantie
d'une obligation devraient d'office être soumises à une
publicité obligatoire. Car c'est le péril que représentent
les droits réels occultes qui justifie l'impératif de la
publicité et non la qualification formelle accordée à tel
ou tel mécanisme.
Ainsi l'absence de publicité des
propriétés sûretés sans dépossession en droit
français à vocation à fournir de manière
récurrente son lot de conflits et de dilemme insoluble. En effet «
Si la réserve de propriété puis la
fiducie-sûreté ont été consacrées par la loi,
le législateur n'a néanmoins prévu aucun régime de
publicité pour ces sûretés lorsqu'elles portent sur des
meubles.94 » Or « À défaut d'une
inscription sur registre public, les tiers ne peuvent connaître
l'existence de la propriété-sûreté sans
dépossession95 ».
Une définition unitaire de la notion de
sûreté aurait le mérite de rattacher les
propriétés sûretés au régime de la
publicité. Ces mécanismes ainsi que tous les autres susceptibles
d'être inventés par la pratique ou par le législateur,
devraient, dans un souci de prévisibilité, être soumis par
avance à une inscription obligatoire96 sur un registre global
des sûretés mobilières.
92Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du
Cercle », préc., p. 150.
93« Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », p. 24, paragr. 62.
94Yannick BLANDIN, « Sûretés et
bien circulant contribution à la réception d'une
sûreté réelle globale », th.
préc., paragr. 160.
95Ibid.
96Sous peine d'inopposabilité.
- CHAPITRE 4 -
LA MISE EN AVANT DE L'INSCRIPTION PAR SIMPLE AVIS
La publicité efficace en matière de
sûreté réelle mobilière comporte
nécessairement deux qualités essentielles. Nous avons
déjà évoqué l'intérêt de distinguer
les notions de constitution et d'opposabilité d'une sûreté.
Toutefois, un régime de la publicité efficace ne saurait tirer
tous les avantages de cette distinction en présence de méthodes
d'opposabilités limitant la constitution de sûreté. Ainsi
l'inscription sur un registre apparaît (notamment, car elle permet la
constitution de sûreté sur bien futur) comme la méthode
d'opposabilité à privilégier (Section 1). Ajoutons encore
que toutes les formalités obligatoires de publicité qui reposent
sur l'inscription sur un registre ne se valent pas. De par sa souplesse, il
apparaît que l'inscription par simple avis doit être
privilégiée à l'inscription par enregistrement des
documents relatifs à la sûreté. (Section 2)
Section 1 : L'inscription plutôt que la
dépossession
La dépossession en tant que méthode
d'opposabilité a tout d'un vestige, du contrat réel
qu'était le gage en droit français. Avant l'ordonnance de 2006,
on considérait le gage comme un contrat réel où la
dépossession du constituant entre les mains du créancier garanti
était une condition de validité. « Le Code civil de 1804
ne reconnaissait comme seule sûreté mobilière que le gage
avec dépossession97 ». La CNUDCI constate par
ailleurs que « Pendant très longtemps, la plupart des
États ont généralement interdit les sûretés
réelles mobilières sans dépossession98
».
Avec la consécration du gage de droit commun
sans dépossession, il convient de se demander si la dépossession
du constituant en tant que méthode d'opposabilité a encore une
place dans un régime moderne de la publicité des
sûretés réelles mobilière.
Autrefois, le manque de sûreté sans
dépossession était si criant, que praticien comme
législateur ont cherché moult pis-aller pour atteindre les
objectifs que seule l'inscription en tant que méthode
d'opposabilité peut atteindre en toute cohérence. Ainsi la
pratique s'est-elle attachée à tordre la notion de
dépossession. Elle découvrit le dispositif de
l'entiercement99. Entiercement qui permit de limiter efficacement la
charge que peut représenter l'obligation de conservation du bien
grevé pour le créancier garanti, tout en permettant aux
constituants de grever plusieurs fois le même bien. Le tiers en tant que
partie neutre pouvant très facilement tenir le compte de la
priorité des droits.
Le législateur quant à lui a
multiplié les exceptions au principe de la dépossession
impérative en matière de sûreté mobilière.
Avant 2006 existait-il ainsi de « nombreux gages ou nantissement
spéciaux sans dépossession qui étaient naturellement les
plus utilisés en pratique100 ». Effet pervers,
« des registres multiples ont eu tendance à se
développer en
97Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle », préc.,
p. 136.
98«Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », p. 113.
99En évoquant les réponses de la
pratique à l'absence de sûreté sans dépossession,
Jean-François RIFFARD nous apprend que « Les commerçants et
industriels français comme américains utilisèrent alors
habilement la notion de dépossession symbolique ainsi que celle de tiers
convenu et indépendant, à travers l'organisation
d'entrepôts publics dans lesquels le constituant était
invité à déposer ses stocks »., Jean-François
RIFFARD, « Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et
la Manière de résoudre la Quadrature du Cercle »,
préc., p. 136.
100Pierre CROCQ, « Sûretés
mobilières : état des lieux et prospective »,
préc., paragr. 11.
conséquence de la reconnaissance, au coup
par coup, de diverses sûretés sans dépossession sur des
biens meubles101 ».
Maintenant que l'inscription en tant que
méthode d'opposabilité est fermement ancrée dans le droit
commun du gage, est-il bien utile de conserver la dépossession en tant
que méthode subsidiaire102 ? Il existe assurément des
raisons légitimes qui peuvent amener un créancier garanti
à préférer un gage avec dépossession à un
gage sans dépossession. Certaines de ces raisons procèdent de la
notion même de dépossession et elles plaident en faveur du
maintien de cette pratique. Cependant, d'autres avantages s'ils ont
été historiquement attachés à la
dépossession peuvent très bien être transposés
à l'inscription par la voie de la réforme, un processus
déjà maladroitement engagé, semble-t-il.
1. L'emprise matérielle, identité propre
de la dépossession. La dépossession est une méthode
d'opposabilité où le constituant d'une sûreté
mobilière renonce à la possession de l'un de ses biens pour le
placer entre les mains du créancier garanti à charge pour ce
dernier de conserver le bien. En principe, le créancier garanti n'a pas
de droit d'usage sur la chose grevée, il bénéficie
simplement d'un droit de préférence le bien grevé
étant affecté à la garantie de sa créance. Dans sa
version la plus basique et entière cette méthode
d'opposabilité emporte des avantages certains que le créancier
garanti ne pourrait obtenir d'une autre façon. À l'inverse, les
avantages qu'elle aurait pour les tiers sont à nuancer dans la mesure
où l'inscription est une formalité obligatoire de
publicité éminemment plus efficace en termes
d'information.
Parce que la dépossession suppose une emprise
matérielle, elle assure le créancier garanti que le constituant
ne pourra pas disposer de ses biens engagés sans son accord. Nul besoin
pour le créancier garanti de se préoccuper de faire valoir un
quelconque droit de suite à l'encontre d'un acquéreur ignorant.
Avec la dépossession le créancier à un total
contrôle sur l'aliénation du bien grevé.
Le créancier garanti est également
protégé contre la négligence du constituant. «Le
créancier garanti ne court pas le risque de voir lesdits biens se
déprécier parce que le constituant en aurait
négligé la conservation ou l'entretien
nécessaire103». Ce point doit toutefois être
nuancé, en effet on peut raisonnablement penser que le professionnel
disposera de la compétence et des moyens nécessaires pour
conserver le bien dans de meilleures conditions que ne peut se le permettre le
créancier garanti. Toutefois, le fait de ne pas dépendre de la
bonne volonté de son cocontractant peut être rassurant pour le
créancier confiant en ses capacités de conservation.
Enfin l'avantage le plus décisif lié
à la dépossession du constituant : « si la
réalisation du gage devient nécessaire, le créancier
garanti se voit épargner les soucis, la perte de temps, les
dépenses et le risque auquel il s'exposait s'il devait réclamer
au constituant la remise des biens grevés 104»
Pour ce qui est des prétendus vertues que la
dépossession aurait du point de vue du constituant et des tiers, nous ne
pouvons pas nous montrer aussi affirmatifs. Selon la CNUDCI, «
L'obligation pour le constituant de se déposséder des biens
engagés évite de créer chez lui une apparence trompeuse de
richesse (à savoir l'apparence qu'il a la propriété des
biens libres de tout droit réel) ». En réponse à
cet argument, largement partagé
101« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », p. 160, paragr. 21.
102Comme le prévoit l'article 2337 du Code
civil: « Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en
est faite ; Il l'est également par la dépossession entre les
mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet
».
103« Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », p. 47, paragr. 55.
104Ibid.
105Lionel ANDREU, « Gage avec dépossession
contre gage sans dépossession », Recueil Dalloz, 2012, p.
1761. 106Ibid.
en doctrine, il convient d'admettre qu'en effet, si un
vendeur ne peut présenter la chose à un acheteur alors ce dernier
aura de bonnes raisons de s'interroger. Toutefois, d'une part le doute n'aide
en rien à assurer une circulation efficace des biens et des capitaux.
C'est de certitude que l'acheteur a besoin pour pouvoir prendre une
décision rapide et ménager ainsi la gestion de son temps et de
ses efforts de recherche. D'autre part, il apparaît qu'à
l'époque de l'essor du e-commerce et de la
dématérialisation des relations bancaires, tiers acquéreur
comme créancier en recherche de garanti semblent peu à même
de se déplacer jusqu'au sillon d'une exploitation agricole pour
vérifier si le constituant conserve toujours la possession de son
outillage. À l'inverse, n'est-il pas plus plausible d'imaginer le
prêteur et le particulier apte à user d'un registre proposant une
simple recherche personnelle que l'on pourrait envisager comme rapide et
gratuite ?
En conclusion, il faut admettre que l'emprise
matérielle en tant que garantie dans la cadre de cette méthode
d'opposabilité qu'est la dépossession à des avantages
caractéristiques pour le créancier garanti. Ainsi ne nous
apparaît-il pas raisonnable de plaider pour une disparition des
sûretés mobilières traditionnelles avec
dépossession. Toutefois, les avantages de cette méthode
d'opposabilité en matière de publicité sont plus que
discutables. Ainsi recommanderons-nous dans cette étude de soumettre
à l'inscription, en tant que formalité obligatoire de
publicité, toutes les sûretés mobilières. Une unique
méthode d'opposabilité pour une sûreté unique
adaptée à tout type de bien, tel est notre projet.
2. Le droit de rétention, une entrave à
l'attractivité de l'inscription. Si les avantages de la
dépossession évoqués plus haut jouent certes un rôle
dans son attractivité, ils ne nous apparaissent pas comme la raison
principale qui pousserait un créancier à la choisir en
présence d'une option avec une sûreté identique sans
dépossession. En droit positif français, les arguments les plus
convaincants des sûretés avec dépossession ne sont pas
directement liés à l'emprise matérielle du
créancier sur la chose comme l'on pourrait le croire. Le
véritable attrait du gage avec dépossession, pour prendre le
droit commun en exemple, est le droit de rétention qui l'accompagne. Or,
la promotion de l'inscription est exigée par des intérêts
économiques cruciaux, tels que la nécessité pour le
constituant de disposer de ses biens dans la poursuite de son activité
économique.
Ainsi, c'est sans doute afin d'aider l'inscription
à prendre le pas sur la dépossession que le législateur a
cru bon de la doter d'un nouvel attrait, le droit fictif de rétention.
En 2006 le législateur avait « réservé au gage
avec dépossession - qui, seul, prive matériellement le
constituant de sa chose - le droit de rétention de l'article 2286 du
Code civil105». Lionel ANDREU poursuit en constatant que
le législateur a assuré « au créancier gagiste
avec dépossession une situation préférable à celle
de créancier gagiste sans dépossession. Cette solution a dû
paraître intolérable au législateur, qui a repris en 2008
le texte consacré au droit de rétention pour gommer cette
différence dissuasive 106». Ainsi naquit le droit
fictif de rétention de l'article 2286 alinéa 4 du Code
civil.
Or si nous sommes favorables à une
revalorisation de l'attractivité des sûretés sans
dépossession, dans le souci de favoriser une publicité efficace
par inscription, nous ne pouvons nous résoudre à sacrifier pour
cela ce qui fait tout l'intérêt de ces mécanismes : la
possibilité de librement disposer des biens grevés. Or le droit
de rétention dans la mesure où il n'existe que comme un pouvoir
de blocage s'oppose à cet idéal. À ce propos nous nous
accordons à la vision de Yannick BLANDIN, libérer « le
gage de la nécessité d'une dépossession de l'assiette,
permettait enfin de dépasser les difficultés en résultant.
Octroyer
au gagiste un droit de rétention même
fictif, revient à réaffirmer un pouvoir de blocage du
créancier que l'on voulait proprement écarter
».
Afin de doter l'inscription du potentiel de
résilience et de protection qui caractérise la
dépossession, le législateur a inventé un droit fictif de
rétention qui bénéficie aux créanciers gagistes
sans dépossession. Toutefois, force est de constater que le droit fictif
de rétention n'est que l'ombre de son homologue plus
tangible.
Qu'est-ce que le droit de rétention ? Ce serait
selon une approche classique le droit de retenir accordé à celui
qui tient la chose pour un motif légitime. C'est le droit du garagiste
d'emmurer la voiture de son client jusqu'à ce que ce dernier ait
consenti à payer l'intégralité des réparations dont
son bien a profité. En adoptant le prisme de la vision classique, on ne
saurait envisager un droit de rétention sans possession. C'est ce qui a
amené une partie de la doctrine à une vive critique du droit
fictif de rétention107. En conséquence, si on admet
que l'emprise matérielle est consubstantielle au droit de
rétention alors tout droit de rétention sur un bien incorporel
paraît inconcevable.
Toutefois, il en va autrement si on adopte la vision
d'Augustin AYNES qui a démontré dans sa thèse que «
si l'on dissocie rétention et détention et si l'on
considère que ce qui compte ici c'est essentiellement l'exercice d'un
pouvoir de blocage sur le bien concerné, on peut parfaitement admettre
que le droit de rétention puisse s'exercer sur n'importe quel bien
incorporel108». L'essence du droit de rétention
serait donc un pouvoir de blocage, on peut aisément admettre ce point de
vue dans la mesure où on comprend comment un créancier garanti,
qui aurait légitimement le droit d'empêcher autrui de jouir et de
disposer de son bien sans passer par des considérations physiques,
serait tout de même en mesure de le contraindre efficacement à
honorer ses dettes. Néanmoins, cette seconde approche ne nous aide pas
à cerner l'apport de l'alinéa 4 de l'article 2286 qui accorde un
droit de rétention fictif au créancier gagiste sans
dépossession. En effet, comme le fait justement remarquer Pierre CROCQ
« ce pouvoir de blocage n'existe pas dans le cas de l'article 2286, 4
°, du Code civil où le législateur, par une
méconnaissance totale de ce qui constitue l'essence même du droit
de rétention, a consacré l'existence d'un droit de
rétention totalement fictif et artificiel ! 109»
Maintenant que les sûretés avec
dépossession ont été consacrées en droit
français via le droit commun du gage, il faut prendre garde au jeu de la
concurrence qui peut exister entre les garanties. En présence de
sûreté avec dépossession trop attrayante, les
créanciers en quête de garantie, partie forte s'il en est une,
pourraient être tentés de réclamer de tels dispositifs
là où une sûreté sans dépossession aurait
été tout indiquée pour permettre à
l'économie de suivre son cours. Assurément, un constituant qui a
besoin d'un crédit acceptera de se passer de certains de ses outils
alors même que cette perte a vocation à affecter la
rentabilité de son travail et donc indirectement sa capacité
à rembourser sa créance.
Pour l'heure, il est difficile de concevoir garantie
plus brutale que le droit de rétention quand il est question de passer
comparativement chaque sûreté à la rude épreuve des
procédures collectives110. C'est une critique que l'on peut
faire au droit de rétention, malgré
107Pour une critique du droit fictif de
rétention voir Yannick BLANDIN, « Sûretés et bien
circulant contribution à la réception d'une sûreté
réelle globale», préc., p. 73, paragr. 92 et
suivants.
108V. A. AYNES, « Le droit de
rétention, unité ou pluralité », préf.
Ch. Larroumet, Économica, 2005, n° 78 à 98, (dans Pierre
CROCQ, « Nantissement de fonds de commerce et refus du droit de
rétention fictif de l'article 2286, 4°, du Code civil »,
RTD civ., 2014, p. 158).
109Pierre CROCQ, « Nantissement de fonds de
commerce et refus du droit de rétention fictif de l'article 2286,
4°, du Code civil », préc.
110« Dans bien des cas, en effet, le gagiste sans
dépossession ne pourra pas se prévaloir des avantages que le
droit des entreprises en difficulté accorde au gagiste avec
dépossession en raison de sa rétention de la chose gagée
(exception à l'interdiction de payer les créances
antérieures ou postérieures non privilégiées pour
retirer le bien retenu ; possibilité d'opposer au cessionnaire du bien
le droit de rétention pour refuser de s'en dessaisir ;
son archaïsme il a le tort d'être trop
efficace, et se faisant il fait de l'ombre à l'inscription en tant que
méthode d'opposabilité. Ce défaut apparaît encore
plus criant quand on prend en considération toutes les inventions de la
pratique qui vise à neutraliser les aspects contraignants de la
dépossession pour n'en conserver que la puissante efficacité.
Avec l'entiercement « à domicile », que d'aucuns voudraient
voir consacré par le droit positif111 on aboutit à une
dépossession très peu contraignante pour le créancier
garanti qui peut de surcroît jouir d'un droit de rétention loin
d'être fictif.
Conserver des opportunités de
sûreté avec dépossession est sans conteste un gage de
diversité qui sert l'efficacité de notre système
juridique. Toutefois, il faut veiller à ce que cette méthode
d'opposabilité soit utilisée dans des cas bien précis
où l'emprise matérielle est directement intéressante pour
le créancier. Une dépossession trop attractive, qui
concurrencerait l'inscription viendrait amoindrir le progrès obtenu par
la consécration de cette méthode d'opposabilité efficace
et moderne. C'est pourquoi, à notre sens, il faudrait que le
législateur se prononce contre cette artificialisation de la
dépossession qui lui confère une attractivité indue. Le
fait qu'on ait à se demander si la dépossession existe où
non dans un cas d'espèce est en soi une preuve de cette dérive.
Ajoutons finalement que cette course à qui volera le plus prêt du
soleil est nuisible aux propres intérêts des créanciers
garantis qui s'exposent aux aléas de la jurisprudence via une
interprétation plus stricte de l'existence de la
dépossession112.
Dans des cas extréme, le constituant en vient
à devoir rémunérer un tiers dont la seule tâche est
de conserver son bien, dans ses locaux, avec le concours de ses propres
salariés113 ! On peut même légitimement se
demander pourquoi les sociétés proposant le service
d'entiercement prendraient la peine de se déplacer jusqu'à
l'entreprise du constituant une fois chaînes et cadenas mis en place.
Dans le même ordre d'idée, on se demande bien quel salarié
vouerait une telle ferveur à la bonne exécution du droit qu'il
refuserait de laisser son employeur accéder à cette machine dont
il a besoin pour honorer une commande imprévue. Un tel contentieux, qui
n'a vocation qu'à croître est selon nous incompatible avec
l'idéal d'une publicité efficace des sûretés
réelles mobilières. Il apparaît que la dépossession
en tant que méthode d'opposabilité telle qu'elle existe
aujourd'hui en droit français n'a de réel intérêt
que pour le créancier garanti. Nous ne nous opposons pas à ce
qu'il jouisse de ses avantages en matière de procédure
collective, là n'est pas notre sujet. Cependant, nous pensons que
l'attrait de la dépossession devrait toujours être
contrebalancé, à minima, par sa totale et non équivoque
effectivité. Maintenant qu'il existe des sûretés sans
dépossession, ces entiercements artificiels font figure de confort
superflu.
impossibilité de se voir imposer une
substitution de garantie. », Lionel ANDREU, « Gage avec
dépossession contre gage sans dépossession »,
préc.
111L'association Henri Capitant propose que l'article
2337 du Code civil : « Le gage est opposable aux tiers par la
publicité qui en est faite. Il l'est également par la
dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu
du bien qui en fait l'objet... » soit complété comme suit :
« La dépossession entre les mains d'un tiers peut avoir lieu sans
déplacement du bien, pourvu que ce tiers en assure la garde effective et
veille au respect de ses obligations par le constituant ». Association
Henri Capitant, « avant-projet de reforme du droit des
sûretés », accessible en ligne :
http://www.henricapitant.org/travaux/legislatifs-nationaux/avant-projet-de-reforme-du-droit-des-suretes
112Pour une analyse de deux jurisprudences comparable
où il faut déployer un certain effort de concentration pour
comprendre pourquoi la dépossession a été reconnue comme
effective dans un cas et non dans l'autre, voir Pierre CROCQ, « Une trop
grande dématérialisation de la dépossession fait perdre le
bénéfice du gage avec entiercement », Dalloz, RTD
Civ., 2015, p. 665.
113Ibid.
Section 2 : L'inscription par simple avis plutôt
que l'inscription par enregistrement de document.
La CNUDCI évoque « Un certain nombre
d'États » qui « ont instauré, pour les
sûretés réelles mobilières, ce que l'on pourrait
appeler un système d'enregistrement de documents qui, s'il ne permet pas
d'inscrire la propriété des biens meubles, sert à prouver
l'existence de certaines sûretés.114
»
En Droit français, c'est l'article 2 du
décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 qui est venu fixer
le cadre de l'inscription du nouveau gage de droit commun. « Le
créancier remet ou adresse au greffier du tribunal de commerce l'un des
originaux de l'acte constitutif de la sûreté ou une
expédition si l'acte est établi sous forme authentique
».
Force est de constater que le droit français a
fait le choix du système de publicité que la CNUDCI évoque
comme un système d'inscription par enregistrement de document. À
notre sens, ce choix n'est pas anodin, il démontre la vocation que le
législateur entend donner à la publicité, une vocation
probatoire. Pourtant selon la CNUDCI dans un régime idéal de la
publicité des sûretés mobilières la loi devrait
faire en sorte que « L'inscription soit effectuée par
enregistrement d'un avis contenant les informations spécifiées
dans la recommandation 57, et non par la présentation de l'original ou
d'une copie de la convention constitutive de sûreté ou d'un autre
document115 ». La recommandation 57 sus-citée
limitant quant à elle les informations nécessairement contenues
dans l'avis à un strict minimum n'ayant pas à être
vérifié par le conservateur du registre pas plus que
l'identité de celui qui procède à l'inscription
d'ailleurs. « Le conservateur du registre n'exige pas la
vérification de l'identité de la personne procédant
à l'inscription ni de l'existence d'une autorisation pour
procéder à l'inscription de l'avis, et ne réalise aucun
examen approfondi de la teneur de l'avis116 ».
À la lumière des exigences de notre
droit positif, ces modalités d'inscription peuvent paraître bien
légères, et sans conteste elles le sont ! C'est en somme
exactement comme cela qu'elles ont été pensées, comme des
modalités souples et simples de nature à faciliter constitution
et opposabilité des sûretés. Dès lors, les
précautions prises en droit français, via l'inscription par
enregistrement de documents, font figure d'alourdissement superflu. Afin
d'apporter un élément de réponse à ce
problème, il faut s'interroger quant à la vocation qui doit
être celle de la publicité efficace. Il faut soulever la
discordance qui peut exister entre ce rôle et la raison d'être des
vérifications et sécurité de l'enregistrement actuel.
Autrement dit le rôle que l'on prête à l'inscription par
enregistrement de document, à savoir apporter la preuve de la
constitution d'une sûreté, est-il compatible avec la vocation
d'une publicité efficace ?
1. La vocation probatoire de l'inscription par
enregistrement de document. Il est très facile de discerner le lien de
parenté entre l'inscription par enregistrement de document et la
publicité foncière. En effet en matière d'immeuble la
publicité a traditionnellement vocation à apporter une preuve
objective de la propriété comme de l'existence de droits
réels. Toutefois, même s'il existe des exemples de biens meubles
immatriculés de grande valeur117
114« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », p. 157, paragr. 11. 115«
Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties
», p. 498. 116Ibid.
117On pensera aux registres spéciaux des navires
et aéronefs par exemple.
pour lesquelles l'exemple de la publicité
foncière peut être très pertinent, en règle
général la publicité mobilière à tout
à gagner à s'éloigner de ce schéma.
Finalement que gagne-t-on à exiger du
conservateur d'un registre des sûretés mobilières qu'il
vérifie l'écrit original de la constitution d'une
sûreté réelle mobilière ? Une preuve de l'existence
de cette convention entre les parties, et la preuve au bénéfice
des tiers que toute sûreté mobilière renseignée dans
le registre à une existence réelle, pourrait-on
répondre.
Entre les parties. Comme nous l'avons vue plus haut,
la distinction entre constitution et opposabilité est une pierre
angulaire de l'efficacité en matière de publicité des
sûretés réelles mobilière. En considérant
cette distinction, il semble étrange de faire jouer à
l'inscription, formalité obligatoire de publicité par excellence,
un rôle probatoire vis-à-vis de la constitution d'une
sûreté. En règle générale, le
législateur exige un écrit à titre probatoire ou en tant
que condition de validité quand il veut promouvoir la
sécurité juridique entourant la constitution d'un acte.
L'inscription apparaît comme un outil contre indiqué pour cette
tâche, d'autant que l'exigence d'un écrit devrait suffire à
prouver l'existence d'une sûreté en cas de litige de nature
contractuelle.
À l'égard des tiers. L'investissement en
temps et en argent que suppose la vérification systématique des
documents exigés par cette forme d'inscription semble totalement
disproportionné vis-à-vis de l'avantage que pourraient en retirer
les tiers. En effet, le risque de la prolifération de fausses
sûretés est un risque auto généré par le mode
de l'inscription par enregistrement de document. Autrement dit, si
l'inscription sur le registre n'emporte pas présomption
réfragable, et encore moins présomption irréfragable, de
l'existence d'une sûreté, on peine à trouver quelle valeur
pourrait avoir une inscription frauduleuse.
Il convient toutefois de nuancer l'approche
préconisée par la CNUDCI, à notre sens l'inscription par
simple avis ne devrait pas supposer qu'on ne vérifie pas
l'identité de celui qui procède à cette formalité.
D'autant que cette vérification sera grandement facilitée par
l'utilisation de la technologie Blockchain que nous préconisons pour la
conservation du registre. En vérifiant systématiquement
l'identité de ceux qui procèdent aux inscriptions, nous pourrons
définitivement écarter le risque d'inscription malveillante
(pensée pour nuire à l'apparence de solvabilité d'un
concurrent par exemple). Cette hypothèse, bien que probablement
marginale doit faire l'objet de sanction exemplaire pour que l'accès au
registre puisse sereinement être ouvert à tous, et que
l'inscription par simple avis s'impose comme la norme.
2. La vocation de la publicité efficace. Afin
de justifier sa démarche, la CNUDCI rappelle que « Les
registres fondés sur le concept d'inscription d'avis existent dans un
nombre croissant d'États et ont en outre recueilli un large soutien au
niveau international118 ». Incontestablement,
l'inscription par simple avis est un modèle qui tend à se
développer au gré de l'harmonisation internationale du droit des
sûretés mobilières. Dans ce contexte l'opposabilité
reposant « sur l'inscription, dans un registre central organisé
sur une base personnelle, d'un simple avis et non de la convention constitutive
de sûreté119 » tant à s'imposer comme
le modèle dominant. Et pour cause, ce système contrairement
à
118La CNUDCI évoque ainsi « la Loi
modèle sur les sûretés de la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement, la Loi type
interaméricaine relative aux sûretés mobilières de
l'Organisation des États américains, le guide sur les registres
de biens meubles intitulé « A Guide to Movables Registries »
de la Banque asiatique de développement, la Convention relative aux
garanties internationales portant sur des matériels d'équipement
mobiles et les protocoles s'y rapportant et l'annexe de la Convention des
Nations Unies sur la cession », « Guide législatif de la
CNUDCI sur les opérations garanties », p. 158, paragr.
14.
119Jean-François RIFFARD, «
L'harmonisation internationale des droits des sûretés
mobilières : ne ratons pas le train ! »,préc., paragr.
14.
l'inscription par enregistrement de document «
autorise les inscriptions en ligne et le cas échéant les
inscriptions conservatoires anticipées120
».
Quand on accepte que la publicité n'a pas
à avoir de vocation probatoire, qu'elle existe pour assurer
l'opposabilité des sûretés et la protection des tiers, on
accepte sans peine qu'un registre basé sur l'inscription de simple avis
ne s'embarrasse pas de vérifications coûteuses et chronophages. En
effet, « Si l'inscription était soumise à approbation
officielle, une telle condition irait à l'encontre du type d'inscription
rapide et bon marché nécessaire pour promouvoir le crédit
garanti ».
Pour ce qui est des deux avantages inhérents
à l'inscription par simple avis soulignés par
Jean-François RIFFARD : inscription en ligne et inscription
conservatoire anticipées, on constate que ces deux
caractéristiques de l'inscription par simple avis sont tout aussi
nécessaires à une publicité efficace qu'elles sont
incompatibles avec le système actuel.
L'inscription en ligne doit sans conteste s'imposer
comme le mode d'inscription de droit commun. Pour s'en convaincre il suffit de
relever toutes les complications inhérentes à la tenue d'un
registre papier. Enfin le simple fait de ne pas avoir à se
déplacer aux greffes du tribunal de commerce, pour y déposer
l'original de la convention de sûreté et le fait de ne pas avoir
à prendre le risque d'envoyer ce document par voie postale constituent
un progrès dont la pratique saura se réjouir. C'est encore plus
vrai pour ce qui est des opérations garanties internationales. Ainsi
certains ont dénoncé un système d'opposabilité
« trop octogonal121 ». D'aucuns ont en effet
relevé que certaines dispositions « exigeant que des
formalités de publicité soient faites sur un registre
spécial tenu au greffe du tribunal « dans le ressort duquel le
débiteur a son siège ou son domicile122 »
». Selon cet auteur cela rendrait « impossible ou inutilement
coûteux l'accomplissement des formalités d'opposabilité
à l'encontre d'un constituant ayant son siège social à
l'étranger et n'étant pas immatriculé en
France123 ». Nul doute que dans ce cas précis
l'approche via l'inscription électronique par simple avis faciliterait
grandement la vie des affaires.
Pour ce qui est du deuxième point,
l'inscription conservatoire anticipée, il est aisé de
la
résumer à une logique lapidaire : nul ne
peut fournir l'original de la sûreté qui n'existe pas encore.
Pourtant l'intérêt est conséquent et le législateur
améliorerait grandement la situation des créanciers garantis s'il
permettait ce type d'inscription anticipée. Ajoutons que cela
constituerait aussi une amélioration de l'information des tiers. En
effet, plus un avertissement survient en amont d'une situation délicate,
plus il est utile.
Ainsi « Dans un système d'inscription
d'avis, ainsi qu'il a été noté
précédemment,
l'avis inscrit est indépendant de la
convention constitutive et il n'est pas nécessaire pour procéder
à l'inscription de soumettre les documents relatifs à la
sûreté ni de prouver celle-ci d'une autre
manière124 ». Entre autres bénéfices,
l'autorisation de l'inscription anticipée permet «
l'inscription d'un avis unique suffit pour assurer l'opposabilité
des sûretés grevant les biens décrits dans l'avis, qu'elles
aient été constituées en vertu d'une convention unique ou
de plusieurs conventions séparées liant les mêmes parties,
même si elles ont été conclues à des dates
différentes125 ».
De manière générale,
l'inscription par simple avis « réduit le coût de
l'opération pour les personnes procédant à l'inscription
(qui n'ont pas besoin de fournir la preuve de la convention constitutive de
sûreté) et pour les tiers effectuant une recherche qui n'ont
pas
120Ibid.
121Étienne GENTIL,« problématique des
investisseurs finance et droit des sûretés », préc.,
p. 102.
122Ibid.
123Ibid.
124« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », P 181, paragr. 98.
125Ibid.
besoin d'éplucher une documentation pouvant
être volumineuse126 ». En outre, cette
méthode « réduit la charge administrative et le travail
d'archivage du personnel chargé d'exploiter le système de
registre127 ». Enfin, elle «
réduit le risque d'erreur d'inscription moins il y a d'informations
à communiquer, moins il y a de risque d'erreur128
». Évidemment, tous ces avantages ne sont pas à
négliger pour qui est en quête du registre efficace !
126« Guide de la CNUDCI sur la mise en place
d'un registre des sûretés réelles mobilières
», p. 24, paragr. 59. 127Ibid., p. 25, paragr. 59.
128Ibid.
- TITRE 2 -
DU RÔLE TRADITIONNEL DE LA PUBLICITÉ, DU
CONSTAT DE SES LIMITES, ET DE SA NÉCESSAIRE ÉVOLUTION
Pour une approche complète de la vocation de la
publicité, il faut distinguer sa mission positive de son rôle
négatif. Positivement, la publicité vise à fournir une
information aux tiers. C'est ce que l'on peut nommer son utilité
traditionnelle : informer (chapitre 1). Négativement, elle commande la
sanction de l'inopposabilité qui vise à protéger les tiers
selon des conditions très variables d'un ordre juridique à un
autre. Le déclencheur de l'inopposabilité d'un acte qui fait le
moins débat est le cas d'absence totale de publicité. Dans un
régime optimisé de la publicité des sûretés
mobilières, un tel exemple devrait confiner à une
inopposabilité inconditionnelle, quels que soient les
intérêts des tiers en présence. Cependant, même une
publicité rigoureuse, du fait de ce que nous nommerons l'angle mort de
la publicité personnelle, ne peut informer les sous-acquéreurs,
que nous nommerons tiers aveugles à la publicité personnelle.
Dès lors faut-il, au mépris du juste et de la
sécurité juridique, sacrifier les intérêts de ces
tiers ? Ou faut-il amputer les créanciers garantis de leurs droits de
suite au risque de nuire gravement à l'efficacité des
sûretés réelles mobilières ? Cette seule question
démontre les limites de la publicité dans sa mission protectrice
des tiers (Chapitre 2). Comme souvent face à un dilemme insoluble, la
bonne solution est de ne pas se résoudre à trancher. En partant
de l'exemple particulier des abondants travaux universitaires sur les
sûretés sur stock, nous proposerons des alternatives au droit de
suite quand les difficultés qu'il pose ne peuvent pas être
traitées par la publicité. Une publicité efficace doit
être consciente de ses lacunes. Ainsi la nécessaire
évolution de cette matière commande-t-elle de supprimer les
risques que nous ne pouvons prévenir (Chapitre 3).
- CHAPITRE 1 -
INFORMER LES TIERS, L'UTILITÉ TRADITIONNELLE DE
LA PUBLICITÉ.
Il existe une multitude de bénéfices
différents propres à la publicité des sûretés
réelles mobilières. Chaque tiers intéressé par les
affaires du constituant en fait un usage distinct. Nommer
précisément une liste de tiers à qui s'adresse la
publicité qui nous intéresse est purement impossible, car par
définition la publicité s'adresse à une foule
anonyme129. Il est néanmoins possible de former
différentes catégories de tiers en fonction de
l'intérêt que la publicité peut avoir à leurs
yeux.
À cette étape, l'important est de
retenir que limiter la vocation informative de la publicité à
certaines catégories de bénéficiaires est purement
contre-productif. Contrairement aux règles de droit qui imposent des
notifications obligatoires, le coût économique des
formalités obligatoires de publicité n'augmente pas
corrélativement au nombre de bénéficiaires. Limiter les
bénéfices d'information et de protection de la publicité
en formant des catégories d'exclus revient à complexifier
inutilement cette matière.
Ainsi si certains tiers doivent être
informés de l'existence d'une sûreté réelle pour
pouvoir mesurer le risque de leurs engagements quand il contracte avec le
constituant ou l'un de ses ayants cause à titre particulier (Section 2),
d'autres tiers dépendent de la publicité pour anticiper la
dégradation de leurs situations (section 1).
Section 1 : Aider le tiers à anticiper
l'aggravation de sa situation.
Considérons la convention constitutive d'un
gage, ce contrat est loin d'être dénué d'effet pour nombre
de tiers. Il ne faut pas retenir de la notion d'effet relatif des conventions
issues du dogme de l'autonomie de la volonté que le contrat serait un
monde alternatif construit par les cocontractants pour y vivre en autarcie.
C'est d'autant plus vrai en matière de droit réel. Même si
l'article 1199 du Code civil dispose que « le contrat ne crée
d'obligation qu'entre les parties », l'affectation d'un bien à
la garantie d'une créance est une opération qui est de nature
à impacter la situation économique des tiers. En effet, l'article
1200 du Code civil ajoute que les tiers doivent « respecter la
situation juridique créée par le contrat ». Pour
Mathias LATINA, cela « illustre le rayonnement de la force obligatoire
au-delà de la sphère contractuelle130 ».
Ainsi même si le contrat ne met pas d'obligations à la charge de
celui qui n'y a pas consenti, il s'agit d'un acte qui crée un
réel juridique que tout agent économique rationnel désire
prendre en compte pour penser ou repenser sa position dans une relation
d'affaires.
Indirectement, la constitution d'une
sûreté réelle, dans la mesure où elle affecte
certains biens à la garantie d'une certaine créance, a vocation
à altérer la solvabilité générale du
constituant. Informer tous ceux qui pourraient voir leur droit de gage
général amputé entre dans le cadre du rôle
traditionnel et basique de la publicité.
Le créancier bénéficiaire d'une
sûreté personnelle et le créancier chirographaire sont les
tiers les plus éloignés de l'épicentre du séisme
que constitue la création d'une sûreté réelle.
Si
129« Dès que les destinataires d'une
information sont connus, nous avons affaire à une notification, non pas
à une publicité, et c'est alors un tout autre régime
juridique qui s'applique », Intervention d'Alain SAYAG, dans le colloque
« l'information légale dans les affaires : quels enjeux ?
Quelles évolutions ? », préc.
130Mathias LATINA, « Principes directeurs du
droit des contrats », Répertoire de droit civil, Dalloz,
actualisation Janv. 2019, paragr. 144.
bien qu'on ne pense pas, de prime abord, à
l'aggravation, pourtant évidente, de leurs situations. Prenons l'exemple
d'un contrat de cautionnement, on comprend rapidement quel intérêt
peut avoir le créancier garanti à être informé des
gages sans dépossession que pourrait consentir sa caution au profit
d'autres créanciers.
Le créancier bénéficiaire d'une
sûreté personnelle se voit consentir un second droit de gage
général sur le patrimoine de son garant. Une telle
sûreté n'emportant pas de droit de préférence, dans
le pire des cas, le créancier bénéficiaire d`une
sûreté personnelle peut se voir primer dans ses droits par une
multitude de créanciers privilégiés. Finalement, les
sûretés réelles lui posent le même problème
qu'à un créancier chirographaire. À ceci prêt que ce
dernier, ne peut compter que sur son droit de gage général
unique. Il est dès lors encore plus exposé aux risques de voir
les droits réels s'accumuler sur le patrimoine de son débiteur.
Autant de soustractions à la valeur sur laquelle il serait susceptible
de se payer en cas de défaillance. Malgré la
précarité de leurs situations, certains seraient tentés de
laisser ces deux tiers en dehors des objectifs d'informations de la
publicité des sûretés réelles mobilières. En
effet, la CNUDCI rappelle que « Dans certains États, la
sûreté produit effet dès sa constitution non seulement
entre le constituant et le créancier garanti, mais aussi à
l'égard des créanciers chirographaires131
».
Il convient à notre sens de se garder d'une
telle hiérarchisation dans les raisons qui poussent les tiers à
désirer l'information. La publicité ne doit pas être un
privilège accordé à une catégorie de tiers
justifiant d'un intérêt particulier. Elle doit s'adresser à
tous ceux qui se donneront la peine de la consulter. Ajoutons qu'un
régime efficace de la publicité des sûretés
réelles mobilières doit produire les mêmes effets, y
compris ceux relatifs à l'inopposabilité, à l'égard
de tous.
Le rôle de la publicité est
d'éviter aux tiers de se méprendre quant à
l'intérêt d'une opération en raison d'une trompeuse
propriété apparemment non grevée du constituant. Or il
n'est pas souhaitable qu'un créancier chirographaire qui a
déjà consenti un crédit se complaise dans une situation
illusoire de solvabilité de son débiteur alors même que
celui-ci est en train de grever un à un chacun de ses biens.
La sûreté réelle est la
sûreté la plus égoïste. Chaque bien mis en gage pour
garantir une créance est un bien qui sera soustrait au droit de gage
général des créanciers chirographaires. Incontestablement,
leurs situations se dégradent à chaque nouvelle
sûreté réelle. Il faut obligatoirement les en informer pour
qu'ils puissent dans le pire des cas faire le deuil d'une créance sur
laquelle ils ne peuvent plus raisonnablement compter. De surcroît, cette
information pourra leur éviter de prêter davantage au constituant
en se figurant que sa situation n'a pas changé depuis leurs premiers
engagements.
Enfin, on peut se demander si « la
publicité est l'appui de la vertu, la sauvegarde de la
vérité, la terreur du crime, le fléau de
l'intrigue132 », toujours est-il qu'en matière de
sûretés réelles mobilières elle a vocation à
éviter des arrangements et fraudes133 contraires aux
intérêts des créanciers chirographaires. Cette raison
suffirait à elle seule à arguer qu'il n'y a pas de tiers de
seconde zone et que l'information via la publicité doit être
accessible à tous. S'il apparaît que l'information est utile aux
créanciers chirographaires déjà engagés, elle l'est
tout autant pour ceux qui envisagent de consentir un prêt. En effet,
« les créanciers
131« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », p. 110., paragr. 10.
132Maximilien ROBESPIERRE, « Discours par
Maximilien Robespierre 17 avril 1792-27 juillet 1794 ».
133« L'obligation d'inscrire rapidement la
sûreté sur un registre public ou d'accomplir une formalité
supplémentaire équivalente réduit le risque qu'une
prétendue sûreté ne soit en fait qu'un arrangement
collusoire entre un constituant insolvable et un créancier
bénéficiant d'un traitement préférentiel »,
« Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations
garanties », p. 110. Paragr. 11.
chirographaires fondent leur décision de
prêter sur la santé financière générale du
constituant, la présence ou l'absence de sûretés peut
être l'un des facteurs pris en compte dans cette
décision134 ». Les créanciers
chirographaires ou bénéficiaires de sûretés
personnelles ont besoin de la publicité des sûretés
réelles mobilières pour évaluer les risques de leurs
engagements.
Section 2 : Informer le tiers des risques de son
engagement.
L'ayant cause à titre particulier du
constituant, voici le tiers le plus emblématique, celui qui vient en
premier à l'esprit quand on songe aux mésaventures du tiers
ignorant en matière de sûretés
mobilières.
En droit français, Romain BOFFA rappelle que
« lorsque le gage opère sans dépossession, le
constituant, propriétaire du bien, conserve ce bien entre ses mains. Il
est donc susceptible de céder le bien à autrui en le mettant en
possession.135 » Un ayant cause à titre particulier
peut alors être : au mieux un autre créancier
bénéficiaire d'une sûreté réelle concurrente,
pire un acheteur, et encore pire un donataire.
1. L'ayant cause à titre particulier,
créancier garanti concurrent. Une première sûreté a
déjà été consentie par le constituant et il
souhaite affecter un même bien à la garantie d'une seconde
créance. Dans cette situation le rôle de la publicité est
d'informer ce second créancier garanti qui est un tiers à la
première convention de sûreté. La question qui
intéresse cet ayant cause à titre particulier du constituant est
celle de l'antériorité. Se voir consentir un droit de
préférence n'est que partiellement rassurant pour lui s'il est
primé en ses droits par des créanciers de rang supérieur.
C'est en ces termes qu'il faut évoquer la question de la priorité
d'une sûreté.
À ce sujet, l'article 2340 du Code civil
dispose que « Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs
gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est
réglé par l'ordre de leur inscription ». Le rôle
de l'inscription est ainsi de fournir une donnée facilement
vérifiable utile au classement chronologique de la priorité des
droits, méthode souhaitable et majoritairement retenue au sein des
différents ordres juridiques. La diffusion transparente de cette
information est en outre dans l'intérêt du constituant, «
en lui permettant d'utiliser un bien déjà grevé pour
garantir et trouver de nouveaux crédits, ce qui ne serait pas possible
si la connaissance de ses futurs créanciers n'était pas
assurée par un système efficace de
publicité136 ». En effet, si on considère un
bien d'une grande valeur et une créance modeste, un droit de
préférence de piètre rang peut suffire. Quand bien
même le créancier garanti serait primé en ses droits par
nombre de créanciers concurrents, il sait qu'en cas de
réalisation de la sûreté le risque qu'il ne soit pas
complètement désintéressé grâce à son
droit de préférence est plutôt faible. Cependant pour faire
ce calcul encore faut-il qu'il bénéficie d'informations fiables
et accessibles.
Quid de l'articulation de la priorité des
droits en présence d'une sûreté avec dépossession et
d'une sûreté sans dépossession ? Le deuxième
alinéa de l'article 2340 du Code civil dispose que « Lorsqu'un
bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement
l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de
préférence du créancier gagiste antérieur est
opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est
régulièrement
134Ibid.
135Romain BOFFA, « L'opposabilité du
nouveau gage sans dépossession », préc., paragr. 11.
136Pierre CROCQ, « Sûretés mobilières : état
des lieux et prospective », préc., paragr. 4.
publié nonobstant le droit de
rétention de ce dernier ». Selon Lionel ANDREU, cet article
« désactive le droit de rétention du seul
créancier gagiste postérieur137». Cela
signifie que le second créancier garanti s'il opte pour un gage avec
dépossession ne pourra pas faire valoir son droit de rétention
contre le gagiste antérieur. Il a donc tout intérêt
à consulter le registre des sûretés réelles
mobilières, car son emprise matérielle sur la chose aurait
tôt fait de lui communiquer un sentiment de sécurité
trompeur.
Si la situation est inversée, la
publicité du gage montre ses premières failles. Si l'ayant cause
du constituant (le second créancier garanti de notre exemple) opte pour
une sûreté sans dépossession, alors qu'il existe
déjà une sûreté avec dépossession affectant
le bien au profit d'un créancier garanti antérieur, il entre en
fâcheuse posture. Or a-t-on réellement laissé à ce
tiers une chance de s'informer correctement ? Pour vanter les mérites de
la dépossession en tant que méthode d'opposabilité Lionel
ANDREU dénonce l'inscription en évoquant « des
formalités complexes et incertaines, qui pourraient retarder le
déroulement de l'opération dans certains
cas138». Nous pouvons lui accorder ce point,
certes la publicité des sûretés mobilières est
éminemment perfectible en droit positif.
Toutefois, il poursuit en regrettant que la
publicité du gage ait « pour effet de porter à la
connaissance des tiers l'existence d'un endettement du débiteur et de
l'affectation d'une partie de ses actifs mobiliers à la garantie des
dettes 139». Cette critique nous interpelle. D'une part,
n'est-ce pas le propre de cette publicité efficace que nous traquons
d'informer les tiers ? D'autre part, vanter la «
confidentialité » de la dépossession n'est-ce pas
reconnaître son total échec sur le plan de l'information des tiers
? La dépossession revient finalement à une publicité par
le vide, où l'on s'attend à ce que le tiers remarque l'absence de
tel bien alors même que nous avons précédemment vu que la
dépossession se fait de plus en plus fictive pour contenter les
intérêts des créanciers garantis.
Admettons que le tiers à une première
convention de sûreté se déplace jusqu'à l'entreprise
du constituant pour choisir physiquement quel bien il désire prendre en
gage, alors même que cette idée est totalement à
contre-courant de la dématérialisation de l'économie.
Peut-on réellement exiger de lui qu'il se figure que le vin
stocké dans les propres cuves du constituant, dont la conservation est
le fruit du travail des propres salariés du constituant140,
est en fait un bien grevé par un gage avec dépossession au profit
d'un créancier antérieur qui menace de le primer dans ses droits
? C'est un fait, plus la dépossession se fait artificielle plus elle
perd cette faculté à informer les tiers que l'on peine à
lui reconnaître en premier lieu.
Aujourd'hui, l'article 2337 du Code civil dispose que
« Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est
faite il l'est également par la dépossession entre les mains du
créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet ».
Notre interrogation est la suivante, faut-il soumettre les gages avec
dépossession à l'inscription ? La question peut paraître
incongrue, mais elle se justifie au gré de nos développements. La
dépossession n'est plus comme autrefois une garantie d'information des
tiers. Quand le recours au registre des sûretés réelles
mobilières se sera démocratisé, l'idée de se donner
la peine de consulter le registre tout en ayant à l'esprit que d'autres
sûretés potentielles n'y sont pas renseignées, à de
quoi susciter la critique. Un simple coup d'oeil au registre devrait suffire
pour qui désire avoir une vue d'ensemble de toutes les
sûretés consenties par un constituant déterminé.
Tous les
137Lionel ANDREU, « Gage avec dépossession
contre gage sans dépossession », préc.
138Ibid.
139Ibid.
140Dans une affaire aux faits similaires, la Cour de
cassation a retenu l'effectivité de la dépossession et donc
l'opposabilité aux tiers. Voir Augustin AYNES, « Gage avec
dépossession par entiercement : admission large de la condition de
dépossession », L.G.D.J, Revue des contrats, n° 4,
1er oct. 2010, p. 1336.
avantages qu'offre l'emprise matérielle sur les
biens grevés devraient venir en supplément si le créancier
garanti souhaite renforcer son contrôle. À notre sens, la
dépossession est une forme de « publicité
matérielle141 » médiocre.
2. L'ayant cause à titre particulier,
acquéreur. Voilà assurément un tiers que le régime
des opérations garanti ne peut se permettre d'ignorer. Certains auteurs
cependant se sont interrogés jusqu'à son existence. En d'autres
termes, le constituant a-t-il seulement le droit d'aliéner le bien qu'il
a mis en gage142 ?
Sur cette question, Yannick BLANDIN fait remarquer que
la loi ne se prononce pas expressément143, il souligne
simplement que la protection des droits du créancier en pareil cas est
la raison d'être du droit de suite. Dans le silence des texte il est
possible de répondre à cette interrogation par une autre : en
tant que propriétaire pourquoi le constituant ne conserverait-il pas le
droit d'aliéner son bien à sa guise ? Si je consens une servitude
de passage à mon voisin sur mon terrain je lui offre un droit
réel accessoire, une charge qui amoindrit ma liberté d'user
pleinement de mon droit de propriété. Pourtant si je
désire vendre mon terrain on conçoit mal que mon voisin puisse
s'y opposer. Il n'aura plus qu'à opposer son droit réel au nouvel
acquéreur. Voilà l'exemple d'un acheteur qui, s'il n'a pas
été prévenu, se retrouve à devoir composer
inopinément avec le droit réel d'autrui sur son bien. Finalement,
cette conclusion est assez proche de ce qu'il se passerait en présence
d'un meuble grevé d'un droit réel de garantie.
En guise d'argument contraire, il y a bien l'article
314-5 du Code pénal qui dispose que « Le fait, par un
débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire
ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ». Mais il ne faudrait
pas se laisser aller à une lecture trop large de cette infraction, si
« Une fois la réalisation de la sûreté entreprise,
l'aliénation devient évidemment impossible, sauf pour le
constituant à encourir des poursuites sur le fondement du
détournement de gage144 », à contrario il
faut bien reconnaître au constituant un droit d'aliéner tant que
la sûreté est pendante.
Ainsi l'efficacité de la publicité
est-elle d'un enjeu crucial pour cette catégorie de tiers. A l'occasion
du premier chapitre de cette première partie : « La non-incidence
de la connaissance effective » nous avons démontré qu'en
droit français les formalités obligatoires de publicité
avaient vocation à créer une présomption de connaissance
des sûretés publiées. Nous rappelons ici que cette
présomption est critiquable parce qu'elle lie l'opposabilité des
sûretés à la question de la connaissance du tiers quand
bien même celle-ci ne serait pas effective. Or, du point de vue du
créancier une inscription par simple avis qui aurait un effet
mécanique d'opposabilité erga omnes est éminemment
préférable.
À notre sens le législateur
français à une vision biaisée de la vocation de la
publicité. Pour s'en convaincre, il suffit de se demander pourquoi il a
ressenti le besoin d'empêcher les ayants cause à titre particulier
du constituant d'invoquer l'article 2276 du Code civil alors
141Voir note (37).
142« L'aliénation créant un risque
anormal pour le gagiste, on peut difficilement admettre que le constituant,
tenu de maintenir le gage en l'état, ait le droit d'y procéder
» M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et P . PÉTEL, «
Droit des sûretés », Litec, 9e éd., 2010, p.
570, n° 763, (cité par Yannick BLANDIN, «
Sûretés et bien circulant contribution à la
réception d'une sûreté globale », th.
préc., paragr.118.).
143« Quant à l'aliénation de
l'assiette du gage, qu'il soit d'ailleurs avec ou sans dépossession, la
loi ne se prononce ni dans le sens de sa validité, ni dans celui de son
interdiction. »,Yannick BLANDIN, « Sûretés et bien
circulant contribution à la réception d'une sûreté
globale », th. préc., paragr.118.
144Yannick BLANDIN, « Sûretés et
bien circulant contribution à la réception d'une
sûreté globale », th préc., paragr.
183.
même qu'en premier lieu, l'application de cet
article au domaine de l'opposabilité des sûretés est
discutable145.
Il faut revoir notre vision de la publicité en
droit national afin d'en extraire les problématiques de connaissance ou
de bonne foi qui pêchent par leur subjectivité. Les effets de la
publicité doivent tenir en ces quelques mots : est opposable, envers
tout tiers qui eût pu user du registre, la sûreté qui a fait
l'objet d'une inscription régulière.
Ceci dit, pour l'ayant cause à titre
particulier du constituant le problème reste entier ! L'article 2337,
alinéa 3 du Code civil le prive du droit, qu'il n'a peut-être
jamais eu, de se prévaloir de l'article 2276 pour se placer hors
d'atteinte du droit de suite d'un créancier garanti. Ce tiers ne
s'intéresse pas à la question de savoir si oui ou non il aurait
pu se prévaloir de la règle avant que celle-ci ne soit
expressément écartée. Il ne peut que constater qu'en tout
état de cause elle ne lui est plus d'aucun secours.
Ce dernier peut alors potentiellement se retrouver
avec une propriété grevée sans espoir de voir celle-ci
purgée de la charge que constitue la sûreté du
créancier garanti. En effet « Étant un droit réel
sur la chose d'autrui, le gage peut être exercé sur le bien quel
que soit le propriétaire de ce dernier146 ». Nul
doute que cela « revient à traiter durement le tiers
acquéreur de bonne foi, son droit se trouvant menacé par un
autre, dont il n'avait nulle connaissance147
».
Finalement, la logique derrière cette norme
revient à traiter l'ayant cause à titre particulier du
constituant comme responsable de son sort. Il aurait dû se renseigner
grâce à la publicité. Si cet argument peut être
défendu sur le plan moral, il s'avère très frêle
quand on l'oppose aux réalités économiques. Contracter en
ayant toujours à l'esprit que son partenaire puisse être le
constituant d'un gage dont il ne dit mot est propice à instaurer un
climat de suspicion et de pesanteur incompatible avec la
légèreté qui caractérise nécessairement un
commerce des meubles efficace.
Bien sûr, en dernier recours, l'ayant cause
à titre particulier du constituant pourra faire valoir le dol en tant
que vice de son consentement. En effet conformément aux dispositions de
l'article 1137 nous serions bien en présence d'une réticence
dolosive au sens de l'alinéa 2 « dissimulation intentionnelle
par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère
déterminant pour l'autre partie ». Dès lors,
l'acquéreur du bien grevé pourra obtenir la nullité de la
vente. Cependant, la nullité de la vente suppose des restitutions
réciproques, les parties doivent être remises dans la situation
dans laquelle elles se trouvaient avant l'acte. Or, l'ayant cause à
titre particulier du constituant pourrait bien découvrir, en guise de
seconde surprise, l'insolvabilité du constituant qui dès lors
serait incapable de lui restituer le prix de la vente.
145À ce sujet, Romain BOFFA et Guillaume
ANSALONI s'opposent quant à la question de la possibilité pour le
tiers acquéreur d'invoquer l'article 2276 du Code civil « En fait
de meubles, la possession vaut titre » pour échapper à
l'opposabilité d'une sûreté réelle qu'il pouvait
légitimement ignoré. Ce désaccord a émergé
à l'occasion de la critique de Romain BOFFA relative au nouvel article
2337, alinéa 3, du Code civil tel qu'issu de l'ordonnance n°
2006-346 du 23 mars 2006 qui prive explicitement les ayants cause à
titre particulier du constituant du bénéfice de l'article 2276
face à un gage sans dépossession régulièrement
publié. Romain BOFFA argue que cet alinéa est inutile en se
basant sur une interprétation restrictive du champ de l'article 2276
dont il dénonce la portée « hypertrophiée ».
Pour lui en tout état de cause cet article n'aurait jamais eu à
jouer en cas d'acquisition « a domino », car il n'a que vocation
à sécuriser les transferts de bien meuble en protégeant
l'acquéreur de bonne foi qui tiendrait ses droits d'un non
propriétaire. (Romain BOFFA, « L'opposabilité du nouveau
gage sans dépossession »,
préc. et
Guillaume ANSALONI, « Sur l'opposabilité du gage sans
dépossession de droit commun », préc.).
146CROCQ Pierre, « gage »,
répertoire de droit civil, Dalloz, févr. 2017,
actualisation Oct. 2018.
147Yannick BLANDIN, « Sûretés et
bien circulant contribution à la réception d'une
sûreté globale », th. préc., paragr.
80.
Le propre d'une sûreté est de
prévenir le risque d'insolvabilité d'un débiteur,
l'injustice est flagrante si on considère que c'est à
l'acquéreur de supporter ce risque contre lequel le créancier
garanti a cru bon de se prémunir148. À l'inverse si le
créancier garanti est obligé de dédommager l'ayant cause
à titre particulier du constituant du prix de la vente, on peut
légitimement se demander à quoi a bien pu lui servir sa
sûreté. Encore plus simplement, Yannick BLANDIN souligne que
l'action en réticence dolosive est une « solution, longue et
contraignante, puisque nécessitant le recours à une
juridiction149 ». On est en droit d'espérer plus
d'efficacité d'un régime de la publicité des
sûretés réelles mobilières.
Voilà autant de bonnes raisons d'informer les
éventuels ayants cause à titre particulier du créancier
gagiste avant qu'ils n'acquièrent cette qualité qui comporte
intrinsèquement des risques forts.
Dans ce chapitre, nous avons détaillé la
catégorie des ayants cause à titre particulier du constituant.
Cependant, il existe une catégorie de tiers qui pose des
difficultés encor plus grandes, pour ne pas dire insoluble en
l'état actuel du droit français. Il s'agit du
sous-acquéreur. En effet, l'acquéreur et le sous-acquéreur
sont exposés aux mêmes risques. Cependant, ils ne sont pas
égaux face à la publicité. Plus que cela, existe-t-il
seulement un moyen d'informer efficacement les sous-acquéreurs de
l'existence d'un droit réel accessoire sur le bien meuble qu'il
s'apprête à acquérir ? A priori, la réponse semble
négative, or si nous sommes incapables de les informer nous ne pouvons
les laisser sans protection. Une protection qui doit être uniforme et
objective si elle se veut efficace.
148Dans le même sens Romain BOFFA évoque
des potentiels dommages et intérêts pour le tiers victime de
l'attribution judiciaire du gage, tout en rappelant qu'en cas « de
procédure collective de son auteur », cette sanction sera pour le
tiers « une bien maigre consolation. », Romain BOFFA, «
L'opposabilité du nouveau gage sans dépossession »,
préc., paragr. 24.
149Yannick BLANDIN, « Sûretés et
bien circulant contribution à la réception d'une
sûreté globale », préc., paragr. 80.
- CHAPITRE 2 -
PROTÉGER LES TIERS, LE CONSTAT DES LIMITES DE LA
PUBLICITÉ.
Idéalement, un régime efficace de la
publicité des sûretés réelles mobilières a
vocation à protéger tous les tiers à portée
d'information. La règle doit être simple, dénuée
d'exception même dans les cas les plus discutables : si un tiers n'a pas
eu une chance de s'informer, car les formalités obligatoires de
publicité n'ont pas été réalisées, alors ses
droits (quelles que soient leurs natures) sur le bien grevé doivent
être intouchables (Section 1). Plus délicate est la question du
traitement que nous devons réserver aux tiers que nous ne pouvons
espérer informer même si les formalités obligatoires de
publicité sont effectuées avec rigueur. Du fait de la nature
personnelle de la publicité des sûretés réelles
mobilières, les sous-acquéreurs sont des tiers aveugles à
la publicité. (Section 2).
Section 1 : La nécessité de ne pas
hiérarchiser la protection des ayants causes à titres
particuliers.
Daniel BASTIAN fait remarquer qu'en droit
français « le droit d'invoquer l'inopposabilité
appartient à tous ceux dont la loi a voulu protéger les
intérêts et à eux seuls150 ». En nous
interrogeant quant aux objectifs d'un système efficace de
publicité nous nous sommes demandé quelles catégories de
tiers avaient intérêt à être informées et pour
quelles raisons. Logiquement, il conviendrait à présent de se
demander quelles catégories de tiers méritent de voir leurs
intérêts protégés par la loi. À ce propos,
nous nous attellerons à défendre l'idée selon laquelle les
droits réels naissants d'une sûreté conventionnelle ne
devraient jamais être opposables aux tiers s'ils n'ont pas fait l'objet
de formalités de publicité régulière.
Pourtant en s'intéressant à la notion de
tiers on pourrait être tenté par l'idée d'une
hiérarchisation. D'aucuns diraient que certains tiers sont plus
méritants que d'autres et que là où certains
méritent une protection totale via le mécanisme de
l'inopposabilité, d'autres pourraient bien être frappés par
la découverte tardive de droits réels occultes sans que le
système de la publicité ait à s'en émouvoir outre
mesure. À ce propos, la CNUDCI rappelle que « Les États
envisagent très différemment les catégories de tiers
à l'égard desquelles une sûreté réelle
mobilière reste inefficace si la formalité supplémentaire
requise n'a pas été accomplie151
».
Pour illustrer ce propos, il est temps
d'évoquer l'ayant cause à titre particulier du constituant que
l'on regarde du plus mauvais oeil. Le donataire. Sur le fondement de la
question du juste, on pourrait arguer qu'entre « un créancier
garanti qui, par définition, a fourni une contrepartie pour sa
sûreté et un donataire qui n'en a fourni aucune, c'est le
créancier garanti qu'il faut protéger même s'il n'a pas
pris les mesures nécessaires pour assurer
l'opposabilité152 ». L'argument tient à
l'idée que, finalement le donataire ne perd rien153 si le
créancier garanti vient épancher sa créance en
réalisant sa sûreté.
150D. BASTIAN, « Essai d'une théorie
générale de l'inopposabilité » : Sirey, 1929, p.
322 s., et spéc. p. 325. (dans Guillaume ANSALONI, « Sur
l'opposabilité du gage sans dépossession de droit commun »,
préc.).
151« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », préc., p. 111., paragr.
9.
152Ibid., p. 112., paragr. 13.
153Selon Adam SMITH, « Du prix réel et du
prix nominal des marchandises, ou de leur prix en travail et de leur prix en
argent», dans Smith (A.), « la richesse des nations »,
[en ligne], 1776, W. Strahan and t. Cadell, Londres, accessible en ligne
à
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75319v.pdf
Toutefois, on opposera à cette vision que c'est
de la propre faute du créancier garanti, qui n'a pas accompli les
formalités de publicité obligatoire, que cette situation est
survenue. De ce contre argument moral naît un argument juridique : plus
stricte et absolue est la sanction de l'inopposabilité plus elle est
incitative. Dans le but de promouvoir la publicité des
sûretés réelles mobilière, le principe de
l'inopposabilité des droits réels occultes ne doit connaitre
aucune exception.
De surcroît quand on vise l'efficacité
d'un ensemble de règles juridiques il faut se garder de trancher le cas
par cas en recherchant l'éthique à l'échelle individuelle.
Il ne peut en résulter que des débats stériles où
chacun invoquera des arguments axiologiques d'une égale
légitimité. Finalement, la question de savoir si tel tiers doit
être davantage protégé qu'un autre est plus une affaire de
politique et d'idéologie qu'une question d'efficacité du droit.
Or c'est bien à cette tâche objective que notre travail de
recherche est dédié. Sous la direction de ce modèle de
pensée, il convient d'évoquer le caractère
délétère de toute différence de traitement entre
les tiers quand il est question de leurs protections par
l'inopposabilité. Tout d'abord, il faut faire remarquer que la recherche
du « statut du bénéficiaire du transfert d'un bien
grevé peut susciter des litiges ex post facto contraires aux objectifs
de certitude et de prévisibilité a priori154
». Ainsi, dans un système de publicité légale
où l'inopposabilité est un sésame dispensé à
quelques-uns, il est facile d'imaginer l'intérêt pour un tiers de
travestir sa situation pour échapper à la saisie entre ses mains
d'un bien grevé. Dès lors, le donataire pourrait tenter
d'inventer toutes les contreparties imaginaires afin d'alimenter un litige avec
le créancier garanti. À l'inverse dans un tel système, on
comprend qu'un créancier qui a négligé les
formalités nécessaires à l'opposabilité de sa
sûreté a tout intérêt à remettre en cause la
contrepartie consentie par le tiers en cas de transfert de
propriété à titre onéreux du bien grevé.
L'opération pourrait potentiellement être requalifiée en
donation. Même si cette éventualité est peu probable il
n'en demeure pas moins qu'opérer une distinction au sein des
règles d'opposabilité en fonction du statut des tiers a vocation
à créer des conflits inutiles.
Pour viser l'efficacité, il ne faut pas songer
à une disposition à l'aune de ses meilleures intentions, mais
bien en considérant tous les mauvais usages qui pourraient en être
faits par ceux qui tenteront de la tordre à leurs profits. La
simplicité est un gage de résilience là où la
multiplication des exceptions a vocation à affaiblir la règle de
droit. Pour ces raisons, l'efficacité en matière de
publicité des sûretés réelles mobilières
commande de se ranger à la recommandation de la CNUDCI « Tant
que les conditions d'opposabilité ne sont pas remplies, la
sûreté est sans effet à l'égard de tous les droits
acquis entre-temps par des tiers sur les biens grevés, quel que soit
leur type155 »
Dans cette optique, on ne peut que saluer le
progrès apporté en droit interne par l'ordonnance de 2006 que
Pierre CROCQ rapporte en ces termes « Les auteurs de l'ordonnance ont,
en effet, considéré que pour qu'un système de
publicité soit vraiment efficace, il faut qu'il ait un effet
mécanique156 ». Il faut comprendre qu'un
système de publicité efficace suppose nécessairement
qu'une publication régulière emporte l'opposabilité de la
sûreté contre tous là ou son défaut de publication
limite toute son efficacité à la sphère purement
contractuelle.
154« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », p. 112., paragr. 13. 155«
Guide législatif de la CNUDCI sur les opérations garanties
», p. 112., paragr. 14. 156Pierre CROCQ, «
Sûretés mobilières : état des lieux et
prospective », préc., paragr. 17.
Section 2 : La problématique de l'angle mort de
la publicité personnelle.
1. Le sous-acquéreur, le tiers aveugle à
la publicité personnelle. « L'inscription du gage prévue
à l'article 2338 du Code civil est faite à la requête du
créancier sur un registre spécial tenu par le greffier du
tribunal de commerce dans le ressort duquel le constituant est
immatriculé ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation
d'immatriculation, dans le ressort duquel est situé, selon le cas, son
siège ou son domicile157 ».
Il est ici question d'une publicité
personnelle, c'est-à-dire une publicité basée sur la
personne du constituant. D'aucuns diraient qu'en présence de meubles non
immatriculés il n'y a pas d'autres systèmes
possibles158.
Se pose alors un problème évident,
« si l'ayant cause immédiat du constituant est en mesure de se
renseigner sur l'existence d'une sûreté qui grève le bien,
il n'en sera pas de même pour ceux qui auront acquis le bien d'un autre
que le constituant159 ».
Nous sommes en présence de tiers, qui
potentiellement n'auront jamais entendu parler du constituant et de ses
affaires. Des tiers placés au bout d'une chaîne translative de
propriété plus ou moins longue, nationale ou même
internationale, qui ne seront jamais en mesure de se rendre sur le site
(
https://www.infogreffe.fr/recherche-gage-sans-depossession)
pour y effectuer une recherche efficace160. Car pour eux le
constituant, personne physique ou morale161, demeurera un parfait
anonyme162.
D'une certaine façon, on peut parler d'un angle
mort de la publicité personnelle, un défaut intrinsèque et
insurmontable qui empêche tout repérage efficace par le
sous-acquéreur d'information qu'on entendrait lui distribuer par ce
biais. Partant de ce constat nous sommes, semble-t-il, en présence d'un
choix cornélien, « Deux alternatives sont alors possibles,
selon que l'on préfère protéger les droits du constituant
ou les intérêts tout aussi légitimes du
tiers163 ». Faut-il sacrifier l'intérêt du
sous-acquéreur et la sécurité juridique de toutes les
transactions de biens meubles non immatriculés, en le laissant se
débattre avec la responsabilité contractuelle de son auteur peu
loquace ? Ou alors faut-il renoncer à l'opposabilité erga omnes
des sûretés réelles mobilières
régulièrement publiées qui ne seraient alors jamais
opposables au sous-acquéreur ? La difficulté naît du fait
que protéger le sous-acquéreur victime de l'angle mort de la
publicité personnelle (par un mécanisme
157Décret n° 2006-1804 du 23
décembre 2006.
158« S'agissant de biens meubles non
immatriculés, seul un système de publicité personnelle,
c'est-à-dire par référence au domicile ou au siège
du constituant, était concevable », Pierre CROCQ, «
Sûretés mobilières : état des lieux et prospective
», préc., paragr.16.
159Romain BOFFA, « L'opposabilité du
nouveau gage sans dépossession », préc., paragr.
5.
160« le site internet tel que visité au 13
mars 2007 impose au requérant conformément à l'article 11
du décret (Décr. 23 décembre 2006) du, de renseigner en
premier lieu l'identité du constituant ». Cette exigence pratique
est toujours d'actualité et est en toutes hypothèses pas
amenées à changer prochainement en raison des difficultés
liées à la publicité des meubles non immatriculés.
Romain BOFFA, « L'opposabilité du nouveau gage sans
dépossession », op. cit., paragr. 21.
161Le site (
https://www.infogreffe.fr/recherche-gage-sans-depossession)
propose de rechercher d'éventuels gages consentis par une personne
morale. Quid de ces montages aux allures de matriochka où telle
société sert de vitrine à une activité tandis
qu'une filiale aurait consenti le gage problématique ?
Évidemment, une recherche basée sur la raison sociale de la
première société à laquelle le tiers ignorant pense
avoir à faire ne lui sera d'aucun secours. Enfin si le changement de nom
est une difficulté plus anecdotique que réelle quand il est
question d'un constituant personne physique, on ne peut qu'espérer que
le registre soit mis à jour promptement si une entreprise change de
nom.
162« Ne connaissant pas par hypothèse
l'identité du constituant, sauf information par leur propre auteur sur
ce point ou circonstances particulières, ils ne peuvent avoir
connaissance du gage qui grève le bien. », Romain BOFFA, «
L'opposabilité du nouveau gage sans dépossession »,
préc., paragr. 21.
163Ibid., paragr. 23.
d'inopposabilité) semble tenir d'un choix aussi
juste que néfaste à l'efficacité des sûretés
réelles mobilières. En partant des variables traditionnelles :
inopposabilité et protection des tiers non informés, contre droit
de suite et conservation des droits du créancier garanti, la
problématique de l'angle mort de la publicité personnelle semble
insoluble.
2. La piste du gage sur chose fongible. Pierre CROCQ
fait remarquer à propos de cette problématique de l'information
des sous-acquéreurs que « s'agissant des acquéreurs de
biens meubles, l'insécurité résultant d'un défaut
de renseignement sera compensée par le fait que le bien gagé est
souvent un bien fongible dont l'aliénation a été
autorisée par le créancier164». Or cette
autorisation d'aliéner, expressément prévue par l'article
Article 2342 du code civil165, Pierre CROCQ l'analyse comme une
renonciation du créancier à l'exercice de son droit de
suite.
En effet, nul besoin d'affliger le tiers
acquéreur d'un droit de suite quand on considère l'obligation qui
est faite au constituant de remplacer les biens aliénés par
« une même quantité de choses
équivalente166 ». La valeur de l'assiette de la
garantie est ainsi préservée malgré les aliénations
successives.
Via cet exemple très particulier du gage sur
chose fongible on constate deux choses : premièrement, on remarque qu'il
suffit de supprimer le droit de suite pour régler totalement le
problème que pose l'angle mort de la publicité personnelle aux
sous-acquéreurs. Deuxièmement, on comprend que cette suppression
ne peut se faire qu'au prix d'un remplacement. Le droit de suite est trop
encombrant (voir totalement inconciliable avec les impératifs d'une
publicité efficace au sein d'une économie de marché
dynamique). Ne serait-il pas préférable de toujours
préférer, en matière de sûreté sur des
meubles non immatriculés, une forme d'assiette pensée pour ne pas
perdre en valeur tout en permettant la mise sur le marché de bien libre
de tout droit réel ?
Le droit français n'est pas obligé de
choisir entre la peste et le choléra, l'exemple du gage de quelques
tonnes de blé porte en lui les germes d'une solution
(généralisable à l'ensemble de la matière).
Cependant pour la découvrir encore faut-il savoir séparer le bon
grain de l'ivraie parmi les friches des sûretés sur
stocks.
164Pierre CROCQ, « Sûretés
mobilières : état des lieux et prospective »,
préc, paragr. 18.
165« Lorsque le gage sans dépossession a
pour objet des choses fongibles, le constituant peut les aliéner si la
convention le prévoit à charge de les remplacer par la même
quantité de choses équivalentes. », article 2342 du Code
civil.
166Article 2342 du Code civil.
- CHAPITRE 3 -
NEUTRALISER LA MENACE, LA NÉCESSAIRE
ÉVOLUTION.
Le constituant a voulu conserver l'usus de ses biens
grevé. On aurait pu croire que ce souhait était incompatible avec
la protection des intérêts des créanciers garantis.
Pourtant le constituant a été exaucé via la
consécration du gage sans dépossession. Aujourd'hui, la bonne
marche de l'économie réclame un nouveau progrès, le
constituant réclame le droit d'aliéner voire même le droit
de détruire ses biens grevés, pour en acquérir ou en
créer de nouveaux.
Des auteurs ont d'ores et déjà
proposé des innovations en droit des sûretés sur stocks sur
la base d'assiettes fluctuantes ou d'assiettes extensibles. Des
mécanismes à même de confiner les droits réels
grevant des meubles à titre de garantie au seul patrimoine du
constituant.
Afin de proposer un régime de la
publicité des sûretés mobilières soucieux des
intérêts des sous-acquéreurs et de la bonne marche de
l'économie, nous analyserons deux solutions proposées par la
doctrine. En cherchant à traiter les particularités des biens
circulants via une certaine évolution du régime des
opérations garanties, les deux auteurs que nous allons évoquer
ont trouvé des moyens efficaces de confiner le droit de suite des
créanciers garantis au seul patrimoine du constituant (Section 1).
Même si leurs travaux ont une portée plus large que la simple
question de la publicité et la protection qu'elle peut offrir aux tiers,
il semble pertinent d'arpenter toutes les pistes pouvant mener à une
publicité efficace. Toutefois, car les évolutions que ces auteurs
proposent sont conséquentes, elles charrieront nécessairement de
nouveaux problèmes dans leurs sillages. Nous devons donc anticiper les
effets secondaires des remèdes que nous recommandons (Section
2).
Section 1 : Comment confiner le potentiel de nuisance
du droit de suite ?
1. L'assiette universalité de la
sûreté globale et ses composants libres de tout droit de suite.
À propos du gage sur chose fongible, Yannick BLANDIN se réjouit
de la capacité de ce mécanisme à ménager «
la disponibilité des biens grevés sans que les
intérêts du gagiste ne soient méconnus167
». Il est communément admis qu'en pareille hypothèse, «
les biens venant en remplacement se substituent à ceux initialement
grevés par le mécanisme de la subrogation
réelle168 ». Ce qui a pour conséquence un
report du droit réel sur les biens acquis en remplacement169.
Le constituant et le créancier garanti y trouvent assurément
leurs comptes.
Ajoutons que le tiers bénéficie aussi de
cette manière de procéder. En effet, on remarque que les droits
réels grevant les biens fongibles du constituant n'ont plus vocation
à menacer les intérêts des tiers. Le confinement des droits
réels accessoires au sein des limites du seul patrimoine du constituant
constitue pour eux la meilleure protection possible. Une protection qui a
l'avantage de ne pas pour autant sacrifier les attentes légitimes du
créancier quant à l'efficacité de sa
sûreté.
Pour l'heure en droit des sûretés
français, le gage sur chose fongible constitue un îlot de
quiétude battu par les vents d'une mer déchaînée.
D'aucuns voudraient en faire un phare, le
167Yannick BLANDIN, « Sûretés et
bien circulant contribution à la réception d'une
sûreté globale », th. préc., paragr. 6. 168Ibid.
169Ibid.
cap que l'ensemble de la matière aurait
vocation à atteindre. En effet pourquoi faudrait-il se passer d'une
solution aussi profitable pour tous, sous prétexte que les biens acquis
en remplacement par le constituant ne seraient pas de même nature, ne
seraient pas fongibles ? C'est ainsi que Yannick BLANDIN s'interroge «
Si la fluctuation des meubles grevés peut résulter de leur
interchangeabilité objective, n'y a-t-il pas toutefois matière
à généraliser le champ de l'assiette fluctuante en la
détachant de la fongibilité ?170 ». L'enjeu
est de taille, l'inclination de la pratique vers ce mécanisme du gage
sur chose fongible est telle qu'elle a amené certains à vouloir
tordre par leur volonté la notion de fongibilité pour pouvoir se
placer sous ce régime171. On assiste au même genre de
phénomène qu'à l'époque où la Cour de
cassation avait entendu imposer le droit spécial du gage des
stocks172 alors même que les cocontractants à qui il
s'adressait cherchaient spontanément à placer leurs relations
sous l'égide du droit commun qui était alors plus favorable pour
différentes raisons. Aujourd'hui, c'est le gage sur chose fongible le
régime le plus attractif en matière de sûretés
mobilières. Ces deux exemples illustrent bien la nature du droit des
sûretés, quand un mécanisme est efficace il est
plébiscité par les agents économiques au détriment
des autres.
Yannick BLANDIN a proposé de résoudre
cette question via la consécration d'une nouvelle sûreté
spéciale « que l'on pourrait dénommer
sûreté réelle globale173 ». Elle se
détacherait de ce que l'on connait actuellement par son assiette
fluctuante, qualifiée en universalité de fait174, qui
substitué au critère de la fongibilité, permettrait
d'obtenir un résultat comparable aux attraits du gage sur chose
fongible175, tout en permettant une assiette composée de
biens de nature différents meubles ou immeubles.
Il est assez amusant de noter que si dans les faits,
nous aurons bien affaire à une assiette fluctuante (les biens allants et
venants au rythme de leurs aliénations et remplois), sur le plan
juridique, l'universalité de fait demeurerait le seul bien jamais
grevé176. Les droits réels du créancier garanti
portant sur cet unique bien, en tant qu'enveloppe vouée à
garantir
170Ibid.
171Sur la question de la fongibilité
conventionnelle voir l'arrêt de la Chambre commerciale du 26 mai 2010
(n° 09-65.812). Où la Cour de cassation avait pu considérer
que par une convention les parties avaient pu s'entendre sur la nature fongible
de biens qui ne l'auraient pas été autrement. L'enjeu de la
qualification de cette fongibilité était de taille, car lui seul
pouvait permettre de retenir le caractère « tournant » de
l'assiette de la sûreté en cause. Pour plus de détaille
voir Dominique LEGEAIS, « Portée d'une clause de substitution des
marchandises introduite dans un contrat de gage », RTD com.,
Dalloz, 2010, p. 596.
172Revenons rapidement sur la saga du gage des stocks.
La Cour de cassation avait « invalidé en 2013 l'application des
dispositions générales du Code civil relatives au gage de choses
fongibles sans dépossession, en conférant au gage spécial
des stocks une portée impérative ». Cette situation
où les professionnels étaient prisonniers d'un régime plus
contraignant que le droit commun à durer jusqu'à l'ordonnance du
29 janvier 2016 qui est venue contrecarrer « la force d'attraction du gage
spécial des stocks en reconnaissant aux parties la liberté de
conclure un gage de droit commun ». Voir Manuella BOURASSIN, «
Réforme du gage des stocks : de l'attraction à
l'attractivité », Gaz. Pal., 8 mars 2016, n° 259m9,
p. 53.
173Yannick BLANDIN, « Gage sur stock - La
réforme du gage des stocks par l'ordonnance n° 2016-56 du 29
janvier 2016 », LexisNexis, Revue de Droit bancaire et financier,
juillet 2016, n° 4, étude 20, paragr. 18.
174Yannick BLANDIN explique ainsi
l'intérêt de qualifier l'assiette de la « sûreté
globale » en universalité de fait : « En tant que bien,
celle-ci permet de constituer l'objet déterminé du droit
réel conféré par la sûreté. En tant
qu'enveloppe, elle ménage la disponibilité de ses composants qui
demeurent soumis à leur propre loi. »,Yannick BLANDIN, «
Sûretés et bien circulant contribution à la
réception d'une sûreté globale », th.,
préc., paragr. 6.
175Avec la sûreté globale comme avec le
gage sur chose fongible nous sommes en présence de deux
mécanismes ayant vocation à conserver une assiette d'une certaine
valeur tout en relâchant périodiquement sur le marché des
biens libres de tout droit réel. À l'aune de cette
première analyse, la sûreté globale semble être un
mécanisme compatible avec l'idéal d'une publicité efficace
des sûretés réelles mobilières.
176En ce sens l'assiette universalité peut
être comparée à un corps humain. Une chose qui conserve son
identité malgré le remplacement incessant de ses
cellules.
l'obligation. Tous les droits réels
problématiques pour les tiers sont fixés sur cette «
enveloppe177 » que les biens meubles178 du
constituant quittent libérés de toute sûreté quand
un tiers se propose de les acquérir.
2. L'extension de l'assiette au produit et la
suppression conditionnelle du droit de suite. À la problématique
des sûretés sur stocks, Jean-François RIFFARD apporte une
solution différente. Tout comme celle proposée par Yannick
BLANDIN, elle comporte des qualités subsidiaires quant à la
protection des sous-acquéreurs aveugles à la publicité
personnelle que nous devons étudier.
Bien conscient de l'innovation proposée par
Yannick BLANDIN, Jean-François RIFFARD s'oppose cependant à la
« tentation du régime spécial179 ».
À cette objection, Yannick BLANDIN répondrait sûrement que
la sûreté globale ne constitue pas « une
énième sûreté mobilière spéciale, mais
une garantie nouvelle de droit commun 180». On peut lui
accorder ce point. Pour lui, la consécration de la sûreté
globale passerait par la suppression de toutes les sûretés
spéciales sur les biens circulants. Il y aurait donc trois
catégories de sûretés de droit commun, les
sûretés sur les meubles, les sûretés sur les
immeubles et les sûretés sur les biens circulants. Tout comme on
ne saurait qualifier les sûretés sur les immeubles de droit commun
et les sûretés sur les meubles de droit
spécial181, penser une sûreté sur les biens
circulants ne saurait revenir à penser une sûreté
spéciale selon Yannick BLANDIN.
Le désaccord entre ces auteurs relève en
profondeur du droit des biens plus que du droit des sûretés.
Yannick BLANDIN envisage le bien circulant comme une remise en cause
fonctionnelle de la suma divisio meuble / immeubles182. À
l'inverse, Jean-François RIFFARD s'intéresse aux stocks, une
catégorie de meuble particulière, qui peut aisément
être intégrée à un droit commun efficace des
sûretés sur meuble. En ce sens, les travaux de
Jean-François RIFFARD prêtent un meilleur concours à notre
étude, dans la mesure où toute la part immobilière de la
réflexion de Yannick BLANDIN s'éloigne de notre
sujet.
En termes pratiques, au lieu de créer une
sûreté spéciale sur le modèle d'une
assiette
177Yannick BLANDIN prend l'exemple du nantissement de
comptes titres pour donner un exemple de l'utilisation qui peut être
faite de la notion d'universalité de fait en matière de
sûretés « La qualification du compte en universalité
de fait permet que l'objet du nantissement soit le compte et non ses
éléments ». L'exemple a le mérite de montrer que la
qualification d'une assiette de sûreté en universalité de
fait peut permettre de dépasser la limite de la fongibilité. Deux
titres financiers n'étant pas des biens fongibles entre eux. Yannick
BLANDIN, « Sûretés et bien circulant contribution
à la réception d'une sûreté globale », th.
préc., paragr. 179.
178La sûreté globale de Yannick BLANDIN a
aussi vocation à recevoir des immeubles au sein de son assiette.
Cependant du fait de l'efficacité de la publicité
foncière, nous ne nous inquiétons pas de la sauvegarde des
intérêts des tiers en la matière.
179Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle », préc.,
p. 150.
180Yannick BLANDIN, « Sûretés et
bien circulant contribution à la réception d'une
sûreté globale », th. préc., paragr.
347.
181Finalement, la distinction entre droit
spécial et droit commun dépend du degré d'harmonisation
qu'un auteur donné souhaite pour le droit des sûretés. Si
on considère comme Jean-François RIFFARD qu'il ne doit exister
qu'une unique sûreté adaptée à tous les biens
meubles, comme peut l'être le Security interest américain, toute
sûreté divergente dont l'assiette comporterait des meubles serait
une sûreté spéciale. Si on considère qu'il ne doit
exister qu'une unique sûreté apte à recevoir les biens
meubles comme immeubles, une sorte d'hypothèque universelle, alors toute
proposition de sûreté assise sur les particularités des
biens meubles devrait être qualifiée de sûreté
spéciale.
182Selon Yannick BLANDIN, « Le bien circulant,
nous le détaillerons, peut être un meuble ou un immeuble, une
chose corporelle ou incorporelle, fongible ou non fongible. Il ne se
caractérise pas par sa nature physique, mais par la fonction qu'il
remplit au sein du processus d'activité de l'entreprise. », Yannick
BLANDIN, « Sûretés et bien circulant contribution
à la réception d'une sûreté globale », th.
préc., paragr. 5.
fluctuante, Jean-François RIFFARD prône
un perfectionnement du droit commun en forçant le trait des
caractéristiques qui font son attractivité. Ainsi pour cet auteur
le gage sur chose fongible consacré par la réforme de
2006183 est éminemment perfectible. Là où
Pierre CROCQ se voulait rassurant en analysant l'autorisation d'aliéner
donnée par le créancier au constituant comme une renonciation
à son droit de suite, Jean-François RIFFARD rappelle que cet
« argument tenant à la probabilité d'une autorisation
donnée par le créancier au regard de l'article 2342, est à
relativiser, car bien que forte, elle n'est pas absolue et elle ne permet pas
de lever les doutes pour l'acquéreur184 ». De
manière plus radicale, Jean François RIFFARD affirme qu'en
matière de sûreté sur stock (fongible ou non) il faut
« abandonner purement et simplement le principe du droit de suite et
de consacrer, de manière générale, la règle selon
laquelle l'acheteur prend toujours les biens libres de toute
sûreté, et ce sans exception ».
Cette proposition intéresse
particulièrement notre sujet, car supprimer le droit de suite c'est
supprimer le dilemme de l'impossible information des tiers incapables
d'accéder à la publicité personnelle. En effet, s'ils ne
sont plus menacés par des droits concurrents, un régime efficace
de la publicité des sûretés réelles
mobilières peut tout à fait tolérer leur ignorance.
À ce propos, Jean-François RIFFARD soutient une suppression
conditionnelle du droit de suite. En effet, c'est d'une protection strictement
encadrée dont il est question. Elle n'a vocation à
bénéficier qu'aux « personnes qui achètent des
marchandises à un commerçant dont l'activité commerciale
habituelle et apparente consiste en la vente de choses
pareilles185 ». Autrement dit, celui qui acquiert un bien
dans le cours normal des affaires n'est pas menacé par un
éventuel droit de suite. Cette protection s'étend logiquement aux
sous-acquéreurs qui tiennent leurs droits d'un acheteur dans le cours
normal des affaires. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette
règle de droit. Car, si la protection de l'ayant cause à titre
particulier du constituant intéresse nécessairement qui veut
penser un régime efficace des opérations garanties, la protection
du sous-acquéreur aveugle à la publicité personnelle est
une condition sine qua non d'un régime efficace de la
publicité des sûretés réelles
mobilière.
Avec ce système, on atteint un idéal de
protection des tiers dans le cadre particulier des sûretés sur
stock186, une matière où le droit de suite semble des
plus absurde en raison de la destinée commerciale de ces biens.
Cependant « si l'acquéreur dans le cours normal des affaires
prend les biens aliénés libres de toute sûreté,
comment alors assurer la protection du créancier ?187
». À l'aune du droit positif français, le créancier
qui autorise le constituant à aliéner les biens fongibles
grevés est protégé par l'obligation qui lui est faite de
les remplacer. Par l'effet de la subrogation réel, la tonne de
blé acquis en remplacement se substituera à la tonne
aliénée laissant la valeur de l'assiette du gage du
créancier inchangée.
Comme précédemment, nul ne saurait
trouver de raison légitime de limiter cette féconde solution aux
seules sûretés sur choses fongibles. Il s'agit « d'une
solution de bon sens. Il se peut en effet que dans le cadre de son
activité normale, le constituant aliène les stocks sans
procéder à leur remplacement à
l'identique188 ». On ne voit pas pourquoi le
183Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative
aux sûretés.
184Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle », préc.,
p. 113.
185Ibid., p. 138.
186« Le terme « stocks » désigne
les biens meubles corporels destinés à être vendus ou
loués dans le cours normal des affaires d'une personne, ainsi que les
matières premières et les produits semi-finis (produits en cours
de fabrication) », « Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », p. 13.
187Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle », préc.,
p. 138.
188Ibid., p. 140.
constituant devrait être contraint
d'émettre sur le marché une tonne de blé grevé d'un
droit de suite, sous prétexte qu'il a remplacé (à valeur
constante) son stock par une certaine quantité de maïs. Pour
étendre cette solution souhaitable au-delà du cadre de la
fongibilité, Jean-François RIFFARD défend la règle
« de l'extension de la sûreté sur les biens issus de
l'aliénation des stocks189 ». Pour fixer le cadre
de cette extension de plein droit il propose d'user de la notion de «
produit190 » en lieu et place de la notion de
fongibilité. Mais plus encore, pourquoi ne pas étendre cette
solution au-delà des limites des seules sûretés sur stock ?
Après tout, cet auteur a déjà fait part de son souhait
d'un droit commun des sûretés mobilières
débarrassé de la prolifération des régimes
spéciaux191. Dès lors l'extension de l'assiette de
sûretés « aux biens acquis en remploi ou
transformés à partir du bien initial ne doit pas être
cantonnée au cadre spécifique des sûretés sur
stocks, mais doit constituer un principe général du droit des
sûretés mobilières192 ». Il appuie
cette recommandation en invoquant l'efficacité des modèles qui
ont eu recours à cette méthode, d'abord le droit
américain, puis la loi type de la CNUDCI sur les sûretés
mobilière.
À l'aune des difficultés posées
par le droit de suite quand il est question de protéger les
sous-acquéreurs, nous ne pouvons qu'apprécier son déclin
et souhaiter son remplacement par un autre mécanisme de protection des
intérêts du créancier chaque fois que cela est possible. Or
à première vue, l'extension de plein droit de l'assiette d'une
sûreté mobilière au produit de la disposition des biens
grevés répond à cet impératif.
Nous sommes donc en présence de deux solutions
(subrogation des éléments d'une assiette universalité et
extension de plein droit de l'assiette aux produits des biens grevés)
qui potentiellement pourraient neutraliser les nuisances du droit de suite et
résoudre par la même occasion l'épineuse question de
l'angle mort de la publicité personnelle. Toutefois, malgré les
promesses de ces deux remèdes en termes d'amélioration de
l'attractivité du droit des sûretés en
général, on constate différents effets secondaires
néfastes quant au point particulier de la publicité des
sûretés réelles mobilières.
Section 2 : Deux remèdes accompagnés
d'effets secondaires.
Quand on compare les avantages et les
inconvénients de l'assiette universalité de la
sûreté globale à ceux de l'assiette étendue au
produit retenue par la CNUDCI. La seconde apparaît
préférable du point de vue de la protection du
sous-acquéreur de bien meuble, même si elle n'est pas sans
soulever d'importantes difficultés en matière de
publicité.
1. La réalisation de la sûreté
globale. Tout au long de sa vie, la sûreté globale
joue
189Ibid.
190« le terme « produit »
désigne tout ce qui est reçu en relation avec un bien
grevé. Il englobe non seulement ce qui est reçu de la vente ou
d'un autre acte de disposition, du recouvrement, de la location ou de la mise
sous licence du bien grevé . Il englobe aussi les fruits naturels et
civils ou les revenus, les indemnités d'assurance, les droits nés
d'un vice, de l'endommagement ou de la perte du bien grevé, et le
produit du produit », « loi type de la CNUDCI sur les
sûretés mobilières », p. 5, consultable sur le
site de la CNUDCI :
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/fr/ml
st f ebook.pdf
191« Source d'insécurité, la
solution de la sûreté spéciale est de plus à
contre-courant de la tendance actuelle gouvernant la plupart des
réformes modernes en matière de sûretés
mobilières. Ces projets consacrent un régime unique de
sûreté, suffisamment large pour couvrir l'hypothèse des
sûretés sur stocks, rendant ainsi inutile le recours à un
régime spécial autonome. », Jean-François RIFFARD,
« Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle »,
préc., p. 151.
192Ibid., p. 140.
son rôle à merveille, en relâchant
des biens circulant exempts de tout droit réel. Cependant lors de sa
réalisation elle génère un risque insurmontable pour les
sous-acquéreurs. Ainsi Yannick BLANDIN envisage-t-il une cristallisation
de l'assiette de la sûreté globale en cas de défaillance du
constituant. Ainsi les actes de disposition du constituant «
postérieurs à la défaillance seront déclarés
inopposables au créancier et ne pourront donc être invoqués
ni par le constituant, ni par les tiers et particulièrement les ayants
cause à titre particulier193 ». Ayant
anticipé les conséquences désastreuses pour les tiers
bénéficiaires des opérations de disposition
sus-citées Yannick BLANDIN reconnaît que «
l'équité commandera de ne faire produire effet à cette
inopposabilité vis-à-vis des tiers qu'à compter de
l'accomplissement d'une inscription modificative sur un registre
public194 ».
Prenons l'exemple de Primus achetant un bien à
Secundus. Le bien est une composante de l'assiette universalité d'une
sûreté globale que Secundus a consentie au bénéfice
de Tertius. Deux hypothèses sont envisageables. Soit Primus a acquis le
bien antérieurement à la formalité obligatoire de
publicité et dans ce cas il a réussi à soustraire
légalement le bien à l'assiette universalité. Le
constituant Secundus se retrouve alors avec une somme d'argent entre ses mains
tout en sachant que son créancier Tertius s'apprête à lui
retirer la capacité de gérer l'assiette de la sûreté
en se ménageant l'inopposabilité de tous ses actes futurs de
disposition. À l'inverse, Primus peut avoir consenti à l'achat
d'un bien grevé antérieurement à la défaillance de
Secundus et à l'accomplissement des formalités obligatoires de
publicité par Tertius. Dans ce cas, la vente sera inopposable à
Tertius qui pourra saisir le bien entre les mains de Primus exactement comme si
Secundus n'avait jamais renoncé à en être
propriétaire.
On ne peut que s'accorder à la conclusion de
Yannick BLANDIN quant à l'efficacité de ce dispositif. «
La sûreté sera efficace en dépit de l'absence de droit
de suite sur les éléments de l'assiette universalité : le
créancier pourra revendiquer les éléments transmis,
ceux-ci n'ayant, à son endroit, jamais quitté l'ensemble objet du
droit réel de garantie195 ». En effet, ce
mécanisme de protection des intérêts du créancier
semble encore plus brutal, à l'égard des tiers, que le droit de
suite.
On pourrait cependant s'en satisfaire. Après
tout, l'acquéreur d'un bien issu de l'assiette universalité est
pleinement en mesure de vérifier196 en temps réel la
publicité qui pourrait être faite de la défaillance du
constituant. On peut arguer qu'il peut renoncer à son achat
jusqu'à la dernière seconde, le blocage de l'assiette
universalité étant sans contexte une raison valable de rompre les
pourparlers avec le constituant. Bien plus difficile est l'acceptation des
effets de cette inopposabilité à l'encontre des
sous-acquéreurs. En effet, même s'il reconnaît que les
sous-acquéreurs n'ont aucun moyen fiable de s'informer du blocage de
l'assiette universalité197 et de l'indisponibilité
pour le constituant des biens qui la constitue, cet auteur entend bien les
soumettre au même régime que celui des ayants cause à titre
particulier du constituant.
Après analyse, il semblerait que la
sûreté globale et son assiette universalité soient
en
193Yannick BLANDIN, « Sûretés et
bien circulant contribution à la réception d'une
sûreté globale », th. préc., paragr.
265.
194Ibid.
195Ibid.
196Cela suppose un registre centralisé et
informatisé, seul modèle de régime viable à
l'ère du numérique. 197« Il est souvent proposé que
la publicité du gage ne protège le gagiste que contre les ayants
cause à titre particulier, les sous-acquéreurs pouvant encore se
prévaloir de la protection fournie par l'article 2276 du Code civil. En
matière de sûreté globale, l'inopposabilité sera
erga omnes que le tiers soit un ayant cause à titre particulier du
constituant ou non. », Yannick BLANDIN, « Sûretés et
bien circulant contribution à la réception d'une
sûreté globale », th. préc., paragr.
412.
mesure de traiter les symptômes de l'angle mort
de la publicité personnelle, mais incapables de régler le
problème de fond en garantissant une totale protection aux
sous-acquéreurs. Elle constitue toutefois une source potentielle
d'inspiration, car même si elle ne résout pas totalement cette
problématique elle demeure largement préférable à
la situation actuelle. En effet avec la sûreté globale la menace
des droits réels pour les intérêts des tiers est
efficacement neutralisée tant que la sûreté est pendante.
Enfin, il faut ajouter que la probabilité d'une mise sur le
marché par le constituant de biens problématiques en cas de gel
de l'assiette universalité serait tout de même grandement
réduite par l'effet dissuasif de l'infraction pénale
pensée par Yannick BLANDIN, le détournement de
sûreté globale198.
Même si le recours à la
sûreté globale n'est pas la piste qui emporte notre conviction, sa
réception par le législateur constituerait sans nul doute une
amélioration de la situation générale des tiers face
à la publicité des sûretés réelles
mobilières.
2. L'assiette extensible et la problématique
des biens métamorphes. Du point de vue de la protection des tiers, le
principe de l'achat libre de toute sûreté dans le cadre du cours
normal des affaires prôné par la CNUDCI, et défendu par
Jean François RIFFARD, apparaît comme la solution à
privilégier, notamment car elle vocation à s'étendre
à toute la matière la ou la solution prônée par
Yannick BLANDIN est limité au seul cadre des sûretés sur
biens circulants.
Toutefois si la solution proposée par la
sûreté globale à la problématique de l'angle mort de
la publicité personnelle a montré ses limites à
l'épreuve du temps199, la solution de la suppression du droit
de suite grevant les biens acquis dans le cours normal des affaires souffre
également des limites d'un cadre restrictif200. La question
du droit de suite est loin d'être totalement réglée, car il
subsiste en cas d'acquisition hors cadre du cour normal des affaires. En effet,
ce n'est pas parce que le créancier acquiert des droits sur le produit
de la disposition des biens grevé que ces derniers sont automatiquement
libérés de sa sûreté201. Cette
précision s'impose, car comme la CNUDCI l'a fait remarquer, tous les
actes de disposition du constituant ne donnent pas lieu à la naissance
d'un produit. Tel est le cas si le constituant transmet le bien grevé
à titre gratuit. Ajoutons que « Dans de nombreux cas, le
produit a peu de valeur, voire n'en a pas du tout, pour le créancier en
tant que sûreté (par exemple une créance qui ne peut
être recouvrée parce que la situation financière du
débiteur ne le permet pas)202 ». En outre
même si un produit a de la valeur, il peut être dilapidé par
le constituant. Dans le même ordre d'idée, « il se peut
qu'un autre créancier ait pris une sûreté
198Les actes entrepris à compter de la
défaillance du constituant seraient constitutifs de l'infraction de
détournement de sûreté globale . Une infraction que Yannick
BLANDIN imagine en ces termes : « L'infraction pénale nouvelle qui
pourra être dénommée « détournement de
sûreté globale » devra s'inspirer du modèle fourni par
l'infraction de détournement de gage » ibid., paragr.
390.
199Nous avons démontré plus haut que si
la sûreté globale via son assiette universalité
empêchait la mise sur le marché par le constituant de bien
grevé par des droits réels durant toute sa durée, elle
perdait cet intérêt lors de sa réalisation. Le gel de
l'assiette universalité emportant des conséquences graves pour
les sous-acquéreurs sans que ceux-ci aient de réels moyens de
s'en informer.
200Comme évoqué
précédemment, la suppression du droit de suite ne concerne que
certaines opérations bien définies. À ce propos, la CNUDCI
énonce que dans les états qui ont choisi cette approche «
lorsqu'une vente de stocks a lieu en dehors du cours normal des affaires du
constituant ou lorsqu'elle porte sur un bien autre que des stocks, l'exception
ne s'appliquera pas; cette vente n'éteint pas les sûretés
», « Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », p. 208, paragr. 67.
201« Alors que des États ont adopté
différentes approches pour concilier les intérêts des
créanciers garantis et ceux des personnes achetant des biens
grevés aux constituants non dépossédés, la plupart
prévoient que la sûreté devrait survivre au transfert
même si le créancier garanti peut aussi faire valoir un droit sur
le produit », « Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », p. 207, paragr. 64.
202« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », p. 207, paragr. 63
sur le produit en tant que bien initialement
grevé et soit prioritaire sur ce produit203 » ou
que le produit ne soit tout simplement pas identifiable. Finalement, il
apparaît que le créancier ne perd son droit de suite que quand le
bien grevé est aliéné dans le cours normal des affaires du
constituant. Ce qui est tout à fait cohérent, car c'est justement
dans ces conditions particulières que le créancier souffre le
moins du remplacement204 des biens grevé.
Malgré ce bémol, tant que l'on se situe
dans le cadre l'acquisition dans le cours normal des affaires, les droits
réels du créancier garanti sont efficacement confinés au
patrimoine du seul débiteur. Piégés par le cycle des
aliénations et des extensions successives de l'assiette aux produits,
ils ne sont plus en mesure d'inquiéter les tiers qui peuvent dès
lors commercer en pleine confiance. Or c'est justement à l'aune de notre
capacité à générer confiance et transparence que
nous devons évaluer l'efficacité d'un système de la
publicité des sûretés réelles mobilières.
Toutefois, ce n'est pas parce que la règle de la prise du bien libre de
toute sûreté en cas d'acquisition dans le cours normal des
affaires résout le problème des tiers confrontés au droit
de suite des créanciers garantis dans la plupart des cas que nous ne
devons pas nous intéresser au sort de la minorité de tiers qui ne
peut pas en bénéficier.
En effet si l'évidence et le bon sens
commandent de protéger celui qui se rend chez le cordonnier pour acheter
une paire de souliers, la recherche de la transparence et de
l'efficacité commande d'informer l'acheteur d'outillage, le donataire,
le légataire205, la foule des créanciers
chirographaires et en règle générale tous les autres tiers
qui pourraient y avoir intérêts.
C'est à l'aune de cette exigence que surgit un
nouveau problème, un effet secondaire de l'extension de l'assiette au
produit des biens grevés. « Le produit pouvant prendre la forme
d'un bien d'une autre nature que le bien initialement grevé, il peut
alors exister une distorsion entre la description du bien tel qu'elle figure
dans l'avis d'enregistrement et le produit sur lequel va porter la
sûreté206 ». Autrement dit, les biens,
grevés par les droits réels initiaux207, ont vocation
à se métamorphoser au gré de l'extension de l'assiette de
la sûreté.
Pour cerner le problème, il suffit de
considérer cet exemple fourni par la CNUDCI, « Une personne
susceptible d'acheter une trayeuse au constituant ne comprendra pas
nécessairement qu'un avis inscrit mentionnant une sûreté
sur le matériel agricole mobile (à savoir les biens initialement
grevés) couvre également la trayeuse en tant que
produit208».
On touche du doigt la distorsion évoquée
par Jean-François RIFFARD, du fait de l'extension de l'assiette au
produit et au produit du produit il est fort probable que l'on obtienne
rapidement un avis inscrit dont la description n'a plus grand-chose à
voir avec les
203Ibid.
204L'acquéreur qui achète un bien dans
le cours normal des affaires l'achète libre de toute
sûreté. Le créancier garanti perd donc ses droits
réels sur ces bien initiaux pour en gagner d'autres sur leurs produits.
C'est la seule occasion où l'on peut réellement parler de
remplacement des biens grevés, toutes les autres devant être
analysées comme une pure extension de l'assiette.
205Ce besoin d'information des donataires et
légataires constitue un exemple simple, une donation où un legs
pouvant être accompagné de charges, nul ne saurait dénier
à ces tiers (qui ont acquis leurs droits hors cadre du cours normal des
affaires du constituant) le droit d'être informé correctement
vis-à-vis de ce à quoi ils s'engagent.
206Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle »,op. cit., p.
143.
207« Raisonner en termes d'assiette de la
sûreté et d'extension de celle-ci aux biens venant en remplacement
conduit en fait à considérer ces derniers comme des biens futurs,
inclus ab initio et de lege feranda dans l'assiette de toute
sûreté mobilière », Jean-François RIFFARD,
« Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle », op. cit., p.
140.
208« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », p. 132, paragr. 90.
biens grevés209. Dès lors,
aucun tiers ne sera en mesure de s'informer correctement, l'avis
obsolète décrivant des biens qui ont déjà
quitté le patrimoine du constituant. Une « nouvelle quadrature
du cercle » se pose alors en ces termes « Doit-on faire
prévaloir l'information des tiers, et la fiabilité du registre en
exigeant une réactualisation « en temps réel » de
l'information publiée ?210 » ou alors doit-on
garantir l'opposabilité d'une sûreté « sur un
produit identifiable quand bien même celui-ci se présenterait sous
la forme d'un bien non visé dans l'avis d'enregistrement, et ce, au
risque de saper les principes qui sous-tendent les règles
d'opposabilité ?211 ». Jean François RIFFARD
répond à ce dilemme en avançant le compromis retenu par la
CNUDCI. Le créancier aura l'obligation d'enregistrer avant un certain
délai « un avis de modification de l'enregistrement initial
afin de faire apparaître, dans la description des biens grevés, le
nouveau produit. À défaut, sa sûreté sur les biens
acquis en remploi d'une autre nature que les biens d'origine ou des
espèces, deviendra inopposable aux tiers212
».
En conclusion, même si l'extension de l'assiette
de la sûreté au produit des biens grevés suppose des
difficultés, d'aucuns diraient des défis213, en
matière de publicité, il nous apparaît impossible de
construire un régime efficace de la publicité des
sûretés réelles mobilières sans traiter la question
de l'angle mort de la publicité personnelle, à minima en ce qui
concerne ses effets directs sur le consommateur. À ce propos, Romain
BOFFA dénonce avec une pointe d'ironie cette problématique en
droit positif actuel : « S'il faudra du temps pour inviter le
consommateur de meubles à consulter systématiquement le fichier
informatique (du registre), il en faudra encore plus pour lui
expliquer qu'il doit subir la sûreté même sans avoir pu la
connaître »214. Non seulement un système qui
ferait supporter un droit de suite concurrent au sous-acquéreur aveugle
à la publicité personnelle ne serait pas efficace, mais il serait
de surcroît injuste et inconcevable politiquement et
économiquement.
209Quand l'avis initial décrit les biens
grevés et leurs produits futurs de manière habile, la question ne
se pose pas. En effet, en formulant l'inscription de manière astucieuse
il est possible de la faire durer dans le temps sans qu'elle perde sa
faculté à informer correctement les tiers sur la nature et le
nombre des biens grevés à un instant T.
210Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle »,op. cit.,
p. 144
211Ibid.
212Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle »,op. cit.,
p. 145
213Outre « Le Défi de la Continuation de
la Sûreté et l'Opposabilité aux Tiers » que nous avons
évoqué succinctement, Jean-François RIFFARD propose des
réponses aux différentes problématiques pratiques qui
accompagnent sa solution. Jean-François RIFFARD, «
Sûretés mobilières et Stocks : ou l'Art et la
Manière de résoudre la Quadrature du Cercle », op.
cit.
214Romain BOFFA, « L'opposabilité du
nouveau gage sans dépossession », op. cit. paragr.
23.
- SECONDE PARTIE -
LE CHOIX DU RÉCEPTACLE : LA GENÈSE DU
REGISTRE EFFICACE
Après avoir plaidé en faveur de
l'hégémonie de l'inscription par simple avis, la méthode
d'opposabilité la plus efficace à notre sens, nous devons
à présent tourner nos efforts vers la construction d'un registre
destiné à recevoir toutes les informations dont nous avons
démontré l'importance pour les tiers. Dans cette seconde partie
nous réaffirmerons les principes forts propres à la substance de
la publicité efficace, absence de caractère probatoire, vocation
universelle et unitaire. Nous alignerons ces caractères aux traits d'un
réceptacle sur mesure qui visera l'accessibilité maximale dans la
plus grande simplicité possible. Afin d'accomplir cet objectif, nous
évoquerons d'abord les caractères généreux et les
besoins d'un registre efficaces dans une sorte de cahier des charges (TITRE 1).
Puis nous analyserons le phénomène blockchain pour
déterminer si cette technologie particulière peut convenir
à notre projet. Nous avancerons méfiants, conscient de l'effet de
mode qui accompagne cette innovation. Toujours est-il que la blockchain est une
technologie à considérer (TITRE 2).
- TITRE 1 -
LES PROPRIÉTÉS D'UN REGISTRE EFFICACE ET
LES MOYENS DE LES
DÉVELOPPER.
Après avoir identifié quelle
publicité nous voulions transmettre aux tiers afin d'assurer
l'opposabilité des droits réels. Il convient de s'éloigner
de l'appréhension juridique de notre problématique pour
s'intéresser à des considérations qui mêlent le
droit à des préoccupations plus matérielles. En effet,
après avoir énuméré les prérequis
fondamentaux de la publicité efficace, à savoir son
imperméabilité à la question de la connaissance
effective215, sa séparation vis-à-vis du domaine de la
constitution de sûreté216, sa vocation à
l'information universelle en matière de droit réel grevant des
meubles à titre de garantie indépendamment de toute
considération notionnelle217, et enfin le rôle crucial
de l'inscription par simple avis, véhicule unique de l'information vers
son réceptacle218, nous nous demanderons ce qui fait
l'essence d'un registre efficace. Car même une information parfaitement
sculptée ne saurait remplir son office sans un écrin à la
hauteur de ses performances. Autrement dit, en matière de
publicité des sûretés réelles mobilière, une
publicité parfaitement pensée peut être rendue totalement
inefficace par un registre pauvrement conçu. En quête du
réceptacle idéal, et en admettant que notre lecteur adhère
aux grandes lignes des principes clés de la publicité efficace,
nous commencerons par souligner l'absolue nécessité d'un registre
totalement informatisé (chapitre 1) avant d'énumérer les
trois principes qui feront son efficacité : clarté,
simplicité, gratuité (chapitre 2).
215Voir supra partie 1 titre 1 chapitre 1. Où
nous avons pu avancer l'idée qu'une publicité efficace n'avait
pas vocation à s'intéresser a des considérations telles
que la connaissance effective du tiers afin de produire ses effets
d'opposabilité. La question qui doit nous intéresser quand il
s'agit de soumettre un tiers à l'opposabilité d'un acte n'est pas
de savoir s'il en avait eu subjectivement connaissance. Il faut se demander si
objectivement il avait accès à cette information.
216Voir supra partie 1 titre 1 chapitre 2. Où
nous avons souligné l'importance d'une distinction entre les concepts
d'efficacité entre les parties et d'efficacité erga omnes. La
publicité ayant attrait au domaine de l'opposabilité des
conventions et non à la question de leurs validités. Nous avons
montré plus haut qu'il fallait par exemple se départir de
l'idée que la publicité aurait vocation à apporter la
preuve de la constitution d'une sûreté. Cette approche confinant
à des formalités d'inscription lourde par le biais de
l'enregistrement de la convention de sûreté dans son
intégralité étant incompatible avec l'impératif de
lisibilité propre à la publicité efficace. Voir
supra.
217Voir supra partie 1 titre 1 chapitre 3. Où
nous avons mis en avant l'importance d'une approche globale et unitaire du
droit des sûretés quand il est question de publicité. Notre
modèle idéal comprendrait une unique sûreté
mobilière adaptée à tout type de bien qui serait assortie
d'un unique régime de publicité, qui grâce à une
approche « englobante » aurait vocation à attirer sous son nom
(car tout ce qui aurait fonction de sûreté serait nommé
sûreté unique) tout mécanisme qui viendrait à
naître a sa suite.
218Voir supra partie 1 titre 1 chapitre 4. Où
nous avons soulevé l'importance des sûretés sans
dépossession en matière économique. Des
sûretés rendues possibles grâce au principe de
l'inscription. Un mécanisme dont il faut promouvoir
l'attractivité autrement que par le droit de rétention purement
fictif que le législateur a inventé en matière de gage
sans dépossession. Enfin, car la publicité efficace ne saurait
souffrir d'un véhicule lent et faillible pour la mener à sa
destination, le registre, nous avons montré qu'il faut
privilégier l'inscription par simple avis sur l'inscription par
enregistrement de document.
- CHAPITRE 1 -
L'ABSOLUE NÉCESSITÉ D'UN REGISTRE
INFORMATISÉ.
« Le Guide sur les opérations
garanties recommande que le fichier du registre (...) soit si possible
électronique219 ». Le fait que le registre
soit consultable par voie électronique n'a pas besoin d'être
débattu. Ce point-là emportant un consensus évident. Plus
dure à tenir est la position selon laquelle il faudrait se passer
intégralement de tout registre papier. Cela permettrait pourtant de
s'épargner la périlleuse tâche de transcrire l'information
d'un support à l'autre. De manière générale, il
semble temps d'en finir avec l'inefficience du registre papier (Section 1). Un
tel bouleversement est envisageable si l'inscription par simple avis
évoqué précédemment a été admise
comme un préalable nécessaire. Méfions-nous cependant de
l'innovation inachevée. En partant de l'exemple critiquable du fichier
national des gages sans dépossession (Section 2), nous
démontrerons que l'accès à une interface informatique trop
limitante n'offre que l'ombre du potentiel d'efficacité que peut avoir
un véritable registre informatisé en accès direct tant en
lecture qu'en écriture.
Section 1 : l'inefficience du registre papier.
Comme le fait remarquer la CNUDCI « Par le
passé, les données inscrites devaient être
conservées sous forme papier. L'apparition du stockage numérique
a cependant facilité l'adoption de bases de données
informatisées et considérablement réduit le travail
d'administration et d'archivage pesant sur le registre220
». Aujourd'hui à l'heure d'internet et où l'immense
majorité des contribuables déclarent leurs impôts en ligne
on voit mal pourquoi il faudrait s'encombrer d'un registre papier. D'autant que
la liste des difficultés inhérentes à l'entretien d'un
registre papier à elle seul devrait nous enjoindre à nous
détourner de cette option. Ainsi, « de toute évidence,
les archives électroniques prennent moins de place et sont plus faciles
à consulter221 ». Ajoutons que s'épargner le
registre papier c'est s'épargner un important volume de transaction
postale. Partant de cette analyse les données envoyées au
registre devraient toujours être d'ordre électronique. Il ne faut
pas qu'il y ait de cassure entre le support des informations fourni au registre
et le support des informations que le registre fournit à ses usagers.
Grâce au tout numérique, on s'épargne la tâche
d'avoir à retranscrire, au risque d'erreurs humaines, l'information d'un
support à l'autre. Il ne devrait pas y avoir d'intermédiaires,
l'avis inscrit par un créancier garanti devrait être le même
avis que celui qui est consultable en temps réel par le tiers. Les
inscriptions devraient répondre à des critères
formels222 et objectifs gérés pour refuser
automatiquement et sans délai les avis non conformes.
De manière générale, le
dispositif du registre papier paraît à bien des égards
incompatible avec la quête du registre efficace. Toutefois, il ne
faudrait pas surévaluer l'intérêt d'une base de
donnée accessible en ligne, cet atout perd beaucoup de ses
intérêts s'il n'est pas assorti de la possibilité offerte
aux utilisateurs d'accéder directement et par eux-mêmes au
registre en écriture et en lecture.
219« Guide de la CNUDCI sur la mise en place
d'un registre des sûretés réelles mobilières
», op. cit., p. 34, paragr. 82.
220« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », op. cit., p. 165, paragr.
38.
221« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », op. cit., p. 165, paragr.
39.
222Ces critères tels que le contenu minimal de
chaque avis devrait être évalué par des algorithmes
intégrés à la blockchains du registre que nous aurons
l'occasion de détailler lors du second chapitre du titre 2 de la partie
2.
Section 2 : L'exemple critiquable du fichier national
des gages sans dépossession,
Selon la CNUDCI, « Un fichier
électronique est le moyen le plus efficace et le plus pratique pour les
États adoptants d'appliquer la recommandation du Guide sur les
opérations garanties selon laquelle ce fichier devrait être
centralisé et unifié223 ». Autrement dit, le
registre efficace serait une base de données informatisée. En
droit positif français, le fichier national des gages sans
dépossession est ce qui se rapprocherait le plus de cet idéal. Il
n'en demeure pas moins éminemment perfectible, de sorte que nous ne nous
inspirerons que très modérément de cet exemple. L'article
9 du décret n° 2006 -- 1804 du 23 décembre 2006 dispose
qu'« Il est créé un fichier électronique national
sur lequel est mentionnée l'existence des inscriptions prises en
application de l'article 2338 du Code civil ».
Commençons par le premier défaut de ce
fichier, le plus évident et le plus facilement remédiable :
comment ne pas regretter que le fichier national des gages sans
dépossession ne s'attache, comme son nom l'indique, qu'à la seule
publicité des gages sans dépossession régis par les
articles 2333 et suivant du Code civil ? Quid, entre autres, du gage de stocks,
régis par les articles L. 527-1 et suivant du code de commerce ? Ainsi
le fichier national des gages sans dépossession a-t-il souffert,
dès sa naissance, de la vision octogonale non unitaire du droit des
sûretés que nous avons pu aborder plus haut224.
Aujourd'hui, il pèche par sa nature lacunaire incapable qu'il est
d'informer les tiers en présence d'une sûreté
spéciale. Cette imperfection n'est qu'une manifestation parmi tant
d'autres du casse-tête de la vision non unitaire de la matière.
Toutefois, même en présence d'un droit des sûretés
éclaté « une élémentaire logique aurait
voulu que l'on crée un registre national pour tous les gages sans
dépossession, quels qu'ils soient225 ». A ce
propos, sur demande du ministère de la Justice, une commission
constituée sous la houlette de l'Association Henri Capitant a entrepris
de solutionner ce désagrément. À l'occasion d'un
avant-projet de réforme qui s'articule autour des dix points
clés, il propose notamment une « amélioration du
régime de la publicité des sûretés mobilières
par la centralisation de l'inscription de toutes les sûretés
mobilières spéciales sur le registre créé par le
décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006226
». Incontestablement, il s'agirait d'un progrès, mais le
remède est-il suffisant ? À vrai dire, nous n'en sommes pas
convaincus dans la mesure ou le fichier national des gages sans
dépossession est affecté d'un second défaut. Un
défaut structurel.
À l'étude des dispositions du
décret du 23 décembre 2006, il apparaît que les usagers
n'ont jamais eu accès directement au registre contenant l'information
relative aux inscriptions des différents gages sans dépossession
sur le territoire. S'il se rend sur le site d'information du Conseil national
des greffiers des tribunaux de commerce227, l'usager sera face
à une simple interface fort limitante dans ses possibilités de
recherche. Cette interface est étrangère à la notion de
registre efficace entendu sous la forme d'un grand livre accessible à
tous en écriture et en lecture comme pourrait le proposer la blockchain.
L'article 10 du décret sus-cité dispose que « Le
greffier du tribunal auprès duquel un gage est inscrit
conformément à l'article 1er reporte par voie électronique
sur le fichier prévu à l'article précédent le nom
du constituant ainsi que la catégorie à laquelle appartient le
bien affecté en garantie. » Quant à
223« Guide de la CNUDCI sur la mise en place
d'un registre des sûretés réelles mobilières
», op. cit., p. 34, paragr. 82.
224Voir supra. Partie 1, Titre 1, Chapitre 3 : L'approche
globale et fonctionnaliste de la notion de sûreté 225Pierre CROCQ,
« Droit des sûretés », Dalloz, 2008, recueille
Dalloz, 2008, p. 2104.
226Xavier DELPECH, « Propositions de
réforme du droit des contrats spéciaux et du droit des
sûretés », Dalloz, AJ contrat 2017, p.404.
227www.cngtc.fr
lui, l'article 12 dispose que « S'il existe
des inscriptions prises au nom du constituant sur le bien décrit, le
Conseil national en informe le demandeur et lui indique le greffe
compétent pour obtenir, à ses frais, la délivrance de
l'état de ces inscriptions ». À la lecture
combinée de ces deux articles, il faut conclure que l'usager qui visite
le site n'a pas la possibilité d'écrire sur le véritable
registre. Cette prérogative étant réservée aux
greffiers malgré la charge de travail inutile que cela implique.
L'usager ne peut pas non plus consulter le véritable registre, tout
juste a il accès gratuitement à une copie lacunaire. Ce
système pose plusieurs problèmes, d'une part si la CNUDCI met en
garde contre le registre papier c'est notamment pour éviter le risque
d'erreur lié au processus de la transcription228. En
l'espèce, le fichier n'a que l'apparence d'un registre
informatisé, car il est issu en substance d'un support papier.
Dès lors, la transcription opérée par les greffes des
tribunaux de commerce apparaît comme une étape inutile lors de
l'inscription et la nécessaire demande de consultation payante qui suit
apparaît comme une étape inutile lors de la consultation. En
somme, les greffes se sont immiscées entre l'utilisateur et son registre
ce qui ne saurait être la fonction d'un conservateur
efficace229.
Pour ce qui est du caractère onéreux de
la « délivrance de l'état de ces inscriptions
», il nous apparaît que ce surcoût n'existe que parce que
le fichier des gages sans dépossession n'a pas su se détacher de
son support papier et de l'inscription par enregistrement de documents. Le
registre efficace devrait donner libre accès aux avis inscrits dans
leurs intégralités, et cela potentiellement gratuitement. La
gratuité d'utilisation et le financement par la publicité
commerciale étant la norme sur internet, il nous semble
intéressant de creuser ces pistes quant au financement du
registre230.
Entre autres limitations, soulignons que quiconque
souhaitant s'informer de la situation patrimoniale d'un particulier, afin de
jauger sa capacité à honorer ses obligations par exemple, doit
impérativement connaitre la date de son anniversaire231 !
L'article 11 b) du décret de 2006 dispose que « Pour consulter
le fichier national, le requérant indique les éléments
suivants : (...) S'il s'agit d'une personne physique non-commerçante ou
d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénoms,
date et lieu de naissance et son domicile ». Or si la CNUDCI admet la
possibilité d'ajouter la date de naissance dans l'avis d'inscription de
la sûreté afin de parer à l'hypothèse où
plusieurs constituants du même nom auraient grevé des biens
similaires elle ajoute évidemment que « Le Guide sur les
opérations garanties ne recommande cependant pas d'utiliser ces
informations complémentaires comme critère de
recherche232 ». Dans le même ordre d'idée, il
faudra impérativement connaitre la
228À propos de l'usage d'un registre
informatisé la CNUDCI affirme que « Cette approche est le moyen le
plus efficace de donner suite à la recommandation du Guide sur les
opérations garanties selon laquelle le système devrait être
conçu pour réduire au minimum le risque d'erreur humaine (...),
puisqu'elle dispense le personnel du registre de saisir dans le fichier du
registre les informations figurant sur un avis papier et élimine ainsi
le risque d'erreur lié à la transcription. », «
Guide de la CNUDCI sur la mise en place d'un registre des
sûretés réelles mobilières », op. cit., p.
34, paragr. 83.
229La CNUDCI rappelle que « L'accès direct
réduit considérablement les frais de fonctionnement et de
maintenance du système », « Guide législatif de la
CNUDCI sur les opérations garanties », op. cit., p. 165. Il ne
semble pas y avoir de bonne raison à empêcher les usagers
d'accéder directement au registre, surtout quand on s'attarde sur le
caractère dissuasif des sanctions relatives aux inscriptions
erronées ou malveillantes que nous avons pu évoquer plus haut.
Dans le même ordre d'idée, « L'accès
électronique direct élimine notamment tout délai entre la
soumission d'un avis au conservateur du registre et la saisie effective dans la
base de données des informations contenues dans l'avis
».
230Voir infra,
231Avec le système de publicité
personnelle proposé par le fichier national des gages sans
dépossession il est impératif de connaître la date de
naissance complète du constituant personne physique pour pouvoir
l'identifier et ainsi procéder à une recherche.
232« Guide de la CNUDCI sur la mise en place
d'un registre des sûretés réelles mobilières
», op. cit., p. 74,
ville de naissance du constituant-personne physique.
Il existe bien une fonction « rechercher dans le site pour renseigner
automatiquement le formulaire », mais elle ne permet que de
substituer un numéro SIREN/SIRET à la rubrique
problématique ce qui ne sera d'aucun secours si le constituant est un
non professionnel. S'il faut bien admettre que cette hypothèse est
marginale, on ne comprend pas pourquoi le fichier ne serait pas assorti d'un
moteur de recherche capable de fournir les différents avis correspondant
à un nom et à un prénom.
Outre les difficultés relatives au formulaire
destiné à identifier le constituant, le site exige que l'usager
renseigne la « catégorie de bien gagé ».
L'article 11 2 ° du décret de 2006 dispose que : « Pour
consulter le fichier national, le requérant indique les
éléments suivants : Sur le bien : la catégorie à
laquelle le bien appartient par référence à la
nomenclature prévue au 6 ° de l'article 2. Chaque consultation ne
peut porter que sur une même personne et une même catégorie
de biens ». Une fois encore on comprend mal pourquoi une même
consultation ne devrait renseigner que sur une catégorie de bien.
Pourquoi serait-il impossible d'avoir une vue d'ensemble des droits grevant le
patrimoine du constituant ? Ce genre d'information peut évidemment
intéresser n'importe quel créancier chirographaire. C'est
à croire que le fichier n'a été pensé que pour les
tiers désireux d'acquérir des droits sur des biens
potentiellement grevés. Or nous avons démontré que la
notion de tiers intéressé par la publicité des
sûretés mobilières était bien plus vaste que cela.
Enfin, on ne peut pas croire que cette limitation ait été
placée à dessein233, car il demeure possible pour qui
s'arme de patience d'effectuer une recherche pour chacune des 18
catégories de bien afin de se faire une image globale des engagements
pris par le constituant. Cette tâche étant particulièrement
fastidieuse on peut s'interroger quant à l'opportunité du
développement d'une application mobile qui effectuerait automatiquement
ces 18 recherches afin d'en fournir une synthèse à son
utilisateur.
En conclusion, le registre efficace devrait à
notre sens être conçu comme un registre purement
informatisé. Il ne devrait pas exister de base de données qui
fournit une information lacunaire et difficile d'accès aux usagers, le
registre devrait lui-même être cette base de données. Quand
on considère le principe de base de l'inscription par simple avis on
voit décroitre l'importance du support papier. En effet si le
système du fichier national des gages sans dépossession souffre
des défauts que nous lui avons trouvés, c'est entre autres choses
parce que toutes inscriptions supposent l'enregistrement de l'acte original
constitutif de la sûreté. Tant que l'inscription par
enregistrement de document sera privilégiée, le registre ne
pourra se départir de l'image d'une étagère
poussiéreuse croulant sous les dossiers épais. La
modernité commande un registre accessible en lecture et en
écriture par tous, cela ne devrait choquer personne dans la mesure
où nous avons déjà établi que l'inscription ne doit
pas avoir pour vocation de prouver l'existence d'une sûreté. Afin
d'aboutir à une réelle dématérialisation du
registre, nous devons nous lancer sur la piste de la Blockchain, un mode de
certification qui brille par sa capacité à se passer
d'intermédiaire. Saura-t-elle générer un registre capable
de minimiser le rôle des conservateurs pour que les utilisateurs aient
enfin accès à une consultation et une inscription direct à
moindre coût ?
paragr. 167.
233Afin de s'assurer que chacun ne prenne que les
informations qui l'intéressent directement, afin que les affaires du
constituant ne soient pas exposées au vu de tous par
exemple.
- CHAPITRE 2 -
PRINCIPES D'UN REGISTRE EFFICACE
En tant que support d'une publicité efficace,
le registre idéal doit répondre à plusieurs
impératifs. Ces performances doivent refléter les qualités
que nous avons cherché à insuffler à la publicité.
Ainsi le réceptacle sera le catalyseur de la substance et
l'efficacité de la publicité sera renforcée par les
qualités de son contenant. Ainsi l'indexation des avis devra briller par
sa clarté (Section 1). Les règles de résolutions des
conflits de priorité devront viser la plus grande simplicité
(Section 2) et en règle générale le registre devra viser
la plus faible onérosité si ce n'est l'autosuffisance (Section
3).
Section 1 : Clarté : la question de l'indexation
des avis.
1. Indexation en considération de la personne
du constituant : méthode principale. Nous avons eu plus haut l'occasion
d'affirmer que la plus grande part de la publicité des
sûretés réelles mobilière ne pouvait être
faite que sous la forme d'une publicité personnelle. C'est-à-dire
une publicité où l'information publiée dans l'avis serait
associée au nom du constituant. Autrement dit, un avis contient
l'identité du constituant, qu'il soit personne physique ou morale, et le
détail du droit réel qu'il a consenti sur un de ses bien.
Toutefois, une convention de sûreté comprend au minimum deux
parties, un constituant et un créancier garanti. Dès lors, on
pourrait aussi qualifier de publicité personnelle la tenue d'un registre
qui détaillerait les garanties dont un créancier peut
espérer bénéficier. Néanmoins, nous devons nous
garder de cette forme de publicité personnelle, car elle a le
défaut majeur de nuire au respect d'une certaine confidentialité.
Ainsi la CNUDCI nous met elle en garde, « Permettre au public
d'effectuer ce type de recherche (en fonction du créancier garanti)
pourrait être contraire aux attentes raisonnables des créanciers
garantis en matière de confidentialité 234».
La commission développe avec un exemple très simple « un
fournisseur de crédit pourrait effectuer une recherche sur la base de
l'identifiant du créancier garanti pour obtenir les listes de clients de
ses concurrents 235». Ainsi la CNUDCI recommande que le
créancier garanti soit identifié dans l'avis d'inscription, tout
en précisant que cette donnée ne doit jamais constituer un
critère de recherche accessible au public236.
Nous avions évoqué plus haut le
principal défaut de la publicité personnelle. Nous avions
qualifié cette difficulté d'« angle mort de la
publicité personnelle ». En bref, tout sous-acquéreur qui
n'a aucun lien avec le constituant est incapable d'effectuer une recherche
efficace et se retrouve dès lors dans la situation de tiers aveugle
à la publicité. Évoquons à présent une forme
de publicité exempte de ce défaut, la publicité
réelle.
2. Indexation en considération de certains
biens grevés : méthode complémentaire. Là où
l'émission d'une publicité personnelle correspond à un
registre où les indexations des avis seraient faites en fonction de
l'identité de chaque constituant, la publicité réelle
propose à l'inverse d'entrer l'identifiant d'un bien en guise de
critère de recherche. Cette forme de publicité est de loin la
plus agréable pour le sous-acquéreur qui, s'il veut s'assurer
qu'un bien n'est pas grevé, a simplement à entrer son
numéro de série ou tout autre identifiant afin de
234« Guide de la CNUDCI sur la mise en place
d'un registre des sûretés réelles mobilières
», op. Cit., p. 118., paragr. 267.
235Ibid.
236« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », op. cit., p. 177, paragr.
81.
lancer une recherche. En général, on
affirme que ce registre est traditionnellement réservé aux biens
de grande valeur. C'est généralement vrai, mais il y a d'autres
critères à prendre en compte. La dangerosité de certains
biens a souvent tendance à forcer le législateur à les
individualiser pour procéder à leurs
répértoriation. On peut prendre l'exemple évident des
armes à feu qui possèdent toutes un numéro de
série. Chacun admettra que la valeur d'un fusil est sans commune mesure
avec le prix d'un navire ou d'un aéronef qui sont les exemples les plus
cités de registre spécial basé sur une publicité
réelle. Pourtant les armes, grand classique des boutiques de prêt
sur gage aux états unis, sont des biens qui pourraient sans
problèmes être incorporés à un registre par
l'indexation de leurs numéros de série. Il en va de même
pour les moteurs et de nombreuses pièces détachées
automobiles qui du fait des exigences en matière de
sécurité doivent être facilement traçables et
identifiables.
C'est pourquoi afin de combler les lacunes de la
publicité personnelle et afin de faciliter l'usage du registre, nous
recommandons qu'une indexation des avis basés sur les biens soit
ajoutée chaque fois que cela est possible. Autrement dit, chaque fois
qu'un bien est facilement identifiable, pour quelque raison que ce soit
(souvent il sera question de logique de sécurité et de
traçabilité), ce bien devrait faire l'objet d'une indexation
réel en sus de l'indexation personnelle. Ainsi un usager du registre qui
aura les caractéristiques techniques d'un bien sous ses yeux, ou qui
tiendra ce bien entre ses mains, sera capable d'effectuer une recherche par
numéro de série sur son smartphone en quelques secondes sans
avoir à se soucier de la personne du constituant.
Pour l'heure, la majorité des registres
fondés sur une indexation réelle sont des registres
spéciaux destinés à des bien spéciaux. On peut
citer l'exemple des immeubles qui sont soumis aux obligations
particulières de la publicité foncière. Or quand on
évoque la question des meubles qui peuvent être attachés
à des immeubles, on comprend rapidement comment ces différents
registres peuvent se chevaucher. Dans le même ordre d'idée, un
navire pourrait faire l'objet d'une inscription dans un registre spécial
et dans le registre global des sûretés réelles
mobilières. Ainsi un registre efficace doit avoir pour objectif une
répartition et une priorisation harmonieuse de l'information entre le
domaine du spécial et le domaine du général. À ce
sujet, la CNUDCI précise que « La coordination soulève
des problèmes complexes, notamment si le registre
spécialisé utilise un système d'inscription par bien
plutôt que le système d'indexation par constituant du registre
général des sûretés recommandé dans le Guide
sur les opérations garanties237 ». Le premier
réflexe pourrait être de recommander une approche unitaire, et
donc une suppression des registres spéciaux au profit d'une convergence
des inscriptions vers le registre général. Cependant, cette piste
doit être écartée, car bien souvent les registres
spéciaux ne poursuivront pas les mêmes objectifs que le registre
général des sûretés réelles
mobilières. Ainsi la CNUDCI souligne que « Ces registres
spécialisés ont généralement des objectifs plus
larges, que la simple publicité des sûretés sur les biens
concernés, notamment l'enregistrement de la propriété ou
des transferts de propriété238 ». Dès
lors, parce qu'il a pour simple vocation d'informer les tiers, contrairement
aux régimes spéciaux destinés à apporter la preuve
de la propriété (ce qui suppose une inscription par
enregistrement de document très lourde et à valeur probatoire) il
semble sage de se plier aux recommandations de la CNUDCI en matière de
priorité des droits inscrits dans ces différents types de
registres. Ainsi la CNUDCI « recommande d'accorder la priorité
aux
237« Guide de la CNUDCI sur la mise en place
d'un registre des sûretés réelles mobilières
», op. cit., p. 26, paragr. 66.
238« Guide de la CNUDCI sur la mise en place
d'un registre des sûretés réelles mobilières
», préc., p. 16, paragr. 37.
droits d'un acheteur ou autre
bénéficiaire d'un transfert concernant lesquels un avis a
été inscrit dans le registre spécialisé par rapport
à une sûreté concernant laquelle un avis a
été inscrit dans le registre général des
sûretés239 ».
Section 2 : Simplicité : la question de la
priorité des droits.
La question de la priorité est indissociable de
la notion d'opposabilité bien qu'il ne faille pas les confondre.
Commençons par une définition du champ d'application des
règles de la priorité des droits qui nous intéressera au
cours de cette section, ensuite il sera temps d'examiner les difficultés
de la relation opposabilité/priorité.
1. Définition des règles de
priorité et délimitation de leurs champs d'application. «
Le concept de priorité est au coeur de tout régime efficace
en matière d'opérations garanties240 ». La
CNUDCI définit les dispositions relatives au concept de
propriété par leurs fonctions. Ainsi les normes relatives
à la priorité en matière de sûreté
réelle mobilière sont « Le principal moyen par lequel
les États résolvent les conflits entre les droits de
différents réclamants concurrents sur les biens du
constituant241 ». Elle poursuit en décrivant plus
particulièrement le contenu de règles de priorité et leurs
conséquences juridiques, elle évoque « un ensemble de
principes et de règles qui définissent la mesure dans laquelle un
créancier garanti peut jouir des effets économiques de sa
sûreté sur un bien grevé du constituant par
préférence à tout autre réclamant concurrent qui
tient ses droits de ce même bien242 ». Nous avons vu
précédemment qu'il pouvait tout à fait exister
simultanément différents droits réels grevant un
même bien au bénéfice de créanciers
différent. Permettre l'existence de cette situation est même un
critère de la réussite d'un système de publicité
des sûretés mobilières. En effet si le système
fourni est assez efficace en matière de transparence, il sera possible
d'exploiter toute la valeur d'un bien en l'affectant à la garantie de
plusieurs créances. Cet achèvement n'est pas une mince affaire
Pour obtenir un tel résultat il faut que le système de
publicité fournisse aux créanciers garantis des données
exactes et précises sur le rang des droits des autres. Comme nous avons
pu le montrer précédemment c'est uniquement comme cela que de
nouveaux créanciers garantis seront suffisamment rassurés pour
venir se greffer en aval des rapports entre le constituant et un premier
créancier garanti243.
Nous n'évoquerons pas le cas des ordres
juridiques qui ne « traite pas directement du rapport entre les divers
créanciers d'un débiteur, mais uniquement du rapport entre le
débiteur et un créancier particulier244 ».
Car dans la grande majorité des états « le droit des
relations entre débiteurs et créanciers a une portée plus
large et prévoit aussi plus explicitement la manière dont doivent
être régies les relations entre l'ensemble des créanciers
d'un débiteur245 ». À notre sens, cette
approche doit être saluée en raison de la vision d'ensemble
qu'elle apporte. Les droits d'un créancier ayant forcément des
conséquences sur les droits d'un autre dans le cadre limitatif du
patrimoine d'un unique débiteur, il est bon que le droit se montre
réaliste et pragmatique en envisageant cet état de fait. C'est
cette approche qui sous-tend la nécessaire discipline collective
imposée au
239Ibid.
240« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », préc., p. 191 paragr.
1.
241Ibid.
242Ibid.
243Voir supra.
244« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », op. cit., p. 191, paragr.
2.
245Ibid.
créancier en cas de procédure
collective. En France, l'article 2285 dispose ainsi que « Les biens du
débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en
distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les
créanciers des causes légitimes de préférence
». Retenons qu'une convention de sûreté est
précisément une cause légitime de
préférence, ainsi le créancier garanti prévoyant se
voit-il accorder le droit de tirer son épingle du jeu en cas
d'insolvabilité du débiteur. Toutefois, il est fort probable
qu'il ne soit pas le seul à avoir voulu se ménager une garantie.
Ainsi « Certains définissent ce concept (la
priorité) de manière assez restrictive en ce qu'ils ne
l'utilisent qu'en cas de concurrence entre les réclamants qui ont obtenu
une préférence en rompant avec le principe
d'égalité des créanciers246 ». Cette
approche, retenue en droit positif national, ne nous satisfait pas tout
à fait. En effet, « la concurrence opposant d'autres
réclamants qui ne revendiquent pas de droits sur un ou plusieurs biens
appartenant au débiteur (notamment les vendeurs réservataires et
les acquéreurs ultérieurs d'un bien du débiteur) n'est
normalement pas qualifiée de conflit de
priorité247 ». Or comme nous avons pu vanter les
mérites d'une approche unitaire du droit des sûretés, nous
devons tirer les conséquences de nos propres recommandations. Ainsi
faut-il à notre sens, conformément aux recommandations de la
CNUDCI, considérer comme relevant des dispositions relatives à la
priorité des droits réels tout droit pouvant être
amené à entrer en concurrence sur un même bien. Autrement
dit, il ne faut pas envisager la question de la priorité uniquement en
analysant les relations entre créanciers garantis, mais il faut
également analyser la situation du tiers acquéreur comme celle
d'un demandeur concurrent à qui il faut attribuer un rang.
Partant de ce postulat, la situation de tout
créancier qui peut avoir un droit sur les biens du constituant doit
être interrogée et incluse dans une théorie unique de la
priorité. Ainsi il sera ici question de la situation du vendeur avec
réserve de propriété, de la situation du crédit
bailleur, etc. Une chose est sûre un régime efficace de la
priorité des droits en matière de sûreté
réelle mobilière ne peut pas faire d'impasse s'il entend
s'accorder à une approche unitaire de la matière. La CNUDCI
recommande que « si un créancier cherche à obtenir une
préférence par contrat pour passer outre au principe du gage
commun ou à celui de l'égalité des créanciers,
l'accord sera considéré comme donnant naissance à une
sûreté et les droits des réclamants concurrents seront
traités dans le cadre d'un conflit de priorité ». Ainsi
semble-t-il essentiel d'en finir avec la figure de propriété
sûreté surplombant les conflits de priorité. De toute
façon, comme nous avions pu le souligner quand nous avons
évoqué l'approche unitaire248, les
intérêts en présence249 sont trop importants
pour que le législateur laisse ce genre de mécanisme braver
toutes les règles imposées aux autres
sûretés.
2. La nuance entre ordre des opposabilités et
ordre des priorités. La première règle en matière
de priorité doit briller par sa simplicité. À ce propos
Jean-François RIFFARD énonce que « la CNUDCI fait sienne
le principe « prior tempore, potior jure » en
disposant
246« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », op. cit., p. 191, paragr.
6.
247Ibid.
248Voir supra.
249Si le créancier garanti rêve de la
sûreté parfaite sous les traits d'une propriété
sûreté pour déjouer la concurrence de ses pairs, il doit
cependant comprendre que cette aspiration n'est pas tenable collectivement. Si
une sûreté prend le pas sur les autres, car elle se soustrait au
dispositif encadrant la priorité des droits elle sera
plébiscitée par l'ensemble des créanciers, annulant par la
même occasion l'avantage individuel qu'ils auraient pu en retirer. Cette
escalade en termes de compétitivité entre sûretés ne
pourra, sur le long terme, que nuire aux règles des procédures
collectives. Or ces procédures sont essentielles à la
santé économique du pays. Voilà pourquoi on ne peut que
s'attendre à ce que les propriétés sûreté
trop virulentes soient sanctionnées par le législateur ou la
jurisprudence qui se garderont bien de faire jouer à la
propriété tous les effets qu'elle devrait pourtant avoir. En
matière de procédure collective, nécessité fait
loi.
que la priorité entre des
sûretés concurrentes sur un même bien est
déterminée en fonction de l'ordre d'inscription au registre des
sûretés mobilières ou de l'ordre dans lequel ces
sûretés sont rendues opposables selon ce qui intervient en
premier250 ». Le principe est tout aussi juste
qu'efficace. Toutefois, nous devons lui apporter quelques précisions.
Premièrement, il apparaît que l'ordre chronologique des
inscriptions ne correspond pas tout à fait à l'ordre
chronologique de la priorité des droits. Deuxièmement, il ne
faudrait pas se laisser aller à confondre simplicité et
simplisme. Cette première règle « prior tempore, potior
jure » doit nécessairement être tempérée
d'exceptions qui peuvent être justifiées tant politiquement
qu'économiquement.
La CNUDCI ne reconnaît pas l'inscription comme
seule méthode d'opposabilité. Dès lors si l'on adopte
cette approche l'ordre chronologique des inscriptions ne doit pas être
confondu avec l'ordre chronologique de la priorité des droits. En effet
dans ce système un créancier garanti qui utilise des
méthodes d'opposabilité telles que la mise en possession ou la
prise de contrôle peut tout à fait avoir un droit d'un rang
supérieur à celui du créancier qui enregistrera le premier
avis relatif à un bien donné sur le registre.
Même si nous ne souhaitons pas la suppression de
la dépossession ou de la prise de contrôle en tant qu'emprise
matérielle sur les biens grevés (ces mécanismes apportant
des effets particuliers que les créanciers peuvent légitimement
rechercher). Nous avons déjà eu l'occasion de remettre en cause
leur efficacité en matière de publicité. Afin que d'un
seul regard sur le registre, n'importe quel utilisateur puisse connaître
l'ensemble des droits réels grevant un meuble, nous recommandons que les
sûretés avec dépossession fassent également l'objet
d'une inscription obligatoire. Autrement dit, l'inscription sur le registre
serait la seule manière de prendre rang. Si l'on suppose une inscription
facile et gratuite251, cette disposition n'aggrave pas
sérieusement la situation des créanciers garantis
bénéficiant d'une sûreté avec dépossession.
Cette mesure aurait le mérite de rompre avec le caractère
lacunaire des informations sur l'opposabilité et la priorité que
le registre devra souffrir tant qu'il existera d'autres méthodes
d'opposabilité que l'inscription.
Cependant même si on admet l'inscription comme
unique méthode d'opposabilité, le premier créancier
à rendre sa sûreté opposable aux autres ne sera pas
nécessairement le premier créancier en termes de rang. En effet,
ce serait sans compter sur la problématique de la perte
d'opposabilité. À ce sujet, nous nous accordons à l'avis
de la CNUDCI selon lequel « La loi devrait prévoir que, si une
sûreté réelle mobilière perd son opposabilité
à un certain moment, cette opposabilité peut être
rétablie, auquel cas elle prend effet à compter de la date
à laquelle elle est rétablie252
».
Si nous avons clairement exprimé le souhait de
voir les propriétés sûreté traitées de la
même manière que tous les mécanismes qui pourrait
être rangé sous la notion unitaire de sûreté, il nous
faut cependant reconnaître qu'un système de priorité
chronologique qui ne connaîtrait aucune exception serait à la fois
inefficace et injuste. En effet, certaines raisons motivées par des
considérations politiques ou économiques s'imposent
nécessairement à un système de priorité. Ainsi on
imagine mal un système ou les salariés seraient mis au même
rang que les créanciers chirographaires. La raison de cette exception
est éminemment politique pour ne pas dire morale. Dans le même
ordre d'idée, bien que plus discutable, on retrouve les
privilèges légaux du fisc. Obéissant à des
considérations économiques le guide
250Jean-François RIFFARD, «
L'harmonisation internationale des droits des sûretés
mobilières : ne ratons pas le train ! », préc., paragr.
15.
251Voir infra., partie 2, titre 1, chapitre 2, Section 3
: faible onérosité, la question du financement.
252« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », op. cit., p. 152, paragr.
47.
fait deux exceptions majeures qui retiendront plus
longuement notre intérêt. Le premier privilégié est
le « créancier garanti finançant
l'acquisition253 » une figure que le guide défini
comme « le créancier garanti titulaire d'une
sûreté réelle mobilière en garantie du paiement
d'une acquisition254 ». L'idée derrière ce
terme est que le constituant a besoin d'investir pour pérenniser son
activité, et que les prêteurs qui entendent l'aider doivent
bénéficier de garanties supplémentaires en raison de
l'utilité économique de cette opération. Dans l'approche
non unitaire, cet objectif est atteint, notamment en droit français, par
l'instrumentalisation de la propriété à des fins de
garantie. Ainsi le créancier garanti finançant l'acquisition sera
souvent en droit positif national le créancier
bénéficiaire d'une réserve de propriété sur
la chose ou un crédit bailleur. Comme nous souhaitons que les
propriétés sûreté affrontent les règles de
priorité sur un pied d'égalité avec les
sûretés traditionnelles, nous devons prévoir une nouvelle
façon d'inciter les prêteurs à financer les acquisitions de
leurs constituants. En termes de solution, le guide propose d'accorder au
créancier garanti finançant l'acquisition « une
super-priorité lui permettant de primer tout autre créancier
ayant antérieurement rendu opposable une sûreté sur biens
futurs, à condition qu'il enregistre un avis dans un certain
délai à compter de la vente255
».
La deuxième figure bénéficiant
d'une exception notable au principe de la priorité chronologique des
droits est l'acquéreur dans le cours normal des affaires. Cette
deuxième exception dont nous avons eu l'occasion de vanter les
mérites en matière de lutte contre les lacunes de la
publicité personnelle se justifie pleinement économiquement, car
elle correspond aux attentes raisonnables des parties. Elle se justifie
tellement qu'on peut reprocher à la CNUDCI de ne pas lui avoir
donné sa pleine mesure. En effet « Selon le Guide, l'acheteur
de marchandises dans le cours normal des affaires du constituant va prendre le
bien libre de toute sûreté, quand bien même elle lui serait
opposable, à moins qu'il n'ait eu connaissance au moment de la vente que
celle-ci violait les droits du créancier garanti256
». Voilà une distinction subtile avec la notion de connaissance
effective ! L'acheteur dans le cours normal des affaires prendrait donc les
marchandises libres de toute sûreté même s'il a connaissance
d'une convention de sûreté les affectant, mais pas s'il a
conscience que cette même convention interdisait au créancier de
disposer des biens. Nous ne pouvons nous ranger à cette approche qui
laisse supposer que la CNUDCI n'a pas tiré toutes les
conséquences de ses arguments relatifs à la difficulté
d'établir la connaissance de ce genre de faits. Ainsi
considérerons-nous que cette précision constitue une inutile
complication du système de la priorité des droits dont il
faudrait ne pas tenir compte257.
Section 3 : faible onérosité, la question
du financement.
La CNUDCI traite la question du financement dans son
guide dédié au registre, elle commence en énonçant
un principe qui fera sans nul doute consensus : « Le Guide sur les
opérations garanties recommande que les frais d'inscription et de
recherche soient fixés non pas pour générer des revenus
pour l'État adoptant, mais seulement pour permettre le
253« Guide législatif de la CNUDCI sur
les opérations garanties », op. cit., p. 10.
254Ibid.
255Jean-François RIFFARD, «
L'harmonisation internationale des droits des sûretés
mobilières : ne ratons pas le train ! », préc., paragr.
15.
256Jean-François RIFFARD, «
L'harmonisation internationale des droits des sûretés
mobilières : ne ratons pas le train ! », préc., paragr.
16.
257À ce propos, Jean-François RIFFARD
écrit : « On peut regretter cette dernière précision.
À notre sens, il aurait été plus judicieux de
prévoir qu'un tel acheteur prend toujours les biens libres de toutes
sûretés », Jean-François RIFFARD, «
L'harmonisation internationale des droits des sûretés
mobilières : ne ratons pas le train ! », préc., paragr.
16.
recouvrement des coûts258
». Nous nous accordons à l'avis de la CNUDCI sur ce premier point.
La vocation du guide n'est absolument pas lucrative. Du moins, pas directement.
Car nous sommes convaincus qu'en participant à générer de
la confiance le registre efficace des sûretés réelles
mobilières ne pourra qu'aider au développement de
l'économie. Ce qui ne manquera pas de générer des revenus
fiscaux en dernier ressort. Or comme « des frais et taxes excessifs
décourageront dans une large mesure l'utilisation du
registre259 », nous devons viser la gratuité de ses
services ou à minima en réduire le coût autant que faire se
peut. Afin d'atteindre cet objectif très ambitieux, nous accuseront nos
recommandations sur deux points : la rationalisation et la minimisation des
dépenses, et les opportunités de financement autonome accessible
au registre.
1. La rationalisation et la minimisation des
dépenses. Le registre entièrement informatisé que nous
avions plébiscité n'est pas uniquement avantageux en termes de
fiabilité ou d'accessibilité, il trouve également sa
raison d'être du point de vue du financement du registre. En effet, la
CNUDCI admet que « Les progrès de l'informatique ont
réduit l'écart entre le coût de la mise en place d'un
registre électronique et d'un registre papier ». Elle poursuit
en affirmant que « les coûts de fonctionnement d'un fichier
électronique sont inférieurs, en particulier si le système
de registre permet aux créanciers garantis et aux personnes effectuant
des recherches de soumettre directement des avis et des demandes de recherche
par voie électronique, sans passer par le personnel du
registre260 ». Nous nous rangeons à l'avis de la
commission sur ce dernier point, a notre sens un registre informatisé
qui ne prévoirait pas une interface permettant un accès direct
perdrait finalement l'essentiel de sa raison d'être.
Nous aurons l'occasion de développer plus en
avant ce deuxième point, mais notons pour l'heure qu'avec la technologie
blockchain nous renforcerons l'intérêt que la commission
prête au registre informatisé. En effet si le passage d'un
registre papier à un registre électronique est l'occasion d'une
économie de main d'oeuvre, le passage d'un registre informatisé
à un registre distribué via la blockchain représente une
nouvelle étape dans cette voie. Après avoir créé la
blockchain, dont les greffes des différents tribunaux de commerce
pourraient être autant de noeuds, il n'y aura quasiment plus besoin de
personnel à proprement parler pour faire vivre le registre.
Une fois les coûts réduits à leurs
stricts minimums il semble envisageable de les couvrir via la méthode
d'auto financement que nous avons à l'esprit.
2. Les opportunités d'auto financement du
registre. Nous ne devons pas perdre de vue que le registre global des
sûretés réelles mobilières que nous envisageons
disposera d'un monopole sur un double service essentiel. À la fois,
support de l'information offerte aux tiers et réceptacle des
inscriptions (Méthode majoritaire sinon unique d'opposabilité si
l'on s'en tient aux recommandations que nous avons pu formuler261),
le registre sera l'outil indispensable à un nombre croissant d'acteurs
économiques. Partant de cet état de fait et en considérant
la nature totalement électronique du registre que nous
proposons262, il semble pertinent d'interroger l'opportunité
d'un financement via un modèle de publicité
commercial
258« Guide de la CNUDCI sur la mise en place
d'un registre des sûretés réelles mobilières
», op. cit., p. 123,
paragr. 274.
259Ibid.
260« Guide de la CNUDCI sur la mise en place
d'un registre des sûretés réelles mobilières
», op. Cit., p. 123
paragr. 275.
261Voir supra., partie 1, titre 1, chapitre 4, section 1
: L'inscription plutôt que la dépossession.
262Voir supra., partie 2, titre 1, chapitre 1 : L'absolue
nécessité d'un registre informatisé.
identique à celui qui a pu faire la fortune du
géant Facebook. Le site internet servant d'interface au registre sera
une vitrine idéale pour tous les préteurs qui pourront y diffuser
leurs offres de financements avec la certitude qu'elles seront
visionnées quotidiennement par un public intéressé. Cet
exemple d'agent économique intéressé par une
publicité commerciale qui aurait le registre en support est des plus
simpliste, outre les prêteurs professionnels, la liste des agents
économiques qui pourront financer le registre en échange d'une
telle visibilité est sans fin.
Afin d'augmenter le rendement de ce modèle, il
est tout à fait possible d'opérer une personnalisation de la
publicité proposée à chaque utilisateur du registre. Si un
ancien constituant s'identifie pour effectuer une recherche relative aux
potentiels engagements consentis par un futur partenaire commercial, il sera
aisé de lui proposer des publicités lui proposant l'acquisition
de bien de la même nature que ceux qu'il avait grevés autrefois.
Dans le cadre d'une inscription d'avis comme dans le cadre d'une recherche, il
y aurait un ou plusieurs bandeaux publicitaires destinés au financement
du registre. Ce modèle à la base d'une majorité des
services disponibles sur internet a déjà fait la preuve de sa
rentabilité.
Dans le même ordre d'idée, si nous
préconisons que les services du registre soient accessibles à
tous, tant en inscription qu'en recherche, nous envisageons également la
création d'une version payante. Cette version du registre accessible via
la souscription d'un abonnement serait exempte de publicité et offrirait
d'autres avantages. Notamment l'accès à une application mobile
qui serait créé en même temps que le registre lui
même. Il y a certainement un intérêt à pouvoir
accéder au registre partout sans avoir besoin de s'encombrer d'un
ordinateur, ce qui peut être particulièrement pratique pour
s'informer en temps réel des droits grevant un meuble lors d'une
négociation sur le terrain.
-TITRE 2 -
L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE A CONSIDÉRÉ :
DE LA BLOCKCHAIN
AUX BLOCKCHAIN.
Après avoir asséné que
l'efficacité en matière de publicité des
sûretés réelles mobilières se ferait via la
création d'un registre entièrement informatisé ou ne se
ferait pas, nous nous apprêtons à livrer bataille contre les
machines. Puissions-nous percer le secret de leurs lignes de codes grâce
au glaive de l'interdisciplinarité. Notre quête commencera par une
approche générale de la notion de blockchain, nous relativiserons
les propriétés de cette pierre philosophale, à laquelle
les juristes prêtent toutes les vertus, en nous demanderons si une simple
base de données ne pourrait pas remplir nos objectifs (CHAPITRE 1).
Enfin, si la Blockchain publique nous fera défaut, nous ne
désespérerons pas de trouver réponse à nos
exigences d'efficacité via l'inspirant projet de blockchain privé
porté par les greffes des tribunaux de commerce (CHAPITRE
2).
- CHAPITRE 1 -
L'APPORT DE LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN
Il est nécessaire de placer un cadre
théorique des plus basique avant de s'interroger quant au potentiel de
la blockchain. En effet, les blockchains sont si nombreuses, la renommée
de certaine est si écrasante que l'on peine à se figurer à
quoi peut bien ressembler cette technologie dans son plus simple appareil.
Notre première section sera l'occasion de poser une théorie
générale de ce qu'est une blockchain (Section 1) en l'opposant
aux innovations successives, véritables mutations de l'ADN originel qui
a débouché sur une ample généalogie où les
blockchain historiques ont toutes leurs caractéristiques
particulières. Dans notre deuxième section, nous opposerons la
blockchain aux bases de données traditionnelles (Section 2) afin
d'évaluer si ses particularités intrinsèques peuvent nous
aider à répondre aux impératifs de la publicité des
sûretés mobilières.
Section 1 : La notion de blockchain, définition
générale.
Il ne faut pas confondre la technologie blockchain,
qui est un outil, et les différentes blockchain, qui sont autant
d'oeuvres aux caractéristiques particulières. En effet, «
Ce n'est pas une blockchain, mais plusieurs types de blockchains qui
existent, cohabitent, voire interagissent. Ainsi, une blockchain peut
posséder des spécificités techniques pour des utilisations
ou des applications particulières263 ».
Cette distinction est d'autant plus importante que la
notoriété de certaines blockchains tant à éclipser
une grande part du champ des possibles en imposant leurs particularités
dans l'esprit général. Ainsi quand il est question de blockchain,
les juristes ont tendance à raisonner sur le modèle Bitcoin alors
même que celui-ci est inadapté à leurs besoins. De
manière plus générale, les définitions de la
blockchain ont le tort de passer sous silence l'existence des blockchains
privés, une nuance
263LELOUP Laurent, « Blockchain, la
révolution de la confiance »,« Blockchain, la
révolution de la confiance »,
Eyrolles, 17 février 2017, accessible en
ligne
http://univ.scholarvox.com.ezproxy.uca.fr/reader/docid/88838650/page/1,
p. 15.
dont une définition générale de
la blockchain ne devrait pas faire l'économie selon nous. Les
blockchains ne se résument pas à la blockchain publique. La
blockchain est doublement protéiforme.
1. L'outil blockchain, une définition pour une
technologie plurielle. L'outil blockchain ne peut être défini que
par une liste non exhaustive des technologies mise en synergie par chaque
créateur. Même si on peut dégager quelques «
briques264 » récurrentes il est, comme nous le
verrons, très périlleux265 de faire des
généralités en la matière.
Bien souvent, les définitions que l'on propose
pour la Blockchain sont centrées sur son apparition historique. C'est le
cas de la définition généraliste que propose Laurent
LELOUP, pour qui la blockchain est une technologie « pour une nouvelle
génération d'applications transactionnelles qui, grâce
à un mécanisme de consensus collectif couplé avec
l'utilisation d'un grand livre de compte public, décentralisé et
partagé, établit la confiance, la responsabilité et la
transparence266 ». Il poursuit en évoquant
« un grand livre distribué ou distributed ledger ou registre
2.0 construit sur le modèle des livres comptables et partagé
entre les participants267 ». Ce registre est
distribué sur un réseau qui repose sur « la
décentralisation et la désintermédiation : aucune
autorité centrale ne contrôle la blockchain, il n'y a pas de tiers
de confiance268 ». On qualifie ce type de réseaux
de réseau pair-à-pair, une technologie préexistante
utilisée dans l'immense majorité des blockchains.
Il y a sûrement un intérêt
pédagogique à présenter la notion de blockchain en mettant
en avant son fonctionnement historique et traditionnel. Cependant, cette
définition empreinte d'un parti pris généraliste ne sied
pas à une exposition du potentiel de la blockchain dans le milieu
juridique. Ainsi afin de proposer une définition plus englobante nous
ajouterons premièrement, que le degré de décentralisation
peut beaucoup varier d'une blockchain à une autre, et que
deuxièmement toutes les blockchains ne reposent pas sur un «
distributed ledger ». Pour ne citer qu'un exemple, nous nous
intéresserons bientôt à un « permissioned
ledger».
La modification des données du registre
(Distributed, permissioned ou autre) ne peut se faire que selon les conditions
prévues par l'algorithme ayant vocation à rechercher le consensus
entre les pairs. Ainsi « le fait qu'une transaction soit
acceptée ou rejetée est le
264Selon Côme BERBAIN le terme blockchain
s'applique à des technologies différentes qui « s'appuient
sur des briques techniques préexistantes (registre distribué,
signature électronique, cryptographie asymétrique, preuve de
travail, machines virtuelles...), l'innovation résidant dans leur
assemblage », Côme BERBAIN, « La blockchain : concept,
technologies, acteurs et usages, réalités industrielles »,
dans Dardayrol (J.-P.), (coordinateur), « Blockchains et smart
contracts : des technologies de la confiance »,
Réalités industrielles, annales des mines, Série
trimestrielle l, août 2017, p. 6.
265Il est assez difficile de poser une liste des
technologies qui participe à l'univers blockchain, car n'importe qui
peut créer une blockchain en lui insufflant une hybridation
particulière avec la plus basique ou la plus complexe des technologies
de l'informatique et de la mise en réseaux. Par exemple, on ne peut pas
dire que la technologie Bluetooth soit au coeur de la sphère blockchain,
pourtant il est possible de faire jouer à cette technologie le
rôle d'internet dans une blockchain locale de notre invention. Pour
être qualifiée de blockchain, une technologie doit répondre
à certains critères, cependant ces critères ne sont pas
exhaustifs et la liste de propriétés que l'on pourrait ajouter
à une blockchain est infinie. Exemple d'ajout possible, un
système de blockchain peut prévoir ou non des « smart
contracts ». (Une technologie qui a acquis ce nom au sein de la blockchain
Ethereum, mais qui peut exister sous différentes appellations dans
d'autres blockchains). Dès lors, affirmer que la technologie blockchain
comprend le domaine des « smart contract » serait une
généralisation trompeuse et erronée.
266Laurent LELOUP, « Blockchain, la
révolution de la confiance », op. cit., p. 13
267Ibid., p.14
268Ibid., p.15
fruit d'un consensus
distribué269 ». À ce stade, bien saisir la
notion de blockchain exige du juriste qu'il soit capable de différencier
un élément particulier de sa fonction. Ainsi toutes les
blockchains ont besoin d'un système d'élaboration du consensus.
L'élaboration du consensus est une fonction là où la
preuve de travail, par exemple, est un simple moyen d'assurer cette
fonction.
2. Les créations blockchain, l'ombre du
Bitcoin. Non seulement les définitions proposées de la blockchain
ont tendance à adopter le prisme exclusif de la blockchain publique,
mais plus encore c'est l'empreinte laissée par l'avènement du
Bitcoin qui semble avoir marqué les esprits. Cependant, a notre sens
c'est prendre un raccourci néfaste que d'affirmer que « Les
teneurs de registres sont appelés des mineurs270 »
ou que « le système de décalage aléatoire est
appelé « preuve de travail271 » ». Ces
illustrations des principes généraux de la blockchain qui usent
des particularités de la plus célèbre d'entre elles, le
Bitcoin, présentent le risque d'installer une confusion dans les
esprits. En effet, des notions telles que « le minage » ou
la « preuve de travail » peuvent, certes, constituer une
certaine norme en matière de cryptomonnaie272. Toutefois, ces
mécanismes sont bien souvent hors sujet quand il est question
d'application juridique, et non cryptofinancière, de la blockchain. Pour
une vulgarisation moins orientée Bitcoin de la notion de blockchain, il
faudrait s'en tenir à dire que toutes les blockchains ont besoin d'un
algorithme de consensus quel qu'il soit et que potentiellement cet algorithme
suppose une pratique telle que le minage273 de Bitcoin. Mais s'il
fallait anticiper le futur nous dirions que jamais les notaires de France
n'exploiteront de blockchain assise sur la « proof of work
», et pour cause ce modèle est l'apanage des blockchains publiques
(pensée pour se passer d'eux) là ou une blockchain privée
servirait éminemment mieux la vocation de cette
profession274.
Il faut souligner l'embarras du choix qui existe en
termes d'algorithme de consensus pour de futurs projets
blockchain275. Cet algorithme est d'ailleurs plus qu'un simple
rouage. À propos de la fonction de l'élaboration du consensus au
sein de la technologie blockchain, Laurent LELOUP écrit que «
C'est d'ailleurs de cet algorithme que dérivent la plupart des
propriétés du registre distribué276
». On peut en conclure que c`est parce qu'il a été
pensé en
269Ibid.
270Barbara THOMAS-DAVID et Jean-Luc GIROT, « La
blockchain expliquée autrement - Libres propos par Barbara Thomas-David
et Jean-Luc Girot », La Semaine Juridique Notariale et
Immobilière, LexisNexis, n° 2122, 25 mai 2018, act. 480, p.
2.
271Ibid.
272Précisions que même en ce domaine le
petit frère de Bitcoin, Ethereum, à déjà
signifié son ambition de passer de la preuve de travail à la
preuve d'enjeu en raison du coût énergétique exponentiel
décrié de cette méthode de consensus.
273Le « minage » de Bitcoin consiste
à se procurer un coûteux matériel informatique afin de
mettre sa puissance de calcul au service de l'élaboration du consensus
sur le réseau Bitcoin. Les mineurs concourent les uns contre les autres
pour trouver la réponse à un casse-tête informatique (il
s'agit d'ajouter des données à un bloque jusqu'à ce que le
passage de ce dernier dans la fonction de hashage donne un hash
commençant par une série de zéros). Plus la puissance de
calcul mondial augmente plus le réseau Bitcoin exige que les hash de ses
bloques commence par plus de zéro. Cette augmentation artificielle de la
difficulté du minage a pour but d'empêcher un mineur ou une
coalition de mineurs de s'emparer du consensus en fournissant la
majorité des block. Cette sécurité est renforcée
par le nombre de mineurs croissant, attirés par la récompense en
Bitcoin pour celui qui fournit le premier un block valide.
274Voir infra, Chap. 2, pour un développement
de la distinction blockchain privé, blockchain publique et une analyse
de leurs potentielles dans le milieu juridique.
275Pour préserver la cohérence
collective du registre, les solutions via différent algorithme de
consensus sont légion. Pour un tour d'horizon des consensus, voir
Laurent LELOUP, « Blockchain, la révolution de la confiance
», op. Cit., p. 98.
276Laurent LELOUP, « Blockchain, la
révolution de la confiance », op. cit., p. 92.
considération des propriétés
nécessaires à l'élaboration des systèmes de crypto
monnaie que l'algorithme de consensus via la preuve de travail est
difficilement transposable dans d'autres matières. Dès lors, on
ne peut que recommander aux juristes d'adopter une définition plus
générale de la blockchain en mettant de côté ce
particularisme du Bitcoin qui ne nous sera d'aucuns secours.
Pour notre projet par exemple il est souhaitable que
nous concluions cette définition générale en nous
concentrons sur les propriétés communes à toutes les
blockchains plutôt qu'a leurs différentes pièces
détachées. Pour certains, la force de la blockchain réside
dans le fait qu'elle permette « d'attester de manière
irréfutable et datée le moment où a été
effectuée une transaction : il s'agit d'une technologie d'horodatage
généralisée277 ». Ajoutons
l'éloge de son immutabilité : « il est impossible de
modifier ou de supprimer des écritures278 », et on
tient un portrait fidèle de cette technologie. Demandons-nous à
présent si nous voulons tailler notre registre des sûretés
mobilières de ce bois-là, l'essence de la blockchain se
pliera-t-elle à nos objectifs sans se rompre ?
Section 2 : Confrontation de la blockchain aux bases de
données traditionnelles.
Il existe un véritable effet de mode blockchain
dans le milieu juridique. Si bien que pour nous en garder nous devons nous
demander si une simple base de données ne serait pas à même
de remplir la fonction de registre efficace. Nous avons eu l'occasion de vanter
la nécessaire simplicité du réceptacle idéal, ainsi
devons-nous nous interroger. La création d'un registre distribué
supporté par un système blockchain est une complexification
substantielle de notre projet, la blockchain est elle porteuse d'atout
suffisant pour contrebalancer cet investissement ?
Pour distinguer l'une de l'autre, de manière
concise nous retiendrons qu'une base de données traditionnelle est un
système permettant d'enregistrer des informations de manière
centralisée, là où la blockchain est un système
permettant d'enregistrer des données de façon
décentralisée. De cet état de fait, nous pouvons tirer
plusieurs conséquences.
Dans une base de données classique,
l'autorité centrale est souveraine. Informatiquement du moins, elle a
tous les droits sur les données qu'elle héberge. Elle peut
détruire, modifier ou falsifier unilatéralement les
données uploadées par ses utilisateurs, même si elle risque
de devoir en répondre en droit. À l'inverse, au sein d'une base
de données distribuée, l'information est détenue par la
foule des pairs du réseau de sorte qu'une donnée inscrite ne peut
être ni supprimée ni modifiée unilatéralement par
personne. Enfin là ou une autorité centrale peut décider
d'une politique de confidentialité au sein de sa base de données,
une telle option est impossible dans un système blockchain où
tous les pairs, tous les noeuds du réseau, auront accès à
l'ensemble des informations.
D'une certaine manière, c'est l'intransigeance
de la blockchain qui fait sa force de certification. Si la confiance est
possible entre pairs, c'est parce que les membres du réseau ont la
conviction qu'aucun d'entre eux ne peut se hisser au-dessus des limitations
inhérentes aux lois de gouvernance du système. Cependant,
voilà, la confiance ainsi acquise paraît chère payé
dans le cadre de l'élaboration d'un registre des sûretés
réelles mobilières.
En effet pourquoi aurait-on des raisons de douter des
greffes des tribunaux de commerce, qui pourrait par exemple orchestrer une base
de données centralisée similaire à une version
perfectionnée de ce qui existe déjà avec le fichier des
gages sans dépossession ?
277Patrick WAELBROECK, « Les enjeux
économiques de la blockchain », dans Dardayrol (J.-P.),
(coordinateur), « Blockchains et smart contracts : des technologies de
la confiance », Réalités industrielles, annales des
mines, Série trimestrielle l, août 2017, p. 10.
278Laurent LELOUP, « Blockchain, la
révolution de la confiance », op. cit., p. 15.
Est-ce un problème si les greffes peuvent
arbitrairement supprimer tel avis ? Non bien au contraire, de prime abord on
pourrait tout à fait attendre de l'autorité qui gère la
base de données centralisée qu'elle fasse le ménage si
nécessaire en sa demeure.
Ajoutons que nous avons déjà soutenu la
recommandation de la CNUDCI visant à nier toute vocation probatoire aux
avis inscrits. Pour rappel, les avis n'emporteront ni la preuve ni même
la présomption de l'existence d'une sûreté. L'objectif de
la publicité efficace a toujours été à notre sens
d'informer les tiers de l'existence d'une sûreté potentielle,
ainsi par exemple on peut tout à fait se satisfaire d'inscription
superflue émanant d'inscription anticipée qui n'ont pas
donné suite à la constitution de sûreté. Pour
gérer ce problème, on pourrait prévoir un simple
délai à l'issue duquel une inscription obsolète doit
être supprimée par son auteur sous peine de sanction
financière279.
Finalement, n'est-ce pas céder aux
sirènes technocratiques que de s'en remettre à la blockchain
plutôt qu'à une base de données classique ? A contrario,
nous ne devons pas nous fermer trop vite à la douce mélodie des
promesses de la blockchain. Comme Ulysse à son mât, attachons-nous
encore quelques lignes à la simplicité d'un modèle bien
connu. Grâce à cette discipline forcée, nous pourrons
comparer deux modèles de registre informatisé avec la meilleure
objectivité possible, sans risquer de nous laisser emporter par
l'optimisme général qui entoure cette technologie.
1. Cette base de données en accès libre
et direct juste sous nos yeux. Le plus gros défaut que nous ayons pu
trouver au fichier national des gages sans dépossession est son absence
d'accès direct tant en écriture qu'en lecture, ce qui ne peut que
nuire à l'efficience du registre et augmenter ses coûts de
fonctionnement. Toutefois, ce défaut n'est pas inhérent à
l'ensemble des bases de données centralisées ! Prenons l'exemple
très connu d'une base de données centralisée qui a
relevé son pari fou de devenir la principale source d'information
produite et réviser collaborativement : Wikipedia.
Malgré son ambition collaborative et
participative, Wikipédia est bien une base de données
centralisée. C'est même de son mode de gouvernance empreinte d'une
forte hiérarchisation qu'elle tire sa fiabilité. En effet, «
Alors que quiconque peut devenir rédacteur sur Wikipedia, il n'en
reste pas moins que certaines pages, traitant de sujets faisant l'objet de
débats politiques, religieux, idéologiques, etc. font l'objet
d'une attention toute particulière de la part de Wikipedia et sont
soumise à une politique de protection280. »
Dès lors, seuls les utilisateurs qui ont montré patte
blanche281 recevront de l'autorité centralisée le
droit de modifier ces pages. « Lancé en 2001 par Jimmy Wales et
Larry Sanger, Wikipedia a été construit autour d'un projet
d'encyclopédie gratuite et participative s'appuyant sur un wiki. Ce
dernier point est essentiel à Wikipédia puisque c'est le «
logiciel » qui permet de collaborer collectivement sans
présence d'une personne en charge de valider282 ».
Nous y voilà, un modèle d'accès direct qui pourrait tout
à fait être transposé à l'usage du registre des
sûretés réelles mobilières.
Avant d'aller plus loin, nous devons définir ce
qu'est un « wiki ». « Un wiki est un site web permettant
à plusieurs utilisateurs de collaborer en ligne sur un même
projet. Le
279Nous avons déjà pu évoquer le
cas d'inscription malveillante visant à nuire à l'apparence de
solvabilité de celui qui est désigné abusivement comme
constituant. Une sanction plus lourde en cas d'inscription malveillante ou sans
fondement devrait suffire à décourager l'immense majorité
des utilisateurs du registre.
280Sébastien LOURADOUR, « Comprendre le
fonctionnement de wikipedia », Yellow vision, accessible sur le site
du magazine en ligne Yellow vision, :
http://yellowvision.fr/comprendre-le-succes-de-wikipedia/
281Wikipedia a constitué une hiérarchisation des
bénévoles, dont certains disposent de droits d'édition
très étendus, ibid.
282Ibid.
concept du wiki devient très populaire en
2000. À tout moment, ces utilisateurs peuvent contribuer à la
rédaction du contenu, modifier ce contenu et l'enrichir en
permanence283 ».
Première proposition : Le registre Wiki, le
registre partagé le plus basique.
Nous allons détailler les
fonctionnalités courantes des Wikis en les illustrant au travers de
l'utilisation concrète d'un registre des sûretés
réelles mobilières. Cette base de données serait
confiée entre les mains des greffes des tribunaux de commerce comme peut
l'être actuellement le fichier national des gages sans
dépossession.
Le créancier garanti devra commencer par la
création d'un compte utilisateur, ce sera une condition sine qua non
pour éditer ou créer un avis comme l'on peut créer ou
éditer une page sur n'importe quel wiki. Le créancier garanti
complétera un formulaire automatisé qui n'autorisera la
création d'une nouvelle page que si le créancier garanti respecte
certaines règles284. Si la page que le créancier
souhaite créer (autrement dit, l'avis qu'il souhaite inscrire) est
conforme aux exigences du registre, alors l'opération sera
instantanée. Sinon un message d'erreur invitera le créancier
garanti à réitérer son inscription. Pour ce qui est de
l'édition, seul l'auteur d'une page (d'un avis), et le personnel du
registre le cas échéant, disposeront des droits pour
procéder à une modification. Entre autres fonctionnalités
un wiki permet la gestion de l'historique des modifications depuis la
création de la page, ainsi le fait de laisser à un
créancier garanti la liberté de modifier leurs avis n'est pas
préjudiciable à la sécurité du
registre285. L'un des avantages majeurs de ce système est la
facilité avec laquelle un créancier garanti pourra corriger (sans
frais) une éventuelle erreur lors de la saisie d'un avis. Toutefois si
l'erreur lors de l'inscription est telle286 qu'elle prive de toute
utilité pour les tiers cette formalité obligatoire de
publicité, nous recommandons de reporter la date de
l'opposabilité de la sûreté à la date de sa
correction.
Pour ce qui est de la recherche, nous recommandons
l'utilisation d'un moteur de recherche par mots-clefs. Un utilisateur devrait
être capable d'obtenir sans difficulté un affichage de l'ensemble
des avis (des pages) mentionnant le nom qu'il a utilisé dans leurs
rubriques : « constituant ». Comme nous avons pu le souhaiter plus
haut, il doit également être possible d'effectuer une recherche
par numéro de série dans le cas des biens facilement
identifiables. À contrario la rubrique : « créancier garanti
», bien que faisant partie des mentions obligatoires lors de l'inscription
ne serait pas incluse dans le champ d'action de l'algorithme de recherche.
Cela, comme nous avons pu l'évoquer précédemment, afin de
protéger la confidentialité de la clientèle des
prêteurs professionnels.
2. Les atouts à doubles tranchants de la
blockchain. Même si l'on peut se montrer prudent vis-à-vis de
l'enthousiasme général autour de cette technologie, le bon sens
nous
283Marie LEBERT, « Booknologie : Le livre
numérique (1971-2010) », Project Gutenberg ebook, accessible
en ligne :
http://www.gutenberg.org/ebooks/33462
284L'algorithme gérera l'acceptation ou le
refus de tel ou tel formulaire. Il prévoira que tout formulaire
incomplet, ne contenant pas les données minimales exigées dans un
avis, par exemple, sera rejeté. Plus important encore l'algorithme
prohibera toute antidatation, si d'aventure un créancier garanti
éprouve le besoin d'inscrire sa sûreté avant d'autres via
un astucieux voyage dans le passé.
285Afin d'assurer la sécurité de ce
registre, notamment contre les tentatives de piratage, il sera important
d'extraire quotidiennement un recueil de l'historique des éditions et
modification. Ce faisant, nous soustrairons au réseau internet un
historique des inscriptions qui fera foi au cas où quelqu'un
accaparerait frauduleusement des droits de modification contraires aux
règles du registre.
286Une erreur sur la personne du constituant ou une
confusion entre plusieurs meubles ayant empêché toute description
utile des biens grevés par exemple.
dicte de ne pas sombrer dans l'excès inverse en
sous-estimant les opportunités qu'elle apporte. Certes, nous avons
cerné un problème majeur287 quant à
l'utilisation de cette technologie dans le cadre d'un registre des
sûretés réelles mobilières. Cependant si la
blockchain montre des atouts suffisant pour nous inviter à poursuivre
nos investigations, il sera toujours temps de chercher une réponse
à cette problématique technique288. Faisons un bref
rappel, pour le meilleur et pour le pire des propriétés
principales de la blockchain en matière de registre :
L'Immutabilité. On ne le dira jamais assez,
« une blockchain est une base de données à laquelle on
ne peut que faire des ajouts : la seule possibilité est d'ajouter de
l'information, dans l'ordre chronologique ; il est impossible de modifier ou
supprimer une information une fois qu'elle est
enregistrée289 ». Ainsi stocker des données
personnelles où des informations dont l'utilité a
nécessairement une durée de vie limitée (comme les avis)
est généralement une mauvaise idée. A contrario, s'il y a
bien une donnée que l'on veut impérissable et infalsifiable c'est
bien l'historique des inscriptions, modifications et radiations des avis. Ce
serait précisément cet historique qu'il faudrait graver dans le
marbre de la Blockchain. On touche là à la faiblesse majeure du
registre wiki que nous avons proposé plus tôt. Certes, ce
modèle brille par sa flexibilité et l'aisance qui
caractérisent son usage, cependant l'ordre des inscriptions, et en
règle générale l'intégrité du registre, sont
des points qu'il faudra constamment surveiller. En effet, les bases de
données centralisées traditionnelles on déjà fait
montre de leurs flexibilités face aux cyber attaques de toute sorte.
Évidemment, le meilleur moyen de sauvegarder une information de ce type
de corruption est de l'extraire du réseau afin de la conserver hors
d'atteinte des pirates écumants les flots de l'internet. Toutefois,
cette solution s'avère contraignante sans pour autant demeurer exempte
de toute suspicion. En effet pour sauvegarder l'historique des inscriptions de
cette menace, le personnel du registre devra extraire du réseau une
copie certifiée à intervalle régulier afin de la
sauvegarder au sein d'un réseau local de manière
régulière. À ce stade et en considération de
l'enjeu que peut représenter l'opposabilité ou la
non-opposabilité d'une sûreté on ne saurait réduire
le risque de corruption ou de pression sur le personnel du registre. La nature
disruptive de la blockchain réside dans sa capacité à
tirer un trait sur cette question. Une fois, une inscription
réalisée à une date et à une heure donnée
nul ne saurait se dédire. La blockchain par bien des aspects peut
paraître exigeante et coûteuse pour qui veut créer un simple
registre des sûretés réelles mobilières, mais il
semble bien que ce prix soit celui de l'inviolabilité. A Blockchain is
forever.
Le consensus distribué. Deuxième
propriété marquante de la blockchain qui n'arrange pas nos
affaires pour ce qui est de l'élaboration du registre efficace. La
blockchain a historiquement été pensée pour instaurer une
confiance entre de parfaits anonymes. Pour accomplir son miracle, la blockchain
Bitcoin a inventé la preuve de travail. Même si d'autres
algorithmes de consensus arrivent sur le devant de la scène ils ne
pourront jamais correspondre à nos besoins. Car ils ont justement
été pensés pour accomplir la lourde tâche de se
passer de tiers de confiance. Or cet objectif est totalement
disproportionné vis-à-vis de nos besoins, car nous avons des
tiers de confiance sous la main.
De prime abord, on pourrait croire que la blockchain
est profondément inadaptée à la
287Le fait qu'il soit impossible de modifier ou de
supprimer des données au sein d'une blockchain s'oppose à
l'inscription directe d'avis sur une base de données
décentralisée. Les avis ayant vocation à être
modifié puis radié aisément il est impossible de se servir
de la blockchain pour stocker efficacement ces données.
288Voir infra X.
289Primavera DE FILIPPI, Michel REYMOND, «
Blockchain et droit à l'oubli », dans T. NITOT, N. CERCY,
Numérique: reprendre le contrôle, novembre 2016,
Framasoft, n° 1, P.138 et s. accessible en ligne :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01676888
fonction de registre. Cependant, c'est un simple effet
d'optique due à la prépondérance des blockchains Bitcoin
et Ethereum. Ce monde est plus vaste qu'on peut se le figurer en tournant le
regard vers l'horizon des crypto monnaies. En vérité, la
blockchain est plurielle et la pesanteur des algorithmes de consensus n'est que
le propre des Blockchain publiques. La vérité est
ailleurs.
- CHAPITRE 2 -
LES BLOCKCHAINS.
Les blockchains publiques comportent de multiples
caractéristiques qui les rendent impropres à l'usage que nous
voudrions en faire. Leur construction qui suppose un accès libre et
anonymisé suppose une élaboration du consensus ultra
sécurisé qui ne convient pas au registre dénué de
vocation probatoire que nous avons pu présenter tout au long de cette
étude. C'est pourquoi nous ne pouvons que constater
l'inadaptabilité de la technologie des blockchains publiques à
notre projet de registre des sûretés réelles
mobilières (Section 1). Toutefois, chacun des reproches que nous ferons
aux blockchains publiques pourra être contrebalancé par l'une des
qualités de la technologie des blockchains privées que nous avons
retenue. Ainsi notre proposition finale nous amènera à nous
inspirer du permissioned ledger mis en place des septembres afin de
perfectionner le registre du commerce et des sociétés (Section
2).
Section 1 : Le constat de l'inadaptabilité de la
blockchain publique aux problématiques du registre des
sûretés réelles mobilières.
1. La blockchain publique. En définitive, il
n'y a qu'une reine. Quand Laurent LELOUP évoque la blockchain publique,
la première à avoir vu le jour, il nous confie que « Les
puristes considèrent que seul le singulier s'applique à cette
technologie : on parle alors de la blockchain290 ».
Cette blockchain fait peu de cas de l'identité de ceux qui la font
vivre. C'est le propre d'une blockchain publique, « C'est un registre
(ledger) ouvert à tous. Cette blockchain se caractérise par son
ouverture totale : tout le monde peut y accéder et effectuer des
transactions et tout le monde peut participer au processus de
consensus291 ». Dans le détail, « Son
fonctionnement est fondé sur les « cryptoeconomics »,
c'est-à-dire la combinaison d'incitations économiques et les
mécanismes de vérification en utilisant la cryptographie comme
une preuve de travail (PoW) ou preuve de la participation
(PoS)292 ». C'est caractéristique technique et ses
propriétés sont profondément disruptive, et pour cause
« C'est le modèle le plus connu, celui qui est à
l'origine de la technologie, selon une approche communautaire, voire
alternative, de l'économie293 ».
C'est aussi le modèle auquel nous nous
intéresserons le moins. Du fait de l'idéologie libertaire qui a
présidé à sa création, la blockchain publique est
loin d'avoir été taillée sur mesure pour faire bon
ménage avec l'économie de notre siècle. On peut
aisément dresser un parallèle avec l'invention d'internet, une
innovation qui devait faire souffler un vent de liberté inédit au
profit des individus et qui de plus en plus se mue en un outil de
contrôle entre les mains des GAFAM294. La blockchain publique
n'a pas révolutionné l'ordre des choses, c'est l'ordre des choses
inébranlable qui a réformé la blockchain pour en faire son
outil : la blockchain privée.
La première illustration qui viendra à
l'esprit quand on évoquera la blockchain est évidemment
le Bitcoin, prince aîné de la lignée crypto monnaie. La
blockchain Bitcoin à vocation à certifier les transactions de la
monnaie du même nom, par conséquent elle a
290Laurent LELOUP, « Blockchain, la
révolution de la confiance », op. cit., p. 93.
291Ibid.
292Ibid.
293Ibid.
294L'acronyme des mastodontes du web, Google, Apple,
Facebook, Amazon et Microsoft.
vocation à apporter la preuve de la
propriété de ce bien fongible et consomptible. Autre
caractéristique notable, cette blockchain ne s'intéresse pas
à l'identité des utilisateurs de Bitcoin295,
l'anonymat faisant partie intégrante de l'idéologie du projet de
son fondateur, le mystérieux Satoshi Nakamoto. Tant et si bien que lui
même disparut dans les méandres de l'internet sans que jamais sa
véritable identité ne soit révélée au grand
jour296.
En pratique, pourquoi voudrions-nous tailler notre
registre des sûretés mobilières sur une base de blockchain
publique ? Nous avons vu que l'usage de la blockchain en tant que registre des
sûretés mobilières exige de nous que nous résolvions
plusieurs difficultés liées à la nature de toute
blockchain. Dans ce chapitre, nous découvrons que la blockchain qui
bénéficie de la plus grande ferveur médiatique, la
blockchain publique et sa cohorte de crypto monnaie, pose des
difficultés supplémentaires.
Premièrement, il faut savoir que moins les
membres du réseau se connaissent et se font confiance, plus il faut
adopter un système d'élaboration du consensus contraignant. Un
algorithme proof of work serait un gouffre financier et
énergétique qui ne nous assurerait même pas une
sécurité suffisante. En effet, vu l'état de la puissance
de calcul à travers le monde et sa constante augmentation boosté
par l'appât du gain de Bitcoin, notre petit système serait une
proie facile. On peut imaginer un algorithme de consensus basé sur une
preuve d'enjeu297. En lieu et place du dépôt de
cryptomonnaie, l'enjeu serait la valeur totale des sûretés
inscrite au registre. Plus la valeur d'une créance garantie serait
haute, plus le créancier correspondant aurait de chance d'être
désigné par l'algorithme de consensus pour valider le prochain
bloc. Mais cette alternative nous montre le véritable problème,
un tel système exigerait des agents économiques une participation
on ne peut plus active à la blockchain registre, ce qui suppose des
récompenses élevées que le registre n'est pas en mesure de
fournir. Nous recommandons donc d'abandonner totalement l'idée d'un
registre des sûretés mobilières basé sur une
blockchain publique.
2. La solution des blockchain privés. Avant de
s'intéresser aux questions techniques, il faut opter pour ce premier
choix. Le registre des sûretés réelles mobilières
bénéficiera de l'appui d'une blockchain privé ou devra
être pensé sans cette technologie. Cette décision se
justifie au regard des caractéristiques particulières des
blockchains privées. « Si la blockchain publique
représente une solution de confiance décentralisée pour
beaucoup, la blockchain
295Question qui a pu susciter autant
d'inquiétude légitime que de fantasmes quant à
l'utilisation du Bitcoin lors de transaction illicite. Même si on ne
saurait dire là où s'arrête la réalité et
où commence la fiction, l'ombre de Silk Road (le marché noir du
darknet où les échanges monétaires usés du Bitcoin)
et de ses successeurs plane encore sur les crypto monnaie.
296« Le 12 décembre 2010, un dernier
message est posté par Nakamoto sur le forum Bitcointalk. Peu de temps
avant son évanescence, Nakamoto désigne Gavin Andresen comme son
successeur en lui donnant accès au projet SourceForge Bitcoin et une
copie de la clé d'alerte, une clé cryptographique privée
unique permettant d'atténuer les effets d'une attaque potentielle sur le
système Bitcoin. », Laurent LELOUP, « Blockchain, la
révolution de la confiance », op. cit., p. 33.
297« La preuve d'enjeu est un algorithme de
consensus pour blockchains publiques (...) Le mécanisme de la preuve
d'enjeu peut être décrit comme un «minage virtuel ».
Là où la preuve de travail prévient efficacement les
attaques Sybil en se fondant sur la rareté et le coût du
matériel informatique, la preuve d'enjeu repose sur la crypto monnaie de
la blockchain elle-même. Avec la preuve de travail, un participant peut
investir 1 000 dollars dans un ordinateur de minage, le brancher, commencer
à participer au réseau en produisant des blocs et recevoir une
récompense. Avec la preuve d'enjeu, le même participant investit 1
000 dollars en achetant directement la cryptomonnaie de la blockchain puis met
en dépôt ces crypto monnaies en utilisant le mécanisme de
preuve d'enjeu, qui va ensuite (pseudo-)aléatoirement assigner à
ce participant le droit de produire des blocs et de recevoir une
récompense », définition par Ethereum France, 3 janv.2017,
mis à jour le 29 avr.2018, accessible en ligne sur le site d'Ethereum
France :
https://www.ethereum-france.com/quest-ce-que-la-preuve-denjeu-proof-of-stake-faq-par-v-buterin-traduction-francaise/
privée peut être complètement
centralisée entre un petit nombre d'acteurs, prenant le contrepied du
rêve libertaire de la blockchain publique298 ». Bien
que cette centralisation ne soit pas vertueuse en elle même, elle a le
mérite de nous dispenser de la recherche d'une solution coûteuse
d'élaboration du consensus, ce qui demeure l'une des
problématiques majeures des blockchains publiques. En effet en
matière de blockchain privé « le processus de consensus
est contrôlé par un ensemble présélectionné
de noeuds (participants)299 ». C'est cet entre-soi qui
permet le recours à un algorithme de consensus bien plus
souple.
Du côté des inconvénients de
telles blockchains, on relèvera que « Dans le cas d'une
blockchain publique, tous les noeuds sont autorisés à
écrire dans celle-ci, et à y lire les données. À
l'opposé, seul un petit nombre de noeuds sont autorisés à
écrire dans une blockchain privée300 ».
Autrement dit, cette caractéristique va à l'encontre du projet
d'un registre en accès direct en lecture comme en écriture que
nous avions préconisé. Toutefois, on peut tout à fait
imaginer un système d'autorisation d'écriture qui reposerait sur
des critères automatisés, une sorte d'algorithme d'autorisation.
Et pour ce qui est de la lecture au sein des blockchains privées il est
possible de restreindre les autorisations de lecture.
Ce dernier point fait figure d'atout majeur à
considérer dans l'élaboration de notre projet de registre. En
effet, « L'une des différences majeures entre blockchain
privée et blockchain publique est liée à la
confidentialité des smart contracts, des transactions et des
données ». Ainsi « il est relativement facile de
garantir la confidentialité des données stockées dans des
blockchains privées, puisque seul un nombre limité d'acteurs peut
y avoir accès301 ». À l'inverse, «
Les données stockées dans les blockchains publiques sont au
contraire accessibles à tous, puisqu'il s'agit de construire un registre
public décentralisé302 ». Opter pour un
système de blockchain privée c'est la garantie que nous pourrons
protéger des informations, tel que le détaille de la
clientèle des prêteurs, qui n'ont pas vocation à être
révélés par notre registre.
Une prédiction décline à mesure
qu'une prise de conscience prend forme : Non la blockchain ne remplacera pas
les tiers de confiance. On eût pu encore le penser lors du plein essor
des blockchains publiques, qui avait en effet cette prétention
révolutionnaire. Cependant même si la blockchain porte en
elle le germe de ce potentiel disruptif on comprend que ce monde sans
intermédiaires ne verra jamais le jour. La raison en est très
simple, les blockchains publiques ne peuvent s'épanouir hors de leurs
espaces alternatifs. Une plus grande ou une plus petite échelle sont
pour elles des mondes inaccessibles. En effet, on ne voit pas comment, à
grande échelle, nous pourrions tous commercer en Bitcoin alors
même que cette blockchain commence déjà à
souffrir303 de son manque de scalabilité304.
À l'autre bout du spectre, à petite échelle, les
blockchains publiques doivent faire face à une concurrence dont elles ne
peuvent triompher : les blockchains privées. En effet si l'on souhaite
créer une blockchain pour un petit nombre de membres, potentiellement
des personnes qui se connaissent il est hors de question de baser le projet sur
une blockchain
298Patrick WAELBROECK, « Les enjeux
économiques de la blockchain », préc., p.13.
299Laurent LELOUP, « Blockchain, la
révolution de la confiance », op. cit., p.94.
300Patrick WAELBROECK, « Les enjeux
économiques de la blockchain », préc., p. 10.
301Ibid., p. 13.
302Ibid.
303« Le passage à l'échelle est
difficile sur une blockchain publique utilisant un consensus basé sur le
proof-of-
work (comme celui utilisé par le réseau
Bitcoin), puisque celui-ci demande un hash-power qui croît avec la
taille
du réseau et nécessite plusieurs
validations avant l'ajout d'un nouveau bloc, ce qui peut prendre une heure
»,
ibid.
304La scalabilité est la capacité d'un
réseau ou d'un système à adapter son fonctionnement
à une augmentation
de la demande.
publique. Enfin, la fonction des tiers de confiance
est éminemment plurielle, elle ne s'arrête pas à une simple
question de certification. On s'en rend compte aisément quand on
considère les mésaventures des aventuriers du Bitcoin, qui aurait
sans nul doute tiré un grand bénéfice de la fonction de
conseil associé à la mission du banquier. Dès lors, ces
intermédiaires, s'ils sont capables d'ajouter un minimum de valeur
ajoutée à leurs services, ne seront pas remplacés.
Pourquoi le serait-il dans la mesure où ils peuvent eux même
exploiter tous les attraits de la blockchain via une blockchain privée ?
Peut-être la blockchain aura-t-elle un impact retentissant dans
les pays du tiers monde où l'on peut douter de l'intégrité
de certains intermédiaires, toutefois il semble plus raisonnable de
considérer que « dans nos pays développés,
où les tiers de confiance existent, les usages seront différents.
Les blockchains ne les remplaceront pas, bien au contraire, elles les outillent
afin d'améliorer leur productivité et la rentabilité des
entreprises qui les adoptent.305 »
Section 2 : L'exemple du permissioned ledger, une
blockchain privée expérimentée par IBM et les greffes des
tribunaux de commerce.
Difficile de se frayer un chemin dans la jungle des
blockchains. Heureusement, nous pouvons compter sur d'audacieux
éclaireurs hexagonaux. Ainsi, « Le Conseil national des
greffiers des tribunaux de commerce a annoncé le 15 mars dernier le
déploiement d'un réseau blockchain développé par
IBM afin d'améliorer la gestion du R.C.S.306 ».
Cette actualité fortuite est une aubaine pour notre étude. Bien
que le projet soit encore nébuleux, sa seule mise à l'essai
confirme le potentiel de la blockchain en matière de publicité
légale. Commençons par cerner les points communs et les
différences entre les vocations du R.C.S. et d'un registre des
sûretés réelles mobilières, afin de définir
la mesure de l'inspiration que nous pouvons tirer de ce projet. Puis,
grâce aux détails techniques glanés grâces aux
différentes sources d'actualité juridiques et la communication
d'IBM, nous proposerons une brève phase de
rétro-ingénierie qui débouchera sur notre seconde
proposition de registre.
1. Registre du commerce et des sociétés
et registre des sûretés réelles mobilières, des
registres voisins ? En jetant un bref regard à la table des
matières de l'ouvrage « publicité légale
» de Pascal BEDER307 on soupçonne d'entrée
la mitoyenneté qui peut exister entre le registre du commerce et des
sociétés et le registre des sûretés
mobilières dont nous avons besoin. L'auteur propose une distinction de
la publicité légale en deux notions déduite de leurs
objets respectifs. Ainsi traite-t-il dans un premier chapitre de « «
la publicité légale de l'état civil » de
l'entreprise308 » tandis que la «
Publicité propre à l'état de « santé
» et publicité de la défaillance de
l'entreprise309 » sont décrites dans un second
chapitre où il est question tant de la publicité des
sûretés réelles mobilières que de la
publicité relative aux difficultés des entreprises au
R.C.S.
Le premier chapitre nous renseigne quant au
fossé qui peut exister entre le registre du commerce et des
sociétés et le registre des sûretés
mobilières tel que nous l'imaginons. En
305Barbara THOMAS-DAVID et Jean-Luc GIROT, « La
blockchain expliquée autrement - Libres propos par Barbara Thomas-David
et Jean-Luc Girot », préc. p. 2.
306Vincent FOURNIER, Philippe BOBET, « La
blockchain se déploie dans les greffes des tribunaux de commerce, Focus
sur une première dans le secteur judiciaire, développée
par IBM », Journal Spécial des Sociétés, 6
avr. 2019, numéro 27., P.4.
307Pascal BEDER, « Publicité
légale », op. cit.
308Ibid.
309Ibid.
effet, une grande part de la raison d'être du
registre du commerce et des sociétés trouve son origine dans
l'encadrement de la personnalité morale des entreprises et dans
l'identification à fin de contrôle des entreprises personne morale
comme physique. Voilà autant de fonctions qui sont
étrangères à la vocation des registres des
sûretés réelles mobilière. On peut donc
légitimement conclure que si le recours à la blockchain à
était décidé pour perfectionner ces fonctions du R.C.S.
alors cette innovation ne nous sera d'aucun secours quant à notre
projet.
Ainsi il faut admettre, au moins dans une certaine
mesure, que ces deux registres ont des vocations distinctes, mais cela
débouche-t-il nécessairement sur des blockchains
foncièrement différentes ?
Un article traitant de cette actualité
évoque « Le rapprochement des greffiers, garants de la
diffusion d'une information certifiée relative à la vie des
entreprises, et de la technologie blockchain310 ». On
constate une distinction importante, l'information du R.C.S. est
certifiée. Ce n'est pas le cas de l'information du registre des
sûretés réel mobilière tel que nous l'avons
imaginé. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, il
n'est pas souhaitable que le contenu des avis intègre une blockchain,
dans la mesure où ils n'ont vocation qu'à informer les tiers
quant à la présence fort probable d'une sûreté
grevant un bien meuble sans pour autant prétendre à une
quelconque vocation probatoire. On peut en conclure qu'une blockchain servant
l'intérêt du registre des sûretés réelles
mobilières sera probablement beaucoup moins volumineuse que la
blockchain pensée pour perfectionner le registre du commerce et des
sociétés.
On nous informe également que « Les
mises à jour du registre (du R.C.S.) peuvent concerner les
ressorts géographiques de plusieurs tribunaux de commerce,
nécessitant de fait une coordination entre les différents
greffes311 ». Les articles présentent cette
coordination entre les greffes comme l'une des principales raisons du
développement de cette blockchain entre greffiers. Cette
problématique ne se pose pas dans le cadre de notre projet.
L'enregistrement des documents constitutif de la sûreté
auprès des greffes compétentes géographiquement (les
greffes du tribunal de commerce du lieu de résidence du constituant) n'a
pas de sens dans le système d'inscription par simple avis au sein d'un
registre totalement dématérialisé. Ainsi blockchain
où non, nous considérons que tout problème de
compétence géographique à déjà trouvé
matière à solution lors de nos précédentes
recommandations.
Le second chapitre de l'ouvrage de Pascal BEDER,
à l'inverse du premier, nous permet de dresser un pont entre les deux
registres malgré leur tranchée mitoyenne. En effet, nous faisons
nôtre l'analyse de cet auteur qui a choisi d'aborder la publicité
des sûretés réelles mobilière dans le même
chapitre que les formalités obligatoires de publicité dans le
cadre des procédures collectives publiées au R.C.S. Ce choix nous
paraît on ne peut plus cohérent, car publicité des
sûretés réelles mobilière et publicité des
mesures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire partagent un
objectif commun. Nous avons déjà démontré que la
publicité légale des sûretés réelles
mobilières a en effet pour rôle d'informer une multitude de
tiers312 (dont les créanciers chirographaires) quant à
l'état de santé économique de l'entreprise du constituant.
Les créanciers non privilégiés pourront ainsi
évaluer la capacité du constituant à honorer ses
obligations les concernant directement. Il s'agit là d'une mission
essentielle de la publicité des sûretés réelles
mobilières visant à assurer à chacun une
prévisibilité et une transparence maximale quant à
l'aggravation de sa situation313. Du côté du R.C.S.,
les
310CNGTC, communiqué de presse, 14 mars 2019,
accessible en ligne sur le site du CNGTC :
https://www.cngtc.fr/fr/actualites.php
(consulté le 20 août 2019).
311Ibid.
312Qui ne saurait être réduite aux seuls
créanciers garantis et sous acquéreur potentiel.
313Voir supra (Partie 1, Titre 2, Chapitre 1, Section 1 :
« Aider le tiers à anticiper l'aggravation de sa
situation
formalités obligatoires de publicité des
procédures collectives ne poursuivent pas une mission différente.
La discipline collective qui s'abat comme une chape de plomb, l'entrée
en jeu de concurrents invincibles en la personne des super
privilégiés, voilà autant d'aggravation de la situation
des créanciers dont il faut les informer au plus
tôt314.
En raison de cet objectif commun, toute innovation de
nature à améliorer l'efficacité de la publicité
légale inhérente aux procédures collectives est adaptable
en un progrès de l'information des tiers dans le cadre de la
publicité des sûretés réelles
mobilières.
En raison du sujet de cette étude, nous avons
donc hâte que la blockchain pensée par IBM et les greffes des
tribunaux de commerce fasse ses preuves. Pour ce qui est de l'après, la
rubrique actualité du site de la société d'édition
Wolters Kluwer rapporte d'intéressants propos tenus par le
président honoraire des greffes des tribunaux de commerce. Monsieur
Philippe Bobet a déclaré qu'après « une phase de
découverte et de déploiement de la solution qui vient de
commencer et qui va se terminer à la fin de
l'année315 » il serait temps de faire le point
« pour savoir si d'autres projets pourraient se greffer
autour316 ».
Nous avons bien une idée de projet à
greffer autour de la blockchain du registre du commerce et des
sociétés. Il s'agirait d'un modeste espace dédié au
stockage de l'historique des inscriptions, modifications et radiations d'avis
d'un registre informatisé et global des sûretés
mobilières. Une fois cette solution mise en place, il sera temps de
remplacer le fichier national des gages sans dépossession par
l'interface autofinancée par la publicité commerciale de notre
registre.
Le registre du commerce et des sociétés
et le registre global des sûretés mobilières, poursuivant
des objectifs communs et ayant tous deux vocation à être
confié aux greffes des tribunaux de commerce, on ne comprend pas
pourquoi il ne pourra pas faire l'objet d'un outil de gestion blockchain en
partie commun.
Une sûreté réelle
mobilière, pour tout type de bien et un seul registre pour en assurer la
publicité, voilà un excellent début. Unir la
publicité légale, de l'inscription d'une sûreté
à l'annonce de l'ouverture d'une procédure collective, au sein
d'un unique réseau blockchain voilà un bel horizon.
2. Notre projet. Que ce soit pour penser une future
greffe de l'historique des inscriptions du registre des sûretés
mobilières à la blockchain R.C.S., ou pour imaginer une
blockchain indépendante qui s'inspirerait de ce modèle, nous
devons étudier la solution mise en place par le Conseil national des
greffes des tribunaux de commerce.
Seulement voilà, cette étude touche
à sa fin et le temps qui nous était imparti pour la
réaliser nous file entre les doigts. On pourrait s'en chagriner tant les
prochains mois s'avèrent riches en retour d'expérience quant
à l'usage de la blockchain en matière de publicité
légale. Malgré tout, la sagesse des stoïciens antique nous
enjoint à ne pas nous troubler de ce qui ne dépend pas de nous
pour mieux tourner nos efforts vers les oeuvres du champ des
possibles.
Ainsi dans l'espoir de glaner des détails
techniques quant à la blockchain mise sur pieds par IBM et les greffes
des tribunaux de commerce nous avons dans un premier temps
écumé
»), pour une démonstration de l'effet que
peut avoir la souscription d'une sûreté réelle sur les
chances des créanciers chirographaires d'être intégralement
désintéressé en cas de défaillance du
constituant.
314Ne serait-ce que pour qu'ils puissent déclarer
leurs créances.
315« L'objectif est d'avoir une blockchain
complète et exhaustive, destinée uniquement aux greffiers,
accessibles à tous les greffiers de France », Propos de Philippe
BOBET rapporté par le site d'actualité juridique
:
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/affaires/societes-et-groupements/20848/la-blockchain-au-soutien-du-rcs-les-greffiers-des-tribunaux-de-commerce-deploient-leur-solution
316Ibid.
Wolters Kluwer (consulté le 10 août
2018), accessible en ligne
Wolters Kluwer (consulté le 10
août
:
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/affaires/societes-et-groupements/20848/la-blockchain-au-soutien-du-rcs-les-greffiers-des-tribunaux-de-commerce-deploient-leur-solution
2018), accessible en ligne
les sites et les revues d'actualité juridiques.
Puis nous avons étudié le propre communiqué de presse du
Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. De ces recherches
nous avons retenu que cette blockchain a été « mise en
oeuvre avec le protocole Hyperledger Fabric317 » et que le
dispositif sera « une blockchain de consortium (permission)
318». Grâce à ces informations, nous
proposerons une solution technique aux deux problèmes majeurs que nous
avons identifiés quant à la création d'une blockchain pour
le registre des sûretés réelles mobilières. En
partant des mêmes bases que les instigateurs du projet de blockchains
R.C.S. et en considérant que ces deux registres sont voisins, il est
fort probable que nous aboutissons à des solutions voisines.
Que pouvons-nous déduire de ce que nous avons
appris ? Premièrement qu'est-ce que le projet Hyperledger Fabric ? On
sait que « IBM a réalisé la plateforme en s'appuyant sur
son expertise dans le domaine de la blockchain et de la cryptographie, et en
utilisant le protocole Hyperledger Fabric, géré sous
l'égide de la fondation open source Linux319 ». Il
faut comprendre que ce « projet n'a pas pour but de mettre en place un
registre partagé directement utilisable, mais plutôt de mettre
à disposition des entreprises les piliers fondateurs pour construire des
blockchains « business-ready » (prêtes à
être utilisées par l'entreprise)320 ». Nous
n'avons qu'une ébauche (voire annexe 1) de l'oeuvre, toutefois nous
pouvons à présent parfaitement cerner l'outil qui procéda
à sa création. En effet, les projets menés grâce
à Hyperledger Fabric sont légion321. Et même si
les détails de l'architecture du réseau blockchain du R.C.S. ne
nous sont pas encore accessibles, rien ne nous empêche de chercher
d'autres modèles issus du même moule afin de trouver celui qui
siéra à notre registre idéal.
Grâce à la seconde information que nous
détenons, nous savons que c'est une blockchain de consortium qui a
été choisi. Nous pouvons réduire le champ de nos
recherches en supposant que ce type de blockchain qui s'adapte aux exigences
d'une forme de publicité légales pourra sûrement satisfaire
les objectifs d'une autre. Notons que cette blockchain de consortium a «
été choisie, parce qu'elle permet un contrôle sur les
accès et la manière dont la gouvernance est
articulée322 ». Autrement dit « Dans un
permissioned ledger, à la différence d'une blockchain publique
(comme le sont par exemple les monnaies cryptographiques Bitcoin et Ethereum),
seuls des acteurs autorisés peuvent participer au
317CNGTC, communiqué de presse, 14 mars 2019,
accessible en ligne sur le site du CNGTC :
https://www.cngtc.fr/fr/actualites.php
(consulté le 20 août 2019) .
318« L'objectif est d'avoir une blockchain
complète et exhaustive, destinée uniquement aux greffiers,
accessibles à tous les greffiers de France », Propos de Philippe
Bobet rapporté par le site d'actualité juridique
Wolters Kluwer (consulté le 10 août 2018),
accessible en ligne :
https://www.actualitesdudroit.fr/browse/affaires/societes-et-groupements/20848/la-blockchain-au-soutien-du-rcs-les-greffiers-des-tribunaux-de-commerce-deploient-leur-solution
319Ibid.
320Laurent LELOUP, « Blockchain, la
révolution de la confiance », op. cit., p. 109.
321« IBM est un des premiers membres fondateurs
d'Hyperledger, un projet de développement collaboratif open source
créé afin de faire progresser les technologies blockchain
interindustries », annonce IBM (consulté le 6 août 2018),
accessible en ligne :
https://www-03.ibm.com/press/fr/fr/pressrelease/54825.wss
C'est parce que ce projet est « open source
» que nous allons facilement pouvoir trouver de nombreux exemples de
réseaux blockchain mis au point par différents agents
économiques.
322« L'objectif est d'avoir une blockchain
complète et exhaustive, destinée uniquement aux greffiers,
accessibles à tous les greffiers de France », Propos de Philippe
Bobet rapporté par le site d'actualité juridique
consensus en devenant un noeud du
système323». Après notre analyse de
l'impraticabilité des blockchains publiques en matière de
publicité légale, on ne peut que se féliciter de ce choix
d'une blockchain privée.
Enfin, conclusion de nos investigations, la blockchain
mise au point pour servir l'efficacité du R.C.S. partage avec la
blockchain que nous imaginons pour le registre des sûretés
mobilières le souci de résoudre deux problèmes
fondamentaux que nous avons détaillés précédemment.
Premièrement, il est impossible de stocker des documents volumineux sur
une blockchain, car elle n'a pas été pensée pour cela.
Deuxièmement, il est impossible de mettre à jour ou supprimer un
document sur la blockchain. Ce point qui fait toute la fiabilité de ce
dispositif confine aux pourrissements de document obsolète qui
s'entasseront à l'infini sur un blockchain qui finira par crouler sous
leurs poids.
Il n'y a qu'une réponse possible à ces
deux problématiques. Il ne faut stocker sur la blockchain que les
données qui le méritent, des données qui seront
perpétuellement pertinentes. En pratique, cela signifie qu'il ne faut en
aucun cas stocker les avis de notre registre des sûretés
mobilières sur une blockchain. Il faut stocker uniquement l'historique
des inscriptions qui conservera sa véracité et son utilité
malgré la valse des inscriptions, modifications et radiations des
avis.
Pour parvenir à cet objectif, on peut passer
par plusieurs modalités techniques. Le filtrage et la
délocalisation des données. Grâce au schéma
rudimentaire (Annexe 1) que nous avons eu du communiqué de presse du
conseil national des greffes des tribunaux de commerce, nous savons qu'un
filtrage a été envisagé. Puisque les greffes doivent
valider toute information transmise par la « SARL Y (Annexe 1) ». On
constate également que des données susceptibles d'évoluer
dans le temps, tel que « l'état civil » de l'entreprise ne
seront pas localisé sur la blockchain puisque seules « Les
notifications envoyées sont inscrites sur la Blockchain ». On
retrouve le but avancé par toutes les actualités :
améliorer la coordination entre les greffes des différents
tribunaux de commerce.
Fort de cet exemple, nous proposerons à
l'occasion de notre dernière recommandation un système
légèrement différent et plus
détaillé.
323Laurent LELOUP, « Blockchain, la
révolution de la confiance », op. cit., p. 109.
- CHAPITRE 3 -
LE REGISTRE EFFICACE
1) Une blockchain invisible. Parmi tous les
internautes qui arpentent la toile, combien savent réellement ce qu'est
internet ? Combien seraient capables d'expliquer techniquement comment
fonctionne ce réseau ? Très peu sûrement. Pourtant notre
ignorance relative ne nous empêche pas de nous servir de l'outil. C'est
cette invisibilité que nous devons viser, il n'est pas question de
former l'ensemble des agents économiques aux subtilités de la
blockchain. Nous devons forger une application, qui comme les navigateurs avec
internet, effacera la technologie pour que ne subsiste que son seul usage
à travers une interface ergonomique.
2) Un réseau composite. Hyperledger Fabric est
un outil qui permet de créer des réseaux composites dans la
mesure où ils sont composés d'éléments très
différents. Là où tous les pairs se ressemblent dans
l'anonymat proposé par les blockchains publiques, les blockchains issues
d'Hyperledger Fabric sont à l'inverse constituées de noeuds
très différents, hiérarchisés et soumis à
des règles de gouvernance établie par une autorité
centralisée (b. les différents acteurs du réseau). Nous
amorcerons le détail de notre projet en proposant quelques
éléments de définition afin de clarifier le rôle de
chaque composant technique dans l'agencement que nous avons retenu (a. les
composants du réseau).
a. Les composants du réseau.
- Un espace de stockage : Si cette première
notion est la seule que nous n'avons pas nommée en anglais c'est parce
que cette technologie n'a rien à voir avec le protocole Hyperledger
Fabric ou même les blockchains. L'espace de stockage est une base de
données traditionnelle qui a vocation à recevoir les avis
inscrits par les créanciers garantis. Cette inscription aura vocation
à être testée par la blockchain proprement dite selon une
procédure que nous allons détailler. Si elle est valide, l'avis
dans son intégralité sera entièrement et durablement
conservé dans cette base de données. À l'inverse si la
transaction ne correspond pas aux critères de validité
ancrée par les greffes des tribunaux de commerce dans la blockchain,
l'avis sera effacé de l'espace de stockage et un message d'erreur sera
envoyé à l'utilisateur via l'interface de
l'application.
- The Ledger : Il s'agit du registre distribué
entre les pairs. Voilà le coeur inaltérable, la blockchain
proprement dite. C'est ici que sera stocké l'historique des transactions
qui auront été approuvées par les « endorsing
peers » et l'« ordering service ». Cet historique
ne sera pas composé de simples données, il recélera les
métadonnées (des données particulières qui
permettent de localiser tel ou tel avis sur notre base de données). Si
on l'associe à la pratique du hashage324 il sera possible
d'exposer au grand jour toute tentative de fraude qui se baserait sur une
attaque de l'espace de stockage visant à modifier un avis. En ne
stockant que des métadonnées sur notre Ledger, nous venons
à bout des deux problèmes fondamentaux que
324Précisons simplement que le passage d'un
document à la moulinette d'une fonction de hashage fournit une
donnée cryptée nommée un hash. Cette pratique qui suppose
un agencement complexe de portes logiques donnera un hash complètement
différent, si ne serait-ce qu'un seul caractère a
été modifié dans le document entre deux cryptages.
Dès lors, on comprend que l'attaque de l'espace de stockage serait une
tentative de fraude grossière, vouée à l'échec tant
que le Ledger demeure sécurisé via la technologie
blockchain.
nous avons soulevés. En effet, il est tout
à fait possible de supprimer les avis obsolètes qui n'ont
d'existence qu'au sein de l'espace de stockage, et seul l'historique des
transactions est inscrit dans notre
blockchain325.
- À Membership Service : Avant de pouvoir
inscrire un avis sur le registre, le créancier garanti devra
s'identifier sur le réseau en tant qu'utilisateur. En termes techniques
« The membership service provider (MSP) maintains the identities of
all nodes in the system (clients, peers, and OSNs326) and is
responsible for issuing node credentials that are used for authentication and
authorization 327». Cette phase d'identification
fonctionne par la délivrance de certificats328 aux nouveaux
utilisateurs.
- The chaincodes : « A smart contract, called
chaincode329». C'est le premier point à retenir,
comme nous l'avons évoqué plus haut, la blockchain publique
Ethereum qui a mis les smart contracts sur le devant de la scène a fait
de nombreux émules. Au sein du protocole hyperledger fabrique les smart
contract sont nommés des chaincode. Une appellation moins
déceptive pour les juristes dans la mesure où les smart contract
ne sont pas des contrats. Chaincode et smart contract doivent être
défini comme des applications distribuées sur la blockchain.
C'est parce qu'elles sont ancrées au sein même de la blockchain
que leur automaticité, leur plus grande qualité est garantie.
Comme on ne peut pas modifier en fraude le Ledger on ne peut pas
tricher avec les smart contract. Si les conditions de fait de son activation
sont remplies, il accomplira son office en toute fiabilité. Les
différents membres du réseau peuvent créer des chaincodes
pour servir leurs besoins divers comme sur la blockchain Ethereum ou chacun est
libre d'inventer ses propres smart contracts. Il faut différencier les
chaincode des « system chaincodes 330» qui seuls
servent aux « endorsing phase » et « ordering phase
».
325« On proposera par conséquent de ne pas
stocker l'intégralité de l'acte dans le registre, mais seulement
une clé (un code) calculée de manière unique à
partir de l'acte d'origine, de telle sorte que la modification d'un seul
caractère du document initial induise une clé complètement
différente, mais que deux documents parfaitement similaires induisent
systématiquement une clé identique. Ainsi, chacun pourra
conserver chez lui une copie de l'acte, seule la clé étant
inscrite dans le registre », Barbara THOMAS-DAVID et Jean-Luc GIROT,
« La blockchain expliquée autrement - Libres propos par Barbara
Thomas-David et Jean-Luc Girot », préc., P.2.
326Par « OSNs » il faut comprendre «
ordering-service n'odes », à savoir les noeuds de la blockchain qui
permettent à l'ordering service d'accomplir sa mission.
327Artem BARGER, Christian CACHIN, Konstantinos
CHRISTIDIS, Yacov MANEVICH, Manish SETHI, Alessandro SORNIOTTI, Marko
VUKOLIÆ, « Hyperledger Fabric: A Distributed
Operating System for Permissioned Blockchains », 30 Janv. 2018, accessible
en ligne :
https://arxiv.org/abs/1801.10228
328« Les autorités de certification (AC)
fournissent l'identité sur le réseau. Une autorité de
certification peut être considérée comme un notaire public
de confiance qui agit comme point d'ancrage entre plusieurs parties. Toutes les
entités du réseau reçoivent un certificat signé par
une autorité de certification racine qui encapsule leur identité
numérique. Ce certificat est la racine de confiance pour toutes les
opérations de signature et de vérification effectuées sur
le réseau », cette définition est accessible en ligne via la
documentation IBM cloud mise à disposition à l'adresse :
https://cloud.ibm.com/docs/services/blockchain?topic=blockchain-managing-certificates&locale=fr
329Artem BARGER, Christian CACHIN, Konstantinos
CHRISTIDIS, Yacov MANEVICH, Manish SETHI, Alessandro SORNIOTTI, Marko
VUKOLIÆ, « Hyperledger Fabric: A Distributed
Operating System for Permissioned Blockchains », préc.
330« The application chaincodes are deployed with
a reference to an endorsement system chaincode (ESCC) and to a validation
system chaincode (VSCC). These two chaincodes are selected such that the output
of the ESCC (an endorsement) may be validated as part of the input to the VSCC.
The ESCC takes as input a proposal and the proposal simulation results. If the
results are satisfactory, then the ESCC produces a response, containing the
results and the endorsement », Artem BARGER, Christian CACHIN,
Konstantinos CHRISTIDIS, Yacov MANEVICH, Manish SETHI, Alessandro SORNIOTTI,
Marko VUKOLIÆ, « Hyperledger Fabric: A Distributed
Operating System for Permissioned Blockchains », préc.
b. les acteurs du réseau.
- Les utilisateurs : « Clients submit
transaction proposals for execution, help orchestrate the execution phase, and,
finally, broadcast transactions for ordering331». Ce sont
évidements les acteurs du réseau qui ont le moins de pouvoir, ils
sont simplement censés soumettre des requêtes qui seront ou ne
seront pas validées par la blockchain proprement dite.
- The peers and the endorsing peers : Il faut
distinguer les « peers » des « endorsing peers ». «
Peers execute transaction proposals and validate transactions. All peers
maintain the blockchain ledger, an append-only data structure recording all
transactions in the form of a hash chain, as well as the state, a succinct
representation of the latest ledger state 332». La mission
des « endorsing peers » va plus loin, « Not all peers
execute all transaction proposals, only a subset of them called endorsing peers
does, as specified by the policy of the chaincode to which the transaction
pertains 333». Ce sont ces maillons de la chaîne qui
nous permettront via « the policy of the chaincode » de
refuser automatiquement toute transaction antidatée ou au nom d'un autre
utilisateur par exemple.
- The ordering service nodes : Ces noeuds particuliers
forment à eux tous l' « ordering service ». Leur mission est
de déterminer l'ordre dans lequel les transactions seront
enregistrées dans le registre, ils ne participent pas à la
validation des transactions334. Au sein des blockchains publiques
c'est souvent la preuve de travail qui détermine l'ordre des blocs qui
peuvent, durant de courtes périodes coexister en même temps
étant donné que de nombreuses transactions peuvent être
enregistrées en même temps. Au sein d'une blockchain privée
pas besoin de déployer des moyens d'une telle démesure, «
the ordering service » remplit cette tâche grâce à un
mode de consensus extrêmement modulable. Autrement dit, c'est quand on
créer cet élément de la blockchain que l'on doit opter
pour l'un des modes d'élaboration du consensus compatible avec
Hyperledger Fabric. Ce choix importe peu, ces noeuds étant
détenus par les greffes des tribunaux de commerce, tiers de confiance
par excellence, n'importe quel mode de consensus léger est
acceptable.
En somme « the ordering service establishes
the total order of all transactions in Fabric, where each transaction contains
state updates and dependencies computed during the execution phase, along with
cryptographic signatures of the endorsing
peers335».
3) Exemple de l'enregistrement d'une
transaction.
Nous avons retenu un agencement
particulièrement simple des différents composants de base
d'Hyperledger Fabric. C'est un choix délibéré, car en
raison de la vocation de la publicité efficace (absence de vocation
probatoire, et mission d'accessibilité maximale), il n'est pas
nécessaire de multiplier les espaces cloisonnés au sein de la
blockchain. En effet, tous les créanciers garantis feront le même
usage de notre application, en inscription, et tous les tiers
intéressés par la publicité des sûretés
mobilières feront le même usage en recherche. Hyperledger Fabric
permet de créer des blockchains pour satisfaire les besoins
d'utilisateurs
331Ibid.
332Ibid.
333Ibid.
334« Orderers are entirely unaware of the
application state, and do not participate in the execution nor in
the
validation of transactions », ibid.
335Ibid.
qui souhaiteraient la partager tout en en faisant des
usages différents. Ainsi il n'est pas nécessaire de
développer un réseau très complexe.
Il y a par principe trois étapes
nécessaires à l'enregistrement d'une transaction au sein d'une
blockchain créée grâce au protocole Hyperledger. Notre
réseau sera construit sur le même modèle. (a. The execution
Phase), (b. The ordering Phase), (c. The validation Phase)
a. The execution phase.
« In the execution phase, clients sign and
send the transaction proposal (...) to one or more endorsers for
execution336». Imaginons qu'un créancier garanti
souhaite inscrire un warrant agricole sur le registre global des
sûretés mobilières. Il devra commencer par s'identifier
auprès du membership service (voir annexe 2). Après quoi
il aura le droit d'uploader l'avis d'inscription sur l'espace de stockage
(voir annexe 2) où l'avis sera conservé temporairement dans
un premier temps. La demande d'inscription sera transmise par l'application
à plusieurs endorsing peers (voir annexe 2). Ces pairs vont
effectuer des calculs et des simulations en activant leurs chaincodes. À
cette étape, un message d'erreur pourra être envoyé au
créancier garanti si sa demande d'inscription ne correspond pas aux
critères de gestion du réseau (the endorsement policy). Le
tracé de cette erreur est représenté sur notre
schéma par le tracé des flèches rouges. Les endorsers
peers exécutent un travail de filtrage, si la demande d'inscription
passe cette étape alors l'information atteindra l'ordering
service.
b. The ordering phase.
« The ordering service batches multiple
transactions into blocks and outputs a hash-chained sequence of blocks
containing transactions337 ». L'ordering service va
rassembler plusieurs transactions pour créer des blocks. Il s'agit de la
blockchain proprement dite. L'information émise par notre
créancier garanti sera « commit » sur un « channel
», un canal de communication au sein de notre réseau.
c. The validation phase.
« Blocks are delivered to peers either
directly by the ordering service or through gossip. A new block then enters the
validation phase which consists of three sequential steps
338». Ces trois phases de validation « The
endorsement policy evaluation 339», the «
read-write conflict check340» et enfin the «
ledger update phase341» constitue la dernière
étape avant l'inscription d'une transaction sur la blockchain. «
The validation system chaincode 342» est
l'élément clé de cette dernière étape. Son
action dépendra des règles de gestion et de gouvernance du
réseau que nous aurons posées grâce au protocole
Hyperledger Fabric, qui est encore une fois très permissif et flexible.
Il faut bien comprendre que nous avons dépassé les étapes
de filtrage (indiquées par le parcours des flèches rouges sur
l'annexe 2). Que la
336Ibid. 337Ibid. 338Ibid. 339Ibid. 340Ibid. 341Ibid.
342Ibid.
transaction soit valide ou non, elle sera inscrite en
tout état de cause sur la blockchain343. L'enjeu est relatif
aux effets de la transaction. Si le créancier A a tenté une
transaction qui a été invalidée, cela signifie que
l'historique de blockchain conservera une trace de l'échec de
l'inscription de sa sûreté. Peut-être l'utilisateur a-t-il
envoyé par mégarde deux demandes d'inscription identiques
à quelques secondes d'intervalle. L'historique conservé dans le
ledger distribué conserva la trace de cette seconde inscription
malvenue.
À l'inverse si l'inscription est valide, la
première inscription tentée par le créancier de notre
exemple le serait par exemple, il est souhaitable que la blockchain transmette
un feedback à l'application dont l'interface pourra prévenir le
créancier garanti que son inscription est valide.
343« If the endorsement is not satisfied, the
transaction is marked as invalid and its effects are disregarded. »,
ibid.
TABLE DES MATIÈRES
PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS
SOMMAIRE
INTRODUCTION (p. 1)
PREMIÈRE PARTIE - LE CHOIX DE LA SUBSTANCE :
VOCATION D'UNE PUBLICITÉ EFFICACE (p. 11)
TITRE I - les prérequis de l'efficacité
en matière de publicité (p. 11)
Chapitre 1 : La non-incidence de la connaissance ou de
l'ignorance effective (p. 12)
Section 1. L'épineuse distinction entre
connaissance de la sûreté et bonne foi au sens de l'article 2276.
(p. 12)
Section 2. La présomption de
connaissance de la sûreté, un pis-aller à un
véritable critère objectif. (p. 13)
Chapitre 2 : La distinction entre constitution et
opposabilité d'une sûreté. (p. 16)
Section 1. La
Fiducie sûretés et les écueils de la première
approche (p. 16)
Section 2. L'exemple du droit commun du gage et
les attraits de la seconde approche (p. 17)
Chapitre 3 : L'approche globale et fonctionnaliste de
la notion de sûreté (p. 19)
Section 1. L'unification nationale, l'approche unitaire
par soustraction (p. 20)
Section 2. L'unification globale, l'approche
unitaire par définition (p. 20) Chapitre 4 : La mise en avant de
l'inscription par simple avis (p. 23 )
Section 1. L'inscription plutôt que la
dépossession (p. 23)
1. L'emprise matérielle, identité propre
de la dépossession (p. 24)
2. Le droit de rétention, une entrave à
l'attractivité de l'inscription (p. 25)
Section 2. L'inscription par simple avis
plutôt que l'inscription par enregistrement de document (p.
28)
1. La vocation probatoire de l'inscription par
enregistrement de document (p. 28)
2. La vocation de la publicité efficace (p.
29)
TITRE II - Du rôle traditionnel de la
publicité, du constat de ses limites, et de sa nécessaire
évolution (p. 32)
Chapitre 1 : Informer les tiers, l'utilité
traditionnelle de la publicité (p. 33)
Section 1. Aider le tiers à anticiper
l'aggravation de sa situation (p. 33) Section 2. Informer le tiers des
risques de son engagement (p. 35)
1. L'ayant cause à titre particulier,
créancier garanti concurrent (p. 35)
2. L'ayant cause à titre particulier,
acquéreur (p. 37)
Chapitre 2 : Protéger les tiers, le constat des
limites de la publicité (p. 40)
Section 1. La nécessité de ne pas
hiérarchiser la protection des ayants causes à titres
particuliers (p. 40)
Section 2. La problématique de l'angle mort de
la publicité personnelle (p. 42)
1. Le sous-acquéreur, le tiers aveugle à
la publicité personnelle (p. 42)
2. La piste du gage sur chose fongible (p.
43)
Chapitre 3 : Neutraliser la menace, la
nécessaire évolution (p. 44)
Section 1. Comment confiner le potentiel de nuisance du
droit de suite ? (p. 44)
1. L'assiette universalité de la
sûreté globale et ses composants libres de tout droit de suite (p.
44)
2. L'extension de l'assiette au produit et la
suppression conditionnelle du droit de suite (p. 46)
Section 2. Deux remèdes accompagnés
d'effet secondaire (p. 49)
1. La réalisation de la sûreté
globale (p. 49)
2. L'assiette extensible et la problématique des
biens métamorphe (p. 50)
SECONDE PARTIE - LE CHOIX DU RÉCEPTACLE : LA
GENÈSE DU REGISTRE EFFICACE (p. 54)
TITRE I - Les propriétés d'un registre
efficace et les moyens de les développer (p. 55)
Chapitre 1 : L'absolue nécessité d'un
registre informatisé (p. 56) Section 1. l'inefficience du
registre papier (p. 56)
Section 2. L'exemple critiquable du fichier
national des gages sans dépossession (p. 57)
Chapitre 2 - Principes d'un registre efficace (p.
61)
Section 1. Clarté : la question de l'indexation
des avis (p. 61)
1. Indexation en considération de la personne du
constituant : méthode principale (p. 61)
2. Indexation en considération de certains biens
grevés : méthode complémentaire (p. 62)
Section 2. Simplicité : la question de la
priorité des droits (p. 63)
1. Définition des règles de
priorité et délimitation de leurs champs d'application (p.
63)
2. La nuance entre ordre des opposabilités et
ordre des priorités (p. 65)
Section 3. faible onérosité, la question
du financement (p. 67)
1. La rationalisation et la minimisation des
dépenses (p. 67)
2. Les opportunités d'auto financement du
registre (p. 68)
TITRE II - L'innovation technologique a
considéré : de la blockchain aux blockchain (p. 69)
Chapitre 1 - L'apport de la technologie blockchain (p.
69)
Section 1. La notion de blockchain, définition
générale (p. 69)
1. L'outil blockchain, une définition pour une
technologie plurielle (p. 70)
2. Les créations blockchain, l'ombre du
Bitcoin (p. 71)
Section 2. Confrontation de la blockchain aux bases de
données traditionnelle
(p. 72)
1. Cette base de données en accès libre et
direct juste sous nos yeux (p. 73) Première proposition : Le registre
Wiki, le registre partagé le plus basique (p. 74)
2. Les atouts à doubles tranchants de la
blockchain (p. 75)
Chapitre 2 - Les blockchains (p. 77)
Section 1. Le constat de
l'inadaptabilité de la blockchain publique aux problématiques du
registre des sûretés réelles mobilières (p.
77)
1. La blockchain publique (p. 77)
2. La solution des blockchain privés (p.
79)
Section 2. L'exemple du permissioned ledger, une
blockchain privée
expérimentée par IBM et les greffes des
tribunaux de commerce (p. 80)
1. Registre du commerce et des sociétés
et registre des sûretés réelles mobilières, des
registres voisins ? (p. 80)
2. Notre projet (p. 82)
Chapitre 3 - Ultime proposition, le registre efficace
(p. 85)
1. Une blockchain invisible (p. 85)
2. Un réseau composite (p. 85)
a. Les composants du réseau (p.
85)
b. les acteurs du réseau (p.
85)
3. Exemple de l'enregistrement d'une transaction (p.
87)
a. The execution phase (p. 88)
b. The ordering phase (p. 88)
c. The validation phase (p. 89)
BIBLIOGRAPHIE ANNEXE
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES GÉNÉRAUX :
RÉPERTOIRES E T ENCYCLOPÉDIES
BEDER (P.), « Publicité légale
», Rép. Soc., oct. 2016.
CROCQ (P.), « gage », Rép.
Civ., Fév. 2017 (actualisation Oct. 2018).
DE KERGOMMEAUX (X.), « Titrisation »,
Rép.
com., janv. 2010 (actualisation Janv.
2018). JUILLET (C.), « Hypothèque », Rép.
Imm., mai 2019.
LATINA (M.), « Principes directeurs du droit des
contrats », Rép. Civ., mai 2017 (actualisation Janv.
2019)
LEGEAIS (D.), « Sûretés »,
Rép. civ., janv. 2016 (actualisation mars 2019).
LEGEAIS (D.), « Fiducie-sûreté »,
J.-Cl., fasc. 10, 1er avr. 2011 (màj12 juin 2017). PRAICHEUX
(S.), « Sûretés financières », Rép.
soc., Avr. 2019.
II. OUVRAGES SPÉCIAUX : OUVRAGES COLLECTIFS ET
THÈSES Ouvrages collectifs :
GARAPON (A.) et LASSEGUE (J.), « Justice
digitale : révolution graphique et rupture anthropologique »,
Presses universitaires de France/Humensis, 11 avr. 2018.
RIFFARD (J-F.), « Sûretés
mobilières et Stocks : ou l'Art et la Manière de résoudre
la Quadrature du Cercle », dans SPYRIDON V BAZINAS, N ORKUN AKSEL, «
International and Comparative Secured Transactions Law Essays in honour of
Roderick A Macdonald », Hart publishing, oct. 2017, P.136. et
s.
Thèses :
BLANDIN (Y.), « Sûretés et bien
circulant, contribution à la réception d'une sûreté
réelle globale », Thèse de doctorat en droit,
université panthéon-assas, Paris, 2014.
PINTO HANIA (V.), « Les biens
immatériels saisis par le droit des sûretés réelles
mobilières conventionnelles », Thèse de doctorat en
droit, Université Paris-Est, Paris, 2011.
III. ARTICLES DE REVUES ET COMMENTAIRE DE
JURISPRUDENCE
ANDREU (L.), «Gage avec dépossession
contre gage sans dépossession», Recueil Dalloz 2012,
n° 27, P. 1761 et s.
ANSALONI (G.), « Sur l'opposabilité du
gage sans dépossession de droit commun », La Semaine
Juridique Entreprise et Affaires, LexisNexis, 2009, n° 27. P. 1672 et
s.
AYNES (A.), « Gage avec dépossession par
entiercement : admission large de la condition de dépossession »,
Revue des contrats, 1er oct. 2010, n° 4, p. 1336.
BENADIBA (A.), « La publicité des
sûretés réelles au Québec : évolution ou
mutation ? », Revue du notariat, Éditions Yvon Blais,
2014, volume 116, n° 3, P. 333 et s.
BERBAIN (C.), « La blockchain : concept,
technologies, acteurs et usages, réalités
industrielles », dans DARDAYROL (J.-P.),
(coordinateur), « Blockchains et smart contracts : des technologies de
la confiance », Réalités industrielles, annales des
mines, Serie trimestrielle l, août 2017, P.6 et s.
BLANDIN (Y.), « Gage sur stock - La
réforme du gage des stocks par l'ordonnance n° 201656 du 29 janvier
2016 », Revue de Droit bancaire et financier, LexisNexis, Juillet
2016, n° 4, étude 20.
BOFFA (R.), « L'opposabilité du nouveau
gage sans dépossession », Recueil Dalloz 2007, n° 17,
p.1161 et s.
BOURASSIN (M.), « Réforme du gage des
stocks : de l'attraction à l'attractivité », Gaz.
Pal. 8 mars 2016, n° 10, P. 53.
CROCQ (P.), « Lacunes et limites de la loi au
regard du droit des sûretés », Recueil Dalloz 2007,
P.1354 et s.
CROCQ (P.), « Droit des sûretés
», recueille Dalloz 2008, P. 2104
CROCQ (P.), « Sûretés
mobilières : état des lieux et prospective », Revue des
procédures collectives, LexisNexis, Nov. 2009, n° 6, dossier
18.
CROCQ (P.), « Nantissement de fonds de commerce
et refus du droit de rétention fictif de l'article 2286, 4°, du
code civil », RTD civ. 2014, n°1, p.158 (Com. 26 nov. 2013,
n° 1227.390).
CROCQ (P.), « Une trop grande
dématérialisation de la dépossession fait perdre le
bénéfice du gage avec entiercement », RTD Civ.,
2015, n° 3 p.665. (Com. 8 avr. 2015, n° 14-13.787)
DELPECH (X.), « Propositions de réforme du
droit des contrats spéciaux et du droit des sûretés »,
Dalloz, AJ contrat, Dalloz, 2017, n°10,
p.404.
EMERICH (Y.), «La nature juridique des
sûretés réelles en droit civil et en common law: une
question de tradition juridique? », RJTUM, 2010, n° 44-1, P.99 et
s.
FOURNIER (V.), BOBET (P.), « La blockchain se
déploie dans les greffes des tribunaux de commerce, Focus sur une
première dans le secteur judiciaire, développée par IBM
», Journal Spécial des Sociétés, 6 avr.
2019, n° 27, P.8 et s.
GENTIL (E.), « problématique des
investisseurs finance et droit des sûretés », Revue
d'économie financière, association d'économie
financière, 2018, n° 129, P. 99 à 115.
LELIEVRE (V.), « BCE, BoJ, Fed : pompiers et
pyromanes », Revue de l'Union européenne, Dalloz 2019,
n° 624, P.57 et s.
LEGEAIS (D.), « Portée d'une clause de
substitution des marchandises introduite dans un contrat de gage »,
RTD com., Dalloz, 2010, n°3, P. 596
PETRUCCIANI (S.), «Les multiples dimensions de la
critique marxienne du droit», Revue Droit & Philosophie nov.
2018., n° 10, P.11 et s.
RIFFARD (J-F.), « L'harmonisation internationale
des droits des sûretés mobilières : ne ratons pas le train
! », Revue de Droit bancaire et financier, LexisNexis,
mars 2016, n° 2, dossier 11.
THOMAS-DAVID (B.) et GIROT (J-L.), « La
blockchain expliquée autrement - Libres propos par Barbara Thomas-David
et Jean-Luc Girot », La Semaine Juridique Notariale et
Immobilière, LexisNexis, mai 2018, n° 21-22, act.
480.
WAELBROECK (P.), « Les enjeux economiques de la
blockchain », dans DARDAYROL (J.-P.), (coordinateur), «
Blockchains et smart contracts : des technologies de la confiance
», Réalités industrielles, annales des mines, Serie
trimestrielle l, août 2017, P.10 et s.
IV. DOCUMENT DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE
DROIT
COMMERCIAL INTERNATIONAL
Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international, « Guide législatif de la CNUDCI sur les
opérations garanties », New York, 2011, accessible en ligne :
https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/f/LGonSTFrench.pdf
Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international, « Guide de la CNUDCI sur la mise en place d'un registre
des sûretés réelles mobilières », Vienne,
2014, accessible en ligne :
https://www.uncitral.org/pdf/french/texts/security/Security-Rights-Registry-Guide-f.pdf
V. DOCUMENTATION INTERNET
Association Henri Capitant, « Avant-projet de
reforme du droit des sûretés », accessible
en
ligne :
http://www.henricapitant.org/travaux/legislatifs-nationaux/avant-projet-de-reforme-
du-droit-des-suretes
BARGER (A.), CACHIN (C.), CHRISTIDIS (K.), MANEVICH
(Y.), SETHI (M.), SORNIOTTI (A.), VUKOLIÆ (M.), «
Hyperledger Fabric: A Distributed Operating System for Permissioned
Blockchains », 30 Janv. 2018, accessible en ligne :
https://arxiv.org/abs/1801.10228
DE FILIPPI (P.), REYMOND (M.), « Blockchain
et droit à l'oubli », dans NITOT (T.), CERCY (N.),
Numérique: reprendre le contrôle, novembre 2016,
Framasoft, n° 1, P.138 et s. accessible en ligne :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01676888
GRIMALDI (M.), MAZEAUD (D.), DUPICHOT (P.), «
Présentation d'un avant-projet de réforme des
sûretés », Dalloz actualité, 3 Oct. 2017,
accessible en ligne :
https://www.dalloz-actualite.fr/chronique/presentation-d-un-avant-projet-de-reforme-des-
suretes#.XVl UOgzZPY
LEBERT (M.), « Booknologie : Le livre
numérique (1971-2010) », Project Gutenberg ebook, accessible
en ligne :
http://www.gutenberg.org/ebooks/33462
LELOUP (L.), « Blockchain, la
révolution de la confiance », Eyrolles, 17 février
2017, accessible en ligne
http://univ.scholarvox.com.ezproxy.uca.fr/reader/docid/88838650/page/1
LOURADOUR (S.), « Comprendre le
fonctionnement de wikipedia », Yellow vision, accessible sur le site
du magazine en ligne Yellow vision, :
http://yellowvision.fr/comprendre-le-succes-de-wikipedia/
ROBESPIERRE (M.), « Discours par Maximilien
Robespierre 17 avril 1792-27 juillet 1794 », Project Gutenberg ebook,
accessible en ligne à
http://www.gutenberg.org/ebooks/29887
SAYAG (A.), « introduction », dans CREDA,
« l'information légale dans les affaires : quels enjeux ?
Quelles évolutions ? », colloque du 1er mars 1994, actes
consultables à
http://www.creda.cci-paris-idf.fr/colloques/1994-information-legale-actes.html
SMITH (A.), « Du prix réel et du prix
nominal des marchandises, ou de leur prix en travail et de leur prix en
argent», dans Smith (A.), « la richesse des nations »,
[en ligne], 1776, W.
Strahan and t. Cadell, Londres, accessible en
ligne
à
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75319v.pdf
ANNEXE 1 :
Exemple du fonctionnement de la Blockchain
initiée par les
Greffes des Tribunaux de Commerce (TC)
|
Un changement relatif a la rie de la SARL Y est déclare
par son dirigeant (ex : changement d'adresser ouverture ou fermeture
d'établissement), ou bien une procédure de traitement des
difficultés est ouverte par le tribunal (procédure de sauvegarde,
redressement OU liquidation judiciaire). Le changement est valide par ie greffe
du TC A. compétent dans son ressort géographique pour
enregistrer ['opération juridique.
|
SARI. aT»
|
i.e SARL V I Sali
siege social au greffe A et des etablu sements
secondaires situés
dans les greffes B, C, D.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le greffe du TC A reçoit
[a demande formulée par la SARL a Y a vende juridiquemenr le.
changement pour la SARL s Y v, modifie son registre du Commerce et des
Sociétés {RCSk et/OU des Procédures Collectives (PC), et
dé[iwre l'extrait d'immatriculation misa jour de la SARL U Y (extrait
K
· bis).
|
|
|
|
Greffe A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Greffe C
Greffe D
Le greffe du TC A envoie des notifications, pour
signifier les modifications, a tous tes greffes des
TC ayant un
établissement Secondaire (es fonds de
commerce,
boutiques...) dans leur ressort géographique. Les
notifications enrayées sont inscrites sur la
Blockchain.
Les greffes.des TC fiant dans leur ressort
géographique des établissements secondaires
vérifient Ees informations contenues dans les notifications
reçues, confirme (a mise a jour de leurs registres
{f.CS et/ou PC) et envoient une natificatéori de réponse
au greffe du TC A pour signifier les mises a jour.
Amélioration de la qualité du service
proposé par les greffiers aux entreprises
1
Sécuriser
juridiquement
les processus de suivi des mises à jour des registres
en simplifiant et en assurant la traçabilité de Caque
opération svr le registre immuable qu'est fa
Blockchain
z
Fluidifier et
optimiser
tes pros de traitements des opérations par un suivi
précis des notifications
3
Nouvelles
perspectives
dans la gestion des registres
RCS et PC et du service
proposé aux
entreprises
ANNEXE 2 :
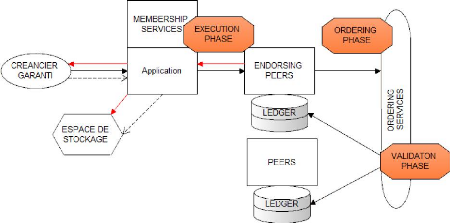
Le tracé des flèches noires
représente la demande de transaction et son parcours jusqu'à
l'enregistrement dans le registre.
Le tracé des flèches rouges
représente le cheminement d'un message d'erreur en cas de demande
invalide.
Le tracé des flèches en pointillés
représente le stockage de l'avis lui même. Comme
évoqué précédemment cet avis sera soit
conservé, soit effacé en fonction de la réponse de la
blockchain quant à la validité ou l'invalidité de la
transaction.



