Abstract
In recent years, 77% of the populations of common Karimama and
Malanville are faced with flooding problems. Faced with the many impacts that
these common experience. The present study aims to contribute to a better
understanding of monitoring and management of natural hazards in Benin: case of
floods in public Karimama and Malanville.
To meet these objectives, several types of data were used.
These are the climatological data, hydrological and socio-economic etc. The
methodological approach comprised various stages including desk research, field
work, analysis and data processing. The ambition is to reduce vulnerability to
the base, integrating people at the heart of development strategies and risk
management related to climate conditions.
The analysis showed that these areas are the most exposed to
risks related to the flooding. The homes of these flooded areas are destroyed
at 50%. Floods and poor distribution of rainfall create huge health problems
(hydro-faecal diseases, malaria) and environmental level of water resources,
agricultural activities, livestock and land degradation estimated at 62% the
area planted to each flood. There are some constraints including those related
to the low involvement of local authorities in the management of risks that
pose a challenge to the success of the decentralization process in these
municipalities. To correct these disparities have chosen as the common method
of management the implementation of an information system through the
preparation and management of information to reduce the impact of flooding.
Keywords: Karimama, Malanville; Risk of flooding; risk
management; vulnerability and information system.
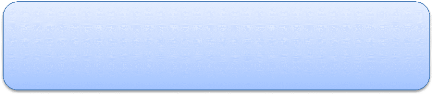
INTRODUCTION
8
9
La convergence des risques environnementaux, techniques et
socio-économiques est un défi pour le développement
durable. Il s'agit d'un problème générationnel qui exige
des efforts collectifs pour penser et construire des politiques
d'amélioration de la résilience des populations (Hountondji,
2010).Par ailleurs, il semble utile de s'attaquer aux causes profondes de ces
risques et de renforcer le mode actuel de leur gestion.
Les défis émergents soulevés par la
durabilité urbaine obligent les services publics à donner une
nouvelle orientation à la prise des décisions de gestion
(prévention, atténuation, réparation) des catastrophes
induites par les risques naturels. Plus concrètement, il leur revient de
prendre des décisions durables qui permettront de réduire les
pertes occasionnées par les catastrophes naturelles tout en contribuant
au développement durable du territoire.
Dans ce contexte, l'atteinte de la durabilité de la
gestion des risques tout comme la mise en oeuvre du développement
durable, dont elle tire son essence, demeure un important défi
méthodologique (Crowley et Risse, 2011). La réponse à ce
défi consiste à rendre compte de l'efficacité des
politiques publiques à travers leurs conséquences sur le plan des
différentes dimensions de durabilité. Plus concrètement il
s'agit de mesurer le degré d'intégration des principes du
développement durable en amont des décisions en vue d'en estimer
l'efficacité, la pertinence, mais surtout la performance par rapport aux
objectifs de durabilité.
Les catastrophes naturelles font régresser le
développement du pays, anéantissant des années d'effort et
de travail, et maintenant dans un état de pauvreté les groupes
déjà défavorisés. Au niveau de la ville et du pays,
elles détruisent investissements et infrastructures, et épuisent
les budgets nationaux, ainsi que l'aide internationale au développement
que reçoivent ces pays.
Malgré tout cela, les catastrophes naturelles ne sont
que rarement, ou jamais, prises en compte dans les politiques de
développement urbain. Il n'est
10
pas rare pour les pays en voie d'urbanisation d'avoir deux
ministères complètement différents pour la gestion des
situations d'urgence (Djènontin; 2010).Tant que la politique de la ville
et la gestion des catastrophes naturelles seront dissociées, et que
cette dernière restera à l'état d'ébauche, on
mettra une croix sur les possibilités efficaces de réduire les
risques urbains. Les conséquences inévitables de la politique des
autorités qui délivrent des permis de construire sur des terrains
dangereux ou des zones inondables continueront à passer totalement
inaperçues, jusqu'à ce qu'une nouvelle catastrophe survienne.
Dans les pays en développement, en revanche, le nombre
des victimes est généralement plus élevé en raison
de l'inexistence ou de l'insuffisance des programmes de prévision et
d'évacuation (Dégboué; 2006). Les pertes en capital
peuvent être inférieures en termes absolus par comparaison avec
celles que subissent les pays développés, mais leur poids relatif
et leur impact économique global sont généralement
considérables, susceptibles même d'affecter la viabilité du
pays.
Les changements climatiques vont aggraver la pauvreté
dans le monde. Ses conséquences seront plus dramatiques dans les pays en
développement, en raison de leur situation géographique, de leurs
conditions climatiques, de leur forte dépendance à l'égard
des ressources naturelles et de leur capacité limitée à
s'adapter à l'évolution du climat. Dans ce groupe de pays, les
plus pauvres, ceux qui ont le moins de ressources et le moins de
capacité d'adaptation sont les plus vulnérables (GIEC, 2001).
Les changements climatiques freinent la trajectoire et le
rythme de croissance économique en raison des modifications des
ressources et des systèmes naturels, des dommages aux infrastructures et
de la baisse de la productivité du travail. Tout ralentissement de la
croissance se traduit directement par une diminution des possibilités de
revenus pour les populations pauvres. Les changements climatiques menaceront la
sécurité alimentaire à
11
l'échelle régionale. En Afrique en particulier,
l'insécurité alimentaire devrait s'aggraver.
La capacité à réagir exige de continuer
la sensibilisation ainsi qu'une bonne gestion des ressources, aussi bien en
temps normal que durant les crises ou des conditions défavorables
(Rafidison ; 2011). Elle permet également de faire face et de contribuer
à la réduction des risques de catastrophe.
Cette étude est structurée en quatre parties. La
première partie est consacrée au cadre théorique de la
recherche et l'approche méthodologique, la deuxième partie
à la l'analyse des caractéristiques générales et de
la démographie des communes, la troisième partie a abordé
les effets globaux des inondations dans les communes et enfin la
quatrième a traité les stratégies de gestion du risque
inondation et expériences en Afrique et au Bénin ; Atouts et
difficultés des communes de Karimama et de Malanville et les pistes
d'actions pour l'épanouissement de la population.

| 


