I.2. HISTORIQUE
Le cholestérol fut découvert sous forme solide
dans les calculs biliaires en 1758 par François Poulletier dela Salle.
Le nutritionniste américain AncelKeys réalisa après la
seconde guerre mondiale une étude épidémiologique sur
plusieurs décennies dans 7 pays qui mit en évidence une
corrélation entre le taux de cholestérol sanguin et les accidents
cardiovasculaires. Ces résultats lui firent émettre
l'hypothèse selon laquelle le cholestérol est le facteur de
risque majeur responsable de la forte mortalité cardio-vasculaire mais
cette étude soufra de biais de comparaison ou des confondeurs.
A la suite de cette étude longitudinale, des essais
cliniques furent menés sur des populations d'anciens combattants
américains mis au régime hypocholestérolémiant mais
ces tentatives n'eurent pas d'impact significatif sur leur mortalité.
En 1954, le chercheur français Jean Cottet
réalisa que des ouvriers agricoles intoxiqués par le pesticide
qu'ils répandaient dans les champs avaient un taux de cholestérol
qui s'était effondré.
Un de ses amis chimistes du nom de Michel Oliver de l'Imperial
chemical industries synthétisa un médicament dérivé
de ce pesticide, le clofibrate. Le test de cette molécule sur des rats
puis sur des patients confirma son effet hypolipémiant (MICHAEL OLIVER,
2O12).
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
réalisa un essai clinique sur 1500 européens pour évaluer
l'effet du clofibrate sur la prévention de l'infarctus mais cette
étude fut négative, l'essai devant même être
arrêté prématurément, car le groupe sous clofibrate
avait une prévalence plus élevée que le groupe sous
placebo.
Malgré cette étude réfutant le lien entre
la baisse du cholestérol et la surmortalité, une famille de
molécules médicamenteuses fut lancée, les fibrates.
Dans les années 1990, deux études sur la
simvastatine et la pravastatines montrèrent leur effet de
prévention sur des hommes ayant un taux de cholestérol
élevé.
Certains soulignent que les recommandations tendant à
viser un taux optimal de cholestérol (plus particulièrement sa
fraction LDL),ne sont en fait étayées par aucune étude
,ces dernières ayant toujours été faites à des
doses fixes de statines quel que soit le taux initial de cholestérol,
la baisse de ce dernier n'étant pas un objectif .il semble que ,les
statines ont un effet de prévention vasculaire mais sans lien avec le
taux de cholestérol.
I.3. STRUCTURE CHIMIQUE
La structure chimique de la molécule
decholestérol met en évidence, substituéssur le noyau
cyclique planaire, d'une part, unechaîne hydrocarbonée hydrophobe,
sur lecarbone 17, d'autre part, un groupe OHpolaire hydrophile sur le carbone
3. La molécule decholestérol est une molécule
amphiphile(pourvued'affinités différentes à chacune deses
extrémités), cette caractéristique étant
àl'origine de ses propriétés physico-chimiqueset
biologiques.Sur une phase aqueuse les molécules decholestérol,
orientées par la présence dugroupe OH, constituent une
monocoucheordonnée fluide, chaque molécule occupantune surface de
0,37 nm². Associées àdes molécules de
lécithines insaturées enmilieu aqueux, les molécules de
cholestérolont un effet condensant, la surface occupéepar les
molécules de lécithines décroissant de0,62 à 0,48
nm² (ATOMIC WEIGHTS, 2007).
L'analyse par spectroscopie de
résonancemagnétique nucléaire et de spin
d'électronmontre que le cholestérol ordonne les couchesmixtes
phospholipides-cholestérol et réduit lamobilité des
chaînes carbonées insaturées.L'état structural des
membranes lipidiquesartificielles et des membranes biologiquesnaturelles est
fonction de la température : gelcristallin au-dessous d'une
températurecritique dite température de transition,
cristalliquide au-dessus de cette température. Laprésence de
molécules de cholestérol affecteconsidérablement cette
transition (allant jusqu'à l'abolir complètement de tellesorte
que, même à des températures infra physiologiques, la
couche lipidiqueconserve sa structure aérée de cristal liquide.La
séparation et l'isolement du cholestérollibre et de ses esters
d'un extrait lipidique,sérique ou tissulaire, sont effectués
parchromatographie sur colonne ou sur plaqued'acide silicique à l'aide
de différents mélanges éluants.
La molécule de cholestérol comprend quatre
cycles carbonés notés A ,B,C et D (noyau
cyclopentano-perhydro-phénanthrénique), 8 carbones
asymétriques (les carbones 3,8,9,10,14,17,et 20),ce qui fait 256
stéréo-isomères dont un seul existe :le 3B-ol
lévogyre.Le cholestérol possède un hydroxy-OH sur le
carbone 3 (C3). Ce groupe chimique constitue la tête polaire .Ce
groupement R-OH constitue donc la partie hydrophile du cholestérol.
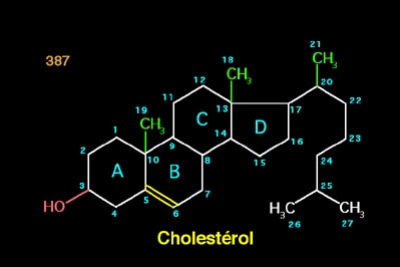
La fonction OH du cholestérol peut être
estérifié par un acide gras qui rend la molécule
totalement insoluble dans l'eau. (FERNANDEZ M.L et coll., 2005).
Figure 1. Structure du cholestérol
| 


