3 Réponses aux questions
1 Quel lien entre les différents types de stagiaires
et les représentations ?
Catégories objectives et subjectives, et
représentations
Quel lien entre les différents types de stagiaires et
les représentations ? Pour répondre à cette question, nous
allons d'abord mettre à plat la terminologie de notre recherche. La
typologie des stagiaires relève des deux types de catégories
suivantes : catégories objectives ; catégories subjectives.
Les catégories objectives sont les éléments
possibles à déterminer de l'extérieur du sujet
concerné comme : âge, sexe, lieu d'origine, expériences
professionnelles etc. Mais que désignent les catégories
subjectives ?
Nous entendons par ces catégories les sens
donnés et raisonnés par le sujet vis-à-vis d'un objet
donné. Pour l'expliquer, prenons un exemple : quelqu'un qui aime le vin
: nous pouvons objectivement le considérer comme « amateur de vin
». Mais suite à cette catégorie objective, nous pouvons nous
poser la question suivante pour en savoir plus : « amateur de vin,
d'accord, mais dans quel sens ? Et pourquoi ? »
Cette question peut conduire le sujet concerné à
mener des raisonnement particuliers sur le fait qu'il est amateur du vin dans
divers sens, soit politique, soit économique, soit philosophique, soit
religieux, soit gastronomique, soit par tradition familiale ou locale, soit
personnel etc.
C'est ce type de raisonnements ou de sens donnés par le
sujet concerné que nous entendons par les catégories subjectives.
Autrement dit, ceux qui peuvent relever de la question de « pourquoi
» donnant une raison ou un sens à une catégorie objective
attribuée à la personne. Et c'est dans cette dimension-là
que nous mettons en question les représentations : nous entendons par
celles-ci les éléments subjectivement mis en relation avec une
catégorie objective ou un objet donné. Autrement dit, les
représentations sont des éléments d'idées donnant
des liens significatifs entre un sujet et un objet.
Dans ce sens-là, nous pouvons rejoindre la
définition suivante des représentations sociales données
par B. Fraysse : « modes spécifiques de connaissances du
réel qui permettent aux individus d'agir et de communiquer760
»
Prenons le cas du Projet Nô-Life. Pour Mme. Konno,
l'agriculture n'avait pas de sens pour elle avant de participer à la
formation Nô-Life, même si elle la connaissait certainement de
manière générale. A partir du moment où ses trois
petits enfants sont tous entrés à l'école maternelle, elle
est arrivée à faire le lien entre sa vie et l'agriculture dans le
sens où celle-ci s'est avérée utile pour rendre compatible
le maintien de son « territoire
760 Fraysse, 2000 : 651.
d'(elle)-même » et ses rôles d'épouse et
de mère de trois enfants.
Sans reprende toute son histoire de suite, nous pouvons
soulever au moins les éléments suivants comme
éléments de représentation de l'agriculture chez Mme.
Konno : territoire individuel (« territoire de soi-même ») ;
rôles domestiques en tant que femme (épouse et mère). Et
ces représentations relèvent de son choix opéré
entre un travail à temps partiel quelconque et la production agricole
à petite échelle susceptible de dégager un revenu
supplémentaire (figues ou pêche dans sa motivation initiale) Puis,
c'est son intention plus stratégique et idéale pour construire sa
vie qui détermine le sens de ces représentations.
Schéma : Représentations de l'agriculture
dans la vie de Mme. Konno

Rôle épouse
Mme. Konno
Agriculture
Territoire individuel
Rôle mère de trois enfants
Représentations en action
Ensuite, suite à l'exemple de Mme. Konno, nous pouvons
considérer que les représentations peuvent fortement
dépendre des actions concrètes du sujet. Autrement dit, nous
présupposons ici que nous ne pourrons pas parler de ses
représentations sans parler de son acte de participation à la
formation Nô-Life suivi d'une série de pratiques, activités
et mises en oeuvre concernées.
Il s'agit là de poser la question de « comment »
: comment les sujets (acteurs) mettent en action, pratiquent ou mettent en
oeuvre leurs représentations ? Nous parlons ici des
représentations vécues par les sujets.
Et nous devons prendre en considération les
possibilités de changements des représentations au cours de cette
expérience chez le sujet concerné, il s'agit des
représentations mises en relation avec la réalité
objective et d'autres représentations extérieures au sujet.
Par rapport à la réalité objective, les
représentations peuvent inévitablement être
confrontées aux catégories objectives attribuées au
sujet.
Schéma : Représentations en action dans
une situation réelle

Catégorie objective A
Rep.A
Sujet A
Rep.B
Objet
Catégorie objective B
Rep.C
Rep.D
Rep.E
Sujet B
Chez Mme. Konno, malgré ses représentations
spécifiques quelconques, d'un côté, elle devra rester
femme, avoir un certain âge et un certain niveau de vie
économique, et tenir compte de tous ces éléments qui
entrent dans la situation réelle de son action de la participation
à la formation Nô-Life.
Puis, de l'autre côté, il est inévitable pour
les représentations d'être confrontées à d'autres
représentations données de l'extérieur qui touchent le
même objet dans la dimension de l'action du sujet.
Les représentations de Mme. Konno peuvent être
confrontées aux représentations préalablement
données au Projet Nô-Life par les agents gestionnaires, comme par
exemple l'agriculture de type Ikigai avec un certain nombre
d'éléments de définition attribués par ces agents
(nous les avons étudié dans le chapitre 2).
Les réalités objectives et les
représentations extérieures peuvent ainsi constituer des facteurs
de dynamiques de représentations.
Représentations dans la temporalité de l'action
Etudier les représentations qui sont en action dans une
situation réelle nous amène également à les situer
dans la temporalité. Via cette introduction de la temporalité
dans notre analyse, nous pouvons appréhender les catégories
objectives et subjectives des sujets en terme de leur trajectoire.
D'où les cinq moments de la vie des stagiaires dans le
Projet Nô-Life que nous avons établi, à partir desquels
nous avons essayé de saisir les représentations en action au sein
des stagiaires de la formation Nô-Life : trajectoire (antérieure)
; motivation initiale ; changement d'idées, d'activités et de
mode de vie ; prise de position vis-à-vis de l'agriculture de type
Ikigai ; réflexions sur le devenir du Projet Nô-Life.
Et les représentations situées dans ces cinq
moments peuvent interagir, se construire ou se reconstruire, ce qui peut
finalement permettre aux sujets de changer (conserver ou transformer) la
trajectoire ultérieure. Ce qui nous permet de voir la construction
possible d'une nouvelle typologie du sujet dans le temps ultérieur.
Etude des dynamiques de représentations de l'agriculture
et de la ruralité dans le « jeu » du Projet Nô-Life
Suite à notre réflexion théorique
menée plus haut, reformulons notre recherche du Projet Nô-Life
avec l'exemple de Mme. Konno.
Quant à sa participation à la formation
Nô-Life, nous avons d'abord essayé de saisir les
éléments de représentations qui entrent dans l'esprit de
cette participation, que nous traitons comme parties des catégories
subjectives de Mme. Konno. Pour désigner ces parties, nous avons
employé le terme de la « motivation initiale » de sa
participation.
Ici, notre question se porte sur les dynamiques des
représentations de l'agriculture et de la ruralité à
travers le Projet Nô-Life. Et comme nous l'avons analysé, le
Projet Nô-Life lui-même porte certaines représentations de
l'agriculture et de la ruralité en tant qu'une politique publique, qui
constituent également la motivation initiale et « officielle »
du projet Nô-Life de la part des agents gestionnaires du Projet (BPA et
CAT761) et d'autres agents institutionnels concernés.
Du côté des stagiaires, les
éléments de représentations constitutifs de la motivation
initiale de la participation à la formation Nô-Life, entrent en
relation à la fois avec le devenir de cette action-même et les
représentations du Projet Nô-Life données par les sujets
extérieurs dont principalement les agents gestionnaires, qui impliquent
celles de l'agriculture et de la ruralité.
Nous entendons par cette relation un « jeu » des
représentations de l'agriculture et de la ruralité à
travers le processus du Projet Nô-Life au sein de différents types
d'acteurs concernés. Ensuite, nous avons analysé les aspects de
confrontation entre les représentations portées par les
stagiaires (usagers du Projet), et les agents institutionnels (gestionnaires du
Projet) dans les différents moments de ce jeu : changements
d'idées, d'activités et de mode de vie ; prise de position
vis-à-vis de l'agriculture de type Ikigai ; réflexions sur le
devenir du Projet Nô-Life.
Processus du Projet Nô-Life : un nouveau monde
émergeant de l'agriculture de type Ikigai
Ce jeu du Projet Nô-Life se situe dans les
temporalités des différents types d'acteurs. Ces
temporalités constituent un monde particulier et émergeant de ce
Projet constitué par les trois pôles de l'agriculture de type
Ikigai que nous avons établi dans l'analyse du processus de
l'émergence du Projet Nô-Life au Chapitre 2 : qualité de
vie ; lien social et territorial ; production matérielle. Ici, nous ne
confondons donc pas ces trois pôles avec les représentations
officiellement données par les gestionnaires du Projet. Car les porteurs
des représentations de l'agriculture de type Ikigai ne sont ni seulement
ces gestionnaires, ni le Projet Nô-Life (nous avons vu dans le processus
d'autres projets qui sont en relation avec le Projet Nô-Life). Donc, les
agents gestionnaires du Projet Nô-Life ne sont que quelques-uns parmi
d'autres porteurs des représentations, mais avec leur
spécificité en tant qu'agent singulier, leur mode d'action (ou
mode de vie du Projet), et leur prise de position dans ce jeu.
Typologie et représentations
Dans ce monde émergeant, la typologie des acteurs peut
être à la fois comme déterminant et déterminé
par rapport à leurs représentations suite aux conséquences
du jeu. Autrement dit, les catégories objectives ou subjectives des
acteurs deviennent elles-mêmes des objets de changement (transformation
ou conservation) en entrant dans les trajectoires spécifiques des
acteurs qui sont « en cours ».
La relation entre la typologie des stagiaires et leurs
représentations est donc cyclique et évolutive, par
l'intermédiaire du jeu de ces représentations, dans la
temporalité du monde émergeant avec le processus du Projet
Nô-Life762.
761 BPA : Bureau de la Politique Agricole de la
Municipalité de Toyota ; CAT : Coopérative agricole de Toyota.
762 Nous pouvons mettre en parallèle cette relation avec
la fameuse question de la relation dialectique et évolutive entre la
poule et l'oeuf : « qu'est-ce qui est apparu en premier, l'oeuf ou la
poule ? »
Schéma : Relation entre la typologie et les
représentations

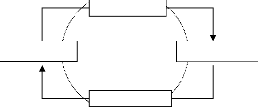
Catégorie objective
Jeu dans la temporalité
Typologie
Catégorie subjective
Représentations
| 


