Relation établie entre acteurs
Quelle relation fut établie entre les acteurs à
travers ce processus de la construction du Projet ? Pour répondre
à cette question, nous allons d'abord constater les positions des sept
acteurs institutionnels telles qu'elles ont été établies
au niveau représentationnel dans le processus de la construction de
l'agriculture de type Ikigai.
Plus haut, nous avons déjà
spécifié les variantes correspondantes à chacun des septs
acteurs institutionnels dans le schéma représentationnel de
l'agriculture de type Ikigai que nous avons établi. Ce schéma
ci-dessous montre leurs prises de position dans le processus de la construction
du Projet Nô-Life.
715 Ville de Toyota (2003) « Plan pour les Zones
spéciales de la Réforme structurelle » : P.4.
Dans ce schéma, nous repérons donc les trois
positions suivantes parmi ces sept acteurs institutionnels :
1. Intérêt général et agricole
cherchant à rendre compatible les trois éléments (BPA et
BDPA)
2. Intérêt du secteur agricole cherchant
à utiliser le lien social et territorial au profit de la production
agricole (CAT, GASATA et ECV). Parmi eux, l'ECV (vulgarisateur agricole) penche
plus du côté de la production matérielle. Tandis que le
GASATA (groupement d'arboriculteurs professionnels) cherche plus à
développer et diversifier le lien social et territorial pour maintenir
leur zone de production frutière dans une situation de crise.
3. Intérêt général mais avec peu
de lien avec l'agriculture, cherchant à améliorer la
qualité de vie de la population locale âgée via le
développement du lien social et territorial. L'agriculture de type
Ikigai peut
Schéma : positions des acteurs institutionnels
dans le
schéma représentationnel de l'agriculture de type
Ikigai

Lien social et
V. 4 Production matérielle
territorial
SCI
CLFS
V. 2
Qualité de vie
BPA* BDPA
CAT* ECV GASATA
V. 1
V. 3
*BPA et CAT sont les co-gestionnaires du Projet Nô-Life.
partiellement servir à cet intérêt. (SCI et
CFLS)
Cette divergence d'intérêts des acteurs
institutionnels n'est évidemment pas sans rapport avec la
différence ou la division objective de leurs rôles institutionnels
respectifs. Mais cela n'est ni figé ni mécanique, quand nous les
situons dans un processus socio-local d'une politique spécifique. Cela
est vrai d'autant plus que la situation de l'agriculture de type Ikigai est
émergente ces dix dernières années et qu'elle est encore
en train de se transformer dans le contexte du vieillissement
acceléré de la population. Autrement dit, nous sommes
amenés à voir ce processus comme un systéme dans un
contexte spatio-temporellement limitée, dans lequel chaque acteur peut
agir et communiquer en interaction avec les éléments
extérieurs et intérieurs y compris ces acteurs eux-mêmes et
les objets concernés716.
Nous reprérons là une relation de «
coopération » mais basée sur une telle divergence de
positions représentationnelles. Nous essaierons d'abord d'eclairer cette
relation en terme de « compromis », dont la définition est
élaborée notamment par Boltanski et Thévenot de
manière à le traiter comme un concept sociologique par exellence
tout en dépassant le sens habituel du terme comme un simple acte
d'arrangement basé sur des concessions mutuelles.
716 Dans ce sens, l'introduction suivante de P. Bourdieu pour
parler du « champ des pouvoirs locaux » est eclairante : « De
même que la `politique du logement' est au niveau central, le produit
d'une longue suite d'interactions accomplies sous contraintes structurales, de
même, les mesures réglementaires qui sont constitutives de cette
politique seront elles-mêmes réinterprétées et
redéfinies au travers d'une nouvelle série d'interactions entre
des agents qui, en fonction de leur position dans des structures objectives de
pouvoir définies à l'échelle d'une unité
territoriale, région ou département, poursuivent des
stratégies différentes ou antagonistes. » (Bourdieu, 2000 :
155)
Relation de compromis
Pour comprendre la relation établie entre les acteurs
institutionnels du Projet Nô-Life, la notion de compromis nous
paraît pertinente. Sur cette notion, L. Boltanski et L. Thévenot
donnent une définition claire à cette notion. Pour notre examen,
nous suivrons l'explication donnée dans un ouvrage récent de M.
Nachi qui nous apporte un bon éclaicissement sur la sociologie de
Boltanski717. D'après M. Nachi, ce sont Boltanski et
Thévenot qui donnèrent à la notion du compromis une place
centrale dans la sociologie718.
Approche du Bien commun : construction d'accords
contraignants
Le compromis constitue une des trois figures de l'accord avec
l'arrangement et la relativisation. Le point commun de ces trois figures est
qu' « ils se présentent comme une alternative lorsque la sortie de
crise devient impossible719 ».
L'arrangement est défini comme un « accord
contingent » qui n'a pas de justification en commun entre les personnes
qui procèdent à cet arrangement. Il s'arrange uniquement sur la
base de leurs intérêts respectifs. Il est donc
relativiste720.
Puis, dans la relativisation, on suspend l'accord afin
d'éviter le désaccord et de détendre la
situation721.
A la différence de ces deux formes de l'accord, le
compromis ne se base pas uniquement sur les intérêts particuliers
des personnes qui entrent en compromis, mais il se base sur un « bien
commun » qui ne relève ni de l'une ni de l'autre partie, mais
comprend les deux722.
Donc, le compromis implique nécessairement une
pluralité de grandeurs ayant chacune une part de justification
dotée d'une généralité spécifique. La
définition du compromis est ainsi donnée par Thévenot :
« une action soumise à des contraintes plus fortes, cherchant
à être justifiable - ou raisonnable - et à s'inscrire dans
un équilibre global723 ». Puis, en visant un bien
commun, le compromis a pour objectif de résoudre le conflit, la tension,
le désaccord entre des personnes appartenant à différentes
grandeurs. Donc, dans une situation de compromis, des contraintes et des
conflits entre les parties sont indissociables724.
Puis, la situation du compromis est complexe et hybride, car
elle est marquée par la présence d'objets
hétérogènes725. Et ce bien commun suppose des
motifs visant une construction et une manifestation d'accords plus ou moins
durables726.
Ambiguïté : contraintes et question de
compatibilité
Une des caractéristiques du compromis réside dans
l'ambiguïté de son principe. Celle-ci du fait que les
717 NACHI, M. (2006), « D'une pragmatique du compromis
à une phéoménologie de l'arrangement » (Chapitre IV),
Introduction à la sociologie pragmatique : vers un nouveau «
style » sociologique ?, Paris, Armand Colin : p.173-185. Dans cette
partie sur le compromis, il se base principalement sur l'ouvrage suivant :
BOLTANSKI, L., THEVENOT, L. (1991), De la justification. Les Economies de
la grandeur, Paris, Gallimard.
718 Chez Boltanski et Thévenot, « il est même
érigé au rang d'un concept central et bénéficie
d'une réflexion de la plus grande importance » (Nachi, 2006 : 174).
Ils sont « parmi les rares auteurs qui sont allés le plus loin dans
la problématisation du compromis » (Ibid.).
719 Ibid.: 173.
720 Ibid. : 180-181.
721 Ibid. : 181-183.
722 Ibid. : 175.
723 Thévenot, 1989 : p177, cité par Nachi, 2006 :
174.
724 « C'est cette pluralité cosubstantielle au monde
de la vie sociale qui véhicule en son sein les marques du compromis.
Car, dans un tel monde, le bien commun ne peut être atteint par le
recours à une grandeur unique. Il faut le concours de plusieurs
principes d'équivalence, de plusieurs formes de
généralités. Le compromis a pour objectif de
résoudre des conflits et de régler des différends en
mobilisant des principes et des objets relevant de mondes différents
». Nachi, 2006 : 174)
725 « la multiplication des objets composites qui se
corroborent et leur identification à une forme commune contribuent ainsi
à stabiliser, à frayer le compromis. Lorsqu'un compromis est
frayé, les êtres qu'il rapproche deviennent difficilement
détachables. » (BOLTANSKI, L., THEVENOT, L., 1991 : 340,
cité par Nachi, 2006 : 175)
726 « Une telle figure sous-entend des relations
interindividuelles animées par des motifs visant `à construire,
à manifester et à sceller des accords plus ou moins durables'
»( BOLTANSKI, L., THEVENOT, L., 1991 : 39, cité par Nachi, 2006 :
175)
personnes entrant en compromis renoncent à clarifier les
principes sur lesquels se base leur compromis, sans pour autant exclure
l'impératif de justification727.
Cette ambiguïté est en partie due aux contraintes
du compromis, parce que celui-ci doit impliquer des « principes
d'équivalence satisfaisant différents ordres de grandeur »
ainsi que le « rapprochement de grandeurs a priori incompatibles
»728. Dans le compromis, il suppose donc la question de
compatibilité des objets relevant de mondes
différents729.
Fragilité
L'ambiguïté des principes et les contraintes du
compromis constituent également des sources de fragilité. Cette
fragilité est inévitable car dans le compromis, l'identité
des parties ne peut pas être mise en cause afin de maintenir le
compromis730. C'est pourquoi le compromis nécessite que le
bien commun (ou l'intérêt général) visé
dépasse un simple arrangement basé uniquement sur les
intérêts particuliers. Il s'agit de la constitution d'une «
cité » par ce bien commun731. Dans cette optique, la
dispute entre les parties n'est pas forcément réglée par
une logique légitime d'un seul monde, mais suspendue en vue de
constituer un compromis. Donc, un compromis risque toujours d'être
déstabilisé ou mis en question par la critique ou la
dénonciation732.
Possibilité de transformation ou de
consolidation
Pour surmonter cette fragilité, il faut que le
compromis fasse l'objet d'une transformation ou d'une consolidation « en
faisant référence à des êtres et à des objets
appartenant à divers mondes mais disposant d'une identité
autonome733. Mais comment ? Selon Boltanski et Thévenot, il
faut doter les éléments constitutifs du compromis d' « une
identité propre » en mettant ces éléments « au
service du bien commun734 ».
Mise en parallèle du concept de compromis avec les
autres éléments théoriques
Après ce survol des caractéristiques du
compromis tel qu'il est conceptualisé par Boltanski et Thévenot,
essayons de mettre en parallèle ce concept avec les autres
éléments théoriques mobilisés dans notre analyse :
représentation sociale ; bricolage ; transaction sociale ;
transcodage.
Représentation sociale
L'approche des représentations sociales que nous avons
présenté dans le chapitre 1, consiste à comprendre comme
un processus la relation dialectique entre les représentations
portées par les acteurs concernés, leurs rapports sociaux et
leurs actions. Surtout via la notion de l'objectivation et celle de l'ancrage,
cette approche vise à articuler les éléments
représentationnels et réels dans leur complexité.
Dans ce sens, cette approche, nous semble-t-il, peut
être un outil pertinent pour éclairer la situation complexe de
compromis. D'autant plus que celle-ci est marquée par la présence
d'objets hétérogènes relevant de différents mondes
qui, à notre égard, impliquent nécessairement des produits
de représentations sociales. La
727 Nachi, 2006 : 175.
728 Ibid. : 175.
729 « (...) il [compromis] présume le
dépassement des intérêts purement individuels ainsi que
l'existence d'un bien supérieur
commun : `le compromis suggère l'éventualité
d'un principe capable de rendre compatibles des jugements s'appuyant sur des
objets relevant de mondes différents.(...)' » (Ibid. : 176)
730 Ibid. : 176.
731 Ibid.
732 Ibid.
733 Ibid. : 177.
734 « une façon de durcir le compromis est de mettre
au service du bien commun des objets composés d'éléments
relevant de
différents mondes et de les doter d'une identité
propre en sorte que leur forme ne soit pas reconnaissable si on leur soustrait
l'un ou l'autre des éléments d'origine disparate dont ils sont
constitués » (BOLTANSKI, L., THEVENOT, L., 1991 : 339, cité
par Nachi,
2006 : 177)
question de mode d'articulation de ces objets
hétérogènes pour constituer un compromis nous renvoie
directement à interroger celui des représentations sociales.
Bricolage
Nous appliquons le concept du bricolage tel qu'il a
été défini par Lévi-Strauss, pour comprendre les
manières dont les acteurs réalisent leurs projets, pas dans le
sens d'une application mécanique de concepts selon des objectifs
préétablis, mais celui d'inventions par appropriation et
réappropriation des objets existants.
Nous pouvons situer le compromis dans le processus de
bricolage, d'autant plus que, nous l'avons vu plus haut, celui-ci implique
toujours « un compromis entre la structure de l'ensemble instrumental et
celle du projet ». Autrement dit, quand on considère le processus
de bricolage comme un processus social, on doit toujours tenir compte du
compromis mis en place entre les acteurs concernés.
Autrement dit, l'oeuvre d'un bricolage collectif est celle
d'un compromis effectué dans son processus. Dans ce sens, ce n'est pas,
nous semble-t-il, un hasard que le caractère précaire et ambigu
du compromis qui implique une possibilité ou une nécessité
de s'appuyer sur un bien commun généralisable (constitution d'une
cité), rejoint également une des caractéristiques de
l'oeuvre du bricolage donnée par Lévi-strauss. Et comme nous
l'avons vu plus haut, l'oeuvre du bricolage dépasse un résultat
contingent d'une action humaine, mais celui apportant un « sens » qui
n'exclut pas la possibilité de se généraliser et ainsi de
généraliser.
Transaction sociale
Le compromis implique certainement un point commun fort avec
le modèle de transaction de Mormont, d'autant plus que Mormont
envisageait la transaction sociale, nous l'avons vu, comme cadre stabilisateur
permettant l'anticipation et l'engagement des acteurs, qui ne se base pas
uniquement sur leurs intérêts sur le court terme, mais qui permet
d'engager leur identité.
La création de nouveaux dispositifs alternatifs
proposée par Mormont du point de vue de la transaction sociale, et la
constitution du bien commun dépassant les intérêts
particuliers des parties, qui suppose de renforcer le compromis et de lui
donner « une identité propre », peuvent, nous semble-il,
être deux approches complémentaires. Le lien théorique
entre le paradigme de la transaction sociale et la sociologie de Boltanski et
de Thévenot nous reste à explorer735.
Transcodage
Enfin, la technique du transcodage pourrait également
être un outil pertinent pour éclairer les conditions du compromis.
Ceci d'autant plus que le transcodage vise à équilibrer les
pratiques et les positions de différents types d'acteurs.
Cependant, il nous semble y avoir une distance de nuances
entre les « visées » du compromis et du transcodage : En
effet, le transcodage suppose que, dans une « situation d'être en
pouvoir » que celui-ci implique, les acteurs peuvent se trouver soit dans
une situation d'autonomie, soit dans une situation de dépendance. Ce qui
amènent les acteurs à lutter pour la « maîtrise des
réseaux d'action publique ». Le transcodage a donc pour objectif
d'équilibrer cette situation. Sur ce point, nous avons une distance
entre le transcodage et le compromis supposant de constituer un « bien
commun » plus ou moins transcendant entre les les parties, relevant de
différents mondes. Le lien théorique entre ces deux concepts nous
reste également à explorer.
Compromis dans le processsus de la construction du Projet
Nô -Life
Le concept du compromis peut, nous semble-t-il, éclairer
la situation de la relation telle qu'elle a été établie
735
entre les agents dans le processus de la construction du Projet
Nô-Life, en terme de l'approche du bien commun, l'ambiguïté
du principe du compromis et la fragilité de celui-ci.
D'abord, le processus de la construction du Projet
Nô-Life s'inscrit, au moins initialement, dans une approche du «
bien commun » de manière explicite : il s'agit de valoriser
l'agriculture et la ruralité non de manière sectorielle, mais via
une « participation citoyenne » (surtout depuis le Plan de 96) en les
considérant comme un bien commun appartenant aux citoyens mais non
uniquement aux agriculteurs.
Cependant, nous l'avons relevé dans l'examen de la
position respective des gestionnaires du Projet Nô-Life (BPA et CAT),
l'ambiguïté du principe du Projet Nô-Life est en question en
raison d'une divergence de leurs propres visions sectorielles tant sur le court
terme que sur le long terme.
En principe, du côté du BPA, il est coincé
entre l'intérêt général qu'il porte, et
l'intérêt du secteur agricole porté par la CAT. Du
côté de la CAT, en réalité, son intérêt
porte exclusivement sur le profit du secteur agricole, malgré la
complexité de son raisonnement.
Intéréts sur le court terme
Sur le court terme, le BPA, en tant qu'agent municipal, doit
d'abord satisfaire le public en répondant le plus possible aux demandes
immédiates des usagers (stagiaires) du Projet. Du coup, le
critère de sélection des stagiaires doit être souple .
C'est pourquoi le Centre Nô-Life accueille divers types de stagiaires qui
ne correspondent pas souvent à l'objectif productiviste du Projet
Nô-Life, (ce qui est d'ailleurs compréhensible en
réalité, nous le verrons dans le Chapitre 3). Puis, quand il doit
présenter le résultat ou la vertu concret du Projet auprès
de la municipalité, il doit nécessairement recourrir aux
éléments quantifiables et immédiats avec des chiffres
concrets (surtout le nombre de stagiaires et la surface agricole mise en
location avec les stagiaires ayant terminé la formation Nô-Life)
plutôt qu'aux éléments non quantifiables qui
dépendent beaucoup du long terme ou de la subjectivité
(qualité de vie, lien social et territorial).
Face à cette exigence du BPA, l'engagement de la CAT
reste mitigé à cause de la faible importance économique
que le Projet Nô-Life pourrait apporter au secteur agricole : la CAT
elle-même est en réalité un grand organisme financier et
commercial dans lequel le domaine des activités agricoles est en
permanence déficitaire736. Si bien que quelques points de
désaccord étaient déjà apparents pour la conduite
actuelle du Projet, sur l'élargissement du Centre Nô-Life
effectué en 2006, à deux autres quartiers : l'un en plaine dans
une zone fortement agricole, l'autre en moyenne montagne, dans une commune
venant de fusionner avec la Ville de Toyota. Ce choix était pour
favoriser la demande de la population locale et l'égalité de
l'offre des services publics en terme géographique. D'après
Monsieur K, président du Centre Nô-Life, la demande pour
l'installation du Centre Nô-Life est surtout forte de la part des
communes de moyenne montagne dépeuplées qui viennent de fusionner
avec la Ville de Toyota, comme un « cadeau d'échange » de
cette fusion. Mais la CAT n'était pas d'accord avec cette
décision. Car ce qui compte pour la CAT, nous l'avons vu, est de «
former les agriculteurs » au lieu de « satisfaire le plus possible le
public ». A cet effet, le nombre des stagiaires accueillis par le Centre
Nô-Life doit être minimum pour la CAT afin de pouvoir
réaliser son objectif de la formation agricole, et
l'élargissement de la taille du Projet Nô-Life n'est pas
prioritaire pour elle.
Intérêts sur le long terme : question de
l'identité agricole
La divergence d'intérêts sectoriaux porte
également sur le long terme qui concerne directement la
définition légitime du métier agricole. La seule
référence légitime de la profession agricole renvoie, en
fait, au montant de
736 Nous avons vu la structure interne de la coopérative :
l'importance économique occupée par les activités
agricoles à l'intérieur de la CAT (achat commun des
matériels agricoles, vente commune des produits agricoles) est
déjà extrèmement faible par rapport aux autres domaines
d'activités. En tant que coopérative agricole, les
coopératives agricoles japonaises effectuent surtout un ensemble de
services financiers (crédits, mutualité, immobiliers, commerce de
détail etc) et également ceux non agricoles (services
immobiliers, divers services dans le domaine de la « vie » comme les
supermarchés, les cérémonies funéraires et services
de l'aide aux personnes âgées dépendantes). Surtout les
services pour les personnes âgées ou leur décès sont
aujourd'hui un marché à conquérir à l'ère du
vieillissement...
revenu agricole annuel des « agriculteurs
qualifiés » considérés comme « porteurs »
de l'agriculture, dont la définition relève de la politique
agricole nationale. Et ce sont ceux qui peuvent bénéficier du
prêt agricole départemental contrôlé par l'ECV
(vulgarisateur agricole). Pour en bénéficier, il faut
déposer un plan planifiant une production agricole susceptible de
dégager plus de 2 500 000 yens de revenu agricole annuel.
L'objectif du Projet Nô-Life semble être
fixé par référence à ce critère
économique. De plus, nous l'avons vu, le montant de revenu agricole
annuel donné par le Projet Nô-Life (un million de yens) s'enracine
également dans l'histoire de la modernisation agricole japonaise des
années 70 comme un slogan national, ensuite dans les années 80
comme un objectif économique donné à l' « agriculture
de type Ikigai » promue par la politique de la vulgarisation agricole dans
la région proche de Toyota, pour les femmes et hommes âgés
des foyers agricoles pluriactifs. Cet objectif est donc lui-même un
référentiel historique de la modernisation agricole.
Donc, la définition légitime du métier
agricole reste quasi-exclusivement dans le monde agricole, et elle se
reflète même dans l'objectif du Projet Nô-Life qui a permis
le compromis entre la CAT et le BPA.
Ainsi, nous pouvons comprendre plus ce que veut
substantiellement dire l'intérêt de « former les agriculteurs
» de la part de la CAT. Et du côté du BPA, il n'a qu'à
se référer à la définition telle qu'elle est
donnée dans le monde agricole, tant qu'il n'a pas d'autres
définitions alternatives du métier agricole, à part la
représentation ordinaire comme les « jardiniers pour le loisir
». Si bien que cet objectif lucratif du Projet Nô-Life a
été décidé par une concession de la part du BPA qui
n'était pas forcément favorable à cet objectif : il
souhaitait donner plus de liberté aux stagiaires pour choisir un type
d'activités agricoles quelconque.
Inégalité de l'effet symbolique du Projet
En plus, selon notre enquête, c'était apparement
l'initiative du maire de la Ville de Toyota (élu en 2004) qui a le plus
fortement poussé le Projet Nô-Life jusqu'à son
démarrage en 2004 (la même année que son
élection...). Ce qui amène Monsieur S, directeur de la Direction
des activités agricoles de la CAT, à se plaindre de l'absence du
« mérite » de la part de la CAT pour la réalisation du
Projet Nô-Life. L'effet « symbolique » de la réussite du
Projet compte ainsi dans leur relation de compromis.
Fragilité du compromis Nô-Life
Comme dit Boltanski, la fragilité du compromis est due
au fait que le compromis ne peut pas mettre en cause des identités des
parties et que la dispute entre elles reste non réglée. Ceci
semble bien être le cas dans le Projet Nô-Life entre les parties
appartenant au monde agricole et au monde des services publics locaux.
Selon notre observation, le compromis entre les agents
co-gestionnaires du Projet Nô-Life, où un
référentiel historique de la modernisation agricole productiviste
se reflète fortement, contraindra, du moins dans l'immédiat, plus
ces stagiaires de la formation Nô-Life que les agents institutionnels
concernés, qui n'ont certainement pas fait partie de ce compromis
initial. Dans le Chapitre 3, nous aborderons les conséquences de ce
compromis en examinant les réactions de ces stagiaires. Il s'agira alors
du compromis du Projet Nô-Life qui sera « à l'épreuve
» de la vie des stagiaires. Là, la question de renforcer ce
compromis en le dotant d'une « identité propre » sera
envisageable par référence aux représentations relevants
des acteurs appartenant à différents mondes autour de l'objet de
l'agriculture de type Ikigai...
Rapport de pouvoirs entre les sept agents
Enfin, le compromis tel qu'il est constitué pour la
construction du Projet Nô-Life, est-il équilibré ou
déséquilibré ? Pour répondre à cette
question, nous allons examiner le rapport de pouvoirs établi entre les
sept acteurs institutionnels à partir du schéma ci-dessous.
Dans ce schéma, nous pouvons facilement repérer
la forte emprise qu'ont des agents appartenant au monde agricole professionnel
(BPA, CAT, BDPA, ECV, GASATA), sur la réalisation du Projet
Nô-Life, par rapport aux deux autres agents (SCI, CFLS) qui n'y sont
qu'indirectement impliqués.
Parmi les cinq agents appartenant au monde agricole
professionnel, quatre agents (BPA ; CAT ; l'ECV : vulgarisateur agricole ;
GASATA : groupement d'arboriculteurs professionnels) s'impliquent directement
dans les activités de la formation Nô-Life. Le BDPA
(administration agricole départementale) conserve un rôle de
tutelle. Lors du contrôle final du stage individuel sur l'état
d'entretien des cultures, quelques responsables de ces cinq agents sont
présents pour donner leurs commentaires.
Puis, traditionnellement, ces cinq agents constituent entre
eux des liens de partenariat. Si bien qu'ils sont constamment en contact dans
leurs activités routinières liées au monde agricole
professionnel. Ce qui renforce leur lien social.
En fait, les deux autres agents ne sont qu'indirectement
impliqués dans les activités du Projet Nô-Life. Le SCI
(agent des services publics locaux pour Ikigai des personnes
âgées), maintient juste son rapport avec le Centre Nô-Life
via son propre projet « Ferme-école des personnes
âgées » qui joue le rôle médiateur entre les
personnes âgées en général et le Centre
Nô-Life. En effet, cette école peut être une première
étape pour apprendre pendant un an les pratiques agricoles en tant que
débutant, et ensuite s'inscrire éventuellement au Centre
Nô-Life pour passer à l'étape suivante. Mais, nous l'avons
vu, l'écart est net entre la position du SCI et le monde agricole
professionnel. Pour le SCI, les activités agricoles pour les personnes
âgées ne peuvent avoir de siginification qu'en relation avec
l'amélioration de la qualité de vie ou de le lien social et
territorial des personnes âgées. Et par là, l'agriculture
peut avoir un lien avec l'aménagement de la Ville dans le sens du
paysage ou de l'aménité, mais le développement agricole au
sens sectoriel et productiviste n'entre pas dans l'approche du SCI.
Schéma : Rapport institutionnel dans le Projet
Nô-Life
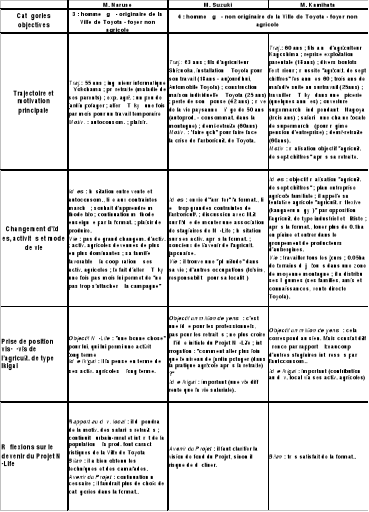
Monde syndical
et salarial
Monde services
publics locaux
(Municipalité)
Monde agricole
professionnel
BDPA
CFLS
SCI
BPA
CAT
ECV
GASATA
: Lien de partenariat direct pour le Projet
: Lien de partenariat indirect pour le Projet Nô-Life
: Lien de partenariat traditionnel
Si le CFLS joue le rôle de médiateur entre les
retraités salariés résidant dans la Ville de Toyota et le
Projet Nô-Life via une offre d'informations auprès de ses
adhérents, il ne s'implique pas dans les activités de la
formation Nô-Life. De même, ces dix dernières années,
il a établi un lien de partenariat avec la Municipalité via
diverses thématiques concernant la vie locale (aménagement
urbain, animation etc) dans lesquelles la thématique de la promotion
d'Ikigai des personnes âgées est abordée en terme de la
qualité de vie et du lien social et territorial. La thématique de
l'agriculture l'intéresse également, mais elle est traitée
dans le cadre de sa politique syndicale à l'échelle nationale,
soit pour l'autosuffisance alimentaire, soit pour la préservation de
l'environnement naturel et rural.
Selon son point de vue (informellement énoncé
lors de notre entretien), le Projet Nô-Life ne pourrait pas contribuer au
développement agricole dans le sens sectoriel et productiviste. A cet
effet, la mobilisation des personnes âgées actives sera incertaine
et insuffisante. Ainsi, il n'a pas l'intention de plus s'impliquer dans le
Projet Nô-Life.
| 


