2 Redéfinition des règles du jeu
Revenons au cadre de transaction proposé par Mormont.
Deuxièmement, pour faire face aux incertitutdes complexes aux niveaux
contextuel et social, la gestion de l'environnement doit effectuer dans son
application une mise en relation de différents domaines
socio-économiques. Il s'agit de la nécessité d'une «
articulation concrète de données physiques et
socio-économiques »639. En se référant
à la sociologie de l'innovation (Latour, Callon), cette démarche
de l'articulation concrète « `invente' une mise en relation
nouvelle, et modifie l'un ou l'autre domaine afin de les rendre
compatibles640 ».
Cette démarche est techniquement « un arragnement
local entre des données biophysiques et sociales (contraintes
juridiques, rapports économiques, demandes sociales), de manière
à former un dispositif qui les harmonise provisoirement au moins, mais
avec assez de stabilité pour que la technique puisse fonctionner et
répondre à des `besoins`641 ».
Puis, les effets causés par l'ensemble de ces processus
sont en question. En effet, ils sont imprévus et non
maîtrisés, et surtout difficiles à analyser en terme des
causalités car « elles sont à la fois écologiques,
techniques, économiques, culturelles et juridiques642 ».
Ce qui spécifie le problème de l'environnement, et «
à tel point qu'il devient nécessaire, d'intégrer dans
l'analyse sociologique l'ensemble de ces processus643 ».
Enfin, Mormont relève, comme problème dans la
redéfinition des règles du jeu pour la gestion de
l'environnement, le « conflit de légitimité
»644. Il s'agit non seulemnt des demandes de différents
types d'acteurs, mais de « questions de fait ou d'évaluation de la
réalité et de l'avenir645 ».
Essayons de transposer dans notre contexte de la gestion du
vieillissement, les enjeux relevés par Mormont sur la
redéfinition des régles du jeu en matière de gestion de
l'environnement. D'abord, nous savons que la gestion du veillissement
nécessite également une mise en relation de différents
domaines socio-économiques, comme dans la gestion de l'environnement.
Nous avons ensuite vu dans la partie de l'acteur 2,
l'évolution du rapport entre acteurs du vieillissement : du rapport
auparavant limité par celui de l'Etat (établissements publics
gérés par l'Etat centralisé) et la famille, aux rapports
multipliés de manière décentralisée concernant
plusieurs domaines diversifiés : économique, santé
physique (dépendance et maladie), santé mentale, diverses
activités de personnes âgées. Et à plusieurs
échelles institutionnelles : Etat, entreprises, syndicats,
collectivités territoriales, hôpitaux, établissements
publics et privés pour les aides aux personnes âgées
dépendantes, diverses organisations pour les activités des
personnes
fortement hybridé la population agricole avec la
population et le système urbains. Berque explique ainsi la
configuration
urbaine-rurale en comparaison avec celle française, ainsi
en 1973 « (...) une imbrication des franges urbaines et de la
campagne,
dont la banlieue parisienne ne donne pas idée ;
là, antinomie entre la grande culture et le résidentiel,
opposition accusée par le
relief ; ici, que ce soit autour d'Osaka, de Nagoya ou de
Tôkyô, rien d'abord qui rappelle les espaces découverts des
plateaux de grande culture de la région parisienne ; puis, la
rizière comme l'habitat ont la même prédilection pour les
mêmes espaces plans ;
enfin, l'habitat ne diffère pas sensiblement de la
ville à sa couronne et à la grande banlieue, à ceci
près qu'il se desserre
relativement : c'est mutatis mutandis comme si l'on trouvait
le même habitat pavillonnaire du plateau de Saclay à la plaine
d'Issy-les-Moulineaux et à Montparnasse. » (Berque, 1973 :
324)
- Toutefois, nous pouvons également évoquer
l'impact que peut avoir le vieillisement de la population
générale dans la campagne française par rapport à
la mobilité des personnes âgées. « Les
mobilités de retraites vers les espaces ruraux ont un peu
contribué à
leur regain démographique au cours des
dernières décennies (...). L'accroissement de cette population
dans les vingt prochaines années est une donnée (en 2020, un
Français sur trois aura plus de 60 ans) ». Mais ce facteur
implique beaucoup d'incertitudes
sur les comportements et modes de vie futurs des personnes
âgées. « Mais il y a beaucoup d'incertitutdes sur les
facteurs ou
variables explicatifs des comportements et modes de vie
futurs des personnes âgées : les ressources et contraintes
budgétaires des retraités, la répartition territoriale de
l'offre d'équipements et de services d'accompagnement en matière
de soins et de santé, les
types d'activités que les seniors pratiqueront dans
l'avenir sont par exemple objet d'incertitudes, et pour certains aspects de
controverses. »(Perrier-Cornet, 2000, 39-40) N'est-il pas aisé
d'y ajouter comme facteur explicatif, soit le contexte du
« vieillissement actif », soit, pourquoi pas, celui
d'Ikigai à la française ?
639 Ibid. : 213.
640 Ibid.
641 Ibid.
642 Ibid. : 214
643 Ibid. : 214
644 Ibid.
645 Ibid.
âgées (Centre des ressources humaines
âgées, Clubs des Personnes âgées, éducation
permanente) et enfin familles etc.
S'agissant du contexte du Projet Nô-Life, nous pouvons
dire que le rapport établi entre les acteurs concernés, est une
des variables locales de la forme multiple et complexe des rapports entre
acteurs du vieillissement mentionnée ci-dessus. Dans le cas du Projet
Nô-Life, nous avons donc : collectivités territoriales
(administration agricole : BPA, BDPA, services pour les activités des
personnes âgées : SCI) ; organismes du secteur agricole
(coopérative agricole : CAT, vulgarisatition agricole : ECV) ; syndicat
ouvrier : CLFS ; agriculteurs professionnels : GASATA, et individus
variés : stagiaires de la formation Nô-Life.
Transcodage : un outil pertinent pour le processus bricolage -
transaction
Dans ce contexte, nous pourrions parler d'une « technique
» de mise en relation des acteurs de politique publique,
opérée dans le processus de la construction du Projet
Nô-Life : celle du « transcodage ».
Cette notion est proposée par P. Lascoumes pour
comprendre les choses qui se traduisent au sein d'acteurs en réseaux
d'action publique646. Pour élaborer cette notion, Lascoumes a
adapté la notion de « traduction » de la sociologie des
sciences (B. Latour, M. Callon), qui implique l'idée de donner aux
autres une interprétation de leurs idées et intérêts
par le langage de ce qui interpréte (traducteur), dans le but de mieux
réaliser la stratégie du traducteur647.
Nous allons repérer ici les caractéristiques de la
notion du transcodage sur les quatre points suivants : 1 Equilibrage ; 2
Situation de pouvoir ; 3 Inégalité de pouvoirs ; 4 Concurrence et
luttes.
1 Equilibrage. Premièrement, le transcodage,
à la différence de la traduction qui essaie d'intégrer
à la stratégie du traducteur, les stratégies des autres
acteurs de types différents, essaie d'équilibrer les
différentes traductions en présence dans l'élaboration des
politiques publiques648.
Dans ce sens, l'approche du transcodage nous semble plus
relativiste que la traduction, et plus éclairant pour comprendre une
relation de compromis qui met en relation des acteurs en conservant leurs
intérêts divergeants.
Ensuite, Lascoumes met l'accent sur le "recyclage" d'idées
et de pratiques déjà établies au sein des acteurs
concernés649.
A partir de là, nous pouvons considérer que le
transcodage est une technique spécifique d'arrangement ou de
coordination qui permet au « transcodeur » de respecter le processus
de bricolages effectués en interaction avec différents types
d'acteurs.
Cela pourrait entrer dans le paradigme de transaction que nous
allons évoquer plus bas, à savoir un cadre pour le
développement d'une politique publique, dans lequel l'anticipation et
l'engagement des acteurs sont primordiaux. Car le transcodage permet aux
acteurs de conserver leur propre manière d'agir et de communiquer sous
forme de réseaux dans le cadre d'une action publique.
2 Situation de pouvoir. Selon Lascoumes,
l'opération de transcodage ne fait pas qu'équilibrer les
positions des
uns et des autres, mais elle implique aussi un rapport de
pouvoir : « être en situation de pouvoir ». Donc, cela
646 LASCOUMES, P.(1996),"Rendre gouvernable : de la "traduction"
au "transcodage" L'analyse des processus de changement dans les réseaux
d'action publique", p.325-338 in La Gouvernabilité, PUF.
647 « J'appellerai traduction l'interprétation
donnée, par ceux qui construisent les faits, de leurs
intérêts et de ceux des gens qu'ils recrutent » LATOUR, Br.
(1989), Science en action : p.172.
648 « La signification que nous donnons à la notion
de `transcodage' s'inspire de celle de 'traduction' utilisée par Michel
Callon, dans la mesure où ce processus concerne une activité de
production de sens par mise en relation d'acteurs autonomes et transaction
entre des perspectives hétérogènes. La traduction est
ainsi une activité spécifique aux réseaux socio-techniques
et technico-économiques étudiés par la sociologie des
sciences ; mais des activités de même type s'observent dans les
réseaux d'action publique, 'polity' ou 'community network'. »
(Lascoumes, 1998 : 336) ; « Les oprérations de transcodage sont
celles de l'agrégation de positions diffuses, le recyclage de pratiques
établies, la diffusion élargie des constructions
effectuées, le tracé d'un cadre d'évaluation des actions
entreprises » (Ibid.)
649 « Tous les discours portants sur la 'nouveauté'
des problèmes et des politiques sont d'abord là pour occulter
l'essntiel, à savoir qu'il s'agit en grande partie d'entreprises de
recyclage. C'est-à-dire de conversion-adaptation du
'déjà-là' de l'action publique, de ses données
préexistantes, de ses catégories d'analyse, de ses
découpages institutionnels, de ses pratiques routinisées »
(Ibid. : 335)
implique le fait de s'imposer aux autres, et de les rendre
dépendants650.
3 Inégalité de pouvoirs. Le transcodage
suppose ensuite l'inégalité des capacités d'agir des
acteurs concernés dans leur situation objective qui
précontraignent leurs espaces d'interactions651.
4 Concurrence et luttes. En tenant compte de cette
inégalité de pouvoirs des acteurs prélimités, le
transcodage ne peut pas s'effectuer dans une condition égale pour tous
les acteurs. Du coup, le jeu des acteurs concernés doit se
dérouler dans un « univers conccurentiel » dans lequel «
tous les acteurs et actants ne disposent pas des mêmes pouvoirs
performatifs652 ».
Dans un tel contexte, selon Lascoumes, le transcodage devient une
sorte de « lutte » pour maîtriser les réseaux
eux-mêmes d'action publique653.
Enfin, étant une manière d'arrangement local dans
une action publique, le transcodage implique l'équilibre et la tension
de pouvoirs d'agir entre différents types d'acteurs impliqués.
Il nous permet d'envisager de mettre en relation
différents types d'acteurs concernés dans une relation
d'équilibre qui leur permettra d'anticiper et d'engager dans le
processus de construction d'une politique publique.
Puis, il nous permet également d'envisager un rapport
de forces inégal donné, de façon à ne pas
l'interpréter ou le réduire à celui
dominant-dominé, mais de l'accepter comme une structure possible
à restructurer via des actions constructives.
Transcodage dans le processus du Projet Nô-Life
Le transcodage a joué un rôle important au cours
du processus de coopération entre les agents du secteur agricole et ceux
du secteur des services publics qui ont abouti à créer le Projet
Nô-Life autour de l'idée de promouvoir l'agriculture de type
Ikigai en s'appuyant sur la population locale âgée mais
potentiellement active (baby-boomers), et ainsi de mettre en valeur les
terrains agricoles menacés de délabrement.
Le transcodage s'est opéré entre les deux
thématiques suivantes relevant chacune d'un domaine politique : la
politique agricole de la conservation (ou développement) agricole ; la
politique sociale du vieillissement du la promotion (ou développement)
d'Ikigai des personnes âgées contribuant à la
prévention de la dépendance.
Ces deux politiques se sont retrouvées autour d'un
référentiel commun pour construire le Projet Nô-Life :
Ikigai. Mais comment ?
Le BPA (Bureau de La politique agricole) de la
Municipalité de Toyota plutôt ancrée dans le secteur
agricole, essayait de trouver des moyens de résoudre le problème
du développement agricole (crise) via une approche du « bien commun
» sous l'implusion de l'idée de la multifonctionalité de
l'agriculture et de la ruralité depuis l'établissement de son
premier plan agricole décennal nommé « Toyota agri-bility
plan 2005 » en 1996. Depuis lors, elle a tenté de trouver non
uniquement dans le secteur agricole, mais davantage dans le public
général, de nouveaux appuis (partenaire) et une nouvelle
destination (client) de sa politique agricole.
Nous l'avons vu dans la partie de l'acteur 1 (BPA : Bureau de
la politique agricole), ce plan s'inscrivait explicitement dans le contexte de
la restructuration de la politique agricole nationale suite au contexte de la
libéralisation du marché extérieur et intérieur
(mondialisation économique) marqué par les accords du GATT
650 « Transcoder, c'est rendre gouvernable. (...) Etre en
situation de pouvoir dans un réseau d'action publique, c'est avoir une
forte capacité d'intégration de
l'hétérogène, de recyclage des pratiques discursives et
matérielles routinisées, de développement d'alliances
stabilisantes et de production de principes de jugement des actions
entreprises. Etre en situation de dépendance, c'est au contraire se voir
imposer des qualifications, des mises en relations, des reconversions, c'est
subir des alliances forcées et des principes de jugement » (Ibid.:
338)
651 « rappeler que les capacités performatives des
actants (humains et objets) varient selon un ensemble de déterminants
économiques et sociaux qui structurent les espaces dans lesquels
s'accomplissent les interactions ». (Ibid. :328)
652 Ibid. : 338.
653 « Face aux changements sociaux, le transcodage est en
quelque sorte la lutte pour la maîtrise des réseaux d'action
publique, de leurs frontières, de leur acteurs, de leurs
intermédiaires, de leurs productions et des significations communes
données aux interactions qui en assurent la cohésion »
(Ibid.)
relatifs à l'agriculture en 1994.
Puis, le BPA a progressivement dirigé sa politique
agricole vers le public dans ce contexte en établissant le lien entre
celui-ci et l'agriculture dans l'optique de la multifonctionalité. Mais
dans un premier temps, son approche penchait plutôt vers le loisir, le
repos et la santé (Parc rural qui a échoué, Jardins
familiaux et citoyens).
Puis, la CAT (Coopérative agricole de Toyota), agent
principal du secteur agricole privé et partenaire traditionnel du BPA, a
rejoint, quoique partiellement, l'approche basée sur l'«
intérêt général » du BPA en lançant en
2000 l'Ecole de l'agriculture vivante destinée au public. Mais en
réalité, cette école était plutôt
destinée aux personnes âgées des foyers agricoles
pluriactifs. Et l'idée de promouvoir une production agricole à
petite échelle avec les femmes (épouses et grand-mères) et
les hommes âgés des foyers agricoles pluriactifs, était
déjà présente tant dans les pratiques de ce type de
population agricole que dans la politique agricole de la modernisation depuis
les années 60 (nous l'avons vu en partie dans le chapitre 1, et le
constaterons également plus bas dans la généalogie de
l'agriculture de type Ikigai).
Et parallèlement à cela, le BPA a
coopéré avec le SCI (Service pour la Création d'Ikigai) de
la Municipalité, relevant du domaine de l'éducation permanente
mais à l'origine du domaine du bien-être - vieillissement, pour
lancer en 2002 la Ferme-école des personnes âgées
destinée au public dont essentiellement la population non agricole
âgée.
Le cadre de coopération s'est ainsi établi entre
les agents du secteur agricole et les services publics en matière de
vieillissement, en se basant sur leurs activités
préétablies, savoirs et intérêts réciproques.
Ceci par l'intermédiaire de l'intervention du BPA et du
référentiel commun d'Ikigai des personnes âgées.
Le Projet Nô-Life fut ainsi construit par la
coordination du BPA tout en effectuant un transcodage par ce
référentiel commun d'Ikigai, entre une série d'acteurs
relevant de secteurs différents, dont notamment le secteur agricole (CAT
: co-gestionnaire ; BDPA : administration agricole ; ECV : vulgarisation
agricole ; GASATA : groupement d'arboriculteurs professionnels), le secteur des
services publics en matière de vieillissement (SCI) et le secteur
industriel et « salarial » (CFLS : syndicat ouvrier). En plus, nous
avons vu qu'une déréglementation de la Loi agraire relative
à la surface minimum d'installation fut effectuée en profitant du
cadre national des « Zones spéciales pour la réforme
structurelle ».
Nous pouvons éclairer cette opération de
transcodage, en schématisant ci-dessus la structure de l'échange
effectué entre ces acteurs dans lequel le cyclique fin - moyen constitue
un procédé crucial654.
654 Rappelons - nous ici la définition du bricolage de
Lévi-Strauss : le bricolage défini par l'univers instrumental
(structure des moyens) en reconstruction incessante par le cyclique de sens
donnés aux objets mobilisés, entre la fin et le moyen. Et son
résultat est toujours « un compromis entre la structure de
l'ensemble instrumental et celle du projet. » (cité plus haut)
Schéma : structure de l'échange fin -
moyen

Secteur services publiques
vieillissement
Secteur agricole
Fin
Fin
et développement agricoles
Conservation
Promotion d'Ikigai
des personnes âgées
Moyen
BPA
Agriculture
de type Ikigai
Moyen
Dispofitifs
socio-économiques
Dispositifs
socio-économiques
Pour le secteur agricole, Ikigai des personnes
âgées (de la population générale) est
interprété comme moyen susceptible de servir à la
conservation et au développement agricoles. Et inversement pour le
secteur des services publics du vieillissement : conservation et
développement agricoles comme moyen de servir à la promotion
d'Ikigai des personnes âgées.
Puis, pour le secteur agricole, les personnes
âgées actives dont la majorité salariale et les dispositifs
socio-économiques des services publics ayant un certain niveau de
capacité de financer le Projet et de mobiliser cette population, sont
également interprétés comme utiles pour la
réalisation de la conservation et du développement agricoles. Et
inversement pour le secteur des services publics du vieillissement : la
population agricole et les dispositifs socio-économiques, comme utiles
pour la réalisation de la promotion d'Ikigai des personnes
âgées.
Autrement dit, dans ce transcodage, elles se sont
réciproquement « instrumentalisées » en
opérérant un transcodage entre leurs fins respectives
(conservation et développement agricole - promotion d'Ikigai des
personnes âgées).
D'un côté, depuis les années 70, la
politique agricole donnait, à la notion d'Ikigai le statut de «
moyen » de réaliser sa fin qui est la conservation et le
développement agricoles, dans un sens incitatif vis-à-vis des
producteurs cibles et marginalisés (femmes au foyer et hommes
âgés des foyers agricoles pluriactifs) dans un contexte de crise
permanente depuis les années 60-70.
De l'autre côté, pour la politique sociale du
vieillissement, l'agriculture a été retrouvée comme un bon
moyen de réaliser sa fin de la promotion d'Ikigai liée à
la prévention de la dépendance (qui est un élément
émergeant dans la structure de son projet en pleine «
restructuration »). Mais dans ce contexte, l'agriculture était
interprétée, au moins au début du processus, plutôt
dans le prolongement du loisir et du moyen de prévenir la
santé.
Cependant, il nous reste à poser une autre question :
cet échange effectué par un transcodage, est-il
équilibré en terme de pouvoirs ? Comme nous l'avons vu plus haut,
P. Lascoumes relevait que transcoder implique d'« être en situation
de pouvoir ». Ce transcodage alimentant un compromis entre les agents
gestionnaires en coopération (BPA et CAT : coopérative agricole
de Toyota), il nous semble nécessairement impliquer un rapport de
pouvoirs inégal tant au niveau matériel et technique qu'au niveau
symbolique. Nous aborderons cette question dans la réponse à la
quatrième question de ce chapitre sur la relation établie entre
acteurs.
3 Modèles de transaction - cadres
institutionnalisés d'anticipation et d'engagement
Reprenons de nouveau le cadre proposé par Mormont.
Troisièmement, les cadres d'anticipation et d'engagement des acteurs et
leur institutionalisation sont supposés comme être constitutifs
des modèles de transaction.
Concernant la notion d'anticipation, Mormont insiste sur le
fait qu'elle est « cruciale pour saisir la complexité des
problèmes d'environnement », pour que ceux-ci puissent
apparaître « comme une situation dans laquelle différents
scénarios d'anticipation sont possibles, se référant
chacun à la fois à des prévisions ou des extrapolations
scientifiques et à des revendications en termes de valeurs ou
d'identité655 ».
En se basant sur sa réflexion sur les comportements
anticipatifs des agriculteurs vis-à-vis de mesures préventives
pour l'environnement, ils conclut que « les rationalités
immédiates de l'agriculteur n'obéissent pas nécessairement
aux représentations que les théories expertes s'en font et ceci
constitue un problème essentiel pour la mise en oeuvre de politiques
préventives656 ». Puis, le comportement anticipatif est
également imposé du côté des acteurs politiques
comme les experts : ils sont en fait « obligés de mobiliser des
modèles par lesquels ils anticipent à la fois sur des processus
naturels et sur des comportements sociaux, ainsi que sur leur
relation657 ». Ce qui fait que « les experts mobilisent
nécessairement une sociologie spontanée à propos des
acteurs, qu'ils soient auteurs ou victimes du risque, sociologie qui leur
permet de formuler leurs propres anticipations658 »).
Suite à cette réflexion portant sur les
comportements des agents institutionnels (experts) et individuels
(agriculteurs), il postule l'hypothèse que l'efficacité de la
mise en oeuvre de ces politiques environnementales dépend de la
correspondance entre les modèles d'anticipation des agents de ces deux
niveaux (« l'efficacité des mesures de prévention est
fortement soumise à une contrainte de correspondance entre les
modèles d'anticipation des experts (auteurs de normes et des conseils)
et les modèles d'anticipation des agents eux-mêmes659
»).
De ce fait, l' « appréhension des problèmes
de pollution par les agriculteurs ne se fait pas [toujours] de manière
technique, et l'ouverture même d'un espace de discussion avec eux
(agriculteurs) sur la question suppose que soient mis en place des cadres plus
larges d'anticipation qui concernent l'avenir de la profession ou au moins le
devenir de tels ou tels systèmes de production, qui concernent aussi le
statut des objets naturels, comme l'eau ou la faune sauvage660
».
Il s'agit donc d'ouvrir un « espace de discussion » qui
permet aux agents concernés de mettre en place les conditions plus
larges de leur anticipation.
Mormont conclut que cette mise en place d'un « espace de
discussion » est finalement « de la capacité de la politique
agricole à proposer des cadres d'expérimentation cohérents
et crédibles pour une redéfinition du métier agricole que
peuvent émerger ces cadres d'anticipation qui assurent des perspectives
à long terme à des catégories d'agriculteurs661
».
Pour aborder la notion d'engagement, Mormont s'interroge d'abord
sur la « manière dont le long terme peut se stabiliser dans un jeu
d'anticipation662 ».
Il s'agit de penser les modèles d'anticipation des acteurs
non seulement à partir de leur intérêt sur le court terme,
mais également à partir de celui sur le long terme qui peut
même relever de leur identité.
Et pour que ces intérêts puissent se mettre en place
(se stabiliser) dans la politique environnementale, quels dispositifs
institutionnels faut-t-il appeller ?
Pour répondre à cette question, Mormont nous
rappelle d'abord qu'il existe un « immense appareil de règles
» qui forme, en fait, un ensemble d'agents dominants dans le monde
agricole (politique agricole, encadrement agricole, vulgarisateurs,
organisations professionnelles etc), et porte « une définition
légitime de
655 Ibid. : 225.
656 Ibid. : 227.
657 Ibid.
658 Ibid. : 228.
659 Ibid.
660 Ibid.
661 Ibid.
662 Ibid. : 229.
l'agriculteur et de son métier663 ». Il
considère ensuite cet ensemble « non seulement comme appareil de
domination, mais comme un cadre stabilisateur permettant des anticipations
», et que cet ensemble a « un rôle dans la diminution des
incertitudes », en plus qu'il est « soumis, au moins en partie,
à des épreuves de vérification de leur validité
pour les agents664 ».
Suite à cette considération, Mormont propose que
« la possibilité de développer des mesures
préventives pour réguler les pollutions agricoles suppose de
déveloper d'autres dispositifs institutionnels dans lesquels puissent
être élaborés et testés d'autres modèles
d'anticipation, ces dispositifs ayant à inclure aussi bien des
éléments identitaires que des éléments techniques
et des connaissances quant à la nature665 ».
C'est dans le cadre de la construction de ces dispositifs
institutionnels alternatifs que Mormont situe la notion d'engagements qui
« peut être mobilisée pour comprendre comment les individus
peuvent entrer dans des processus de transformation qui concernent, dans des
contextes d'incertitudes, aussi bien les outils techniques qu'ils utilisent que
les représentations qu'ils se font de la réalité, des
objets naturels comme des réalités sociales666.
»
Schéma : modèle de transaction de
Mormont
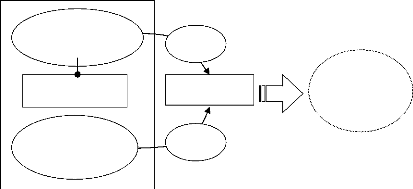
Construction
Dispositifs
institutionnels
alternatifs
Appareil de règles
(agents agricoles dominants)
Définition légitime du métier
(agriculteur)
Individus (agriculteurs)
Anticipation Engagement
Anticipation Engagement
Politique
environnement
Enfin, Mormont considère qu'il faut reconstruire ces
dispositifs institutionnels alternatifs pour que les agriculteurs ayant perdu
confiance à l'égard de la politique agricole dominante en raison
de la situation de crise, puissent à nouveau s'y engager « en
accordant suffisamment de crédibilité à de nouveaux
experts et assez de confiance à leur devenir professionnel667
». Et « ces dispositifs institutionnels doivent être vus comme
des dispositifs d'échange, consititués de transactions
c'est-à-dire de combinaison de règles, dans lesquelles sont
reconnus à la fois des intérêts sectoriels et dans des
intérêts généraux, des identités
professionnelles et des légitimités
sociétales668 ».
Cet appel à la reconstruction de nouveaux dispositifs
de la politique agricole tient compte du fait que la politique agricole (de
l'Europe occidentale) reposait bien sur un type de dispositif depuis les
années 50 basé sur un compromis entre le productivisme agricole
orienté vers le marché et l'indépendance des
exploitations
663 Ibid. : 230.
664 Ibid.
665 Ibid.
666 Ibid.
667 Ibid : 231.
668 Ibid. : 231-232. Sur ce point, Mormont se
réfère à Jobert et Muller. Ouvrage cité : JOBERT,
B., MULLER, P. (1990), L'Etat en action, Paris, PUF.
familiales, ce qui fonctionnait également comme un cadre
transactionnel669 entre les agriculteurs et l'appareil de
régles du monde agricole.
Dans le contexte d'incertitudes, le paradigme de la
transaction devient ainsi « éclairant pour essayer d'identifier les
modes d'élaboration possibles de nouveaux dispositifs institutionnels
susceptibles d'intégrer progressivement la protection de
l'environnement670 ».
Enfin, nos analyses du processus de la construction du Projet
Nô-Life portent également sur à la fois des agents
politiques et individuels, à savoir :
- agents institutionnels du secteur agricole (administration
agricole, coopérative agricole, vulgarisation agricole) - agents
institutionnels de la politique sociale du vieillissement
- agents individuels ou collectifs du secteurs agricole
(groupement de producteurs, producteurs professionnels) - divers individus
usagers (stagiaires ayant diverses trajectoires)
Et c'est une politique relevant à la fois de la crise
agricole et d'une nouvelle politique du vieillissement, nous pouvons
également supposer comme le schéma ci-dessous une construction de
nouveaux dispositifs alternatifs de la politique agricole dans le paradigme de
transaction selon le schéma de modèles de transaction que nous
avons établi ci-dessus :
Schéma : modèle hypothétique de
transaction pour le Projet Nô-Life

Appareil de règles
(agents agricoles dominants)
Définition légitime du métier
(agriculteur)
Individus
(agriculteurs)
Individus (stagiaires)
Anticipation Engagement
Projet Nô-Life
Anticipation Engagement
Anticipation Engagement
Agents institutionnels
non agricoles
Public
Construction Dispositifs institutionnels alternatifs ?
4 Transaction : grille d'analyse des interdépendances
Nous tentons d'analyser dans notre lecture du processus de la
construction du Projet Nô-Life la dynamique des représentations
sociales de l'agriculture et de la ruralité an sein de divers acteurs
concernés, d'une part, au niveau des rapports institutionnels apparement
stabilisés mais impliquant des désaccords sous-jacents, et
d'autre part, au niveau des rapports entre ces agents institutionnels et ceux
individuels portant différents types de représentations et
pratiques.
Sur ce point, comme Mormont l'indique en quatrième
point, le paradigme de la transaction sociale nous apparaît
également utile « comme une grille d'analyse des
interdépendances soit sous la forme de rapports stabiliés (qui
impliquent de lire dans les institutions les rapports sous-jacents qu'elles
entretiennent entre elles), soit sous la forme de situations d'invention
sociale de nouvelles régulations de ces
interdépendances671 ».
669 Ibid. : 232
670 Ibid.
671 Ibid. : 234.
Et nous le verrons dans le Chapitre 3, les
intérêts des stagiaires du Projet Nô-Life portent non
seulement sur le court terme mais également sur le long terme qui peut
relever de leur identité et de valeurs à respecter dans leur vie
individuelle et sociale. Nous pouvons donc rejoindre le paradigme de la
transaction sociale dans le sens de Mormont qui la différencie de la
négociation par le fait que la transaction sociale « porte sur les
principes de base des identités sociales et sur les
représentations des objets qui ne peuvent donner lieu à
négociation qu'à partir du moment où ils sont suffisamment
stabilisés pour constitutuer des cadres d'anticipation où des
intérêts peuvent être identifiés et
calculés672 ».
| 


