2. Méthodologie
Nous présenterons ici notre méthodologie
à deux niveaux : empirique et théorique. Au niveau empirique,
nous expliquerons brièvement le déroulement des deux
enquêtes de terrain, dont le première a consisté en une
observation participante à long terme (six mois) effectuée sur
les formations agricoles données dans le Projet Nô-Life. La
deuxième a consisté en des entretiens intensifs et individuels
effectués auprès d'une trentaine d'acteurs institutionnels et
individuels concernés par le Projet Nô-Life.
Au niveau théorique, nous présenterons comment
nous appliquerons l'approche des représentations sociales comme
démarche d'analyse. Dans la présente étude, nous
essaierons d'articuler l'approche des représentations sociales avec
d'autres approches conceptuelles en anthropologie et en sociologie. Chacune de
ces approches sera présentée dans le chapitre 2 en sorte qu'elles
soient mieux adaptées à leurs contextes d'application.
Méthode empirique : enquêtes de
terrain
L'enquête de terrain a été effectuée
en deux phases. La première enquête, de mars à septembre
2005, a consisté en une observation participante de la formation offerte
par le Projet. Et la deuxième, durant un mois en
8 Braudel a ainsi préconisé : « les autres
sciences sociales sont assez mal informées et leur tendance est de
méconnaître, en même temps que les autres travaux des
historiens, un aspect de la réalité sociale dont l'histoire est
bonne servante, sinon toujours habile vendeuse : cette durée sociale,
ces temps multiples et contradictoires de la vie des hommes, qui n'osent pas
seulement la substance du passé, mais aussi l'étoffe de la vie
sociale actuelle. (...) ; rien n'étant plus important, d'après
nous, au centre de la réalité sociale, que cette opposition vive,
intime, répétée indéfiniment, entre l'instant et le
temps lent à s'écouler. Qu'il s'agisse du passé ou de
l'actualité, une conscience nette de cette pluralité du temps
social est indispenable à une méthodologie commune des sciences
de l'homme. » (Braudel, 1969 : 43)
9 Par exemple, les agricultures française et japonaise. Il
serait vain de les comparer uniquement sur la base d'une observation sur le
présent ou le court terme sans se référer au temp long
dans lequel s'inscrivant ces deux objets. Déjà, en Europe
occidentale, pouvons-nous trouver une situation de pluriactivité
généralisée telle qu'elle existe déjà au
Japon ? De plus, dans ce cas précis s'ajoute la notion d'Ikigai qui est
spécifiquement japonaise.
2006, a consisté en des entretiens intensifs et
individuels avec des acteurs institutionnels et individuels concernés
par le Projet.
Première enquête : observation participante
Dans la première enquête, l'enquêteur
(rédacteur du présent mémoire), a pleinement
participé aux formations offertes par le Projet en tant que stagiaire et
individu ayant le même statut que les autres stagiaires. Les principaux
enquêtés, objets directs de l'observation, étaient une
trentaine de stagiaires des années 2005-2007. Les stagiaires des
années 2004-2006, premiers stagiaires de la formation Nô-Life,
sont exclus de notre observation directe. La période de cette
enquête correspond au premier quart de la totalité de la formation
des stagiaires des années 2005-2007. L'enquêteur a suivi toutes
les formations divisées en trois filières : culture
maraîchère ; cultures maraîchère et rizicole ;
culture fruitirère. Une trentaine de stagiaires étaient
répartis dans ces trois filières. Les cours théoriques et
pratiques sont donnés par filière une fois par semaine de 9h
à 12h (sauf les cours exceptionnels donnés par exemple lors des
périodes des récoltes).
Cette participation avait préalablement
été autorisée par l'organisme gestionnaire du Projet, le
« Centre Nô-Life », dont le nom officiel est « Toyota-shi
Nô-Life Sôsei Center (Centre pour la Création de la Vie
rurale de la Ville de Toyota) », auquel l'enquêteur avait
présenté son objectif de recherche.
Par ailleurs, l'enquêteur a effectué une
enquête par questionnaire auprès des stagiaires des années
2004-2006 et 2005-2007. Le questionnaire a été distribué
au total à 69 stagiaires de manière anonyme. 50 réponses,
soit un taux de récupération de 72 %, ont été
récoltées. Ce questionnaire contenait 24 points visant à
saisir le profil, les motifs pour la participation à la formation, les
perspectives des stagiaires pendant et après la formation
etc10.
Apports de la première enquête
Cette première enquête nous a permis d'avoir un
certain degré d'interconnaissance, d'intimité et de confiance
avec les enquêtés(es) ainsi que les personnels du Centre
Nô-Life (trois permanents et deux temporaires, pour certains
employés de la Municipalité de Toyota et pour d'autres
employés de la Coopérative agricole de Toyota). Cette
enquête nous a également permis d'observer concrètement la
situation intérieure du Projet. Puis, le caractère
personnalisé de la relation enquêteur - enquêté(e)
mentionné nous a permis d'aborder certains aspects subjectifs et
personnels des acteurs.
Limites de la première enquête
Cependant, nous pouvons relever certaines limites de cette
enquête en deux points suivants : le premier est dû au
caractère « clos » du déroulement de l'enquête.
En effet, l'enquêteur se cantonnait aux activités de la formation
offertes par le projet, ce qui a limité la portée de notre
observation aux acteurs intérieurs du Projet : stagiaires et personnels
du Centre Nô-Life. Les acteurs extérieurs au projet, comme les
agents concernés au sein des autres institutions n'ont pas
été recensés ; le second point réside dans le
caractère collectif de l'enquête. En fait, la participation de
l'enquêteur au Projet et la distribution du questionnaire de
manière anonyme ne nous ont pas permis d'aborder de manière
approfondie les aspects individuels et personnels des acteurs. Notamment le cas
des stagiaires dont le profil et les motifs de participation au Projet se sont
avérés très divers suite au résultat de
l'enquête par questionnaire.
La deuxième enquête : entretiens intensifs et
individuels
Afin de pallier à ces deux défauts, la
deuxième enquête à court terme (pendant un mois) a
été effectuée en octobre 2006 auprès des divers
acteurs intérieurs et extérieurs concernés par le Projet.
Cette enquête a été menée sous forme d'entretiens
intensifs et individuels auprès d'une trentraine d'acteurs
institutionnels et individuels.
10 Pour le détail du questionnaire, voir l'annexe 1.
L'analyse du résultat de cette enquête sera
présentée dans le chapitre 3.
Ces entretiens ont été enregistrés et
dactylographiés en intégralité. Deux types de questions
ont été posées aux acteurs : questions communes à
tous les acteurs ; questions particulières à certains acteurs
spécifiques. Nous avons intégré dans les annexe 2 et 3, la
liste des questions posées lors des entretiens ainsi que la
synthèse du résultat de cette enquête par entretiens.
Méthode théorique : étude des
représentations sociales
L'intérêt de la présente étude est
d'étudier les représentations, les actions et les pratiques
à l'égard de l'agriculture et de la ruralité, dans un
contexte particulier qui est celui du vieillissement.
Notre approche globale est interdisciplinaire en articulant
notamment l'hitoire, l'anthropologie et la sociologie. Donc notre
éventail de concepts d'analyse ne relève ni d'une seule
discipline, ni d'une seule théorie, ni d'un seul courant. L'approche des
« représentations sociales », relevant de la phychologie
sociale francophone, se situe à notre égard « à la
croisée » de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie et de
la phychologie. Nous l'appliquons dans cette étude comme démarche
d'analyse susceptible d'englober ces différentes approches
disciplinaires.
Représentations et dynamiques sociales dans un contexte
spécifique
Pour éclairer les caractéristiques de l'approche
des représentations sociales, nous pouvons nous référer
à quelques articles montrant des appplications concrètes sur des
contextes spécifiques de cette approche.
L'article de C. Garnier et L. Sauvé11 montre
un mode d'application de la théorie des représentations sociales
dans une recherche empirique sur un contexte spécifique qui est celui de
l'éducation de l'environnement. Par contre, celui de B.
Fraysse12 cherche des liens entre l'identité et les
représentations chez les élèves de la formation
professionnelle d'ingénieurs. Ces deux articles portent sur
l'application de cette approche sur des contextes spécifiques et
concrets. Si le premier porte un intérêt à la fois
compréhensif et pragmatique en essayant de montrer dans quelle mesure
l'approche des représentations sociales pent être pertinente pour
décrire, expliquer (ou comprendre) son objet de recherche et ensuite
élaborer une stratégie d'intervention, le second porte
plutôt un intérêt purement analytique sur son objet de
recherche et s'attache à montrer sa compéhension de cet objet.
Notre démarche rejoint surtout l'approche
présentée par le premier article, qui nous semble plus
adaptée et opérationnelle pour notre étude de cas du
Projet Nô-Life. Car dans notre recherche, en partant d'une description
historique et ethnographique des enjeux des acteurs, nous nous attacherons
également à donner une analyse compréhensive et à
en relever les problèmes et contradictions, et ensuite à proposer
des solutions possibles.
La théorie des représentations sociales a
été développée « en Europe francophone au
cours des trois dernières décennies13 » par de
nombreux phychologues sociaux dont notamment S. Moscovici, D. Jodelet, W. Doise
et J-Cl. Albric etc. Mais elle ne constitue pas pour autant « une
théorie unifiée », mais « un ensemble de perspectives
théoriques qui sont apparues à la croisée de la sociologie
et de la phychologie14 ».
Soulignons quelques caractéristiques de la notion des
représentations sociales. D'abord, une représentation peut
déjà comprendre des éléments de types
extrêmement divers et complexes. Ainsi, étant un «
phénomène mental », elle « correspond à un
ensemble plus ou moins conscient, organisé et cohérent,
d'éléments cognitifs, affectifs et du domaine des valeurs
concernant un objectif particulier appréhendé par un
sujet15 ». Et la notion
11 Garnier et Sauvé, 1998.
12 Fraysse, 2000.
13 Garnier et Sauvé, 1998 : 66.
14 Ibid.
15 Ibid. : 66. Et on peut même y trouver « des
éléments conceptuels, des attitudes, des valeurs, des images
mentales, des connotations, des associations, etc. C'est un univers symbolique,
culturellement déterminé, où se forgent les
théories spontanées, les opinions, les préjugés,
les décisions d'actions, etc. » (Ibid.)
des représentations sociales est non seulement de simples
représentations produites par un sujet à l'égard d'un
objet, mais également des éléments constitutifs de «
processus sociocognitifs16 ».
En fait, l'approche des représentations sociales est
d'étudier les représentations en relation avec les objets sociaux
et la dynamique des rapports sociaux dans lesquels les sujets agissent,
interagissent et se communiquent. Et la relation entre une
représentation, son objet, son sujet et ses rapports sociaux n'est pas
figée, mais interactive voire interdépendante. Ainsi, « une
représentation se construit, se déconstruit, se reconstruit, se
structure et évolue au coeur de l'interaction avec l'objet
appréhendé, alors même que l'interaction avec l'objet est
déterminée par la représentation que le sujet en
construit17». W. Doise souligne ainsi que « la dynamique
d'élaboration des représentations est intimement
entremêlée à la dynamique des rapports sociaux18
».
L'approche devient donc nécessairement systèmique
mais non causale, c'est-à-dire que les représentations sociales
sont indissociables du discours et de la pratique, et qu'ils forment un «
tout19 ».
S'agissant d'un contexte spécifique (comme
l'environnement et la santé chez C. Garnier et L. Sauvé), cette
approche éclaire le « caractère socialement construit des
représentations20 » dans ce contexte donné.
Autrement dit, selon la théorie des représentations sociales,
« toute représentation portée par un individu est
socialement construite21 ».
Représentations comme instruments cognitifs et
intellectuels
Selon B. Fraisse, qui s'attache surtout à la dimension
individuelle en recherchant la relation entre les représentations et le
processus d'apprentisage individuel et interindividuel ainsi que la
construction identitaire, les représentations sont définies comme
des « modes spécifiques de connaissances du réel qui
permettent aux individus d'agir et de communiquer22 ».
Les représentations sociales peuvent être de
véritables instruments congnitifs et intellectuels pour l'acteur.
Ensuite, celui-ci s'en sert pour communiquer à partir des
réalités « ayant le statut de représentations »,
et ainsi reconstruit le lien entre ses représentations et les
réalités23. Donc, dans la dimension individuelle, les
représentations peuvent se comprendre comme éléments du
processus particulier de construction - reconstruction des connaissances de la
réalité24.
Objectivation et ancrage : deux processus fondamentaux
L'approche des représentations sociales ne se contente
pas d'étudier les contenus représentationnels, mais consiste
à analyser la structure génératrice de ceux-ci à
travers l'action, la communication et la relation sociale des
sujets25.
Deux processus fondamentaux initialement définis par S.
Moscovici marquent l'approche des représentations sociales :
objectivation et ancrage26. Selon nous, ces deux processus
désignent la relation réciproque entre les représentations
et la réalité sociale et spatio-temporelle. D. Jodelet
caractérise ces deux processus ainsi :
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Doise et al. (1992), cité par Garnier et Sauvé,
1997 : 67
19 Ibid. : 67.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Fraysse, 2000 : 651.
23 Ibid.
24 Sur ce point, la notion du bricolage semble avoir une
proximité, dans le sens où le bricoleur construit son oeuvre
(représentation) à partir d'un objet existant
(réalité et en reconstruit une autre au moyen de sa construction
antérieure. Nous emploierons ce terme dans les chapitres 2 et 3 dans
notre analyse du mode d'action des acteurs.
25 « la théorie des représentations sociales a
été construite autour de la notion de système. Bien
au-delà de l'étude des contenus représentationnels, la
recherche sur les représentations sociales vise à mettre en
évidence les structures organisatrices de ces
contenus » (Garnier et Sauvé, 1997 : 68)
26 Moscovici, 1961 ; 1976, cité par Garnier et
Sauvé, 1997 : 69.
Schéma : mondes représentationnel et
réel
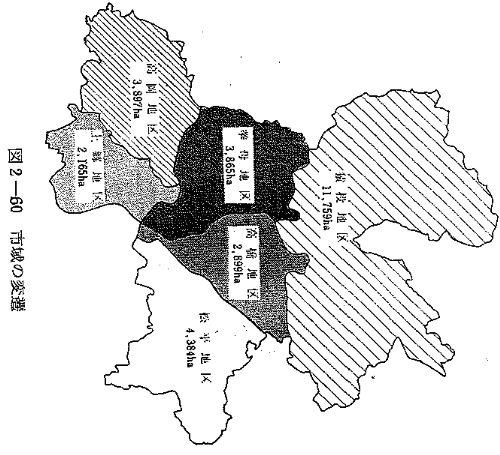
Monde réel
: Interaction
Monde représentationnel
Ancrage
Objectivation
Objet (réel)
Objet (réel)
Objet (réel)
Relation sociale
Représentation Représentation Représentation
Représentation
Sujet Sujet Sujet Sujet
- « l'objectivation correspond à une
sélection d'éléments d'un objet appréhendé
et à la construction d'un schéma organisationnel de ces
éléments (remodelage) en une image concrète,
préhensible, qui facilite la communication au sein du groupe à
propos de l'objet en question. »
- « l'ancrage enracine la représentation de
l'objet dans un réseau de savoirs antérieurs et de significations
au sein du groupe, et permet de le situer par rapport aux valeurs sociales ;
l'ancrage confère également une valeur fonctionnelle à la
représentation pour l'interprétation et la gestion de
l'environnement27 ».
Notre cadre d'analyse va donc se baser sur le schéma
ci-dessus. La relation (ou la frontière) entre le monde réel et
le monde représentationnel ne peut pas être figée ni
séparée, mais est indissociable et cyclique. Car nous avons dit
plus haut que la représentation n'est pas seulement un produit
figé, mais un processus. Avec ce schéma, nous avons essayé
de présupposer la relation dialectique entre les représentations,
les actions et la relation sociale.
Ce présent schéma n'est ni un modèle
théorique figé, ni définitif. Il n'est qu'un cadre
d'analyse de base que nous supposons comme point de départ, à
partir duquel nous devrons explorer et appréhender la complexité
et la diversité de la réalité sociale et locale.
Démarche : description, explication et stratégie
d'intervention
Ensuite, la perspective de recherche présentée
par C. Garnier et L. Sauvé va plus loin avec l'approche des
représentations sociales en inscrivant celle-ci dans une démarche
constituée par les trois étapes suivantes : description -
explication - stratégie d'intervention.
Si c'est l'environnement qui constitue un objet social et
politique dans la recherche de ces auteurs28, dans notre recherche,
il s'agit de l'agriculture et de la ruralité dans un contexte local et
japonais du vieillissement de la population, qui constituent également
un objet social et politique. Et l'intérêt fondamental de la
théorie des représentations sociales pour l'intervention, est que
les représentations « orientent la communication sociale et
27 Jodelet, 1989 cité par Garnier et Sauvé, 1997 :
69
28 Ibid. ; 69.
servent de guide pour l'action29 » comme «
processus de décodage et grille de lecture de la
réalité30 ».
Et l'étude des représentations sociales peut
contribuer à éclairer « la dynamique des rapports entre la
personne, le groupe social31 » et son objet. Et « elle
peut aider à saisir le caractère systèmique et complexe
des enjeux liés aux questions », et « à mieux
comprendre les dynamiques menant à la prise de position des
différents acteurs et celles qui régissent les conflits entre
groupes sociaux32 ». Les auteurs soulignent qu'« une telle
compréhension est indispensable pour planifier des interventions visant
à résoudre des problèmes ou pour concevoir des projets
socialement viables33 ».
En rejoignant cette position à la fois
compréhensive et pragmatique de ces auteurs, notre analyse
procèdera d'abord à une description basée sur une
enquête historique, ethnographique et sociologique de la
réalité complexe dans laquelle agissent, interagissent,
communiquent et se positionnent les acteurs qui se différencient tant au
niveau de l'échelle (institutionnel, groupe, individuel) qu'au niveau
des champs sociaux. Et ceci dans un contexte particulier au Projet
Nô-Life.
Ensuite, nous essaierons de dégager un ensemble
représentationnel dans lequel divers types de représentations se
situent autour d'un objet en question dans le contexte étudié. Il
s'agit d'étudier l' « ensemble que constitue le réseau
représentationnel dans lequel s'insère une représentation
particulière ». C. Garnier et L. Sauvé évoquent que
cette représentation particulière d'un objet (ex. environnement)
entretient des liens avec celles de différents types d'objets (ex.
santé et corps chez les jeunes enfants)34. Dans notre
recherche, nous le verrons dans le Chapitre 2, nous avons relevé trois
objets qui entrent dans l'ensemble représentationnel dans le processus
de la construction du Projet Nô-Life. Il s'agit de la qualité de
vie, du lien social et territorial et la production matérielle qui sont
mis en relation avec l'objet en question, qui est celui de l'agriculture de
type Ikigai.
Puis, nous avons essayé de repérer les prises de
position des acteurs concernés, lesquelles ancrent des
éléments constitutifs de cet ensemble représentationnel,
et ainsi de mettre en évidence la convergence et la divergence dans leur
relation sociale.
Enfin, à partir de ces analyses compréhensives
et explicatives, nous avons essayé de donner des réponses
à une série de questions que nous avons posées
préalablement au début des chapitres 2 et 3, sur les enjeux des
acteurs observés. Et par là, nous avons essayé de relever
des problèmes et des contradictions qui sont tantôt visibles
tantôt invisibles dans la réalité objective, mais qui nous
ont paru exister au niveau de la situation complexe de représentation,
de pratique et de pouvoir.
Et dans la réponse pour la dernière question du
Chapitre 3, nous avons essayé de formuler quelques propositions
destinées aux acteurs du Projet. Ceci en portant un double
intérêt d'un côté celui des acteurs pour une
meilleure régulation de cette situation, de l'autre celui de montrer sa
pertinence et sa perspective à l'épreuve de la
réalité faisant l'objet de cette étude.
| 


