III.1.10 Analyse des paramètres
bactériologiques
L'objectif de l'analyse bactériologique d'une eau est
de rechercher des germes qui sont susceptibles d'être pathogènes,
ou des germes qui sont indicatrices de contaminations fécales. Selon
Rodier, cette analyse sert essentiellement au contrôle des eaux de
boisson qui ne doivent contenir aucun germe pathogène.
Généralement les normes de qualité bactériologique
des eaux de boisson se fondent sur le nombre de germes aérobies
mésophiles appelés couramment `'germes totaux» et sur la
présence des microorganismes non pathogènes en eux même,
mais servant d'indicateurs d'une contamination fécale d'origine humaine
ou animale. Ainsi les indicateurs utilisés sont le groupe de
bactéries des coliformes totaux (Escherichia coui) et les
entérocoques. Les eaux de boissons ne doivent pas contenir plus de 10
germes par ml (germes totaux), aucun E. coui, aucun entérocoque
par 100 ml. L'analyse bactériologique doit être effectuée
au plus tard 24h après le prélèvement pour éviter
l'effet de la lumière et de la température nocif sur la survie
des microorganismes.
Le matériel utilisé lors de ces analyses doit
être stérile pour éviter toute source de contamination.
Germes recherchés
Nous avons effectué pendant notre travail la recherche
des germes indicateurs de pollution qui sont :
- Les coliformes totaux
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 39
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
- Les coliformes fécaux
- Les entérocoques fécaux
- Les flores aérobies totales (à titre
indicatif).
III.1.11 Protocole et méthodes d'analyse
bactériologique
Une analyse bactériologique en milieu solide et/ou
liquide pour le dénombrement des germes respecte les étapes
suivantes :
- Une préparation du milieu de culture,
- Un ensemencement,
- Et une interprétation tel que décrit par
Rodier.
Les milieux de culture utilisés au laboratoire national
de l'eau sont de trois
types :
? Nous avions le chromocult (gélose) qui isole les
coliformes totaux, fécaux et E.coli.
? Le milieu (S) Stanetz et Barley qui isole les
entérocoques ;
? Le milieu (P) qui isole les flores meso-aero totales.
Les échantillons sont préalablement filtrés
aux membranes.
Méthode de la Membrane Filtrante
La méthode utilisée c'est le dénombrement
par filtration sur membrane qui retient les microorganismes. Le mode
opératoire est le suivant :
Après avoir filtré sous vide 100 ml de
l'échantillon sur une membrane millipore stérile, dont la
porosité est de 0,45 ìm, cette dernière est
déposée sur le milieu de culture spécifié pour
chaque germe recherché, puis incubé dans la température
optimal pour la multiplication des germes.
Durant l'incubation, des colonies se forment à la surface
de la membrane.
Germes test de contamination fécale
Pour les coliformes, le milieu de culture utilisé c'est le
Tergitol 7 agar au TTC et
l'incubation se fait pendant 24 à 48 heures à
une température de 37°C pour les coliformes totaux et de 44°C
pour les coliformes fécaux. Pour les streptocoques fécaux, le
milieu de culture utilisé c'est le milieu m-Enterococcus et l'incubation
se fait pendant 24 heures à une température de 37°C.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 40
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
La flore mésophile aérobie totale (FMAT) a
été recherchée par la méthode d'ensemencement en
profondeur. La culture des FMAT a été réalisée sur
milieu LB (Luria Bertani) et incubée à 37°C pendant 24
heures.
Les colonies jaunes-orange sont comptées comme des
coliformes, les colonies rouges ou rouges brique sont comptées comme des
streptocoques fécaux. Les résultats de dénombrement sont
exprimés en unité formant colonies (UFC) par 100 ml. Et les
colonies blanchâtres pour la FMAT, les résultats de
dénombrement sont exprimés en unité formant colonies (UFC)
par ml.
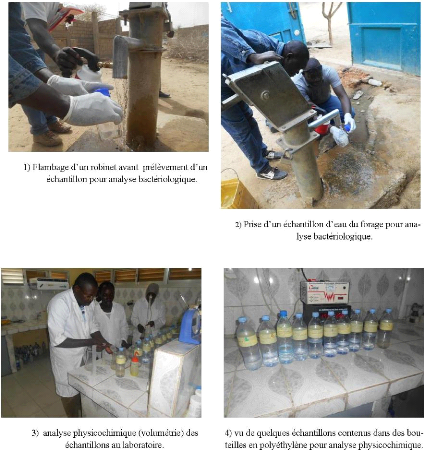
Figure 17: opérations de
prélèvements d'échantillons sur le terrain et d'analyses
au
laboratoire.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 41
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.1.12 Les méthodes
d'interprétation:
Dans cette étude pour l'interprétation des
résultats d'analyses, nous avons fait recours aux méthodes
suivantes :
-Cartographie de l'évolution des paramètres physico
chimiques : conductivité électrique, teneur en chlorure, teneur
en nitrates... par l'emploi du logiciel Arc GIS 10.
-Détermination du faciès chimique de la nappe par
les diagrammes de Piper et de Scholler-Berkaloff avec le logiciel Diagramme.
-Enfin, étude de la qualité de la nappe à
l'alimentation par la comparaison des résultats avec les normes de l'OMS
avec le logiciel Diagramme.
Analyse et traitement des données
L'analyse et le traitement statistique des données sont
rendus possible grâce : au logiciel Microsoft Excel utilisé pour
la codification des données et des résultats d'analyse du
laboratoire, au logiciel Arc GIS 10.1 utilisé pour le positionnement des
points de prélèvement ainsi que la situation géographique
des points d'eau de notre étude et XLSTAT pour la comparaison des
éléments chimiques par corrélation.
Limite de l'étude
Au cours de nos travaux de terrain, certaines difficultés
ont été rencontrées. Aux nombres desquelles on peut citer
:
- la réticence de certains utilisateurs pour le
démontage des pompes nécessaire pour les mesures de niveau
d'eau,
- des moyens logistiques et techniques très limités
pour approfondir les recherches notamment pour le prélèvement
d'échantillons supplémentaires etc.
- des essais de débits susceptibles de nous édifier
sur les paramètres hydrodynamiques et du coup sur la
vulnérabilité de la zone d'étude, peu nombreux,
- bref, des moyens financiers assez limités.
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.2 RESULTATS:
Les résultats sont la finalité ou l'aboutissement
de notre recherche et la base de notre discussion.
Pour la présente étude, les résultats sont
énumérés ci-dessous.
Tableau 3: résultats des paramètres
hydrodynamiques de quelques points d'eau de la ville de N'Djamena. (Source
: H2O-Consultants 2018).
|
Quartier
|
Transmissivité
(m2/s)
|
Debit
spécifique
(m3/h/m
)
|
Coefficient
d'emmagasinement*
(%)
|
Perméabilité** (m/s)
|
|
Walia (STE)
|
1,26x10-2
|
12,95
|
20
|
8,4x10-4
|
|
Mandjafa
|
1 ,1x10-2
|
10,81
|
20
|
1,8x10-3
|
|
Ndjari1
|
7,18x10-3
|
6,78
|
10
|
5,9x10-4
|
|
Ndjari (STE)
|
1,07x10-2
|
10,89
|
20
|
7,13x10-4
|
|
Toukra
|
1,18x 10-2
|
12,25
|
15
|
1,96x10-3
|
|
Moyenne
|
5,3x10-2
|
10,73
|
17
|
1,18x10-3
|
*les valeurs du coefficient d'emmagasinement
(ou porosité efficace en nappe libre) données à titre
indicatif, sont exprimées en fonction de la lithologie des terrains
aquifères observée et en corrélation avec le tableau de
CASTANY (tableau 5).
**les valeurs de la perméabilité sont
calculées sur la base de la formule : T= k.b => k=T/b
Avec : T : transmissivité en (m2/s), b :
épaisseur de la nappe mouillée (ici longueur des crépines)
en (m) et K coefficient de perméabilité en (m/s).
Tableau 4: valeurs de la porosité efficace moyenne
pour les principaux réservoirs (CASTANY, G. 1982).
|
Types de réservoirs
|
Porosité efficace
|
Types de réservoirs
|
Porosité efficace
|
|
(%)
|
|
(%)
|
|
Gravier gros
|
30
|
Sable gros
|
20
|
|
Gravier moyen
|
25
|
Sable moyen
|
15
|
|
Gravier fin
|
20
|
Sable fin
|
10
|
|
Gravier+sable
|
15 à 25
|
Sable très fin
|
5
|
|
Alluvions
|
8 à 10
|
Sable gros+silt
|
5
|
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page
42
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 43
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.2.1. Résultat des corrélations des
coupes litho- stratigraphiques
Dans cette partie de la représentation
géologique de terrain, nous allons décrire sommairement les
différentes structures géologiques des forages de la zone
d'étude et d'essayer de voir s'il ya une corrélation
lithologique, ensuite nous allons mettre en exergue l'allure des niveaux
piézométriques et d'identifier le substratum (ou mur de
l'aquifère), voire estimer sa profondeur au niveau de chaque point
d'eau. Ce qui nous permettra par la suite de déterminer la
géométrie globale et la structure de la nappe d'eau souterraine
de N'Djamena.
notre zone d'étude se trouve sur le bassin
sédimentaire du Tchad, réputé être strictement
continental (Moussa, A, 2010) ; le remplissage de ce bassin s'est fait durant
les différentes phases de sédimentation. Du point de vue
lithologique, les forages montrent de grandes entités
sédimentaires très hétérogènes et
comprennent, des séries fluviatiles, lacustres, voire deltaïques.
La lithologie présente des variations latérales de faciès
qui rend des corrélations difficiles. La nappe aquifère de notre
zone d'étude se trouve dans des formations sableuses ou
sablo-argileuses. Le niveau piézométrique baisse du Sud vers le
Nord.
Coupe lithologique N° I :
La coupe N°I montre des alternances verticales rapides
entre les dépôts fluviatiles (sable) et les dépôts
lacustres (argile) sur les 8 sites représentés,
caractéristiques de conditions de sédimentation du quaternaire
ancien. Cependant, nous remarquons une dominance des séries fluviatiles
allant jusqu'à 70 à 80% (secteur Dembé et Farcha). A Gassi
1 et 2, Kartota voire Chagoua1, nous observons un équilibre parfait
entre les séries lacustres faites d'argile, d'argile sableuse en
alternance avec des séries fluviatiles allant du sable fin à
moyen, du sable argileux. La surface piézométrique tend à
baisser du SE vers le NW, nous remarquons cependant sur la coupe une
légère hausse sur le site du marché à mil, lequel
site comportant un forage profond captif. Le mur ou substratum de la nappe du
quaternaire est observé à 51m au marché à mil et
seulement (vraisemblablement) autour de 43m à Kartota. Il n'est pas
visible sur certains logs.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 44
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena

Figure 18: coupe lithologique
Farcha-Kartota.
Coupe lithologique N° II
Sur la coupe II, les séries sableuses sont dominantes,
la surface de la nappe décroit vers le nord, le mur de la nappe est
identifié à 60m à Milezi et 55m à Guinebor2 (voir
figure 19).
Coupe lithologique N°III
Sur la coupe N°III , nous observons une
prédominance des séries argileuses à Ndjari STE, ce qui se
traduit par une valeur de transmissivité ( 7,18x10-3
m2/s) inférieure aux autres sites. Cette tendance est aussi
mise en évidence à Diguel Est, Chagoua1 et Walia STE où
les séries argileuses sont importantes. Dans le secteur Toukra par
contre, les séries sableuses sont omniprésentes ; la surface du
niveau piézométrique diminue globalement du Sud vers le Nord
(voir figure 20).
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 45
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
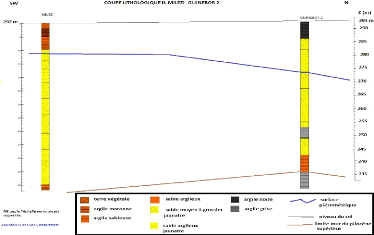
Figure 19: coupe lithologique Milezi-
Guinebor2.
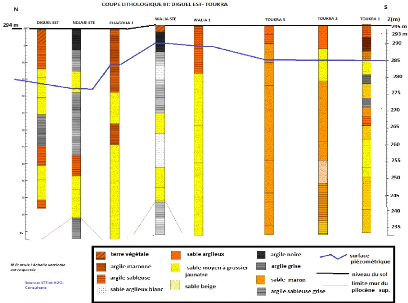
Figure 20: coupe lithologique Diguel Est-
Toukra.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 46
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
Coupe lithologique N°IV
Cet axe regroupe des sites à l'Est de la zone
d'étude, sites caractérisés par une dominance des
formations sablo-argileuses ; l'aquifère est cependant contenue dans du
sable moyen à grossier. Dans ce secteur, le mur de la nappe se trouve
autour de 45m.

Figure 21: coupe lithologique Boutalbagar-
Bakara.
Coupe lithologique N° V
Le profil de cette coupe est orienté S-NE, à
Dingagali, la lithologie est dominée par des séries sableuses et
le niveau de la nappe est presque affleurant pendant la saison des pluies ;
à Walia -STE les formations argileuses sont dominantes, cependant la
nappe aquifère est logée dans
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 47
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
de séries sableuses (sable grossier) avec une
excellente transmissivité (1,26x10-2 m2/s), le mur
de la nappe est identifié aux alentours de 52m. Globalement le niveau
piézométrique décroit fortement de Dingagali à
Boutalbagar ; le mur lui, remonte plutôt et est identifié à
environ 45m à Boutalbagar qui est dominé par des formations
sableuses.
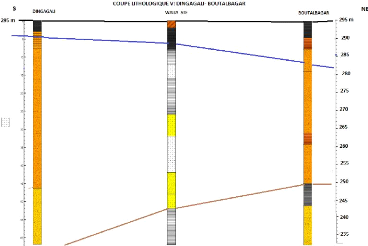

Figure 22: coupe lithologique Dingagali-
Boutalbagar.
Coupe lithologique N° VI
Comme pour les autres coupes, nous remarquons ici une
alternance entre l'argile, l'argile sableuse, le sable moyen à grossier
et le sable argileux. A Chagoua, les 20 premiers mètres sont argileux et
le mur n'est pas visible. A Moursal, le mur est identifié à
55métres. Le niveau piézométrique est presque constant sur
ce profil.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 48
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
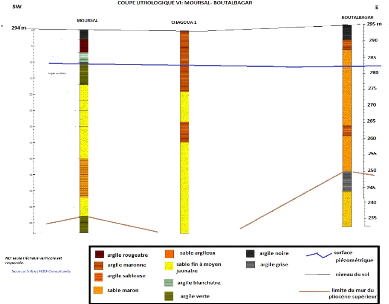
Figure 23: coupe lithologique Moursal-
Boutalbagar.
III.2.2. Relation entre la lithologie et la contamination
bactériologique des points d'eau Les sites à dominance
sableuse, perméable, transmissive où le niveau de la nappe est
sub-affleurant sont à priori vulnérables à une
contamination bactériologique comme l'ont démontré
Abderamane et al (2017) dans des travaux antérieurs dans notre
zone d'études. En effet, les quartiers longeant le fleuve Chari comme
Walia, Dingali, Chagoua, Gassi
( transmissivité moyenne de l'ordre de
1,3x10-2 m2/s) voire Farcha ont un terrain propice
à la contamination de la nappe compte tenu de la structure de leur zone
non saturée assez poreuse. Les cartes thématiques de
vulnérabilité élaborées à cet effet, par
Abderamane et al (2017) confirme cet état de
fait. Le recouvrement supérieur de la nappe n'est pas entièrement
imperméable et est le plus souvent sableux (Walia, Gassi, Farcha), le
niveau statique faible (4m à Dingagali) entre autres. Cela impacte sur
la contamination bactériologique comme nous verrons plus loin.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 49
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
III.2.3. levé des niveaux statique et
piézométrique
Les mesures des niveaux statiques ont été faites
pendant la période de basses eaux, en avril, mai et juin 2018. Les NS
varient de 4,29m à 22 ,50m ; tandis que les niveaux
piézométriques eux, oscillent entre 271m à 289m. Les
résultats sont consignés dans le tableau en annexe 2.1.
III.2.4 piézométrie de la nappe de
N'Djamena
L'étude piézométrique d'une nappe fournit
des renseignements de première importance sur les
caractéristiques de l'aquifère. Elle permet en particulier,
d'apprécier de façon globale les conditions d'écoulement
des eaux souterraines, ainsi que leurs conditions d'alimentation et de
drainance, et la variation de leurs réserves (ERIC GILLI et
al.2012).
Les études piézométriques
nécessitent de disposer d'un nivellement très précis de
points d'observation (puits, forage, piézomètre, sources) qui
permet de garantir la précision dans l'établissement des cartes
piézométriques. Celle-ci est tracée par interpolation
(kirgeage) entre les cotes relevées, sur la base des courbes
hydro-isohypses (ligne d'égale altitude de la surface
piézométrique) dont la qualité et l'équidistance
dépendent de la densité des points de mesure et de
l'échelle d'étude adoptée.
Le résultat de cette étude
piézométrique est représenté par les cartes
piézométriques ci-dessous (figures 24 et 25) obtenue par
l'utilisation des logiciels Arc Gis version 10 et surfer 8. La carte
piézométrique d'une nappe permet une vision instantanée de
son état à un moment précis. Elle sera donc établie
durant une période très courte, pour être
représentative sur l'ensemble du secteur couvert de conditions
identiques vis-à-vis des influences locales et des
événements périphériques (débit,
pluviométrie).
La surface piézométrique s'interprète, de
la même façon qu'une surface topographique, par sa morphologie, sa
pente ses variations intimes et ses anomalies
.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 50
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena

Figure 24:carte piézométrique de la ville
de N'Djamena obtenue par Arc Gis10.
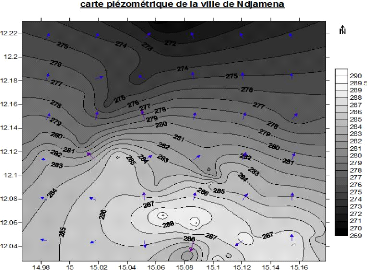
Figure 25: carte piézométrique de la ville
de N'Djamena obtenue à partir de surfer 8.
Mémoire de Master rédigé par Amann
Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 51
Contribution à l'étude de la qualité
physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la
ville
de N'Djamena
| 


