|
Année universitaire 2020-2021
|
Université de Bordeaux INSPE
d'Aquitaine
Master Métiers de l'Enseignement, de
l'Éducation et de la Formation
Mention
PLP
Parcours Biotechnologies Santé Environnement
Le rôle de l'enseignant dans l'estime de
soi
des adolescents en lycée professionnel
:
les effets sur l'apprentissage scolaire.
Mémoire présenté en vue de l'obtention du
grade de Master.
Réalisé par Noriega
Mégane
Sous la direction de Mr. Franck Tanguy
Date de soutenance : 26/05/2021
2
REMERCIEMENTS
Je tiens à exprimer ma gratitude à M. Tanguy, un
formateur admirable, pour son implication et ses encouragements. Merci d'avoir
élargi mes pistes de réflexion dans de nombreux domaines.
Merci à tous les élèves de 1re
baccalauréat professionnel du lycée Marcel Dassault qui ont
participé volontairement et sérieusement aux expériences
de ce mémoire ; et au proviseur adjoint M. Baury pour m'avoir accueillie
dans son établissement.
Mes remerciements pour mon tuteur M. Guillaud, qui a cru en
moi plus que moi-même ; et à tous mes collègues du
lycée Marcel Dassault pour leur bienveillance
indéfectible.
Merci à mes collègues et amis de la promotion
2020-2021 qui m'ont toujours fait
sourire même dans les moments les
plus compliqués.
Une pensée toute particulière pour l'homme qui
partage ma vie, Jonathan. Merci
pour sa patience, ses encouragements et sa
compréhension incroyable tout au long
de l'année.
Enfin, je souhaite remercier mes parents, mes beaux-parents,
mon frère, ma demi-
soeur et leurs conjoints respectifs qui m'ont
soutenue par tous les moyens possibles
malgré certaines de mes
absences aux rassemblements familiaux.
3
ABRÉVIATIONS
ACC : Accueil
AP : Accompagnement personnalisé
Bac Pro : Baccalauréat
professionnel
CF : Confer (reportez-vous à)
COM : Commerce
MEEF : Métiers de l'Enseignement, de
l'Éducation et de la Formation
MELEC : Métier de
l'électricité et de ses environnements connectés
PLP : Professeur de lycée
professionnel
PSE : Prévention Santé
Environnement
TICE : Technologies de l'information et de la
communication pour l'enseignant
TU : Technicien d'usinage
ULIS : Unité localisée pour
l'inclusion scolaire
4
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS 2
ABRÉVIATIONS 3
TABLE DES MATIERES 4
INTRODUCTION 7
PARTIE THÉORIQUE 10
1. Adolescence 10
1.1 Théorie de l'adolescence 10
1.1.1 Définition 10
1.1.2 Approches biologiques et psychologiques 11
1.1.2.1 Théorie de Hall 11
1.1.2.2 Théorie Freudienne 11
1.1.2.3 Théorie d'Erikson 12
1.1.3 Approches culturelles et sociologiques 13
1.1.4 Approche écologique 13
1.2 Changements chez les adolescents 14
1.2.1 Développement biologique 14
1.2.2 Développement métacognitif 15
1.3 Références et repères sociaux
des adolescents 15
1.3.1 Parents 15
1.3.2 Enseignants 17
2. Lien entre estime de soi et apprentissage scolaire
18
2.1. Concept de soi et estime de soi 18
2.1.1. Définition du concept de soi 19
2.1.2. Différents modèles du concept de soi 19
2.1.2.1 Modèle unidimensionnel 20
2.1.2.2 Modèle multidimensionnel 20
2.1.2.3 Modèle hiérarchique 21
2.1.3. Estime de soi 22
2.1.4. Facteurs influençant l'estime de soi des
adolescents 23
2.1.4.1 Facteurs individuels de l'adolescent 24
2.1.4.2 Facteurs impliquant des personnes extérieures
25
5
2.2 Apprentissage scolaire 26
2.2.1 Processus d'apprentissage 26
2.2.2 Motivation en contexte scolaire 29
2.3. Conceptions de soi de réussite scolaire
31
2.3.1 Organisation en mémoire des conceptions de soi de
réussite scolaire 31
2.3.2 Croyances en son efficacité personnelle 33
3. Lien entre enseignant et estime de soi des
adolescents. 34
3.1 Interactions de l'enseignant 34
3.2 Rôle de l'enseignant dans l'estime de soi des
élèves 36
3.2.1 Posture de l'enseignant 36
3.2.1.1 Postures enseignantes 36
3.2.1.2 Bienveillance 38
3.2.2 Langage : classification de bloom. 39
3.2.3 Nature des activités proposées 42
3.3 Évaluation 42
PROBLÉMATIQUE 45
PARTIE MÉTHODOLOGIQUE 48
1.Méthode 48
1.1 Participants 48
1.1.1 Participants protocole 1 48
1.1.2 Participants protocole 2 49
1.2 Procédure 49
1.2.1 Protocole 1 49
1.2.1.1 Questionnaire 49
1.2.1.2 Déroulement 52
1.2.2 Protocole 2 52
1.2.2.1 Pédagogie de projet 52
1.2.2.2 Questionnaire et grille d'observation 53
2. Résultats et analyse 54
2.1 Résultats en lien avec l'hypothèse
générale 1 55
2.2 Résultats en lien avec l'hypothèse 2
61
3. Discussion 68
3.1 Effets de l'estime de soi sur l'apprentissage
scolaire 68
6
3.2 Effets de l'enseignant sur l'estime de soi des
élèves 73
3.3 Critiques de nos méthodes 76
CONCLUSION 78
BIBLIOGRAPHIE 80
TABLE DES FIGURES 84
TABLE DES TABLEAUX 85
ANNEXES 86
ANNEXE 1 Questionnaire pour les élèves
87
ANNEXE 2 Fiche séquence projet « reportage
vidéo » 90
ANNEXE 3 Grille d'observation 91
ANNEXE 4 Questionnaire projet 92
ANNEXE 5 Réponses des participants pour chaque
item du test de Rosenberg. 93
ANNEXE 6 Table de la loi khi-deux 96
RÉSUMÉ 97
7
INTRODUCTION
J'ai toujours été attirée par les
métiers du social et par la période de l'adolescence. J'ai
également suivi des études en sciences de la vie et de la Terre.
Cette matière m'a toujours intéressée. Être
professeur en lycée professionnel regroupe ces deux aspects : le social
et les sciences. Depuis le mois de septembre, je suis professeur stagiaire au
Lycée Professionnel Marcel Dassault à Mérignac. J'enseigne
les sciences de la vie et de la Terre auprès d'une classe de
troisième prépa métier. J'enseigne aussi la
Prévention Santé Environnement à des classes de
première de différentes sections : vente, accueil, commerce,
métiers de l'électricité et de ses environnements
connectés, technicien d'usinage.
En commencent l'enseignement, j'ai été
confrontée à plusieurs situations intrigantes. En début
d'année, lors des présentations, huit élèves ont
mentionné le fait qu'ils auraient préféré
être en lycée général. Ils ne sont pas
intéressés par leur section. D'après eux, ils sont en
lycée professionnel, car ils estiment ne pas avoir les ressources
suffisantes pour être en lycée général. De plus,
j'ai également observé cet état d'esprit lors des
évaluations. Les élèves se sentent incapables de
réussir les évaluations, avant même d'avoir lu la
première question.
De ce fait, je me suis demandée la cause de cet
état d'esprit. Y a-t-il un rapport entre ces réactions et
l'estime de soi ? Des recherches ont été menées sur
l'estime de soi, et selon Doré (2007)1, « l'estime de
soi influence la façon de se percevoir, et par conséquent, la
manière d'agir et de réagir face aux situations. ». Nous
comprenons que si un élève se perçoit incapable, sa
manière d'agir, par exemple face à une évaluation, sera
différente que s'il se percevait capable : les résultats de son
évaluation seront donc peut-être modifiés par sa
manière d'agir.
C'est pourquoi j'ai été amenée à
me poser les questions suivantes : Qu'est-ce que l'adolescence ? Qu'est-ce que
l'estime de soi ? Quels sont les repères des
1 Doré, C. (2017). L'estime de soi : analyse
de concept. Recherche en soins infirmiers, 2(2), 18-26.
8
adolescents ? L'enseignant peut-il altérer l'estime de
soi d'un élève ? Ou bien au contraire l'améliorer ?
Existe-t-il des méthodes pédagogiques pour améliorer
l'estime de soi d'un élève ? Lesquelles ? L'estime de soi d'un
élève a-t-elle des effets sur son apprentissage scolaire ?
Lesquels ?
La question de départ est donc : l'estime de
soi des élèves peut-elle, d'une part, influer sur leurs
apprentissages scolaires, et, d'autre part, être influencée par
l'enseignant ?
En m'intéressant à cette problématique,
je cherche à mieux comprendre, d'une part, la construction de l'estime
de soi d'un adolescent, et d'autre part, le lien possible entre l'estime de soi
des adolescents, leurs apprentissages scolaires et le rôle de
l'enseignant. Des recherches montrent que la conception de soi et l'estime de
soi sont étroitement liées (Martinot, 20O1)2. Martinot
souligne que plus un élève a une organisation en mémoire
des conceptions de soi de réussite accessible, plus il sera performant
et fera des efforts pour progresser dans ses apprentissages scolaires. Martinot
souligne également le contraire : si l'organisation en mémoire
des conceptions de soi de réussite est moins accessible,
l'élève fera moins d'efforts, il atteindra de moins en moins
souvent des réussites dans son apprentissage scolaire, son organisation
en mémoire des conceptions de soi de réussite deviendra de moins
en moins accessible et il sera démotivé. De plus, aujourd'hui
dans le système éducatif Français, les textes officiels
mentionnent davantage la valorisation de l'estime de soi des
élèves et la bienveillance des enseignants (Blanquer,
2019)3. Nous comprenons donc que les enseignants doivent jouer un
rôle dans l'estime de soi des élèves.
Nous émettons alors les hypothèses suivantes :
- L'estime de soi des élèves influe sur leurs
apprentissages scolaires.
- L'enseignant influence l'estime de soi des
élèves à travers sa posture et la nature des
activité proposées aux élèves.
2 Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et estime
de soi : ingrédients pour la réussite scolaire. Revue des
sciences de l'éducation, 27 (3), 483-502.
3 Blanquer, J. M. (2019). Lettre de Jean-Michel
Blanquer aux professeurs sur le projet de loi pour une École de la
confiance. Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et
des sports.
9
Plus précisément, nous émettons
l'hypothèse que plus un élève a un niveau d'estime de soi
faible, plus il a de chance d'être en échec scolaire. Et
inversement. Ces hypothèses nous emmèneraient donc à
penser que l'enseignant peut renforcer l'estime de soi des élèves
afin d'améliorer leurs apprentissages scolaires.
Pour structurer cette recherche, nous organisons ce
mémoire en trois parties. Dans une première partie
théorique, nous nous intéresserons premièrement à
l'adolescence, puis à l'estime de soi en lien avec l'apprentissage
scolaire, en enfin aux stratégies de l'enseignant en lien avec l'estime
de soi des élèves. Nous rappellerons notre problématique
dans une seconde partie. Enfin, la troisième partie est une partie
méthodologique : nous expliquerons la méthodologie de
l'expérimentation, puis nous préciserons les résultats, et
enfin, nous discuterons ces résultats.
10
PARTIE THÉORIQUE
Afin de mieux comprendre les liens possibles entre l'estime de
soi des adolescents, leurs apprentissages scolaires et le rôle des
enseignants, il nous a paru intéressant d'étudier la
période de l'adolescence. Nous pensons ceci : expliquer les variations
de l'estime de soi durant la période de l'adolescence semble plus facile
en étudiant auparavant les changements s'opérant durant la
période de l'adolescence et en identifiant les repères des
adolescents. Nous définirons ensuite l'apprentissage scolaire et le
rôle d'un enseignant : nous associerons ces deux éléments,
le rôle de l'enseignant et l'apprentissage scolaire, à l'estime de
soi afin de découvrir, théoriquement, un lien possible entre ces
trois éléments.
1. Adolescence
Nous passons tous par la période de l'adolescence, mais
qu'est-ce que l'adolescence ? Nous recherchons, dans ce premier chapitre, les
différentes théories sur l'adolescence, les changements et les
repères des adolescents afin de mieux comprendre la période de
l'adolescence. Nous mettrons alors en lien plus facilement, dans un
deuxième chapitre, l'adolescence et l'estime de soi.
1.1 Théorie de l'adolescence 1.1.1 Définition
Nous savons que l'adolescence est une étape dans notre
vie, mais comment peut-elle se définir ? Selon Cloutier
(1996)4 « l'adolescence est la période qui sépare
l'enfance de l'âge adulte ». Cloutier écrit que l'adolescence
rassemble trois dimensions. La dimension biologique, nous entendons
par-là les transformations physiques et génétiques. La
dimension psychologique, à savoir les changements de comportements et de
processus mentaux. Enfin, la dimension sociale : en lien avec la
société et les relations de l'adolescent. Recherchons alors les
différentes théories fondées sur ces différentes
dimensions.
4 Cloutier, R. (1996). Psychologie de
l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.
11
1.1.2 Approches biologiques et psychologiques 1.1.2.1
Théorie de Hall
Hall s'est inspiré d'une théorie
développée en 1866 par Haechel dans son livre Generelle
Morphologie der Organismen (Hall, 1904)5. Cette théorie
se nomme : la théorie biogénétique de la
récapitulation. Elle suggère que le développement d'un
individu passe par l'histoire évolutive de ses ancêtres. Une
nouvelle génération d'individus ne se retrouve pas au point de
départ de son développement : elle a acquis les
développements des générations précédentes.
Hall compare des étapes de notre vie à des périodes de
l'histoire : le désir de monter dans les arbres à l'enfance
ferait référence à l'époque préhistorique
où les hommes montaient dans les arbres pour s'alimenter. Á
quelle période ferait référence l'adolescence ? Selon
Cloutier (1996)6, Hall compare l'adolescence à une
période « où l'homme vivait dans des sociétés
tribales ignorant la technique, mais connaissant des transitions
fréquentes et turbulentes ». Nous comprenons ici que ces
transitions turbulentes pourraient être la cause des changements
psychologiques des adolescents. Or, dans la théorie de Hall, nous
observons qu'il ne prend pas en compte la dimension sociale. Il évoque
seulement la génétique.
1.1.2.2 Théorie Freudienne
Freud propose une théorie du développement
distinguant le moi, le surmoi et le ça en 1923 (Quinodoz,
2004)7. Selon Freud, le ça représente les pulsions et
les désirs de l'individu : il fait partie de l'inconscience. Le surmoi,
lui, représente les interdictions, les lois morales. Enfin, le moi
représente le principe de la réalité : c'est la partie la
plus consciente. Le moi doit trouver un équilibre entre le ça, le
surmoi, et le monde extérieur. Il distingue également cinq stades
dans le développement psychosexuel. Les adolescents (12-18 ans)
représentent le stade cinq : le stade génital. Durant le stade
génital, il y a l'apparition de la puberté et une intensification
des pulsions
5 Hall, G. S. (1904). Adolescence. New York :
Appelton.
6 Cloutier, R. (1996). Psychologie de
l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.
7Quinodoz, J. (2004). Le moi et le ça, S.
Freud (1923b). In J. Quinodoz, Lire Freud : Découverte chronologique
de l'oeuvre de Freud (pp. 231-238). Paris : Presses Universitaires de
France.
12
sexuelles. La fille de Freud s'inspire de cette théorie
et selon elle, durant la période de l'adolescence, le ça prend le
dessus sur le moi : les pulsions sexuelles sont plus importantes et provoquent
un déséquilibre chez les adolescents (Chmid-Kilsilkis,
2002)8 . Chmid-Kilsilkis écrit que selon la fille de Freud,
l'adolescent peut également dominer ses pulsions d'une manière
excessive. Ce phénomène met l'adolescent dans une situation
inconfortable : il lutte pour trouver un bon équilibre. Cette lutte peut
mener à des comportements tel le désir de solitude ou bien au
contraire le désir d'être très entouré.
1.1.2.3 Théorie d'Erikson
Erikson propose une théorie sur la psychogenèse
identitaire, à savoir l'origine et le développement de
l'identité chez un être-humain par des phénomènes
psychiques (Cohen-Scali, Guichard, 2008)9. Comment
l'être humain construit-il son identité ? Cohen-Scali et Guichard
écrivent qu'Erikson distingue huit stades de développement
identitaire. Si l'être humain n'arrive pas à franchir tous ces
stades, il peut ressentir un sentiment d'aliénation. Les adolescents
représentent le stade cinq : la crise identitaire. Durant cette crise,
l'adolescent recherche qui il est. Il souhaite affirmer son moi, se pose des
questions individuelles, s'explore lui-même. Cette période peut
s'accompagner d'une détresse. Cette crise n'est pas négative,
selon Erikson, elle est normative et essentiel pour le développement de
l'identité (Da Conceição Taborda-Simões,
2005)10.
Cependant, l'idée d'une crise identitaire à
l'adolescence est contestée par plusieurs auteurs tel Coleman ou Keyes
(Cloutier, 1996)11. Selon Coleman, il n'y a pas une crise plus forte
à l'adolescence qu'à une autre période de la vie. Coleman
reproche aux recherches menées de ne pas être
représentatives des adolescents en général.
8 Schmid-Kilsikis, E. (2002). Le moi et les
mécanismes de défense. Dictionnaire international de la
psychanalyse. Paris : Hachette.
9 Cohen-Scali, V. & Guichard, J. (2008).
L'identité : perspectives développementales. L'orientation
scolaire et professionnelle, 37/3, 321-345.
10 Da Conceição
Taborda-Simões, M. (2005). L'adolescence : une transition, une crise ou
un changement ? Bulletin de psychologie, 5(5), 521-534.
11 Cloutier, R. (1996). Psychologie de
l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.
13
1.1.3 Approches culturelles et sociologiques
Mead pense que la culture est au centre du
développement de l'adolescent (Dasen, 1995)12. Mead met la
dimension culturelle avant la dimension biologique. Ses recherches comparent
des adolescents dans deux cultures différentes, en occident et à
Samoa. Dasen résume les travaux de Mead « la liberté
sexuelle accordée aux adolescents de Samoa permettrait une
période sans problème et une parfaite intégration dans la
communauté des adultes ». En occident, l'adolescence
représente une période de transition pour la sexualité :
les adolescents ont accès à la sexualité, mais la
société restreint cette sexualité. L'adolescence
représente aussi une période de transition pour les
responsabilités : la société prépare les
adolescents à devenir des adultes qu'ils ne sont pas encore. Selon Mead,
à Samoa, l'adolescence est une période de transition moins
marquée dans les rôles et les responsabilités,
évitant le stress chez les adolescents.
Davis, lui, pense que la dimension sociale est très
importante dans le développement des adolescents (Cloutier,
1996)13. Selon Davis, l'adolescence est une période où
l'adolescent change de rôle. Ce changement de rôle suscite des
tensions. La famille de l'adolescent, la classe sociale, les interactions avec
d'autres personnes influencent ce changement de rôle.
1.1.4 Approche écologique
Il existe une autre théorie, avec une approche
écologique, prôné par certains auteurs tel Barker et
Bronfenbrenner (Cloutier, 1996)14. Contrairement aux théories
biologiques et sociologiques, l'approche écologique se distingue par le
fait qu'elle ne met aucune dimension en avant. Dans les théories
écologiques, la biologie, la
12 Dasen, P. R. (1995). Représentation
sociale de l'adolescent : une perspective interculturelle. Vous avez dit...
pédagogie, 37, 17-30.
12 Cloutier, R. (1996). Psychologie de
l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.
13 Cloutier, R. (1996). Psychologie de
l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.
14 Cloutier, R. (1996). Psychologie de
l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.
14
psychologie et le social jouent des rôles égaux dans
le développement de l'adolescent.
1.2 Changements chez les adolescents
Nous comprenons qu'un changement se définit par une
modification ou une évolution. En grandissant notre corps et nos
pensées changent.
1.2.1 Développement biologique
Le corps se modifie physiologiquement et morphologiquement
lors de l'adolescence : c'est la puberté. Les organes génitaux se
modifient et maturent ; la voix, la pilosité, les seins se modifient
sous l'influence des hormones ; il y a l'apparition des règles chez les
filles et des éjaculations chez les garçons (Kauffmann,
2010)15.
Ces changements jouent un rôle sur le
développement psychique (phénomènes relevant de l'esprit)
des adolescents. Ils doivent accepter leur nouveau corps. Selon Discour
(2011)16, « Il est indispensable de comprendre que l'adolescent
se retrouve dans une situation narcissiquement inconfortable et douloureuse,
source d'inquiétudes voire d'angoisses. ». L'adolescent compare son
nouveau corps avec son idéal esthétique, sous l'influence des
médias. Les modifications pondérales et l'accumulation de
graisses, en particulier chez les filles, peuvent être source de
mal-être : les médias associent la beauté à la
minceur (Guellaï et Esseily, 2018)17. En ce qui concerne le
ménarche, à savoir l'apparition des règles : les
menstruations ont longtemps été un tabou jusqu'au XXème
siècle. Il est important pour les jeunes filles de connaître
l'existence des menstruations et leurs rôles avant leurs premières
règles pour ne pas ressentir un malaise suite à ce changement
identitaire (Mardon, 2009)18.
15 Kauffman, A. S. (2010). Coming og agee in the
kisspeptin Era : Sex differences, development and puberty. Molecular and
cellular Endocrinology, 324(1-2), 51-63.
16 Discour, V. (2011). Changements du corps et
remaniement psychique à l'adolescence. Les Cahiers Dynamiques,
1(1), 40-46.
17 Guellaï, B. & Esseily, R. (2018).
Psychologie du développement. Paris : Armand Colin.
18 Mardon, A. (2009). Les premières
règles des jeunes filles : puberté et entrée dans
l'adolescence. Sociétés contemporaines, 3(3),
109-129.
15
1.2.2 Développement métacognitif
La métacognition se développe durant
l'adolescence. Qu'est-ce que la métacognition ? Elle se traduit par le
fait de penser sur nos pensées (Flavell, 1985)19. Nous
comprenons que la métacognition rend possible la représentation
de soi à soi-
|
même et
|
l'utilisation des connaissances que nous possédons.
|
Les adolescents
|
réfléchissent sur leurs points faibles et sur
leurs points forts (Guellaï et Esseily, 2018)20. La
métacognition permet également de réfléchir sur nos
émotions et sur nos interactions avec d'autres personnes.
Nous nous sommes posés cette question : l'enseignant
pourrait-il travailler sur la métacognition des élèves
afin d'influer sur leur estime de soi ? Nous nous intéresserons à
cette possibilité dans notre troisième chapitre.
1.3 Références et repères sociaux des
adolescents
Les adolescents requièrent des repères,
autrement dit des personnes les aidant à s'orienter, de la
reconnaissance et de l'organisation pour se développer. Les adultes
entourant un adolescent doivent apprendre à écouter ses demandes,
mais ils doivent également établir des limites, des règles
(Cannard, 2019)21.
1.3.1 Parents
L'adolescent cherche sa propre identité, il souhaite se
différencier de ses parents, or les parents continuent de jouer un
rôle primordial dans le développement de l'adolescent (Coslin,
2006)22. L'adolescent veut devenir autonome, c'est-à-dire
d'après Steinberg (1990)23, être capable de «
penser, ressentir, prendre des décisions et agir de son propre chef
», mais il souhaite également que ses parents veillent sur lui.
Cette quête d'autonomie peut engendrer des conflits entre l'adolescent et
les
19 Flavel, J. H. (1985). Cognitive
development. Etats-Unis : Prentice-Hall.
20 Guellaï, B. & Esseily, R. (2018).
Psychologie du développement. Paris : Armand Colin.
21 Cannard, C. (2019). Le développement de
l'adolescent. Belgique : De Boeck Supérieur.
22 Coslin, P. G. (2002). Psychologie de
l'adolescent. Paris : Armand Colins.
23 Steinberg, L. (1990). Autonomy, conflict, and
harmony in the family relationship. In S. S. Feldman & G. R.
Elliott (Eds.), At the threshold: The developing adolescent (p.
255-276). Etats-Unis : Harvard University Press.
16
parents, mais ces conflits sont nécessaires dans le
processus d'acquisition de l'autonomie.
Selon Cannard (2019)24, le style éducatif
utilisé par les parents a des incidences différentes sur
l'adolescent. Cannard classe quatre styles éducatifs parentaux (figure
1)
|
Degré d'affirmation du contrôle
élevé faible
|
|
Degrés de sensibilité
aux besoins de
l'ado
|
Elevé Faible
|
Autoritaire/démocratique Indulgent/permissif
Autoritariste/autocratique
Indifférent/désengagé
|
Figure 1 : Classification des quatre styles
éducatifs parentaux
.
Le premier est le style autocratique, les parents demeurent
stricts, exigeants et peu sensibles aux besoins de l'adolescent. Le
deuxième est le style permissif, les parents n'imposent pas de limite
claire et sont très sensibles aux besoins de l'adolescent. Le
troisième est le style désengagé, les parents sont
indifférents aux limites et aux besoins de l'adolescent. Enfin, le
dernier est le style démocratique, les parents communiquent avec
l'adolescent en étant très sensibles à ses besoins et aux
limites à lui imposer. Ces différents styles éducatifs
engendrent des comportements différents chez les adolescents, ils ne
bénéficient pas tous des mêmes repères. Un
adolescent avec des parents de style désengagé ne
bénéficie d'aucun soutien de leur part : il est davantage
susceptible d'adopter un comportement antisocial ou dépressif. Au
contraire, un adolescent avec des parents de style démocratique est
davantage susceptible de développer son intersubjectivité
réflexive.
De plus, les repères d'un adolescent peuvent être
modifiés suite à un changement familial : divorce
(séparation des parents), recomposition familiale (demi-
24 Cannard, C. (2019). Le développement de
l'adolescent. Belgique : De Boeck Supérieur.
17
frère, demi-soeur, beaux-parents),
monoparentalité (un seul parent). Suite à ces
événements de plus en plus fréquents de nos jours,
l'adolescent peut ressentir un sentiment de détresse, d'abandon ou
encore d'anxiété s'il n'accepte pas la situation (Coslin,
2006)25.
Enfin, il est également important de mentionner l'effet
de l'utilisation du numérique dans les familles. Les smartphones, la
télévision, les ordinateurs font aujourd'hui partie de notre
quotidien. L'utilisation passive et excessive du numérique, engendre une
perte d'interactions humaines et une perte d'attention (Desmurget,
2019)26. Selon Desmurget, lorsqu'une personne utilise son smartphone
durant une conversation, son attention diminue et elle répond par des
phrases courtes. C'est le même phénomène avec une
télévision allumée lors d'un repas. Les adolescents ont
besoin d'attention, ils ont besoin de communiquer avec leurs parents. Plus les
parents utilisent passivement les outils numériques, plus l'adolescent
se sent délaissé.
1.3.2 Enseignants
Les enseignants jouent également un rôle
important dans le développement des adolescents. Selon Balegamire
Bazilash et Marc (2000)27, les enseignants « jouent le
rôle d'imago parentale ». Ils possèdent la capacité
d'orienter, de soutenir, de cadrer un adolescent. Nous comprenons ici qu'un
enseignant peut devenir un repère principal pour un adolescent, d'autant
plus si l'adolescent se sent délaissé par sa famille. Balegamire
Bazilash et Marc insistent sur la notion de distance : l'enseignant est tenu de
garder une certaine distance avec l'élève afin de favoriser son
développement du soi.
25 Coslin, P. G. (2002). Psychologie de
l'adolescent. Paris : Armand Colins.
26 Desmurget, M. (2019). La fabrique du
crétin digital. France : Seuil.
27 Balegamire Bazilashe, J. & Marc, P. (2000).
Adolescence : des clefs pour comprendre. Suisse : édition du
tricorne.
18
Pour conclure sur ce premier chapitre, nous comprenons ceci :
· L'adolescence rassemble différentes dimensions
: sociale, psychologique, biologique.
· L'adolescence implique des changements physiques et
psychologiques.
· Les personnes qui servent de repères pour les
adolescents jouent un rôle important dans leur développement.
Nous pensons, de part ces changements physiques et
psychologiques et leurs différents repères, que la période
de l'adolescence est propice aux variations de leur estime de soi. Nous
recherchons à comprendre le développement de l'estime de soi d'un
adolescent. Nous pensons également que l'estime de soi influence
l'apprentissage scolaire des adolescents. Nous définirons, dans le
deuxième chapitre, l'estime de soi et l'apprentissage scolaire afin de
faire un lien entre l'adolescent, l'estime de soi, et l'apprentissage
scolaire.
2. Lien entre estime de soi et apprentissage scolaire
Comment définir l'estime de soi ? Quel est le
rôle de l'estime de soi des adolescents dans l'apprentissage scolaire ?
L'objectif de ce deuxième chapitre est d'étudier ces questions
afin de mieux comprendre le lien entre l'estime de soi des adolescents et
l'apprentissage scolaire. Dans le troisième chapitre, nous pourrons
alors étudier plus facilement le rôle des enseignants dans
l'estime de soi des adolescents.
2.1. Concept de soi et estime de soi
Pour évoquer l'estime de soi, de nombreux termes sont
employés, comme par exemple le concept de soi (Fiasse &
Nader-Grobois, 2016)28. Selon Fiasse et Nader-
28 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016).
De la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck
Supérieur.
19
Grobois, le concept de soi est étroitement lié
à l'estime de soi, mais ces deux notions sont différentes.
2.1.1. Définition du concept de soi
Il existe de nombreux modèles conceptuels du concept
de soi avec des approches psychosociales, psychanalytiques,
phénoménologiques ou encore cognitives (Fiasse &
Nader-Grobois, 2016)29. Le concept de soi correspond essentiellement
à des descriptions de soi-même dans les domaines cognitif, social
et physique (Duclos, 2004)30. Selon Duclos, le concept de soi est
une représentation globale du soi se définissant comme la
façon dont une personne se décrit elle-même. Duclos place
le concept de soi à l'interface entre la connaissance de soi, à
savoir la façon dont une personne se perçoit dans
différents domaines, et le moi idéal, à savoir ce que la
personne souhaite être.
Cadieux (2003)31, insiste sur le fait que le
concept de soi peut être réaliste mais aussi irréaliste :
l'auto-description d'une personne doit correspondre à la description de
cette personne faite par une autre personne de son entourage. Plus ces deux
descriptions sont éloignées, plus le concept de soi est
irréaliste et inversement.
2.1.2. Différents modèles du concept de
soi
L'évolution du concept de soi a fait émerger
différents modèles pour le décrire (Fiasse &
Nader-Grobois, 2016)32.
29 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016).
De la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck
Supérieur.
30 Duclos, G. (2004). L'estime de soi, un
passeport pour la vie. Montréal : hôpital Sainte-Justine.
31 Cadieux, A. (2003). Concept de soi et
comportements en classe d'élèves vivant avec une
déficience intellectuelle : une étude longitudinale. Revue
francophone de la déficience intellectuelle, 14(2), 121-137.
32 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016).
De la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck
Supérieur.
20
2.1.2.1 Modèle unidimensionnel
Fiasse & Nader-Grobois (2016)33 écrivent
que certains auteurs, tels Rosenberg et Coopersmith « envisagent le
concept de soi et l'estime de soi dans sa globalité et son
unicité, selon une approche globale et unidimensionnelle ».
Autrement dit, Rosenberg et Coopersmith n'envisagent pas qu'une personne puisse
se percevoir différemment en fonction des domaines (social, physique ou
encore scolaire) dans lesquels elle s'observe : ils envisagent un facteur
dominant tous les autres pour créer une estime de soi globale.
2.1.2.2 Modèle multidimensionnel
Le modèle unidimensionnel est controversé et fait
émerger le modèle multidimensionnel (figure 2).
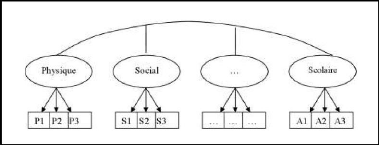
Figure 2 : Modèle multidimensionnel
corrélé du concept de soi
Selon Marsh (1997)34, le concept de soi ne se
caractérise pas seulement par une image globale, mais par un ensemble de
représentations dans différents domaines reliés entre eux,
tel le domaine physique, social ou encore scolaire. Autrement dit, il
existerait autant de conception de soi que de domaines dans lesquels une
personne peut s'observer et se décrire (Harter, 1983)35.
33 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016).
De la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck
Supérieur.
34 Marsh, H.W. (1997). The measurement of physical
self-concept : a construct validation approach. In K.R. Fox (Ed.), The
physical self : from motivation to well-being (pp. 27-58). Etats-Unis :
Human Kinetics.
35 Harter, S. (1983). Supplementary
description of the Self-Perception Profile for children : Revision of the
Perceived Competence Scale for children. Denver : University of Denver.
21
2.1.2.3 Modèle hiérarchique
Le modèle hiérarchique représente un
modèle structuré et hiérarchisé. Il met en lien le
modèle multidimensionnel et le modèle unidimensionnel. Le concept
de soi global résulte à présent de différents
domaines eux-mêmes organisés en sous-domaines (Marsh,
2008)36. Par exemple, le concept de soi général se
constitue de plusieurs domaines, comme le domaine du concept de soi scolaire ou
encore le domaine du concept de soi social, puis ces domaines sont
constitués de sous-domaines. Prenons l'exemple du domaine scolaire, ses
sous-domaines sont par exemple l'anglais, la prévention santé
environnement ou encore les maths, autrement dit des disciplines
différentes. Enfin, dans chaque sous-domaine, la personne évalue
des situations spécifiques, comme par exemple une évaluation
proposée par l'enseignant de prévention santé
environnement. Hubner, Shavelson et Stanton (1976)37 proposent une
représentation du modèle hiérarchique du concept de soi
(figure 3). D'après Hubner et all, le concept de soi
général est plus stable que les dimensions du soi
spécifique dans les différents domaines. Même si les
domaines sont reliés entre eux, ils peuvent se différencier.
36 Marsh, H.W. (1997). The measurement of physical
self-concept : a construct validation approach. In K.R. Fox (Ed.), The
physical self : from motivation to well-being (pp. 27-58). Etats-Unis :
Human Kinetics.
37 Hubner, J.J. & Shavelson, R.J. &
Stanton, G.C. (1976). Validation of construct interpretations. Review of
Educational Research, 46, 407-441.
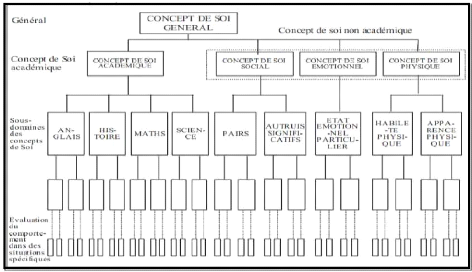
22
Figure 3 : Représentation de l'organisation
hiérarchique du concept de soi.
2.1.3. Estime de soi
Nous avons expliqué la notion du concept de soi, mais
alors quel est le lien du concept de soi avec l'estime de soi ? L'estime de
soi, selon le petit Larousse de la psychologie (2016)38, se
définit comme « l'attitude plus ou moins favorable envers
soi-même, la manière dont on se considère, le respect que
l'on se porte, l'appréciation de sa propre valeur dans tel ou tel
domaine ». L'estime de soi en comparaison avec le concept de soi, implique
un aspect évaluatif. Selon Duclos (2004)39, la divergence
entre la connaissance de soi et le moi idéal influence l'estime de soi
(figure 4).
38 Antoine, C. & Angel, S. (2016). Estime de
soi. In Le petit Larousse de la psychologie (pp. 297-305). Paris :
Larousse.
39 Duclos, G. (2004). L'estime de soi, un
passeport pour la vie. Montréal : hôpital Sainte-Justine.
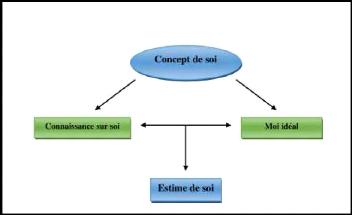
.
23
Figure 4 : Schéma des liens entre concept de
soi et estime de soi
Nous comprenons ici que plus les réussites et les
connaissances de soi d'une personne seraient proches de ses aspirations et de
son moi idéal, plus elle aurait une haute estime d'elle-même. Au
contraire, plus les réussites et les connaissances de soi d'une personne
seraient éloignées de ses aspirations et de son moi idéal,
plus elle aurait une basse estime d'elle-même.
Pour Duclos (2004)40, d'autres composantes, en
plus de la connaissance de soi, constituent l'estime de soi.
Premièrement le sentiment de confiance, à savoir la
sécurité physique et psychologique, puis le sentiment de
compétences, à savoir l'évaluation à propos de ses
compétences dans différents domaines permettant d'affronter les
situations avec succès, et enfin le sentiment d'appartenance, à
savoir le besoin de faire partie d'un groupe social.
2.1.4. Facteurs influençant l'estime de soi des
adolescents
Il existe de nombreux facteurs influençant l'estime de
soi des adolescents. Étudions quelques-uns de ces facteurs, comme les
facteurs individuels et les facteurs impliquant des personnes
extérieures.
40 Duclos, G. (2004). L'estime de soi, un
passeport pour la vie. Montréal : hôpital Sainte-Justine.
24
2.1.4.1 Facteurs individuels de l'adolescent
L'estime de soi varie, premièrement, en fonction de
l'âge d'une personne. Nous avons étudié dans le chapitre
précédent que l'adolescence représente une période
de changements : recherche identitaire, préoccupations sociales,
développement de l'autonomie de pensée, puberté. Les
sentiments de confiance, de compétences, de connaissance de soi et
d'appartenance sont susceptibles de se modifier lors de ces changements, et par
conséquence d'entraîner une variation de l'estime de soi chez
l'adolescent (Duclos, 2004)41.
Donnons un exemple d'un facteur individuel lié
à l'âge des adolescents : selon Hater, des domaines
spécifiques de la conception de soi prédominent par rapport
à d'autres domaines lors de l'adolescence et participent davantage
à l'estime de soi globale. Ces domaines sont l'apparence physique,
l'acceptation et les relations sociales avec les pairs ainsi que les
compétences scolaires. Plus l'auto-évaluation de l'adolescent sur
ces domaines spécifiques est positive, plus son estime de lui global
augmente, car à son âge, il apporte beaucoup d'importance à
ces domaines (Cannard, 2019)42.
Deuxièmement, Bardou et Oubrayrie-Roussel
(2014)43 écrivent que l'estime de soi à l'adolescence
diffère en fonction du genre. Selon Bardou et Oubrayrie-Roussel, de par
les médias et les diktats de la beauté diffusés, les
filles, en comparaison avec les garçons, sont davantage susceptibles de
s'auto-évaluer négativement dans le domaine physique. La
différence d'estime de soi entre les genres apparaît aussi au
niveau des stéréotypes dans le milieu scolaire : les
garçons s'auto-évalueraient plus positivement dans les domaines
des mathématiques et résolutions de problèmes alors que
les filles s'auto-évalueraient plus positivement dans le domaine verbal
(Marsh et al, 1998)44.
41Duclos, G. (2004). L'estime de soi, un
passeport pour la vie. Montréal : hôpital Sainte-Justine.
42Cannard, C. (2019). Le développement de l'adolescent.
Belgique : De Boeck Supérieur. 43Bardou, E. &
Oubrayrie-Roussel, N. (2014). L'estime de soi. Paris : In Press.
44Marsh, H.W. (1998). Age and Gender Effects in
Physical Self-Concepts for Adolescent Elite Athletes and Nonathletes : A
multicohort-Miltioccasion Design. Journal of Sport and Exercise
Psychology, 20, 237-259.
25
2.1.4.2 Facteurs impliquant des personnes
extérieures
Dans le premier chapitre, nous avons vu que la dimension
sociale s'avère être très importante lors de la
période de l'adolescence. Les personnes extérieures jouent un
rôle important dans l'estime de soi des adolescents (Cannard,
2019)45. Cannard, en s'inspirant des auteurs Bolognini et
Prêteur, expose différents facteurs influençant l'estime de
soi des adolescents. Ces facteurs impliquent des personnes extérieures
:
· L'intériorisation des jugements des
autres ; à savoir le jugement porté par la famille, les
enseignants, les amis de l'adolescent. Si ces personnes apportent du soutien,
de l'affection, et jugent d'une façon positive les actions de
l'adolescent, alors l'estime de soi de cet adolescent augmentera, et
inversement.
· L'opinion d'une personne déterminante ;
autrement dit si de nombreuses personnes émettent une opinion
positive sur l'adolescent, mais qu'une seule personne en particulier comptant
beaucoup pour l'adolescent émet une opinion négative sur lui,
alors l'estime de soi de cet adolescent sera altérée.
· Le style éducatif parental ;
nous avons déjà étudié les différents styles
éducatifs parentaux dans le premier chapitre, à présent
expliquons l'effet de ces différents styles éducatifs sur
l'estime de soi des adolescents. Toujours d'après Cannard «
l'estime de soi sera d'autant plus positive que dans le style éducatif
s'exercent la négociation, la relation, la communication et
l'encouragement à la prise de décisions. Á
l'opposé, l'estime de soi sera négative lorsque seront
prédominants le contrôle, la contrainte, et une faible
communication ». Nous comprenons alors que le style éducatif
démocratique favorise une haute estime de soi de l'adolescent, et au
contraire le style éducatif désengagé favorise une basse
estime de soi de l'adolescent.
45 Cannard, C. (2019). Le développement de
l'adolescent. Belgique : De Boeck Supérieur.
·
26
L'écart à des modèles ;
un adolescent se compare sans cesse aux autres personnes comme les
stars ou ses propres amis dans tous les domaines du concept de soi. Par exemple
dans le contexte scolaire, l'estime de soi d'un adolescent peut diminuer s'il
obtient des notes toujours inférieures aux notes de ses camarades de
classe. L'adolescent se compare et peut se sentir incapable par rapport aux
autres.
Nous pouvons reporter tous ces derniers facteurs dans un
contexte scolaire. Au lycée, l'adolescent est entouré de
nombreuses personnes : ses amis, ses camarades de classe, ses enseignants. Chez
lui, sa famille et ses parents jouent également un rôle dans la
scolarité de l'adolescent, par exemple pour son l'orientation ou bien
pour le suivi des devoirs. Lorsque qu'un adolescent se retrouve dans un
contexte scolaire, il ne fait pas face qu'à une seule dimension du
concept de soi : plusieurs dimensions du concept de soi interviennent.
Dans le domaine scolaire, les facteurs motivationnels (ce qui
motive l'élève à apprendre) sont également
très importants dans l'estime de soi, nous l'étudierons
ci-dessous (Fiasse & Nader-Grobois, 2016)46.
2.2 Apprentissage scolaire
Rappelons-le, nous pensons qu'il existe un lien entre
l'estime de soi des adolescents (les apprenants) et leurs apprentissages
scolaires. Avant d'identifier un lien possible, expliquons ce qu'est
l'apprentissage scolaire.
2.2.1 Processus d'apprentissage
Selon Anderson (2000)47, apprendre c'est
transformer une connaissance ancienne ou bien élaborer une connaissance
nouvelle. Un processus d'apprentissage
46 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016). De
la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck
Supérieur.
47 Anderson, J. R. (2000). Learning and memory.
New York : Wiley.
27
se met en place pour apprendre. Musial, Pradère et Tricot
(2008)48 expliquent les six processus d'apprentissage suivants :
· L'interprétation (ou
compréhension) : il s'agit d'un « processus
d'élaboration d'une connaissance spécifique d'une situation, d'un
texte, d'un objet, d'une image, d'un fait ». Autrement dit, c'est le
processus permettant une représentation mentale.
· La conceptualisation : il s'agit d'un
« processus d'élaboration d'un concept », mobilisable dans
différentes situations.
· La procéduralisation : il
s'agit « soit d'un processus d'élaboration d'une connaissance
procédurale, soit d'un processus de transformation d'une connaissance.
». Ce processus se compose de trois grandes étapes.
Premièrement, l'élève identifie des connaissances
nécessaires à la résolution du problème, ensuite il
associe la situation à une solution, enfin il « crée des
règles qui consistent en l'appariement entre une condition et une
action. ».
· L'automatisation : il s'agit d'un
processus permettant la transformation d'une méthode en automatisme :
« elle devient un automatisme ou un schéma quand elle est
fréquemment utilisée et régulièrement
rencontrée. ».
· La prise de conscience : il s'agit
d'un processus permettant « l»élaboration d'une connaissance
déclarative de quelque chose que l'on sait faire. C'est se mettre
à comprendre ce que l'on savait faire « sans
réfléchir ». Autrement dit c'est la capacité à
expliquer ce que l'on sait.
· La mise en application : il s'agit
d'un processus de particularisation d'une connaissance
générale.
Afin que l'élève puisse apprendre, une
séance se doit d'être construite de manière
réfléchie. La séance doit apporter une réponse
à l'élève. Le scénario d'une séance peut se
référer au scénario de la figure ci-dessous (figure 5).
48 Tricot, A. & Musial, M. & Pradère,
F. (2011). Prendre en compte les apprentissages lors de la conception d'un
scénario pédagogique. Open Edition Journal, 68.
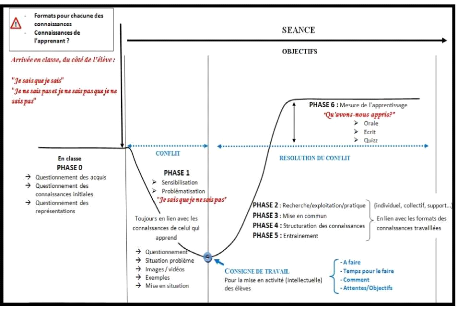
28
Figure 5 : Schéma de construction d'une
séance (Guillet sur la base des cours de
Tanguy 2017)
.
Selon Tanguy (2021)49, lors de la phase 0,
l'élève arrive en classe L'enseignant commence par questionner
les acquis de l'apprenant à l'aide d'un support par exemple :
l'apprenant ne sait pas qu'il ne sait pas. Lors de la phase 1, l'enseignant
problématise la séance, l'élève fait alors face
à un conflit cognitif, à présent il sait qu'il ne sait
pas. Les phases suivantes ont pour objectif de résoudre ce conflit
cognitif. Lors de la phase 2, l'élève se met en activité,
c'est une phase de recherche où il doit être actif. Lors de la
phase 3, les recherches de l'élève sont mises en commun avec les
autres élèves. La phase 4 structure les connaissances. Lors de la
phase 5 l'élève s'entraîne sur ses nouvelles connaissances.
Durant la dernière phase, l'élève doit être en
mesure d'expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il a appris et comment il pourra
réinvestir ce qu'il a appris. Toutes ses phases sont reliées par
des micro-ajustements. Précisons
49 Tanguy, F. (2020). Cours dispensés dans
le cadre du module didactique générale, master 2
MEEF.
29
que le schéma de la figure n'est pas mis à la
bonne échelle au niveau du temps : la phase 1 est plus courte que la
phase 3 par exemple.
Toujours selon Tanguy, apprendre fait appel à la
mémoire à long terme (mémoire permettant à
l'apprenant de maintenir les informations sur une longue période) et
à la mémoire de travail (mémoire permettant à
l'apprenant de maintenir les informations quelques instants). La mémoire
de travail est sollicitée en première, mais les informations sont
stockées dans le temps dans la mémoire à long terme.
Apprendre demande aux apprenants de fournir des efforts. Les apprenants
s'engageront à faire ses efforts seulement s'ils sont motivés.
Pour être motivé, l'apprenant doit être attentif. Être
attentif est un élément de posture de l'apprenant.
La motivation s'avère donc être un
élément important pour faire progresser les élèves
dans leurs apprentissages et leurs réussites scolaires.
Intéressons-nous alors à la motivation des élèves,
afin d'en établir un lien avec l'estime de soi des
élèves.
2.2.2 Motivation en contexte scolaire
Selon Viau (1998)50, la motivation en contexte
scolaire se définit comme « un état dynamique qui a ses
origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et
de son environnement et qui l'incite à choisir une activité,
à s'y engager et à persévérer dans son
accomplissement afin d'atteindre un but. ». Nous comprenons donc que
l'estime de soi d'un élève et sa motivation en contexte scolaire
ne se dissocient pas l'une de l'autre : la façon dont se perçoit
l'élève et l'auto-évaluation de ses capacités
scolaires peuvent influencer sa motivation, nous l'étudierons plus
précisément ensuite.
Dans une perspective socio-cognitive, Viau
(2004)51 propose un modèle de motivation en contexte
scolaire, créant une « dynamique motivationnelle » (figure
6).
50 Viau, R. (1998). Les perceptions de
l'élève : sources de sa motivation dans les cours de
français. Québec français,
(110), 45-47.
51 Viau, R. (2004). La motivation : condition
de plaisir d'apprendre et d'enseigner en contexte scolaire, 3e
congrès des chercheurs en éducation Bruxelles. Québec :
université de Sherbrooke.
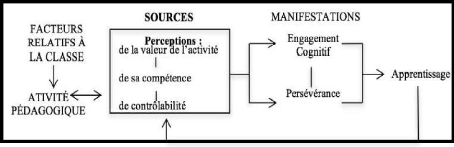
30
Figure 6 : Modèle de la dynamique motivationnelle
de l'élève d'après Viau (2004)
Dans le modèle de Viau (2004)52, les sources
de motivation de l'élève se caractérisent par les
perceptions suivantes :
· La perception de la valeur qu'il accorde
à l'activité ; l'élève se pose la question
« Pourquoi ferais-je cette activité ? ». Deux types de
motivations interviennent alors. La première se nomme la motivation
intrinsèque qui provient de l'intérêt de
l'élève, il n'attend pas de récompense extérieure.
La deuxième se nomme la motivation extrinsèque où
l'élève réalise l'activité dans l'objectif
d'obtenir une récompense.
· La perception qu'il a de sa compétence
à accomplir ; l'élève se pose la question «
Suis-je capable d'y arriver ? ». Nous avons déjà
expliqué le principe du concept de soi et de l'estime globale, en se
posant cette question nous comprenons alors que l'élève fait
appel à sa perception du concept de soi dans les sous-domaines du
domaine scolaire qui eux-mêmes influencent l'estime de soi globale de
l'élève.
· Sa perception de contrôlabilité
; l'élève se pose la question « Vais-je
réussir à finir l'activité ? ».
Ces perceptions influencent l'engagement cognitif
de l'apprenant, à savoir les efforts fournis par l'apprenant
pour réaliser l'activité, sa
persévérance, autrement
52 Viau, R. (2004). La motivation : condition
de plaisir d'apprendre et d'enseigner en contexte scolaire, 3e
congrès des chercheurs en éducation Bruxelles. Québec :
université de Sherbrooke.
31
dit, la durée qu'il consacre à
l'activité, et enfin son apprentissage, à savoir
l'ensemble de son attitude et de son comportement menant vers la
réussite de l'activité.
Viau (1998)53 liste également quatre
facteurs influençant la dynamique motivationnelle de
l'élève dans un contexte scolaire : les facteurs relatifs
à la classe, tels l'enseignant ou le climat de classe,
les facteurs relatifs à l'école tels les
horaires ou le règlement, les facteurs relatifs à la
société telle la culture et enfin les facteurs
relatifs à la vie de l'élève tels sa famille ou
ses amis.
Nous avons déjà étudié les
facteurs influençant l'estime de soi d'un adolescent ; nous remarquons
ici que les facteurs influençant la motivation scolaire d'un apprenant
présentent des similitudes avec les facteurs influençant l'estime
de soi d'un adolescent : présences des personnes extérieures. De
plus, dans le modèle dynamique motivationnel de Viau, la perception
qu'un apprenant a de ses compétences est également en lien avec
la dimension évaluative de l'estime de soi : l'adolescent est
motivé car il se sent capable de faire l'activité. Nous
constatons donc que l'estime de soi et la motivation des apprenants sont
liées, mais quels sont les effets de l'estime de soi sur la motivation
et sur l'apprentissage scolaire des apprenants ?
2.3. Conceptions de soi de réussite scolaire
Recherchons à présent les effets de l'estime de
soi et des conceptions de soi sur la motivation et l'apprentissage scolaire des
adolescents.
2.3.1 Organisation en mémoire des conceptions de
soi de réussite scolaire
Á partir des travaux de psychologie sociale, Martinot
(2001)54 met en lien l'organisation en mémoire des
conceptions de soi de réussite scolaire, à savoir que
53 Viau, R. (1998). Les perceptions de
l'élève : sources de sa motivation dans les cours de
français. Québec français,
(110), 45-47.
54 Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et
estime de soi : ingrédients pour la réussite scolaire. Revue
des sciences de l'éducation, 27 (3), 483-502.
32
l'élève garde en mémoire ses
réussites dans le milieu scolaire, avec la réussite scolaire.
Selon Martinot, « c'est un cercle vicieux », plus un
élève a une organisation en mémoire des conceptions de soi
de réussite scolaire accessible, plus il sera performant et
motivé pour effectuer des efforts afin de progresser dans son
apprentissage scolaire. Au contraire, si cette organisation en mémoire
des conceptions de soi de réussite scolaire est moins accessible,
autrement dit que l'élève n'a pas souvenir de ses
réussites dans le milieu scolaire, alors il fera moins d'efforts. En
faisant moins d'efforts, il atteindra de moins en moins souvent des
réussites scolaires, son organisation en mémoire des conceptions
de soi de réussite scolaire deviendra de moins en moins accessible et il
sera démotivé. Précisons que cette organisation en
mémoire des conceptions de soi de réussite scolaire peut varier
entre chaque matière, par exemple entre le français et les
mathématiques.
Plus un adolescent a un niveau de conception de soi
élevé, plus il arrive à effectuer des ajustements de type
cognitif, émotionnel et comportemental, afin de trouver des solutions
pour palier ses difficultés. Au contraire, plus un élève a
un niveau de conception de soi faible, moins il essaiera de trouver des
solutions pour palier ses difficultés (Bariaud et Bourcet,
1998)55. L'élève avec une conception de soi faible
peut donc se désengager complétement des activités
scolaires par peur de ne pas les réussir. L'élève utilise
des stratégies pour ne pas réaliser les activités, ou bien
pour se créer des obstacles lui-même, qui se nomment les «
stratégies d'auto-handicap » ; ces stratégies ont pour
objectif de protéger leur estime de soi (Leyrit, 2010)56.
Cependant, l'estime de soi et les concepts de soi ne
concernent pas que le domaine scolaire, nous l'avons déjà
étudié, il existe différents domaines. Si un
élève en échec scolaire se désintéresse du
système scolaire, alors son estime de soi ne sera plus associée
au milieu scolaire, il portera davantage d'importance à un autre
domaine,
55 Dozot, C. & Piret, A. & Romainville, M.
(2009). L'estime de soi des étudiants de première année du
supérieur en abandon d'études. L'orientation scolaire et
professionnelle, 38/2, 205230.
56Leyrit, A. & Oubrayrie-Roussel, N. &
Prêteur, Y. (2011). L'auto-handicap chez les adolescents : Analyse d'une
stratégie de protection de Soi à l'école.
L'orientation scolaire et professionnelle, 40/2.
33
comme par exemple le domaine social. L'adolescent peut
s'intégrer dans un groupe d'élève du même niveau
scolaire, et vouloir obtenir leur respect, par exemple en transgressant les
règles en classe. Son estime de soi sera haute grâce au respect
que son groupe d'amis lui accorde, mais il ne voudra pas progresser dans ses
apprentissages scolaires (Fiasse & Nader-Grobois, 2016)57.
2.3.2 Croyances en son efficacité personnelle
D'après Cannard (2019)58 « si vous
croyez en votre efficacité et que vous vous attendez à
réussir, vous étudierez bien et vous accroîtrez vos chances
de réussir ». Nous comprenons que l'inverse est aussi valable :
plus un élève s'attend à échouer, moins il est
motivé et moins il a de chance de réussir et de progresser dans
son apprentissage scolaire. Ce phénomène se nomme « le
phénomène de l'auto-réalisation de la prophétie
» (figure 7).
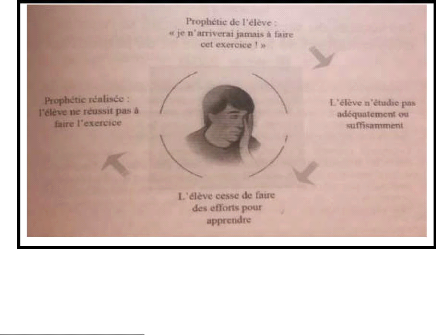
Figure 7 : Phénomène de l'auto-réalisation
de la prophétie d'après Bandura
57 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016). De
la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck
Supérieur.
58 Cannard, C. (2019). Le développement de
l'adolescent. Belgique : De Boeck Supérieur.
34
Les croyances en son efficacité personnelle peuvent
être influencées par les autres camarades de classe.
Inconsciemment, les élèves se comparent entre eux. Un
élève peut se comparer avec d'autres élèves ayant
un niveau scolaire plus faible : la croyance en son efficacité
personnelle et son estime de soi augmente, mais la progression dans son
apprentissage scolaire peut stagner, ou même régresser (Martinot,
2001)59.
Pour conclure ce chapitre, nous comprenons ceci :
· La motivation des apprenants influence leur apprentissage
scolaire.
· L'estime de soi et les conceptions de soi de
l'adolescent influencent la motivation et par conséquence
l'apprentissage scolaire.
Cependant nous avons également étudié
que les personnes extérieures jouaient un rôle important dans
l'estime de soi des adolescents. Qu'en est-il des enseignants ? Peuvent-ils
influencer l'estime de soi des adolescents afin de les motiver pour les faire
progresser dans leurs apprentissages scolaires ?
3. Lien entre enseignant et estime de soi des
adolescents.
Recherchons dans ce dernier chapitre, les liens possibles
entre les enseignants, qui peuvent être des repères pour les
adolescents, et l'estime de soi des adolescents. Avant d'identifier les liens
possibles, étudions le rôle des enseignants.
3.1 Interactions de l'enseignant
L'enseignant joue un rôle primordial dans
l'apprentissage des élèves. Houssaye (2014)60 propose
un triangle pédagogique reliant l'enseignant, l'apprenant et le savoir
(figure 8).
59 Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et
estime de soi : ingrédients pour la réussite scolaire. Revue
des sciences de l'éducation, 27 (3), 483-502.
60 Houssaye, J. (2014). Le triangle
pédagogique, les différentes facettes de la
pédagogie. France : ESF.
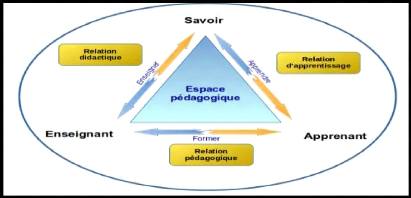
35
Figure 8 : Triangle pédagogique d'après
Houssaye
Le triangle pédagogique d'Houssaye (2014)61
met en évidence les trois processus (enseigner, apprendre et former)
reliant l'enseignant, l'apprenant et le savoir. L'enseignant est
impliqué dans l'interaction reliant l'enseignant et le savoir pour
créer une relation didactique, autrement dit l'enseignant doit rendre un
savoir intelligible. L'enseignant est aussi impliqué dans l'interaction
reliant l'enseignant et l'apprenant pour créer une relation
pédagogique ; mais qu'est-ce que la pédagogie ? D'après
Tanguy (2020)62, « La pédagogie rassemble les
méthodes et pratiques d'enseignement requises pour transmettre un savoir
(connaissances), un savoir-faire (capacités) ou un savoir être (un
savoir devenir). La pédagogie signe notre aptitude à enseigner
». L'enseignant doit transformer un objectif d'enseignement en objectif
d'apprentissage.
Dans le premier chapitre, nous avons expliqué le terme
de métacognition qui se développe lors de l'adolescence ;
rappelons-le, selon Delvolvé (2006)63, la
métacognition « est la représentation que
l'élève a des connaissances qu'il possède et de la
façon dont il peut les construire et les utiliser ». La
métacognition est donc directement reliée aux conceptions de soi
et à l'estime de soi. L'enseignant ne doit pas
61 Houssaye, J. (2014). Le triangle
pédagogique, les différentes facettes de la
pédagogie. France : ESF.
62 Tanguy, F. (2020). Cours dispensés dans le
cadre du module didactique générale, master 2 MEEF.
63 Dévolvé, N. (2006).
Métacognition et réussite des élèves. Les
cahiers pédagogiques.
36
négliger la métacognition de
l'élève afin d'améliorer l'interaction entre l'apprenant
et le savoir (relation d'apprentissage). Á l'aide de la didactique et de
la pédagogie, l'enseignant doit favoriser la métamémoire
des élèves, autrement dit, leur faire prendre conscience de ce
qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas, afin d'améliorer ensuite
leur métarésolution. Plus la métarésolution d'un
apprenant se développe, plus il a la capacité de raisonner et de
trouver des solutions à ses difficultés. L'enseignant doit donc
favoriser le développement des compétences métacognitives
des élèves : savoir observer, savoir gérer ses
émotions, savoir utiliser ses mémoires, savoir raisonner, savoir
comprendre et apprendre. Plus ces compétences seront
développées, plus l'adolescent aura une haute estime de soi.
3.2 Rôle de l'enseignant dans l'estime de soi des
élèves
Selon Tanguy (2020)64, l'enseignant doit trouver des
formes de médiation entre ses objectifs d'enseignement et ses objectifs
d'apprentissage pour l'apprenant. L'enseignant est un médiateur. La
passerelle entre l'enseignant et l'élève passe par la posture, la
démarche, le langage et enfin la nature des activités
proposées par l'enseignant. Ces éléments influencent
l'apprentissage des apprenants, or, nous avons vu que l'estime de soi influence
l'apprentissage des apprenants. Nous comprenons donc que la posture, la
démarche, le langage et la nature des activités proposées
par l'enseignant peuvent être susceptibles d'influencer l'estime de soi
des apprenants. Nous allons alors étudier certains de ces
éléments.
3.2.1 Posture de l'enseignant 3.2.1.1 Postures
enseignantes
Selon Bucheton et Soulé (2009)65, il existe
six postures enseignantes. Elles peuvent influencer la posture et l'attitude de
l'élève et modifier leur attention.
64 Tanguy, F. (2020). Cours dispensés dans le
cadre du module didactique générale, master 2 MEEF.
65 Bucheton, D. & Soulé, Y. (2009). Les
gestes professionnels et le jeu des postures de l'enseignant dans la classe :
un multi-agenda de préoccupation enchâssées. Education
et didactique, 3(3), 29-48.
37
Voici ces six postures enseignantes :
· La posture de contrôle ;
l'enseignant cadre la situation par un pilotage serré. Cette posture
engendre une atmosphère de classe tendue et hiérarchique avec peu
d'interactions avec les élèves. Les élèves
deviennent des exécutants. Nous comprenons que l'estime de soi des
élèves n'est pas réellement favorisée, mais elle
peut l'être si l'élève comprend les notions
évoquées par l'enseignant.
· La posture de contre-étayage ;
c'est une posture proche de la posture de contrôle, mais ici l'enseignant
peut aller jusqu'à faire le travail à la place de l'apprenant.
Nous comprenons que cette posture ne favorise pas le développement
positif de l'estime de soi d'un élève : l'élève
s'évalue comme incompétent dans le domaine scolaire, car il ne
fait pas le travail lui-même.
· La posture d'accompagnement ;
l'enseignant « apporte, de manière latérale, une
aide ponctuelle ». Les élèves peuvent alors raisonner par
eux-mêmes individuellement ou dans des discussions entre eux. Nous
comprenons que l'estime de soi des élèves peut être
favorisée, mais pas toujours s'il l'élève se compare
négativement aux autres élèves lors des discussions.
· La posture d'enseignement ; «
l'enseignant formule, structure les savoirs, les normes, en fait
éventuellement la démonstration. ».
· La posture de lâcher-prise ;
les élèves sont en autonomie dans un climat de confiance,
l'enseignant n'intervient pas. Les élèves détiennent
davantage des responsabilités, ils ont également la
possibilité d'expérimenter par eux même : nous comprenons
que leur estime de soi augmente si l'élève comprend l'objectif de
l'activité.
· La posture du magicien ; l'enseignant
met en scène son cours, par exemple en utilisant des jeux.
L'enseignant doit faire prendre conscience aux
élèves qu'ils sont compétents en leur laissant le temps de
réfléchir et de raisonner, dans une posture réflexive.
38
3.2.1.2 Bienveillance
La bienveillance des enseignants peut se définir comme
un cadre intellectuel, émotionnel et matériel propice aux
apprentissages. Selon Shankland, Bressoud, Tessier, et Gay (2018)66,
« la bienveillance englobe les notions de respect, de tolérance,
d'acceptation, d'empathie, de compassion, ainsi que d'exigence adaptée
à l'âge, de fermeté et de rigueur, c'est-à-dire de
maintien d'un cadre conforme aux besoins psychologiques des
élèves », l'enseignant ne doit pas surprotéger ses
élèves. La bienveillance en classe ne permet pas seulement une
atmosphère joyeuse, elle permet de développer les
compétences des élèves.
Lorsqu'un enseignant adopte une posture bienveillante, sur
quoi agit-il ? Toujours selon Sankland et all, la bienveillance doit agir sur
les trois besoins psychologiques d'un élève, à savoir son
autonomie (l'élève doit percevoir « une cohérence
entre l'action qu'il lui est demandé de faire et ses valeurs
»), son sentiment de compétences (vouloir réussir
les tâches demandées, se sentir capable de les réaliser) et
sa proximité sociale (se sentir accepté dans un groupe).
Pour être bienveillant, l'enseignant doit être en
mesure d'adopter (Sankland & all, 2018)67:
· Une ouverture attentionnelle ;
l'enseignant doit être attentif aux trois besoins psychologiques
de l'élèves.
· Des compétences émotionnelles
; L'empathie affective de l'enseignant lui permet de percevoir les
émotions des élèves. L'empathie cognitive de l'enseignant
lui permet de se représenter les pensées de ses
élèves.
· Une cohérence entre ses valeurs et ses
actions ; « un enseignant qui affirme trouver important de donner
de l'autonomie à ses élèves générera des
66 Shankland, R. & Bressoud, N. & Tessier, D.
& Gay, G. (2018). La bienveillance : une compétence
socio-émotionnelle de l'enseignant au service du bien-être et des
apprentissages ? Questions Vives (29).
67 Shankland, R. & Bressoud, N. & Tessier, D.
& Gay, G. (2018). La bienveillance : une compétence
socio-émotionnelle de l'enseignant au service du bien-être et des
apprentissages ? Questions Vives (29).
39
incompréhensions - conscientisées ou non - chez
ses élèves s'il est contrôlant et directif dans ses cours.
».
Si un élève ressent le climat bienveillant,
alors son engagement, son bien-être, sa créativité
augmenteront et par conséquent influenceront son estime de soi.
L'estime de soi d'un adolescent augmente lorsqu'un adulte,
comme un enseignant, lui renvoie une image positive de lui-même ; par
exemple, lorsqu'un élève a participé durant toute la
séance, l'enseignant ne doit pas hésiter à lui faire une
remarque positive sur son attitude (Nader-Grobois & Fiasse,
2016)68. Nader Grobois et Fiasse insistent sur les
bénéfices d'une attitude bienveillante d'un enseignant ; si
l'enseignant sollicite l'élève en lui posant des questions
bienveillantes favorisants la connaissance de soi telles « Qu'est-ce qui
t'intéresse ? Que ressens-tu ? Comment comprends-tu cette situation ?
Pourquoi n'es-tu pas d'accord ? », alors l'élève se sentira
important. En ce sentant important l'élève se comparera moins aux
autres et son estime de soi augmentera.
L'enseignant doit réactiver l'organisation en
mémoire des conceptions de soi de réussite scolaire et l'estime
de soi de l'élève. Il doit lui rappeler ses réussites
scolaires sans être dans le jugement (Martinot, 2001)69.
3.2.2 Langage : classification de bloom.
Le langage utilisé par l'enseignant influencerait aussi
l'estime de soi des apprenants. Prenons pour exemple les travaux de Bloom
révisés par Krathwohl (Anderson, Krathwohl & Bloom,
2001)70 (figure 9).
68 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016).
De la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck
Supérieur.
69 Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et
estime de soi : ingrédients pour la réussite scolaire. Revue
des sciences de l'éducation, 27 (3), 483-502.
70 Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Bloom, B.
S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing : A revision of
Bloom's taxonomy of educational objectives. Etats-Unis : Allyn &
Bacon.
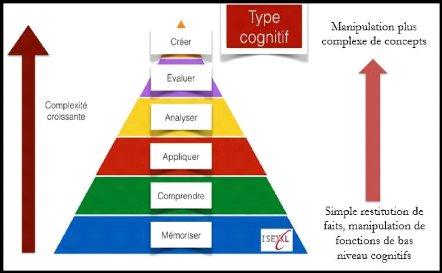
40
Figure 9 : Taxonomie de Bloom révisée
par Krathwohl
Bloom et all (2001)71 ont créé une
taxonomie des niveaux de pensée et d'acquisition des connaissances dans
le processus d'apprentissage à l'aide de verbe d'action. Cette taxonomie
cible des niveaux d'apprentissage de type cognitif ; elle permet d'identifier
la nature et la complexité des capacités sollicitées par
l'apprenant lors d'une activité. Le langage de Bloom n'est jamais
neutre, le verbe d'action utilisé demande des niveaux d'activités
intellectuelles différentes. Cette classification se classe en six
finalités cognitives allant du plus simple (bas de la pyramide) au plus
complexe (haut de la pyramide) :
· Connaissance ; c'est le fait de «
mémoriser ou de restituer des informations ». Les verbes d'action
associés sont par exemple « définir, nommer, identifier
».
71 Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Bloom, B.
S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing : A revision of
Bloom's taxonomy of educational objectives. Etats-Unis : Allyn &
Bacon.
·
41
Compréhension ; c'est le fait de
« traduire ou d'interpréter l'information en fonction de ce qui a
été appris ». Les verbes d'action associés sont par
exemple « expliquer, illustrer, représenter ».
· Application ; c'est le fait de «
sélectionner et transférer des données pour
résoudre une tâche ». Les verbes d'action associés
sont par
exemple « développer, représenter, calculer
».
· Analyse ; c'est le fait de «
mettre en relation des faits et des énoncés ou questions ».
Les verbes d'action associés sont par exemple « comparer, opposer,
questionner ».
· Synthèse ; c'est le fait de
« concevoir, intégrer et synthétiser des idées en une
proposition ». Les verbes d'action associés sont par exemple «
composer, créer, réorganiser »
· Evaluation ; c'est le fait «
d'estimer, d'évaluer ou de critiquer en fonction de critères que
l'on se construit ». Les verbes d'action associés sont par
exemple « argumenter, justifier, décider ».
L'enseignant peut donc utiliser différents verbes
d'action dans les consignes proposées à ses élèves,
afin de formuler clairement les objectifs des activités d'apprentissage.
L'enseignant peut être le responsable de la difficulté des
activités : plus il utilise les verbes d'action du bas de la pyramide
dans ses consignes, plus l'activité cognitive de l'apprenant est basse ;
plus l'enseignant utilise les verbes d'action du haut de la pyramide dans ses
consignes, plus l'activité cognitive de l'apprenant est haute.
Selon Tanguy (2020)72, si le verbe d'action
utilisé fait appel à des capacités cognitives plus
élevées que les capacités cognitives existantes de
l'apprenant, alors celui-ci peut se démotiver. Nous comprenons que si un
élève n'arrive pas à faire l'activité, il peut
s'auto-évaluer négativement et perdre en estime de soi. Au
contraire, si le verbe d'action utilisé fait appel à des
capacités cognitives moins élevées que les
capacités cognitives existantes de l'apprenant, alors celui-ci peut
s'ennuyer. Nous comprenons ceci : l'élève pourrait penser que
l'enseignant ne le
72 Tanguy, F. (2020). Cours dispensés dans le
cadre du module didactique générale, master 2 MEEF.
42
pense pas capable de mobiliser davantage ses capacités
cognitives et ressentir une dévalorisation de l'enseignant sur sa propre
personne, l'apprenant perdra en estime de soi.
3.2.3 Nature des activités proposées
Les natures des activités proposées par
l'enseignant jouent, elles aussi, un rôle dans l'estime de soi des
élèves. Prenons pour exemple une activité dans le cadre
d'une pédagogie de projet. Une pédagogie de projet a pour
objectif une production concrète (Perrenoud, 1999)73.
Perrenoud écrit qu'un apprentissage par projet permet de «
construire des compétences », « développer la
coopération et l'intelligence collective » et «
développer l'autonomie et la capacité de faire des choix ».
Il insiste sur le fait que les activités impliquées dans une
pédagogie de projet « aident chaque élève à
prendre confiance en lui, renforcer l'identité personnelle et collective
», autrement dit aide à favoriser l'estime de soi de
l'élève. L'élève améliore sa conception de
soi en construisant des nouvelles compétences dans le domaine scolaire,
mais aussi social. Travailler en groupe lors des activités pour
réaliser un projet permet d'interagir avec les autres, les
élèves forment une équipe, se soutiennent entre eux face
aux difficultés rencontrées. Plus un adolescent perçoit le
soutien qu'on lui apporte plus son estime de soi augmente, mais il faut que ce
soutien soit perçu comme un soutien de qualité (Nader Grobois
& Fiasse, 2016)74. La réalisation finale du projet
favorise la motivation, or nous avons déjà étudié
que la motivation et l'estime de soi sont liées, si un
élève est motivé alors il se sentira capable de faire
chaque activité menant au projet : son estime de soi augmente.
3.3 Évaluation
Les enseignants donnent des évaluations aux
élèves. Par une évaluation, l'enseignant mesure les
performances ou les comportements de l'élève par rapport
à
73 Perrenous, P. (1999). Apprendre à
l'école à travers des projets : pourquoi ? comment ?
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
Université de Genève.
74 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016). De
la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck
Supérieur.
43
des objectifs demandés ; l'évaluation permet aux
élèves et aux enseignants de faire le point sur les nouvelles
connaissances acquises par les élèves. (Reuter, Cohen-Azria,
Daunay, Delcambre & Lahanier-Reuter 013)75.
L'évaluation est bénéfique pour les
élèves qui reçoivent des bonnes notes, cependant,
d'après chouinard (2002)76, les évaluations «
conduisent un nombre considérable d'élèves à
ressentir des émotions négatives et à s'engager dans des
comportements d'autodépréciation ». Chouinard explique ceci
: l'enseignant joue un rôle important sur la perception qu'ont les
élèves concernant l'objectif d'une évaluation. Si
l'évaluation est perçue comme un moyen de comparaison avec les
autres élèves ou comme une punition, alors la perception des
conceptions de soi des élèves tendra à devenir
négative. Au contraire si l'évaluation est perçue comme un
moyen d'améliorer son apprentissage et de progresser vers un objectif,
alors l'élève sera encouragé et engagé, il voudra
préserver, palier ses difficultés pour atteindre un objectif.
L'enseignant doit expliquer aux élèves les
bénéfices de l'évaluation, et les rassurer. Les
élèves ne doivent pas ressentir une pression, ils doivent
ressentir de l'envie.
Pour cela, Chouinard insiste sur la notion d'erreur.
L'élève ne doit pas avoir peur de l'erreur, ni dans les
activités faites en classe, ni dans les évaluations. L'erreur
doit être perçue positivement par l'élève, elle
permet d'apprendre et de progresser. L'erreur ne doit pas être
perçue comme « un indicateur d'un manque de capacité
annonciateur de l'échec ». C'est pour cette raison que l'enseignant
ne doit pas toujours noter les évaluations pour éviter que
l'élève associe erreur et échec. Plus un
élève perçoit l'erreur positivement, plus il
s'auto-évaluera positivement.
Enfin, pour éviter la baisse d'estime de soi des
élèves, une autre façon d'évaluer, autre que par
les notes, se met en place. Il s'agit de l'évaluation par
compétence. L'évaluation par compétence donne l'envie
à l'élève de travailler pour
75 Reuter, Y., Cohen-Azria, C., Daunay, B.,
Delcambre, I., Lahanier-Reuter, D.
(2013). Dictionnaire des concepts fondamentaux des
didactiques. Belgique : Louvain-la-Neuve.
76 Chouinard, R. (2002). Évaluer sans
décourager. Département de psychopédagogie et
d'andragogie, Université de Montréal, Centre de recherche et
d'intervention sur la réussite scolaire (CRIRES).
44
construire des compétences et non pas pour avoir une
bonne note. D'après Tanguy (2020)77, travailler par
compétence permet « d'expliciter les objectifs et les
démarches : donner du sens », « sortir du côté
vexatoire et parfois angoissant de la note, c'est un système qui
évite de confondre être jugé-être
évalué », « créer une cohésion
d'équipe ».
Pour conclure ce chapitre, nous comprenons ceci :
l'enseignant, par sa posture, son langage, ses activités
proposées et ses évaluations, a la capacité d'influencer
l'estime de soi et la motivation de ses élèves, et par
conséquence influencer leurs apprentissages scolaires.
77 Tanguy, F. (2020). Cours dispensés dans
le cadre du module didactique générale, master 2
MEEF.
45
PROBLÉMATIQUE
Avant d'écrire ce mémoire, nous nous demandions
si un rapport existait entre certaines réactions des
élèves en classe, comme par exemple le fait que certains
élèves pensent ne pas pouvoir réussir une
évaluation avant même d'avoir lu le sujet de l'évaluation,
et l'estime de soi.
Nous avons alors entrepris des recherches théoriques
sur l'estime de soi, l'apprentissage scolaire et le rôle des enseignants,
afin d'observer un lien possible entre ces trois éléments.
Rappelons notre question de départ guidant nos
recherches : l'estime de soi des élèves peut-elle, d'une
part, influer sur leurs apprentissages scolaires, et, d'autre part, être
influencée par l'enseignant ? Suite à nos recherches
théoriques, nous reformulons notre question de départ afin de la
préciser : l'estime de soi des élèves,
composée des concepts de soi dans le domaine scolaire, peut-elle d'une
part, influer sur leur motivation et leurs apprentissages scolaires, et d'autre
part, être influencée par la posture et la nature des
activités proposées par l'enseignant ?
Pour répondre à cette question, nous reprenons
nos deux hypothèses générales :
- Hypothèse générale 1
: l'estime de soi des élèves influe sur leurs
apprentissages scolaires.
- Hypothèse générale 2
: l'enseignant influence l'estime de soi des élèves
à travers sa posture et la nature des activités proposées
aux élèves.
Nous avons découvert, dans nos recherches
théoriques, que l'estime que soi globale est influencée par
différents domaines des concepts de soi. Nous avons alors
réalisé l'importance des concepts de soi scolaires. Rappelons
qu'un élève peut percevoir positivement ses concepts de soi dans
le domaine scolaire, mais il peut toutefois avoir une estime de soi globale
basse si sa perception des concepts de soi dans les autres domaines
s'avère être négative. Au contraire, un élève
peut percevoir négativement ses concepts de soi dans le domaine
scolaire, mais il peut toutefois avoir
46
une estime de soi globale haute si sa perception des concepts
de soi dans les autres domaines s'avère être positive : c'est
possible si l'élève apporte peu d'importance au domaine
scolaire.
Nous décidons donc d'intégrer la notion des
concepts de soi scolaires dans nos hypothèses opérationnelles
précisant nos hypothèses générales :
Hypothèse opérationnelle 1 :
une haute estime de soi globale et une vision positive des concepts de
soi dans le domaine scolaire favorisent la motivation des élèves,
et par conséquent, améliorent leurs apprentissages scolaires.
Hypothèse opérationnelle 2 :
une haute estime de soi et une vision négative des concepts de soi dans
le domaine scolaire desservent la motivation des élèves, et par
conséquent, altèrent leurs apprentissages scolaires.
Hypothèse opérationnelle 3 :
une faible estime de soi globale et une vision positive des concepts de soi
dans le domaine scolaire favorisent la motivation des élèves, et
par conséquent, améliorent leurs apprentissages scolaires.
Hypothèse opérationnelle 4 :
une faible estime de soi globale et une vision négative des concepts de
soi dans le domaine scolaire desservent la motivation des élèves,
et par conséquence, altèrent leur apprentissage scolaire.
Hypothèse opérationnelle 5 :
en adoptant une posture bienveillante et en proposant des activités
favorisant l'autonomie des élèves, l'enseignant améliore
l'estime de soi des élèves.
Ces hypothèses nous amènent à penser
ceci : l'enseignant pourrait renforcer l'estime de soi des élèves
afin d'améliorer leurs apprentissages scolaires.
Pour valider ou invalider ces hypothèses et
répondre à notre question de recherche, nous réalisons,
dans un premier temps, un questionnaire pour les élèves. Ce
questionnaire vise à mesurer l'estime de soi globale des
élèves, leurs conceptions de soi dans le domaine scolaire, et
leur niveau scolaire. Ce questionnaire vise également à
repérer le ressenti des élèves sur l'influence des
enseignants sur leur estime de soi. Dans un deuxième temps, nous
analyserons, à l'aide d'un projet pédagogique mis en place durant
l'année de stage, les effets d'une posture
47
bienveillante de l'enseignant et d'une séquence
favorisant l'autonomie des élèves sur l'estime de soi des
élèves. Grâce à ces protocoles, nous pourrons
mesurer et mettre en lien l'estime de soi globale des élèves,
leurs conceptions de soi dans le domaine scolaire, leurs apprentissages
scolaires et le rôle de l'enseignant dans l'estime de soi des
élèves via sa posture et la nature des activités
proposées.
48
PARTIE MÉTHODOLOGIQUE
Nous avons construit deux protocoles différents afin
de répondre à notre problématique de recherche et de
valider ou invalider nos hypothèses.
1.Méthode
1.1 Participants
1.1.1 Participants protocole 1
Nous avons soumis le premier protocole à cinq classes
de 1re baccalauréat professionnel : 1re
baccalauréat professionnel technicien d'usinage (Bac Pro TU), 1re
baccalauréat professionnel vente (Bac Pro Vente), 1re
baccalauréat professionnel accueil (Bac Pro ACC), 1re
baccalauréat professionnel commerce (Bac Pro COM), 1re
baccalauréat professionnel métiers de l'électricité
et de ses environnements connectés (Bac Pro MELEC). Les cinq classes
rassemblent au total 102 élèves ; sur les 102
élèves, 26 élèves sont des filles et 76
élèves sont des garçons. Les garçons
représentent donc une majorité des participants. Les
élèves sont âgés de 16 à 21 ans ; l'âge
moyen est de 17 ans. Sur 102 élèves, un seul élève
fait partie du dispositif ULIS (unité localisée pour l'inclusion
scolaire), il est dyspraxique.
Nous avons décidé de nous centrer sur cette
population pour plusieurs raisons. Premièrement, les participants
sélectionnés sont nos élèves durant notre
année de stage : nous avons tissé une relation de confiance avec
eux et nous pouvons prendre le temps de leur expliquer l'intérêt
de cette expérimentation en classe. Deuxièmement, le niveau
scolaire, les centres d'intérêts ou encore la situation sociale
diffèrent selon chaque élève : nous pouvons faire ce
protocole sur un ensemble d'élève afin de mesurer une moyenne
dans un lycée professionnel. Pour faire l'expérimentation sur
l'ensemble des élèves, nous n'avons pas écarté
d'élève et tous les élèves ont été
soumis aux mêmes conditions d'expérimentation. Les
élèves n'ont pas été rémunérés
pour participer à notre protocole, ils ont tous participé
volontairement.
49
1.1.2 Participants protocole 2
Nous avons soumis le deuxième protocole à une
classe de 1ère Bac Pro COM. La classe est composée de
30 élèves, dont 12 filles et 18 garçons. L'âge moyen
des élèves est 17 ans. Nous avons sélectionné les
élèves de cette classe, car nous les avons en accompagnement
personnalisé (AP) durant notre année de stage et nous souhaitions
faire notre expérimentation durant les créneaux d'AP.
1.2 Procédure
1.2.1 Protocole 1
1.2.1.1 Questionnaire
Nous avons construit un questionnaire de recherche pour les
élèves, composé de 17 questions (cf. Annexe 1 :
questionnaire pour les élèves). Pour créer ce
questionnaire, nous nous sommes focalisés sur les concepts
abordés dans la partie théorique. Les questions choisies nous
aident à aborder les notions suivantes :
· L'estime de soi globale des élèves
· Les concepts de soi scolaires
· La perception de compétence à accomplir
· Le niveau scolaire
· L'influence de l'enseignant dans l'estime de soi des
élèves (la nature des activités et la posture de
l'enseignant)
Expliquons à présent la construction de notre
questionnaire : L'estime de soi globale des élèves
Nous voulons mesurer l'estime de soi globale des
élèves, en rapport avec nos hypothèses
opérationnelles 1, 2, 3 et 4. Nous utilisons l'échelle de
Rosenberg pour mesurer l'estime de soi globale des élèves
(Crépin & Delarue, 2014)78 . L'échelle de
78 Crépin, N. & Delarue, F. (2014).
Echelle d'estime de soi de Rosenberg. Institut Régional du
Bien-être de la Médecine et du Sport santé.
50
Rosenberg se compose de dix items (les 10 premières
questions du questionnaire). Pour chaque item, les modalités de
réponse sont les mêmes : l'élève doit entourer
« tout à fait en désaccord », « tout à fait
en accord », « plutôt en accord » ou « plutôt
en désaccord ». Chacune de ces réponses correspond à
un chiffre de 1 à 4 (1 = tout à fait en désaccord, 2 =
plutôt en désaccord, 3 = plutôt en accord, 4 = tout à
fait en accord). Pour mesurer l'estime de soi globale de l'élève,
nous additionnons les chiffres de chaque item, en inversant les points lorsque
les phrases sont formulées négativement. Le total donne une
mesure de l'estime de soi globale, elle peut être très faible,
faible, dans la moyenne, forte ou très forte. Nous choisissons
d'utiliser cette échelle, car elle comporte peu de questions, et par
conséquent, elle peut être remplie rapidement par les
élèves.
Les concepts de soi scolaires
En nous appuyant sur nos recherches théoriques, nous
avons étudié l'importance des concepts de soi scolaires. Nous
voulons mesurer leurs concepts de soi scolaires, à savoir si elles sont
positives ou bien négatives, en rapport avec nos hypothèses
opérationnelles 1, 2, 3 et 4. Nous proposons alors une affirmation
(question 11) permettant d'aborder cette notion : « je réussis
souvent les exercices/évaluations au lycée ». Les
modalités de réponse sont les suivantes : l'élève
doit répondre par oui ou par non. Si les élèves
répondent oui, nous considérerons qu'ils ont une vision de leurs
concepts de soi scolaires positive. Si les élèves
répondent non, nous considérerons qu'ils ont une vision de leurs
concepts de soi scolaires négative.
La perception de compétence à accomplir
En nous appuyant sur nos recherches théoriques, nous
avons étudié ceci : la motivation favorise l'apprentissage
scolaire des élèves. Nous souhaitons alors mesurer la motivation
des élèves, en rapport avec nos hypothèses
opérationnelles 1, 2, 3 et 4, afin de la mettre en lien avec l'estime de
soi des élèves. Pour mesurer la motivation des
élèves, nous choisissons de nous focaliser sur une des sources de
motivation du modèle de la dynamique motivationnelle de Viau : la
perception de
51
compétence à accomplir (Viau,
2004)79. Nous posons la question « Je pense que j'ai des
compétences nécessaires pour réussir une activité
en classe et pour progresser dans mes résultats scolaires »
(question 12). Les modalités de réponse sont les suivantes :
l'élève doit répondre par oui ou par non. Si les
élèves répondent oui, nous considérerons qu'ils
sont motivés pour réaliser des activités et pour
progresser dans leurs résultats scolaires ; par conséquent, nous
considérerons qu'ils améliorent leurs apprentissages scolaires.
Si les élèves répondent non, nous considérerons
qu'ils ne sont pas motivés pour réaliser des activités et
pour progresser dans leurs résultats scolaires ; par conséquent,
nous considérerons qu'ils n'améliorent pas leurs apprentissages
scolaires.
Le niveau scolaire
Nous souhaitons connaître le niveau scolaire moyen des
élèves afin de le mettre en lien avec leur estime de soi, en
rapport avec nos hypothèses opérationnelles 1, 2, 3 et 4. Nous
posons donc la question « Quelle est ta moyenne générale au
lycée ? » (question 13). Nous considérerons ceci :
plus la moyenne générale des élèves est haute, plus
leurs apprentissages scolaires sont favorisés.
L'influence de l'enseignant dans l'estime de soi des
élèves
Nous souhaitons mettre en lien l'estime de soi des
élèves avec la posture de l'enseignant et la nature des
activités qu'il propose, en rapport avec notre hypothèse
opérationnelle 5. Nous proposons alors quatre questions :
-Selon toi, les activités proposées par les
enseignants améliorent-elles ton estime de toi-même ? (Question
14).
-Selon toi, les postures ou les attitudes des enseignants
améliorent-elle ton estime de toi-même ? (Question 15).
79 Viau, R. (2004). La motivation : condition
de plaisir d'apprendre et d'enseigner en contexte scolaire, 3e
congrès des chercheurs en éducation Bruxelles. Québec :
université de Sherbrooke.
52
- Si tu as répondu oui à la question 14 : quels
types d'activités en particulier permettent d'augmenter ton estime de
toi-même ? (Question 16).
- Si tu as répondu oui à la question 15 : quels
types d'attitudes/postures de l'enseignant permettent d'augmenter ton estime de
toi-même ? (Question 17).
1.2.1.2 Déroulement
Nous avons distribué le questionnaire aux
élèves le 22 et 23 mars 2021, à la fin d'un cours de
prévention santé environnement (PSE), après une
évaluation (nous avons distribué le questionnaire la semaine
suivante pour les élèves absents). Nous avons expliqué aux
élèves l'objectif de nos recherches et l'importance de
l'honnêteté de leurs réponses. Nous avons laissé le
choix aux élèves de participer ou de ne pas participer : la
totalité des élèves ont acceptés de répondre
au questionnaire. Le recueil des données se base donc sur 102
questionnaires. Nous avons expliqué les modalités de
réponse et nous avons reformulé toutes les questions avec eux
afin qu'ils comprennent toutes les questions. Le questionnaire était
sous forme papier, les élèves devaient y répondre
individuellement et anonymement, pendant vingt minutes. Nous avons
ramassé les questionnaires avant la fin du cours.
1.2.2 Protocole 2
Ce deuxième protocole permet une analyse plus fine, en
complément du protocole 1, en rapport avec notre hypothèse
opérationnelle 5. Il permet une mesure qualitative et non quantitative
car seulement 30 élèves y participent.
1.2.2.1 Pédagogie de projet
Nous voulons mettre en lien, par l'intermédiaire d'un
projet réalisé en classe, l'estime de soi des
élèves, leurs apprentissages scolaires et l'influence de
l'enseignant par sa posture et la nature des activités proposées.
En nous appuyant sur nos recherches théoriques, nous avons
étudié les bénéfices des projets
pédagogiques sur l'autonomie des élèves. Nous avons donc
imaginé un projet pédagogique, nommé « le
53
reportage vidéo ». Le projet constitue une
séquence de plusieurs séances (cf. Annexe 2 : fiche
séquence projet « le reportage vidéo »). Pour la
réalisation de ce projet, les élèves de
1ère COM se regroupent en demi-groupe, le mardi matin, en AP.
L'objectif de ce projet est la réalisation d'un reportage vidéo
par les élèves. Nous distribuons aux élèves une
fiche rassemblant toutes les étapes à réaliser. Les
élèves doivent former des groupes de six, choisir un des sujets
proposés (en lien avec le programme de PSE), trouver une
problématique, faire des recherches internet à l'aide de
l'ordinateur, rassembler les informations trouvées avec leur groupe,
écrire le scénario du reportage vidéo en imaginant les
mises en scène, puis se filmer à l'aide d'une caméra en
train de jouer les mises en scène. Nous réaliserons ensuite le
montage vidéo de leur reportage pour obtenir le résultat
final.
En tant qu'enseignant, nous adoptons une posture de
lâcher prise mais aussi d'accompagnement, nous guidons le projet avec une
posture bienveillante : nous souhaitons que les élèves se sentent
capables de créer un projet par eux-mêmes.
Tout au long de ce projet, nous observons si leur estime de
soi augmente grâce au travail de groupe, aux mises en scène
préparées devant la caméra, ou encore grâce à
la posture bienveillante de l'enseignant.
Nous précisons que ce projet est en cours de
réalisation, il n'est pas terminé. Nous l'avons commencé
en février 2021. Suite à un changement d'emploi du temps,
lié à la situation sanitaire, des séances d'AP ont
été supprimées : il reste encore des séances pour
finir le projet. Cependant, nous avons décidé de comparer nos
observations entre le début du projet et le milieu du projet.
1.2.2.2 Questionnaire et grille d'observation
Pour mesurer l'évolution de l'estime de soi des
élèves en lien avec les activités du projet
pédagogique et la posture bienveillante de l'enseignant, nous utilisons
une grille d'observation remplie par l'enseignant et un court questionnaire
dédié aux élèves.
54
A l'aide de la grille d'observation, nous comparons
l'implication de l'élève au début du projet et au milieu
du projet (cf. Annexe 3 : grille d'observation). La grille d'observation se
compose de plusieurs observations en lien avec l'évolution de l'estime
de soi. Sur les modalités d'observation, nous entourons 1, 2, 3 ou 4 en
fonction du degré d'implication de l'élève. Prenons un
exemple : si l'élève n'est pas enthousiaste de passer devant la
caméra, nous entourons 1, si au contraire il se montre très
enthousiaste, nous entourons 4.
Le questionnaire (cf. Annexe 4 : questionnaire projet) permet
d'obtenir le ressenti et la perception des élèves sur leur estime
de soi, et sur l'influence de l'enseignant dans l'évolution de leur
estime de soi. Le questionnaire se compose de deux questions :
1. Avec ce projet, ton estime de toi-même a-t-elle
augmenté, diminué ou bien stagné ?
2. L'attitude de l'enseignante t'a-t-elle permis de te sentir
capable de faire ce projet ? Pourquoi ?
Nous distribuons ce questionnaire aux élèves
durant l'étape de l'écriture du scénario du reportage, en
format papier. Nous laissons le choix aux élèves de participer ou
de ne pas participer. La totalité des participants ont accepté de
répondre au questionnaire : le recueil des données se base donc
sur 30 questionnaires. Les élèves doivent répondre
individuellement et anonymement durant une période de dix minutes,
à la fin de la séance.
2. Résultats et analyse
Nous présentons les résultats sous forme de figures
et de tableaux.
55
2.1 Résultats en lien avec l'hypothèse
générale 1 Estime de soi globale
Les dix premières questions du questionnaire permettent
de mesurer l'estime de soi globale des participants avec l'échelle de
Rosenberg. Les participants ont répondu aux dix premières
questions (cf. Annexe 5 : réponses des participants pour chaque item du
test de Rosenberg) et nous avons calculé leur niveau d'estime de soi
globale.
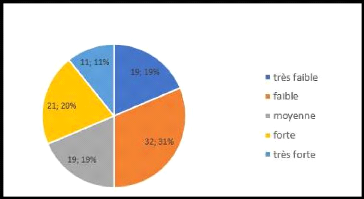
(Q1-10) Estime de soi globale
Figure 10 : Niveaux d'estime de soi globale des
participants mesurés avec
l'échelle de Rosenberg.
La majorité des participants ont une estime de soi
faible (31 %), voire très faible (19 %). 19 % des participants ont une
estime de soi moyenne. Nous observons également que 20 % des
participants ont une estime de soi forte, voire très forte (11 %)
(figure 10).
Afin d'obtenir des résultats en lien avec nos
hypothèses opérationnelles 1, 2, 3 et 4 nous avons fait le choix
de distinguer les participants possédant une haute estime de soi et les
participants possédant une basse estime de soi, pour les questions 11,
12 et 13 du questionnaire.
56
|
Estime de soi globale
|
Nombres
|
|
Très forte
|
Haute estime de soi
|
32
|
|
Forte
|
|
Faible
|
Basse estime de soi
|
51
|
|
Très faible
|
Tableau 1 : Formation de deux ensembles "haute estime de soi"
et "basse estime
de soi" à partir des quatre niveaux d'estime de soi
globale des participants.
Les participants possédant une très forte et
forte estime de soi sont rassemblés ensemble pour former un groupe de 32
participants avec une haute estime de soi. Les participants possédant
une très faible et faible estime de soi sont rassemblés ensemble
pour former un groupe de 51 participants avec une basse estime de soi (tableau
1).
Concepts de soi scolaires
Maintenant, observons les réponses de nos deux groupes
pour la question 11 du questionnaire.
Participants avec une haute estime de soi répondant
à la Q11
« je réussis souvent les
exercices/évaluations au lycée ».
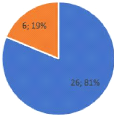
Figure 11 : Répartition de la perception des
concepts de soi scolaires, positive ou
négative, pour les participants avec une haute estime de
soi.
57
La majorité des participants du groupe avec une haute
estime de soi considèrent qu'ils réussissent souvent les
exercices au lycée (81%). Nous suivons notre méthode : en
répondant « oui » à la question 11, nous
considérons que les participants ont une vision positive de leurs
concepts de soi solaires. Cependant, 19% des participants du groupe avec une
haute estime de soi considèrent qu'ils ne réussissent pas souvent
les exercices au lycée : en suivant notre méthode nous
considérons alors qu'ils ont une vision négative de leurs
concepts de soi scolaire (figure 11).
Participants avec une basse estime de soi répondant
à la Q11
« je réussis souvent les
exercices/évaluations au lycée ».
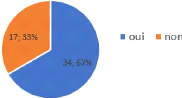
Figure 12 : Répartition de la perception des
concepts de soi scolaires, positive ou
négative, pour les participants avec une basse estime de
soi.
La majorité des participants du groupe avec une estime
de soi basse considèrent qu'ils réussissent souvent les exercices
au lycée (67%). Nous suivons notre méthode : en répondant
« oui » à la question 11, nous considérons que les
participants ont une vision positive de leurs concepts de soi solaires.
Cependant, 33% des participants du groupe avec une estime de soi basse
considèrent qu'ils ne réussissent pas souvent les exercices au
lycée : en suivant notre méthode nous considérons alors
qu'ils ont une vision négative de leurs concepts de soi scolaires
(figure 12).
Nous créons, à présent, suite aux
résultats précédents, quatre ensembles différents
pour la suite des résultats des questions 12 et 13 du questionnaire.
58
Estime de soi,
concepts de soi et
nombre //
Participants
|
Estime de soi
globale
|
Vision des concepts
de soi scolaires
|
Nombre
|
1. Participants A
|
Haute
|
Positive
|
26
|
2. Participants B
|
Haute
|
Négative
|
6
|
3. Participants C
|
Basse
|
Positive
|
34
|
4. Participants D
|
|
Basse
|
Négative
|
17
|
|
Tableau 2 : Formation de quatre ensembles, participants A,
B, C et D à partir de
l'estime de soi globale et de la vision des
concepts de soi scolaires des participants.
Ø Le premier ensemble « participants A »,
regroupe 26 participants : ceux ayant une haute estime de soi globale et une
vision de leurs concepts de soi scolaires positive.
Ø Le deuxième ensemble « participants B
», regroupe 6 participants : ceux ayant une haute estime de soi globale et
une vision de leurs concepts de soi scolaires négative.
Ø Le troisième ensemble « participants C
», regroupe 34 participants : ceux ayant une basse estime de soi globale
et une vision de leurs concepts de soi scolaires positive.
Ø Le quatrième ensemble « participants D
», regroupe 26 participants : ceux ayant une basse estime de soi globale
et avec une vision de leurs concepts de soi scolaires négative (tableau
2).
La perception de compétence à accomplir
Nous observons, à présent, les réponses
de nos quatre ensembles de participants à la question 12 du
questionnaire, nous pourrons ensuite interpréter plus facilement si un
lien existe entre l'estime de soi/concepts de soi scolaires et la
motivation/apprentissage scolaire des participants.
« Je pense que j'ai des compétences
nécessaires pour réussir
une activité en classe et pour
progresser dans mes résultats
scolaires. » (Q12)
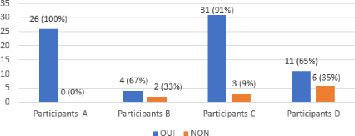
59
Figure 13 : Perception des compétences à
accomplir des participants A, B, C et D.
Nous observons (figure 13) :
Ø Pour l'ensemble « participants A », la
totalité des élèves (100 %) pense avoir les
compétences suffisantes pour réussir des activités en
classe et pour progresser dans leurs résultats scolaires. Nous suivons
notre méthode : les participants de cet ensemble sont donc
motivés, et par conséquent, leurs apprentissages scolaires
s'améliorent.
Ø Pour l'ensemble « participants B », 67 %
des élèves pensent avoir les compétences suffisantes pour
réussir des activités en classe et pour progresser dans leurs
résultats scolaires. Nous suivons notre méthode : ces
participants sont donc motivés, et par conséquent, leurs
apprentissages scolaires s'améliorent. Cependant, 33 % des
élèves pensent ne pas avoir les compétences suffisantes
pour réussir des activités en classe et pour progresser dans
leurs résultats scolaires.
Ø Pour l'ensemble « participants C », 91 %
des élèves pensent avoir les compétences suffisantes pour
réussir des activités en classe et pour progresser
60
dans leurs résultats scolaires. Nous suivons notre
méthode : ces participants sont donc motivés, et par
conséquent, leurs apprentissages scolaires s'améliorent.
Cependant, 9% des élèves pensent ne pas avoir les
compétences suffisantes pour réussir des activités en
classe et pour progresser dans leurs résultats scolaires.
Ø Pour l'ensemble « participants D », 65 %
des élèves pensent avoir les compétences suffisantes pour
réussir des activités en classe et pour progresser dans leurs
résultats scolaires. Nous suivons notre méthode : ces
participants sont donc motivés, et par conséquent, leurs
apprentissages scolaires s'améliorent. Cependant, 35 % des
élèves pensent ne pas avoir les compétences suffisantes
pour réussir des activités en classe et pour progresser dans
leurs résultats scolaires.
Niveau scolaire
Observons la moyenne générale scolaire des
participants de nos quatre ensembles :
Moyenne générale scolaire
sur 20 /
Participants
|
Inférieure à
10
|
Entre 10 et
12,5
|
Entre 12,5
et 15
|
Supérieure
à 15
|
Participants
A
|
Nombre
|
0
|
4
|
14
|
8
|
|
0 %
|
15,4 %
|
53,9 %
|
30,7 %
|
|
|
|
|
|
Participants
B
|
Nombre
|
0
|
6
|
0
|
0
|
|
0 %
|
100 %
|
0 %
|
0 %
|
|
|
|
|
|
Participants
C
|
Nombre
|
0
|
8
|
15
|
11
|
|
0 %
|
23,5 %
|
44,1 %
|
32,4 %
|
|
|
|
|
|
Participants
D
|
Nombre
|
2
|
10
|
4
|
1
|
|
11,8 %
|
58,8 %
|
23,5 %
|
5,9 %
|
|
|
|
|
|
|
Tableau 3 : Moyenne générale scolaire des
participants A, B, C et D.
61
Nous observons (tableau 3) :
Ø Pour l'ensemble « participants A », 15,4 %
des élèves déclarent avoir une moyenne
générale entre 10 et 12,5 (sur 20) ; 53,9 % déclarent
avoir une moyenne générale entre 12,5 et 15 ; 30,7 %
déclarent avoir une moyenne générale supérieure
à 15. La médiane des moyennes générales dans cet
ensemble se situe entre 12,5 et 15.
Ø Pour l'ensemble « participants B », la
totalité des élèves (100%) déclarent avoir une
moyenne générale entre 10 et 12,5 (sur 20). La médiane des
moyennes générales dans cet ensemble se situe entre 10 et
12,5.
Ø Pour l'ensemble « participants C », 23,5 %
des élèves déclarent avoir une moyenne
générale entre 10 et 12,5 (sur 20) ; 44,1 % déclarent
avoir une moyenne générale entre 12,5 et 15 ; 32,4 %
déclarent avoir une moyenne générale supérieure
à 15. La médiane des moyennes générales dans cet
ensemble se situe entre 12,5 et 15.
Ø Pour l'ensemble « participants D », 11,8 %
des élèves déclarent avoir une moyenne inférieure
à 10 ; 58,8 % des élèves déclarent avoir une
moyenne générale entre 10 et 12,5 (sur 20) ; 23,5 %
déclarent avoir une moyenne générale entre 12,5 et 15 ;
5,9 % déclarent avoir une moyenne générale
supérieure à 15. La médiane des moyennes
générales dans cet ensemble se situe entre 10 et 12,5.
2.2 Résultats en lien avec l'hypothèse 2
L'influence de l'enseignant dans l'estime de soi des
élèves
· Résultats protocole 1
Les résultats des questions 14 et 15 du questionnaire
nous permettent d'observer les perceptions des 102 élèves sur
l'influence de l'enseignant dans leur estime de soi.
L'influence de l'enseignant (activités proposées
et postures)
sur l'amélioration de l'estime de soi des
élèves (Q14 et Q15).
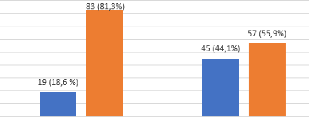

62
Figure 14 : L'influence positive (barres bleues) ou
négatives (barres orange) des activités proposées par
l'enseignant et des postures de l'enseignant sur l'estime de soi des
élèves selon la perception des participants.
Dans la figure 14, nous observons ceci : une majorité
des élèves (81,3 %) pensent que les activités
proposées par les enseignants ne permettent pas d'améliorer leur
estime de soi. Cependant, 18,6 % des élèves pensent le contraire,
ils pensent que les activités proposées par l'enseignant
permettent d'améliorer leur estime de soi.
Une majorité des élèves (55,9 %) pensent
que les postures ou les attitudes des enseignants ne permettent pas
d'améliorer leur estime de soi. Cependant, 44,1 % des
élèves pensent le contraire : ils pensent que les postures ou les
attitudes des enseignants permettent d'améliorer leur estime de soi.
L'écart entre la perception des élèves concernant l'effet
des postures et des attitudes de l'enseignant sur l'estime de soi est moins
grand que l'écart entre la perception des élèves
concernant l'effet des activités proposées par l'enseignant sur
l'estime de soi.
A présent, observons les résultats des
questions 16 et 17 du questionnaire, précisant les questions 14 et 15.
Pour la question 16 « Quels types d'activités proposées par
les enseignants permettent d'augmenter ton estime de toi-même ? »,
rappelons que seuls les élèves ayant répondu oui à
la question 14 peuvent y répondre. Ces élèves pensent que
les activités proposées par les enseignants permettent
63
d'améliorer leur estime de soi : 19 élèves
répondent donc à la question 16. Nous avons replacé les
activités citées par les élèves dans un tableau
:
Activités citées
|
Nombre
|
Pourcentage
|
Activité en groupe
|
11
|
57,8 %
|
Activité sur le
manuel/polycopié
|
2
|
10,5 %
|
Oral / exposé
|
5
|
26,3 %
|
Projets
|
5
|
26, 3 %
|
Travaux pratiques
|
10
|
52, 6 %
|
|
Tableau 4 : les activités proposées par
l'enseignant augmentant l'estime de soi des
élèves citées par les
participants.
Nous observons (tableau 4), selon la perception des
élèves, que les activités proposées par les
enseignants améliorent l'estime de soi des élèves lorsque
ce sont des activités de groupe (pour 57,8% des élèves),
des travaux pratiques (pour 52,6% des élèves), des
activités orales ou des projets (pour 26,3% des élèves),
ou des activités sur le manuel/polycopié (pour 10,5% des
élèves).
Pour la question 17 « Quels types d'attitudes/postures
des enseignants permettent d'augmenter ton estime de toi-même ? »,
rappelons que seuls les élèves ayant répondu « oui
» à la question 15 peuvent y répondre. Ces
élèves pensent que les postures ou les attitudes des enseignants
permettent d'améliorer leur estime de soi : 45 élèves
répondent donc à la question 17. Nous avons replacé les
mots récurrents des réponses des élèves dans un
tableau :
Mots récurrents
|
Nombre
|
Pourcentage
|
Se soucier de moi
|
14
|
31%
|
Compréhensif / patient
|
9
|
20%
|
Décrire nos capacités
|
13
|
42%
|
Gentillesse
|
28
|
62%
|
|
Tableau 5 : Mots cités par les participants
à propos des postures de l'enseignant
favorisant l'estime de soi des
élèves.
64
Nous observons ceci (tableau 5) : selon la perception des
élèves, la posture ou l'attitude de l'enseignant améliore
l'estime de soi des élèves lorsque les enseignants se soucient
des élèves (pour 31% des élèves), sont
compréhensifs et patients (pour 20% des élèves),
décrivent les capacités des élèves (pour 42% des
élèves), ou encore lorsqu'ils font preuve de gentillesse envers
les élèves (pour 62% des élèves).
· Résultats protocole 2
Nous avons réalisé le projet du « reportage
vidéo » et nous avons complété notre grille
d'observation. Rappelons que dans ce protocole 2, 30 élèves
participent.
|
Observation
de
l'enseignant
//
Degrés
d'implication
|
L'élève est
fière de
sa
(future)
production.
|
L'élève communique ses idées, sûr de
lui, dans son groupe.
|
L'élève est
autonome
|
L'élève est
enthousiaste
à
l'idée de passer
devant une caméra
|
|
N
|
%
|
M
|
N
|
%
|
M
|
N
|
%
|
M
|
N
|
%
|
M
|
|
Au début
de la
séquence
|
1
|
5
|
17 %
|
3
|
4
|
13 %
|
3
|
9
|
30 %
|
2
|
10
|
33 %
|
2
|
|
2
|
9
|
30 %
|
7
|
23 %
|
13
|
43 %
|
5
|
17 %
|
|
3
|
7
|
23 %
|
9
|
30 %
|
5
|
17 %
|
8
|
27 %
|
|
4
|
9
|
30 %
|
1
0
|
34 %
|
3
|
10 %
|
7
|
23 %
|
|
Au milieu
de la
séquence
|
1
|
2
|
7 %
|
4
|
2
|
7 %
|
4
|
2
|
7 %
|
3
|
2
|
12 %
|
4
|
|
2
|
2
|
7 %
|
2
|
7 %
|
4
|
13 %
|
1
|
6 %
|
|
3
|
1
0
|
33 %
|
8
|
26 %
|
10
|
33 %
|
6
|
38 %
|
|
4
|
1
6
|
53 %
|
1
8
|
60 %
|
14
|
47 %
|
21
|
44 %
|
Tableau 6 : Comparaison des observations de l'enseignant sur
le degré d'implication des élèves entre le début du
projet et le milieu de projet.
65
Nous observons (tableau 6) :
Ø Au début de la séquence (au
début du projet), la médiane du degré d'implication des
élèves (sur des degrés d'implication de 1 à 4) pour
l'observation « L'élève est fière de sa (future)
production. », est 3, alors qu'au milieu de la séquence (milieu du
projet), la médiane du degré d'implication est 4.
Ø Au début de la séquence, la
médiane du degré d'implication des élèves pour
l'observation « L'élève communique ses idées,
sûr de lui, dans son groupe. », est 3, alors qu'au milieu de la
séquence, la médiane du degré d'implication est 4.
Ø Au début de la séquence, la
médiane du degré d'implication des élèves pour
l'observation « L'élève est autonome. » est 2, alors
qu'au milieu de la séquence, la médiane du degré
d'implication est 3.
Ø Au début de la séquence, la
médiane du degré d'implication des élèves pour
l'observation « L'élève est enthousiaste à
l'idée de passer devant une caméra. » est 2, alors qu'au
milieu de la séquence, la médiane du degré d'implication
est 4.
A présent, observons les réponses des
élèves pour la question 1 du questionnaire, à savoir
« Avec ce projet, ton estime de toi-même a-t-elle augmenté,
diminué ou bien stagné ? ». Ce projet favorise l'autonomie
des élèves, nous évaluons alors la perception de
l'élève de son estime de soi lors d'activités favorisant
son autonomie.
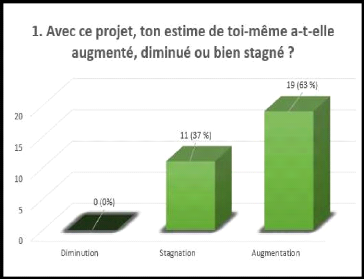
66
Figure 15 : volution de l'estime de soi des
participants avec le projet
"reportage vidéo"
La majorité des élèves (63 %) estiment
que leur estime de soi a augmenté grâce au projet « reportage
vidéo » et 37 % des élèves estiment que leur estime
de soi n'a ni augmenté ni diminué mais stagné lors de la
réalisation du projet. Aucun élève ne mentionne une
diminution d'estime de soi (figure 15).
Les résultats de la deuxième question du
questionnaire, à savoir « L'attitude de l'enseignante t'a-t-elle
permis de te sentir capable de faire ce projet ? » nous permettent
d'évaluer la perception de l'élève concernant l'influence
de l'attitude de l'enseignant sur son estime de soi.
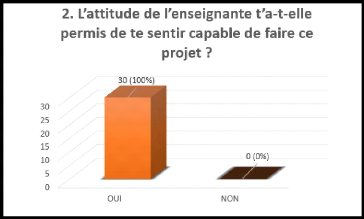
67
Figure 16 : Effet de l'attitude de l'enseignante sur
l'estime de soi des élèves lors du
projet "reportage vidéo".
La totalité des élèves (100%) estime que
l'attitude de l'enseignante leur a permis de se sentir capable de
réaliser le projet (figure 16).
Les réponses de la deuxième partie de la
question 2, nous donnent des précisions sur l'attitude de l'enseignante
qui leur a permis de se sentir capable de faire le projet. Nous avons
rassemblé dans un tableau les attitudes citées par les
élèves :
|
Attitudes/postures citées
|
Nombre
|
Pourcentage
|
|
Bienveillante
|
14
|
47 %
|
|
Encourageante
|
24
|
80 %
|
|
Autonomie/liberté
|
4
|
14 %
|
|
Souriante
|
16
|
54 %
|
|
Motivante
|
11
|
37 %
|
|
Intéressée /à l'écoute
|
8
|
27 %
|
Tableau 7 : Attitudes et postures de l'enseignant
favorisant l'estime de soi des
élèves dans le projet "reportage vidéo",
citées par les participants.
68
Nous observons ceci (tableau 7) : selon la perception des
élèves, les postures ou les attitudes de l'enseignante qui leur
ont permis de se sentir capables de réaliser le projet sont la
bienveillance (pour 47% des élèves), les encouragements (pour 80%
des élèves), le sourire (pour 54% des élèves), une
posture motivante (pour 37% des élèves), une posture
d'écoute active lorsque les élèves proposaient leurs
idées (pour 27% des élèves). Pour finir, 14% des
élèves ont mentionné le fait qu'ils se sont sentis
capables de faire le projet car l'enseignante leur laissait une certaine
liberté pour la réalisation du projet et par conséquent,
selon eux, ils se sentaient « forts ».
3. Discussion
Nous discutons l'ensemble de nos résultats afin de
valider ou d'invalider nos hypothèses opérationnelles, puis de
valider ou d'invalider nos hypothèses générales.
3.1 Effets de l'estime de soi sur l'apprentissage
scolaire
· Hypothèses opérationnelles 1/2 et 3/4
Nous rappelons notre hypothèse opérationnelle 1
« Une haute estime de soi globale et une vision positive des concepts de
soi dans le domaine scolaire favorisent la motivation des élèves,
et par conséquent, améliorent leurs apprentissages scolaires.
» et notre hypothèse opérationnelle 2 « Une haute
estime de soi et une vision négative des concepts de soi dans le domaine
scolaire desservent la motivation des élèves, et par
conséquent, altèrent leurs apprentissages scolaires. ». En
comparant les résultats en lien avec ces deux hypothèses, nous
nous concentrons sur l'effet de la vision des concepts de soi dans le domaine
scolaire sur l'apprentissage scolaire car dans ces deux hypothèses, les
élèves ont une estime de soi haute.
Nous nous intéressons aux participants A (haute estime
et vision positive des concepts de soi scolaires) et B (haute estime et vision
négative des concepts de soi scolaires) dans la figure 13. Nous partons
du principe que si les participants A et B ont les mêmes résultats
à la question 12 de notre questionnaire, alors nos hypothèses
opérationnelles 1 et 2 sont fausses : cela voudrait dire que la vision
des concepts de soi scolaires n'a aucun effet sur l'apprentissage scolaire. Or,
dans la partie résultats,
69
nous avons observé des résultats
différents. Nous pouvons écrire que nos hypothèses
opérationnelles 1 et 2 ne sont pas fausses : les résultats des
participants A et B diffèrent.
Peut-on, cependant, valider entièrement les
hypothèses opérationnelles 1 et 2 ? Nous pouvons valider notre
hypothèse opérationnelle 1, car 100 % des élèves
obtiennent le même résultat : une haute estime de soi globale et
une vision positive des concepts de soi dans le domaine scolaire favorisent la
motivation des élèves, et par conséquent,
améliorent leurs apprentissages scolaires.
Pouvons-nous, cependant, réellement valider notre
hypothèse opérationnelle 2 ? Nous pouvons écrire qu'une
vision des concepts de soi scolaires négative ou positive peut
influencer l'apprentissage scolaire, car pour les participants A, nos
résultats affirment qu'aucun élève n'améliore pas
son apprentissage scolaire, contre un tiers des participants B. Nous ne pouvons
pas nous arrêter à cette donnée, nous devons la
préciser. La majorité des participants B sont
motivés, et par conséquent, leurs apprentissages scolaires
s'améliorent. On ne peut donc pas écrire qu'une haute estime de
soi et une vision négative des concepts de soi dans le domaine scolaire
desservent la motivation des élèves, et par conséquent,
altèrent leurs apprentissages scolaires : ce n'est pas le cas pour
tous les élèves. Nous pouvons cependant
écrire qu'une haute estime de soi et une vision négative des
concepts de soi dans le domaine scolaire peut desservir la
motivation des élèves, et par conséquent, altérer
leurs apprentissages scolaires. Nous validons, alors, partiellement notre
hypothèse opérationnelle 2.
Nous retrouvons les mêmes tendances pour les
résultats (figure 13) de nos hypothèses opérationnelles 3
« Une faible estime de soi globale et une vision positive des concepts de
soi dans le domaine scolaire favorisent la motivation des élèves,
et par conséquent, améliorent leurs apprentissages scolaires
» et 4 « Une faible estime de soi globale et une vision
négative des concepts de soi dans le domaine scolaire desservent la
motivation des élèves, et par conséquent, altèrent
leurs apprentissages scolaires. ». Nous appliquons alors le même
raisonnement pour nos hypothèses opérationnelles 3 et 4 que pour
nos hypothèses opérationnelles 1 et 2. Nous validons
l'hypothèse opérationnelle 3 : une faible estime de soi globale
et une vision positive
70
des concepts de soi dans le domaine scolaire favorisent la
motivation des élèves, et par conséquent,
améliorent leurs apprentissages scolaires. Nous validons partiellement
l'hypothèse opérationnelle 4, car dans la phrase, nous
préférons remplacer « desservent » par «
peut desservir ».
La validation ou la validation partielle de nos
hypothèses opérationnelles 1, 2, 3 et 4 sont en accord avec nos
recherches théoriques. Nous rappelons que, selon Viau
(2004)80, la motivation de l'élève influence son
apprentissage, et une des sources de motivation de l'élève est
« La perception qu'il a de sa compétence à accomplir
». Nous pouvons écrire, à l'aide de nos
résultats, ceci : plus un élève à une perception de
sa compétence à accomplir positive, autrement dit une vision
positive des concepts de soi dans le domaine scolaire, plus il sera
motivé et plus son apprentissage scolaire s'améliorera.
Nous pouvons également nous appuyer sur les recherches
de Martinot (2011)81. Rappelons-le, selon Martinot, plus un
élève a une organisation en mémoire des concepts de soi de
réussite scolaire accessible, plus il sera performant et motivé
pour effectuer des efforts, afin de progresser dans son apprentissage scolaire.
Au contraire, si cette organisation en mémoire des conceptions de soi de
réussite scolaire est moins accessible, autrement dit que
l'élève n'a pas souvenir de ses réussites dans le milieu
scolaire, alors il fera moins d'efforts. C'est exactement ce que nous avons
observé dans nos résultats et dans nos validations de nos
hypothèses.
· Hypothèses opérationnelles 1/3 et 2/4
Nous comparons, à présent, les résultats
entre nos hypothèses opérationnelles 2 et 4. En comparant ces
résultats (figure 13), nous nous concentrons sur l'effet de l'estime de
soi globale (haute ou basse) sur l'apprentissage scolaire, car dans ces deux
hypothèses, les élèves ont tous une vision des concepts de
soi scolaires négative. Nous partons du principe que si les participants
B (haute estime de soi
80 Viau, R. (2004). La motivation : condition
de plaisir d'apprendre et d'enseigner en contexte scolaire, 3e
congrès des chercheurs en éducation Bruxelles. Québec :
université de Sherbrooke.
81 Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et
estime de soi : ingrédients pour la réussite scolaire. Revue
des sciences de l'éducation, 27 (3), 483-502.
71
globale) et D (basse estime de soi globale) obtiennent des
résultats différents à la question 12 de notre
questionnaire, alors l'estime de soi globale influence l'apprentissage
scolaire. Or, nous avons observé les mêmes résultats pour
les participants B et D, à savoir environ 1/3 des élèves
dont l'apprentissage scolaire ne s'améliore pas et environ 2/3 des
élèves dont l'apprentissage scolaire s'améliore. Nous
pouvons emmètre la même conclusion lorsque nous comparons nos
hypothèses opérationnelles 1 et 3 : les résultats ne sont
pas différents entre les participants A (haute estime de soi et vision
positive des concepts de soi scolaires) et C (basse estime de soi et vison
positive des concepts de soi scolaires) : environ la totalité des
élèves sont motivés et améliorent leurs
apprentissages scolaires. Nous pouvons alors écrire, d'après la
comparaison de nos résultats, que l'estime de soi globale n'influence
pas l'apprentissage scolaire des élèves.
Appuyons-nous sur nos recherches théoriques. Rappelons
que l'estime de soi globale ne rassemble pas seulement le domaine scolaire.
Selon Fiasse et Nader-Grobois (2016)82 , si un élève
en échec scolaire se désintéresse du système
scolaire, alors son estime de soi ne sera plus associée au milieu
scolaire. L'élève portera davantage d'importance à un
autre domaine, comme par exemple le domaine social, et inversement. Nous
pouvons alors penser ceci, avec nos résultats :
-Les élèves avec une vision négative des
concepts de soi scolaires et une estime de soi haute, ne portent pas
d'importance au milieu scolaire, mais apportent davantage d'importance dans
d'autres domaines. Ils ont une vision positive des concepts de soi dans ces
autres domaines, comme par exemple le domaine social, et par conséquent,
leur estime de soi globale reste haute. Leur estime de soi est haute, mais
leurs apprentissages scolaires ne s'améliorent pas, car leur vision des
concepts de soi scolaires est négative.
- Les élèves avec une vision positive des
concepts de soi scolaire et une estime de soi basse portent de l'importance au
milieu scolaire. Il se peut qu'ils aient une vision des concepts de soi dans
d'autres domaines (comme par exemple le domaine social) négative. Leur
estime de soi globale est basse, mais leurs apprentissages scolaires
s'améliorent, car ils ont une vision des concepts de soi scolaires
positive.
82 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016). De
la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck
Supérieur.
72
Vérifions ceci à l'aide des résultats du
tableau 3. Nous partons du principe que si l'estime de soi globale influence
l'apprentissage scolaire, alors les élèves avec une haute estime
de soi auraient tous une moyenne générale haute ; et que les
élèves avec une basse estime de soi globale auraient tous une
moyenne générale basse. Or, nous n'observons pas ces
résultats. Nous observons que c'est la vision des concepts de soi dans
le domaine scolaire qui influence la moyenne générale des
élèves. Les élèves avec une vision positive des
concepts de soi dans le domaine scolaire ont une moyenne générale
plus haute que les élèves avec une vision négative des
concepts de soi dans le domaine scolaire.
Relevons un autre détail, pour finir. Nous observons
une légère différence entre les figures 11 et 12 : les
élèves avec une haute estime de soi ont plus souvent une vision
positive des concepts de soi scolaires que les élèves avec une
basse estime de soi. Rappelons que selon Hater, des domaines spécifiques
de la conception de soi prédominent par rapport à d'autres
domaines lors de l'adolescence et participent davantage à l'estime de
soi globale, le domaine scolaire en fait partie (Cannard, 2019)83.
Nos participants sont des adolescents. Nous pouvons donc écrire que la
vision des concepts de soi dans le domaine scolaire des participants, peut
influencer leur estime de soi globale, car le domaine scolaire est un domaine
important lors de l'adolescence. Une vision des concepts de soi scolaires
positive favoriserait une haute estime de soi globale.
Á l'aide de tous ces éléments, nous
pouvons à présent valider ou invalider notre hypothèse
générale 1 « l'estime de soi des élèves influe
sur leurs apprentissages scolaires ». Nous ne validons pas
entièrement cette hypothèse, car ce n'est pas l'estime de soi
globale des élèves qui influe sur leurs apprentissages scolaires,
mais leur vision des concepts de soi dans le domaine scolaire. Cependant, la
vision des concepts de soi dans le domaine scolaire peut influencer l'estime de
soi globale alors nous validons partiellement notre hypothèse.
83 Cannard, C. (2019). Le développement de
l'adolescent. Belgique : De Boeck Supérieur.
73
3.2 Effets de l'enseignant sur l'estime de soi des
élèves
Discutons notre hypothèse opérationnelle 5
« En adoptant une posture bienveillante et en proposant des
activités favorisant l'autonomie, l'enseignant améliore l'estime
de soi des élèves. ».
Premièrement, les résultats
présentés dans la figure 14 nous laissent penser qu'aucun lien
n'existe entre l'enseignant et l'estime de soi des élèves. Nous
avons décidé de réaliser un test khi-deux, à l'aide
du logiciel Excel et d'un tableau de contingence, afin de confirmer ou de ne
pas confirmer notre impression. Le test khi-deux (tableau 8), nous permet
d'évaluer un lien possible entre l'influence de l'enseignant
(postures/attitudes, activités proposées) et
l'amélioration de l'estime de soi des élèves. Nous posons
l'hypothèse nulle H0 : « Il n'y a aucun lien entre l'influence de
l'enseignant et l'estime de soi des élèves ».
Mesure réelle :
X : favorisation de l'estime de soi // Y influence de
l'enseignant
|
Posture / attitude
|
Activités proposées
|
Non
|
57
|
83
|
Oui
|
45
|
19
|
Total
|
102
|
102
|
|
Mesure théorique dans le cas de l'hypothèse nulle
:
X : favorisation de l'estime de soi // Y influence de
l'enseignant
|
Posture
bienveillante
|
Activité proposées
|
Non
|
70
|
70
|
Oui
|
32
|
32
|
|
Mesure du degré de signification :
P-Value 8,75
Tableau 8 : Test statistique Khi-deux sur la relation
possible entre l'influence de l'enseignant et l'amélioration de l'estime
de soi des élèves.
Á l'aide de la table de la loi khi-deux (cf. Annexe 6 :
table de la loi khi-deux), nous pouvons écrire que 8,74 est
supérieur à 3,84, donc nous rejetons l'hypothèse nulle H0,
les deux variables ne sont pas indépendantes : l'influence de
l'enseignant et l'estime de soi des élèves sont
associés.
74
Deuxièmement, le tableau 4 nous permet de
repérer, selon la perception des élèves, les
activités proposées par l'enseignant améliorant leur
estime de soi. Nous remarquons que toutes les activités citées
sont des activités favorisant l'autonomie des élèves
(projet, travaux pratiques, activité en groupe, exposé).
L'activité la moins citée est « activité sur le
manuel » : cette activité est l'activité favorisant le moins
l'autonomie des élèves. Nous pouvons donc écrire ceci :
les activités proposées par l'enseignant qui favorisent
l'autonomie des élèves, améliorent l'estime de soi des
élèves. Ce que nous écrivons est en accord avec nos
recherches théoriques. Prenons l'exemple d'un projet, selon Perrenoud
(1999)84, un apprentissage par projet permet de «
développer l'autonomie et la capacité de faire
des choix » et les activités impliquées dans une
pédagogie de projet « aident chaque élève à
prendre confiance en lui », autrement dit aide à favoriser l'estime
de soi de l'élève.
Enfin, le tableau 5 nous permet de repérer, selon la
perception des élèves, les postures/attitudes de l'enseignant
améliorant leur estime de soi. Nous remarquons que toute les
postures/attitudes citées peuvent se rassembler dans un seul groupe : la
bienveillance. Nous pouvons écrire cela, car rappelons-le, selon
Shankland, Bressoud, Tessier, et Gay (2018)85, « la
bienveillance englobe les notions de respect, de tolérance,
d'acceptation, d'empathie, de compassion ». Toutes les postures
citées par les élèves renvoient à ces notions.
De plus, selon Fiasse et Nader-Grobois (2016)86,
l'estime de soi d'un adolescent augmente lorsqu'un adulte, comme un enseignant,
lui renvoie une image positive de lui-même, et selon Martinot
(2011)87, l'enseignant doit réactiver l'organisation en
mémoire des conceptions de soi de réussite scolaire de
l'élève en lui rappelant ses réussites scolaires, sans
être dans le jugement. Les attitudes présentées par ces
auteurs sont une nouvelle fois en accord avec les postures/attitudes
citées par les
84 Perrenous, P. (1999). Apprendre à
l'école à travers des projets : pourquoi ? comment ?
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
Université de Genève.
85 Shankland, R. & Bressoud, N. & Tessier, D.
& Gay, G. (2018). La bienveillance : une compétence
socio-émotionnelle de l'enseignant au service du bien-être et des
apprentissages ? Questions Vives (29).
86 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016).
De la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck
Supérieur.
87 Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et
estime de soi : ingrédients pour la réussite scolaire. Revue
des sciences de l'éducation, 27 (3), 483-502.
75
élèves. Nous pouvons alors écrire ceci :
en adoptant une posture bienveillante, l'enseignant améliore l'estime de
soi des élèves.
Tous ces éléments nous laissent penser que
notre hypothèse opérationnelle 5 est vraie. Cependant, nous avons
fait le choix de discuter les résultats du protocole 2, afin de
préciser notre étude.
Selon les résultats de notre grille d'observation
(tableau 6), plus le projet « reportage vidéo » avance, plus
les élèves se montrent impliqués dans le projet. Nous
constatons que leur estime de soi augmente, car par exemple, au début du
projet, ils ne voulaient pas être filmés, mais au milieu du
projet, ils étaient enthousiastes à l'idée d'être
filmés. Rappelons que dans ce projet, l'enseignant adopte une posture
bienveillante et les activités proposées dans ce projet
favorisent l'autonomie des élèves. Ces deux
éléments semblent alors être à l'origine de
l'augmentation de l'estime de soi des élèves.
Nous consultons les résultats des figures 15 et 16,
afin de vérifier notre impression sur l'augmentation
générale de l'estime de soi des élèves grâce
à ce projet. Ces résultats nous le confirment. Nous pouvons
écrire ceci, car lorsqu'un élève se sent capable de mener
un projet, son estime de soi augmente. De plus, les postures/attitudes de
l'enseignant citées par les élèves (tableau 7), peuvent
une nouvelle fois être regroupées dans le groupe «
bienveillance ».
Les résultats du protocole 2 sont donc en accord avec
les résultats du protocole 1, et par conséquent, avec nos
recherches théoriques. Nous validons alors notre hypothèse
opérationnelle 5 « En adoptant une posture bienveillante et en
proposant des activités favorisant l'autonomie, l'enseignant
améliore l'estime de soi des élèves ».
En validant notre hypothèse opérationnelle 5,
nous pouvons valider notre hypothèse générale 2 «
l'enseignant influence l'estime de soi des élèves à
travers sa posture, et la nature des activités proposées aux
élèves. »
76
3.3 Critiques de nos méthodes
Dans l'ensemble, nos résultats sont en accord avec nos
recherches cependant, il faut prendre du recul sur nos méthodes, car
elles sont critiquables.
Premièrement, les résultats de nos protocoles
sont majoritairement basés sur la perception des élèves,
or la perception des élèves peut s'avérer être
différente de la réalité. Pour poursuivre et
préciser l'étude, nous pourrons adresser des questionnaires aux
enseignants ou encore aux parents, afin d'obtenir d'autres perceptions. Nous
pourrons également compléter notre étude en
réalisant une activité ne favorisant pas l'autonomie des
élèves et comparer les résultats avec les résultats
de notre protocole 2. Rappelons également que nos participants sont tous
en 1ère baccalauréat professionnel. Il serait intéressant
d'avoir l'avis d'autres niveaux (terminal, seconde, CAP) : les perceptions
peuvent être différentes. Enfin, nous pourrons préciser
l'étude en analysant les résultats en fonction du sexe et du
niveau social des participants : les perceptions peuvent aussi être
différentes.
Ensuite, nous avons validé partiellement notre
hypothèse générale 1 en partant du principe que la source
de motivation « la perception de la compétence à accomplir
» améliore ou n'améliore pas l'apprentissage scolaire. Or,
dans la dynamique motivationnelle de Viau (2004)88, il n'y a pas
qu'une source de motivation mais trois sources de motivation. Nous n'avons pas
mesuré les deux autres, nos résultats peuvent donc être
faussés.
De plus, nous avons mesuré la perception des concepts
de soi dans le milieu scolaire d'une façon générale, mais
rappelons que la perception des concepts de soi scolaires peut différer
en fonction des différentes matières. Si nous souhaitons
préciser notre étude, nous pourrons mesurer les concepts de soi
scolaires pour chaque matière.
Enfin, nous avons validé partiellement notre
hypothèse générale 1 en précisant que c'est la
perception des concepts de soi dans le domaine scolaire qui favorise
88 Viau, R. (2004). La motivation : condition
de plaisir d'apprendre et d'enseigner en contexte scolaire, 3e
congrès des chercheurs en éducation Bruxelles. Québec :
université de Sherbrooke.
77
l'apprentissage scolaire et non l'estime de soi globale. Pour
préciser notre étude, il serait intéressant de remplacer
« l'estime de soi » par « la perception des concepts de soi
scolaires » dans notre hypothèse générale 2, afin de
mettre en relation d'une manière plus précise nos deux
hypothèses générales.
78
CONCLUSION
Á l'origine de ce mémoire, nous nous posions la
question « L'estime de soi des élèves, composée des
concepts de soi dans le domaine scolaire, peut-elle d'une part, influer sur
leur motivation et leurs apprentissages scolaires, et, d'autre part, être
influencée par la posture et la nature des activités
proposées par l'enseignant ? ». En effet, nous avons
étudié l'estime de soi des élèves, car nous
entendions souvent ceci : l'estime de soi des élèves en
lycée professionnel est peu élevée. D'après nos
recherches, il s'avère que ce n'est pas une simple rumeur, la
majorité de nos participants ont une estime de soi peu
élevée. Nous voulions alors trouver les liens, d'une part entre
l'estime de soi des élèves et leurs apprentissages scolaires, et
d'autre part, entre l'estime de soi des élèves et l'influence des
enseignants, afin de savoir si l'enseignant pouvait jouer un rôle dans
l'estime de soi des élèves, et par conséquent, sur leurs
apprentissages scolaires.
Les recherches ont permis d'apporter des réponses
à nos questions. Nous savons, à présent, que l'adolescence
est une période caractérisée par de nombreux changements.
Nous pensons, de part ces changements physiques et psychologiques, que la
période de l'adolescence est propice aux variations de l'estime de soi.
Pour faire le lien entre l'estime de soi des adolescents et l'apprentissage
scolaire, nous avons utilisé la motivation des élèves. En
effet, grâce au modèle de la dynamique motivationnelle de Viau,
nous avons appris qu'il existe trois sources principales de motivation, dont la
perception de la compétence à accomplir. Ces sources principales
de motivation influencent l'apprentissage scolaire des élèves. En
faisant le lien entre l'estime de soi des élèves et
l'apprentissage scolaire, nous nous sommes rendu compte de ceci : ce n'est pas
l'estime de soi globale des élèves qui influence leur motivation,
et par conséquent, leurs apprentissages scolaires, mais c'est la
perception de leurs concepts de soi scolaires. Comment expliquer ceci ? Nous
avons appris que l'estime de soi se compose de plusieurs
éléments, comme par exemple la confiance en soi, le sentiment de
compétence, le sentiment d'appartenance ou encore les différents
domaines (sociale, scolaire, physique) des concepts de soi. L'estime de soi
globale ne se caractérise donc pas seulement par la perception qu'un
élève à de lui dans le domaine scolaire : les concepts de
soi dans le domaine scolaire et l'estime de
79
soi globale peuvent donc être différents.
L'amélioration de la motivation et des apprentissages scolaires
dépend donc des concepts de soi du domaine scolaire et non de l'estime
de soi globale des adolescents, même si les concepts de soi scolaires
peuvent influencer l'estime de soi globale des adolescents.
Dans un deuxième temps, nous avons appris que
l'enseignant peut être un des repères principaux pour les
adolescents. Il peut influencer leur estime de soi part sa posture et part les
activités qu'il propose. S'il adopte une posture bienveillante,
l'enseignant agit sur les trois besoins psychologiques d'un
élève, à savoir son autonomie, son sentiment de
compétence et sa proximité sociale. Il améliore l'estime
de soi des élèves, mais également leur motivation, car
plus un élève se sent capable de réaliser une
activité, plus il sera motivé. Nous avons également
étudié ceci : l'enseignant doit proposer des activités qui
favorisent l'autonomie des élèves (projet, activité en
groupe) pour améliorer leur estime de soi. En effet, plus un
élève est autonome, plus il prend confiance en lui et plus il se
sent capable de faire les activités.
Nous pensons donc que l'enseignant peut améliorer
l'estime de soi des élèves et la perception qu'ils ont sur leurs
concepts de soi scolaires, afin qu'ils soient davantage motivés, et par
conséquent, qu'ils améliorent leurs apprentissages scolaires.
Cependant, même si les résultats de nos
protocoles sont en accord avec nos recherches théoriques, nous avons
émis des limites sur nos méthodes. Nos limites concernent nos
participants et la précision de nos protocoles. Nous pourrons envisager
d'approfondir nos recherches en réalisant d'autres expériences
plus précises sur la mesure de tous les domaines de l'estime de soi par
exemple.
Pour finir, suite à ces recherches, nous nous posons
d'autres questions : Comment motiver cette nouvelle génération
d'élèves ? Les TICE (technologies de l'information et de la
communication pour l'enseignant) sont-elles de réelles sources de
motivation pour les élèves ? Les TICE peuvent-elles
améliorer l'estime de soi des élèves et améliorer
leurs apprentissages scolaires ? Comment les enseignants et les parents des
élèves peuvent-ils s'associer pour améliorer l'estime de
soi des élèves ?
80
BIBLIOGRAPHIE
Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Bloom, B. S. (2001).
A taxonomy for learning, teaching, and assessing : A revision of Bloom's
taxonomy of educational objectives. Etats-Unis : Allyn & Bacon.
Anderson J. R. (2000). Learning and memory. New York :
Wiley.
Antoine, C. & Angel, S. (2016). Estime de soi. In Le
petit Larousse de la psychologie (pp. 297-305). Paris: Larousse.
Balegamire Bazilashe, J. & Marc, P. (2000). Adolescence
: des clefs pour comprendre. Suisse : édition du tricorne.
Bardou, E. & Oubrayrie-Roussel, N. (2014). L'estime de
soi. Paris : In Press.
Blanquer, J. M. (2019). Lettre de Jean-Michel Blanquer aux
professeurs sur le projet de loi pour une École de la confiance.
Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des
sports.
Bucheton, D. & Soulé, Y. (2009). Les gestes
professionnels et le jeu des postures de l'enseignant dans la classe : un
multi-agenda de préoccupation enchâssées. Education et
didactique, 3(3), 29-48.
Cannard, C. (2019). Le développement de
l'adolescent. Belgique : De Boeck Supérieur.
Cadieux, A. (2003). Concept de soi et comportements en classe
d'élèves vivant avec une déficience intellectuelle : Une
étude longitudinale. Revue francophone de la déficience
intellectuelle, 14(2), 121-137.
Chouinard, R. (2002). Évaluer sans décourager.
Département de psychopédagogie et d'andragogie,
Université de Montréal, Centre de recherche et d'intervention sur
la réussite scolaire (CRIRES).
Cloutier, R. (1996). Psychologie de l'adolescence.
Montréal : Gaëtan Morin.
Cohen-Scali, V. & Guichard, J. (2008). L'identité :
perspectives développementales. L'orientation scolaire et
professionnelle, 37(3), 321-345.
81
Coslin, P. G. (2002). Psychologie de l'adolescent. Paris
: Armand Colins.
Crépin, N. & Delarue, F. (2014). Echelle d'estime de
soi de Rosenberg. Institut Régional du Bien-être de la
Médecine et du Sport santé.
Da Conceição Taborda-Simões, M. (2005).
L'adolescence : une transition, une crise ou un changement ? Bulletin de
psychologie, 5(5), 521-534.
Dasen, P. R. (1995). Représentation sociale de
l'adolescent : une perspective interculturelle. Vous avez dit...
pédagogie, 37, 17-30.
Desmurget, M. (2019). La fabrique du crétin digital.
France : Seuil.
Dévolvé, N. (2006). Métacognition et
réussite des élèves. Les cahiers
pédagogiques.
Discour, V. (2011). Changements du corps et remaniement
psychique à l'adolescence. Les Cahiers Dynamiques, 1(1),
40-46.
Doré, C. (2017). L'estime de soi : analyse de concept.
Recherche en soins infirmiers, 2(2), 18-26.
Dozot, C. & Piret, A. & Romainville, M. (2009). L'estime
de soi des étudiants de première année du supérieur
en abandon d'études. L'orientation scolaire et professionnelle,
38/2, 205-230.
Duclos, G. (2004). L'estime de soi, un passeport pour la
vie. Montréal : hôpital Sainte-Justine.
Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016). De la perception
à l'estime de soi. Belgique : De Boeck Supérieur.
Flavel, J. H. (1985). Cognitive development. Etats-Unis
: Prentice-Hall.
Guellaï, B. & Esseily, R. (2018). Psychologie du
développement. Paris : Armand Colin.
Hall, G. S. (1904). Adolescence. New York :
Appelton.
Harter, S. (1983). Supplementary description of the
Self-Perception Profile for children : Revision of the Perceived Competence
Scale for children. Denver: University of Denver.
82
Houssaye, J. (2014). Le triangle pédagogique, les
différentes facettes de la pédagogie. France : ESF.
Hubner, J.J. & Shavelson, R.J. & Stanton, G.C. (1976).
Validation of construct interpretations. Review of Educational
Research, 46, 407-441.
Kauffman, A. S. (2010). Coming og agee in the kisspeptin Era
: Sex differences, development and puberty. Molecular and cellular
Endocrinology, 324(1-2), 51-63.
Leyrit, A. & Oubrayrie-Roussel, N. & Prêteur, Y.
(2011). L'auto-handicap chez les adolescents : Analyse d'une stratégie
de protection de Soi à l'école. L'orientation scolaire et
professionnelle, 40/2.
Mardon, A. (2009). Les premières règles des
jeunes filles : puberté et entrée dans l'adolescence.
Sociétés contemporaines, 3(3), 109-129.
Marsh, H.W. (1997). The measurement of physical self-concept: a
construct validation approach. In K.R. Fox (Ed.), The physical self : from
motivation to wellbeing (pp. 27-58). Etats-Unis: Human Kinetics.
Marsh, H.W. (1998). Age and Gender Effects in Physical
Self-Concepts for Adolescent Elite Athletes and Nonathletes : A
multicohort-Miltioccasion Design. Journal of Sport and Exercise
Psychology, 20, 237-259.
Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et estime de soi :
ingrédients pour la réussite scolaire. Revue des sciences de
l'éducation, 27 (3), 483-502.
Perrenoud, P. (1999). Apprendre à l'école
à travers des projets : pourquoi ? comment ? Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation Université de
Genève.
Quinodoz, J. (2004). Le moi et le ça, S. Freud (1923b).
In J. Quinodoz, Lire Freud : Découverte chronologique de l'oeuvre de
Freud (pp. 231-238). Paris : Presses Universitaires de France.
Reuter, Y., Cohen-Azria, C., Daunay, B., Delcambre, I.,
Lahanier-Reuter, D. (2013). Dictionnaire des concepts fondamentaux des
didactiques. Belgique : Louvain-la-Neuve.
83
Schmid-Kilsikis, E. (2002). Le moi et les mécanismes de
défense. Dictionnaire international de la psychanalyse. Paris :
Hachette.
Shankland, R., Bressoud, N., Tessier, D. & Gay, G. (2018).
La bienveillance : une compétence socio-émotionnelle de
l'enseignant au service du bien-être et des apprentissages ?
Questions Vives (29).
Steinberg, L. (1990). Autonomy, conflict, and harmony in the
family relationship. In S. S. Feldman & G. R. Elliott (Eds.),
At the threshold: The developing adolescent (p. 255-276). Etats-Unis :
Harvard University Press.
Tricot, A. & Musial, M. & Pradère, F. (2011).
Prendre en compte les apprentissages lors de la conception d'un scénario
pédagogique. Recherches et formations, 68.
Tanguy, F. (2020). Cours dispensés dans le cadre du
module didactique générale, master 2 MEEF.
Viau, R. (1998). Les perceptions de l'élève :
sources de sa motivation dans les cours de français. Québec
français, (110), 45-47.
Viau, R. (2004). La motivation : condition de plaisir
d'apprendre et d'enseigner en contexte scolaire, 3e
congrès des chercheurs en éducation Bruxelles. Québec :
université de Sherbrooke.
84
TABLE DES FIGURES
Figure 1 : Classification des quatre styles
éducatifs parentaux 16
Figure 2 : Modèle multidimensionnel
corrélé du concept de soi 20
Figure 3 : Représentation de
l'organisation hiérarchique du concept de soi. 22
Figure 4 : Schéma des liens entre concept
de soi et estime de soi 23
Figure 5 : Schéma de construction d'une
séance (Guillet sur la base des cours de
Tanguy 2017) 28
Figure 6 : Modèle de la dynamique
motivationnelle de l'élève d'après Viau (2004) 30
Figure 7 : Phénomène de
l'auto-réalisation de la prophétie d'après Bandura 33
Figure 8 : Triangle pédagogique
d'après Houssaye 35
Figure 9 : Taxonomie de Bloom
révisée par Krathwohl 40
Figure 10 : Niveaux d'estime de soi globale des
participants mesurés avec l'échelle
de Rosenberg. 55
Figure 11 :
Répartition de la perception des concepts de soi scolaires, positive
ou
négative, pour les participants avec une haute estime de
soi. 56
Figure 12 : Répartition de la perception
des concepts de soi scolaires, positive ou
négative, pour les participants avec une basse estime de
soi. 57
Figure 13 : Perception des compétences
à accomplir des participants A, B, C et D.59 Figure 14
: L'influence positive (barres bleues) ou négatives (barres
orange) des activités proposées par l'enseignant et des postures
de l'enseignant sur l'estime de
soi des élèves selon la perception des
participants. 62
Figure 15 : volution de l'estime de soi
des participants avec le projet "reportage
vidéo" 66
Figure 16 : Effet de
l'attitude de l'enseignante sur l'estime de soi des élèves lors
du
projet "reportage vidéo". 67
85
TABLE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Formation de deux ensembles "haute
estime de soi" et "basse estime de
soi" à partir des quatre niveaux d'estime de soi globale
des participants. 56
Tableau 2 : Formation de quatre
ensembles, participants A, B, C et D à partir de l'estime de soi globale
et de la vision des concepts de soi scolaires des participants.
58
Tableau 3 : Moyenne générale
scolaire des participants A, B, C et D. 60
Tableau 4 : les activités
proposées par l'enseignant augmentant l'estime de soi des
élèves citées par les participants.
63
Tableau 5 : Mots cités par les participants
à propos des postures de l'enseignant
favorisant l'estime de soi des élèves.
63
Tableau 6 : Comparaison des observations de l'enseignant
sur le degré d'implication
des élèves entre le début du projet et le
milieu de projet. 64
Tableau 7 : Attitudes et postures de
l'enseignant favorisant l'estime de soi des élèves
dans le projet "reportage vidéo", citées par les
participants. 67
Tableau 8 : Test statistique Khi-deux sur
la relation possible entre l'influence de
l'enseignant et l'amélioration de l'estime de soi des
élèves. 73
86
ANNEXES
87
ANNEXE 1 Questionnaire pour les
élèves
Consigne
· Pour les questions de 1 à 10 (échelle de
Rosenberg) ? entourer la réponse correspondant le plus à votre
ressenti.
· Pour les questions 11, 12, 14 et 15 ? entourer oui ou non
en fonction de votre avis sur la question.
· Pour les questions 13, 16 et 17 ? répondre aux
questions.
Sachez qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses,
essayer de répondre honnêtement.
|
Echelle de Rosenberg
|
1
|
Je pense que je suis une personne de valeur, au
moins
égale à n'importe qui d'autre.
Tout à fait en désaccord Plutôt en
accord
Plutôt en désaccord Tout à fait en
accord
|
|
2
|
Je pense que je possède un certain nombre de
belles
qualités.
Tout à fait en désaccord Plutôt en
accord
Plutôt en désaccord Tout à fait en
accord
|
|
3
|
Tout bien considéré, je suis porté
à me considérer comme
un raté.
Tout à fait en désaccord Plutôt en
accord
Plutôt en désaccord Tout à fait en
accord
|
88
|
4
|
Je suis capable de faire les choses aussi bien que
la
majorité des gens.
Tout à fait en désaccord Plutôt en
accord
Plutôt en désaccord Tout à fait en
accord
|
|
5
|
Je sens peu de raisons d'être fier de
moi.
Tout à fait en désaccord Plutôt en
accord
Plutôt en désaccord Tout à fait en
accord
|
|
6
|
J'ai une attitude positive vis-à-vis
moi-même.
Tout à fait en désaccord Plutôt en
accord
Plutôt en désaccord Tout à fait en
accord
|
|
7
|
Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi.
Tout à fait en désaccord Plutôt en
accord
Plutôt en désaccord Tout à fait en
accord
|
|
8
|
J'aimerais avoir plus de respect pour
moi-même.
Tout à fait en désaccord Plutôt en
accord
Plutôt en désaccord Tout à fait en
accord
|
|
9
|
Parfois je me sens vraiment inutile.
Tout à fait en désaccord Plutôt en
accord
Plutôt en désaccord Tout à fait en
accord
|
|
10
|
Il m'arrive de penser que je suis un bon à
rien
Tout à fait en désaccord Plutôt en
accord
Plutôt en désaccord Tout à fait en
accord
|
89
11
|
Je réussis souvent les exercices/
évaluations aux lycées.
OUI NON
|
|
12
|
Je pense que j'ai des compétences
nécessaires pour
réussir une activité en classe et pour
progresser dans
mes résultats scolaires.
OUI NON
|
|
13
|
Quelle est ta moyenne générale au
lycée /20 ?
|
|
14
|
Selon toi, les activités proposées par
les enseignants
améliorent-elles ton estime de toi-même
?
OUI NON
|
|
15
|
Selon toi, les postures ou les attitudes des
enseignants
améliorent-elle ton estime de toi-même
?
OUI NON
|
|
16
|
Si tu as répondu oui à la question 14 :
Quels types
d'activités en particulier te permettent d'augmenter
ton
estime de toi-même ?
|
|
17
|
Si tu as répondu oui à la question 15 :
quels types
d'attitudes/postures de l'enseignant te
permettent
d'augmenter ton estime de toi-même ?
|
90
ANNEXE 2 Fiche séquence projet « reportage
vidéo »
|
Classe :1ère BP COM.
|
Prérequis : PSE modules A6/A8/B4 +
compétence B2I + séquence 2 AP « la prise de parole » +
séquence 1 AP « la confiance en soi ».
|
|
Matière : accompagnement
personnalisé
|
Durée : 8 heures
|
|
Objectif général : concevoir un
reportage vidéo.
|
Compétences : C1, C4, C5, C6 de PSE +
compétences du PIX
|
|
DATE
|
SEANCES
|
DUREE
|
OBJECTIFS
INTERMEDIAIRES
|
Explications
|
|
FEVRIER
|
N°1 : présentation du projet et des règles du
droit d'auteur.
|
1H
|
-expliquer les règles du droit d'auteur. -Proposer une
problématique.
|
L'enseignant présente le projet en distribuant une «
FICHE PROJET » avec toutes les étapes du projet. Il présente
également un diaporama pour expliquer les règles des droits
d'auteurs.
Les élèves forment les groupes de travail (7
élèves par groupe). Ils choisissent ensemble le sujet (2 sujets
possibles : aliments ultra-transformés ou impact environnemental des
vêtements). Puis ils réfléchissent et proposent une
problématique en lien avec le sujet choisi qui sera le fils conducteur
de leur reportage.
|
|
MARS
|
N°2 : recherches internet 1
|
1H
|
-rechercher des informations pour répondre à une
problématique.
|
Les élèves se placent devant des postes
d'ordinateur afin d'effectuer des recherches internet. Ils doivent faire les
recherches individuellement et trouver des informations pertinentes pour
répondre à leur problématique tout en respectant les
règles du droit d'auteur. Les recherches sont conservées sur un
document texte.
|
|
MARS
|
N°3 : recherche internet 2
|
1H
|
|
MARS
|
N°4 : mise en commun des informations
|
1H
|
-rassembler des informations.
|
Les élèves se remettent en groupe de travail et
échangent sur les informations trouvées. Ils doivent se mettre
d'accord sur la sélection des informations les plus pertinentes.
|
|
MARS
|
N°5 : écriture du reportage
|
1H
|
-écrire un scénario.
|
En groupe de travail, les élèves imaginent et
écrivent le scénario du reportage. Ils doivent imaginer les
textes, les différentes mises en scène, les costumes, les
vidéos à prendre chez eux pour compléter la vidéo
finale.
|
|
AVRIL
|
N°6 : entraînement
|
1H
|
-s'entraîner à l'oral.
|
Les élèvent s'entraînent à
répéter leurs mises en scène du reportage. Ils essaient
avec différentes intonations, différentes postures,
différents costumes pour trouver la meilleure mise en scène
possible.
|
|
AVRIL
|
N°7 : filmage du reportage
|
1H
|
-filmer le
reportage vidéo.
|
Les élèves filment eux-mêmes le reportage
qu'ils ont créé, scène par scène (fiche
séance sur cette séance).
|
|
AVRIL
|
N°8 : visionnage et évaluation
|
1H
|
-s'auto-évaluer.
|
L'enseignant a préparé le montage vidéo pour
tous les groupes et présente les reportages vidéo en classe en
l'aide du vidéo projecteur. Une fiche d'auto-évaluation est
distribuée ensuite.
|
91
ANNEXE 3 Grille d'observation
|
1= pas du tout 2= peu
3= moyennement 4= beaucoup
|
|
Observation de
l'enseignant
(amélioration
estime
de soi) // Degré
d'implication
|
Au début de la
séquence
|
Au milieu de la
séquence
|
|
L'élève est fière de sa
(future)
production.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
L'élève communique
ses idées, sûr
de lui,
dans son groupe.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
L'élève est autonome
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
L'élève est
enthousiaste à
l'idée
de passer devant une
caméra.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
2
|
3
|
4
|
92
ANNEXE 4 Questionnaire projet
Consigne
Répondre aux deux questions
ci-dessous, selon ton avis, en lien avec les séances sur le projet
« reportage vidéo ».
Question 1
Avec ce projet, ton estime de toi-même a-t-elle
augmenté, diminué ou bien stagné ?
Question 2
L'attitude de l'enseignante t'a-t-elle permis
de te sentir capable de faire ce projet ? Si oui, pourquoi ?
93
ANNEXE 5 Réponses des
participants pour chaque item du test de Rosenberg.
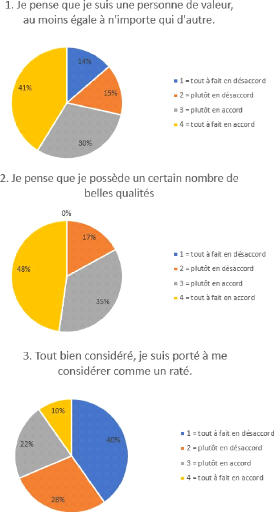
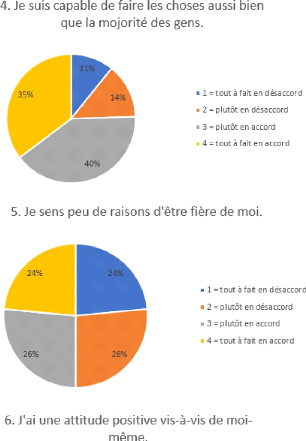
94
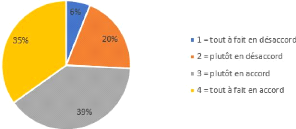
95
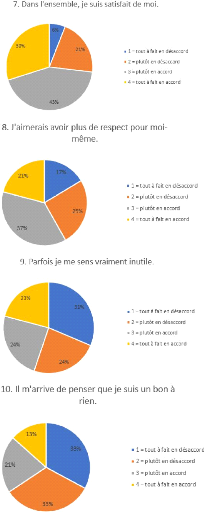
96
ANNEXE 6 Table de la loi khi-deux
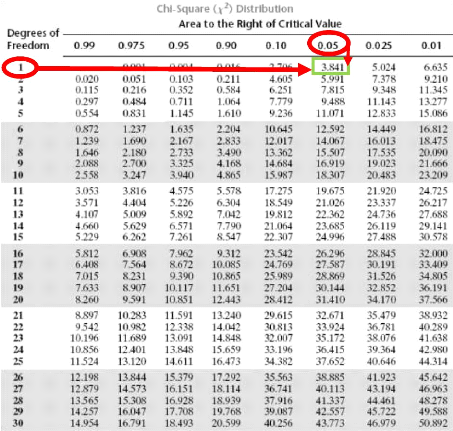
97
RÉSUMÉ
Le rôle de l'enseignant dans l'estime de soi des
adolescents en lycée
professionnel : les effets sur l'apprentissage
scolaire.
Nous entendons souvent ceci : l'estime de soi des adolescents
en lycée professionnel semble peu élevée. En tant
qu'enseignante en lycée professionnel, j'ai fait face à des
situations où les élèves se dévalorisaient et
où je me sentais impuissante. J'avais l'impression qu'une estime de soi
peu élevée faisait obstacle à l'apprentissage scolaire des
élèves. J'ai donc décidé de mener une
réflexion sur un lien possible entre l'estime de soi des
élèves, leurs apprentissages scolaires et le rôle de
l'enseignant dans l'estime de soi des élèves. Nous voulons savoir
si l'enseignant peut améliorer l'estime de soi des élèves
afin d'améliorer leurs apprentissages scolaires. Durant cette
étude, le sujet s'est montré complexe et nous avons
découvert de nombreuses notions, comme par exemple les concepts de soi
scolaires.
Mots clés : adolescent, estime de soi, concepts de
soi, apprentissage scolaire, rôle de l'enseignant.
ABSTRACT
The role of the teacher in the self-esteem of
adolescents in
vocational schools : effects on academic
learning.
We often hear this: the self-esteem of adolescents in vocational
high schools seems low. As a vocational school teacher, I have encountered
situations where students devalue themselves and I feel powerless. I felt that
low self-esteem was a barrier to students' academic learning. So I decided to
reflect on a possible link between students' self-esteem, their academic
learning, and the teacher's role in students' self-esteem. We want to know if
the teacher can improve students' self-esteem in order to improve their
academic learning. During this study, the subject was complex and we discovered
many notions, such as the concepts of academic self.
Key words : adolescent, self-esteem, self-concepts,
academic learning, teacher's role.



