|

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVIDROIT »
LA SANCTION PÉNALE EN DROIT DE
L'ENVIRONNEMENT: ÉTUDE COMPARÉE
DES
DROITS CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du MASTER II en Droit International et Comparé de
l'Environnement
Option : Droit Comparé de l'Environnement
Par :
AKOBE ATCHOUM Aminatou
Sous la direction de :
Madame le Professeur Jessica MAKOWIAK
Août 2015

SOMMAIRE

SOMMAIRE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES ABREVIATIONS iv
INTRODUCTION GENERALE 1
Ière PARTIE : LA SANCTION PENALE, UNE NOTION
COMMUNE AUX DROITS
CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS 7
CHAPITRE I : LE CONCEPT DE SANCTION PENALE EN DROIT
9
DE L'ENVIRONNEMENT 9
SECTION I : LA PROBLEMATIQUE DE L'AUTONOMIE DU DROIT
PENAL DE
L'ENVIRONNEMENT 9
SECTION II : LA FINALITE DE LA SANCTION
PENALE EN DROIT DE
L'ENVIRONNEMENT 14
CHAPITRE II : LA RECONNAISSANCE
DE LA SANCTION PENALE COMME MOYEN EFFICACE DE REPRESSION DES ATTEINTES A
L'ENVIRONNEMENT
19
SECTION I : LA PRESERVATION DE
L'INTEGRITE DE L'ENVIRONNEMENT : UNE PREOCCUPATION CONSTANTE DE LA COMMUNAUTE
INTERNATIONALE
19
SECTION II : LES AXES D'ENRACINEMENT DE LA SANCTION
PENALE EN
DROITS DE L'ENVIRONNEMENT CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS
24
DEUXIEME PARTIE: LA SANCTION PENALE : REGIMES JURIDIQUES
DISTINCTS EN DROITS FRANÇAIS ET CAMEROUNAIS DE
L'ENVIRONNEMENT 31
CHAPITRE I : LA SANCTION DES
ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT EN
DROIT CAMEROUNAIS 33
SECTION I : UN REGIME
HYBRIDE DE LA SANCTION PENALE EN DROIT
CAMEROUNAIS 34
SECTION II : LES FAIBLESSES DE LA SANCTION
PENALE EN DROIT
CAMEROUNAIS DE L'ENVIRONNEMENT 40
CHAPITRE II : LA
SANCTION DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT EN
DROIT FRANÇAIS 47
SECTION I : LE
REGIME DE LA SANCTION PENALE EN DROIT FRANÇAIS DE
L'ENVIRONNEMENT 48
SECTION II : LA DIFFICILE INTEGRATION DE
LA SANCTION PENALE EN DROIT
FRANÇAIS DE L'ENVIRONNEMENT 54
CONCLUSION GÉNÉRALE 60
BIBLIOGRAPHIE 65
TABLE DE MATIERES 68

DEDICACE

II
A
? Mon frère AKOBE NTAH Ahmed
? Mes parents AKOBE NTAH et BELECK ASSA
Fatou.

REMERCIEMENTS

III
Nous remercions tout d'abord Dieu pour nous avoir accordé
la grâce de réaliser ce
travail.
Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude
à notre tuteur pédagogique, le professeur Jessica MAKOWIAK pour
son soutien constant et sa disponibilité pour le travail.
Nous remercions également le responsable de la gestion
du Master, Monsieur François PELISSON qui a su se montrer disponible
tout au long de la formation. Nous ne voulons pas passer sous silence notre
gratitude envers l'Agence Universitaire de la Francophonie qui nous a permis de
suivre paisiblement cette formation à distance. Nous remercions
également tout le personnel du campus numérique francophone de
Yaoundé pour son aimable attention.
Nous adressons une reconnaissance particulière à
nos frères et soeurs AKOBE NDJOKO Blanche Kadidjatou, AKOBE ISSAH Abdou
Salam, AKOBE KETCHANG Abibatou et RIBAMA ABOUEM Martin Moussa qui ont toujours
été d'un soutien inébranlable et pour leur
particulière attention.
Nous rendons hommage à tous nos enseignants,
j'espère que ce travail leur donnera pleine satisfaction.
Nous désirons exprimer notre profonde gratitude
à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de
loin à la réalisation de ce travail ; nous pensons d'abord aux
professionnels pour leurs précieux conseils notamment à Madame
AMOUGOU de la Brigade des Inspections Environnementales de la
Délégation Régionale du Ministère de
l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement
Durable de la région du Littoral au Cameroun. Aussi, à nos
camarades de promotion 2014-2015 du Master II Droit International et
Comparé de l'Environnement pour leur aide dans la rédaction et la
compréhension de ce mémoire.
Que tous nos proches veuillent bien agréer l'expression
de notre sincère reconnaissance pour leurs encouragements et conseils,
particulièrement PEREM Aoudou, pour sa disponibilité et son
soutien moral.

LISTE DES ABREVIATIONS

iv
AHJUCAF : Association des Juridictions de
Cassation Francophones
Al : Alinéa
AME Accords Multilatéraux sur
l'Environnement
Art. : Article
BDEI : Bulletin de Droit de l'Environnement
Industriel
C. Cass. Crim : Chambre Criminelle de la Cour
de Cassation
CAA : Cour Administrative d'Appel
CJCE : Cour de Justice des Communautés
Européennes
CNAF : Commission Nationale des Allocations
Familiales
CP : Code Pénal
CPP : Code de Procédure
Pénale
ICPE : Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement
IRIC : Institut des Relations Internationales
du Cameroun
JCP : Journées Camerounaises de la
Propreté
MINDT : Ministère des Mines, de
l'Industrie et du Développement
Technologique
MINEP : Ministère de l'Environnement
et de la Protection de la Nature
MP : Ministère Public
OMD : Objectifs du Millénaire pour le
Développement
P : Page
PME : Petites et moyennes entreprises
PP : Pages
PVD : Pays en voie de Développement
RIDC : Revue Internationale de Droit
Comparé
RJE : Revue Juridique de l'Environnement
RNALP : Revue Négro-Africaine de
Littérature et de Philosophie
Sous la dir. : Sous la Direction de

INTRODUCTION GENERALE

1

2
I- PRÉSENTATION DU SUJET
Dans le cadre de l'initiation à la recherche, les
étudiants en fin d'études de Master II dans les
universités françaises en général et à
l'Université de Limoges en particulier sont appelés à
rédiger et à présenter un Mémoire. C'est dans cette
perspective qu'après validation de notre projet par le tuteur
pédagogique choisi parmi nos enseignants et mis à notre
disposition par l'Université, que nous présentons ce
Mémoire qui a pour thème « La sanction pénale en
droit de l'environnement : étude comparée des droits camerounais
et français ».
Le thème sur « La sanction pénale en droit
de l'environnement : étude comparée des droits camerounais et
français » est un sujet qui fait appel à plusieurs
disciplines du droit public à savoir :
- le droit de l'environnement car les questions
abordées portent essentiellement sur la protection de
l'environnement,
- le droit pénal de l'environnement car dans le cadre
de ce sujet il est question de présenter comment est organisée la
répression pénale des atteintes à l'environnement en
France et au Cameroun.
- le droit comparé car ce sujet met en exergue la
comparaison des législations de deux pays ayant des systèmes
juridiques différents et présentant des enjeux environnementaux
différents.
II-CADRE CONCEPTUEL DU SUJET
La compréhension de ce thème passe
nécessairement par la définition des mots et expressions
constituant le noyau dur de notre thème que sont « sanction
pénale », « droit de l'environnement », «
étude comparée », « camerounais », «
français ».
Le terme sanction dérive du latin « sanctio »
et plus précisément du verbe « sancire » qui signifie
rendre irrévocable. Selon le Dictionnaire Larousse, ce
terme a plusieurs acceptions : dans une acception large, le terme sanction
désigne la conséquence naturelle d'un acte, il désigne
également dans une certaine mesure l'acte par lequel un usage, un
événement, une action sont entérinés et
reçoivent une sorte de validité. Au sens restreint, le terme
sanction désigne la peine édictée par une loi pour
réprimer certains actes ; à titre de synonymes on peut citer les
termes comme condamnation, répression et punition. C'est cette
dernière définition qui sera retenue dans le cadre de notre
thème.

3
Le droit de l'environnement quant à lui désigne
l'étude ou l'élaboration de règles juridiques visant la
compréhension, la protection, l'utilisation, la gestion ou la
restauration de l'environnement sous toutes ses formes - terrestres, aquatiques
et marines, naturelles et culturelles, voire non-terrestres.... il se divise en
plusieurs branches parmi lesquelles le droit de la protection de la nature, le
droit des installations classées et le droit de l'urbanisme. A
l'origine, le droit de l'environnement était un droit essentiellement
préventif et sensibilisateur en ce qu'il se contentait uniquement
d'édicter une ligne de conduite visant à inciter les populations
à adopter des mesures garantissant une meilleure protection de
l'environnement. Mais, avec l'avènement des progrès scientifiques
et techniques du XIXème siècle, l'on s'est vite rendu
compte que les atteintes à l'environnement ne faisaient que
s'intensifier. A ce moment, réprimer les atteintes à
l'environnent est devenue une nécessité. C'est à ce titre
que certains auteurs considèrent le droit de l'environnement comme un
droit ambivalent, c'est-à-dire à la fois défensif (le
droit de protection de l'environnement), et offensif, de nature à
permettre la lutte contre les atteintes dont il peut être la victime (par
exemple, le droit de lutte contre la pollution).
S'agissant de l'expression « étude comparée
» il s'agit purement et simplement d'un travail intellectuel qui nous
permettra d'acquérir des connaissances relatives à un aspect du
droit pénal de l'environnement français et camerounais (en
l'occurrence sur les sanctions) et d'approfondir nos connaissances en la
matière.
III- DELIMITATION DU SUJET
Il est évident que prétendre à
l'exhaustivité dans le cadre de ce sujet serait une utopie en raison de
la vastitude du champ d'application de ce thème. Notre travail sera
essentiellement basé sur l'étude de la sanction en droit de
l'environnement camerounais et français. Dans le cadre de ce sujet, le
terme « sanction » doit s'entendre de façon très
restreinte car il ne s'agit pas d'étudier tous les types de sanction
mais l'éventail des sanctions pénales prévues par les
droits camerounais et français. En effet, en raison de l'insuffisance du
temps qui nous est imparti pour la rédaction du mémoire nous ne
pourrons pas aborder tous les différents secteurs du droit de
l'environnement nous étudierons uniquement les secteurs suivants :
- les pollutions dans ses divers domaines notamment en ce qui
concerne l'eau, le bruit, l'air, les installations classées pour la
protection de l'environnement ;
- la protection de la nature ;
- le droit de l'urbanisme

4
IV- PROBLÉMATIQUE
De ce sujet se dégage une question principale et
plusieurs questions subsidiaires auxquelles nous nous attèlerons
à trouver des réponses constructives. En effet, comment est-ce
que les droits de l'environnement camerounais et français
appréhendent la sanction pénale? Quel est le régime
juridique de la sanction pénale en droit de l'environnement camerounais
et français? Paul HERMAND définit le régime comme un
ensemble de règles auxquelles obéissent les rapports entre les
bénéficiaires et les organismes pour un handicap donné. En
effet, les régimes juridiques de la sanction pénale
prévues par les droits camerounais et français de l'environnement
sont-ils similaires ou alors totalement différents ? Le régime
juridique de la sanction pénale prévu en droit de l'environnement
camerounais et français est-il satisfaisant?
Dans la pratique on note une pléthore de textes qui
sont d'origine étatique telles les lois, loi-cadre, décrets en la
matière ceci dans le but de s'arrimer aux dispositions contenues dans
les AME que le Cameroun et la France, comme la plupart des États membres
de l'Organisation des Nations Unies, ont ratifié et qui visent assurer
une meilleure protection de l'environnement. Il s'agit notamment de la
Convention de Rio de Janeiro sur la diversité biologique adoptée
en 1992, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
adoptée en 2001, la Convention de bale sur le contrôle des
mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur
élimination adoptée en 19891, la Convention de
Washington sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction dite convention CITES
adoptée le 03 mars 1973, la Convention de Vienne pour la protection de
la couche d'ozone adoptée en 1985, la Convention-cadre des nations unies
sur les changements climatiques adoptée en 1992 et le Protocole de Kyoto
à la Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques
des Nations Unies adoptée en 1998. Cependant, malgré cette
multitude de textes qu'est-ce qui expliquent les multiples revendications
notamment de la société civile, qui laissent transparaître
un sentiment d'insatisfaction? Quelles pistes de solutions pouvons-nous
suggérer pour une protection plus efficace de l'environnement facteur de
paix et de bien être ?
1 A titre d'illustration sur les accords multilatéraux
relatifs à l'environnement, l'article 4 de la Convention de Bâle
dispose en son alinéa 3 : « les parties considèrent que le
trafic illicite des déchets dangereux ou d'autres déchets
constitue une infraction pénale » et l'alinéa 4 du
même texte poursuit : « chaque partie prend les mesures juridiques,
administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre et
faire respecter les dispositions de la présente convention, y compris
les voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en
contravention de la convention ».

5
V- INTERET DU SUJET
L'intérêt de ce sujet est double :
- Sur le plan théorique, ce sujet nous permet de cerner
les contours de la notion de sanction pénale en droit de l'environnement
et de passer en revue les droits camerounais et français en la
matière afin d'avoir une visibilité nette sur la position des
deux droits. En outre, la prise en compte des contributions doctrinales et
professionnelles nous permettra d'évaluer les efforts
considérables entrepris par les auteurs en matière de protection
de l'environnement.
- Sur le plan pratique, il est clair que la protection de
l'environnement a toujours été au centre des
préoccupations de la communauté internationale des États
dans son ensemble car de la qualité de l'environnement dépendent
la santé et la sécurité des individus qui font partie des
droits fondamentaux consacrés par les instruments juridiques
internationaux tels que la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
du 10 décembre 1948, les Pactes internationaux relatifs aux droits
civils et politiques et aux droits économiques et socioculturels
adoptés le 16 décembre 1966 et bien d'autres textes.
VI- CHOIX METHODOLOGIQUE
Le thème qui fait l'objet de notre étude nous
amène à étudier sa profondeur ainsi que ses
différents aspects. Notre recherche sera donc essentiellement
concentrée sur l'analyse documentaire qui nécessite une forte
documentation à savoir la loi, les conventions internationales, la
jurisprudence, la doctrine etc.... Il s'agit de faire une étude
comparative consistant à ressortir les points communs et les points
spécifiques de chaque législation en matière de droit
pénal de l'environnement.
VII-REVUE DE LA LITTÉRATURE
Au fil du temps, la communauté internationale a pris
conscience de ce que les ressources environnementales n'étaient pas
inépuisables et qu'il était urgent de prendre des mesures
importantes afin de garantir la préservation de l'environnement et par
ricochet la survie de l'homme sur terre. C'est cette préoccupation qui a
traduit la préparation des conférences de Stockholm de 19722 et
Rio de 19923qui ont marqué le cours de l'histoire du
2 Conférence de Stockholm sur
l'environnement humain à `issue de laquelle fut créé le
Programme des Nations Unies pour l'Environnement.

6
droit de l'environnement et à partir de ce moment de
nombreuses résolutions ont été adoptées notamment
celles visant à adopter des mesures visant à créer des
institutions, organes et celles visant l'adoption des instruments juridiques
contraignants ou non contraignants. C'est cette «
obligatoriété »4 qui a contraint les États
à adopter des « lois » visant à garantir la sauvegarde
de l'environnement. Au fil du temps, malgré l'élaboration des
normes internationales et des dispositions légales internes en la
matière le droit de l'environnement demeurait en quelque sorte sans
efficacité compte tenu des multiples dérives constatées
(tant du côté des personnes morales que de celui des personnes
privées). Il fallait donc édicter des normes visant à
sanctionner les atteintes à l'environnement. C'est ce souci
d'efficacité qui a conduit à l'émergence d'une branche du
droit de l'environnement à savoir le droit pénal de
l'environnement dont l'autonomie5 fait l'objet de controverses
doctrinales.
En effet, le droit de l'environnement serait sans
efficacité si la violation des règles en la matière
n'était pas punie. La quasi-totalité des législations en
matière d'environnement comportent des dispositions pénales.
C'est d'ailleurs le cas de la France et du Cameroun qui feront l'objet de notre
étude. Comme indiqué plus haut, il sera question pour nous
d'apprécier le régime juridique de la sanction pénale
aussi bien en droit de l'environnement camerounais qu'en droit de
l'environnement français afin de ressortir une étude comparative.
A ce sujet, le Cameroun tout comme la France disposent d'un éventail
juridique considérable car bon nombre de textes en matière
environnementale comportent des dispositions pénales. À titre
démonstratif, nous allons dans un premier temps faire une
présentation de la législation camerounaise et par la suite ce
sera le tour de la France.
VIII- PLAN DE RECHERCHE DES RESULTATS
Notre travail sera étalé sur deux grandes
parties comportant deux chapitres chacune. La première partie
présentera la sanction pénale comme étant une notion
commune aux droits de l'environnement camerounais et français
(Ière partie) et la seconde partie nous amènera
à ressortir les points spécifiques de chaque législation
en la matière (IIème partie).
3 Conférence de Rio de Janeiro sur
l'environnement et le développement à l'issue de laquelle fut
adopté l'agenda 21
4. . S. ITOUROU SONGUE La thématique de
l'environnement dans la jurisprudence de la cour internationale de justice,
IRIC - Master II , 2011.
5. O. Borskovic , L'efficacité du droit de
l'environnement, mise en oeuvre et sanctions, préface, juillet 2010.

Ière PARTIE : LA SANCTION PENALE, UNE NOTION
COMMUNE AUX DROITS CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS

7

8
Le droit, le dit-on très souvent, est l'ensemble des
règles qui régissent les rapports entre les personnes vivant en
société et le respect de ces règles est assuré par
l'autorité publique qui en cas de non-respect ou de violation de ces
règles a le pouvoir de sanctionner. C'est à ce titre que le droit
pénal intervient pour réprimer les comportements antisociaux afin
de rétablir l'ordre qui a été troublé. Le droit
pénal est donc la branche du droit qui détermine quelles sont les
conduites antisociales et en quoi consiste la réaction de la
société contre ces divers comportements6. Cette
définition nous permet de retenir deux mots clés qui constituent
l'essence du droit pénal à savoir la conduite antisociale qui
cause un dommage a la société et la réaction de la
société qui consistera à infliger une sanction à
l'auteur de la conduite antisociale. Ainsi, l'infraction et la sanction sont
deux notions essentielles du droit pénal.
Grâce aux progrès scientifiques et techniques et
à l'avènement de la mondialisation, on assiste depuis plus
à l'émergence de plusieurs disciplines et inéluctablement
à la subdivision de différentes disciplines du droit. A ce titre,
plusieurs disciplines découlent et se sont détachées du
droit pénal à savoir le droit pénal des affaires, le droit
pénal international, le droit pénal spécial, etc. A la fin
des années 60, la communauté internationale a pris conscience des
dangers qui menaçaient la nature car s'étant rendue compte que
les ressources naturelles n'étaient pas inépuisables et qu'il
fallait veiller à la sauvegarde de l'environnement. Fort de ceci, chaque
Etat s'est doté d'une législation afin de garantir la sauvegarde
de l'environnement. Le Cameroun et la France se sont inscrits dans cette
logique en instaurant un cadre juridique en la matière.
Désormais, le droit de l'environnement va établir les
règles applicables à la gestion et à la protection de
l'environnement. En outre depuis les années 70, l'environnement a
progressivement fait l'objet d'une protection pénale spécifique
que ce soit en droit français ou en droit camerounais. La
répression pénale des atteintes à l'environnement s'est
vue comme moyen efficace de renforcement de l'effectivité et de
l'efficacité du droit de l'environnement. C'est cette protection accrue
de l'environnement qui nous permet de nous rendre compte que la sanction
pénale est une notion commune aux droits de l'environnement camerounais
et français. Cette reconnaissance de la sanction comme moyen de
renforcement de l'efficacité du droit de l'environnement (chapitre II)
nous amène au préalable à étudier le concept de
sanction pénale en droit de l'environnement (chapitre I).
6 www
cours-de-droit.net.
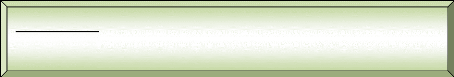
CHAPITRE I : LE CONCEPT DE SANCTION PENALE EN DROIT
DE L'ENVIRONNEMENT

9
Le terme "concept" est généralement
employé lorsqu'on veut définir une notion. Ainsi, envisager le
concept de « sanction pénale » en droit de l''environnement
nous amène à le définir, déterminer ses
caractéristiques et ses fonctions. Le droit de l'environnement est une
discipline évolutive. A l'origine on est parti d'un droit
éducateur-sensibilisateur à un droit coercitif dont le
non-respect est susceptible d'entraîner une sanction pénale.
Ainsi, le droit de l'environnement français tout comme le droit de
l'environnement camerounais réprime les atteintes à
l'environnement et reconnaît la sanction comme moyen de renforcement de
cette répression. Dans cette perspective, l'émergence de la
sanction pénale comme moyen efficace de lutte contre la
dégradation de l'environnement a conduit au jaillissement d'une
discipline dont l'autonomie est controversée par une partie de la
doctrine (Section I). Malgré cette controverse doctrinale la
consécration de la sanction pénale en droits français et
camerounais de l'environnement est une réalité indubitable. En
effet, quelle est la raison d'être de la sanction pénale en droit
de l'environnement ? C'est là la finalité de la sanction
pénale en droit de l'environnement (Section II).
SECTION I : LA PROBLEMATIQUE DE L'AUTONOMIE DU DROIT
PENAL DE L'ENVIRONNEMENT
Le droit pénal de l'environnement est-il une branche du
droit de l'environnement ou alors une discipline entièrement à
part ? En d'autres termes, la question de l'autonomie du droit pénal de
l'environnement revient à se demander si le droit pénal de
l'environnement est un droit autonome vis-à-vis des autres disciplines
juridiques, c'est-à-dire dépendant de celles-ci ou s'il se suffit
à lui-même. C'est cette préoccupation qui depuis plus d'une
décennie divise la doctrine, car certains auteurs estiment qu'elle est
une discipline juridique totalement indépendante, tandis que d'autres
auteurs estiment que les critères de l'autonomie ne sont pas tous
réunis (Paragraphe I). Face à ceci, nous allons tenter de donner
notre avis en militant en faveur de la thèse intermédiaire qui
selon nous mérite d'être retenue (Paragraphe II).

10
Paragraphe I : La controverse doctrinale
La controverse doctrinale qui anime le problème de
l'autonomie du droit pénal de l'environnement amène à
ressortir deux courants doctrinaux à savoir d'une part le courant
doctrinal positiviste (A) et d'autre part le courant doctrinal
négativiste (B).
A- La thèse positiviste
Selon la thèse positiviste, le droit pénal de
l'environnement est une discipline autonome car elle comporte les propres
règles, objectifs et méthodes. C'est une discipline originale
dont l'autonomie fonctionnelle est dévoilée. L'objet du droit
pénal de l'environnement est clair et précis, c'est celui de la
répression pénale des atteintes à l'environnement. Cela
revient à dire que le droit pénal de l'environnement intervient
dès lorsqu'un acte contraire aux objectifs du droit de l'environnement
et du développement durable à en commis. C'est donc un droit
« sanctionnateur ». Selon la thèse positiviste, le droit
pénal de l'environnement est une discipline complètement
indépendante des autres disciplines juridiques en l'occurrence le droit
de l'environnement et le droit pénal général ou le droit
pénal spécial dont elle tire ses principales origines. Il est
vrai que depuis une vingtaine d'années, le droit pénal de
l'environnement connaît un essor considérable et cet ensemble de
choses réconforte les adeptes de la thèse positiviste car le
régime de la responsabilité pénale en matière
environnementale est clairement distinct de celui des autres formes de
responsabilité (responsabilité en droit pénal des
affaires, responsabilité en droit pénal général,
etc....). C'est la raison pour laquelle un auteur affirme aisément que
« le droit pénal de l'environnement constitue une discipline
autonome puisqu'elle présente ses propres particularités au plan
pratique »7.
De tout ce qui précède, il ressort que la
thèse positiviste met en relief l'autonomie théorique du droit de
l'environnement. Cependant, elle comporte des limites car la mise en oeuvre du
droit pénal de l'environnement ne peut se faire qu'avec l'intervention
du droit de l'environnement et/ou du droit pénal général
autrement dit, on ne saurait parler du droit pénal de l'environnement
sans droit de l'environnement et sans droit pénal général
ce qui fait gagner du terrain à la thèse négativiste.
7 P. F. MERCURE, Rapport de l'AHJUCAF,
clôture des débats sur le droit pénal de l'environnement.
Actes de Porto Novo, Bénin, 2008, p.96.

11
B- La thèse négativiste
Selon la thèse négativiste, le droit
pénal de l'environnement n'est qu'une branche du droit de
l'environnement et ne saurait être une discipline autonome. Le droit
pénal de l'environnement existe parce que le droit de l'environnement
l'a prévu. A titre d'exemple, si le code de l'environnement
réprime le déversement des objets toxiques dans l'eau, c'est
parce que le droit à un environnement sain a été
consacré par la quasi-totalité des systèmes juridiques
pour parodier un auteur « A quoi sert la répression en
matière d'environnement si ce n'est qu'à assurer
l'effectivité de la norme ?»8 Car « La
répression et plus largement la sanction est en effet de nature à
favoriser l'effectivité de la norme9 ». Ainsi le droit
pénal de l'environnement intervient pour renforcer l'efficacité
du droit de l'environnement, le droit pénal de l'environnement n'est
qu'une conséquence logique du droit de l'environnement autrement dit
c'est une prolongation de celui-ci car selon Jacques MOURGEON la punition
permet d'éviter la violation de la règle de droit « soit
à priori par l'impact intimidant qu'elle produit soit à
posteriori, en réduisant les possibilités de la renouveler
». La thèse négativiste réduit donc le droit
pénal de l'environnement à un simple moyen de
concrétisation du droit de l'environnement qui vise
l'amélioration de la protection de l'environnement, la garantie d'un
environnement sain, équilibré et respectueux de la santé
de tous.
De tout ce qui précède, il ressort que le droit
pénal de l'environnement n'est pas une discipline autonome car selon les
négativistes, elle ne vise que la répression des attitudes
contraires à la norme environnementale qui édicte les lignes de
conduite à suivre. Toutefois, ces arguments sont certes convaincants
mais comportent des limites car la mise en oeuvre du droit pénal de
l'environnement révèle certaines spécificités qui
n'appartiennent ni au droit pénal général, ni au droit de
l'environnement. Face à ceci, il convient d'adopter une solution
intermédiaire qui intègre à la fois la thèse
positiviste et la thèse négativiste.
Paragraphe II : La thèse intermédiaire
Face à la controverse doctrinale soulevée par
l'existence du droit pénal de l'environnement, il apparaît que
l'existence du droit pénal de l'environnement est une
réalité indubitable malgré sa douloureuse parturition. En
revanche, le problème de son autonomie fait couler beaucoup d'encre car
certains auteurs confirment son autonomie pendant que d'autres la remettent en
cause. Face à ceci, la sagesse juridique nous suscite à adopter
une
8 J. BETAILLE, Revue juridique de l'environnement,
volume 39, 2014, p.47.
9 . J. BETAILLE. Op.cit, p.47.

12
position intermédiaire. Il nous revient donc de
présenter l'exposé et le contenu de notre thèse
intermédiaire (A) avant d'en analyser la portée (B).
A- Le contenu de la thèse
intermédiaire
La thèse intermédiaire que nous tenterons
d'exposer dans les lignes qui suivent nous permet de trancher le débat
en réalisant le juste milieu entre la thèse positiviste et la
thèse négativiste. Selon vous, l'autonomie du droit pénal
de l'environnement doit être admise mais sous certaines conditions.
En effet, la répression pénale sur
l'environnement tend à s'internationaliser10. Compte tenu du
contentieux abondant en matière environnementale et des plaintes qui
affluent devant les juridictions internationales11. Cet état
de choses fait que l'autonomisation du droit pénal de l'environnement
doit apparaître comme une nécessité impérieuse et
pour y parvenir, le droit pénal de l'environnement doit avant tout
reconnaître qu'il ne peut pas exister sans le droit de l'environnement
car ce dernier constitue sa principale source. En outre en l'état actuel
du droit, aucun pays n'a conçu ou adopté un « code
pénal de l'environnement » ou alors un instrument juridique
similaire, les infractions environnementales sont contenues dans les lois
relatives à l'environnement et les lois spéciales telles que les
lois sur l'eau, la protection de la nature12 etc.... Cet état
de choses contribue à embrigader le droit pénal de
l'environnement qui pour gagner son autonomie doit au préalable disposer
d'un instrument juridique qui lui est propre à savoir le « code
pénal de l'environnement » ou « code répressif de
l'environnement », ce qui permettrait d'avoir plus de visibilité
sur la répression pénale des atteintes à l'environnement
car la disparité des textes peut être source
d'insécurité juridique et pour le faire, il faut trouver le juste
milieu entre les infractions écologiques et les infractions qui rentrent
dans le cadre de la violation d'un règlement
administratif13.
10 M. PRIEUR, Actes de Porto Novo lors de la
clôture des débats de l'AHJUCAF, Bénin 2008.
11 Affaire du Probo Koala voir le rapport d'Amnesty
international « Côte d'Ivoire, une vérité toxique
à propos de Trafigura, du Probo Koala et du déversement de
déchets toxiques en Côte d'Ivoire » (2012),
téléchargeable sur le site d'Amnesty International, Affaire
Dubrovnik (Tribunal Pénal International 18 mars 2004). Au plan
régional, la CJCE en septembre 2006 a consacré le droit
pénal européen comme nécessaire à
l'effectivité du droit matériel de l'environnement consacrant
ainsi l'autonomie, du droit pénal de l'environnement dans le cadre des
traités européens.
12 Le code de l'environnement français
comporte des dispositions pénales tout comme la loi cadre du Cameroun
relative à l'environnement.
13 Lors de la clôture des débats de la
réunion de Porto Novo au Bénin, le Professeur Michel .PRIEUR
s'est posé la question de savoir si on peut parler de droit pénal
de l'environnement quand celui-ci réprime seulement la violation d'un
règlement administratif.

13
Bien plus, le droit pénal de l'environnement doit se
doter de principes rigoureux et efficaces qui permettront de mieux faire
asseoir son indépendance par exemple, être capable d'engager la
responsabilité pénale de l'Etat même si dans bon nombre
d'Etats, l'Etat est généralement considéré comme
« pénalement irresponsable ». En outre, le droit pénal
de l'environnement doit réprimer et sanctionner dès lors que
l'acte a été réalisé (actus reus)
indépendamment des éléments de la « mens rea
»14.
Tout ce qui précède nous permet de ressortir de
façon ramassée et à vol d'oiseau le contenu de notre
thèse intermédiaire. Il apparaît que l'autonomie du droit
pénal de l'environnement est à relativiser car, il puise ses
sources dans plusieurs disciplines juridiques (droit pénal
général, droit de l'environnement, droit administratif, etc...).
Bien plus, le droit pénal de l'environnement doit s'armer de moyens
appropriés afin de concrétiser son autonomie, face à ceci
qu'elle peut être la portée de notre thèse
intermédiaire ?
B- La portée de la thèse
intermédiaire
La portée de la thèse intermédiaire doit
être envisagée sur un plan théorique et sur un plan
pratique.
Sur le plan théorique, il ressort que
l'interdépendance entre le droit de l'environnement et le droit
pénal de l'environnement est incontestable et de ce fait, on ne saurait
parler de droit pénal de l'environnement sans droit de l'environnement
et vice versa car si le droit pénal de l'environnement existe, c'est bel
et bien pour sanctionner tout acte anti écologique. En outre, le droit
de l'environnement ne saurait se substituer au droit pénal de
l'environnement car chacune de ces disciplines disposent d'un objet et d'une
méthode qui leurs sont propres. A titre d'illustration, le droit
pénal de l'environnement vise la répression des atteintes
à l'environnement tandis que le droit de l'environnement édicte
l'ensemble des conduites à tenir afin de préserver
l'intégrité de l'environnement. Pour faire simple, on peut dire
que le droit pénal de l'environnement et le droit de l'environnement
interviennent à des étapes différentes car si le droit de
l'environnement intervient « à priori » ou « en amont
» pour sensibiliser, informer ou renseigner sur l'état de
l'environnement, le droit pénal de l'environnement quant à lui
intervient « à posteriori » ou « en aval » pour
sanctionner les atteintes perpétrées contre l'environnement.
C'est donc un droit sanctionnateur.
14« Mens rea » est le terme latin signifiant l'esprit
criminel, l'intention coupable.

14
Sur le plan pratique, la mise en oeuvre du droit pénal
de l'environnement ne se fera pas comme en droit pénal
général, car si le juge ou la loi admet des circonstances et des
excuses atténuantes ça ne sera pas forcément le cas en
droit pénal de l'environnement dont le régime est plus ou moins
strict. Le juge pénal devra s'armer de beaucoup de délicatesse
afin de ne pas heurter la sensibilité du droit de l'environnement.
De tout ce qui précède, il ressort que la
thèse intermédiaire nous permet de mieux cerner les contours de
la notion de l'autonomie du droit pénal de l'environnement. Il en
ressort que l'autonomie du droit pénal de l'environnement peut
être établie si les conditions énumérées dans
les paragraphes précédentes sont remplies. Toutefois si
l'autonomie du droit pénal de l'environnement tergiverse ce n'est pas le
cas pour la sanction pénale qui en droit de l'environnement
connaît un essor considérable. Quelle est donc la finalité
de la sanction pénale en droit de l'environnement ?
SECTION II : LA FINALITE DE LA SANCTION PENALE EN DROIT
DE
L'ENVIRONNEMENT
Parler de la finalité de la sanction pénale en
droit de l'environnement revient à identifier quel est le but de la
sanction pénale. En d'autres termes quel est l'objectif recherché
par le droit de l'environnement lorsqu'il consacre la sanction pénale.
Pour aller plus loin, on peut même parler de l'utilité de la
sanction pénale en droit de l'environnement. In limine litis, il faut
signaler que la sanction pénale n'est pas un moyen pour les uns de se
venger des autres15, Car la sanction pénale remplit les
fonctions de rétribution, d'intimidation et de réadaptation ; ce
trio constitue ce qu'il est convenu d'appeler les « fonctions classiques
» de la sanction pénale car ces fonctions sont communes quelle que
soit la branche du droit pénal dans laquelle on se trouve (droit
pénal des affaires, droit pénal du travail, droit de l'entreprise
etc...) (Paragraphe I). A côté des fonctions classiques de la
sanction pénale, il convient également d'identifier les fonctions
qui sont spécifiques au droit pénal de l'environnement. C'est ce
que nous avons identifié comme étant les finalités
spécifiques de la sanction pénale en droit de l'environnement
(Paragraphe II).
15 S.B. OUATTARA., Sanction pénale,
Université de Bamako, mémoire de maîtrise en droit,
carrières judiciaires 2009.

15
Paragraphe I : Les finalités traditionnelles de la
sanction pénale
La finalité traditionnelle ou classique de la sanction
pénale est celle qui est instituée par le droit pénal
général. Les fonctions de rétribution, de
réadaptation et d'intimidation de la sanction pénale sont
reconnues par la quasi-totalité des systèmes juridiques au point
où on se demande s'il n'est pas judicieux de les ériger au rang
de « principes généraux du droit ». Nous allons dans un
premier temps analyser les formations d'intimidation et de rétribution
de la sanction pénale (A) puis dans un second temps, nous examinerons la
fonction de réinsertion de la sanction pénale (B).
A- Les fonctions d'intimidation et de
rétribution de la sanction pénale
La sanction pénale le dit-on très souvent, est
la réaction de la société contre l'auteur d'un
comportement réprimé. Ainsi, la sanction pénale
protège les intérêts de la société en
sanctionnant l'auteur d'une infraction. Par conséquent, celui qui a subi
une sanction une première fois hésitera à commettre
à nouveau une infraction ; c'est ce qu'on appelle fonction
d'intimidation qui dans un premier temps peut être individuelle ou
collective : En réprimant un acte, le droit pénal prévient
quiconque tentera de commettre une infraction qu'il s'expose à une
punition plus au moins sévère. La sanction pénale permet
d'avertir et de prévenir la société. L'adage latin16selon
lequel « nemo censetur ignorare lege » trouve tout son sens ici. En
résumé, intimidation renvoie à avertissement,
prévention, pression, chantage.
S'agissant de la fonction rétributive de la sanction
pénale, elle revient à exprimer le châtiment que la
société réserve à celui qui a commis une
infraction, le délinquant récoltant ce qu'il a semé. C'est
pourquoi l'on estime généralement que la sanction infligée
au délinquant soit proportionnelle à l'acte qu'il a
posé.
A côté des fonctions d'intimidation et de
rétribution de la sanction pénale, il convient également
d'ajouter la fonction d'élimination de la sanction pénale car
bien qu'ayant disparu en droit pénal français, elle subsiste
encore en droit pénal camerounais17 ; elle vise à
ôter la vie au délinquant dans les cas les plus extrêmes.
De tout ce qui précède, il ressort que les
fonctions d'intimidation et de rétribution de la sanction pénale
en droit de l'environnement valent leurs pesant juridique car elles visent
à
16En français « nul n'est censé
ignorer la loi ».
17 A titre d'illustration, l'article 4
alinéa 1 de la loi N°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur
les déchets toxiques et dangereux puni de la peine de mort toute
personne non autorisée qui procède à l'introduction,
à la production, au stockage, à la détention au transit ou
au déversement sur le territoire camerounais des déchets toxiques
et ou dangereux sous toutes leurs formes.

16
empêcher ou dans le cas extrême à
réprimer les atteintes à l'environnement et le droit de
l'environnement camerounais va même jusqu'à éliminer le
délinquant lorsque celui-ci a commis à un acte
considéré comme intolérable. Quid de la fonction de
réinsertion de la sanction pénale ?
B- La fonction de réinsertion de la sanction
pénale
La fonction de réinsertion de la sanction pénale
vise la resocialisation du délinquant. En effet, lorsque le juge
sanctionne un délinquant, ce dernier subit la peine qui lui a
été infligée et à l'issue de sa condamnation, l'on
estime que le délinquant a suffisamment pris conscience de ses erreurs
et que cette condamnation aura permis de façonner un homme meilleur et
sociable. Ainsi, l'on peut dire que la sanction pénale conduit à
une fonction d'amendement en ce sens qu'elle amène le délinquant
à éprouver un sentiment de regret compte tenu des
dégâts matériels, physiques, psychologiques, financiers ou
écologiques qu'il a causé à la société.
La fonction de réinsertion sociale du délinquant
vise à restaurer l'harmonie entre le délinquant qui avait
été mis hors d'état de nuire pendant un certain temps et
la société qui le considérait comme dangereux, de
manière simple, on peut dire que la sanction pénale remplit une
fonction symbolique de cohésion sociale. La réinsertion sociale
confère à la peine une action positive sur les individus car elle
produit un effet thérapeutique sur ceux-ci ; le rejet de la
rétribution traduit la volonté du législateur à ce
que la sanction soit tournée vers l'avenir.
Tout ce qui précède ressort les principales
fonctions de la sanction pénale, nous n'avons pas envisagé
d'étudier la fonction de réparation à la victime parce que
nous estimons qu'elle n'est pas prééminente ici, car
l'environnement est un bien d'intérêt général, il
appartient à tout le monde et à personne en même temps.
C'est cette spécificité du droit de l'environnement qui nous
amène à envisager les fonctions spécifiques de la sanction
pénale en droit de l'environnement.
Paragraphe II : Les fonctions spécifiques de la
sanction pénale en droit de l'environnement
La spécificité du droit de l'environnement
génère également des particularités dans son
domaine répressif. En effet, le droit de l'environnement est né
pour contribuer à la sauvegarde de la nature et des
écosystèmes et pour ce faire, la sanction pénale joue un
grand rôle car elle remplit une finalité économique (B) et
une finalité sociale (A).

17
A. La finalité sociale de la sanction
pénale en droit de l'environnement : la remise en état des
lieux
Elle se traduit par la fonction de restauration ou des
atteintes en état de lieux. Lorsque des atteintes ont été
perpétrées contre l'environnement, le droit pénal de
l'environnement ne se contente pas seulement de punir le délinquant en
lui infligeant une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende, le juge va
généralement plus loin ; c'est le cas lorsqu'une forêt a
été illégalement détruite, le juge pénal
ordonne un reboisement afin de faire régénérer la
forêt.
De même en matière d'installations
classées, l'entreprise qui déverse des déchets polluants
pour l'environnement a l'obligation de mettre tout en oeuvre pour faire
disparaître les déchets toxiques ayant endommagé
l'environnement. C'est ainsi qu'en France en matière d'ICPE l'obligation
de remise en état des lieux pèse sur l'exploitant18. A
ce sujet, la jurisprudence a admis que cette obligation n'était pas
assortie d'une prescription extinctive car elle est maintenue
indépendamment de l'abrogation d'un acte administratif ayant
autorisé l'exploitation19. En droit camerounais en
matière de déchets, l'article 5 de la loi N°89/027 du 29
décembre 2989 portant sur les déchets toxiques et dangereux est
ferme : « la juridiction saisie ordonnera à toute personne reconnue
coupable d'avoir introduit, stocké, détenu, transporté,
fait transiter ou déversé des déchets toxiques et/ou
dangereux, de les éliminer immédiatement et de restituer les
lieux en leur état antérieur ». Cela renvoie clairement
à l'idée selon laquelle la décision de remise en
état des lieux n'est qu'une conséquence logique ou
prononcée de la sanction pénale par le juge et que celui-ci ne
saurait exempter le délinquant de cette obligation.
De tout ce qui précède, il ressort que la remise
en état des lieux n'est qu'un prolongement de la sanction pénale
et cette obligation de remise en état des lieux ne peut être
établie que si la responsabilité pénale de l'auteur de
l'infraction a été constatée. La
« restitutuo in integrum » a ainsi été
érigée comme principe aussi bien en droit camerounais
qu'en
droit français (restitution intégrale). Qu'en est-il de la
fonction économique de la sanction pénale en droit de
l'environnement ?
B. La fonction économique de la sanction
pénale en droit de l'environnement
Elle se traduit par la présence des peines d'amendes.
En effet, en matière de responsabilité pénale des
personnes morales, il est matériellement impossible de prononcer
18 Art. LS12-17 du code de l'environnement.
19 CAA Bordeaux 3 juin 2014.

18
une peine privative de liberté contre une
société, c'est pourquoi le législateur instaure
généralement de fortes peines d'amende à l'encontre des
personnes morales. A titre d'illustration, au Cameroun en matière ICPE,
le montant de l'amende peut aller jusqu'à deux millions de francs CFA
lorsqu'une personne exploite un établissement classé sans
autorisation ou déclaration préalable20. La sanction
pénale joue un rôle économique car le paiement d'une amende
permet de compenser les dommages subis par l'environnement sur le plan
économique. La prégnance des sanctions pécuniaires en
droit de l'environnement marque le déclin de la peine d'emprisonnement
car cette dernière ne possède plus aux yeux du plus grand nombre
les « vertus quasi thérapeutiques voire religieuses que les
spécialistes de la science criminelle lui reconnaissaient au
XIXème siècle... »21.
De tout ce qui précède, il ressort que la
sanction pénale remplit également une finalité
économique car les sanctions pécuniaires constituent une forme de
dommages intérêts compensatoires pour l'environnement car ce sont
les montants versés qui permettent le plus souvent de réhabiliter
les sites pollués surtout dans les PVD comme le Cameroun où les
enjeux de développement durable sont plus énormes.
En tout état de cause, si la notion de sanction
pénale a toujours été considérée comme une
notion polysémique22. Cela ne lui ôte pas ses
finalités qui sont pratiquement les mêmes en droit camerounais
qu'en droit français (à l'exception de la fonction
d'élimination de la sanction pénale qui a été
supprimée en droit français). C'est à juste titre que nous
pouvons affirmer que la sanction pénale est reconnue par les droits
camerounais et français comme moyen efficace de répression des
atteintes à l'environnement.
20 Art 34 de la loi du 14 Juillet 1998 relative aux
établissements classés, insalubres ou incommodes.
21 D. GAILLARDOT, « Les sanctions pénales
alternatives », RIDC, Numéro 2, volume 46, 1994, p.683.
22 M.Van de KERCHOVE, « Les fonctions de la
sanction pénale » ; Informations sociales N° 127, CNAF, 2005,
p.22.

CHAPITRE II : LA RECONNAISSANCE DE LA SANCTION
PENALE
COMME MOYEN EFFICACE DE REPRESSION DES ATTEINTES
A
L'ENVIRONNEMENT

19
Au fil des années, la sanction pénale s'est
intégrée en droit de l'environnement au point où elle
apparaît désormais comme une condition d'efficacité de la
norme environnementale car que ce soit en droit français ou en droit
camerounais, la plupart des prescriptions législatives et
règlementaires sont assorties de sanctions pénales. Ce recours
à la sanction pénale baptisée par la doctrine comme
étant un « arme pénale »23 s'avère
désormais comme une nécessité impérieuse pour la
sauvegarde de l'environnement. Ce que confirme les instances internationales
notamment le conseil de l'Europe24. En ce qui concerne la France,
cette reconnaissance de la sanction comme moyen de lutte contre la
dégradation de l'environnement découle du code pénal qui
réprime les atteintes aux intérêts fondamentaux de la
nation au rang desquels l'environnement25. Quant au droit
camerounais, il est moins explicite en ce qui concerne la sanction
pénale, mais les dispositions du préambule de la constitution
camerounaise et du code pénal camerounais26 manifestent
timidement la volonté du gouvernement camerounais à
reconnaître la sanction pénale comme moyen efficace de protection
de l'environnement. C'est donc à juste titre que
l'intégrité de l'environnement préoccupe constamment la
communauté internationale (Section I) et bien plus, le processus
d'enracinement de la sanction pénale en droits français et
camerounais est en voie d'achèvement (Section II).
SECTION I : LA PRESERVATION DE L'INTEGRITE DE
L'ENVIRONNEMENT : UNE PREOCCUPATION CONSTANTE DE LA COMMUNAUTE
INTERNATIONALE
Maintenir l'intégrité de l'environnement pour
assurer la santé, la sécurité des populations et
l'équilibre des écosystèmes n'a jamais été
une tâche facile, c'est pourquoi
23 D. ROETS, Cours de droit comparé de
l'environnement, le droit français partie 4, la responsabilité
pénale, Université de Limoges, Master II, 2014-2015.
24 Dans le cadre de la convention sur la protection
de l'environnement par le droit pénal adopté le 04 novembre 1998
à Strasbourg.
25 Art. 410-1 du code pénal français.
26 Préambule de la constitution du 18
Janvier 1996 modifiée par celle du 14 Avril 2008, et Art. 261 du code
pénal qui réprime la pollution.

20
plusieurs conférences internationales ont
été organisées à cet effet27. Car l'on
estime qu'en coordonnant et en unissant les efforts réalisés par
chaque pays, l'on peut aboutir à une situation tout à fait
satisfaisante. Il y va de l'intérêt de tous car il ne fait aucun
doute que l'environnement est un patrimoine commun de l'humanité
(Paragraphe I) et qu'en tant que tel il est la pierre angulaire ou au mieux le
noyau dur du développement durable (Paragraphe II).
Paragraphe I : La reconnaissance de l'environnement comme
un patrimoine commun de l'humanité
Avec le temps, l'on s'est rendu compte que les ressources
naturelles n'étaient pas inépuisables et qu'il fallait
nécessairement veiller à leur sauvegarde. Selon la Charte
mondiale de l'environnement : « le patrimoine commun est constitué
de l'ensemble des éléments matériels et immatériels
qui concourent à maintenir et développer l'identité et
l'autonomie de chacun dans le temps et dans l'espace. Le patrimoine commun
n'est donc pas quelque chose de figé et s'adapte au fil du temps. C'est
une notion qui sous-tend la responsabilisation à l'égard de
l'environnement et la réparation des dommages qui lui sont portés
». Il ressort de cette définition que le patrimoine commun n'est
pas défini d'une façon précise mais cette notion est
reconnue en droits de l'environnement camerounais et français et
intègre les éléments comme la forêt, l'eau, les
espèces animales et végétales, les sites et paysages comme
faisant partie du patrimoine commun de la nation d'où la
nécessité de veiller à leur protection et le cas
échéant à sanctionner tout manquement à cette
protection car il faut le dire, la terre est un objet de convoitise depuis
belle leurette (A) et bien plus le droit de l'environnement est reconnu comme
une valeur universelle (B).
A- La « terre » : objet de désirs
immodérés ?
La terre regroupe toute l'ensemble des éléments
nécessaires à la vie et à la survie de l'homme. Les
progrès scientifiques et techniques du XIXème
siècle ont amené l'industrialisation avec tout ce que cela
comporte à savoir l'amélioration du bien matériel de
l'homme mais aussi les pollutions et catastrophes ; tout ceci a
contribué à inquiéter la communauté internationale
car comme le souligne un auteur « l'urbanisation galopante, l'agriculture
intensive et l'industrialisation débridée ne font qu'engendrer
une aggravation des pollutions et multiplier les déchets
»28, les déséquilibres écologiques
provoqués par les
27 Notamment, la conférence de Stockhohn en
1972 sur l'environnement, la conférence de Rio de 1992 sur
l'environnement et le développement, la conférence de
Johannesburg de 2002 baptisée Rio +10.
28 C. BERGER, J. L. ROCQUES, La terre comme objet
de convoitise, appropriation, exploitation, dégradation, l'Harmattan,
2008, Paris, p.10.

21
activités de l'homme ainsi que de divers sondages
montrent que pour 90% des individus interrogés, la préservation
de l'environnement est une préoccupation majeure29. Face
à ceci que peut faire la sanction pénale ? A cette question, nous
renvoyons à la section II du chapitre précédent qui nous a
permis d'être suffisamment éclairé sur les fonctions ou
plutôt la finalité de la sanction pénale en droit de
l'environnement, ce qui nous permet de garder une lueur d'espoir contrairement
à certains auteurs qui ont une vision pessimiste du droit de
l'environnement au point où ils ne sont pas loin d'annoncer l'apocalypse
lorsqu'ils déclarent que malgré les divers appels et certaines
prises de conscience,« rien ne semble changer, la situation continue
à empirer lentement mais sûrement »30.En tout
état de cause, l'universalisation du droit de l'environnement est une
réalité indéfectible.
B- L'acceptation de la sanction pénale comme une
valeur universelle
L'universalisation est l'action de rendre universel, commun
à tous les hommes, répandre partout31. Nous avons
choisi d'employer le mot universalisation pour montrer à quel point les
exigences environnementales préoccupent tous les Etats du monde peu
importe leur niveau de développement. L'adoption de la convention sur la
protection de l'environnement par le droit pénal montre à
suffisance le degré d'inquiétude des Etats face aux questions
environnementales.
La sanction pénale est un moyen de neutraliser «
l'incivisme environnemental » présent dans la société
camerounaise tout comme dans la société française.
Désormais, tous les moyens employés pour lutter contre la
dégradation de l'environnement sont bons dès lorsqu'ils sont
efficaces, il faut agir car « la pollution atmosphérique qui
découle de l'utilisation des combustibles fossiles s'accompagne de
manifestations secondaires qui touchent plus ou moins gravement tous les
écosystèmes tant terrestres qu'aquatiques. C'est par exemple le
cas des précipitations acides qui affectent de nombreux lacs et
rivières et contribuent au dépérissement forestier
»32.
De tout ce qui précède, il ressort que la
sanction pénale comme nous l'avons dit plus haut permet aux droits
camerounais et français de renforcer l'efficacité du droit de
l'environnement car vu l'état des choses, le danger est imminent avec le
réchauffement climatique dont les conséquences et les
dégâts sont de plus en plus perceptibles.
29 C. BERGER, J. L. ROQUES Op.cit, p.11.
30 C. BERGER, J. L. ROQUES Op.cit, p.11.
31 www.
Cnrtl.fr/définition/universalisation.
32 M. et C. BEAUD et M. LARBI BOURGUERRA (Sous la
dir.),l'état de l'environnement dans le monde, la découverte,
fondation pour le progrès de l'homme, (F.P.H), (UNESCO), Avril 1993,
Paris).

22
Paragraphe II : La reconnaissance de l'environnement comme
instrument de promotion du développement durable
Le développement durable est une forme de
développement économique ayant pour finalité principale la
conciliation du bien-être économique et social avec la
préservation de l'environnement considéré comme un
patrimoine devant être transmis aux générations futures. Un
peu plus précise, la commission mondiale pour l'environnement et le
développement de l'ONU, la WCED33 dite "Commission
Brundtland"34 a défini le développement durable ainsi
: « le développement durable est un développement qui tient
compte des besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs... ». Cette
définition du développement durable nous permet de nous rendre
compte que l'environnement est une branche du droit du développement (A)
et que le renforcement de la protection de l'environnement par le droit
pénal de l'environnement permet de renforcer l'efficacité de
l'Agenda 21 (B).
A- La sanction pénale au secours du
développement durable
Le développement durable tel que défini est un
concept dont la réalisation ou la mise en oeuvre s'apparente à
priori à une sinécure mais la réalité est tout
à fait le contraire. Pendant longtemps, le droit pénal
était considéré comme une notion étrangère
au développement durable car la mise en oeuvre de celui-ci faisait appel
à des notions scientifiques, économiques et techniques (le
développement durable était beaucoup plus une affaire de
géographes et de scientifiques). Avec l'intégration progressive
du droit pénal en droit de l'environnement, une question lancinante
apparaît, c'est celle de savoir si le droit pénal demeure
étranger au développement durable. A cette question, nous
estimons qu'une réponse affirmative s'impose désormais car
l'importance des enjeux nécessite une présence des moyens
appropriés dont le droit pénal fait partie. Le respect des normes
environnementales est assuré par le droit pénal qui intervient
pour contrecarrer les dérives des personnes indélicates. A titre
d'exemple si le droit camerounais réprime l'exploitation
forestière illégale35, c'est justement pour garantir
la gestion durable des ressources naturelles dont la forêt fait partie.
En France, l'adoption des lois Grenelle montre son attachement au
développement durable. Le développement durable n'est plus un
simple engagement moral sans valeur contraignante. Le développement
durable
33World Commission on Environment and Development.
34 Ceci dû au nom de la présidente de
ladite commission, la norvégienne GRO HARLEM BRUNDTLAND.
35 Article 154 tiret 5 de la loi camerounaise
portant régime des forets, de la faune et de la pêche punit d'une
amende de 5 000 à 50 000 et d'un emprisonnement de dix jours ou de l'une
de ces deux peines seulement toute exploitation forestière
illégale.

23
est une valeur dont le respect s'impose à tous car il
est question d'assurer la survie de l'homme sur terre par conséquent
c'est « au droit pénal que la France a confié la sanction du
respect par les entreprises d'un dispositif visant à intégrer les
principes du développement durable à savoir assurer une meilleure
protection de la santé humaine et de l'environnement contre les risques
liés aux substances chimiques36.
De tout ce qui précède, il ressort que la mise
en oeuvre du développement durable fait intervenir plusieurs disciplines
parmi lesquelles le droit pénal. A ce titre, la sanction pénale
intervient donc pour renforcer sa mise en oeuvre et veiller au respect de
celui-ci. C'est pourquoi certains auteurs estiment que « la prise en
compte des principes de développement durable » s'impose à
tous sous peine dans certaines situations qui tendront très certainement
à se généraliser, de sanctions pénales
»37. C'est dans cette perspective que nous pouvons affirmer que
la sanction pénale permet le renforcement de la mise en oeuvre de
l'Agenda 21.
B- La sanction pénale en droit de
l'environnement : un moyen d'achèvement de la mise en oeuvre de l'Agenda
21
Le droit du développement ne doit pas se confondre au
droit au développement qui est un droit qui intègre les droits et
libertés publiques car le droit au développement est un droit de
l'homme. Alors que le droit du développement n'intègre pas
l'équilibre classique « liberté-ordre social
»38 qui se rompt automatiquement car le besoin d'ordre
l'emporte et de beaucoup, sur la nécessité d'accorder les
libertés. Ainsi, le droit du développement est une technique
juridique et un ensemble de méthodes de la législation propres
à sous-tendre le développement économique et
social39.
Les exigences environnementales permettent de rationaliser les
politiques en matière de développement et de veiller à la
satisfaction de tous, par exemple la liberté du commerce et de
l'industrie se trouve limitée par les exigences en matière de
droit des ICPE ; l'on estime que pour certaines activités, il faut
limiter le taux de production à un seuil raisonnable de façon
à ne pas faire peser des dommages aux populations car si la santé
de ceux-ci est comprise, cela mettrait en mal la politique du
développement d'un Etat quand on sait que la santé des
populations est une priorité en matière de développement
durable. C'est pour cela
36 J. MOGIN, E. DAOUD, « Le droit pénal
demeure-t-il étranger à la notion de « développement
durable ? » Rien n'est moins sûr ! », Pratiques et professions
N°10/2009-octobre 2009, p.403.
37 J. MOGIN et E. DAOUD, Op.cit. p.404.
38 K .MBAYE,Le droit au
développement, Ethiopiques(RNALP),Numéro 21,Janvier 1980,P.1
39 K. MBAYE, Op.cit P1.

24
que nous estimons que la sanction pénale permet le
renforcement de la mise en oeuvre de l'Agenda 21.
L'Agenda 21 est un ensemble de résolutions qui ont
été adoptées dans le but d'améliorer les conditions
de vie des populations notamment en ce qui concerne la conservation et la
gestion des ressources aux fins de développement. Selon l'Agenda 21, la
protection de l'environnement est d'une nécessité vitale pour les
populations. La sanction pénale est donc considérée comme
le « gendarme » ou alors le « garde du corps » de
l'environnement.
De tout ce qui précède, il ressort que la mise
en oeuvre de la politique environnementale nécessite l'emploi de grands
moyens et la sanction pénale en est à coup sûr l'un des
plus efficaces. Face à ceci, l'utilité de la sanction
pénale en droit de l'environnement n'est plus à démontrer.
Quelle serait donc la particularité de la sanction pénale en
droit de l'environnement par rapport à la sanction pénale en
droit pénal général ? La sanction pénale en droit
de l'environnement serait-elle plus sévère qu'en droit
pénal classique ? Ces questionnements nous amènent à
ressortir les axes d'enracinement de la sanction pénale en droits de
l'environnement camerounais et français.
SECTION II : LES AXES D'ENRACINEMENT DE LA SANCTION
PENALE
EN DROITS DE L'ENVIRONNEMENT CAMEROUNAIS ET
FRANÇAIS
Malgré la douloureuse parturition du droit pénal
de l'environnement, son existence est d'une importance capitale pour la
sauvegarde de l'environnement et pour s'implanter, la sanction pénale
emploie plusieurs façons. Dans les prochains paragraphes, nous tenterons
de montrer que la sanction pénale utilise les mêmes
procédés aussi bien en droit de l'environnement camerounais qu'en
droit de l'environnement français. Ceci se caractérise par
l'adoption au Cameroun comme en France des dispositions pénales
réprimant les atteintes à l'environnement (Paragraphe I). Bien
plus, la technique de l'aggravation est employée en droits camerounais
et français de l'environnement comme moyen de renforcement de
l'efficacité du la sanction pénale (Paragraphe II).

25
Paragraphe I : L'intégration des dispositions
spécifiques réprimant les atteintes à l'environnement en
droits camerounais et français
Au Cameroun comme en France, il n'existe pas du moins pour
l'instant un « code pénal de l'environnement » qui rassemble
toutes les infractions en matière environnementale. Les dispositions
réprimant des atteintes à l'environnement font
généralement l'objet d'une section, d'un titre, ou d'un chapitre
qui peut s'intituler « des infractions » ou alors des «
dispositions pénales ». Cette répartition disparate des
infractions en droit de l'environnement camerounais et français peut
être considérée comme l'un des traits
caractéristiques du droit pénal de l'environnement. De
manière classique, on répartit le droit de l'environnement en
trois branches à savoir le droit de la protection de la nature
(protection des espèces, des espaces et des paysages), le droit de
l'urbanisme et enfin le droit de la lutte contre les pollutions (pollutions de
l'eau, de l'air, du bruit, les ICPE) et sur cette base le Cameroun et la France
ont intégré dans les lois spécifiques adoptées par
leurs législateurs respectifs, des dispositions pénales visant
à assurer le respect de ces lois. Nous identifierons donc quelques
dispositions pénales contenues dans les lois relatives à la
protection de l'environnement en droit camerounais (A) et les dispositions
pénales relatives à la protection de l'environnement en droit
français (B).
A- Les dispositions pénales contenues dans les
lois relatives à la protection de l'environnement en droit
camerounais
Après son accession à la souveraineté en
1960, le Cameroun s'est doté d'un éventail juridique contribuant
à lui octroyé sa personnalité internationale. Le droit de
l'environnement camerounais s'est progressivement construit autour de la
thématique du développement durable. L'adoption en 1996 de la loi
N°96/12 du 05 Août 1996 portant loi cadre relative à la
gestion de l'environnement a contribué à bâtir un droit de
l'environnement autonome. Ainsi, la loi cadre relative à la gestion de
l'environnement au même titre que la quasi-totalité des lois
sectorielles contiennent toutes des dispositions pénales.
S'agissant de la loi de 1996 suscitée, les articles 79
à 87 portent sur la répression des atteintes à
l'environnement. A titre d'exemple, l'article 80 de la loi de 1996 punit d'une
amende de cinquante millions à cinq cent millions de francs CFA et d'une
peine d'emprisonnement à perpétué40 toute
personne qui introduit des déchets toxiques et ou dangereux sur le
territoire camerounais. Bien plus, la réalisation d'un projet sans
étude
40 Conformément aux dispositions de l'article
21 du CP camerounais c'est un crime.

26
d'impact alors que celui-ci nécessitait une
étude d'impact est sévèrement sanctionnée en droit
de l'environnement camerounais41 au même titre que
l'importation, la production, la détention et/ou l'utilisation des
substances nocives ou dangereuses en violation des dispositions
légales42.
Quant aux lois sectorielles en matière d'environnement,
elles sont nombreuses au rang desquelles on peut citer la loi relative au
régime des forêts, de la faune et de la flore43, la loi
portant code gazier44, le code minier45, la loi relative
à l'urbanisme46, la loi portant régime de l'eau47, la
loi sur les ICPE48, la loi relative à la gestion des déchets
toxiques et dangereux49, la loi relative à
l'électricité50 et bien d'autres. Ces lois comportent
des dispositions pénales parmi lesquelles on peut citer l'article 34 de
la loi sur les ICPE qui punit d'une amende de cinq cent mille à deux
millions de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de six mois à un
an ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui continue
l'exploitation d'un établissement dont la fermeture a été
ordonnée, l'article 124 de la loi sur l'urbanisme réprime le
non-respect des règles en matière d'alignements et de servitudes
publiques, la violation de l'obligation de présenter un permis de
construire ou d'implanter. Ces dispositions pénales ne sont que quelques
exemples parmi tant d'autres. En tout état de cause, le
législateur camerounais a consacré deux peines principales en
droit pénal de l'environnement à savoir l'emprisonnement et
l'amende et plusieurs peines complémentaires à savoir les
déchéances, la fermeture d'établissement, la publication
du jugement, etc...
De tout ce qui précède, il ressort que la
sanction pénale occupe une place de choix en droit de l'environnement
camerounais. Quid du droit français ?
41 Art.79 de la loi cadre relative à la gestion
de l'environnement au Cameroun.
42Art. 81 de la loi cadre relative à la
gestion de l'environnement délité punit d'une amende de dix
à cinquante millions de francs CFA et d'une peine d'emprisonnement de
deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
43 Loi N° 94/01du 20 Janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche.
44 Loi N° 2002/013du 30 décembre 2002
portant code gazier.
45 Loi N° 001-2001du 16 Avril 2001portant code
minier.
46 Loi N° 2004/003du 21Avril 2004
régissant l'urbanisme au Cameroun.
47 Loi N°98/005 du 14 Avril 1998 portant
régime de l'eau
48 Loi N° 98/015 du 14 Juillet 1998 relative aux
établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
49 Loi N° 89/027 du 29 décembre 1989
portant sur les déchets toxiques et dangereux.
50 Loi N° 2011/022du 14 décembre 2011
régissant le secteur de l'électricité au Cameroun.

27
B- Les dispositions pénales contenues dans les
lois relatives à la protection de l'environnement en droit
français
En droit français, les dispositions pénales
relatives à la répression des atteintes à l'environnement
sont contenues dans plusieurs textes en l'occurrence le code de
l'environnement, la loi sur les ICPE51, le code de l'urbanisation,
le code minier52, la loi relative au bruit53, la loi
relative aux déchets, à l'air, à l'eau et bien d'autres. A
titre d'exemple, l'article 332-25 du code de l'environnement punit d'une peine
d'emprisonnement de six mois et de 9000 euros d'amende les infractions aux
dispositions des articles L 332-6, L332-7, L332-9, L 332-17 et 332-18 relatives
à la constitution, à la protection et au déclassement des
réserves naturelles. Il en est ainsi du fait de ne pas respecter les
prescriptions des périmètres de protection prévues
à l'article L 332-17, du fait de détruire ou de modifier dans
leur état ou dans leur aspect les territoires classés en
réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L
332-17. Bien plus, l'article L 1163-2 punit d'une amende de 1200 euros par
hectares exploité le fait pour les propriétaires de ne pas
respecter les dispositions prévues à l'article L 124-6 relative
à la reconstitution d'une forêt après coupe. En plus des
dispositions contenues dans le code de l'environnement, il faut noter que le
code pénal français comporte plusieurs infractions
intéressant l'environnement de façon directe ou indirecte. C'est
le cas de l'article L222-16 qui punit d'une peine d'un an d'emprisonnement et
de 15000 euros d'amende les appels téléphoniques malveillants ou
les agressions sonores réitérées en vue de troubler la
tranquillité d'autrui, l'article L 421-2 punit de 20 ans de
réclusion ferme et d'une amende de 35 000 euros le crime de «
terrorisme écologique ». Tous ces exemples montrent à
suffisance le degré d'implantation de la sanction pénale en droit
de l'environnement comme le support juridique de la norme environnementale.
De tout ce qui précède, il ressort que la
sanction pénale permet au droit de l'environnement de maintenir sa
rigueur aussi bien en droit camerounais qu'en droit français et cet
enracinement de la sanction pénale se manifeste également par un
procédé qui a été instauré par les
législateurs camerounais et français, c'est cette technique que
nous avons baptisée ici, technique de l'aggravation.
51 Loi 76.663 du 19 Juillet 1976 relatives aux
ICPE.
52 Adopté en Novembre 1956 puis modifié
en 1970, 1977 et 1994.
53 Loi 92.1444 du 31décembre 1992 relative
à la lutte contre le bruit.

28
Paragraphe II : La technique de l'aggravation comme moyen
de renforcement de l'efficacité de la sanction pénale en droits
camerounais et français de l'environnement
Les législateurs camerounais et français ont
instauré des situations entraînant l'aggravation de la peine par
le juge. En droit pénal de l'environnement, la technique de l'indulgence
est peu usitée car ici les dispositions relatives au sursis et aux
circonstances atténuantes s'appliquent difficilement. A titre d'exemple,
on peut citer l'article 87 de la loi cadre camerounais relative à la
gestion de l'environnement qui stipule que : « les dispositions des
articles 54 et 90 du CP relatif au sursis et aux circonstances
atténuantes ne sont pas applicables aux sanctions prévues par la
présente loi ».Bien au contraire, il y a des situations dans
lesquelles la peine est doublée en raison du statut procédural ou
particulier du délinquant (A) et à défaut la peine est
généralement aggravée par les peines
complémentaires (B).
A- L'aggravation de la peine en raison du statut
procédural du délinquant
La technique de l'aggravation de la peine est une technique
qui est employée dans la quasi-totalité des systèmes
juridiques. En effet, les raisons motivant l'aggravation de la peine, peuvent
être dues à plusieurs facteurs. Il en est ainsi du statut
procédural du délinquant c'est-à-dire lorsque celui-ci est
récidiviste de même que lorsque l'infraction est commise par un
agent de l'administration qui a pour mission de veiller à la protection
de l'environnement.
S'agissant de la récidive, ce mot vient du latin «
recidere » qui veut dire rechute. Elle renvoie à la situation d'une
personne qui, déjà définitivement condamnée pour
une infraction en commet une autre dans des conditions fixées par loi.
En droit de l'environnement camerounais, la récidive est reconnue comme
une cause d'aggravation de la sanction pénale, il en est ainsi des
articles 81, 82, 83, 84 de la loi cadre relative à la protection de
l'environnement qui précisent qu'en cas de récidive le montant
maximal des peines est doublé. Par contre en droit de l'environnement
français, le législateur semble avoir abrogé la
récidive54. En droit camerounais de l'environnement, le
législateur a également prévu, l'aggravation de la peine
lorsqu'une infraction a été commise par un fonctionnaire ayant
pour mission de veiller à la protection de l'environnement55.
Quant au droit français de l'environnement, il semble ne pas faire de
distinction entre les différents auteurs. On peut
54 Les articles L216-8 du code de l'environnement ont
été abrogés.
55 Art 86 de la loi cadre relative à la
gestion de l'environnement : « La sanction est doublée lorsque les
infractions suscitées sont commises par un agent relevant des
administrations chargées de la gestion de l'environnement, ou avec sa
complicité.

29
donc traduire ceci par le respect du sacro-saint principe de
« l'égalité de tous devant la loi » cher au droit
français.
De tout ce qui précède, il ressort que la
récidive et le statut professionnel du délinquant constituent des
moyens permettant au législateur camerounais d'aggraver la situation du
délinquant, avis que ne partage pas toujours son homologue
français qui préfère employer les peines
complémentaires comme moyens d'aggravation de la sanction
pénale.
B- L'aggravation de la peine par l'instauration des
peines complémentaires
L'instauration des peines complémentaires n'est pas le
seul apanage du droit pénal de l'environnement car elles existent
également dans d'autres domaines du droit. Elles permettent au juge de
prendre les mesures qu'il estime nécessaire pour empêcher la
réitération de l'infraction. C'est ainsi qu'en cas de commission
du délit d'ICPE sans autorisation, l'article L. 514-9-111 du code de
l'environnement français autorise le juge à exiger une «
remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine
». Bien plus, il peut aller jusqu'à interdire l'utilisation de
l'exploitation en ordonnant la fermeture de celle-ci. En droit camerounais de
l'environnement, les peines complémentaires sont également
présentes à titre d'exemple, on peut citer l'interdiction
temporaire ou définitive de l'exercice de la profession56
Les peines complémentaires permettent de renforcer
l'efficacité de la sanction pénale en conférant au juge
pénal un rôle de modérateur en droit de l'environnement car
la remise en état des lieux tout comme l'interdiction d'exercer font
partie des pouvoirs de police administrative qui est exercé par
l'administration.
De tout ce qui précède, il ressort que la
sanction pénale, élément constitutif de l'infraction est
l'apanage du droit de l'environnement français et du droit de
l'environnement camerounais. Ces vingt dernières années, la prise
de conscience écologique a connu un essor particulier au Cameroun tout
comme en France et ce mouvement de prise de conscience évolue de
façon dynamique car le problème environnemental intéresse
tout le monde, il prend de l'ampleur compte tenu des différents enjeux
auxquels doivent faire face les Etats notamment en matière
énergétique, en matière forestière et en
matière de changements climatique. C'est aussi une
caractéristique de l'évolution du droit de l'environnement qui
jusqu'à une époque récente était un « droit
jeune dont l'autonomie en tant que branche du droit suscitait des doutes et
dont l'empirisme et la dispersion attiraient la critique. Pourtant
56 Art. 162 al 3 de la loi forestière de 1994
op.cit.
aujourd'hui, on ne peut que constater son développement
spectaculaire. La protection de l'environnement inspire toutes les politiques
publiques et les normes qui y concourent sont de plus en plus nombreuses et
variées »57.
Les chapitres que nous venons d'étudier nous ont permis
de ressortir les points des similitudes entre les droits de l'environnement
camerounais et français. A la question de savoir s'il existe un droit
pénal de l'environnement au Cameroun tout comme en France, nous
répondrons par l'affirmative ; peu importe qu'il soit autonome ou pas,
ce qui importe c'est de veiller à la sauvegarde de l'environnement. Les
législateurs camerounais et français disent « Stop »
à la dégradation de l'environnement. Toutefois s'il est vrai que
la sanction est une notion commune aux droits de l'environnement
français et camerounais, il faut également relever que le
régime ou alors le traitement juridique de la sanction pénale
diffère selon que l'on se trouve en France ou au Cameroun.

30
57 O. BOSKOVIC, L'efficacité du droit de
l'environnement, Dalloz, Paris, 2010, p.1.

DEUXIEME PARTIE: LA SANCTION PENALE :
REGIMES
JURIDIQUES DISTINCTS EN DROITSFRANÇAIS ET
CAMEROUNAIS DE
L'ENVIRONNEMENT

31

32
Chaque Etat dispose d'un décor législatif qui
lui est propre, ceci ne se fait pas pour des raisons fantaisistes mais
généralement pour des raisons historiques, culturelles ou
géographiques d'une part ou pour des raisons de sécurité
et de soutien au développement d'autre part. Ainsi, dans un Etat
à climat sahélo-saharien, les enjeux en matière de
protection de l'environnement sont forcément plus importants car le
bien-être des populations est mis en péril par opposition à
un Etat qui dispose d'un climat équatorial ou tempéré.
Ceci va se répercuter également en matière de
répression des atteintes à l'environnement. Le Cameroun, ancienne
colonie française et anglaise a hérité d'un système
juridique hybride comprenant à la fois les particularités du
système romano-germanique et celles du système anglo-saxon. Cet
héritage colonial a permis au droit camerounais de se bâtir un
droit original après les indépendances. C'est ainsi qu'en
matière de répression des atteintes à l'environnement de
nombreuses dispositions ont été intégrées dans les
lois, lois cadre et les décrets. La lecture de ces différents
textes nous montre que, bien que le Cameroun ait maintenu certains
éléments du droit de l'environnement qui lui avaient
été légués par le droit français, le
Cameroun a su bâtir une législation en tenant compte des
réalités tropicales. Quant au droit de l'environnement
français, il a également connu des avancées historiques
que nous allons découvrir dans les prochaines lignes. Ceci nous
amène à la conclusion selon laquelle, le droit de l'environnement
est en perpétuelle construction ce qui n'est qu'une traduction du
caractère « dynamique » du droit. La lecture de l'ossature des
droits camerounais et français en matière de sanction
pénale en droit de l'environnement nous amène à
reconnaître que bien que la sanction pénale soit connue des droits
de l'environnement français camerounais, elle n'est pas
appréhendée de la même façon. Nous allons dans les
lignes qui suivent présenter le régime juridique de la sanction
des atteintes à l'environnement en droit camerounais (chapitre
Ter) puis nous présenterons le régime juridique de la
sanction des atteintes à l'environnement en droit français
(chapitre II).

L'ENVIRONNEMENT EN DROIT CAMEROUNAIS
CHAPITRE I : LA SANCTION DES ATTEINTES A

33
Très souvent fustigée par la communauté
internationale d'accuser un énorme retard en matière de droits de
l'homme, l'Afrique a pourtant été le premier continent à
procéder de manière formelle à un consécration
juridique du droit à un environnement sain ceci s'est traduit par
l'adoption à Nairobi de la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples du 28 juin 1981 qui dispose en son article 24 : « tous les peuples
ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à
leur développement ». Avant l'adoption de la loi cadre relative
à la gestion de l'environnement, le Cameroun disposait d'une
législation éparse car le régime juridique de la
protection de l'environnement était précaire. Ainsi les atteintes
à l'environnement étaient réprimées de
manière superficielle à titre d'exemple on peut citer l'article
261 qui réprime la pollution de l'eau potable et la pollution de l'air
lorsqu'il dispose : « Est puni d'un emprisonnement de quinze jours
à six mois et d'une amende de 5.000 à 1 million de francs ou de
l'une de ces deux peines seulement celui qui, par son activité :
a) Pollue une eau potable susceptible d'être
utilisée par autrui ; ou
b) Pollue l'atmosphère au point de la rendre nuisible
à la santé publique.
Au Cameroun, le premier texte intervenu pour réprimer
». À ce texte, on peut ajouter les articles 235 et 369 al 5 qui
répriment respectivement les cris séditieux et les tapages
nocturnes. Mais ce dispositif n'était pas assez complet pour
réprimer les atteintes à l'environnement car il réprimait
les pollutions de manière superficielle sans tenir compte des autres
formes d'atteinte à l'environnement. Face à ceci, le
législateur est intervenu pour compléter le dispositif
législatif en adoptant des lois spécifiques telles que la loi
relative à la gestion de la forêt, la loi sur les ICPE, la loi sur
la gestion des déchets dangereux et bien d'autres. Les différents
textes comportant des dispositions pénales en matière d'atteintes
à l'environnement nous ont permis de nous rendre compte du dispositif
hétérogène mis en place par le législateur
camerounais (Section I) qui bien que comportant des mérites est
malheureusement assorti de faiblesses (Section II).

34
SECTION I : UN REGIME HYBRIDE DE LA SANCTION PENALE
EN
DROIT CAMEROUNAIS
Le traitement juridique de la sanction pénale en droit
de l'environnement camerounais varie en fonction de la personne poursuivie. En
effet, les personnes morales se voient très souvent subir des sanctions
pénales différentes de celles subies par les personnes physiques.
En effet, certaines sanctions pénales comportent des
particularités qui rendent leur exécution impossible. C'est ainsi
qu'il est matériellement impossible de condamner une personne morale
à une peine d'emprisonnement. Face à ceci, le législateur
se trouve dans l'obligation de "compenser" cette impossibilité
matérielle d'exécution, par une autre mesure plus ou moins
équivalente. En tout état de cause, le régime
hétérogène de la sanction pénale en droit de
l'environnement camerounais ressort la rigueur du législateur
camerounais dans l'éventail de sanctions encourues pour les personnes
physiques (Paragraphe I) tandis qu'en ce qui concerne les sanctions encourues
par les personnes morales, le législateur camerounais fait preuve d'une
souplesse mesurée (Paragraphe II).
Paragraphe I : Une « rigueur affirmée » du
législateur camerounais quant aux sanctions encourues par les personnes
physiques
En matière de lutte contre les atteintes à
l'environnement, le législateur camerounais a instauré un canevas
dont le respect s'impose à tous et la transgression de ces règles
fait intervenir le droit pénal de l'environnement et en l'occurrence, la
sanction pénale. La sanction pénale est donc la
conséquence de l'atteinte à l'intégrité de
l'environnement. Le droit pénal de l'environnement a consacré
deux peines principales à savoir la peine d'emprisonnement et la peine
d'amende. Les peines d'emprisonnement sont celles qui sont le plus souvent
subies par les personnes physiques (A). Bien plus, dans la pratique, les
personnes physiques ne bénéficient pas des circonstances
atténuantes (B) et ne peuvent donc pas bénéficier d'une
transaction.
A- L'instauration de fortes peines d'emprisonnement
L'emprisonnement est la peine la plus employée par le
juge pour sanctionner les personnes physiques qui ont porté atteinte
à l'environnement certainement parce qu'elle constitue le moyen de
répression. L'emprisonnement est défini à l'article 24 du
CPC comme étant une peine privative de liberté pendant laquelle
le condamné est astreint au travail sauf décision contraire de la
juridiction. En droit camerounais, la peine emprisonnement peut être

35
prononcée à l'encontre d'une personne en cas de
contravention, de délit ou de crime. En droit pénal camerounais,
il existe très peu de contraventions58 mais les délits
constituent les infractions les plus nombreuses59 au même
titre que les crimes60. C'est ainsi qu'en cas d'atteinte à
l'environnement les peines d'emprisonnement prononcées sont très
souvent supérieure à dix jours. La quasi-totalité des
contraventions en droit de l'environnement sont celles qui sont contenues dans
la loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche
notamment l'article 154 qui réprime la pêche dans un
établissement aquacole, domanial ou communal sans autorisation, la
provocation des animaux lors d'une visite dans une réserve de faune ou
d'un jardin zoologique, la détention d'un outil de chasse dans une aire
interdite de chasse61. Cet exemple que nous venons de montrer nous
permet d'apprécier à quel point le législateur attache un
prix au respect et à la protection de la nature.
En droit de l'environnement camerounais, la peine
d'emprisonnement va de dix jours à la prison à
perpétuité. Il en est ainsi en matière d'introduction ou
d'importation de déchets dangereux qui est possible d'une peine
d'emprisonnement à vie62. L'article 80 de la loi cadre
relative à la gestion de l'environnement punit d'une amende de cinquante
millions à cinq cent millions de F CFA et d'une peine d'emprisonnement
à perpétuité, toute personne qui introduit des
déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais. Il
ressort de cet article que le choix de la sanction pénale par le juge
n'est pas libre en ce qui concerne le prononcé de la peine
d'emprisonnement à perpétuité. La peine d'emprisonnement
à perpétuité doit être prononcée dès
lors que l'introduction de déchets dangereux sur le sol camerounais a
été réalisée, l'on se demande alors qui subira la
peine d'emprisonnement en cas d'infraction commise par une personne morale ? En
effet, dans la pratique, le déversement ou l'importation de
déchets dangereux est généralement réalisée
par des multinationales disposant de gros moyens financiers63 et
sont généralement à mesure de payer de montants
exorbitants face à ceci faut-il privilégier le
dédommagement ou alors l'emprisonnement. En cas de condamnation de la
personne morale qui subira la peine d'emprisonnement, est-ce le
préposé, le ou les dirigeants ou alors les fondateurs ? Quelle
peut être la portée de l'article 80
58 L'Art. 21 du CPC définit les
contraventions comme étant des infractions punies d'un emprisonnement
qui ne peut excéder dix jours ou d'une amende qui ne peut excéder
25 000 F CFA.
59 L'Art. 21 al (1) (b) CPC définit les
délits comme étant des infractions punies d'une peine privative
de liberté ou d'une amende lorsque la peine privative de liberté
encourue est supérieure à dix jours et n'excède pas dix
ans ou que le maximum de l'amende est supérieur à 25 000 F
CFA.
60 L'Art. 21 al 3 (c) du CPC définit les
crimes comme étant les infractions punies de la peine de mort ou d'une
peine privative de liberté dont le maximum est supérieur à
dix ans.
61 Ces infractions sont punies d'une peine
d'emprisonnement de dix jours, d'une amende de 50 000 F CFA, ou de l'une de ces
deux peines seulement.
62Exemple de l'affaire du Probo Koala en Côte
d'Ivoire.
63Art. 80 de la loi cadre relative à la gestion
de l'environnement.

36
de la loi cadre ? A notre avis, l'article 80 a le
mérite de ressortir le régime juridique de l'infraction
d'introduction de déchets dangereux considéré comme
étant un crime écologique, cependant il faut reconnaître
que le juge pénal aura du mal à condamner une
société à une peine d'emprisonnement qui reste
réservée aux seules personnes physiques.
En matière de lutte contre les pollutions de l'air, du
sol et des sous-sols et d'altération de la qualité de l'eau, la
peine d'emprisonnement constitue l'une des sanctions pénales les plus
usitées en droit de l'environnement car une bonne partie des
dispositions pénales en la matière sont assorties de peine
d'emprisonnement dont la durée s'avère plus ou moins longue.
Signalons toutefois l'avancée significative qu'a connue le droit
pénal de l'environnement. Ces dernières années la peine de
mort était encore applicable au Cameroun en droit de l'environnement
notamment par l'article 4 alinéa 1 de la loi de 1989 portant sur les
déchets toxiques et dangereux qui punissait de la peine de mort celui
qui introduisait sans autorisation des déchets toxiques et/ou dangereux
sur le territoire camerounais. Ces dispositions ont été
abrogées par l'article 98 alinéa 2 de la loi cadre de 1996.
L'abolition de la peine de mort par le droit pénal de l'environnement
témoigne du souci du législateur camerounais de protéger
l'environnement et de sanctionner les atteintes tout en préservant et en
respectant les droits de l'homme en l'occurrence le droit à la vie.
En plus de l'instauration de fortes peines d'emprisonnement
pour les personnes physiques, la rigueur du législateur se fait
également ressentir par l'absence des circonstances atténuantes
et du sursis.
B- L'absence du bénéfice des
circonstances atténuantes du sursis en droit camerounais
de l'environnement
A la lecture des dispositions relatives à la sanction
pénale en droit de l'environnement, on est tenté d'affirmer que
le pardon n'est pas la chose la mieux partagée en droit camerounais car
il suffit de lire les dispositions de l'article 87 de la loi cadre de 1996 qui
dispose de manière péremptoire « les dispositions relatives
au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux
sanctions prévues par la présente loi ». Il ressort de ce
texte que nul ne peut bénéficier des circonstances
atténuantes, ni du sursis en cas de commission d'une infraction
environnementale quelles que soient les circonstances. Le régime de
droit commun de la responsabilité pénale en droit de
l'environnement considère que les atteintes perpétrées
contre l'environnement sont suffisamment graves et intolérables.
Lorsqu'une personne pollue sciemment une eau potable, elle met en péril
la santé et même la

37
vie de plusieurs autres par conséquent, le sursis
« mesure probatoire qui sert d'alternative à l'exécution des
condamnations fermes »64 n'a pas de place ici ; c'est aussi le
cas en ce qui concerne les circonstances atténuantes car le
délinquant écologique ne peut pas bénéficier de la
clémence du juge pénal. Cette intransigeance du
législateur laisse un goût d'inachevé quand on sait que la
transaction est admise en droit de l'environnement (voir Section II sur les
faiblesses de la sanction pénale en droit camerounais de
l'environnement). Les circonstances atténuantes et le sursis sont
inapplicables même pour les infractions les plus minimes ou les moins
graves cela nous amène à nous poser la question suivante :tous
les dommages écologiques se valent-ils ? A notre avis, il est convenable
de répondre par la négative parce que toutes les infractions
écologiques ou environnementales ne se valent pas, il y en a qui sont
sévèrement sanctionnées et d'autres qui ne le sont pas.
Les paragraphes qui précèdent nous permettent de
ressortir l'ensemble des mesures employées par le législateur
dans la sanction des personnes physiques. Quid des personnes morales ?
Paragraphe II : Une « souplesse mesurée »
du législateur camerounais quant aux sanctions pénales encourues
par les personnes morales
Le législateur camerounais se montre beaucoup plus
complaisant en ce qui concerne les sanctions pénales des personnes
morales car les entreprises qui exercent des activités polluantes sont
généralement celles qui sont supposées "booster"
l'économie. Sur ce point le législateur tente de réaliser
le juste milieu car les exigences de développement sont plus pesantes
dans les PVD comme le Cameroun (B) et pour s'arrimer à ces exigences,
les peines d'amendes constituent une alternative (A).
A- Le recours à de fortes peines d'amendes par
le législateur camerounais
L'amende est une sanction pécuniaire imposée par
la loi à une personne condamnée. Elle permet de compenser le
trouble causé à la société ; le montant total de
l'amende doit être payé au trésor public. Le
législateur camerounais a instauré de fortes peines d'amende en
ce qui concerne le droit de l'environnement. Dans la loi cadre de 1996, le
montant de l'amende va jusqu'à cinq cent millions de F CFA65
et dans certaines lois sectorielles notamment en droit gazier, le
législateur camerounais introduit des sommes colossales. C'est ainsi
qu'aux termes de l'article 57 de la loi N° 2002/013 du 30 décembre
2002 portant code gazier punit d'une
64http ://
fr.wikipedia.org./wiki/sursis. 65
Art.80 de la loi cadre Op.cit.

38
amende de cinquante millions de F CFA le non-respect des
régies techniques de sécurité d'hygiène ou portant
sur l'environnement et les sites protégées et exceptionnels. En
matière d'ICPE, le montant de l'amende va de cinq cent mille à
deux millions de F CFA en cas d'exploitation d'une ICPE dont la fermeture a
été ordonnée, en cas d'exploitation d'une ICPE sans
autorisation, ni déclaration préalable ou même en cas
d'obstacle ou d'oppositions aux missions d'inspections, de contrôle
prévues par la loi66. Face à ceci, une question
lancinante apparaît : pourquoi ce choix du législateur ? En
d'autres termes, pourquoi avoir instauré de fortes sommes d'amende ? Le
législateur camerounais serait-il entrain d'encourager le monnayage de
l'environnement ou alors est-ce une transposition nationale du principe
pollueur-payeur ? Pour répondre à ces questions, il convient de
relever les avantages de la peine d'amende en droit de l'environnement.
En effet, pour les entreprises, il est souvent inutile de les
faire trainer devant les juridictions quand on sait que la comparution devant
les tribunaux provoque un choc moral, ce qui peut entraver gravement
l'activité de l'entreprise. Ainsi contrairement à la peine
d'emprisonnement, la peine d'amende ne perturbe ni la société, ni
l'activité de celle-ci. Bien plus, « l'amende offre des
possibilités plus grandes d'individualisation de la sanction et
d'adaptation à la gravité objective du fait »67.
Ainsi, l'amende serait la sanction la mieux adaptée aux entreprises car
frapper les entreprises au niveau de leur porte-monnaie a un effet beaucoup
plus intimidateur que la condamnation à une peine d'emprisonnement. La
peine d'amende permet de minimiser et de réduire les efforts consentis
par l'administration car elle traduit une simple opération de transfert
de biens par la personne morale condamnée vers les caisses de l'Etat.
En tout état de cause, cette « monétisation
» de l'environnement par les personnes morales n'est pas toujours mauvaise
car elle permet le renflouement des caisses de l'Etat qui peut grâce
à ces fonds initier de nouveaux projets structurants, ce qui permet de
ressortir l'efficience ou encore l'efficacité économique de
l'amende car les choix du législateur sont toujours guidés par un
souci d'apaisement.
Le recours aux peines d'amende en ce qui concerne les
personnes morales est également justifié par le souci de
préserver ou d'améliorer le climat des affaires au Cameroun.
66Art. 34 de la loi sur les établissements
classés insalubres et incommodes pour la protection de l'environnement
op.cit.
67 P. MULAMBULWA OMARI, Analyse du régime
répressif en droit congolais : cas de l'infraction tentée,
Université de Kindu, Graduat 2008.

39
B- Les exigences de développement : principal
motif de l'indulgence du législateur
Les exigences liées au développement constituent
à notre humble avis le principal motif de mansuétude du
législateur à l'égard des personnes morales car il n'est
pas toujours évident d'allier environnement et développement. Les
investisseurs seraient tentés de se décourager si la
législation camerounaise en matière de droit de l'environnement
était trop rigoureuse. Cette souplesse mesurée du
législateur se justifie par le souci d'amélioration du climat des
affaires car les peines d'emprisonnement sont inadéquates et
jugées trop excessives. Dans l'application des sanctions pénales
aux hommes d'affaires, le juge pénal de l'environnement ne doit pas
perdre de vue que plus que la rudesse c'est l'assurance du châtiment qui
produit un impact didactique. Il est souhaitable que le juge pénal dans
l'application des sanctions pénales se rende compte qu'il est investi
d'une subtile fonction, celle de sanctionner la violation des normes
environnementales tout en tenant compte des OMD dont la réalisation est
chère aux PVD comme le Cameroun. Pour se faire, il doit jouer le
rôle d'un véritable équilibriste. Il doit par ses jugements
combattre efficacement la délinquance écologique, tout en
préservant la fierté et la réputation des entreprises, car
certains estiment qu'il n'est pas juste pour l'économie d'un pays de
faire subir aux entreprises le supplice de la comparution devant les
juridictions. Toutefois, l'attitude peu recommandable de certaines entreprises
qui n'aiment pas entendre parler du droit de l'environnement montre bien que la
sanction pénale peut contribuer à leur normalisation. Le droit de
l'environnement camerounais a également envisagé la
responsabilité pénale des chefs d'entreprise qui devront
répondre pour les personnes morales68. Il en découle
qu'en cas de condamnation, l'entreprise sera tenue solidairement responsable
avec le ou les chefs d'entreprise condamnés au paiement des amendes,
réparations civiles, frais et dépenses.
De tout ce qui précède, il ressort que la
sanction pénale en droit camerounais a un régime juridique dont
l'originalité réside dans la forte présence des peines
d'amendes pour les personnes morales et la prépondérance des
peines d'emprisonnement pour les personnes physiques ce qui nous permet de
relever les mérites de la législation camerounaise dans sa
politique nationale de lutte contre la dégradation de l'environnement.
Cependant, force est de constater que comme la plupart des législations,
le régime juridique de la sanction pénale en droit camerounais
comporte des bémols.
68 Art .4 al 3 de la loi N° 89/0257 du 29 décembre
1989 portant sur les déchets toxiques et dangereux.

40
SECTION II : LES FAIBLESSES DE LA SANCTION PENALE EN
DROIT
CAMEROUNAIS DE L'ENVIRONNEMENT
Le problème de l'efficacité du droit de
l'environnement demeure une préoccupation pour bon nombre de pays parmi
lesquels le Cameroun. En effet, la question de la mise en oeuvre du droit de
l'environnement est une problématique classique69 car la
pléthore des textes en la matière entraîne une
complexification de la législation et une application éthique des
textes. La mise en oeuvre de la sanction pénale en droit de
l'environnement se heurte à de nombreuses entraves au rang desquelles le
laxisme des autorités compétentes en matière de lutte
contre la dégradation de l'environnement combiné à
l'insuffisance des ressources financières (Paragraphe I). En outre,
l'administration camerounaise a érigé la transaction comme une
étape préalable à tout règlement de nature
environnementale ce qui constitue un effritement de la sanction pénale
(Paragraphe II).
Paragraphe I : Le laxisme des autorités
compétentes en matière de répression des atteintes
à l'environnement : les faiblesses d'ordre institutionnel
La réglementation hétéroclite de la
sanction pénale en droit de l'environnement souffre d'une application
difficile du fait des carences inhérentes aux autorités
compétentes en la matière en l'occurrence les agents de
l'administration d'une part et du juge pénal d'autre part (A). Bien
plus, la mise en oeuvre de la sanction pénale se heurte à
l'insuffisance des moyens financiers (B) mis à la disposition de
l'administration.
A- Les carences inhérentes aux autorités
compétentes en matière de répression, des atteintes
à l'environnement
Le laxisme des autorités compétentes constitue
un frein au développement du droit de l'environnement ; ce laxisme se
traduit par le faible suivi de la règlementation encouragé par
les agents de l'administration d'une part et par le manque de
spécialisation des juges en matière de droit de l'environnement
d'autre part.
Sur le faible suivi de la législation
: Au Cameroun, le droit de l'environnement « tout entier souffre
d'un faible suivi »70. Le droit protecteur de l'environnement
est très peu appliqué par les acteurs ce qui entraîne un
laisser-faire de la part des personnes assujetties au
69 M. KAMTO, Colloque sur la mise en oeuvre du
droit de l'environnement en Afrique, la mise en oeuvre du droit de
l'environnement : forces et faiblesses des cadres institutionnels, Abidjan, 29
au 31 octobre 2013.P4
70 R. L. LONGO, La gestion des déchets
dangereux au Cameroun, IRIC, Université de Yaoundé II,
Mémoire de Master en Relations Internationales, 2012.

41
droit de l'environnement. Les justifications à cette
situation calamiteuse ne tarissent pas ; tantôt certains évoquent
le caractère épars des textes, d'autres le manquent de
clarté et de précision des textes et d'autres évoquent
même une violation volontaire de la loi. C'est une situation ahurissante
et d'une gravité particulière car cela conduirait à
réduire le droit camerounais de l'environnement à un droit
purement théorique qui n'existe que dans les textes et toute politique
visant à le rendre vivant ou plus pratique serait vaine. Pour illustrer
le laxisme des autorités compétentes, nous allons procéder
par quelques exemples.
Exemple 1 : en matière de gestion des
déchets
Au Cameroun, la règlementation en matière de
gestion des déchets est malheureusement très peu respectée
malgré l'existence d'une règlementation en la matière.
C'est le cas de l'obligation de déclaration prescrite par la loi de 1989
qui a pour but d'obliger les entreprises à déclarer leur
activité et à préciser le volume de leurs déchets.
Malheureusement, la stratégie nationale de gestion des déchets
hospitaliers71 qui sont mélangés aux autres formes de
déchets (déchets plastiques, liquides, ménagers etc...).
La problématique de la gestion des déchets au Cameroun
préoccupe et inquiète toutes les couches de la
société car « la saleté nous assiège et son
cortège de la maladie nous guette ». Qui peut se prétendre
à l'abri du microbe que le vent propagera de quartier en quartier ? Il
n'y a pas de liesse quand la crasse n'est pas loin, omniprésente,
nauséabonde. La vie suffoque sous cette étreinte de la
malpropreté »72
Exemple 2 : en matière de lutte contre la
pollution de l'eau
Au Cameroun, 21 entreprises sont autorisées à
commercialiser l'eau minérale selon un communiqué du MINDT.
Malheureusement, le secteur des eaux minérales connaît beaucoup de
turbulences dues à la prolifération des marques des eaux et
à leur qualité douteuse. Malgré les multiples circulaires
et communiqués des autorités, la situation reste
inchangée. Des entreprises exercent en pleine illégalité,
c'est-à-dire sans accomplir les formalités préalables de
déclaration ou d'autorisation. Le problème du commerce d'eau
minérale au Cameroun est dominé par des entreprises
récalcitrantes qui n'ont aucun respect pour l'administration. L'inertie
de l'administration est une situation qui affecte particulièrement le
droit de l'environnement camerounais car elle contribue à l'affaiblir.
L'administration gagnerait à mettre sur pied des politiques
adaptées à la situation économique et géographique
du pays. On
71 Stratégie nationale de gestion des
déchets au Cameroun période 2007-2015.
72 F. NTONE NTONE, A l' occasion des JCP, BOSANGI,
Magazine trimestriel de l'environnement, Avril-Mai-Juin 2012, Numéro
30.

42
pourrait par exemple promouvoir une plus forte participation
des populations dans la mise en oeuvre du droit de l'environnement. Toutefois,
le laxisme ou la mauvaise volonté des agents de l'administration n'est
pas la seule difficulté à laquelle se heurte la sanction
pénale.
Sur le manque de spécialisation des juges en
matière de droit de l'environnement
Très peu de juges camerounaises possèdent des
connaissances en droit de l'environnement. Ce qui peut entraîner une
accumulation du contentieux en la matière. Ainsi, une
spécialisation des juges en droit de l'environnement serait
salutaire.
De tout ce qui précède, il ressort que les
autorités compétentes en matière de répression des
atteintes à l'environnement font preuve d'une négligence
caractérisée entraînant ainsi une banalisation du droit de
l'environnement. Toutefois, le laxisme des intervenants est également
causé par la faiblesse des ressources.
B- L'insuffisance de ressources financières et
humaines
La faiblesse des moyens financiers est l'un des grands
problèmes de la protection de l'environnement au Cameroun. La plupart
des intervenants de la répression des atteintes à l'environnement
disposent de peu de moyens d'exécution. A titre d'exemple, on peut citer
les moyens permettant aux agents assermentés des eaux et forêts de
se déplacer, pour constater la réalisation d'une infraction
(véhicules, cyclomoteurs, etc...). Les agents assermentés se
trouvent parfois obligés de bénéficier de l'appui des mis
en cause, des ONG ou même des organisations internationales pour faire
leur travail. Face à cette situation, l'administration se retrouve
généralement dans une situation passive et se contente d'observer
plus tôt que d'agir. En matière de lutte contre la pollution par
les déchets seule une société a eu le mérite de
lutter efficacement contre l'insalubrité et bénéficie
à ce jour des appuis de l'Etat : il s'agit de la société
HYSACAM.
En tout état de cause, l'administration gagnerait
à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la
répression des atteintes à l'environnement qui constitue un atout
majeur pour l'épanouissement du droit de l'environnement.
Les développements précédents nous
permettent de ressortir les faiblesses d'ordre institutionnel de la sanction
pénale en droit de l'environnement. Sur un premier point, il
apparaît que le suivi de la législation par les acteurs du droit
de l'environnement n'est pas assez concentré. Bien plus, le
défaut de spécialisation des juges fait obstacle à
l'efficacité de la sanction pénale. Sur un second point, il
apparaît que l'application de la sanction pénale

43
souffre du manque de moyens financiers et humains
nécessaires à sa mise en oeuvre. Ceci ne fait que corroborer les
propos d'un auteur qui en relevant les difficultés ou au mieux les
faiblesses du droit de l'environnement en Afrique, a pu dire : « En effet,
quel que soit le secteur de la protection de l'environnement
considéré, ce constat demeure invariable. La faiblesse de la mise
en oeuvre efficace du droit de l'environnement tient aux trois facteurs
suivants : l'insuffisance de l'autorité du Ministère de
l'Environnement et de la Coordination institutionnelle, dans un contexte
où les missions dudit Ministère ne sont pas toujours bien
définies et où règne parfois une instabilité
institutionnelle due au changement fréquent de l'appellation du
Ministère ou à son rattachement à d'autres
départements ministériels ; l'insuffisance des ressources
humaines en nombre et en qualité, l'insuffisance des moyens
financiers73. Bien plus, l'efficacité de la sanction
pénale est également biaisée par la transaction.
Paragraphe II : L'effritement de la sanction pénale
par le recours à la transaction : les faiblesses d'ordre
procédural
La transaction constitue l'un des modes alternatifs de
règlements des conflits. Elle permet de contrecarrer le passage devant
le juge et les longues tracasseries judiciaires car comme le dit le dicton,
« mieux vaut un mauvais arrangement qu'un long procès ». La
transaction est définie par l'article 2044 du code civil comme
étant « un contrat par lequel les parties terminent une
contestation née, ou préviennent une contestation à
naître »74. Selon certains auteurs, la transaction peut
avoir un sens similaire à celui de la négociation75.
Le législateur camerounais a retenu la transaction comme mode alternatif
de règlement des conflits en droit de l'environnement. Ce choix du
législateur nous amène à nous interroger sur la nature
juridique de la transaction en droit de l'environnement (A) et sur sa
portée juridique (B).
A- La nature juridique de la transaction en droit de
l'environnement camerounais
Aux termes de l'article 91 alinéa (3) de la loi cadre
relative à la gestion de l'environnement ; « la procédure de
transaction doit être antérieure à toute procédure
judiciaire éventuelle sous peine de nullité » il ressort des
dispositions de ce texte que la
73 M. KAMTO, Op.cit. P.5
74 Art. 2044 al 1 du Code civil.
75 S. BRAUDO, Dictionnaire du droit privé
téléchargeable sur le site www. Dictionnaire
juridique.com.

44
transaction est une étape obligatoire à tout
contentieux ayant un enjeu environnemental et le défaut ou alors le non
recours à la transaction entraîne ipso facto la nullité des
poursuites.
La transaction est une phase administrative ou extrajudiciaire
qui se déroule en deux étapes76 à savoir :
1) La transmission des dossiers des agents verbalisateurs
comprenant les rapports de mission et le procès-verbal à la
direction des normes du contrôle qui par le biais de l'unité de
suivi et du contentieux prend connaissance de l'ensemble du dossier aux fins de
vérifier les éventuelles irrégularités de fond et
de forme ; Puis
2) La deuxième étape consiste en la
notification de l'infraction et à la fixation du montant de la
pénalité par le MINEP qui peut se faire par acte extrajudiciaire.
Selon l'article 90 alinéa 1 de la loi cadre de 1996, le contrevenant
dispose d'un délai de vingt jours pour contester le procès-verbal
de constatation de l'infraction.
La transaction pénale en droit de l'environnement est
donc une échappatoire à la sanction pénale car elle
constitue une alternative aux poursuites pénales. Cependant pour
s'opérer, les conditions suivantes doivent être réunies
:
- La procédure de transaction doit être
antérieure à toute poursuite judiciaire - Le montant de la
transaction ne saurait être inférieur à l'amende
pénale.
Selon la loi cadre, les autorités chargées de la
gestion de l'environnement ont le plein pouvoir pour transiger. Selon certains
critères, l'originalité de la loi cadre de 1996 permet à
l'auteur de l'infraction d'échapper aux sanctions
pénales77. Car la transaction produit un effet suspensif en
ce sens qu'elle interrompt toute poursuite pénale susceptible
d'être engagée contre l'auteur de l'infraction, ce qui
entraîne une paralysie de la sanction pénale.
B- La portée judiciaire de la transaction : la
paralysie de la sanction pénale
Le principal effet de la transaction pénale est celui
de la paralysie de la sanction pénale. En effet, le recours obligatoire
à la transaction pénale suscite moult interrogations la sanction
pénale en droit de l'environnement a-t-elle encore une raison
d'être ? Le législateur camerounais a-t-il vraiment l'objectif de
réprimer des atteintes à l'environnement. En effet, il existe une
pléthore de textes en matière de répression des atteintes
à l'environnement. Ce droit
76 MINEP, Guide de procédures du contentieux
environnemental du Ministère de l'Environnement et de la Protection de
la nature, Juillet 2009, PP. 4 à 6.
77 D. BISSECK, Rapport de la Cour Suprême du
Cameroun sur le droit pénal de l'environnement, Porto Novo-26 et 27 Juin
2008, p.99, consulté sur le lien
www.ahjucaf.org/Rapport-de-la-cour-suprême-du
6715.html.

45
de l'environnement s'avère même très
impitoyable compte tenu de la fermeté des peines mais il est
malheureusement peu appliqué car il y a peu de poursuites judiciaires et
encore moins de sanctions pénales. Les cas d'infractions
constatées se règlent très souvent par le canal de la
transaction. Le contentieux en matière de répression des
atteintes à l'environnement porte le plus souvent sur le braconnage
selon un rapport de la cour suprême du Cameroun sur le Droit Pénal
de l'Environnement « Si de temps en temps, les tribunaux sont saisis en
matière d'infraction sur la législation relative à la
faune, les autres domaines ne semblent pas faire l'objet de poursuite, peut
être en raison de la primauté de la procédure
transactionnelle, mais certainement en raison du défaut dans la
recherche en la constatation des infractions environnementales78. La
lecture des dispositions législatives nous permet de nous rendre compte
de ce que la sanction pénale est neutralisée par le recours
obligatoire à la transaction pénale. Cet état de chose est
déplorable quand on sait que la transaction est susceptible d'encourager
la criminalité environnementale qui ne fait que gagner du terrain. En
effet, lorsque la transaction s'opère, elle entraîne ipso facto
l'extinction de l'action publique et donc l'arrêt des poursuites
conformément aux dispositions du code procédure pénale
camerounais79.
La transaction en elle-même n'est pas mauvaise dans la
mesure où elle permet de réparer financièrement le
préjudice qui a été causé à l'environnement
car les fonds versés vont permettre à l'administration
d'effectuer des travaux (par exemple le reboisement en cas de
déforestation, le réaménagement et l'assainissement en cas
de pollution des eaux, etc.). Mais nous pensons qu'il est plus convenable dans
l'application de la sanction pénale, de maintenir la transaction
pénale pour les infractions les moins graves comme les contraventions
mais pour les délits et les crimes, elle ne doit intervenir qu'en cas
d'abandon des poursuites et à la diligence du Ministère Public.
Dans ce cas le recours à la transaction ne sera plus automatique mais
sera une simple faculté.
Au Cameroun, bien que le devoir de tous de veiller à la
protection de l'environnement soit proclamé au préambule de la
constitution, on observe que le problème de la criminalité
environnementale n'a pas encore trouvé une solution efficace. Les
dispositions pénales sanctionnant les atteintes à l'environnement
sont certes fermes mais très souvent inopérantes. À quoi
sert la sanction pénale si la transaction est le principe ? Le recours
exceptionnel à la
78D. BISSECK. Op.cit
79 Art. 62 al 1(f) qui prévoit l'extinction
de l'action publique par la transaction, voir également P. KEUBOU,
Précis de Procédure Pénale Camerounaise, Presses
universitaires d'Afrique, l'Africaine d'Edition et de Services, Yaoundé
2010, p.89.

46
sanction pénale serait-il l'idéal pour notre
droit de l'environnement ? Cette situation serait vraiment désastreuse
pour un État qui se veut garant de la protection de l'environnement.
Les développements précédents nous ont
permis de présenter le régime juridique de la sanction
pénale en droit de l'environnement camerounais. Nous allons dans les
prochaines lignes présenter celui de la sanction pénale en droit
français de l'environnement qui à coup sûr se
démarque du droit camerounais.

CHAPITRE II : LA SANCTION DES ATTEINTES A
L'ENVIRONNEMENT EN DROIT FRANÇAIS

47
Le droit français de l'environnement s'est
progressivement bâti autour des années 70 car la prise de
conscience écologique a entraîné l'adoption de diverses
lois relatives à la protection de l'environnement. De l'adoption d'un
code de l'environnement en 2000 (ordonnance N°2000-914 du 18 Septembre
2000 ratifiée par la loi N° 2003-591 du 02 Juillet 2003) à
l'intégration du droit de l'environnement au bloc de
constitutionnalité, le droit français de l'environnement
connaît un essor particulier. L'article 1er de la charte de
l'environnement du 1er mars 2005 reconnaît le droit de chacun
de « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de
la santé » et son article 4 poursuit en déclarant que «
toute personne doit contribuer à la réparation des dommages
qu'elle cause à l'environnement dans les condition définies par
la loi » ; en outre le code pénal français en son article L
410-1 intègre « l'équilibre de son milieu naturel et de son
environnement » parmi les intérêts fondamentaux de la nation.
Les dispositions législatives et constitutionnelles qui viennent
d'être énumérées constituent ce que nous pouvons
appeler le socle du droit français de l'environnement. L'environnement
est considéré par le droit français comme l'un des
idéaux de la nation, c'est d'ailleurs ce qui fait dire à certains
auteurs qu'il constitue désormais une « valeur sociale
protégée »80 et la concrétisation de cette
protection doit se faire par l'édiction de règles
spéciales visant à sauvegarder l'environnement sous tous ses
angles. Pour assurer le respect des normes environnementales, le
législateur français les a assorties pour la majorité de
sanctions pénales qui constituent désormais le « gendarme
» du droit de l'environnement. Selon la doctrine, l'apparition de
l'environnement dans le droit pénal revêt l'aspect d'un «
ordre public écologique »81. Le droit français de
l'environnement se caractérise par la mise en place d'un dispositif
hétérogène marqué par une diversité
d'incriminations environnementales et des mécanismes de sanctions
multiples. Le présent chapitre vise à présenter le
régime juridique de la sanction pénale en droit français
de l'environnement. La sanction des atteintes à l'environnement en droit
français est marquée par la spécificité du
régime juridique de la sanction pénale des personnes physiques et
de celui
80 J. LASSERE CAPDEVILLE, « le droit
pénal de l'environnement : un droit encore à l'apparence
redoutable et à l'efficacité douteuse », in sauvegarde de
l'environnement en droit pénal, Nérac-Croisier (sous la dir),
l'Harmattan, collection « Sciences criminelles », 2007, p.20.
81 E. DAOUD, C. LECORRE « La
responsabilité pénale des personnes morales en droit de
l'environnement, BDEI N°44, Mars 2013, p.53.

48
des personnes morales (Section I). Cependant, malgré
l'apparence sévère des textes, on note une difficile
intégration de la sanction pénale en droit français
(Section II).
SECTION I : LE REGIME DE LA SANCTION PENALE EN
DROIT
FRANÇAIS DE L'ENVIRONNEMENT
A la lecture des dispositions légales, on se rend
compte que malgré quelques similitudes, le régime de la sanction
pénale des personnes physiques diffère considérablement de
celui des personnes morales. En effet dans le souci de s'arrimer aux exigences
de la directive 2008 / CE du 19 Novembre 2008 du conseil de l'Europe relative
à la protection de l'environnement par le droit pénal qui
prône l'adoption des peines effectives, proportionnées et
dissuasives par les Etats membres du conseil de l'Europe, la France a
adopté l'ordonnance N°2012-34 du 11 Janvier 2012 modifiant
l'échelle des peines prévues par le code de l'environnement.
L'ordonnance du 11 Janvier 2012 a harmonisé le montant des sanctions
encourues pour des infractions similaires et a aggravé certaines peines
en fonction de l'intensité du préjudice environnemental. Le code
de l'environnement a créé de nouvelles sanctions pénales
au même titre qu'il en a modifié. En outre, l'ajournement avec
injonction a été étendu en droit de l'environnement aux
personnes physiques et aux personnes morales conformément à
l'article L 173 - 9 du code de l'environnement82 en cas de manquement à
une disposition légale ou réglementaire dans le but d'obliger le
délinquant à se conformer à la loi. Le droit
français de l'environnement regorge de diverses sanctions pénales
dont le régime varie selon que l'on se trouve en face d'une personne
morale (Paragraphe II) ou d'une personne physique (Paragraphe I).
Paragraphe I : Le régime de la sanction
pénale des personnes physiques
Le droit français considère comme personne
physique, tout être humain doté de la personnalité
juridique. La personnalité juridique est l'aptitude à
acquérir des droits et à accomplir des obligations. C'est la
personnalité juridique qui confère à un citoyen
l'obligation de respecter la loi dont tout manquement sera
éventuellement sanctionné. Ainsi défini le droit de
l'environnement s'applique à toute personne physique sans distinction de
race, de sexe, d'âge, ou d'origine. Ainsi, il convient de
présenter la nomenclature des sanctions pénales
82 Selon l'Art. L 179-9 du code l'environnement, les
dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur
l'ajournement e avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux
personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction
prévue au présent code ; le même article prévoit que
l'injonction peut être assortie d'une astreinte de 3000 euros au plus par
peur de retard.

49
applicables aux personnes physiques (A) avant d'envisager le
cas particulier de l'extension de la sanction pénale aux dirigeants
sociaux (B).
A- La nomenclature des sanctions pénales
applicables aux personnes physiques
Le législateur français a prévu deux
types de peines pouvant être prononcées à l'encontre des
personnes physiques, à savoir d'une part les peines principales et
d'autre part les peines accessoires.
S'agissant des peines principales, elles sont au nombre de
deux à savoir l'emprisonnement et l'amende. Les peines principales sont
celles qui sont prononcées à titre principal par le juge.
L'emprisonnement est une peine qui vise à placer le condamné
coupable d'une infraction environnementale dans une maison d'arrêt
communément appelée « prison ». Elle permet d'isoler le
condamné en espérant que cet isolement aura permis sa
rééducation. Quant à l'amende, elle vise à ordonner
le paiement d'une somme d'argent à l'Etat dans le but de compenser le
dommage subi par l'environnement.
En droit français de l'environnement, les peines
d'amendes sont généralement prononcées en cas de
commission d'une contravention. Il en est ainsi en cas de contravention de
première, deuxième, troisième, quatrième et
cinquième classe où le montant ne peut excéder trois mille
euros83. En matière de crime et de délits, les peines
d'amende sont généralement prononcées en même temps
que les peines d'emprisonnement.
S'agissant des peines accessoires ou complémentaires,
elles sont généralement prononcées à titre
supplétifs dans le souci d'empêcher une réitération
de l'atteinte à l'environnement ; on peut citer la
confiscation84 ; la publication du jugement, l'interdiction
d'exercice de la profession et bien d'autres.
En tout état de cause, le législateur
français a prévu un régime général de la
sanction pénale qui est celui contenu dans le code pénal et un
régime spécifique qui est celui contenu dans le code de
l'environnement et d'autres lois spéciales.
S'agissant du régime général de la
sanction pénale, on peut recenser plusieurs sanctions dont le montant
varie en fonction de la gravité de l'infraction commise à titre
d'exemples :
83 Art. 131-13 du code pénal
français.
84 Art. L 713-5 du code de l'environnement.

50
- l'article 222-16 du code pénal qui punit d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros toute personne qui effectue
des appels téléphoniques malveillants
réitérés, des envois réitérés de
messages malveillants par des voies de communication électroniques ou
les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui.
- l'article 421-2 qui punit d'une amende de 350.000 euros et
d'un emprisonnement de vingt ans le fait d'introduire dans l'atmosphère,
sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires
ou dans les eaux y compris celles de la mer territoriale, une substance de
nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des
animaux ou du milieu naturel. Ce crime est communément appelé
crime de « terrorisme écologique »85
- l'article 322 qui punit de deux ans d'emprisonnement et de
trente mille euros d'amende celui qui détruit, dégrade un bien
appartenant à autrui. Les articles R 632-2 comportent également
des sanctions pénales applicables aux personnes physiques.
S'agissant du régime spécifique contenu dans le
code de l'environnement, on peut citer le délit de pollution des cours
d'eau qui est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000
euros86 les infractions prévues dans le code de
l'environnement ayant pour effet des destructions, dégradations ou des
dommages à l'environnement qui sont punies par les peines prévues
dans le code de l'environnement87. Le code de l'urbanisme contient
également des sanctions pénales88.
De tout ce qui précède, il ressort que le
régime de sanction pénale applicable aux personnes physiques est
à la fois complexe et variée, c'est pour cette raison que nous
avons choisi d'étudier isolement le cas de la sanction pénale du
dirigeant d'une personne morale.
B- Le cas particulier des sanctions pénales
applicables aux dirigeants d'une personne morale
Le dirigeant d'une personne morale est la personne qui exerce
les fonctions de direction et de contrôle au sein d'une entreprise. En
effet, il existe une « présomption de faute » sur le dirigeant
d'une entreprise lorsque celle-ci a commis une infraction environnementale par
le biais de son personnel ou de ses préposés dans
l'accomplissement des travaux ayant un lien direct ou indirect avec le
fonctionnement de son établissement. Cette
85 Encore appelée crime contre
l'environnement ou crime écologique, on parle aussi d'écomafia
pour désigner les auteurs de ces crimes quand leurs méthodes sont
celles du crime organisé ; pour en savoir plus consulter le lien https :
//
fr.wikipedia.org/wiki/crime_environnemental.
86 Art. L 216-6 du code de l'environnement.
87 Art. L. 436-7, L 431-3, L 431-3, L 42-3, L 218-73,
du code de l'environnement.
88 Art. 410 et suivant de code de l'urbanisme.

51
présomption de faute a été
consacrée par la chambre criminelle de la cour de cassation dans une
décision rendue en date du 28 février 1956 en matière de
pollution d'eau. Il a ainsi été établi que pour que la
responsabilité pénale du chef d'entreprise soit engagée,
il n'est pas nécessaire que le chef d'entreprise soit présent sur
les lieux où l'infraction a été perpétrée.
Cependant, cette présomption de responsabilité peut être
levée en cas de délégation de pouvoirs à un
responsable d'exploitation « si elle ne porte pas sur l'ensemble des
pouvoirs de direction et si l'entreprise est d'une taille importante.
»89 Par conséquent, le responsable de l'exploitation
doit être doté « de la compétence, de
l'autorité ainsi que des moyens nécessaires »90.
Ainsi, le dirigeant ou le décideur d'une entreprise peut subir une
extension de la responsabilité pénale qui l'exposera aux peines
d'emprisonnement aux peines d'amende ainsi qu'aux peines complémentaires
prévues par la législation en vigueur.
De tout ce qui précède, il ressort que la
délégation de pouvoirs est une cause d'exonération de la
responsabilité. Toutefois, la jurisprudence précise qu'elle ne se
présume pas car si elle n'est pas nécessairement écrite,
elle doit résulter d'un organigramme91. Ce dispositif
législatif permet de contrecarrer les arguments des dirigeants et des
responsables des exploitations qui se réfugient très souvent
derrière l'échappatoire de la responsabilité personnelle
de la personne morale. Toutefois dans la pratique, en matière de droit
de l'environnement, la délégation de pouvoirs ne protège
pas suffisamment les dirigeants des personnes morales car lorsqu'elle est
orale, sa preuve devient difficile. Il importe à présent, de
présenter le régime juridique de la sanction pénale
applicable aux personnes morales.
Paragraphe II : Le régime de la sanction
pénale des personnes morales
Selon l'article 121-2 du code pénal : « les
personnes morales, à l'exclusion de l'Etat sont responsables
pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des
infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou
représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et
leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions
commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de
conventions de délégation de service public. La
responsabilité pénale des personnes morales n'exclue pas celle
des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article
121-3 ». Ce texte constitue le fondement juridique de la
responsabilité pénale des personnes morales. Les personnes
morales peuvent être définies
89 C. CASS, Crim.arrêt N° 76-90-895 du 02
mars 1977.
90 C. CASS. Crimop.cit.
91 C. CASS. Crim 26 Juin 1979 Bull. N° 232.

52
comme étant une expression désignant « une
construction juridique à laquelle la loi confère des droits
semblables à ceux des personnes physiques (nom, domicile,
nationalité, droit d'administrer et de céder un patrimoine
etc.... »92. Le législateur a défini
l'éventail des sanctions pénales pouvant être
prononcées à l'encontre de celles-ci lorsqu'elles ont commis par
l'exercice de leurs activités, des atteintes à l'environnement en
mettant un terme au principe de spécialité consacré par le
législateur de 1992 qui stipulait que les personnes morales
n'étaient responsables que « dans les cas prévus par la loi
ou par les règlements ». Le régime de la sanction
pénale des personnes morales se caractérisent par un
grossissement du quantum de la sanction pénale et par une automatisation
des peines complémentaires (A). Bien plus, le régime
répressif des groupes de sociétés suscite quelques
spécificités (B).
A- L'élargissement du quantum de la sanction
pénale et l'automatisation des peines complémentaires
Des sanctions pénales peuvent être
prononcées à l'encontre des personnes morales compte tenu du fait
qu'elles sont dotées de la personnalité juridique. Aux termes des
articles L 131-38 et 131-39 du code pénal, les personnes morales dont la
responsabilité pénale est établie sont passibles des
sanctions suivantes :
- l'amende prévue à l'article 131-38 du code
pénal, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est
égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques
par la loi qui réprime l'infraction ;
- la dissolution, lorsque la personne morale a
été créée c'est le cas en cas de création
d'une ICPE sans autorisation ni déclaration préalable.
- l'interdiction, à titre définitif ou
temporaire (ne pouvant excéder cinq ans)
- la fermeture définitive
- l'exclusion des marchés publics à titre
temporaire ou définitif (article 131-38)
- la confiscation du corpus délicti93
- La publication du jugement ou de l'arrêt qui selon
l'article 131-39 du code pénal peut se faire par la presse
écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie
électronique. Ainsi, la responsabilité pénale de la
personne morale peut être retenue en cas d'atteinte à
l'intégrité physique et/ou morale causés par les
préjudices et dommages environnementaux. C'est ce qui ressort de
l'arrêt AZF du 24 Septembre
92 S.BRAUDO, Dictionnaire du droit privé,
consulté sur le lien suivant :
www.dictionnairejuridique.com/définition/personnemorale.php
93 Objet ayant permis la commission de l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.

53
2012 où la cour d'Appel de Toulouse a infirmé la
décision du tribunal correctionnel de Toulouse rendue en date du 19
Novembre 2009 (Affaire MPC/Grande Paroisse SA et associés). La cour
d'Appel retient la responsabilité pénale de l'entreprise et de
son dirigeant pour les infractions d'homicides et blessures involontaires en se
basant sur la mauvaise gestion des déchets industriels produits par les
activités de l'entreprise et leur lien de causalité avec la
survenance de l'exploitation du bâtiment mis en cause, ce qui fait dire
à la doctrine que « les manquements constatés en
matière d'impératifs environnementaux servent de fondements
à l'engagement de la responsabilité pénale de l'entreprise
sur le terrain du droit pénal commun »94.
Bien plus dans la pratique de manquement d'une entreprise aux
engagements auxquels elle a volontairement souscrit peut être source de
responsabilité pénale, c'est pour cette raison que la doctrine
considère la responsabilité sociale de l'entreprise comme une
« source exponentielle de responsabilité pénale des
personnes morales en droit de l'environnement »95. C'est ainsi
que le délit de « pollution involontaire » a été
retenu par la cour de cassation baptisée « arrêt Erika
»96 contre la société TOTAL SA qui avait
manqué à son obligation de procéder au contrôle des
navires avant l'embarquement de ceux-ci en mer. La cour de cassation estime
qu'elle « n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient
»97.
Tout ce qui précède permet de ressortir les
différentes sources de la responsabilité pénale des
personnes morales ainsi que les différentes sanctions pénales qui
peuvent être prononcées, contre elles lorsqu'elles ont commis des
faits constitutifs d'atteinte à l'intégrité de
l'environnement. Cet état de choses nous amène à nous
appesantir sur le régime répressif des groupes de
société en droit français de l'environnement.
B- Le régime répressif des groupes de
sociétés
Le régime répressif des groupes de
sociétés nous permet de poser le problème de
l'imputabilité à la société mère aux
infractions environnementales commises par sa filiale98. En effet,
une société mère peut-elle être
déclarée pénalement responsable des infractions
environnementales commises par sa filiale ? Les principes de
l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie juridique veut
que la réponse soit entièrement négative. Cependant ayant
constaté l'impunité des infractions commises par la filiale, la
jurisprudence a admis que
94 E. DAOUD, C. LECORRE, Op.cit p.54.
95 E. DAOUD, C. LECORRE, Op.cit, p.55.
96 En raison du nom du Navire.
97 CASS. Crim., Jugement N° 10.82-938 du 25
septembre 2012.
98 E. DAOUD et C. LECORRE Op.cit, p.56.

54
compte tenu de l'universalité du droit de
l'environnement, la responsabilité pénale de la
société mère peut être retenue dans certaines
circonstances. Dans l'arrêt Erika (voir B infra), il a été
déclaré que « le droit de l'environnement devrait permettre
au regard d'un ordre public écologique, de passer outre l'autonomie
juridique des sociétés en situation de groupe. Le droit de
l'environnement apparaît ainsi comme un impératif supérieur
à ce principe d'indépendance des personnes morales ».
Ainsi, l'ordre public écologique permet de neutraliser
le principe de la responsabilité personnelle et d'éviter que les
groupes de société organisent leur « insolvabilité
environnementale par le truchement des filiales poubelles »99.
L'établissement de la responsabilité pénale de la
société mère permet l'application des sanctions
pénales prévues par les textes en vigueur (voir A infra) pour
concrétiser cette responsabilité la loi N° 2010-788 du 12
Juillet 2010 dite loi Grenelle 2 a inséré à l'article
512-17 du code de l'environnement des dispositions y relatives.
Cette insertion avait été préalablement
proposée par la loi N°2009-967 du 03 Août 2009 dite loi
Grenelle I qui déclarait en son article 53 que « la France
proposera l'introduction au niveau communautaire du principe de la
reconnaissance de la responsabilité des sociétés
mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteintes
graves à l'environnement et elle soutiendra cette orientation au niveau
international ». Cette disposition législative marque une forte
tendance à l'universalisation de la responsabilité pénale
de la société mère pour les infractions environnementales
commises par sa filiale.
De tout ce qui précède, il ressort que le
régime juridique de la sanction pénale connaît une
évolution constante marquée par une porte implantation de la
sanction pénale en droit de l'environnement et une structuration
rigoureuse des sanctions pénales encourues par les personnes morales. La
primeur de l'ordre public écologique constitue une base fondamentale du
droit français de l'environnement. Cependant, le dispositif
répressif à l'apparence sévère qui vient
d'être présenté se heurte dans sa mise en oeuvre, à
de nombreux obstacles car l'on constate une difficile intégration de la
sanction pénale en droit français de l'environnement.
SECTION II : LA DIFFICILE INTEGRATION DE LA SANCTION
PENALE
EN DROIT FRANÇAIS DE L'ENVIRONNEMENT
En France comme dans plusieurs pays, le problème de
l'efficacité du droit pénal de l'environnement se pose encore
avec acquitté. En effet, malgré l'implantation d'un
décor
99 S. MUPUY, La responsabilité environnementale
des groupes de société par le Grenelle : enjeux et perspectives
droit des sociétés N° 11, Novembre 2012, étude 16.

55
législatif en la matière, le droit pénal
de l'environnement et plus précisément la sanction pénale
a du mal à se faire une place. Ceci peut se ressentir au niveau des
insuffisances de la sanction pénale (Paragraphe I). Toutefois, comme
toute discipline, le droit français de l'environnement est perfectible.
C'est l'occasion de saluer les efforts entrepris par la doctrine pour
contribuer à l'amélioration et au renforcement de
l'efficacité de la sanction pénale, nous faisons allusion ici au
« rapport NEYRET » dont l'originalité a captivé le
gouvernement français en ce qu'il donne une lueur d'espoir au droit
pénal français de l'environnement (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les insuffisances de la fonction
pénale en droit français de l'environnement
Reconnu comme une valeur universelle, l'environnement est un
bien dont la préservation préoccupe toute la communauté
internationale au point où il devrait être intégré
parmi les normes de « jus cogens » en droit international
public100. Il ne fait plus aucun doute que la France a
érigé le droit de l'environnement aux normes des droits
universels et supérieurs car le « particularisme marqué des
incriminations de droit pénal de l'environnement »101 en
témoigne longuement. Cependant, la consécration de la sanction
pénale comme moyen dissuasif de répression qui constitue une
force du droit pénal français de l'environnement ne doit pas nous
faire perdre de vue que ce droit regorge de nombreuses faiblesses, ce qui fait
dire à la doctrine que « l'état actuel du dispositif
répressif marqué par de nombreuses particularités, oscille
entre forces et faiblesses »102. Dans le cadre de cette partie,
nous avons choisi de présenter quelques insuffisances relevées
car nous ne pouvons pas prétendre à l'exhaustivité. Ainsi,
les faiblesses de la sanction pénale en droit français de
l'environnement se caractérisent par l'inadéquation des sanctions
pénales (A) et par les défaillances relevées au niveau du
système coercitif (B).
A- Le problème de la proportionnalité de
la sanction à l'infraction commise
On note une tergiversation du législateur
français dans l'application des sanctions pénales. En effet, le
législateur se montre parfois indulgent pour des infractions
100 Du latin droit contraignant, elle est définie par
l'article 53 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 comme étant une
norme impérative acceptée et reconnue par la communauté
internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle
aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être
modifiée que par une nouvelle forme de droit international
général ayant le même caractère.
101V. JAWORSKI, « L'Etat du droit pénal
de l'environnement français: entre forces et faiblesses »,
téléchargeable sur le lien
http://id.erudit.org/iderudit/03934ar
, p.894
102 V. JAWORSKI opcit. P.889.

56

57
particulièrement graves. Ainsi, en matière de
protection de la nature, il existe de grandes lacunes, ce qui est
inquiétant compte tenu des enjeux qui se présentent. A titre
d'exemple, le droit pénal puni le vol simple d'une peine
d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros alors que le
droit de l'environnement réprime l'atteinte à la conservation des
espèces de faune ou de flore menacées extinction d'une amende de
neuf mille euros et d'un emprisonnement dont la durée maximale ne peut
excéder six mois d'amende. Est-ce à dire qu'une aiguille
volée aurait plus de valeur qu'une plante dont la survie est
nécessaire au maintien de l'équilibre écologique ? Nous
espérons que ce ne soit pas le cas car ce serait une bévue de
présenter les choses ainsi. L'inégale répartition des
sanctions est également présente au niveau de la protection des
espèces en voie de d'extinction cela se fait ressentir au niveau des
sanctions applicables en matière de perturbation des espèces : en
effet, celui qui cueille un edelweiss103 s'expose à une peine
d'emprisonnement de six mois et de 9 000 euros d'amende tandis que la
déstabilisation intentionnelle d'un faucon pèlerin entrain de
materner constitue une contravention de cinquième classe punie de 1500
euros d'amende alors même que ces faits sont susceptibles
d'entraîner l'éclosion d'un « bébé faucon
pèlerin » mort-né. Cet état de choses est
écoeurant compte tenu de l'ampleur des intérêts à
sauvegarder.
Bien plus, en matière de circonstances aggravantes, le
code de l'environnement n'a pas reconnu la récidive comme circonstance
aggravante pourtant dans l'ancien code de l'environnement, les peines encourues
étaient doublées en cas de récidive. C'est tout à
fait inquiétant compte tenu de l'impact que peut avoir la
récidive sur la protection de l'environnement. Serait-ce une «
erreur matérielle de recopiage »104 ? En tout
état de cause, nous appelons à la sagesse du législateur
pour nous éclairer sur la question.
De tout ce qui précède, il ressort que les
carences ou plutôt les lacunes présentées par les sanctions
pénales en droit français de l'environnement peuvent
manifestement fausser la politique du gouvernement français en
matière de protection de la nature. L'on se souvient encore de
l'enlèvement des dix-sept petits singes dans la nuit du 10 mai 2015 au
Zoo de Beauval qui a accablé toute la France entière. A
côté du problème de proportionnalité des sanctions
pénales, l'on note également des défaillances du
système coercitif.
B- Les défaillances du système coercitif
Les défaillances du système coercitif peuvent
être relevées à plusieurs niveaux.
103 Espèce de fleur protégée, souvent
utilisée en Suisse comme un emblème national.
104 V. JAWORSKI Op.cit p.911.
D'abord, la technicité des textes entraîne leur
appréhension difficile par les autorités habiletés
à lutter contre la criminalité environnementale ceci fait en
sorte que le droit de l'environnement soit une discipline peu accessible.
Parfois, les services de police judiciaire ne disposent pas les
compétences techniques et les moyens matériels adéquats
pour exercer leurs fonctions en toute sérénité.
Ensuite, l'on note un manque d'harmonisation et de
coordination des procédures pénales car les administrations
chargées du contrôle des activités polluantes en
matière ICPE sont réparties de façon inégale et
inopérante (mairie, préfecture, ministère de
l'environnement etc.).
Enfin, le recours aux modes alternatifs de règlement
des conflits entraîne très souvent l'abandon des poursuites. En
effet, la transaction est souvent employée par le Ministère
public pour contrecarrer les lenteurs judiciaires notamment en matière
de pollution des eaux, des infractions commises dans les parcs nationaux et
dans le domaine de la pêche. Cet état de choses entraîne une
faiblesse du contentieux car selon un rapport du Ministère de la Justice
en 2003 sur sept paquets d'Ile de France, le taux de classement sans suite des
affaires dites « poursuivables » était de 53% en
matière environnementale contre 32% pour le contentieux pénal
général. Ceci « explique qu'un nombre modeste de
condamnations pénales sanctionnent les atteintes à
l'environnement »105.
De tout ce qui précède, il ressort que l'arsenal
juridique mis en place par le législateur français se heurte
à de nombreuses entraves tant dans sa mise en oeuvre que dans la
répartition inégale des sanctions pénales. Pour y
remédier, le rapport NEYRET propose des axes.
Paragraphe II : Le rapport NEYRET : lueur d'espoir du droit
pénal de l'environnement
Baptisé « rapport NEYRET » en raison de son
nom, le Professeur Laurent NEYRET a rédigé un rapport qui a
été remis au Ministère de la Justice Garde des Sceaux Made
Christiane TAUBIRA le 17 septembre 2013. Ce rapport qui fait l'objet de ce
paragraphe a le mérite de présenter les limites du droit
pénal français de l'environnement et propose des solutions pour y
remédier (A), ce qui a valu son adoption par le législateur
français (B).
105 CHAUMONT, Op.cit, p.146.

58
A. Le contenu du rapport NEYRET
Le rapport NEYRET fait l'état du droit pénal de
l'environnement en insistant sur ses faiblesses. Le rapport NEYRET note une
défaillance manifeste du droit pénal français de
l'environnement dans la lutte contre la criminalité environnementale.
Ainsi, le manque d'accessibilité et de lisibilité des textes, les
peines rarement dissuasives et la timidité des juges constituent les
principales faiblesses du droit pénal français de l'environnement
selon le professeur NEYRET. Bien plus, le rapport note une disparité des
sanctions en matière de criminalité environnementale. Face
à cette situation déplorable, le professeur NEYRET propose un
éventail de solutions.
Le rapport NEYRET propose ainsi une harmonisation des
sanctions pénales entre les Etats du monde, la création d'un code
pénal des délits de mise en danger et d'atteinte à
l'environnement, la création d'un réseau national
dédié à la sécurité environnementale, le
renforcement des contrôles des autorités chargées de
veiller à la sauvegarde de l'environnement. En outre, pour pallier
à la timidité des juges, le rapport propose l'instauration d'une
cour pénale et d'un procureur international de l'environnement et
propose d'octroyer au juge la possibilité d'accroître les peines
d'amende encourues par les entreprises auteurs d'infractions environnementales
à un taux de rentabilité de 10% du chiffre d'affaire moyen annuel
de ces entreprises auteurs de troubles écologiques.
Bien plus, l'un des plus remarquables travaux du professeur
NEYRET est sans doute la proposition de l'intégration du
préjudice écologique dans le code civil, ainsi que
l'élévation de l'écocide au rang de crimes contre
l'humanité106.
De tout ce qui précède, il ressort que le
rapport NEYRET peut être considéré comme l'expression du
« ras le bol » des populations françaises en ce qu'il donne
une piste de solutions afin de résoudre le problème de la
délinquance environnementale qui ne cesse de gagner du terrain, c'est
d'ailleurs ce qui a valu sa présentation aux membres du parlement
français. Il convient néanmoins d'analyser la portée.
B. La portée du rapport NEYRET
Le rapport NEYRET a été rédigé
dans le but d'instaurer un ordre public en matière environnemental
confortable et équitable c'est-à-dire soucieux de
préserver les intérêts de tous et chacun en garantissant le
développement durable. L'adoption ou alors l'intégration des
106 Pour plus de détails, lire L. NEYRET (sous la dir),
des crimes à l'écocide, le droit pénal au secours de
l'environnement, Editions Bruylant.

59
propositions contenues dans le rapport NEYRET contribuerait
à baisser ou à diminuer considérablement la
criminalité environnementale qui sévit en France comme dans tous
les Etats du monde. Le rapport NEYRET a séduit les membres du
gouvernement français à plus d'un titre, on peut le prouver par
le projet de loi qui a été présenté à
l'intégration du préjudice écologique dans le code
civil.
En tout état de cause, la prise en compte du rapport
NEYRET par le législateur français contribuera à renforcer
l'efficacité de la sanction pénale en droit français de
l'environnement en particulier et pourra inspirer le législateur
camerounais et ceux des autres Etats signataires des AME, à renforcer
également l'efficacité de la sanction pénale en droit de
l'environnement dans leurs pays respectifs.
Tous les développements précédents nous
permettent de mieux apprécier le degré d'intégration de la
sanction pénale en droit français de l'environnement. La sanction
pénale est considérée à côté de
l'évaluation, de la sensibilisation et la participation environnementale
comme un moyen efficace de promotion de l'environnement. Toutefois,
l'application de la sanction pénale n'est pas toujours évidente
compte tenu des divers facteurs qui interviennent. Il est donc question de
renforcer l'efficacité de la sanction pénale.
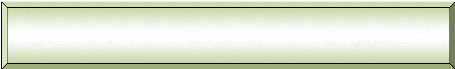
CONCLUSION GÉNÉRALE

60

61
La sanction pénale en droit de l'environnement est une
notion dont les contours restent difficiles à cerner tant en droit
camerounais qu'en droit français. Certes, les législateurs
camerounais et français se sont attelés à
réglementer et à instaurer un cadre juridique de protection de
l'environnement mais il en demeure que celui-ci laisse un goût
d'inachevé.
Au regard des développements et des analyses faites
dans ce travail, il ressort que la sanction pénale en droit de
l'environnement est une notion qui préoccupe tous les partenaires
sociaux ainsi que la communauté internationale des Etats dans son
ensemble. Comme nous l'avons dit plus haut les problèmes
environnementaux préoccupent tous les Etats quelle que soit leur forme,
leur régime politique ou leur situation géographique. Pour
assurer la protection de l'environnement, la promotion du développement
durable, la mise sur pied d'un régime plus répressif
s'avère être une urgence ».
Dans la première partie de notre travail, il
était question pour nous de présenter la sanction pénale
comme étant un concept partagé par les droits camerounais et
français. Pour y parvenir, nous avons dans un premier temps ressortir la
problématique de l'autonomie du droit pénal de l'environnement
car il est clair que l'on ne saurait parler de sanction pénale sans
mettre en exergue le problème de son autonomie. Sur ce point, il est
apparu que le droit pénal de l'environnement est une discipline nouvelle
qui tire ses origines de plusieurs disciplines à savoir le droit
pénal, le droit de l'environnement et cet état de chose rend
difficile son acceptation comme une discipline autonome. Sur ce point deux
thèses s'affrontent à savoir la thèse positiviste pour qui
le droit pénal de l'environnement serait une discipline autonome car
elle a un objet et une méthode qui lui sont propres et la thèse
négativiste qui veut que le droit pénal de l'environnement soit
une discipline « accessoire au droit de l'environnement régissant
les sanctions pénales qui donnent force à ses prescriptions
»107. Pour trancher le débat, nous avons estimé
qu'il serait plus méthodique d'opter en faveur d'une thèse
intermédiaire qui intègre à la fois les
éléments de la thèse positiviste et ceux de la
thèse négativiste ce qui permettrait de clore ce débat
houleux. L'accroissement de la criminalité environnementale a
pratiquement forcé le Cameroun et la France à s'armer d'un droit
de l'environnement qui était à l'origine inoffensif vers un droit
désormais offensif. La sanction pénale permet donc au droit de
l'environnement de retrouver toute sa vitalité. En droit camerounais,
tout comme en droit français, la quasi-totalité des textes
règlementant une branche du droit de l'environnement comportent des
dispositions pénales ce qui permet au droit pénal de
l'environnement de s'enrichir.
107 J-H Robert et M. Rémon GOUILOUD, Droit Pénal de
l'environnement, MASSON, 1983, N°4.

62
Dans la seconde partie de notre travail, il était
question de ressortir la spécificité du régime juridique
de la sanction pénale en droit camerounais par rapport au droit
français. Nous avons constaté que le législateur
camerounais a prévu un régime hybride de la sanction
pénale en distinguant celui des personnes physiques et celui des
personnes morales. Le régime de sanction des personnes physiques se
caractérise par une rigueur dissuasive tandis que celui des personnes
morales se caractérise par une souplesse mesurée certainement
à cause des impératifs de développement. Cependant, ce
régime juridique souffre de nombreuses insuffisances dans sa mise en
oeuvre car celle-ci se heurte au manque de spécialisation des juges
camerounais droit de l'environnement ainsi qu'au laxisme des autorités
compétentes en matière de constatation des infractions. En outre,
la transaction au lieu de contribuer à la baisse de la
délinquance environnementale constitue plutôt un facteur
d'augmentation des atteintes à l'environnement au point de se demander
si la transaction a encore sa place en droit de l'environnement compte tenu du
fait qu'elle vient plutôt ajouter de l'huile au feu.
Quant au droit français, le régime juridique de
la sanction pénale en droit de l'environnement se montre beaucoup mieux
étoffé car ici on note un grossissement du quantum de la sanction
pénale des personnes morales et une automatisation des peines
complémentaires car le montant de l'amende va jusqu'à cinq fois
le montant de celle encourue par les personnes physiques. Toutefois, la
sanction pénale souffre de nombreux maux en droit pénal de
l'environnement français car la problématique de la restitution
intégrale demeure et la complexité des textes entraîne une
accessibilité difficile. Face à ceci, l'on attend toujours que le
parlement français adopte le rapport NEYRET qui viendrait faciliter un
certain nombre de choses et améliorerait à coup sur le "climat
environnemental" français.
La sanction pénale est d'une utilité pratique
pour tout Etat qui veut améliorer son cadre juridique de protection de
l'environnement. C'est une mesure qui permet d'assurer un confort raisonnable
aux populations et une préservation durable des
écosystèmes. Dans les PVD comme le Cameroun, on a assisté
à de nombreuses tragédies qu'on aurait pu éviter si un
certain nombre de dispositions avaient été prises. A titre
d'exemple, on peut citer la catastrophe de NSAM qui s'est produite le 14
février 1998, grand incendie qui a semé la terreur dans la ville
de Yaoundé capitale du Cameroun avec un bilan de 250 morts, 500
blessés et plusieurs déplacés
environnementaux108, résultat d'un incivisme des entreprises
qui
108 J.J. POUMO LEUMBE, Catastrophes et droits de l'homme au
Cameroun, rapport des enquêtes de terrain CRIDEAU / OMIJ, 30 Juillet
2012.P.7

63
sont plus préoccupées à réaliser
des bénéfices sans tenir compte des risques qu'une simple
négligence peut causer. L'Etat camerounais s'était battu à
réparer les préjudices subies par les populations mais celles-ci
n'ont jamais été satisfaites car dans un pays où la
réparation est considérée comme étant une «
faveur »109 l'on a tendance à tolérer tout. Dans
le bilan dressé par les autorités compétentes, on n'a
noté aucune condamnation au pénal, ce qui est tout à fait
ahurissant.
La sanction pénale est une solution indispensable au
renforcement de l'efficacité du droit de l'environnement et son
intégration effective que ce soit en droit camerounais ou en droit
français ne peut se faire que par la prise en compte des faiblesses qui
ont été relevées dans les développements
précédents, étant donné que la problématique
de la responsabilité pénale en droit de l'environnement demeure
une préoccupation constante.
Fort de ceci, une question lancinante apparaît : la
sanction pénale est-elle la seule solution pour lutter efficacement
contre les atteintes à l'environnement ?
A cette question, nous répondons par la négative
car depuis peu, on assiste à l'émergence de plusieurs types de
mesures impulsées par la Convention-Cadre sur les changements
climatiques et le protocole de Kyoto et ratifiées par les gouvernements
camerounais et français, dans le but de prévenir la
dégradation de l'environnement. Au rang de ces mesures nous pouvons
citer :
? Le financement des programmes de sensibilisation,
d'éducation et d'échanges d'expériences sur
l'environnement conduits par les associations et ONG environnementales. Au
Cameroun par exemple, l'article 75 de loi cadre de 1996, relative à la
gestion de l'environnement stipule que toute opération contribuant
à enrayer l'érosion, à combattre efficacement la
désertification, ou toute opération de boisement ou de
reboisement, toute opération contribuant à promouvoir
l'utilisation rationnelle des ressources renouvelables, notamment dans les
zones de savane et la partie septentrionale du pays bénéficie
d'un appui du Fonds prévu par ladite loi. En France, l'article 13-III de
la loi N° 2009/967 du 3 Août 2009 de programmation relative à
la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement dite Grenelle 1 dispose qu'en
matière des transports un programme estimé par les
collectivités locales à 18 millions d'euros d'investissements. A
titre illustratif, le gouvernement a prévu un
109 J. J. POUMO LEUMBE, op.cit. p.7.

64
financement à concurrence de 2,5 milliards d'euros aux
projets obéissant aux objectifs de désenclavement des
quartiers.
? L'adoption de mesures incitatives accordées aux
promoteurs de projets faisant la promotion de technologies propres visant le
développement d'une économie verte, moins émettrice de gaz
à effet de serre. A titre d'exemple, l'article 76 de la loi cadre
relative à la gestion de l'environnement au Cameroun stipule que «
les entreprises industrielles qui importent des équipements leur
permettant d'éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs
produits les gaz à effet de serre notamment le gaz carbonique, le
chloro-fluoro-carbone, ou de réduire toute forme de pollution
bénéficient d'une réduction du tarif douanier sur ces
équipements dans les proportions et une durée
déterminés, en tant que de besoin, par la loi de Finances. Cet
article stipule en outre que les personnes physiques ou morales qui
entreprennent des actions de promotion de l'environnement
bénéficient d'une déduction sur le bénéfice
imposable suivant des modalités fixées par la loi de Finances. En
France, l'article 18 paragraphe 2 de la loi grenelle précitée,
l'Etat s'engage à favoriser le développement des énergies
renouvelables par la mise en place des mécanismes incitatifs pour
favoriser la conception et la fabrication des produits et de
procédés permettant de réduire les consommations
d'énergie et de produire des énergies renouvelables notamment par
les PME.
? La création de taxes spéciales retenues comme
un moyen pouvant permettre l'assainissement du milieu environnemental par
l'encouragement des comportements plus respectueux de l'environnement. Au
Cameroun comme en France, on assiste de plus en plus à l'adoption de
mesures fiscales à titre d'exemple, on peut citer les la taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP) et les
marchés de permis en France. Au Cameroun, la fiscalité
environnementale se fait également ressentir en matière
pétrolière et gazière. C'est le cas de la taxe
spéciale sur les produits pétroliers instituée par la loi
des finances 1984/1985 et la taxe sur le chiffre d'affaires devenue taxe sur la
valeur ajoutée.
Pour clore notre étude, nous pouvons affirmer que la
sanction pénale est nécessaire
pour réprimer les atteintes à l'environnement,
mais les législateurs ont bien raison de développer des mesures
incitatives visant à prévenir les atteintes à
l'environnement car le dicton : « prévenir vaut mieux que
guérir » est très adapté à tout ce qui
concerne l'environnement, un bien d'intérêt général,
dont les dégâts qu'il subit sont parfois irréversibles et
peuvent entraîner la destruction partielle ou totale de nos
écosystèmes.
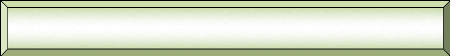
BIBLIOGRAPHIE

65
A- OUVRAGES GENERAUX :
C. BERGER, J. L. ROQUES, La terre comme objet de convoitise :
appropriation, exploitation, dégradation, l'Harmattan, 2008, Paris.
M. C. BEAUD et M. LARBI BOUGUERRA (Sous la dir), L'état
de l'environnement dans le monde, la découverte, fondation pour le
progrès de l'Homme (FPH) (UNESCO), Avril 1993, Paris.
S. BRAUDO, Dictionnaire du droit privé
téléchargeable sur le site www. Dictionnaire
juridique.com.
B- OUVRAGES SPECIALISES
Actes de Porto-Novo, Réunion consécutive du
comité sur l'environnement de l'AHJUCAF du 26 Juin 2008 sur le droit
pénal de l'environnement.
J-H Robert et M. REMON GOUILOUD, Droit Pénal de
l'environnement, MASSON, 1983, N°4.
N. BAILLON, N. NAHMIAS, E. SACKSICK, Pratique du droit de
l'environnement (ICPE, Droit de l'eau, grands projets d'infrastructures, DUP,
sols pollués), éditions Lemoniteur, Paris 2006.
C-MÉMOIRES
(C.F.A) MATCHUM KOUOGUE, La protection juridique de
l'environnement au Cameroun et en France : le cas des nuisances sonores,
Université de Limoges, mémoire de Master II en Droit
International et Comparé de l'Environnement option Droit Comparé
de l'Environnement, Septembre 2009.
(P) MULAMBULWA OMARI, Analyse du régime
répressif en droit Congolais : cas de l'infraction tentée,
mémoire de Master II en droit, option carrières judiciaires,
université de Kindu, 2008
(R.L) La gestion des déchets dangereux au Cameroun,
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Université
de Yaoundé II - Master en relations internationales, option diplomatie,
spécialité contentieux international 2012
(S. B) OUATTARA, « sanction pénale »,
université de Bamako, carrières judiciaires, 2009.
La thématique de l'environnement dans la jurisprudence de
la cour internationale de justice. » Serge ITOUROU SONGUE, Institut des
Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master II, 2011.

66
D- ARTICLES DE DOCTRINE :
« Le droit pénal de l'environnement sera-t-il
plus efficace à l'avenir ? » par Laurent Radisson, Cabinet
GREEN LAW AVOCAT.
B. JALUZOT, « Méthodologie du droit
comparé : bilan et perspectives », Revue internationale de
droit comparé, 2005, volume 57, PP.29-48.
D. GAILLARDOT, « Les sanctions pénales
alternatives », RIDC, N°2, Volume 46, 1994, P.683.
E. DAOUD, C. LE CORRE « La responsabilité
pénale des personnes morales en droit de l'environnement »
BDEI N° 44 Mars 2013.
J. LASSERE CAPDEVILLE, « le droit pénal de
l'environnement : un droit encore à l'apparence redoutable et à
l'efficacité douteuse », in sauvegarde de l'environnement en
droit pénal, Nérac-Croisier (sous la dir), l'Harmattan,
collection « Sciences criminelles », 2007.
J. MONGIN, E. DAOUD, « Le droit pénal demeure il
étranger à la notion de « développement durable
?» rien n'est moins sûr » Revue AJ pénal
N°403, Pratiques et professions N°10 du 10 octobre 2009.
K. MBAYE, « Le droit au développement
», Éthiopiques (RNALP), Numéro 21, Janvier 1980,
P.1).
D. ROETS, Cours de droit comparé de l'environnement, le
droit français partie 4, la
responsabilité pénale, Université de
Limoges, Master II, 2014-2015.
M. VAN de KERCHOVE, « Les fonctions de la sanction
pénale », Informations sociales N° 127, CNAF, 2005,
P.22.
E- DECLARATIONS, CHARTES, CONVENTIONS ET PACTES
Convention sur la protection de l'environnement par le droit
pénal, Strasbourg, 4.XI.1998. Charte Africaine des droits de
l'homme et des peuples adoptée le 28 juin 1981 à Nairobi.
F-LEGISLATION Cameroun :
1. Constitution du 18 janvier 1996.
2. Loi de 1967 portant code pénal.
3. La loi cadre de 1996 sur la protection de l'environnement.
4. Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des
forêts, de la faune et de la pêche.
5. Loi N°89/027 du 29 décembre 1989 - portant sur
les déchets toxiques et dangereux.
6. Loi N°98/015 du 14 Juillet 1998 relative aux
établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
7.

67
Loi N°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de
l'eau.
8. Loi N°2004/003 du 21 avril 2004 portant régissant
l'urbanisme au Cameroun.
9. Loi N°2011/022 du 14 décembre 2011
régissant le secteur de l'électricité au Cameroun.
10. Loi N°2003/007 du 10 Juillet 2003 régissant les
activités du sous-secteur engrais au Cameroun.
11. Loi N°2002/013 du 30 décembre 2002 portant code
gazier.
12. Loi N°99 /013 du 22 décembre 1999 portant code
pétrolier.
13. la loi portant code minier.
France :
1. Journal officiel de la République française
du13 juillet 2010 portant publication de la loi N°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l'environnement (Loi Grenelle).
2. Journal officiel de la République française
du 05 août 2009 portant publication de la loi N°2009-967 du 03
Août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du
Grenelle de l'environnement.
3. Code pénal français.
4. La loi de 1995 sur la protection de l'environnement.
5. La loi de portant code minier.
6. La loi sur les déchets.
7. La loi sur l'eau.
8. La loi 76.663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement.
9. La loi 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à
la lutte contre le bruit.
10. La loi sur l'air.
11. La loi portant code de l'urbanisme.
WEB BIBLIOGRAPHIE:
http://fr.wikipedia.org.
www.ahjucaf.org/Rapport-de-la-cour-suprême-du
6715.html.
www.dictionnairejuridique.com/définition/
http://id.erudit.org/iderudit/03934
www
cours-de-droit.net.
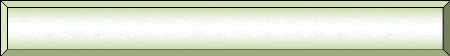
TABLE DE MATIERES

68
SOMMAIRE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES ABREVIATIONS iv
INTRODUCTION GENERALE 1
II-CADRE CONCEPTUEL DU SUJET 2
III- DELIMITATION DU SUJET 3
IV- PROBLÉMATIQUE 4
V- INTERET DU SUJET 5
VI- CHOIX METHODOLOGIQUE 5
VII-REVUE DE LA LITTÉRATURE 5
VIII- PLAN DE RECHERCHE DES RESULTATS 6
Ière PARTIE : LA SANCTION PENALE, UNE NOTION
COMMUNE AUX DROITS
CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS 7
CHAPITRE I : LE CONCEPT DE SANCTION PENALEEN DROIT
9
DE L'ENVIRONNEMENT 9
SECTION I : LA PROBLEMATIQUE DE L'AUTONOMIE DU DROIT
PENAL DE
L'ENVIRONNEMENT 9
Paragraphe I : La controverse doctrinale 10
A- La thèse positiviste 10
B- La thèse négativiste 11
Paragraphe II : La thèse intermédiaire 11
A- Le contenu de la thèse intermédiaire 12
B- La portée de la thèse intermédiaire
13
SECTION II : LA FINALITE DE LA SANCTION PENALE EN DROIT DE
L'ENVIRONNEMENT 14

69
Paragraphe I : Les finalités traditionnelles de la
sanction pénale 15
A- Les fonctions d'intimidation et de rétribution de la
sanction pénale 15
B- La fonction de réinsertion de la sanction
pénale 16
Paragraphe II : Les fonctions spécifiques de la
sanction pénale en droit de
l'environnement 16
A- La finalité sociale de la sanction pénale en
droit de l'environnement : la remise en
état des lieux 17
B- La fonction économique de la sanction pénale en
droit de l'environnement 17
CHAPITRE II : LA RECONNAISSANCE DE LA SANCTION PENALE
COMME MOYEN EFFICACE DE REPRESSION DES ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT
19
SECTION I : LA PRESERVATION DE
L'INTEGRITE DE L'ENVIRONNEMENT : UNE PREOCCUPATION CONSTANTE DE LA COMMUNAUTE
INTERNATIONALE
19
Paragraphe I : La reconnaissance de l'environnement
comme un patrimoine commun de
l'humanité 20
A- La « terre » : objet de désirs
immodérés ? 20
B- L'acceptation de la sanction pénale comme une
valeur universelle 21
Paragraphe II : La reconnaissance de l'environnement
comme instrument de promotion
du développement durable 22
A- La sanction pénale au secours du développement
durable 22
B- La sanction pénale en droit de l'environnement : un
moyen d'achèvement de la mise
en oeuvre de l'Agenda 21 23
SECTION II : LES AXES
D'ENRACINEMENT DE LA SANCTION PENALE EN
DROITS DE L'ENVIRONNEMENT CAMEROUNAIS ET FRANÇAIS
24
Paragraphe I : L'intégration des dispositions spécifiques
réprimant les atteintes à
l'environnement en droits camerounais et français 25
A- Les dispositions pénales contenues dans les lois
relatives à la protection de
l'environnement en droit camerounais 25
B- Les dispositions pénales contenues dans les lois
relatives à la protection de
l'environnement en droit français 27
Paragraphe II : La
technique de l'aggravation comme moyen de renforcement de l'efficacité
de la sanction pénale en droits camerounais et français de
l'environnement . 28
A-

70
L'aggravation de la peine en raison du statut procédural
du délinquant 28
B- L'aggravation de la peine par l'instauration des peines
complémentaires 29
DEUXIEME PARTIE: LA SANCTION PENALE :
REGIMES JURIDIQUES DISTINCTS EN DROITSFRANÇAIS ET CAMEROUNAIS DE
L'ENVIRONNEMENT
31
CHAPITRE I : LA SANCTION DES ATTEINTES A
L'ENVIRONNEMENT EN
DROIT CAMEROUNAIS 33
SECTION I : UN REGIME
HYBRIDE DE LA SANCTION PENALE EN DROIT
CAMEROUNAIS 34
Paragraphe I : Une « rigueur
affirmée » du législateur camerounais quant aux sanctions
encourues par les personnes physiques 34
A- L'instauration de fortes peines d'emprisonnement 34
B- L'absence du bénéfice des circonstances
atténuantes du sursis en droit camerounais
de l'environnement 36
Paragraphe II : Une « souplesse
mesurée » du législateur camerounais quant aux
sanctions pénales encourues par les personnes morales
37
A- Le recours à de fortes peines d'amendes par le
législateur camerounais 37
B- Les exigences de développement : principal motif de
l'indulgence du législateur 39
SECTION II : LES FAIBLESSES DE LA
SANCTION PENALE EN DROIT
CAMEROUNAIS DE L'ENVIRONNEMENT 40
Paragraphe I : Le laxisme
des autorités compétentes en matière de répression
des atteintes
à l'environnement : les faiblesses d'ordre institutionnel
40
A- Les carences inhérentes aux autorités
compétentes en matière de répression, des
atteintes à l'environnement 40
B- L'insuffisance de ressources financières et
humaines 42
Paragraphe II : L'effritement de la sanction pénale par
le recours à la transaction : les
faiblesses d'ordre procédural 43
A- La nature juridique de la transaction en droit de
l'environnementcamerounais 43
B- La portée judiciaire de la transaction : la paralysie
de la sanction pénale 44
CHAPITRE II : LA SANCTION DES ATTEINTES A
L'ENVIRONNEMENT EN
DROIT FRANÇAIS 47

71
SECTION I : LE REGIME DE LA SANCTION PENALE EN DROIT
FRANÇAIS DE
L'ENVIRONNEMENT 48
Paragraphe I : Le régime de la sanction pénale des
personnes physiques 48
A- La nomenclature des sanctions pénales applicables aux
personnes physiques 49
B- Le cas particulier des sanctions pénales applicables
au dirigeant d'une personne
morale 50
Paragraphe II : Le régime de la sanction pénale des
personnes morales 51
A- L'élargissement du quantum de la sanction
pénale et l'automatisation des peines
complémentaires 52
B- Le régime répressif des groupes de
sociétés 53
SECTION II : LA DIFFICILE INTEGRATION DE LA
SANCTION PENALE EN DROIT
FRANÇAIS DE L'ENVIRONNEMENT 54
Paragraphe I : Les
insuffisances de la fonction pénale en droit français de
l'environnement 55
A- Le problème de la proportionnalité de la
sanction à l'infraction commise 55
B- Les défaillances du système coercitif
56
Paragraphe II : Le rapport NEYRET : lueur d'espoir du droit pénal
de l'environnement 57
A- Le contenu du rapport NEYRET 58
B- La portée du rapport NEYRET 58
CONCLUSION GÉNÉRALE 60
BIBLIOGRAPHIE 65
TABLE DE MATIERES 68
| 


