CHAPITRE III : UNE PARTICIPATION EFFECTIVE
DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON
GOUVERNEMENTALES AU DEVELOPPEMENT
DE LA REGION
CENTRE DU CAMEROUN
46
INTRODUCTION
De manière générale, les organisations
non gouvernementales se donnent pour mission de participer au
développement socio-économique des localités dans
lesquelles elles exercent leurs activités. Leurs actions sont souvent
plus visibles à travers des interventions dans des zones de conflit, des
régions de forte crise alimentaire ou suite à des catastrophes
naturelles. Elles viennent ainsi en aide aux victimes et leurs apportent
l'assistance d'urgence et les secours de première
nécessité à travers l'aide médico-sanitaire,
alimentaire, sécuritaire, logistique... Dans le cas du Cameroun, plus
précisément dans la région du Centre, l'absence de
conflits armés depuis la fin de la lutte pour l'indépendance dans
les années 1960 donne à penser que l'environnement
politico-social peut être qualifié de paisible, sinon stable. De
plus, la région est restée à l'abri des catastrophes
naturelles entre 1960 et 2010. Par ailleurs, malgré la condition
préoccupante de la sécurité alimentaire dans certaines
zones du pays (cas du Grand Nord), la région du Centre ne court pas un
risque de crise alimentaire sérieux, quoique la situation se soit
considérablement dégradée ces dernières
années.50 Au regard du tableau ainsi brossé, l'on
pourrait s'interroger, non sans pertinence, sur la nécessité et
même l'opportunité de la présence des OING dans notre pays
en général, et dans la région du Centre en particulier.
Le paradoxe apparent précédemment décrit
s'estompe dès lors qu'on tient compte du fait que l'action des OING ne
se limite guère à la seule aide humanitaire, encore moins
à l'humanitaire dit d'urgence. En effet, il convient de distinguer ici
l' « humanitaire d'urgence »,
50 Le Cameroun est considéré comme un
Pays à Faible Revenu et à Déficit Vivrier (PFDRV) et
classé au 144ème sur 177 pays dans le rapport 2007 de
développement humain du PNUD. Près de 25% de la population
camerounaise était touchée par l'insécurité
alimentaire avant le début de la crise alimentaire mondiale de 2008,
40.2 % de sa population vit au-dessous du seuil de pauvreté (1 dollar EU
par jour) et 70% dépendent des activités agropastorales.
47
l'« humanitaire de reconstruction » et l' «
humanitaire de développement ». Le premier renvoie à
l'assistance apportée aux victimes de crises diverses (crise
alimentaire, conflit armé, catastrophe naturelle...) en leur fournissant
les soins primaires, les premiers secours, les produits de première
nécessité, la logistique... Il s'agit de soulager les besoins
immédiats des populations vulnérables, ou rendues ainsi par le
fait d'une situation de crise donnée. C'est donc une aide qui se
déploie dans l'extrême nécessité. Par
conséquent, sa durée dans le temps est assez limitée. Elle
prend fin dès lors que les risques représentés par la
situation d'urgence sont réduits, voire maîtrisés. La
seconde forme d'aide humanitaire, renvoie à la réhabilitation des
infrastructures détruites lors des catastrophes et grandes crises. La
dernière forme à laquelle la plupart des professionnels
s'accordent à réserver le substantif de « coopération
au développement », s'inscrit quant à elle dans une
dynamique de plus long terme. En effet, elle renvoie aux diverses actions
menées par les OING pour accompagner les Etats dans leurs politiques de
développement. Ces actions se situent en droite ligne des programmes
gouvernementaux et se consacrent à des secteurs de développement
précis. Les institutions étatiques bénéficient de
l'expertise de ces structures ainsi que des financements qu'elles mobilisent,
afin de mener avec force et pertinence les actions définies par le
gouvernement dans la poursuite de ses axes prioritaires de
développement. C'est justement cette forme d'assistance humanitaire que
l'on retrouve principalement dans la région Centre du Cameroun. Il
devient dès lors capital de s'interroger sur la réalité de
la participation de ces structures au développement de ladite
région, de découvrir les modalités de leurs interventions
et de scruter l'environnement dans lequel leurs actions sont menées. De
prime abord, il apparaît que l'oeuvre des ONG internationales dans ladite
région durant le cinquantenaire qui constitue notre période
d'étude est caractérisée par une diversité et une
pluralité qui transparaissent non seulement à travers leurs
identités (section I), mais aussi par le biais des actions
concrètes menées par celles-ci sur le terrain (section II).
48
Section I) Un profil pluriel des organisations
internationales non gouvernementales présentes dans la région
Centre du Cameroun
Les OING oeuvrant dans la région du Centre
présentent quelques similitudes, mais en général, elles
diffèrent profondément les unes des autres. Elles sont toutes
d'origine occidentale, exception faite d'INADES Formation, qui est une
association internationale africaine. Quant aux divergences, elles sont plus
nombreuses et portent sur une multitude de points, allant des objectifs
principaux jusqu'aux ressources humaines et financières, en passant par
les domaines d'intervention, la nature, le public cible etc. Cette
disparité d'éléments caractéristiques décrit
une mosaïque hétérogène qui s'avère
difficilement intelligible, si l'on ne dispose pas de repères et
d'outils de catégorisation pouvant nous servir de clé de lecture.
A cet effet, il nous revient d'une part d'effectuer une classification de ces
organisations en fonction des diverses caractéristiques propres à
chacune d'entre elles (A), et d'autre part, de donner une description
panoramique de l'environnement dans lequel elles évoluent, ainsi que du
cadre des différents partenariats mis en place (B).
Paragraphe A) Caractéristiques et classification des
organisations internationales non gouvernementales présentes dans la
région du Centre
Dans le cadre de cette étude, les données
recueillies auprès des OING présentes dans la région du
Centre nous ont permis d'élaborer une classification de ces
dernières. En effet, plusieurs critères peuvent être
retenus pour distinguer ces différentes organisations. Sans
prétendre à une classification exhaustive, il ressort des
résultats51 de cette étude que cette
caractérisation peut être faite sur la base de deux principaux
groupes d'éléments majeurs, et distinguer ainsi d'un
côté les critères identitaires que sont la nature, la
période d'établissement, le positionnement envers l'Etat
d'origine...(1) et de l'autre, les critères d'effectivité
représentés par les domaines d'intervention, les ressources
financières, les ressources humaines...(2).
51 Voir tableau des données ci-dessous.
49
Tableau 1: Synthèse des données recueillies
auprès des OING52
|
#
|
Organisation
|
Période
d'établissement
|
Personnel
|
Ressources
financières
|
|
|
Avant
1990
|
A partir de 1990
|
Hommes
|
Femmes
|
National
|
Intl.
|
(en euros)
|
|
1
|
COE
|
1970
|
|
204
|
214
|
397
|
21
|
2.389. 635
|
|
2
|
Care Cameroun
|
1983
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Catholic Relief Services
|
1961
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Counter Part International
|
|
2008
|
19
|
16
|
34
|
1
|
4.001.786
|
|
5
|
Fairmed
|
1960
|
|
25
|
11
|
34
|
2
|
1.524.490
|
|
6
|
France Volontaires
|
1964
|
|
3
|
1
|
2
|
2
|
|
|
7
|
Geoaid Cameroun
|
|
2008
|
5
|
1
|
5
|
1
|
|
|
8
|
Global Viral
Forecasting Initiative
|
|
2008
|
12
|
5
|
|
|
|
|
9
|
Helen Keller International
|
|
1992
|
|
|
30
|
1
|
|
|
10
|
INADES Formation
|
1970
|
|
|
|
17
|
0
|
304.898
|
|
11
|
International Medical Corps
|
|
2008
|
|
|
67
|
4
|
|
|
12
|
Management Sciences for Health
|
|
2012
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Médecins Sans Frontières
|
1984
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Plan Cameroon
|
|
1996
|
105
|
38
|
141
|
2
|
8.396.000
|
|
15
|
Planète Urgence
|
|
2009
|
1
|
1
|
1
|
1
|
200.000
|
|
16
|
Population Services international
|
1989
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Sight Savers International
|
|
1997
|
7
|
4
|
9
|
2
|
|
|
18
|
SNV
|
1963
|
|
25
|
13
|
30
|
8
|
3.000.000
|
|
19
|
SOS village d'enfants
|
|
1990
|
|
|
|
|
|
|
20
|
UICN
|
|
1995
|
|
|
45
|
5
|
1.500.000
|
|
21
|
VSO
|
|
1998
|
|
|
|
|
|
|
22
|
WCS
|
|
2001
|
32
|
8
|
39
|
3
|
800.000
|
|
23
|
WWF
|
|
1990
|
110
|
30
|
|
|
4.573.470
|
|
TOTAL
|
10
|
14
|
554
|
345
|
829
|
53
|
26.690.636
|
Source: Tsafack Judith
52 Les organisations n'ont pas toutes fournies les
informations demandées, ce qui explique la présence des cases
vides dans ce tableau.
50
1) Selon les critères
identitaires
Les OING établies dans la région du Centre sont
en très grande majorité des associations à
caractère laïc et apolitique. Du point de vue de leur nature, on
peut y voir une certaine homogénéité. Toutefois, on peut
les distinguer non seulement selon la période à laquelle elles se
sont installées au Cameroun, mais aussi en fonction des rapports
qu'elles entretiennent avec leur Etat d'origine.
? La période d'établissement
La législation nationale en matière
d'associations a connu une certaine évolution. La loi de Juin 1967 y
relative a été abrogée par celle de décembre 1990,
elle-même complétée par celle de Juillet 1999. On distingue
alors d'un côté les OING installées au Cameroun avant 1990
c'est-à-dire sous l'ancienne loi, et de l'autre, les organisations
présentes après Décembre 1990, donc sous le régime
de la loi actuelle. Des résultats de cette étude, il ressort que
des 23 OING répertoriées, 9 d'entre elles soit 37% se sont
installées au Cameroun avant 1990 contre 15 représentants 63%
pour celles installées au Cameroun après cette date.
Avant 1990 A partir de 1990

58%
42%
Graphique 1: Répartition des OING selon la
période d'établissement au Cameroun
Lorsqu'on y regarde de plus près, il apparaît que
le choix de la période d'établissement est plus lié au
contexte socio-économique ambiant qu'au cadre légal national.
Certes, la loi de 1990 a probablement offert un cadre plus propice à
l'installation des ONG étrangères au Cameroun. Cependant,
l'analyse poussée des résultats nous permet de penser que les
ONG
51
actives avant 1990 (France Volontaires, COE, Catholic Relief
Services, SNV, INADES53 et FAIRMED) se sont installées pour
certaines quelques années après les indépendances afin de
contribuer au développement économique et social du jeune Etat
qu'était le Cameroun en ce moment. Certaines ont même connu une
évolution : c'est le cas de France Volontaires qui s'installa dans la
région du Centre sous le nom de l'AFVP (Association Française des
Volontaires du Progrès). La SNV par exemple était une Association
de Volontaires Néerlandais (SNV comme sigle de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers en Néerlandais). Plus tard, elle est passée
à l'organisation de coopération néerlandaise pour devenir
Organisation néerlandaise de développement. Nous constatons que
ces OING installées au Cameroun après les indépendances
ont évolué avec le développement du Cameroun et ont pour
certaines changé leur nom en fonction des facteurs soient internes
à l'organisation, soient internes au pays dans lequel elles exercent.
Quant aux organisations installées à partir de
1990 qui représentent d'ailleurs plus de la moitié du nombre
total d'OING, il est logique de penser que les programmes d'ajustements
structurels (PAS) auxquels les Etats africains entre autres le Cameroun, ont
été soumis à la fin des années 1980 ont eu un effet
dévastateur plongeant les populations camerounaises dans la
pauvreté. A travers les PAS, les Institutions Financières
Internationales (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International) ont
obligé le Cameroun à effectuer de nombreuses coupes
budgétaires dont les populations en sont devenues les principales
victimes. En réalité, les années 1990 marquent un tournant
décisif dans la compréhension des questions de
sous-développement et de lutte contre la pauvreté. A l'inverse de
la décennie 80 qualifiée de « perdue » par divers
théoriciens hétérodoxes du développement, elles ont
été caractérisées par un changement
considérable dans la réflexion sur le « marché »
du développement et les méthodes pour le promouvoir. Les
enseignements tirés de l'échec des PAS, conjugués aux
innovations dans le domaine des théories économiques,
institutionnelles, politiques et sociales ont débouché sur une
nouvelle perspective qui semble être caractérisée par une
compréhension plus large et plus intégrée du
développement54. C'est dans cette optique d'une
compréhension plus étendue du développement que
s'inscrivent dès lors la plupart des initiatives et politiques de
coopération au développement en faveur des populations des pays
dont les économies ont subi de telles
53 Inades Formation, certes organisation
transnationale (africaine), est classée parmi les ONG internationales
dans le cadre de cette étude.
54 DIOUBATE Badara., Histoire et fondements
théoriques de l'économie du développement, Op Cit.
52
détériorations. Il s'agit désormais de
prendre en compte la nécessité de soutenir les pays du
tiers-monde dans la correction des méfaits causés par la mise en
place dans ces pays des programmes de développement inadaptés, et
qui se sont avérés au final contre productifs. C'est
également pourquoi la société civile du Nord manifeste son
élan de solidarité vis-à-vis de celle du Cameroun en
créant des branches de certaines organisations occidentales au Cameroun
avec pour but d'améliorer les conditions de vie des populations qui
subissent cette pauvreté.
? Les rapports avec l'Etat d'origine
Selon Pierre MICHELETTI, les associations de solidarité
internationale peuvent être distinguées en fonction de la nature
des rapports qu'elles entretiennent avec leur Etat d'origine. Dans ce cas, on
en distingue trois principaux types :
y' Le modèle rhéno-scandinave ayant des
relations fortes avec leurs Etats (Ex. Suède, Danemark).
y' Le modèle anglo-saxon où l'on a affaire
à des ONG plus libérales dans l'esprit et dans la logique de leur
financement.
y' Modèle méditerranéen
hérité des thèses de De Tocqueville au XIXè
siècle : les ONG se positionnent comme des outils de contre
pouvoir.55
Dans le cadre du Cameroun en général et dans la
région du Centre en particulier, la troisième catégorie de
cette typologie est tout à fait inexistante. Les OING se positionnant
comme des outils de contre pouvoir sont beaucoup plus présentes dans les
grandes démocraties occidentales, où il règne un rapport
de force dynamique entre les autorités gouvernementales et les diverses
entités de contradiction. Dans notre contexte, seuls les deux premiers
types d'organisation sont présents. En effet, au regard de la loi
n°90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté
d'association, l'article 4 précise que les actions des associations
doivent être conformes à la Constitution, aux lois et aux bonnes
moeurs, et ne doivent pas porter atteinte à la sécurité,
à l'intégrité territoriale, à l'unité
nationale, à l'intégration nationale et à la forme
républicaine de l'Etat. En outre, étant donné qu'au
Cameroun, les associations (autre que les partis politiques) sont tenues de
conserver un caractère apolitique, quand bien même une association
étrangère traiterait des questions politiques dans son pays
d'origine, en s'installant au
55 MICHELETTI Pierre, Les enjeux contemporains de
l'action humanitaire non gouvernementale, IRIC, CA2D, 2012.
53
Cameroun, elle se doit de respecter la législation en
vigueur. Par conséquent, elle ne saurait s'immiscer dans des questions
politiques au point de se positionner comme un outil de contrepouvoir.
Toutefois, cette disposition ne les empêche pas de mener des actions de
plaidoyer auprès des autorités étatiques. La
répartition en fonction des diverses catégories est
précisée dans le diagramme ci-dessous.
La plupart de ces organisations sont de type anglo-saxon (Plan
Cameroon, WWF, Sight Savers, MSF, Planète Urgence, VSO, Geoaid Cameroon,
SOS villages d'enfants). Elles jouissent d'une certaine autonomie
vis-à-vis de leurs Etats d'origine. C'est pourquoi une partie
considérable des initiatives prises l'est de façon
indépendante de l'Etat d'origine. C'est donc une collaboration directe
entre les sociétés civiles du Nord et celles du Sud.
Les ONG d'origine américaine telles que Counter Part
International, Management Sciences for Health, International Medical Corps,
Global Viral Forecast Initiative appartiennent au modèle
rhéno-scandinave. Leurs ressources financières proviennent
principalement du gouvernement américain soit directement des
départements d'Etat, soit de l'Agence Américaine d'aide au
développement USAID.
2) Selon les critères
d'effectivité
Les critères ici présentés portent sur
les modalités d'action des OING dans la région d'étude.
Ils prennent en compte le champ d'action, les visées que se fixent
lesdites structures, le type de population auxquelles elles
s'intéressent, leurs capacités humaines et même
financières.
? Les domaines d'intervention
Ces organisations agissent dans la région du Centre
dans des domaines assez divers. Leurs initiatives répondent à des
besoins identifiés soit directement par les populations auprès
desquelles elles interviennent, soit par les organisations elles-mêmes,
ou encore en fonction des priorités définies par le gouvernement.
Si certaines OING mettent l'accent sur un volet bien précis, d'autres
par contre couvrent des champs d'intervention multiples. Il s'agit notamment de
l'éducation (l'accès à l'éducation primaire pour
les populations les plus défavorisées, et dans une moindre
mesure, la qualité de l'éducation secondaire) ; les droits de la
personne humaine (avec une insistance sur les droits des catégories
vulnérables telles que les femmes, les enfants, la jeune fille, les
minorités) ; le genre ; le développement local ; les
problématiques environnementales
54
(environnement et conservation) ; la recherche et production
(en vue de la mise en place d'un savoir-faire et des solutions adaptées
aux exigences du contexte) ; la santé (notamment la lutte contre le
VIH/SIDA, la santé maternelle et infantile, l'éradication des
maladies liées à la pauvreté, l'accès pour tous aux
soins de première nécessité...) ; l'eau et
l'assainissement ; l'humanitaire ; les questions de gouvernance (lutte contre
la corruption, liberté d'expression...) ; l'agriculture (formation aux
techniques agricoles et aux métiers du secteur agropastoral...).
Le tableau ci-dessous (fig.1) récapitule les divers
domaines dans lesquels interviennent les
structures identifiées.
55
Tableau 2: Matrice d'intervention des OING
présentes dans le Centre
|
Domaines d'intervention
ONG
|
Agriculture
|
Développement local
|
Droits de l'Homme
|
Eau et assainis- sement
|
Education
|
Environnement
|
VIH/SIDA
|
Humanitaire (urgences)
|
Santé
|
1.
|
CARE
|
|
X
|
X
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.
|
COE
|
|
X
|
|
|
X
|
|
X
|
|
|
3.
|
Catholic Relief Services
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
X
|
4.
|
Counter Part Intl.
|
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
5.
|
FAIRMED
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
6.
|
France Volontaires
|
|
X
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
7.
|
Geoaid
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
X
|
8.
|
GVFI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
9.
|
Helen Keller International
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
10.
|
INADES
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
|
|
|
|
11.
|
International Medical Corps
|
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
12.
|
MSH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
13.
|
MSF
|
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
14.
|
Plan Cameroon
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
15.
|
PSI/ACMS
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
X
|
16.
|
Planète Urgence
|
|
X
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
17.
|
Sight Savers Intl.
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
X
|
18.
|
SNV
|
X
|
X
|
|
X
|
|
|
|
|
|
19.
|
SOS Villages d'enfants
|
|
X
|
X
|
|
X
|
|
X
|
|
X
|
20.
|
UICN
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
21.
|
VSO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.
|
WCS
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
23.
|
|
WWF
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
Total par domaine
|
3
|
9
|
6
|
2
|
11
|
5
|
9
|
5
|
17
|
Source: Tsafack Judith
56
La lecture de cette matrice nous permet de constater qu'un
accent particulier est mis sur les domaines identifiés comme
étant les plus sensibles. Il est important de remarquer que ces aspects
sont tous liés aux Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) dont le but principal est de réduire
l'état de précarité dans lequel vivent certaines
populations de la planète. Parmi ceux-ci, on retrouve la santé
(OMD 4 : Réduire la mortalité infantile, OMD 5 : Améliorer
la santé maternelle, OMD 6 : Combattre le VIH/Sida, le paludisme et
d'autres maladies) ; l'éducation (OMD 2 : Assurer l'éducation
primaire pour tous), le développement (OMD 8 : Mettre en place un
partenariat mondial pour le développement), l'environnement (OMD 7 :
Assurer un environnement durable).
Le graphique ci-dessous représente une
répartition des divers domaines d'intervention en fonction de leur
importance.
Graphique 2: Répartition des OING par domaine
d'intervention
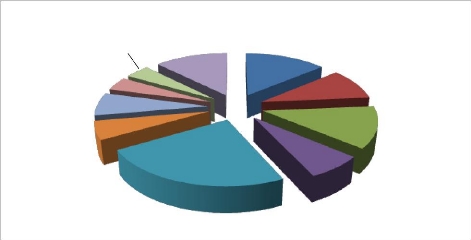
Urgences
Humanitaires
7%
Eau et
Assainissement
6%
Gouvernance
4%
Agriculture
4% VIH/SIDA
Répartition par domaine
d'activité
Santé
24%
12%
Education
14% Droits de l'Homme
10%
Environnement
7%
Développement local
12%
Source : Judith Tsafack
Ce diagramme nous montre que 24% des OING présentent
dans le Centre interviennent dans le domaine de la santé, 14 % dans
l'éducation, 12% dans le VIH/SIDA, 12% également dans le
développement local. S'agissant de la santé et le VIH/SIDA, cet
engouement des OING est en partie justifié par l'intensité de la
lutte contre cette pandémie qui touchait 5,5% de la population
camerounaise en 2004 et le paludisme dont le taux de
57
prévalence national était d'environ 40% la
même année.56 A cela s'ajoute la prise en charge de la
santé maternelle et infantile. D'ailleurs, selon le Document de
Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), le nombre de femmes qui
décèdent à la suite d'un accouchement au Cameroun est
passé de 430 à 669 pour 100.000 naissances entre 1998 et 2004.
Nous notons ainsi une dégradation de la situation sanitaire qui appelle
à une intensification des efforts de la part des différents
acteurs en matière de santé. De plus, le domaine de la
santé à lui seul est évoqué dans trois OMD à
la fois (OMD 4 : Réduire la mortalité infantile, OMD 5 :
Améliorer la santé maternelle, OMD 6 : Combattre le VIH/Sida, le
paludisme et d'autres maladies), et le rôle des OING consiste entre
autres à la poursuite de ces objectifs, ce qui peut justifier qu'elles
soient un certain nombre à se préoccuper de ces questions.
Il en ressort également que 12% de ces organisations
interviennent dans des questions de développement local. Dans le cadre
des thématiques d'intervention, le terme développement local
désigne l'ensemble des actions dont le but immédiat est
l'augmentation du niveau de revenu des populations locales. Une telle
proportion justifie la précarité dans laquelle vivent les
populations de notre région d'étude. Si le niveau de vie dans la
ville de Yaoundé semble relativement élevé, on ne saurait
faire le même constat pour les autres départements. En outre, dans
la région, il existe un besoin réel de maîtrise et
réduction du taux de chômage des jeunes.
Quant à l'éducation, elle mobilise 14% des OING,
l'éducation primaire constituant la principale priorité.
Malgré une légère hausse du taux de scolarisation primaire
au Cameroun entre 2001 et 200757, il faut reconnaître que la
qualité de l'éducation continue de poser problème. En
plus, le poids de la culture camerounaise contribue à la
sous-scolarisation de la jeune fille, ce qui pousse un nombre
considérable d'organisations sensibles à la question du genre
à s'intéresser à l'éducation de la jeune fille.
La protection de l'environnement dans l'ensemble occupe
également une place de choix parmi les objectifs définis. 7% de
la population étudiée y consacre des activités. On
retrouve d'ailleurs pas moins de trois organisations spécialisées
sur les questions liées à l'environnement. En effet, cet
intérêt des OING pour l'environnement peut se justifier par
l'augmentation des atteintes à la biodiversité (exploitation
abusive des ressources forestières, le braconnage...). Néanmoins,
leurs interventions dans la région du Centre concernent beaucoup plus
l'appui au gouvernement en matière de définition des
stratégies de protection
56 Institut National de la Statistique, Rapport
Enquête Démographique et de Santé Cameroun (EDSC),
2004.
57 Document de Stratégie pour la Croissance et
l'Emploi, Cameroun, 2009.
58
de l'environnement et des espèces menacées, les
actions de terrain se focalisant sur d'autres régions.
Les droits de la personne humaine, l'eau et l'assainissement
ainsi que l'assistance humanitaire font l'objet d'un certain
intérêt (23% pour les trois réunis). Les sujets les moins
traitées sont ceux relatifs à la gouvernance et à
l'agriculture58. Ces secteurs réunis intéressent moins
de 10% des structures recensées.
Si cette répartition selon les domaines
d'activités révèle une certaine pertinence, d'autres
facteurs peuvent être pris en compte pour effectuer cette
classification.
? Les ressources humaines
Les OING présentent dans le Centre agissent parfois
dans des domaines similaires, mais leurs actions n'ont pas
nécessairement une ampleur identique. Celle-ci varie notamment en
fonction des capacités d'intervention de l'une ou l'autre structure.
Pour évaluer ces dernières, l'on pourrait se
référer à un indicateur de capacité, à
l'instar de la dotation en ressources humaines qui constitue une clé du
succès des actions de ces organisations.
L'observation de la réalité de l'oeuvre des ONG
internationales dans la région Centre du Cameroun révèle
une grande disparité en termes de personnel déployé. En
effet, elles emploient plus d'un millier de personnes, sans distinction de
genre avec une moyenne d'environ 73 employés par organisation.
L'histogramme ci-dessous montre une répartition des organisations en
fonction du nombre d'employés recensés.59
58 Le secteur agricole camerounais est pourtant en
pleine effervescence, mais ici, l'Etat agit en collaboration principalement
avec les institutions internationales et interétatiques ainsi que les
organismes de coopération. Au niveau national, il fait participer les
collectivités territoriales ainsi que les ONG et associations
nationales.
59 Le personnel dont il est question concerne l'ONG
dans son ensemble, les employés peuvent donc être affectés
à des tâches effectuées dans des régions autres que
le Centre. Par ailleurs, une distinction n'a pas été faite entre
le personnel permanent salarié d'une part, et le personnel temporaire
non salarié d'autre part, constitué de volontaires,
bénévoles, stagiaires.
59
Graphique 3: Effectif des employés par
OING
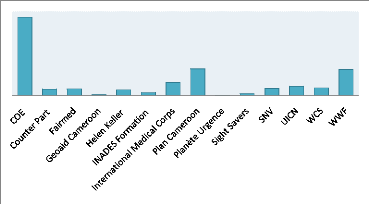
418
35 36 6 31 17
71
143
2 11 38 50 42
140
Source : Judith Tsafack
Il ressort de cette représentation que, dans la
région du Centre, l'on peut distinguer en fonction du personnel
employé d'une part des structures qui comptent plus d'une centaine
d'employés, et que l'on peut qualifier de « grandes » OING, il
s'agit de l'Association COE (41%), Plan Cameroun (14%), WWF (14%). D'autre part
des « petites » structures qui comptent quant à elles moins
d'une trentaine d'employés à l'instar de Inades Formation (2%),
GVFI (2%), Geoaid (1%), Helen Keller (1%), France Volontaires (1%),
Planète Urgence (moins de 1%). Cette
hétérogénéité apparente s'explique part le
fait que certaines « grandes » structures mobilisent un effectif
considérable afin de faire face à leurs besoins d'intervention
dans des domaines assez variés. De plus, leurs zones
géographiques d'intervention couvrent plusieurs régions du
Cameroun dans lesquelles elles possèdent parfois des bureaux. C'est le
cas par exemple de :
? Associazione COE (Zone d'intervention : Centre, Nord, Ouest,
Extrême-Nord, Littoral. Bureaux régionaux : Mbalmayo, Garoua,
Bafoussam, Douala).
? Plan Cameroon (Zone d'intervention : Centre, Est,
Nord-ouest, Nord, Adamoua et
Extrême-Nord. Bureaux régionaux : Yaoundé,
Bertoua, Bamenda, Garoua et Maroua). ? WWF (Zone d'intervention : Centre, Est,
Sud, Sud-ouest. Bureaux régionaux :
Yokadouma, Campo'o Man, Jengi).
A l'opposé, d'autres organisations, les « petites
», optent pour des tâches beaucoup plus ciblées,
généralement dans un domaine bien spécifique
requérant une expertise certaine.
60
Ces structurent utilisent alors un personnel dont l'effectif
est beaucoup moins important, mais avec des qualifications beaucoup plus
poussées. Elles se constituent dès lors comme un soutien
technique pour le gouvernement et leur rôle consiste ainsi à
conseiller les instances publiques sur les décisions à prendre,
à les accompagner dans l'exécution des décisions prises et
à jouer un rôle de plaidoyer lorsque ces dernières
s'écartent de ce qui est considéré comme la norme à
suivre. Il faut également observer qu'il s'agit pour certaines d'entre
elles, des organisations de volontariat international. Elles utilisent un
modèle qui selon elles ne nécessitent pas absolument un effectif
élevé au niveau du Cameroun. Elles sont tout simplement des
plateformes d'interface entre les organisations locales nécessiteuses
d'une expertise donnée et le volontaire qui est disposé à
mettre ses connaissances et compétences au profit de l'organisation
locale identifiée par l'OING. Les volontaires quant à eux,
viennent souvent d'un pays étranger, la France pour Planète
Urgence et depuis quelques années, de plusieurs pays du monde en ce qui
concerne France Volontaires. Nous constatons que les organisations de
volontariat international disposent d'une petite équipe de coordination
au Cameroun. Les volontaires sont soit des salariés en Occident qui
profitent de leur congé pour mener une action sociale au Cameroun, soit,
de jeunes volontaires qui viennent séjourner au Cameroun pour une
durée d'un à deux ans afin de mettre leur connaissance au profit
des organisations locales, et en retour acquérir une expérience
professionnelle.
D'autres par contre, bien qu'installées dans la
région du Centre, n'y mènent aucune action. Leurs locaux de
Yaoundé servent en effet de bureau de coordination. C'est le cas de VSO,
Counter Part International ....
Les ressources humaines peuvent également être
scindées en fonction de la nationalité d'origine. On peut
distinguer d'une part les employés nationaux, d'autre part, les
employés internationaux. De manière générale, 94%
des employés sont des camerounais, alors que seuls 6% sont d'origine
étrangère. C'est dire que ces structures prennent en compte le
capital humain local dans la réalisation de leurs activités. Nous
constatons ainsi que dans l'ensemble, les OING font plus recourt au personnel
local qu'au personnel international. D'un côté, on peut se dire
que le personnel international, généralement à des postes
de management coûte extrêmement cher pour l'organisation. Et d'un
autre coté, l'Etat du Cameroun se rassure lors de la signature de
l'Accord d'Etablissement de l'OING au Cameroun qu'elle emploiera à une
certaine proportion la main d'oeuvre locale. Ce personnel varie en fonction des
domaines d'intervention. On y retrouve des spécialistes de la
santé pour celles exerçant dans le domaine de la santé et
du VIH Sida, les spécialistes de l'éducation pour le domaine de
l'éducation, des
61
ingénieurs pour la thématique Eau et
Assainissement, des juristes pour des questions de droits de l'Homme, des
Ecologistes, Environnementalistes et Socio économistes pour des
questions de Conservation et environnement, des sociologues, anthropologues et
économistes pour des questions de développement, pour ne citer
que ceux-là. A cela, s'ajoute le personnel administratif et financier.
Il faut préciser ici que les locaux sont présents à tous
les niveaux de responsabilité et occupent quelquefois des positions
hiérarchiques considérables notamment celles de Directeur
national : COE (Mr MBARGA Georges Alex), Fairmed (Dr UM BOOCK), INADES
Formation Cameroun (Mme MBEZELE Elisabeth Epse MBALLA)...
L'aspect genre retient également notre attention dans
cette étude. Des treize OING ayant répondu à la question
sur le nombre d'hommes et femmes employés, nous constatons qu'elles
emploient 62% d'hommes contre 38% de femmes. Nous constatons ainsi que, si
certaines d'entre elles accordent une attention particulière à
l'aspect genre dans le recrutement du personnel, il n'en est de même pour
d'autres. Spécifiquement, le COE est celle qui prend le plus en compte
l'approche genre dans le recrutement de son personnel.
Graphique 4: Répartition du personnel des OING en
fonction du genre
Approche Genre

FEMMES
38%
HOMMES
62%
Source : Judith Tsafack
Contrairement à ce qui est constaté dans la
majorité des cas, le COE emploie 214 femmes contre 204 hommes, soit 67%,
donc plus de femmes que d'hommes ! Ceci pourrait se justifier non seulement par
le souci d'équilibre entre les genres, mais aussi et surtout par la
nature des thématiques dans les quelles cette organisation intervient.
Il s'agit notamment la santé, l'éducation, la formation
professionnelle en Industrie d'Habillement (IH) et l'Economie Sociale et
Familiale (ESF). Apparemment, ce sont des domaines qui font
considérablement appel à une main d'oeuvre féminine
(infirmières, aides-soignantes, institutrices, enseignantes
62
d'ESF et IH). Dans cette même logique, Counter Part
International emploie environ 46% de femmes et Sight Savers International en
compte 36%.
Si la prise en compte des ressources humaines donne une
idée assez précise des capacités d'intervention de ces
structures, l'analyse de leurs ressources financières apporte un
complément d'information indispensable à une étude
pertinente.
? Les ressources financières
Les ressources financières sont une condition sine qua
none au fonctionnement de toute structure, entreprise, organisation et les OING
ne sont pas en reste. Si les capacités en termes de personnel
déployé permettent une certaine évaluation de l'ampleur de
l'action des OING dans le Centre, la prise en compte des moyens financiers
mobilisés pour la réalisation des différentes actions
donne également un aperçu assez révélateur de
l'étendue de leur oeuvre. L'histogramme60 ci-dessous
présente la répartition des OING en fonction de leurs
capacités financières. Il prend en compte uniquement la moyenne
du budget annuel de chaque structure.
Graphique 5: Ressources financières par
OING
Budget annuel moyen (en euros)
|
9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000
1000000
0
|
|
|
Source : Judith Tsafack
60 Seules les organisations ayant acceptées de
nous fournir leurs données financières sont
présentées dans ce graphique.
63
Dans cet histogramme, on constate une certaine divergence
quant aux ressources financières mobilisées. L'ensemble des OING
ici considérées réuni un montant d'environ 30 millions
d'euros par an, pour une moyenne de près de deux millions et demi
d'euros par structure. Cette statistique ne ressort pas toutefois la grande
variabilité que l'on peut constater d'une organisation à l'autre.
Parmi les 23 OING répertoriées desquelles 18 nous ont
accordé une collecte d'informations, une moyenne de 60% a accepté
de nous fournir des informations sur leur budget annuel ainsi que les sources
de financement. Pour d'autres, les informations financières sont des
données sensibles qu'elles ne souhaitent pas partager. Le budget le plus
considérable est celui de Plan Cameroon qui tourne autour de huit
millions et demi d'euros (5 milliards de FCFA), soit plus du triple de la
moyenne !61 Dans cette catégorie, on retrouve d'autres
organisations à l'instar du WWF avec plus de quatre millions et demi
d'euros (3 milliards de FCFA), Counter Part nantie à peu près de
la même dotation financière, et trois millions d'euros (un peu
plus de 1,9 milliards de FCFA) pour la SNV. Par ailleurs, on retrouve
également des ONG avec des budgets beaucoup plus modestes comme Inades
Formation qui dispose 305 000 euros (soit environ 200 millions de FCFA) et
Planète Urgence avec 200 000 euros (plus de 131 millions de FCFA)...
Cette disparité entre les différentes enveloppes
budgétaires s'explique d'une part par les méthodes de
mobilisation des ressources financières, et d'autre part par le poids
des partenaires financiers. Ainsi, certaines OING possèdent des
mécanismes assez variés pour la récolte fonds ou
plutôt d'accès au financement. Pour la plupart, elles
reçoivent un financement de base et de façon
régulière de leur siège. En plus de ces financements
s'ajoutent les diverses subventions, les contributions des particuliers et des
entreprises. A côté de cela, certaines dans le cadre des
partenariats avec les bureaux nationaux62 de l'ONG en Occident,
reçoivent des fonds pour le financement des projets précis, c'est
le cas de Plan Cameroon et du WWF. Des OING telles que Counter Part
International et la SNV reçoivent des fonds du gouvernement de leur pays
d'origine, respectivement le Département d'Etat américain
à l'Agriculture et la Direction Générale de la
Coopération Internationale du Ministère néerlandais des
Affaires Etrangères (DGIS). De cette étude, il ressort
également que la crise financière en Europe a eu un impact
considérable sur les budgets des OING et elles
61 Seul le budget annuel global est pris en compte
ici. Abstraction est faite des autres paramètres de comparaison. Une
répartition par projet aurait été plus pertinente, mais
elle a été rendue impossible du fait de l'inaccessibilité
d'une telle statistique auprès des structures enquêtées.
62 Les bureaux nationaux sont des
représentations nationales de l'ONG. Elles se retrouvent
généralement dans les pays dits du Nord. Leur travail consiste
à mobiliser des fonds dans leurs pays pour soutenir les bureaux
programmes qui se trouvent dans les pays en développement.
64
réfléchissent désormais à nouer
des contacts avec de nouveaux partenaires financiers, à des alternatives
qui pourront leur permettre de traverser cette période difficile.
Outre cette classification qui nous a permis de prendre
conscience du profil pluriel des OING que l'on retrouve dans notre
région d'étude, l'environnement dans lequel elles évoluent
constitue également une donnée qui permet de rendre compte
fidèlement de leur action.
| 


