SOMMAIRE
DEDICACES......................................................................................................I
REMERCIEMENT..............................................................................................II
AVANT
PROPOS................................................................................................III
INTRODUCTION
GENERALE........................... 4
PREMIERE
PARTIE : ELEMENTS CONCEPTUELS LIES A
L'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE ET AU ROLE DE L'ETAT DANS LA REGULATION DE
L'ECONOMIE...7
CHAPITRE
I : Elements théoriques de l'enseignement-apprentissage
..............................8
Section
1 : Définitions des concepts pédagogique et l'apport
théorique ................................. 8
Section
2 : Les stratégies d'enseignement et méthodes
d'enseignement-apprentissage ...............12
CHAPITRE
II : Synthèse théorique du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie ...... .16
Section
1 : Le rôle traditionnel et la nouvelle orientation de l'action
publique dans la régulation de l'économie 16
Section
2 : L'importance de l'étude .....................................
31
DEUXIEME
PARTIE : ANALYSE DE L'ENSEIGNEMENT DU ROLE DE L'ETAT DANS
LA REGULATION DE L'ECONOMIE EN CLASSE DE PREMIERE B...........................
37
CHAPITRE
III : Demarche méthodologique
................................................. 38
Section
1 : Contexte de l'étude et élements méthodologiques
............................................38
Section
2: Analyse des résultats
................................................ 42
CHAPITRE
IV : proposition des nouvelles approches stratégiques de
l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat dans la régulation
de l'économie en classe de première B.....61
Section
1 : Remarques et
suggestions.............................................................
62
Section
2 : proposition d'une fiche de
leçon.................................................................65
CONCLUSION GENERALE....................... 81
BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................83
Tableaux...........................................................................................................86
Figures...................................................
88
TABLES DES
MATIERES...................................................................................................................................85

A ma mère INANGA Pierrette, à mon père
MAGANGA Alexis, et à ma fille IVORA MAGANGA Grace Ether Lisa pour leur
amour sincère, leur attention, leurs conseils et surtout pour leur
présence quotidienne.

Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma
reconnaissance au Directeur Général et au corps enseignant de
l'Ecole Normale Supérieure qui durant cinq années
académiques ont su nous transmettre les connaissances relatives à
notre formation.
Je remercie également madame Anne NTCHINANG
(co-directeur) et M. Gouédard ALLOGO OBAME pour leur
disponibilité, leur patience et leur soutien qu'ils m'ont apporté
tout au long de ces mois de mémoire. Je les remercie également
pour la passion de la recherche qu'ils ont su me transmettre. Leur exigence et
leur rigueur scientifique m'ont été d'une grande aide sur le plan
méthodologique. Leurs remarques pertinentes ont été
essentielles pour l'achèvement de ce travail.
Ce mémoire n'aurait pu être mené à
terme sans le concours financier et affectif de ma fiancée Luce
Andréole MADJINZA qui a été un soutien
indéfectible. Loin de ma famille, elle a été une
épaule sur laquelle je me suis si souvent reposé.
Ce mémoire doit également beaucoup aux
encouragements de mes proches et de ma famille.
Je remercie en particulier ma mère et mon père
pour leur affection et patience. J'ai une pensée particulière
pour mes soeurs, Pégie, Olga, Odette, Edwige et Princilia qui
s'impatientaient de me voir finir ce travail; pour frères, nièces
et neveux, belles soeurs et beaux frères, pour leurs encouragements. Ces
remerciements ne seraient pas complets sans l'expression de ma sympathie
à M. MBASSI Jean Claude qui m'a toujours relevé le moral à
travers ses conseils bibliques et à mes amis pour leur confiance et
disponibilité.
AVANT PROPOS
Située au quartier qui porte son nom sur un site
d'environ 4000m2, et placé sous la tutelle du Ministère de
l'enseignement supérieur, l'Ecole Normale Supérieure est une
institution scolaire dont la mission première est de former les jeunes
gabonais dans les métiers de l'enseignement. Elle assure donc la
formation initiale des personnels enseignants du second degré ;
celle des personnels d'encadrement des premiers (Conseillers
pédagogiques et Inspecteurs pédagogiques) et second degrés
(Conseillers pédagogiques) ; le perfectionnement du personnel
enseignant et d'encadrement ; la promotion de la recherche fondamentale et
appliquée à l'Education. Dans le cadre de ses missions, chaque
fin d'année des diplômes sont délivrés par
l'institution aux étudiants méritants.
L'Ecole Normale Supérieure compte dix neuf
filières regroupées en deux catégories : le personnel
enseignant : français, anglais, espagnol,
histoire-géographie, sciences de la vie et de la terre, sciences
économiques et sociales, mathématiques, sciences physiques,
philosophie, le personnel d'encadrement : Conseillers et Inspecteurs
pédagogiques, Conseillers pédagogiques du secondaire et
Conseiller d'orientation.
Toutefois, au terme de leur formation, les
élèves professeurs de l'Ecole Normale Supérieure en fin de
cycle, en vue de l'obtention du Master II professionnel doivent d'abord
valider le nombre des crédits requis, passer une leçon devant
jury, fournir un rapport de stage pratique et sont également tenus de
produire un mémoire qui revêt à la fois un caractère
scientifique et pédagogique. En effet, c'est dans cette optique que nous
avons mené une étude dont le thème de recherche est
l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat dans la régulation
de l'économie en classe de première B.
Nous finissons par cette citation : « Le but de
l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation
toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier et de la
corriger. Il ne s'agit pas de soumettre chaque génération aux
opinions comme à la volonté de celle qui la
précède, mais de les éclairer de plus en plus, afin que
chacun devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre
raison » (Condorcet, 1994 : 93).
INTRODUCTION GENERALE
Pour toutes les économies, le rôle de l'Etat
reste une préoccupation permanente et constante. Cet
intérêt essentiel est surtout lié au fait qu'il est au
centre de tout processus de développement. De nos jours, certains
auteurs (Keynes 1936) prônent la nécessité d'une
intervention publique dans l'économie. Et d'autres (Smith 1776) militent
pour la régulation par le marché. Un consensus semble ainsi avoir
émergé autour d'une « troisième voie »
(Leibenstein 1937), entre le tout-État1(*) et le tout-marché, entre le dirigisme
étatique radical et le laissez-faire absolu2(*). Avec le développement du
libéralisme et la montée de la mondialisation, qui s'accompagne
des inégalités croissantes, nous observons que les objectifs
généralement recherchés par les interventions des pouvoirs
publics et les impacts attendus de ces politiques ne semblent pas converger
vers les résultats attendus.
Nous partons du fait que, le souci premier des responsables de
l'éducation nationale est d'amener les élèves de sciences
économiques et sociales à comprendre le monde contemporain avec
ses multitudes transformations (crises économiques, environnementales,
bonne gouvernance...). La présente recherche basée sur les
expériences des enseignants et des élèves de la classe de
première B, montre que ces deux acteurs révèlent une
certaine difficulté dans l'enseignement-apprentissage sur la
problématique du rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie.
Et le rôle de l'Etat dans les économies de
marché est non seulement une notion complexe car nécessitant
des connaissances dans plusieurs disciplines, notamment économiques
(politiques économiques), juridiques (réglementation des
activités), sociologiques (réduction des inégalités
sociales), politiques (biens publics) et conjoncturelle (changement des
politiques économiques avec la mondialisation) mais aussi et surtout
que les enseignants ont du mal à actualiser et à contextualiser
cet enseignement qui reste souvent très théorique pour les
élèves et à cela s'ajoute le choix d'une mauvaise
stratégie d'enseignement.
Partant de ce constat, nous nous posons la question de savoir
pourquoi malgré le développement du libéralisme, la
vitesse de la mondialisation et le changement des politiques d'intervention de
l'Etat (la bonne gouvernance, le faire-faire, la taille optimale de l'Etat)
dans la régulation de l'économie, les enseignants n'abordent pas
la bonne gouvernance, et la délégation de pouvoir et même
la réglementation comme étant des instruments de la
régulation de l'économie par les pouvoirs publics ? De cette
question découle le problème lié à
l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat dans la régulation
de l'économie. C'est pourquoi nous nous demandons alors dans quelle
mesure peut-on améliorer l'enseignement-apprentissage du rôle de
l'Etat dans la régulation de l'économie en classe de
première B?
Notre hypothèse générale de travail est
la suivante : les enseignants et les élèves rencontrent des
difficultés dans l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat
dans la régulation de l'économie en classe de première B.
Si les enseignants parviennent à actualiser et à contextualiser
le rôle de l'Etat dans la régulation de l'économie cela
faciliterait la compréhension des apprenants à cerner les
différentes stratégies dont dispose l'Etat afin de mener à
bien ses politiques économiques et sociales. La seconde
hypothèse est que si les enseignants adaptaient leur stratégie
d'enseignement à la notion, cela faciliterait l'apprentissage des
élèves.
Nous cherchons à montrer non seulement
l'évolution du rôle de l'Etat dans les économies actuelles,
mais également à faciliter l'enseignement de celui-ci à
travers une meilleure stratégie d'enseignement apprentissage.
L'objectif visé par cette problématique est
d'abord la comparaison des théories existantes du rôle de l'Etat
dans la régulation de l'économie et de son enseignement
apprentissage avec ce qui se fait dans les lycées du Gabon. Ensuite
relever les similitudes et les différences. Et enfin, proposer une
leçon rénovée du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie. Il s'agit par ailleurs, de faciliter
la compréhension des élèves sur le thème, à
travers les nouvelles méthodes d'enseignement-apprentissage d'une part,
mais aussi et surtout de montrer que l'ancienne conception de l'Etat
régulateur ne résiste plus au développement du
libéralisme et au nouveau contexte de la mondialisation, d'autre
part.
Pour remplir cet objectif, nous avons choisi une
méthodologie basée sur les éléments suivants :
la recherche documentaire, l'entretien exploratoire et l'administration d'un
questionnaire adressé aux enseignants et aux apprenants des classes de
première B.
En vue d'apporter quelques éléments de
réponse à cette problématique, la démarche suivante
a été retenue : Analyser le bien-fondé de
l'évolution de l'enseignement-apprentissage et du rôle de l'Etat
dans la régulation de l'économique en s'appuyant sur l'approche
conceptuelle et le cadre théorique dans la première partie. Puis
nous essayons dans la seconde partie du travail de voir la façon de
faciliter l'action pédagogique de l'enseignement-apprentissage du
rôle de l'Etat dans la régulation de l'économie en classe
de première B, à partir d'une démarche
méthodologique (contexte de l'étude, éléments
méthodologiques et analyse des résultats) et à une
proposition des nouvelles approches stratégiques de
l'enseignement-apprentissage (remarques et suggestions, et proposition d'une
leçon) dans la deuxième partie.
PREMIERE PARTIE : ELEMENTS CONCEPTUELS LIES A
L'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE ET AU ROLE DE L'ETAT DANS LA REGULATION DE
L'ECONOMIE
Cette partie a pour objectif de relever les
éléments conceptuels lies à l'enseignement-apprentissage
du rôle de l'Etat dans la régulation de l'économie.
Elle comporte deux chapitres, le premier chapitre porte
essentiellement sur les éléments théoriques de
l'enseignement-apprentissage et le second porte sur la synthèse
théorique du rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie.
CHAPITRE I : ELEMENTS THEORIQUES
DE L'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE
Ce chapitre nous amène premièrement
à définir et à préciser les théories
pédagogiques3(*) qui tournent
autour de la notion d'enseignement-apprentissage (Section 1) et expliquer d'une
manière pratique les méthodes et stratégies d'enseignement
qui peuvent faciliter l'enseignement-apprentissage de la notion du rôle
de l'Etat dans la régulation de l'économie (Section 2)
SECTION 1 : DEFINITIONS DES CONCEPTS
PEDAGOGIQUES ET L'APPORT THEORIQUE
Selon Durkheim (1895) « le savant doit toujours
définir les choses dont il traite, afin que l'on sache et qu'il sache de
quoi il est question. » C'est dans ce sens, et dans le souci
d'éviter toute ambigüité conceptuelle, que nous tentons au
fur et à mesure de définir les concepts pédagogiques et
économiques avant d'étaler les débats qui tournent autour
du sujet.
1- 1- Définition des concepts
1-1-1- Définition de l'enseignement
Selon le courant socioconstructiviste, l'enseignement c'est
l'organisation des situations d'apprentissage propices au dialogue en vue de
provoquer et de résoudre des conflits sociocognitifs. Le rôle du
formateur n'est plus ici de déverser du contenu dans la mémoire
de l'apprenant, mais de mettre en place des situations de construction de
l'apprentissage à plusieurs, qui présentent l'avantage d'amener
l'apprenant à verbaliser, c'est-à-dire à expliciter la
façon dont il s'y est pris pour faire et à la comparer aux
stratégies des autres.
1-1-2- Définition de
l'apprentissage
En première approximation, on peut considérer
l'apprentissage comme une modification stable et durable des savoirs, des
savoir-faire ou des savoir- être d'un individu, modification attribuable
à l'expérience, à l'entraînement, aux exercices
pratiqués par cet individu. Ainsi, il n'existe pas d'enseignement sans
apprentissage.
1-1-3- Définition de la notion
enseignement-apprentissage
Le mot enseignement est défini comme une action, une
manière d'enseigner4(*). Et ce terme, désigne aussi ''l'art
d'éveiller la curiosité des jeunes âmes pour la satisfaire
ensuite''5(*).
Quant au mot apprentissage, il désigne l'acquisition d'une formation
professionnelle. Il peut encore se définir comme une modification du
comportement après un enseignement.
Dans le cadre de ce travail, le concept
enseignement/apprentissage peut se définir comme la transmission des
connaissances par une aide à la compréhension et à
l'assimilation. Elle se confond à l'éducation qui est une
conduite sociale ayant pour but de transformer le sujet d'un point de vue
cognitif et pratique. Alors, le concept enseignement/apprentissage aidera
à mieux cerner ce qu'on entend par conception d'une leçon dont le
but est de réaliser à la fin de ce travail une leçon selon
l'approche Objectif Problématique Activité Evaluation (OPAE).
L'enseignement/apprentissage est la manière qu'emploi
un enseignant pour transmettre des connaissances aux apprenants et pour se
faire comprendre par ceux-ci. Ces connaissances avant de les dispenser, elles
doivent être au préalable durement structurées et
organisées en suivant une démarche scientifique. Pour ce faire,
il nécessite d'avoir une connaissance en pédagogie et en
didactique. Ces notions constituent la base des moyens et techniques mise
en oeuvre dans la conception d'une leçon donnée. La suite
présente les concepts pédagogie et didactique. Le choix de
définir en couple enseignement apprentissage, relève du fait,
que ces deux notions sont étroitement liés, il n'existe pas
d'enseignement sans apprentissage, de même, il n'y a pas d'apprentissage
sans enseignement.
1-2- Apports théorique de l'enseignement
apprentissage
En Sciences de l'Education, plusieurs courants de
pensée se sont développés au cours du 20ème
siècle pour décrire et expliquer l'apprentissage. Chacun envisage
l'apprentissage d'un point de vue sensiblement différent. Les
conséquences que ces différentes façons de concevoir
l'apprentissage ont sur les pratiques d'enseignement sont évidemment
très importantes. Dans cette partie, nous avons choisis de
présenter quatre grands courants pédagogiques en montrant leurs
implications en matière de choix de stratégies d'enseignement par
les enseignant-e-s.
1-2-1- le Behaviorisme
Développé par Skinner (1904-1990) pour le
behaviorisme6(*),
l'apprentissage y est considéré comme une adaptation individuelle
de ses comportements à des stimuli provenant de l'environnement. En
d'autres mots, l'individu doit apprendre à adapter ses comportements et
ses modes de pensée à son environnement qui change.
Cette adaptation est une forme d'apprentissage. En termes
d'enseignement, pour que les étudiant-e-s développent leurs
capacités d'adaptation, on recourt le plus souvent à une
planification de l'enseignement en objectifs précis qui se
succèdent, à une répétition et au renforcement des
comportements considérés comme adaptés, à une
correction immédiate des erreurs et des comportements non conformes et
à un découpage précis du contenu enseigné avec des
exercices répétitifs. On peut trouver des exemples de ce type
d'enseignement pour s'entraîner à la prononciation d'une langue
étrangère, pour manipuler correctement du matériel
technique de laboratoire, pour apprendre à respecter des règles
de sécurité sur un chantier, pour maîtriser des gestes
techniques en sport ou pour maîtriser l'application d'une formule
mathématique à certains types de problèmes.
1-2-2- le cognitivisme
Le cognitivisme7(*) s'est intéressé au
fonctionnement du cerveau humain pour expliquer l'apprentissage, en particulier
les facultés de mémorisation, d'organisation et de mobilisation
d'informations et de modification des structures mentales. En
considérant ainsi l'apprentissage, le rôle de l'enseignant est de
mettre en oeuvre des stratégies pour aider les étudiants à
sélectionner l'information et l'organiser dans leur mémoire pour
ensuite la restituer sous différentes formes. La pratique du feed-back
est aussi importante dans la mesure où elle permet de corriger en
continu les informations non comprises ou mal mémorisées. Une
technique d'enseignement très efficace issue du cognitivisme consiste
à introduire un sujet au moyen de questions ou de courtes
activités de réflexion qui vont susciter l'intérêt
des étudiants en stimulant leurs structures de connaissances
préalables et les aider à mémoriser les nouvelles
informations.
Pour soutenir les étudiant-e-s dans leur apprentissage,
l'enseignant peut aussi proposer par exemple des techniques de
mémorisation ou de prise de notes, l'usage de cartes conceptuelles, une
évaluation des connaissances préalables qui permet aux
étudiants de lier les nouvelles informations avec ce qu'ils ont
déjà en mémoire, une structuration de l'information dans
un polycopié, des activités de résolution de
problème, etc.
1-2-3- le constructivisme
Le constructivisme8(*) est un courant développé par Piaget
(1896-1980). Pour lui, l'apprentissage consiste à entrer dans un
processus actif de construction (plutôt que d'acquisition) de
connaissances en interagissant avec son environnement, en donnant du sens
à ses expériences et en développant ses
représentations. L'action de l'enseignant-e dans ce cadre est d'apporter
un soutien à cette construction en proposant des activités de
réflexion à propos des représentations préalables
des étudiants, des tâches à réaliser en autonomie
(recherche d'informations, projet personnel, etc.), des visites de terrain,
etc.
1-2-4- le socioconstructivisme
Le socio-constructivisme9(*), courant développé par Vygotski à
partir des années 1980, propose de considérer l'apprentissage
comme une participation active à des activités en situation
réelle et en interagissant avec d'autres. L'action de l'enseignant vise
alors à créer des situations d'apprentissage qui invitent les
étudiants à agir, coopérer, créer collectivement et
se questionner en vue de développer des compétences
professionnelles. Ceci peut se réaliser par exemple dans des travaux de
groupe, des stages de terrain, des rencontres avec des experts, des discussions
de groupe, un enseignement réciproque (entre étudiant), des
collaborations à distance en recourant à l'usage de technologies,
des simulations, etc.
Ces différentes approches de l'apprentissage
amènent à s'interroger sur nos propres conceptions de
l'enseignement. Enseigner, est-ce pour nous plutôt « transmettre des
informations », « proposer et encadrer des activités
d'apprentissage », « amener les étudiant-e-s à
construire leurs connaissances », « développer l'autonomie et
la collaboration chez les étudiants », etc. ? Il n'y a bien
sûr pas de conception qui pourrait s'imposer par rapport aux autres mais
nous voyons que pour un enseignement donné, il peut être important
de varier les méthodes d'enseignement en fonction des différents
objectifs d'apprentissage et de notre conception personnelle de
l'enseignement.
SECTION 2 : LES STRATEGIES
D'ENSEIGNEMENT ET METHODES D'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE ;
I- les stratégies
d'enseignement-apprentissage
Les stratégies d'enseignement sont des techniques
employées par les enseignants pour aider les élèves
à devenir des apprenants indépendants ou stratégiques. Ces
techniques deviennent des stratégies d'apprentissage lorsque les
élèves en choisissent certaines de manière
indépendante et les utilisent efficacement pour accomplir des
tâches ou atteindre des objectifs. Ainsi, plusieurs
éléments peuvent intervenir dans le choix d'une stratégie
d'enseignement, notamment le niveau d'interactivité souhaitée
avec les apprenants, la familiarité de l'enseignant avec telle ou telle
stratégie, le temps à disposition, le type de salle dans laquelle
va se dérouler l'enseignement, etc.
I-1- enseignement et apprentissage coopératif
L'apprentissage coopératif signifie que les
élèves travaillent en petits groupes pour accomplir des
tâches et réaliser des projets. Les tâches sont
structurées de telle sorte que chaque membre d'un groupe puisse
participer au travail. Le succès dépend du rendement du groupe
plutôt que du rendement d'un élève en particulier. Cette
stratégie a plusieurs avantages dans la mesure où les
activités d'apprentissage coopératif permettent aux
élèves de mieux respecter et comprendre les habiletés, les
champs d'intérêt et les besoins de leurs pairs. Ces
activités encouragent les élèves à être
responsables de leur apprentissage.
I-2- Les discussions de groupe
Les discussions de groupe font partie intégrante du
cours Carrière et vie. Elles sont essentielles pour développer
des connaissances sur des sujets particuliers, créer la motivation et un
intérêt, et donner aux élèves la possibilité
de s'exprimer, tout en explorant de nouvelles idées et de nouvelles
informations. Les discussions de groupe aident les élèves
à apprendre à exprimer leurs points de vue et à
réagir aux opinions qui diffèrent des leurs. Ces discussions
peuvent se faire avec l'ensemble de la classe ou en petits groupes. Les groupes
de deux à six élèves donnent de meilleurs
résultats.
Le fait de participer aux discussions de groupe permet aux
élèves d'évaluer les perspectives des autres et de
perfectionner leurs habiletés de résolution de
problèmes
I-3- l'étude autonome
L'étude autonome, c'est une stratégie
d'enseignement individualisée grâce à laquelle les
élèves peuvent choisir un sujet, définir des
problèmes ou des questions, rassembler et analyser de l'information,
mettre des habiletés en pratique et créer un produit pour montrer
ce qu'ils ont appris. Cette stratégie donne de meilleurs
résultats chez les élèves qui ont un degré
élevé d'autonomie et une maîtrise de compétences de
base en recherche.
Dans le cadre d'un projet d'étude autonome,
l'interaction entre l'élève et l'enseignant s'impose. Cette
interaction peut prendre la forme d'un entretien structuré ou encore,
d'une conversation occasionnelle lorsque l'enseignant circule dans la classe
pendant que les élèves travaillent.
II- LES METHODES D'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE
Les méthodes tout comme les techniques et les
procédés d'enseignement-apprentissage sont les moyens dont
dispose tout enseignant pour faire acquérir ou transmettre le savoir. Le
nombre de méthodes d'enseignement est infini et leur efficacité
dépend non seulement de celui qui les utilise mais aussi et surtout de
celui sur qui ils sont appliqués. On peut définir une
méthode d'enseignement comme le cheminement suivit par l'enseignant en
vue de transmettre les connaissances à travers l'exploitation des
techniques et procédés divers, elle représente la
manière d'organiser les relations entre les trois composantes du domaine
de la pédagogie à savoir l'élève, le savoir et le
professeur Ainsi, nous avons choisit trois principales
méthodes pédagogiques.
II-1- La pédagogie frontale
La pédagogie frontale met l'accent sur
l'activité du professeur ; C'est la forme de travail qui a
prévalu depuis les débuts de l'enseignement
généralisé et elle a même été
longtemps la seule pédagogie utilisée. Elle évoque l'image
de l'enseignant qui fait face à ses élèves, qui fait front
ou qui affronte le groupe classe. L'enseignant parfois juché sur une
estrade, est l'objet de l'attention de tous les élèves, assis sur
des tables bancs rangées les unes derrière les autres. Cette
disposition de la classe prédispose à une situation dans laquelle
la quasi-totalité des informations part du professeur en direction de
l'ensemble des élèves ; l'enseignant est une
véritable autorité détenteur de la parole et est un
modèle. L'enfant ici est comparé à un vase
à remplir sans qu'il ne fournisse aucun effort. Dans cette situation
d'enseignement, on constate que, le professeur est valorisé et que
l'élève est minoré. La différence des rôles
est bien marquée, le professeur qui est l'enseignant, détient le
savoir et il est chargé de le transmettre directement à
l'élève par des moyens appropriés ; il est un
donateur et l'élève est un receveur. Cette méthode
est nommée de différente manière ; méthode
traditionnelle, méthode magistrale ; méthode dogmatique. La
pédagogie frontale a été longtemps critiquée
et a connu une nette amélioration d'où de novelles
méthodes ont vu le jour.
II-2- La méthode active
Les méthodes actives mettent l'accent sur
l'activité des élèves, elle est basée sur la
confiance et la liberté. Ces deux facteurs incitent l'enfant à
s'exprimer spontanément, à formuler ses observations, à
donner ses impressions, à poser librement des questions. Dans la
méthode active, le professeur est toujours placé entre le savoir
et les élèves mais ceux-ci ne dépendent plus exclusivement
du professeur, l'élève devient l'élément dominant
de la situation pédagogique. Ils entretiennent également des
relations entre eux et avec le savoir, ce qu'ils apprennent résulte pour
une grande partie de ce qu'ils ont découvert eux-mêmes grâce
à des manipulations, des recherches, des tâtonnements face
à un problème donné. En d'autres termes, les
élèves sont les acteurs de la pédagogie. On peut dire
qu'il y a méthode active chaque fois que l'élève est agent
volontaire, actif et conscient de sa propre éducation. L'enfant retient
mieux ce qu'il a découvert tout seul dans ses recherches.
L'enseignant ici n'est plus un donateur mais un conseiller ; un
guide ; un animateur il place l'enfant dans les conditions de travail et
devant un problème, ce dernier multiplie des efforts pour trouver une
solution à son problème et dans cette méthode active,
l'élève est motivé et devient autonome. Avec le travail de
régulation, de contrôle et de la gestion de la salle de classe,
l'enseignant est un médiateur entre les élèves et le
savoir. Avec la modernisation de la société, une autre
méthode est mise sur pied.
II-3- L'enseignement programmé
Basée sur les contenus à enseigner,
l'enseignement programmé, peut se définir comme une
méthode pédagogique qui permet de transmettre des connaissances
sans l'intermédiaire direct d'un professeur ou d'un moniteur. Ceci tout
en respectant les caractéristiques spécifiques de chaque
apprenant pris individuellement. L'enseignement programmé se
caractérise par : la recherche d'un ordre de présentation
efficace, l'adaptation au rythme de l'élève, la p Il s'agit
d'une méthode centrée sur le contenu à enseigner.
L'élève est en relation directe avec le savoir qui a
été préparé à son intention, la relation
élève\ professeur est pratiquement inutile. L'enseignant se
contente de fabriquer des contenus que l'élève doit
s'approprier ; c'est une méthode scientifique car elle ne laisse
rien, au hasard et détermine à l'avance les effets de
l'enseignement sur l'élève.
Ce chapitre basé sur les éléments
théoriques de la notion d'enseignement-apprentissage, nous a permis de
faire le tour des différentes stratégies et des méthodes
d'enseignement-apprentissage afin de choisir la stratégie et les
méthodes optimales pour un meilleur enseignement apprentissage du
rôle de l'Etat dans la régulation de l'économie.
CHAPITRE II : SYNTHESE THEORIQUE DU ROLE DE
L'ETAT DANS LA REGULATION DE L'ECONOMIE
Durant les deux dernières décennies, la question
de la régulation économique10(*) par l'Etat continue d'alimenter les débats,
tout comme les thématiques liées à la pertinence des
politiques publiques et des programmes gouvernementaux de même
qu'à l'efficacité des administrations publiques. Cette notion
reste cependant très difficile à définir car elle renvoie
à des arrangements institutionnels d'une grande variété.
Généralement, on distingue deux principales façons
d'intervention de la puissance publique : intervention
« permanente11(*) » et une intervention
« conjoncturelle12(*) ».
Ainsi, ce chapitre nous amène à analyser d'un
point de vue théorique la notion du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie en mettant en évidence les
différentes approches de cette notion en partant de la
réglementation, en passant par les politiques économiques de
relance et d'ajustement pour aboutir à la gestion des services publics
et les politiques sociales.
SECTION 1 : LE ROLE TRADITIONNEL ET LA NOUVELLE
ORIENTATION DE L'ACTION PUBILIQUE DANS LA REGULATION DE L'ECONOMIE
Le débat sur l'État et sa transformation
constitue une des principales interrogations de la sociologie de l'action
publique, voire de la sociologie de l'État.
I- LE ROLE TRADITIONNEL DE L'ETAT
1-1- La réglementation : L'Etat minimal du
courant libéral
Si l'opposition entre l'Etat gendarme (19ème
siècle) et l'Etat providence (20ème siècle)
occupe une place importante dans la théorie économique, elle ne
permet pas de comprendre toute la complexité des débats entre
économistes. En effet, le courant libéral a souvent
insisté sur le fait qu'un certain degré d'intervention de l'Etat
était nécessaire. On parle ainsi d'Etat minimal.
Dans son ouvrage, « Recherches sur les causes et la
nature de la richesse des nations », Adam Smith (1776) a
posé les bases d'un Etat minimal : « Dans le système de la
liberté naturelle, le souverain n'a que trois devoirs à remplir;
trois devoirs, à la vérité, d'une haute importance, mais
claires, simples et à la portée d'une intelligence ordinaire. -
Le premier, c'est le devoir de défendre la société de tout
acte de violence ou d'invasion de la part des sociétés
indépendantes.
Le second, c'est le devoir de protéger, autant qu'il
est possible, chaque membre de la société contre l'injustice ou
l'oppression de tout autre membre, ou bien le devoir d'établir une
administration exacte de la justice. Et le troisième, c'est le devoir
d'ériger et d'entretenir certains ouvrages publics et certaines
institutions que l'intérêt privé d'un particulier ou de
quelques particuliers ne pourrait jamais les porter à ériger ou
à entretenir, parce que jamais le profit n'en rembourserait la
dépense à un particulier ou à quelques particuliers,
quoiqu'à l'égard d'une grande société ce profit
fasse beaucoup plus que rembourser les dépenses » .
Par la suite, les économistes néoclassiques (Pigou, Samuelson...)
vont admettre que l'Etat peut avoir une action correctrice dans certains
cas.
1-1-1- les externalités
Le premier échec de marché réside dans
l'existence d'externalité13(*). La définition de cette notion est assez
technique. Pour le Français Pierre Picard, les externalités
désigne des « situations où des décisions de
consommation ou de production d'un agent affectent directement la satisfaction
ou le profit d'un autre agent, sans que le marché évalue et fasse
payer ou rétribue l'agent pour cette action ». Les exemples
d'externalités sont nombreux. Prenons le cas de la consommation de
cigarettes. On s'attend à ce que les fumeurs retirent une certaine
satisfaction de la consommation de leurs cigarettes. Mais qu'en est- il de
leurs voisins, collègues à qui ils font subir du tabagisme passif
? On voit bien à travers cet exemple qu'il y a alors une
externalité négative puisque la consommation de cigarette par un
fumeur détériore le bien-être de ses voisins non fumeurs
sans que ce dernier effet ne rentre à priori en ligne du compte dans la
décision du fumeur de fumer une cigarette. Un autre exemple important
tient aux processus de recherche et développement : Lorsqu'une
entreprise met au point un nouveau procédé de fabrication,
d'autres entreprises sont également susceptibles de
bénéficier de ce progrès technique, même si elles le
font avec un décalage dans le temps. L'avantage apporté par
l'innovation à l'ensemble de l'Economie sera alors bien supérieur
aux gains enregistrés par l'innovateur. Il y a alors une
externalité positive.
Comment alors réguler l'économie en
présence d'externalités ? On peut distinguer trois types
d'instruments : les instruments réglementaires, la fiscalité et
la redéfinition des droits de propriété
déterminés par les pouvoirs publics. Chacun de ces instruments
présente des avantages et inconvénients.
La première possibilité consiste à fixer
des quotas ou des interdictions sur le fait de fumer des cigarettes. Pour notre
deuxième exemple, elle consiste à obliger les entreprises
à assurer un minimum de dépenses en recherche et
développement en fonction de leur chiffre d'affaires. La deuxième
option consiste à instaurer une taxe spécifique. Dans le cas de
la cigarette, cela revient à appliquer le principe du «pollueur -
payeur » en mettant en place un impôt indirect spécifique sur
le tabac. Pour les externalités positives on mettra en place une
subvention.
Le troisième type d'instrument est motivé par
les travaux du prix Nobel américain Ronald Coase. L'idée est
qu'une externalité se manifeste lorsque contingentement à une
action économique explicite il y a une autre opération
économique qui existe mais qui ne fait pas l'objet de transaction
marchande. Dans le cas des investissements des entreprises privées en
recherche et développement, il suffit de donner à une entreprise
innovante un droit de propriété sur son savoir. Cela obligerait
les autres entreprises souhaitant bénéficier de l'innovation
à verser un revenu à l'entreprise innovante. Ainsi, l'existence
d'externalité justifie une certaine régulation économique,
mais qui est circonstanciée et dont les modalités
dépendent du cas considéré
1-1-2- les biens collectifs
La deuxième source de défaillance de
marché concerne certains biens et services que l'on qualifie de biens
collectifs. Il s'agit de biens qui peuvent bénéficier
simultanément à plusieurs agents. Une fois produits, la
consommation de ces biens par certains agents n'entrave pas leur consommation
par d'autres agents. Par exemple, la Défense Nationale
bénéficie simultanément à tous les individus.
Il se trouve que les mécanismes de marché ne
permettent pas une allocation efficace des biens collectifs. L'explication est
similaire à celle qui prévaut pour les externalités
positives. Par exemple, dans un système de souscription publique
où chacun décide du montant qu'il est prêt à
consacrer à la production d'un bien collectif, chaque individu
n'intègre que les bienfaits qu'il retire personnellement du bien
collectif, ignorant l'impact sur ses voisins. Un tel mécanisme
volontaire aboutit donc à une sous-production du bien collectif.
Il est alors souvent beaucoup plus efficace que l'Etat
décide directement la quantité de bien collectif qui doit
être produite.
En général les biens collectifs sont des biens
produits directement par l'Etat.
L'exemple de la Défense Nationale est à ce titre
explicite. Soulignons également que la nouvelle économie se
caractérise par l'émergence de nouveaux biens qu'on qualifie d'
« intellectuels », reposant essentiellement sur le Savoir. Il en est
ainsi des innovations, des livres, des codes génétiques, des
enregistrements de disques, ou de la conception de romans. Pour tous ces biens,
l'essentiel des coûts de production concerne dorénavant la
conception intellectuelle du bien et non son support matériel. Or cette
conception consiste essentiellement à accroître le Savoir de
l'Humanité. Il s'agit par conséquent au sens littéral du
terme de biens collectifs. Prenons l'exemple d'un logiciel X, qui serait vendu
à 1500F CFA dans le commerce. Grâce au graveur de CD vendus
maintenant avec tous les ordinateurs PC, ce logiciel peut être reproduit
sans difficulté et vendu à la modique somme de 500F CFA pour
l'achat d'un CD vierge. Il suffit qu'une seule personne achète une fois
le logiciel ! L'essentiel du logiciel est donc effectivement un bien
intellectuel collectif.
En somme, L'une des fonctions principales de l'Etat est de
financer les biens collectifs (défense
nationale, la police, la justice...). L'intervention de l'Etat est
ici nécessaire pour produire des biens et des
services que le marché ne serait pas en mesure
d'offrir (contrairement aux biens privés, la consommation d'un
bien public ne génère ni
rivalité, ni exclusion). Par ailleurs, les biens publics
sont gratuits ou quasi-gratuits (payés par
l'impôt).
1-1-3 les monopoles naturels14(*)
Le troisième argument légitimant la
régulation de l'économie par l'Etat réside dans la nature
de la concurrence. Il est donc important de comprendre en quoi un monopole se
comporte différemment d'une entreprise en concurrence pure et parfaite.
La réponse est que, par rapport à une entreprise en situation de
concurrence pure et parfaite, un monopole a intérêt à
diminuer sa production afin d'accroître le prix de sa vente. Par
ailleurs, laisser faire l'économie de marché signifie
souvent laisser les entreprises mettre en place des collusions et des ententes
sur les prix, ce qui signifie justement la disparition de la concurrence.
Ces arguments théoriques amènent à une
recommandation claire de politique économique. Il faut que l'Etat veille
à ce que les entreprises ne se regroupent pour constituer des cartels
monopolistiques ou oligopolistiques qui fausseraient la concurrence. Tout de
même trois faits doivent être soulignés. Le premier fait
nous vient de l'économiste Autrichien Joseph Schumpeter (1883-1950).
Pour lui, l'innovation et la recherche et développement n'ont
d'intérêt pour les entreprises privées que si elles
engendrent des profits suffisants aux entreprises innovantes. Or, par leur
nature même, les innovations engendrent des positions monopolistiques
plus ou moins durables et avantageuses selon l'intensité avec laquelle
le Droit de la propriété intellectuelle protège les
innovateurs de leurs concurrents.
Par ailleurs, les innovations de procédés
permettent de produire un bien préexistant à un moindre
coût et donc de chasser les concurrents du marché.
La régulation de la concurrence serait alors
confrontée au dilemme suivant. Selon une
vision de court terme, on devrait lutter contre les monopoles,
même lorsqu'ils sont le résultat d'un processus d'innovation. Au
contraire si l'on ne regarde que le long terme, on devrait protéger les
innovateurs par le biais d'un droit de la propriété
intellectuelle très stricte au détriment de l'efficacité
économique présente. Un tel dilemme a été remis au
goût du jour récemment en particulier par le français
Philippe Aghion (2007) et le canadien Peter Howitt (2010). Cet argument contre
des politiques de la concurrence trop agressives a par exemple
été employé par les industries pharmaceutiques contre la
volonté du gouvernement sud africain d'importer des médicaments
génériques contre le SIDA.
Ensuite, le deuxième fait tient au fait que si les
positions monopolistiques sont dans une certaine mesure nuisible à
l'efficacité économique, les positions monopsoniques le sont tout
autant. Un monopsone est un agent économique qui est en situation
d'acheteur unique sur un marché. C'est donc l'exact inverse d'un
monopole. Les situations de monopsones sont beaucoup moins anecdotiques que
l'on pourrait croire. Elles existent sur certains marchés du travail en
particulier dans des bassins d'emplois spécifiques concernant une main
d'oeuvre peu mobile. Elles concernent également certains secteurs
agricoles et agroalimentaires.
Enfin, la troisième remarque tient aux processus de
privatisation. Le prix Nobel Américain Joseph Stiglitz (2001). Ce
défenseur d'une économie de Marché régulée a
pu décrire les ravages commis par les recommandations
systématiques de privatisation du Fond Monétaire International
dans plusieurs pays en voie de développement.
La privatisation systématique sans définition
préalable de règles de la concurrence a souvent conduit à
transformer les monopoles publics préexistants en monopoles
privés autonomes et fortement incités à user de tous les
moyens pour empêcher l'apparition de concurrents et d'une
législation concurrentielle, le cas échéant par le biais
du lobbying voire de la corruption.
De telles privatisations vont clairement à l'encontre
de l'efficacité économique.
Ainsi, l'Etat a un rôle crucial à jouer pour
éviter l'émergence non seulement de positions monopolistiques
mais également de positions monopsoniques trop importantes.
1-1- Les politiques économiques de relance et
d'ajustement : L'Etat interventionniste
1-2-1- John Maynard Keynes : la
régulation par l'Etat
Jusqu'aux années 1970, le courant de pensée
économique dominant est celui du keynésianisme qui prône
l'intervention de l'Etat et la considère même comme indispensable.
A l'occasion de la crise de 1929, John Maynard Keynes a formulé une
critique cohérente de la théorie classique de Smith et
prôné une certaine intervention de l'Etat. La théorie
keynésienne se caractérise par l'importance qu'elle accorde
à l'explication du chômage involontaire, le seul chômage
véritable. Contrairement à l'optimisme candide de la
théorie classique, Keynes ne croît pas que notre système
économique puisse assurer automatiquement le plein
emploi. C'est pourquoi Keynes a prophétisé un
développement du rôle économique de l'Etat.
Keynes publie en 1936 la Théorie générale
de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Bien qu'il prône
l'intervention de l'Etat, ce texte reste d'inspiration libérale. Son
domaine d'étude est le sous-emploi ou le chômage. Il utilise les
phénomènes monétaires comme base pour expliquer notamment
le taux de l'intérêt.
Keynes tire de cette théorie la nécessité
du rôle de l'Etat, même s'il se considère comme un
libéral plutôt conservateur : « Je crois à une
économie de marché et s'il y a une révolution, je serai du
côté des bourgeois », écrit-il en 1928.
Par l'intermédiaire de la consommation, de
l'investissement et de la demande de monnaie, les anticipations orientent la
nature et le niveau de l'emploi. Il ne faut pas compter sur les marchés
financiers pour donner une vision réaliste de l'avenir. C'est pourquoi
l'Etat doit prendre cette responsabilité. Keynes voit l'Etat comme un
catalyseur des anticipations individuelles, car le facteur majeur de
l'explication keynésienne est la confiance.
Alors que la crise se prolonge dans les années 1980,
(inflation, chômage, déficits publics, faible croissance), on
assiste au déclin du keynésianisme pur. A la fin des
années quatre-vingt dix, une nouvelle génération de
"néo-keynésiens" apparaît. Il s'agit de N. Gregory Mankiw,
George Akerlof, Olivier Blanchard, Joseph Stiglitz, Stanley Fischer, Lawrence
Summers, David Romer(1986), Edmund Phelps...
Ils conservent de Keynes deux principes majeurs :
l'imperfection du marché et la nécessité de l'intervention
de l'Etat.
1-2-2- Friedman et les
néo-classiques
Le libéralisme, basé sur la non-intervention de
l'Etat et sur les mécanismes du marché comme facteurs principaux
de l'établissement de l'équilibre économique,
prôné par les théoriciens classiques de l'économie
publique fut réaffirmé dans les années 1970 par Friedman
et les néo-classiques. La mauvaise utilisation et l'efficacité
limitée des outils de relance constituent le principal argument de
Friedman pour combattre les interventions de l'Etat afin de corriger
l'équilibre des marchés. Ce courant de pensée
économique comprend également les idées de Hayek et
Schumpeter qui considèrent que l'univers économique est lui aussi
soumis à une certaine sélection naturelle, qui ne doit pas
être troublée par l'intervention de l'Etat. En effet, selon eux,
une économie doit comporter des porteurs de risques, des pionniers de
l'innovation. Lorsqu'ils s'orientent vers de nouveaux domaines ils prennent le
risque de ne pas réussir.
Les néo-classiques justifient la
nécessité de non-intervention de l'Etat en se basant sur
l'inefficacité des politiques de relance ainsi que sur le rôle du
déséquilibre dans l'innovation.
A l'heure actuelle, on constate que la théorie
keynésienne pure est en pleine disgrâce, pour laisser place
à une polémique entre les courants néo-classiques et
néo-keynésiens (par exemple, N.G. Mankiw et M. Friedman figurent
parmi les principaux conseillers économiques de George W. Bush). Cette
polémique trouve notamment son extension dans les difficultés que
connaissent actuellement les systèmes de répartition
occidentaux.
2- Les modalités de régulation de
l'activité économique
Les marchés ne peuvent exister sans un cadre
institutionnel, notamment des droits de propriété bien
définis et protégés. En outre, laissé à la
seule initiative des acteurs privés, le fonctionnement du marché
connaît des défaillances variées aboutissant à des
situations indésirables au plan économique comme au plan social.
Il est impuissant à fournir certains biens collectifs ou à
prendre en charge les besoins fondamentaux des individus les plus
défavorisés ; il ignore ou sous-estime les effets négatifs
sur l'environnement ; il peut déboucher sur des
déséquilibres macroéconomiques tels que le chômage
de masse ; ses insuffisances concurrentielles ne permettent pas toujours
d'arriver à une allocation optimale des ressources.
2-1- les fonctions de Musgrave
Chaque moment de l'histoire de la pensée
économique a cherché à développer une
théorie de l'Etat. Acteur incontournable de l'économie, il a
été présenté selon les époques soit comme un
problème soit comme une solution. L'époque keynésienne,
qui n'en finit pas, a plutôt vu en lui une solution. Mais
paradoxalement, si elle a donné naissance à beaucoup de
thèses sur la politique économique, elle a assez peu
étudié l'Etat en tant que tel.
2-1-1- la fonction
d'allocation
L'Etat doit intervenir sur l'allocation des ressources pour
atteindre des objectifs jugés économiquement ou socialement plus
satisfaisants que ceux qui résultent du marché. Le cas
emblématique est l'usage que peut faire l'Etat de la fiscalité
pour orienter certaines consommations. Ainsi, en augmentant le prix du tabac,
il incite la population à limiter l'usage de ce produit nocif. Tout
l'art de la gestion publique est de le faire avec habileté et mesure de
façon à ne pas favoriser l'apparition d'une importante
contrebande. De même, la fiscalité sur le pétrole doit se
donner comme objectif non seulement de fournir à l'Etat des ressources
faciles à collecter, mais là encore d'aboutir à une
moindre consommation de ce produit non renouvelable.
Pour les économistes, cette fonction est souvent
assimilée à la prise en charge des externalités,
c'est-à-dire la gestion des conséquences indirectes de la
production que le marché ignore comme la pollution ;
2-1-2- la fonction de redistribution
L'Etat démocratique doit chercher à corriger la
répartition initiale des revenus dans un sens conforme à la
vision que la société se fait de la justice sociale. Pour ce
faire, il dispose évidemment au premier chef de la fiscalité.
Mais pour améliorer la situation des catégories sociales
jugées a priori comme défavorisées, il peut
également utiliser ses dépenses. Et il peut in fine
combiner les deux. Par exemple, en France, la politique d'aide aux
handicapés passe par de multiples canaux qui mobilisent les
dépenses au travers du versement de l'Allocation aux adultes
handicapés et la fiscalité puisque les entreprises qui
n'emploient pas un certain quota d'handicapés doivent verser une somme
compensatoire à l'Etat.
2-1-3- la fonction de stabilisation
C'est cette fonction que les économistes
étudient le plus volontiers. Pour assumer cette fonction de
stabilisation, l'Etat doit se donner comme objectif d'assurer une croissance
économique équilibrée, c'est-à-dire faire en sorte
qu'il atteigne le plein emploi sans provoquer ni inflation ni déficit
extérieur. C'est d'ailleurs pourquoi les économistes
Keynésiens estiment que l'Etat doit intervenir dans les domaines
économiques et sociaux. Cette intervention se fait par la politique
économique.
Qu'est-ce que la politique économique et quels sont ses
objectifs ?
La politique économique est l'ensemble des
décisions, mesures prises par les pouvoirs publics (Gouvernement) pour
orienter, influencer l'activité économique en vue d'atteindre
certains objectifs.
- Les différentes formes de la politique
économique :
La politique économique se compose d'une dimension
conjoncturelle et une dimension structurelle.
La politique conjoncturelle est une politique à court
terme visant à orienter l'activité économique vers la
recherche de quatre principaux objectifs présentés sous la forme
du carré magique15(*) (N. KALDOR) : résumant ainsi, la situation
conjoncturelle d'un pays à partir de quatre indicateurs : le taux de
croissance du PIB, le taux d'inflation, le taux de chômage et le solde de
la balance des transactions courantes en % du PIB (commerce extérieur).
Ces quatre indicateurs dont la représentation graphique constituent les
quatre côtés d'un carré, correspondent aux quatre objectifs
fondamentaux de la politique économique conjoncturelle.

La politique structurelle est au contraire une politique
économique à long terme visant à modifier durablement la
structure ou l'organisation de l'économie d'un pays (comme la politique
industrielle, de la recherche, politique de la concurrence, la réforme
du contrat de travail...Privatisations...).
Ce carré est
qualifié de magique parce que l'expérience et les faits
économiques prouvent qu'il est très difficile d'atteindre
simultanément les quatre objectifs. Certains objectifs s'opposent comme
l'inflation et le chômage par exemple : une baisse de l'inflation
provoque une hausse du chômage du chômage et inversement.
Il
existe deux grands types de politique économique conjoncturelle : une
politique de relance (Gabon 2009) et une politique de rigueur (Allemagne depuis
2008).
La politique de relance, d'inspiration Keynésienne,
privilégie les objectifs de lutte contre le chômage et de
stimulation de la croissance grâce à une politique
budgétaire visant à soutenir la demande au prix d'un
déficit budgétaire. Cependant en voulant atteindre ces deux
objectifs, cette politique déforme le "carré" car, elle favorise
l'inflation et détériore le commerce extérieur. La
politique de rigueur quant à elle privilégie la lutte contre
l'inflation (politique monétaire de la Banque Centrale
Européenne), l'équilibre budgétaire et la réduction
du déficit de la balance commerciale. En voulant atteindre ces deux
objectifs, cette politique freine la croissance ainsi que les emplois durables
et donc modifie ce "carré".
Mais dans un contexte de mondialisation de l'économie
les gouvernements ont-ils encore suffisamment de marges de manoeuvre pour
conduire la politique économique ?
II- LA GESTION DES SERVICES ET LES POLITQUES SOCIALES :
LA NOUVELLE ORIENTATION DE L'ACTION PUBLIQUE
1- Le faire-faire comme moyen de rationalisation des
actions étatiques dans la régulation de l'économie (la
gestion des services publics)
Les questions de délégation de pouvoir de l'Etat
ont suscité un engouement dans un grand nombre de pays durant les deux
dernières décennies. Cette notion reste cependant très
difficile à définir car elle renvoie à des arrangements
institutionnels d'une grande variété.
La théorie du faire-faire16(*) peut être définie
comme étant le transfert de pouvoir et de responsabilité de
l'Etat central à des entités souvent semi-autonomes dans un
domaine de responsabilité bien défini. Ces entités qui ont
la personnalité morale et un budget autonome sont
généralement tenues de rendre des comptes à l'Etat
central. Elles sont généralement amenées à offrir
certains services bien précis qui leur sont
délégués par l'Etat central ou l'échelon de
gouvernement supérieur (elles sont alors les récipiendaires des
compétences et des ressources déléguées).
Ainsi, quels sont les fondements du mode incitatif
(faire-faire) ?
Les ancrages théoriques qui soutiennent le faire-faire
sont fondés sur le rôle et l'efficacité de l'intervention
de l'Etat dans la sphère économique. Les principales
théories qui fondent la délégation de pouvoir peuvent
être résumées dans les approches suivantes : la
théorie du fédéralisme, la théorie de
l'efficience-x, la théorie du New Public Management, la théorie
des coûts de transaction, la théorie de l'agence et la
théorie des choix publics.
1-1- La théorie du
fédéralisme
Le fédéralisme souligne la
délégation à l'aune de l'analyse des grandes fonctions de
l'Etat de Musgrave (1959). On distingue généralement trois types
de fonctions assurées par le secteur public (c'est la fameuse «
trilogie » de Musgrave) : les fonctions d'allocation des ressources, de
redistribution et de stabilisation de l'activité économique -
cette dernière englobant dans sa version moderne les fonctions
macroéconomiques de l'Etat. Pour lui les deux premières fonctions
doivent être déléguées et seule celle de
stabilisateur restera du ressort exclusif du pouvoir central.
1-2- la théorie de l'efficience-x,
Le faire-faire repose également sur la théorie
de l'efficience-x développée en 1966 par Leibenstein, certaines
inefficacités organisationnelles ne résultent pas d'un
défaut d'allocation des facteurs de production mais plutôt des
facteurs non mesurables voire non identifiables (facteurs-x) tels que
motivation, savoir faire, culture d'entreprise etc.
Les réflexions primaires de Leibenstein (1966) avec la
théorie du partenariat public-privé seront établi dans son
article publié en 1978, où il dégage un certain nombre de
facteurs qui seraient source d'inefficience-x tels que l'absence de pressions
externes qui favoriserait une `vie tranquille' dans l'administration publique,
l'immortalité de l'administration publique et la multiplicité des
objectifs qui lui sont assignés. Selon Leibenstein, les sources
d'inefficience dans l'administration publique se trouvent justifiées par
les comportements inadaptés de l'Etat et de ses agents, d'une part et
par la structure organisationnelle fortement bureaucratisée de celle-ci,
d'autre part. C'est pourquoi les théoriciens de l'efficience-x
soutiennent que le « faire-faire » pourrait contribuer
à réduire de manière substantielle les sources
d'inefficience-x dans les organisations publiques, permettant ainsi à
celle-ci de renouer avec la performance et la compétitivité.
1-3- la théorie du New Public
Management
Nous avons la théorie du New Public Management (1980),
qui vise à introduire dans l'administration publique les valeurs et les
modes de fonctionnement de la firme privée. Le New Public Management
apparaît comme l'une des reformes ayant précédé et
précipité de façon implicite les Partenariats
Public-Privés. Cette théorie va de l'idée que la
modernisation de l'administration publique et l'amélioration de sa
gestion sont des processus qu'il faut engager afin de donner aux services
publics leur lettre de noblesse et surtout de renouer avec l'efficience et
l'élimination des énormes déficits accumulés au
cours de ces dernières années. Le New Public Management peut
être perçu comme une sorte de réponse à la crise des
finances publiques.
1-4- La théorie des coûts de
transaction
Une autre approche est celle des coûts de transaction,
développée par Coase (1937) et reprise par Williamson (1985). La
théorie des coûts de transaction considère que si les
administrations publiques sont inefficaces, c'est parce qu'elles ne sont pas
capables de minimiser leurs coûts de transaction (coût
d'information, de négociation, d'exécution des contrats)
contrairement aux firmes privées. L'une des argumentations de cette
théorie est qu'au sein des organisations publiques, la rigidité
des structures, le processus de prise de décision et les cercles vicieux
bureaucratiques imposent une délégation de pouvoirs; ce qui
engendre, en raison, notamment de l'imperfection de l'information et des
comportements opportunistes des agents, des structures onéreuses et des
mesures coûteuses de surveillance. Ces comportements opportunistes dans
un contexte d'asymétrie de l'information font que les transactions dans
la sphère publique se font sur les produits de mauvaise qualité
(Akerlof, 1970). Cette même idée est soutenue par la
théorie de l'agence qui prétend que l'entreprise est un noeud de
contrats entre un mandant (le principal, l'Etat) et un mandataire (l'agent, le
gestionnaire). Pour s'assurer de la qualité de l'effort de son agent, le
principal doit instaurer un système incitatif.
1-5- la théorie des choix publics
Dans le même sens, Buchanan (1972), dans sa
théorie des choix publics, postule que l'inefficience des entreprises
publiques est due notamment aux groupes d'intérêt et aux jeux
politiques qui caractérisent l'administration publique. L'argumentation
de l'école des choix publics est que les personnes qui sont
supposées prendre des décisions publiques notamment les
administrateurs d'entreprise, les politiciens et les bureaucrates, le font, non
pas en privilégiant les intérêts de la
société dans son ensemble, comme l'affirment les discours
officiels étatiques, mais plutôt leurs intérêts
propres comme c'est le cas pour tout autre individu dans d'autres contextes de
la vie privée (Hodge, 2000).
Ce courant oppose l'Etat et le marché en
considérant le marché comme le mécanisme d'allocation
efficiente par excellence des ressources. La préoccupation de ces
théoriciens s'oriente vers la manière de rendre minimale
l'intervention de l'Etat dans l'économie. Cette théorie
considère donc qu'en raison de l'inefficacité de l'Etat, pour des
considérations partisanes et bureaucratiques, il est impérieux de
soumettre à la sanction du marché, le plus grand nombre
d'activités gouvernementales.
I- la bonne gouvernance comme renouveau de l'action
publique.
2-1- Considération générale de la
bonne gouvernance
La gouvernance n'est pas une idée neuve. On en trouve
des traces dans le latin médiéval : gubernantia
renverrait aux idées de conduite, de pilotage, de direction. Cette
notion renvoie au processus de coordination d'acteurs, de groupes sociaux et
d'institutions, en vue d'atteindre des objectifs définis et
discutés collectivement. L'intérêt actuel pour ces
questions de gouvernance répond à la transformation du rôle
de l'Etat et des modes de régulation politique et économique qui
s'y attachent.
Le concept de gouvernance a progressivement gagné la
plupart des sciences sociales dans les années 1990. En sciences
économiques, il permettra dans la perspective institutionnaliste ouverte
par l'Ecole de Chicago, de formaliser les mécanismes assurant la
coordination des activités économiques, notamment au sein de
l'entreprise, autrement que par l'échange ou la hiérarchie. En
théorie des relations internationales, il servira, à partir de
l'ouvrage pionnier coordonné par J.-N. Roseneau et E. O. Czempiel,
à rendre compte des nouvelles formes d'organisation d'une
société internationale de plus en plus fragmentée et
hétérogène. En science politique, il visera à
théoriser le mouvement de repli d'un Etat devenu « creux » -
Hollow State - (Peters, 1993) et confronté à la montée en
puissance d'autres acteurs, publics et privés, internes et externes, qui
entendent peser sur les choix collectifs et avec lesquels il est devenu
nécessaire de composer. La gouvernance constitue aussi un puissant
moteur de réforme qui alimente la croyance en la nécessité
de la promotion, à tous les niveaux et dans les domaines de la vie
sociale, de nouvelles méthodes de décision et d'action.
Le rôle des institutions financières
internationales sera déterminant dans la définition de ce que
doit être la « bonne gouvernance ». Du reste, l'explosion de
l'engouement actuel pour ce mot-valise (Gaudin, 2002 : 9) est le fait des
grandes agences internationales de l'aide au développement, de la Banque
mondiale en particulier. Son registre d'énonciation varie d'un organisme
à l'autre. Ainsi, ont pu voir le jour des formulations tantôt
savantes tantôt impératives pour traduire la « bonne
gouvernance ». Au détour des rapports de ces agences et bailleurs
de fonds, ce concept figure sous des formulations variées
considérées soit comme une injonction faite aux pays en voie de
développement à se plier à de sévères plans
d'ajustement structurel allant de pair avec la privatisation de certaines
fonctions régaliennes et une promotion du rôle de la «
société civile », soit de manière subtile comme une
recommandation. Il ressort du document issu du sommet du G 8 de juin 200210,
où se manifeste le propos des pays riches de concentrer leur appui
« sur les pays qui se montreront attachés politiquement et
financièrement à la bonne gouvernance et à la
primauté du droit, qui investiront dans leur capital et qui poursuivront
des politiques propres à stimuler la croissance économique et
à réduire la pauvreté ». De plus en plus, la
prescription peut même se transmettre sur le ton paternel de l'heureuse
révélation de nouvelles « stratégies de
réduction de la pauvreté ». Formulations plus savantes ou
plus impératives, ces variations de style ne changent pourtant rien sur
le fond. Le concept de « bonne gouvernance » en matière de
développement demeure le plus incertain de tous,
caractérisé par ses éléments
périphériques plutôt que par un quelconque noyau dur.
« La popularité de la notion de gouvernance dans le registre
discursif des élites dirigeantes africaines, montre bien le potentiel
qu'elle recèle en termes d'instrumentalisation, y compris de
l'utilisation idéologique qui en est faite dans la perspective
néolibérale pour discréditer l'Etat, et fabriquer les
recettes d'une bonne gouvernance » (Nguelieutou, 2008.).
2-2- La bonne gouvernance : un autre moyen de
régulation économique
Une bonne partie de la littérature existante montre le
rôle croissant des acteurs supranationaux (Banque mondiale, FMI, clubs
créanciers) et infranationaux dans la production et
l'implémentation des politiques publiques. Leur poids est tel qu'il
devient désormais très difficile d'élaborer l'action
publique sans faire référence aux mesures et aux recommandations
faites par les acteurs transnationaux notamment (Smith, 2008 : 197-214). Ce
processus se caractérise par l'effacement des frontières
nationales dans la construction de l'action collective. Cet effacement
résulte d'un double mouvement, en partie interdépendant, de
supranationalisation (régionalisation, mondialisation) et d'infra
nationalisation des politiques publiques.
Le récit de la bonne gouvernance constitue une remise
en cause des règles et des manières de faire constitutives et
héritées de l'ordre wébérien. La diffusion de ce
nouveau vocabulaire et le recours systématique aux instruments
directement repris du New public Management constituent
désormais une donnée factuelle incontournable (Bezes, 2008 :
215-253). Dans le processus d'élaboration des réformes, les hauts
fonctionnaires des finances, de la fonction publique, les membres des cabinets
ministériels puisent largement dans le stock des recettes de la
gouvernance. Profil d'emploi, poste de travail sont désormais les
nouveaux enjeux de la réforme administrative ; les
propriétés les plus constitutives de l'administration ont
été exposées à des projets de réforme
radicale.
Pour les autorités nationales l'impératif de
gouvernance fonctionne comme une ressource mais aussi comme une contrainte. Ces
autorités en font usage pour justifier et renforcer des
stratégies de repositionnement dans l'espace public en tant qu'acteur
central dans sa mise en oeuvre.
La mise en oeuvre de la gouvernance correspond à un
processus d'appropriation du programme par les acteurs nationaux (locaux) et se
traduit, en définitive, par l'apprentissage de nouvelles normes et de
nouveaux répertoires d'action par ces différents acteurs au
travers des mécanismes de socialisation tels que séminaires,
colloques...
SECTION 2 : L'IMPORTANCE DE L'ETUDE
II-1- Intérêt de l'étude
La grande préoccupation des pays
développés et plus encore des pays en développement est de
savoir comment poursuivre les objectifs de croissance économique
à travers les politiques économiques de pouvoirs publics dans la
mesure où les marchés ne peuvent exister sans un cadre
institutionnel17(*),
notamment des droits de propriété bien définis et
protégés. En outre, si le rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie a toujours été
enseigné, il n'en demeure pas moins vrai que les enseignants ont du mal
à actualiser, à contextualiser et à choisir une meilleure
stratégie afin de faciliter l'enseignement-apprentissage de cette
notion. Cet enseignement d'Etat régulateur permet aux jeunes
populations d'appréhender les missions actuelles des pouvoirs publics
dans une société mais surtout de cerner les missions qui sont les
leurs afin d'accompagner l'Etat à atteindre les objectifs fixés
et d'assurer le bien être de tous. Une meilleure compréhension de
cette notion en classe de première peut être source dans une
certaine mesure de la culture des efforts d'entreprise des populations et
l'accumulation de richesses des pays du sud à travers une meilleure
prise en compte du rôle de chacun dans une économie. Elle permet
également aux élèves de première B de comprendre
les trois derniers chapitres du programme de terminale B qui mettent l'accent
sur les relations économiques internationales.
Quand on parle du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie en classe de première B et
partant du fait que, le rôle de l'Etat dans les économies de
marché est non seulement une notion complexe car nécessitant
des connaissances dans plusieurs disciplines, notamment économiques
(politiques économiques), juridiques (réglementation des
activités), sociologiques (réduction des inégalités
sociales), politiques (biens publics)...et conjoncturelle (changement des
politiques économiques avec la mondialisation) mais aussi et surtout
les enseignants ont du mal à actualiser et à contextualiser cet
enseignement qui reste souvent très théorique pour les
élèves. A cela s'ajoute le choix d'une mauvaise stratégie
d'enseignement.
Ce sont ces multiples raisons qui ont nourrit notre motivation
à faire des recherches sur ce sujet qui est d'une importance capitale
à notre égard. D'où notre problématique comment
améliorer l'enseignement apprentissage de la notion du rôle de
l'Etat dans la régulation de l'économie
II-2- Problématique de recherche
La problématique de l'enseignement du rôle de
l'Etat dans la régulation de l'économie est aujourd'hui plus
importante dans les pays en développement (PED) dans la mesure
où non seulement la jeunesse est en perte de la culture d'entreprise et
attend tout des pouvoirs publics, mais également parce que la
régulation des marchés est d'autant plus actuelle qu'elle part du
constat des limites de l'existence d'un marché «
auto-régulateur » et facteur d'équilibre entre les
acteurs économiques. Ce principe « néo-classique » a
longtemps été la base des orientations politiques et
économiques de plusieurs pays et institutions mondiales18(*) (FMI, Banque mondiale). Mais,
les théories économiques quelles qu'elles soient (économie
institutionnelle, économie néo-classique, microéconomie,
etc.), doivent être utilisées en prenant en compte leurs limites
et leurs conditions d'application.
Aujourd'hui encore, le rôle des pouvoirs publics dans la
régulation de l'économie et les stratégies efficaces de
son enseignement dans les lycées restent encore un des champs les
plus actifs de la recherche en didactique des sciences économiques et
en pédagogie dans les pays en développement. Le niveau de
questionnement s'est particulièrement accentué avec la
montée de la mondialisation, les crises économiques et la
transformation du rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie mais surtout l'adaptation de son enseignement selon les pays
et selon les périodes. Plusieurs travaux ont par ailleurs mis en
évidence la transformation du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie depuis les années 1960
(Nguelietou et Tchekoumi, 2012).
La recherche sur l'enseignement apprentissage du rôle de
l'Etat dans la régulation de l'économie trouve également
sa justification dans l'actualisation du contenu de la leçon, la
difficulté pour un enseignant de pouvoir réunir plusieurs savoirs
au même moment (économiques, sociologiques, politiques,
juridiques...) et de pouvoir contextualiser avec ce qui se fait par les
pouvoirs publics dans le pays.
Notre étude s'intéresse dès lors à
montrer la transformation du rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie avec la montée de la mondialisation afin de proposer
une meilleure stratégie de son enseignement-apprentissage.
Ainsi, va se poser la question centrale suivante :
1- Comment améliorer l'enseignement apprentissage-du
rôle de l'Etat dans la régulation de l'économie
II-3- Objectif de l'étude
L'objectif visé par cette problématique est non
seulement de comparer les théories existantes du rôle de l'Etat
dans la régulation de l'économie et de
l'enseignement-apprentissage avec ce qui se fait dans les lycées du
Gabon en général et de Libreville en particulier mais
également d'établir les similitudes et les différences
afin de donner des propositions claire dans le but d'améliorer
l'enseignement-apprentissage de la notion du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie. Cet objectif est le principal fil
conducteur de notre étude car elle nous offre la meilleure entrée
pour visualiser l'ensemble des missions, des modalités et des moyens
d'un « Etat-régulateur » afin de proposer une
meilleure leçon et une meilleure stratégie de son
enseignement-apprentissage. Mais, d'abord essayons de définir le concept
d' « Etat-régulateur ». Dans un sens
général, la régulation est l'ensemble des techniques
permettant le maintien de la constance d'une fonction. En économie, le
concept de régulation se réfère aux arrangements
institutionnels par les quels un système économique se reproduit.
Le terme de régulation intègre ainsi les notions de «
système » et de « durabilité ».
La régulation, est-elle donc le résultat de
l'action d'une puissance publique (déléguée par l'Etat) ?
Ou est-ce le résultat d'un processus collectif dont la viabilité
est garantie par des règles acceptées par tous les acteurs ?
Si les discours annonçant la fin de l'État ont
une certaine histoire (Marx et la thèse du dépérissement
de l'État par exemple), ils ont aujourd'hui acquis une nouvelle
vigueur. Qu'ils traitent de la fragmentation interne et de la
différenciation de l'État ou bien des effets de la globalisation,
maints auteurs prennent au sérieux l'hypothèse du déclin
de l'État. Les titres d'ouvrages, d'articles sont éloquents :
Taille optimale de l'Etat dans une union monétaire : le cas de la
CEMAC (Mengue Bidzo, 2012), L'État en miettes (Dupuy &
Thoenig, 1985). En revanche, les formules que l'on trouve plutôt dans la
littérature française comme « l'État stratège
», « l'État animateur » ou « État
régulateur », visent à suggérer de nouvelles formes
d'action de l'État.
Ainsi, il convient de noter que la formule même de
l'« État régulateur » comporte de telles
équivoques qu'on ne saurait y recourir sans qu'ait été au
préalable opéré un indispensable travail de clarification.
En termes généraux, la régulation renvoie à la
relation entre l'Etat et le marché. Il s'agira tout au long de ce
travail de montrer la relation qui existe entre l'Etat et le marché.
Même si cette question est centrale en science économique, les
études sur la régulation sont difficiles à
catégoriser. Cette difficulté est liée à la grande
diversité des usages du terme régulation dans la
littérature et aux imprécisions de traduction entre l'anglais et
le français. L'Ecole française de la régulation a peu en
commun avec les approches anglo-saxonnes de la régulation, qui sont
parfois regroupées sous le terme « réglementation »
pour les distinguer.
Conçue ainsi, l'étude de la régulation
renvoie à une sociologie de l'État qui cherche à
caractériser le rôle, les transformations de l'État et les
régimes de gouvernance politique et économique. Elle correspond
à une réduction de l'intervention du gouvernement dans la
fourniture des services publics et à une démultiplication du
nombre d'acteurs. Dans cette optique minimaliste, qui est celle des programmes
d'ajustement structurel mis en place dès les années quatre-vingt
dix, l'intérêt est recentré sur les seules institutions
effectuant les fonctions régaliennes de l'État - garantie de la
propriété, de la monnaie et des transactions (Quantin, 2005 :
18).
Tout compte fait, les acceptions du terme de «
régulation » sont innombrables. Le seul point commun entre toutes
étant que cette notion suppose la restriction du choix (privé)
par l'imposition de règles (publiques). Une analyse approfondie
relève un clivage entre une acception européenne plus large et
une approche américaine plus stricte de la régulation.
Pour de nombreux experts européens, la
régulation, en termes de fabrication de règles, ressortit
à un éventail très large d'activités
gouvernementales, voire même à l'entière
élaboration de la gouvernance. En Europe, il y
a une tendance à identifier la régulation avec l'ensemble du
domaine de la législation, le pilotage
macroéconomique et le contrôle social (Majone,
1994 : 233-271). Une acception aussi vaste conduit à
assimiler l'étude de la régulation
à l'ensemble du droit, de l'économie, de la science politique et
de la sociologie et constitue un obstacle à la
construction d'une théorie de la régulation comme un
mode particulier d'opération des politiques publiques.
Selon Robert Boyert, par exemple, la régulation
correspond à l'ensemble des règles gouvernant les modes de
production capitaliste. Hancher et Moran utilisent le concept d'« espace
régulateur » dont les contours sont fondamentalement définis
par les interactions entre les grandes organisations publiques et
privées dans les économies capitalistes avancées.
Dans le contexte américain, la régulation a
acquis une signification plus spécifique, et y est mieux
développée. La régulation au sens américain,
s'applique au contrôle public exercé sur les activités
économiques du secteur privé au nom de l'intérêt
public. La régulation comme forme distincte de contrôle
gouvernemental, suppose en principe un organisme gouvernemental ayant charge
d'édicter des règles contraignantes sur un certain nombre de
décisions économiques (privées) au moyen de
procédures administratives quasi juridiques (Noll, 1985 : 9-63). La
régulation renvoie à « un contrôle attentif et soutenu
exercé par une instance publique sur des activités
généralement considérées comme désirables
par la société (Selznick, 1985 : 363-367) ». Cette
définition a l'avantage de rendre explicite l'un des traits
déterminants du style américain de réglementation : le
contrôle attentif et soutenu de l'autorité publique. Cette
caractéristique implique que la réglementation ne consiste pas
seulement à promulguer une loi mais exige un savoir
détaillé sur l'activité réglementée et une
implication intime de l'autorité publique dans son fonctionnement. Aussi
bien l'adoption de la réglementation comme mode d'action publique
implique tôt ou tard, la création d'instances et de commissions
spécialisées capables de s'informer, de fixer et de mettre en
service des règles.
En somme, l'État régulateur renvoie en effet
à deux évolutions interdépendantes des politiques
publiques. La première est le passage progressif, du faire au
faire-faire : l'État régulateur est un État qui
agit plus indirectement que directement, qui est plus en interaction qu'en
action, qui délègue plus qu'il n'intervient directement, qui
pilote et qui oriente plus qu'il ne met en oeuvre. La seconde évolution,
qui découle de la première, est le renforcement des
capacités de contrôle étatique à travers le
développement de l'audit, de l'évaluation, du contrôle de
qualité, en particulier dans le cadre des agences (Hassenteufel, 2007 :
311-329).
Au Gabon, la plupart des fonctions de régulation des
marchés sont mises en oeuvre par des partenariats publics-privés
incluant la participation de certaines institutions publiques.
C'est le cas de l'Agence Nationale des Grands Travaux19(*) (ANGT) qui assure un
rôle de construction des infrastructures de base afin de relancer
l'économie, l'Agence Nationale des Infrastructures
numériques...
Après avoir pris connaissance des différentes
approches actuelles du rôle de l'Etat dans les économies de
marchés, nous allons à présent analyser
l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat dans la régulation
de l'économie en classe de première B dans certains lycées
de la capitale gabonaise.
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE L'ENSEIGNEMENT DU
ROLE DE L'ETAT DANS LA REGULATION DE L'ECONOMIE EN CLASSE DE PREMIERE
B
L'objectif de cette partie est de collecter les données
sur le terrain qui vont nous permettre de proposer un
enseignement-apprentissage permettant d'apporter des éléments de
solution à notre problématique de recherche. La partie d'analyse
consiste à présenter notre démarche méthodologique
et la collecte des données (troisième chapitre) ce qui va nous
permettre de proposer une nouvelle fiche de leçon adapter à
l'enseignement-apprentissage de la notion du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie (quatrième chapitre).
CHAPITRE III : DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Ce chapitre consiste à présenter le contexte de
l'étude et les éléments de méthodologie
(Section 1) dans le but de proposer une leçon
(Section 2)
SECTION 1 : CONTEXTE DE L'ETUDE ET ELEMENTS
METHODOLOGIQUES
I- ELEMENTS METHODOLOGIQUES
Il s'est agit de faire une première phase de recherche
bibliographique20(*) sur
le sujet pour définir la problématique. Cette étape a
consisté à faire une analyse théorique afin de nous
permettre de prendre connaissance des différentes approches du
rôle de l'Etat dans la régulation de l'économie, et des
différentes approches d'enseignement-apprentissage. Ainsi, notre analyse
s'est basée sur le choix méthodologique et l'enquête d'une
part, et sur la collecte des données et le guide d'entretien d'autre
part.
I-1- le choix de la méthodologie et collecte des
données
Nous essayons de justifier et de décrire ici la
recherche documentaire, la méthode de collecte de données
employées, les critères de sélection de
l'échantillon et sa composition puis les complications inhérentes
à l'enquête de terrain.
I-1-1- cadre d'étude
Notre étude a porté sur trois grands
Lycées de Libreville, notamment le Lycée d'Application Nelson
Mandela, Immaculé Conception et le Lycée Georges MABIGNATH. Le
choix de ces établissements se justifie par le fait de la
proximité et de la facilité d'accès rendu possible par nos
collègues ayant passé leur stage dans ces établissements.
Mais également nous voulions enquêter auprès d'un grand
nombre d'enseignants de sciences économiques et sociales et recueillir
des résultats au baccalauréat de certains établissements
comme Immaculée Conception. La bonne réputation de cet
établissement suppose qu'il dispose des enseignants chevronnés et
des élèves sérieux dans le travail. Quant au choix du
Lycée d'Application Nelson Mandela, il est dû au fait que nous
avons passé notre stage de professorat dans cet établissement.
Dans ces établissements, nous nous sommes
intéressés aux classes de première B. Le choix de la
première B, parce que la notion du rôle de l'Etat est
enseignée dans cette classe. Mais dans certains établissements
nous n'avons pu interroger quelques redoublants, du fait qu'avec les mouvement
de grèves des enseignants pour l'année académique
2014-2015, certains enseignants ne sont pas arrivés à ce
chapitre et donc n'ont pas enseigné cette partie du programme en classe
de première B, c'est d'ailleurs le cas du Lycée d'Application
Nelson Mandela, ou nous étions nous même stagiaire.
I-1-2- La recherche documentaire
La recherche documentaire est une composante du choix
méthodologique. Elle est une étape du travail qui consiste
à trouver des sources afin de bien situer la problématique du
sujet et d'essayer de résoudre le problème posé. Cette
phase a occupé une place très importante dans notre étude.
Elle a duré plus de deux mois et demi et a porté sur :
· Le concept de régulation des marchés par
les pouvoirs publics ;
· L'évolution du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie ;
· Les différentes approches
d'enseignement-apprentissage
Pour atteindre cet objectif, nous avons investi plusieurs
sources d'information notamment internet, qui a été d'un
très grand apport, les livres de spécialité en science de
l'éducation et ouvrages de sciences économiques et sociales et
certains mémoires de CAPES disponibles à la bibliothèque
de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) et de l'Université Omar Bongo
(UOB).
Par ailleurs, les cours sur les problèmes
économiques contemporains et sur la Didactique des Sciences Economiques
et Sociales que nous avons reçus à l'Ecole Normale
Supérieure pour le compte de l'année académique 2014-2015
respectivement par le Professeur Jean Louis NKOULOU NKOULOU et le
Didacticien-Inspecteur NDONG BIBANG nous ont permis de mieux comprendre l'enjeu
et la problématique posés par la question de
l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat dans la régulation
de l'économie.
Nous avons retenu la recherche documentaire parce que le
thème d'enseignement apprentissage du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie est un thème théorique
qui nécessite une collecte d'informations sur les théories
libérales et keynésiennes du rôle des pouvoirs publics dans
une économie. Les résultats de la recherche documentaire nous ont
permis par la suite de proposer un exemple de leçon sur
l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat dans la régulation
de l'économie. Mais nous n'avons pas pu l'expérimenter sur le
terrain car nous étions déjà à la date
d'arrêt de cours prévue par le Ministère et la direction de
l'Etablissement.
I-1-3- L'enquête
Cette partie de l'étude est basée sur le
questionnaire et des entretiens auprès des principaux acteurs
impliqués dans le domaine de l'enseignement - apprentissage. A travers
le terme « acteur », nous entendons aussi bien les
élèves (première B) que les enseignants des sciences
économiques et sociales. On attend par enquête, une
« démarche intellectuelle qui a pour but la découverte
des faits, l'amélioration des connaissances ou la résolution des
doutes et des problèmes. Concrètement, il s'agit d'une recherche
poussée d'information avec le but d'exhaustivité dans la
découverte des informations inconnues au début de l'enquête
et parfois de la volonté de publication des informations
collectées » (M. Vigezzi, éléments de
méthodologie pour économiste, Grenoble : PUG, 1993, p.43).
Ainsi, Les principaux thèmes abordés lors des
enquêtes sont :
· La problématique de l'enseignement :
· La contextualisation :
· La stratégie d'enseignement
utilisée :
A cet effet, l'objet de notre enquête est de proposer
une meilleure façon d'assurer un enseignement-apprentissage du
rôle de l'Etat dans la régulation de l'économie en classe
de première B.
II- La collecte des données
Comme nous l'avons indiqué précédemment,
elle a été menée à base d'un questionnaire et d'un
guide d'entretien. Cette étude descriptive et analytique de terrain
présente également des limites.
II-1- L'élaboration du questionnaire
Nous avons choisi comme premier outil d'analyse le
questionnaire adressé aux élèves et aux enseignants des
classes de première.
Nous avons retenu les questions qualitatives qui nous ont
semblé plus aisées pour les élèves et les questions
de type texte pour recueillir les opinions des enquêtés sur les
informations complémentaires. Ces questions portent principalement sur
la compréhension de la notion de la relation Etat-marché et des
stratégies adoptées pour assurer un meilleur
enseignement-apprentissage.
II-2- le guide d'entretien
L'entretien21(*) est une technique de recueil de l'information qui se
déroule dans une relation de face à face. Les entretiens peuvent
être classés en deux catégories en fonction du type de
personne interrogée : les élèves et les enseignants du
Lycée d'Application Nelson Mandela et les élèves et les
enseignants du Lycée Georges MABIGNATH. Une même approche a
cependant été employée pour l'ensemble des personnes
interrogées puisque nous avons systématiquement eu recours
à des entretiens semi-directifs (cette stratégie de recueil des
données consistait à poser des questions semi fermées
simples et des questions semi-fermées de façon orale aux deux
acteurs concernés par l'enseignement-apprentissage. Nous entendons par
« acteur concerné » les élèves et les
enseignants). Cela nous a semblé être la méthode la plus
susceptible de faire apparaître des éléments
imprévisibles liés à l'enseignement-apprentissage de la
notion du rôle de l'Etat dans la régulation de l'économie
tout en nous permettant d'aborder les thématiques importantes dans le
cadre de notre recherche. Les questions n'ont donc pas systématiquement
été les mêmes, nous adaptant à chaque fois à
notre interlocuteur, mais les sujets abordés ont néanmoins
été récurrents. La plupart des descriptions de nos
interlocuteurs ont été ainsi confirmées par les autres sur
de nombreux points et certains thèmes auxquels nous n'aurions
peut-être pas porté une grande attention se sont ainsi
révélés essentiels. Les entretiens ont eu des
durées extrêmement variables, les rencontres ayant oscillé
entre cinq minutes et quinze minutes.
II-3- Limites et contraintes méthodologiques
L'une des principales contraintes de cette étude est le
temps consacré à la phase de terrain qui s'est vu réduit
pour des raisons des grèves dans l'enseignement supérieur, comme
dans l'enseignement secondaire. De ce fait, nous n'avons eu au total que douze
entretiens, dont quatre avec les enseignants (deux du Lycée
d'Application Nelson Mandela où nous avons passé le stage et
deux du Lycée Georges MABIGNATH où nous avons profité de
les interroger le jour du repas organisé par leurs stagiaires, qui sont
nos condisciples) et huit entretiens avec les élèves de
terminale B du Lycée d'Application Nelson Mandela. Un entretien plus
large avec les enseignants du Lycée d'Application Nelson Mandela, nous a
permis de mieux définir leur stratégie
d'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat dans la régulation
de l'économie.
Une autre limite est le désintéressement de
certains élèves de remplir le questionnaire et de nous le
restituer. Ce qui fait que nous avons eu un manque de questionnaire qui aurait
bien pu nous être d'un très grand apport dans notre étude.
Enfin, l'autre limite et pas de moindre est que nous n'avons pas pu
expérimenter notre proposition de leçon afin de mieux
appréhender les limites que celle-ci pourrait avoir.
SECTION 2 : ANALYSE DES RESULTATS
La présente section s'articule sur la
présentation des résultats de l'enquête menée
auprès des élèves et des enseignants des
établissements cités en amont (section 1) ce qui nous conduira
à relever quelques remarques et à donner des propositions afin
d'améliorer l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie. Certes, nous soulignons
dorénavant le caractère non fiable des données, car, elles
ne sont pas issues d'un organisme ou institut de sondage légalement
reconnu dans la récolte des données statistiques. Mais, nous
avons effectué cette enquête pour coller aux exigences de l'Ecole
Normale Supérieure, qui est une Ecole Post-universitaire. Et, la
rédaction de ce mémoire découle après le stage
pratique qui a favorisé l'élaboration de ces questionnaires qui
servent de base de données.
I- Présentation et interprétation des
résultats
Nous allons présenter successivement les
résultats de l'enquête menée auprès des
élèves et des enseignants tout en essayant de les
interpréter et de les analyser.
I-1- Les résultats des enquêtes menées
auprès des élèves
Au total, nous avons soumis cent cinquante (150)
questionnaires de dix (10) questions chacun dont 85 aux nouveaux et 65 aux
redoublants de la première B des établissements cités en
amont et à l'Institut Immaculée conception (I.I.C). En retour,
nous n'avons reçu que 63 questionnaires de la part des nouveaux et 54
questionnaires de la part des redoublants de la classe de première B,
soit un total de 117 questionnaires. Dans les 117 questionnaires, 96
élèves ont répondu à la totalité des
questions posées, tandis que 21 autres n'ont répondu qu'à
une partie de question. Au cours de notre travail, nous analysons les
résultats sans aucune distinction de classe, car les deux groupes font
partie de la même série et sont censés avoir les
mêmes connaissances sur une notion bien définie. Ce questionnaire
a pour but d'analyser la représentation des élèves et de
repérer les difficultés liées à l'apprentissage de
la notion du rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie. Ainsi, pour se faire, nous présentons les
résultats sous forme de tableaux statistiques et graphiques avant de
procéder à leurs interprétations et analyses.
Question 1 : avez-vous déjà entendu
parler du rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie ? Si oui dans quel contexte ?
Tableau 1 : Opinion des
élèves sur la connaissance de la notion.
|
Type de réponses
|
Nombre de réponses
|
Pourcentage (%)
|
|
En classe
|
89
|
76,07
|
|
Dans les journaux
|
2
|
1,71
|
|
Dans un ouvrage
|
26
|
22,22
|
|
N'ayant pas de réponse
|
00
|
00
|
|
Total
|
117
|
100
|
Source : Nos enquêtes,
de juin-juillet 2015

Figure 1 :
Répartition des élèves sur la connaissance de la
notion
Au regard des statistiques, il apparait que sur les 117
élèves ayant répondu à la question, tous ont
déjà entendu parler de la notion du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie. Pour la grande majorité, soit
76,07% des élèves interrogés ont entendu parler de cette
notion en classe. 22,22% des élèves ont pour la première
fois entendu parler de celle-ci dans les ouvrages et 2% dans les journaux.
Cette question a pour objectif de percevoir le niveau de culture de nos
élèves afin de montrer l'importance que peut avoir un cours
dispensé par un enseignant en classe de première B.
Question 2 : avez-vous une certaine connaissance
sur les objectifs poursuivis par ce cours ?
Tableau 2 : Opinion des
élèves sur les objectifs de la notion.
|
Type de réponses
|
Nombre de réponses
|
Pourcentage (%)
|
|
oui
|
12
|
10,26
|
|
Pas vraiment
|
43
|
36,75
|
|
Non
|
61
|
52,14
|
|
N'ayant pas de réponse
|
1
|
1
|
|
Total
|
117
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de juin-juillet
2015
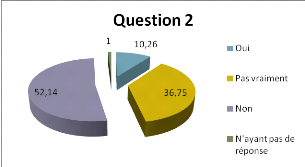
Figure 2 :
Répartition des élèves sur la connaissance des objectifs
de la notion
Les résultats concernant les perceptions des objectifs
de l'apprentissage du rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie par les élèves, se présentent comme
suit : sur 100% des élèves interrogés, 10,26% pensent
connaitre les objectifs poursuivis par l'enseignant ; cette connaissance
des objectifs permet aux élèves de mesurer l'importance du cours
et donc motive les apprenants à continuer les recherches sur la
notion. 36,75% estiment que les objectifs sont rarement définis par les
enseignants et 52,14% disent ne pas percevoir du tout les objectifs de
l'enseignement-apprentissage de la notion du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie. Cette absence des objectifs peut dans
une certaine mesure justifier le désintéressement des
élèves et la démotivation de ces derniers à
comprendre et à fournir des efforts de construction de savoirs sur la
notion enseignée, car il y a un manque d'intérêt.
Question 3 : les enseignants prennent-ils des
exemples sur les actions des pouvoirs publics au Gabon ?
Tableau 3 : Opinion des
élèves sur la stratégie d'enseignement utilisée par
les enseignants.
|
Type de réponse
|
Nombre de réponse
|
Pourcentage (%)
|
|
oui
|
00
|
00
|
|
Rarement
|
7
|
5,98
|
|
Pas du tout
|
102
|
87,18
|
|
N'ayant pas de réponse
|
8
|
6,84
|
|
Total
|
117
|
100
|
Source : Nos
enquêtes, de juin-juillet 2015

Figure 3 :
Répartition de l'opinion des élèves sur la
stratégie d'enseignement utilisée par les enseignants.
Cette question relève de la contextualisation de
l'enseignement de la notion du rôle des pouvoirs publics dans la
régulation de l'économie, qui un élément capital de
l'apprentissage chez les élèves, car sans contextualisation la
notion reste très théorique et imaginaire pour ces derniers, ce
qui d'ailleurs est une autre source du manque d'intérêt
accordé à la notion à étudier. Ainsi, sur 117
élèves interrogés, 108 disent ne jamais avoir entendu leur
enseignant prendre des exemples sur les actions des pouvoirs publics au Gabon,
soit un total de 87,18%. Par ailleurs, aucun élève ne se souvient
de la récurrence de prise des exemples sur le Gabon.
Question 4 : De quelle façon les
professeurs devraient-ils procéder afin de mieux transmettre
les connaissances sur la notion du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie ?
Tableau 4 : Opinion des
élèves sur le choix de la stratégie appropriée pour
une bonne transmission des connaissances sur la notion.
|
Type de réponse
|
Nombre de réponse
|
Pourcentage (%)
|
|
Exposé de groupe
|
10
|
8,55
|
|
Cours accompagné des documents sur le Gabon
|
53
|
45,30
|
|
Travail de maison
|
52
|
44,45
|
|
N'ayant pas de réponse
|
2
|
1,71
|
|
Total
|
117
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin-juillet 2015
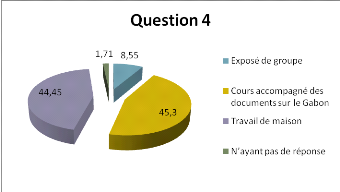
Figure 4 :
Répartition de l'opinion des élèves sur le choix de la
stratégie appropriée pour une bonne transmission des
connaissances sur la notion.
Selon nos statistiques, la tendance est plus forte pour des
cours accompagnés des documents sur le Gabon, soit 45,30% des
élèves préfèrent discuter non seulement avec
l'enseignant, mais surtout avec les condisciples sur cette notion à
travers des textes plus pratiques sur le Gabon pendant le cours. Cette
méthode nous semble également pertinente dans la mesure où
elle permet à l'enseignant de repérer les difficultés des
ses élèves et de leur permettre de construire entre
eux-mêmes les savoirs. 44,45% préfèrent le travail de
maison, mais cette méthode a le défaut que certains
élèves ne préparent plus eux-mêmes le travail, la
tendance est qu'ils préfèrent souvent donner à leurs
ainés, ce qui ne favorise aucun apprentissage à
l'élève concerné.
Les 8,55% et le 1,75% sont les élèves qui eux
préfèrent respectivement les exposés de groupe et ceux
n'ayant pas répondu à la question. La méthode des
exposés n'est bénéfique souvent que pour une petite partie
des élèves travailleurs et motivés, car certains ne
participent pas au travail en groupe et profitent juste des notes au
détriment de la connaissance.
Question 5 : Quelle méthode utilisez-vous
pour étudier vos leçons ?
Tableau 5 : Opinion des
élèves sur la méthode utilisée pour étudier
leur leçon.
|
Type de réponses
|
Nombre de réponses
|
Pourcentage (%)
|
|
Mémorisation des cours
|
55
|
47,01
|
|
Lecture complémentaire
|
33
|
28,21
|
|
Autres (précisez)
|
8
|
6,84
|
|
N'ayant pas de réponse
|
21
|
17,95
|
|
Total
|
117
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin-juillet 2015
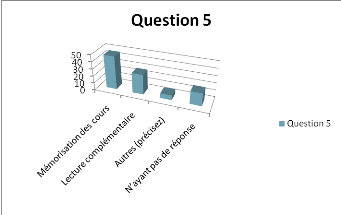
Figure 5 :
Répartition de l'opinion des élèves sur la méthode
utilisée pour étudier leur leçon.
En interprétant le graphique, il ressort que 47,01%
soit un total 55 élèves utilisent la méthode de la
mémorisation des cours et 28,21% le font par lecture
complémentaire et les autres 6,84 et 17,95% sont respectivement ceux
utilisant d'autres méthodes et ceux n'ayant pas de réponse.
Cette tendance montre la non construction des savoirs en classe, ce qui pousse
les apprenants à utiliser la méthode de mémorisation qui
est une conséquence du modèle de l'enseignement transmissif.
Question 6 : les cours dispensés par votre
enseignant d'économie s'accompagnent-ils des documents
sur le Gabon ?
Tableau 6 : Opinion des
élèves sur la qualité des exemples pris par les
enseignants sur la notion.
|
Type de réponses
|
Nombre de réponses
|
Pourcentage (%)
|
|
Oui
|
22
|
18,80
|
|
Rarement
|
34
|
29,06
|
|
Jamais
|
60
|
51,28
|
|
N'ayant pas de réponse
|
1
|
1
|
|
Total
|
117
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin-juillet 2015

Figure 6 :
Répartition de l'opinion des élèves sur la qualité
des exemples pris par les enseignants sur la notion.
Comme nous l'avons signalé en amont, cette question
relève de la contextualisation de l'enseignement-apprentissage du
rôle de l'Etat dans le but de ne pas trop rester théorique, ce qui
d'ailleurs peut être une source de désintéressement des
élèves sur la notion. Au regard de nos statistiques, 51,28% des
élèves disent ne jamais avoir eu des textes portant sur le Gabon
pendant l'enseignement-apprentissage de cette notion. Cette tendance vient
renforcer la première sur le manque des exemples pris sur le Gabon
pendant le cours sur la notion. 18,80 et 29,06% des élèves
disent respectivement avoir et avoir souvent des textes portant sur le Gabon
pendant le cours. Pendant les entretiens avec certains élèves,
certains sont allés jusqu'à nous dire qu'ils travaillent
difficilement sur les textes, que ce soit de l'extérieur ou encore du
Gabon. Cela vient également confirmer la préférence des
enseignants au cours magistral dans nos lycées.
Question 7 : Selon vous, quelle est la
problématique de la leçon sur le rôle de l'Etat dans
la régulation de l'économie ?
Tableau 7: Opinion des élèves
sur la problématique de la leçon.
|
Type de réponses
|
Nombre de réponses
|
Pourcentage (%)
|
|
L'Etat doit il intervenir dans une économie ?
|
12
|
10,26
|
|
Pourquoi l'Etat intervient ils pour réguler
l'économie ?
|
26
|
22,22
|
|
Pourquoi et comment l'Etat intervient-il pour réguler
les activités dans une économie de marché ?
|
47
|
40,17
|
|
N'ayant pas de réponse
|
32
|
27,35
|
|
Total
|
117
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de juin-juillet 2015
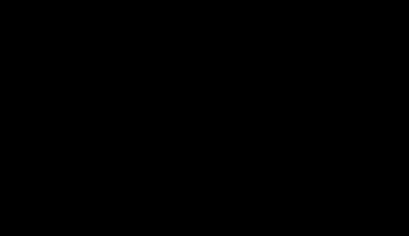
Figure 7 :
Répartition de l'opinion des élèves sur la
problématique de la leçon.
En ce qui concerne cette question qui relève de la
problématique actuelle de la relation entre Etat et marché, la
tendance pour la première problématique est perceptible :
40,17% des élèves pensent que la problématique à la
question est de savoir pourquoi et comment l'Etat intervient-il pour
réguler les activités dans une économie de
marché ? Cette tendance montre que malgré les
difficultés de compréhension de la notion, ils ont une bonne
compréhension de la problématique. Car la question actuelle n'est
plus de savoir si l'Etat devrait intervenir dans une économie, mais
plutôt pourquoi et comment peut il intervenir de façon optimale
dans l'économie du pays. 22,22% des élèves sont favorables
pour le premier volet de la question et les 10,26 et les 27,35% des autres
élèves sont ceux ayant penché pour la première
problématique et ceux n'ayant pas de réponse à la
question.
Question 8 : Selon vous quelles sont les raisons
d'intervention de l'Etat dans une économie ?
Tableau 8 : Opinion des
élèves sur la connaissance de la notion.
|
Type de réponse
|
Nombre de réponse
|
Pourcentage (%)
|
|
Uniquement pour produire des biens et services
|
17
|
14,53
|
|
Uniquement pour booster la croissance économique
|
47
|
40,17
|
|
Pour résoudre les défaillances du
marché
|
27
|
23,08
|
|
N'ayant pas de réponse
|
26
|
22,22
|
|
Total
|
117
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin-juillet 2015
Il apparait généralement que les
élèves pensent que le rôle de l'Etat dans une
économie ne se limite qu'à la politique de la relance
économique, ce qui explique que 40,17% des élèves estiment
que l'Etat n'intervient que pour booster la croissance économique.
Penser ainsi, c'est limiter le rôle de l'Etat dans la construction des
infrastructures.
Question 9 : Connaissez-vous les principaux
moyens d'intervention de l'Etat dans la régulation de
l'économie ? Si oui lesquels ?
Tableau 9 a : Opinion des
élèves sur la connaissance des moyens d'intervention dont
disposent les pouvoirs publics pour réguler les activités
économiques.
|
Type de réponse
|
Nombre de réponse
|
Pourcentage (%)
|
|
oui
|
52
|
44,44
|
|
Non
|
60
|
51,28
|
|
N'ayant pas de réponse
|
5
|
4,27
|
|
Total
|
117
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin-juillet 2015

Figure 8 :
Répartition de l'opinion des élèves sur la
connaissance des moyens d'intervention dont disposent les pouvoirs publics pour
réguler les activités économiques.
Par rapport à cette question, les statistiques nous
montrent que 44,44% des élèves interrogés sont convaincus
qu'ils connaissent les moyens dont les pouvoirs publics disposent pour
réguler l'économie. Tandis que 51,28% disent ne pas savoirs les
moyens d'intervention de l'Etat dans une économie.
Question 9 b : Si oui lesquels ?
Tableau 10 : Opinion des
élèves sur la précision des moyens d'intervention de
l'Etat dans la régulation de l'économie.
|
Type de réponse
|
Nombre de réponse
|
Pourcentage (%)
|
|
Le Budget
|
44
|
37,61
|
|
La réglementation
|
20
|
17,09
|
|
Budget et réglementation
|
33
|
28,21
|
|
N'ayant pas de réponse
|
20
|
17,09
|
|
Total
|
117
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin-juillet 2015
Pour le deuxième volet de la question, qui consiste
à préciser ces moyens d'intervention 44 élèves sur
les 117 élèves interrogés soit une moyenne de 37,61%
pensent que le moyen d'intervention de l'Etat est le Budget. 17,09% des
élèves pensent que l'Etat intervient à travers la
réglementation et 28,21% ont une bonne réponse sur les moyens
dont disposent les pouvoirs publics pour assurer un bon fonctionnement des
activités économiques.
Question 10 : selon vous, dans une
économie de marché, l'Etat doit il être
considéré comme :
Tableau 11 : Opinion des
élèves sur la connaissance de la place de l'Etat dans une
économie de marché.
|
Type de réponse
|
Nombre de réponse
|
Pourcentage (%)
|
|
Arbitre
|
41
|
35,04
|
|
Décideur
|
33
|
28,21
|
|
Producteur
|
35
|
29,91
|
|
N'ayant pas de réponse
|
8
|
6,84
|
|
Total
|
117
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin-juillet 2015

Figure 9 :
Répartition de l'opinion des élèves sur la
connaissance de la place de l'Etat dans une économie de marché.
Au regard des résultats, il apparait que la
majorité des élèves arrive bien à situer le
rôle de l'Etat dans une économie. Ainsi, 35,04% savent que les
pouvoirs publics se comportent désormais comme un arbitre du jeu
économique. L'État régulateur est un État qui agit
plus indirectement que directement, qui est plus en interaction qu'en action,
qui délègue plus qu'il n'intervient directement, qui pilote et
qui oriente plus qu'il ne se met en oeuvre. 35,04% considèrent encore
l'Etat comme un producteur des biens et services, tandis que 29,91% voient
l'Etat comme un décideur, un agent économique toujours en
action.
I-2- Analyse des résultats de l'enquête:
entretien avec les enseignants
Un questionnaire anonyme composé de sept questions a
été soumis aux enseignants de sciences économiques et
sociales du Lycée d'Application Nelson Mandela (le 15 Juin 2015), de
l'Institut Immaculée Conception (le 22 Juin 2015) et du Lycée
Georges MABIGNATH (le 29 Juin 2015). Ce questionnaire vise à recueillir
des informations sur l'enseignement du thème, le rôle de l'Etat
dans la régulation de l'économie en classe de première B.
Sur un total de 12 questionnaires distribués nous avons reçu en
retour huit (8) questionnaires remplis, dont deux (2) du Lycée
d'Application Nelson Mandela, sept (5) du Lycée Georges MABIGNATH et un
(1) questionnaire de l'Institut Immaculée Conception. Nous sommes
conscient que cet échantillon est largement insuffisant pour tirer des
conclusions générales, et qu'elles ne sont pas issues d'un
organisme ou institut de sondage légalement reconnu dans la
récolte des données statistiques comme nous l'avons
signalé dès le départ. Mais, compte tenue des
circonstances dans lesquels nous avons passé cette année, nous
n'avons pas eu d'autres choix que de donner le maximum qu'on pouvait. Nous
avons effectué cette enquête pour répondre aux exigences de
l'Ecole Normale Supérieure. Qu'à cela ne tienne, nous
présenterons successivement chacune des questions posées
accompagné de son interprétation et une brève analyse.
Tableau 12 : Effectif de la population
étudiée
|
Effectif total
|
12
|
|
Nombre traité
|
8
|
|
Percentage
|
66,67
|
|
Nombre dépouillé
|
8
|
Source : Nos enquêtes, de
juin 2015
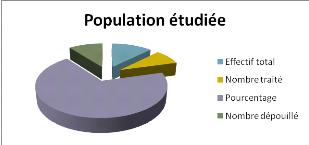
Figure 10 :
Répartition de l'effectif total de la population
étudiée
Question 1 : Depuis combien d'année
dispensez-vous les cours de sciences économiques et
sociales en première?
Tableau 13 : Opinion des enseignants sur
l'enseignement de la leçon
|
Type de réponses
|
Nombre de réponses
|
Pourcentage (%)
|
|
Moins de 3ans
|
1
|
12,5
|
|
3 à 6ans
|
1
|
12,5
|
|
6ans et plus
|
4
|
75
|
|
Total
|
8
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin 2015
Selon nos statistiques, la majorité des enseignants
interrogés soit un pourcentage 75% ont une expérience au moins de
six ans. Cette tendance montre que ces enseignants sortis au moins dans les
années 2008-2009 de l'Ecole Normale Supérieure ont soit
été formés au format OPAE par séminaire, ou n'ont
jamais appris cette stratégie d'enseignement, ce qui a pour
conséquence l'emploie des ancienne stratégies
d'enseignement-apprentissage.
Question 2: Quelles sont les difficultés
auxquelles vous êtes confrontés dans les classes de
premières dans le cadre de l'enseignement-apprentissage portant
sur le thème : le rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie ?
Tableau 14 : Difficultés de
l'enseignement du thème le rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie
|
Type de réponse
|
Nombre de réponse
|
Pourcentage (%)
|
|
Manque des données sur le Gabon
|
3
|
37,5
|
|
Sources d'information
|
0
|
00
|
|
Contextualisation
|
5
|
62,5
|
|
Total
|
8
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin 2015
Du coté des enseignants, il était question de
voir avec eux les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans
les classes de première B pour enseigner le thème le rôle
de l'Etat dans la régulation de l'économie qui figure dans
la progression indicative de l'Institut Pédagogique National. A cette
question de savoir les difficultés rencontrées par les
enseignants, il ressort en général que les difficultés
sont liées à la contextualisation, (62,5%) et à la non
disponibilité des données concernant le Gabon (37,5%) afin de
rendre plus compréhensif le cours.
Question 3 : Quelle est la stratégie que
vous adoptez pour dispenser cet enseignement ?
Tableau 15: Opinion des enseignants sur les
stratégies d'enseignement
|
Type de réponses
|
Nombre de réponses
|
Pourcentage (%)
|
|
Cours magistral
|
6
|
75
|
|
OPAE
|
1
|
12,5
|
|
Autres
|
1
|
12,5
|
|
Total
|
8
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin 2015
Cette question qui porte sur les stratégies
d'enseignement a pour objectif de voir les moyens utilisés par les
enseignants pour une meilleure efficience de l'action pédagogique. Il
est à noter que 75% des interrogés utilisent la stratégie
magistrale contre 12,5% qui font usage de la stratégie d'objectif
problématique, activité évaluation (OPAE) et 12,5% qui
adoptent d'autres stratégies.
Question 4 : Que pensez-vous de l'approche OPAE
?
Tableau 16 : Opinion des enseignants
concernant l'approche OPAE
|
Type de réponse
|
Nombre de réponse
|
Pourcentage (%)
|
|
Favorise l'enseignement-apprentissage
|
1
|
12,5
|
|
Pas adaptée à nos réalités
|
4
|
50
|
|
Ne maitrise pas
|
3
|
37,5
|
|
Total
|
8
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin 2015
Cette question adressée aux enseignants avait pour
objectif d'avoir leur point de vue sur le format OPAE (Objectif
Problématique Activité Evaluation) afin de mieux comprendre leur
réticence dans l'application de celui-ci dans les salles de classe. Elle
vise également à savoir la façon dont les enseignants
perçoivent cette stratégie d'enseignement dans le contexte
gabonais. Selon nos statistiques, nous constatons que 60% des enseignants
interrogés estiment que cette stratégie d'enseignement n'est pas
adaptée à nos réalités. Ils évoquent
notamment le manque de moyens didactiques (photocopieuse, les livres...)
adaptés à la stratégie, les effectifs pléthoriques
dans les salles de classe qui ne favorisent pas une bonne gestion du temps et
donc du programme. 30% d'autres enseignants disent ne pas maitriser le
dispositif OPAE. Et seul 10% des enseignants interrogés reconnaissent
l'efficacité de cette nouvelle stratégie d'enseignement.
Question 5 : Selon vous, quelle est la
problématique de la leçon sur le rôle de l'Etat dans
la régulation de l'économie ?
Tableau 17: l'opinion des enseignants sur la
problématique de la leçon
|
Type de réponse
|
Nombre de réponse
|
Pourcentage (%)
|
|
L'Etat doit-il intervenir dans une économie ?
|
2
|
25
|
|
Pourquoi l'Etat intervient-ils pour réguler
l'économie ?
|
3
|
37,5
|
|
Pourquoi et comment l'Etat intervient-il pour réguler
les activités dans une économie de marché ?
|
3
|
37,5
|
|
Total
|
8
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin-juillet 2015
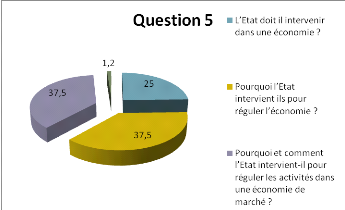
Figure 11 :
Répartition de l'opinion des enseignants sur la
problématique de la leçon
A cette question, les enseignants sont partagés entre
les 37,5% qui estiment que la bonne problématique est pourquoi l'Etat
intervient-il pour réguler l'économie ? Et ceux qui sont
pour la troisième problématique : pourquoi et comment l'Etat
intervient-il pour réguler les activités dans une économie
de marché ? Pour cette problématique également 37,5%
des enseignants interrogés ont un penchant pour la bonne
problématique. Par contre seul 25% des enseignants interrogés ont
une mauvaise connaissance de la problématique actuelle.
Question 6: Abordez-vous la réglementation
comme moyen d'intervention des pouvoirs publics dans la
régulation de l'économie ? Si non
pourquoi ?
Tableau 18 : Opinion des enseignants
concernant la place de la réglementation dans la régulation de
l'économie
|
Type de réponse
|
Nombre de réponse
|
Pourcentage (%)
|
|
Oui
|
3
|
37,5
|
|
Non
|
5
|
62,5
|
|
Total
|
8
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin 2015
Selon nos statistiques, 62,5% des enseignants n'abordent pas
la réglementation comme un des moyens de l'intervention de la puissance
publique et 37,5% abordent cet élément comme moyen de
régulation des activités économiques par l'Etat. A la
question de savoir pourquoi ? Certains estiment ne pas être assez
outillés en droit afin d'aborder la partie juridique de la notion tandis
que d'autres évoquent le manque des textes à leur portée
concernant la réglementation gabonaise sur les activités
économiques.
Question 7 : Que pensez-vous de l'enseignement de
la leçon sur le rôle de l'Etat dans
l'économie ? Et pourquoi ?
Tableau 19 : Opinion des enseignants sur
l'enseignement de la leçon
|
Type de réponse
|
Nombre de réponse
|
Pourcentage (%)
|
|
Facile à transmettre
|
1
|
12,5
|
|
Abordable
|
2
|
25
|
|
Complexe
|
5
|
62,5
|
|
Total
|
8
|
100
|
Source : Nos enquêtes, de
juin 2015

Figure 12 :
Répartition de l'opinion des enseignants sur l'enseignement de
la leçon
Du coté des enseignants, il était question de
voir avec eux si cette notion est difficile ou facile à transmettre et
pour quelles raisons. Selon le graphique, 62,5% des enseignants ayant
répondu à la question trouvent la notion complexe à
transmettre, ils évoquent notamment la multidisciplinarité de la
notion, l'absence des données des actions des pouvoirs publics, et la
difficulté de contextualiser la notion. 25% par contre trouvent la
notion abordable mais avec les données de la France, car ce sont les
seules qu'ils ont à leur disposition.
Chapitre IV : proposition des nouvelles approches
stratégiques de l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat
dans la régulation de l'économie en classe de première
B
Depuis le début du vingtième siècle, et
de manière récurrente, plusieurs commentateurs ont pu parler d'un
« bégaiement » constitutif du discours pédagogique. Il
est d'usage d'opposer une « pédagogie centrée sur
l'enseignant » et une « pédagogie centrée sur
l'apprenant ». Dans la première, la situation serait
organisée autour de la prestation du maître : celui-ci dispense
des informations dont la validité scientifique et culturelle est
avérée mais sans se demander d'aucune manière si elles
sont adaptées à ses élèves, intégrées
dans leur progression et participent à leur formation personnelle. Dans
la seconde, la situation serait organisée autour de la construction par
l'élève de ses propres connaissances : l'enseignant y devient une
personne-ressource qui diagnostique les besoins de chacun, lui fournit les
documents et exercices adaptés, l'accompagne dans un parcours
individualisé. Dans la « pédagogie centrée sur
l'enseignant », il s'agirait de séduire ou de capter un auditoire
pour l'amener à reproduire un comportement intellectuel
standardisé. Dans la « pédagogie centrée sur
l'apprenant », on mettrait en place des « contrats » à
partir d'objectifs négociés, avec le souci constant d'impliquer
chacun dans la démarche, de le rendre « actif » et de le faire
participer à sa propre évaluation. Dans la première
règnerait la sélection drastique imposée par la
règle du « mimétisme identificatoire ». Dans la seconde
se construirait progressivement un modèle de réussite
différencié où chacun pourrait atteindre des objectifs
différents mais d'égale dignité.
Ainsi, si tous les experts de l'éducation recommandent
la deuxième stratégie d'enseignement à travers le
dispositif Objectif Problématique activité évaluation
(OPAE), cette stratégie est- elle adaptée à nos
réalités ? Sinon, comment la rendre plus efficace afin
d'atteindre les objectifs fixés ?
Dans ce chapitre, il s'agit de proposer une meilleure
façon d'aborder cet enseignement-apprentissage en classe de
première B. Et pour cela, nous présentons premièrement les
remarques sur ce qui se fait actuellement dans les lycées (Section 1),
avant de proposer une nouvelle leçon (Section 2).
SECTION 1 : REMARQUES ET SUGGESTIONS
Dans cette section, il s'agit de mener une discussion qui
comprend un constat général et une brève synthèse
critique suivie de quelques recommandations ;
1- Constat général
Avec le développement du libéralisme et la
vitesse de la mondialisation, nous constatons que la régulation de
l'économie par les Etats ne se fait plus sans tenir compte des
politiques menées par l'extérieur, par exemple le Gabon ne peut
pas prendre des décision de politiques économiques sans tenir
compte des politiques économiques des autres pays membres de la zone
CEMAC. Plus encore les politiques économiques menées dans les
pays en développement doivent désormais tenir compte des
conditions dictées par les institutions financières
internationales notamment la Banque Mondiale(B.M), et le Fond Monétaire
International (F.M.I). Ces conditions peuvent être résumées
en un seul mot : La Bonne Gouvernance.
A cela s'ajoute la difficulté de contextualisation de
la notion par les enseignants.
Par ailleurs, plusieurs décennies de recherche sur
l'enseignement permettent d'affirmer aujourd'hui que ce que les enseignants
font en classe est sans conteste le premier des déterminants scolaires
de l'apprentissage et de la réussite des élèves. Il va
sans dire que toutes les pratiques pédagogiques ne sont pas
égales à cet égard. Il importe par conséquent
d'identifier et de promouvoir les pratiques les plus efficaces,
c'est-à-dire celles qui aident les élèves à
réaliser le plus efficacement possible les apprentissages
souhaités. Dans cette perspective, tous (chercheurs, décideurs,
formateurs d'enseignants, encadreurs pédagogiques, parents, praticiens
de la classe) s'accordent à rejeter l'enseignement dit
«traditionnel». Il s'agit d'un enseignement essentiellement
expositif, dominé par l'enseignant, reléguant les
élèves à un rôle passif, réduisant leur
activité en classe à la mémorisation de données
à réciter à l'enseignant, c'est d'ailleurs ce que
révèle notre étude dans la question 5.
Les alternatives proposées à ce type d'enseignement peuvent
être regroupées en deux grandes catégories : les
pédagogies structurées et les pédagogies par
découverte. Les partisans de chacune de ces catégories
s'entendent sur un fait : l'acquisition du savoir est un processus de
construction (constructivisme et socioconstructivisme). Comment soutenir
efficacement ce processus en milieu scolaire est la question qui les divise.
Pour des raisons évidentes, la réponse à cette question
est particulièrement importante pour le cas du Gabon. En effet, au
Gabon, en grande partie à cause du manque de la volonté
politique, les conditions d'apprentissage ne sont pas optimales et les
indicateurs en matière d'offre éducative, en terme de
qualitatifs, sont faibles Nguema endamane, (2011) Quantin de mongaryas (2014).
De plus, l'enseignement dit «traditionnel» s'avère y
être la pratique dominante. Dans de tels contextes et au regard des
objectifs d'éducation de base de qualité pour tous, l'on doit
poser à la fois la question d'efficacité pédagogique et
d'efficience
2- Introduction de la notion de la bonne gouvernance
dans le rôle de l'Etat dans la régulation de l'économie.
Notre première suggestion est d'ajouter la notion de la
bonne gouvernance dans le rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie. En effet, comme nous l'avons signalé dans notre
constat général, la régulation de l'économie ne se
fait plus sans tenir compte des contraintes extérieures notamment les
politiques des autres pays et les conditions imposées par les
institutions économiques et financières internationales. Cette
notion est un préalable à la compréhension du
thème I : croissance, développement et
sous-développement et du thème VII : les
mécanismes monétaires et financiers internationaux, croissance et
développement en classe de terminale B.
3- Les réalités de l'école
gabonaise et les nouvelles stratégies d'enseignement
Comme le montre les résultats de nos enquêtes,
les stratégies utilisées pour assurer un enseignement
apprentissage optimal du rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie ne sont pas appropriées du fait de la
complexité de la notion et du manque des éléments de
contextualisation. Une chose semble claire cependant, la majorité des
travaux mené par nos ainés (mémoires
précédents) s'entendent pour dénoncer les insuffisances
de la pédagogie traditionnelle et préconisent la méthode
de la pédagogie active22(*). Cependant, dans le contexte gabonais où l'on
retrouve des classes à effectifs pléthoriques, des enseignants
parfois peu ou mal formés, une insuffisance de matériel, il
semble difficile d'implanter des approches aussi complexes que les
pédagogies actives (Objectif Problématique, Activité,
Evaluation : OPAE). Mais pourtant elles semblent être les meilleurs
et moins couteuses que d'autres pédagogies innovantes (les
méthodes de pédagogies par découverte)
Entre les insuffisances de la pédagogie traditionnelle,
d'une part, et le coût élevé, l'engagement personnel
intense des enseignants et la complexité d'apprentissage par les
enseignants des pédagogies par découverte, d'autre part, il ne
nous reste que la pédagogie active, adaptable en contexte gabonais, et
sur l'enseignement-apprentissage de la notion du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie en particulier, et qui correspondrait
à l'enseignement explicite. L'efficacité de cette
approche a été démontrée, son efficience
également. De plus, elle ne s'éloigne pas trop de ce que les
enseignants savent déjà faire mais elle le leur fait mieux faire,
elle n'exige pas de matériel sophistiqué et peut s'adapter
à des classes à effectifs élevés pourvu que
l'enseignant prenne plus de temps dans la préparation de son cours et
que les pouvoirs publics mettent à sa disposition des photocopieuses et
tout ce qui va avec. C'est une pédagogie active mais structurée
et plus simple à appliquer.
4- La formation des enseignants
Si l'on s'entend pour dire que la difficulté de
l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat dans la régulation
de l'économie est d'ordre pédagogique et contextuel, alors il est
nécessaire de mettre l'accent sur la formation des enseignants afin
qu'ils soient capables de dépasser les insuffisances de la
pédagogie traditionnelle et d'enseigner de manière plus efficace.
Or, sur le plan des approches pédagogiques, nous pensons que plus
l'écart est grand entre ce que les enseignants savent faire et ce qu'on
voudrait leur faire apprendre, plus les risques d'échec sont
élevés. Certaines stratégies d'enseignement-apprentissage
sont intéressantes mais difficiles à
maîtriser. De plus, on l'a vu, leur efficacité réelle est
remise en question. C'est pourquoi nous pensons qu'il est plus
raisonnable d'opter pour les mises à niveau des enseignants n'ayant pas
été formés sur des modèles d'enseignement
plus simples (OPAE) mais dont l'efficacité a
été largement démontrée tant à
l'échelle de la classe, de l'école, du
système scolaire, tant en milieu favorisé que
défavorisé. Ainsi, à l'Ecole Normale supérieure,
les enseignements en science de l'éducation devraient être
dispensés de façon permanente dès la première
année (Licence I) dans toutes les disciplines jusqu'à la
dernière année de la formation (Master II) ; cela se fait
dans les filières de conseiller d'orientation. Dans cette perspective,
une formation initiale axée exclusivement sur les disciplines scolaires
ne saurait convenir. Qu'elle se déroule à l'Ecole Normale ou dans
le milieu scolaire lors de stages pratiques, la formation doit être
professionnalisante, c'est-à-dire qu'elle doit rendre possible
l'apprentissage des comportements que les professionnels de l'enseignement
auront à exercer pour oeuvrer auprès de leurs
élèves. En ce sens, former un économiste est
différent de former un enseignant d'économie.
En plus de ce qui est dit précédemment,
l'Institut Pédagogique Nationale en collaboration avec les pouvoirs
publics doivent confiner la progression indicative en proposant des ressources
et des supports d'activité en ligne afin de rendre facile la
contextualisation des cours.
Section 2 : proposition d'une fiche de
leçon
Cette section propose une leçon rénovée
basée sur une meilleure stratégie d'enseignement-apprentissage et
qui tient compte de la transformation du rôle de l'Etat dans la
régulation des économies de marché. Cette transformation
est une conséquence de la mondialisation. Désormais, les Etats ne
peuvent plus prendre des décisions des politiques économiques
sans tenir compte de l'extérieur. Ces contraintes sont également
et surtout imposées par les institutions financières
internationales notamment : le Fond monétaire international (FMI),
la Banque Mondiale (BM)... A cela s'ajoute un effort de contextualisation de la
notion en prenant des documents qui assurent l'approchement des
élèves avec leur culture afin de facilité la
compréhension et la construction des savoirs et de savoir-faire.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE,
REPUBLIQUE GABONAISE
DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.
Union- Travail- Justice
LYCEE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Département des Sciences Economiques et Sociales
Elève stagiaire : Fridolin MAHANGA
Classe : Première
X
Effectif : X
Fiche de déroulement de la
leçon
Date :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CHAPITRE V: La régulation des activités
économiques par l'Etat
Leçon précédente : les limites du
marché
|
Verification des acquis : 5 min
|
Questions
|
Propositions de réponses
|
|
Savoir
Savoir-faire
|
- Qu'entend-on par limites du marché ?
- Quelles sont les principales défaillances du
marché ?
- Quels sont les principaux déséquilibres du
marché ?
|
L'ensemble des biens et services que les marchés sont
incapables de fournir ou qu'ils ne peuvent pas éviter certaines
conséquences de la production qui sont soient bénéfiques
ou indésirables pour le bien fonctionnement du marché.
Les principales défaillances du marché
sont : les biens collectifs (ou biens publics) les externalités (ou
effets externes) et les monopoles naturels
Les principaux déséquilibres du marché
sont : les déséquilibres macroéconomiques, les
inégalités économiques et sociales et les choix
stratégiques
|
Annonce de la leçon du jour : le rôle de
l'Etat dans la régulation de l'économie
|
Pré-requis : 5 min
Savoirs
Savoir-faire
|
Qu'est ce qu'une loi ?
Comment peut-on définir l'Etat ?
|
Une loi est une règle écrite,
générale et obligatoire, élaborée par
l'Assemblée Nationale. Elle peut être à l'initiative du
gouvernement (projet de loi) ou de l'Assemblée nationale (proposition de
loi). Elle est votée par l'Assemblée nationale.
Ensemble d'organes politiques et administratifs dont
l'organisation est régie par la constitution qui exercent le
pouvoir politique et gèrent les services
publics.
|
|
Objectif 3 min
|
Objectif général : A la
fin de la leçon, l'élève devrait être capable
d'analyser le rôle des pouvoirs publics en matière de politiques
économiques et sociales
Objectifs spécifiques : A la fin
de cette séquence de cours, l'élève devrait être
capable:
Objectif spécifique1: de distinguer la
régulation de la réglementation
Objectif spécifique 2 : de
préciser les différents moyens dont dispose l'Etat pour atteindre
ses objectifs
|
|
Problématique : 2 min
Pourquoi et comment l'Etat intervient-il pour réguler
l'économie ?
|
Plan de la leçon 1 min
|
I- définition de termes clés
1- réglementation
2- régulation
II- les moyens de régulation de l'Etat
1- la réglementation
2- la régulation par les règles de droit
a) La politique budgétaire de relance
b) La politique monétaire
c) La bonne gouvernance
|
Sollicitation de
représentations : 5 min
|
Stratégies
|
Questions
|
|
Questionnement direct
Documents de sensibilisation
Exercice sur document
|
-Qu'est ce que la réglementation ?
- Qu'est ce que la régulation ?
-Quels sont les moyens d'intervention de l'Etat dans la
régulation de l'économie ?
|
Activités
|
Séquence1
|
Exploitation du document et réponses aux questions
|
10 min
|
|
Séquence 2
|
Proposition de correction de l'activité
|
5 min
|
Mise en place des activités
d'apprentissage
|
Objectifs spécifiques
|
Document retenu
|
Durée : 15 min
|
|
Objectifs spécifiques : A la fin
de cette séquence de cours, l'élève doit être
capable de :
Objectif spécifique1: de distinguer la
régulation de la réglementation
Objectif spécifique 2 : de
préciser les différents moyens dont dispose l'Etat pour atteindre
ses objectifs
|
Documents1: l'action du gouvernement
gabonais.
Sur les routes bitumées, le membre du
Gouvernement a indiqué à l'opinion que depuis 2010, 1500
km de routes aux standards internationaux ont été
engagés. 500 km sur les 1500 km ont
été réceptionnés par le Gouvernement. Avec ce vaste
chantier, qui concerne l'ensemble des provinces du pays, le Gouvernement veut
à terme faire rallier l'ensemble des capitales provinciales à
Libreville en béton bitumineux. (...)
Sur les logements, l'invité de `'Faire
Savoir'' a indiqué que des actions dans ce sens sont en cours de
réalisation. 12 000 logements, visant deux
catégories de gabonais sont en construction. (...) Les
mesures prises lors des dernières assises sociales permettent
déjà de redynamiser l'Office national de l'emploi (ONE) avec la
mise en place incessamment des services de proximité aussi bien à
Libreville qu'à l'intérieur du pays, pour accompagner dignement
les demandeurs d'emplois.
Pour faire face à la dépendance du Gabon
vis-à-vis de l'extérieur en matière de denrées
alimentaires, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba a
mis sur pied dix fermes agropastorales.
Dans ses relations avec le Parlement, le Ministre a
présenté, au nom du Gouvernement, plusieurs projets de lois
visant à poser les bases juridiques du Plan stratégique Gabon
émergent (PSGE), cher au Président de la République. Ces
textes, déjà adoptés par les deux chambres du Parlement,
sont actuellement en phase de promulgation. Il s'agit de : la loi portant
modification et suppression de certaines dispositions de la loi n°001/2005
du 04 février 2005 portant Statut général des PME PMI.
Cette loi, qui pose le fondement juridique de l'accès aux marchés
publics, permet désormais, non seulement de réorganiser les
offres des marchés dans un esprit d'équité, de justice
sociale et de transparence, mais surtout de susciter l'esprit saine
émulation et de performance dans le travail..
L'action, Bimensuel d'Information Gouvernementale,
deuxième partie N°02 - 03 au 16 Novembre 2014. P .7
Document 2: la bonne gouvernance

|
|
Travail à faire sur document 1
|
Libellés
|
Questions
|
Réponses
|
|
Tâche 1
|
Identifiez les domaines d'intervention des pouvoirs
publique
|
Selon le texte, l'Etat intervient dans trois principaux
domaines : économique, social et juridique.
|
|
Tâche 2
|
Qu'est ce que la réglementation ?
|
la réglementation est un ensemble de lois, de
prescriptions, de règles, régissant une activité
sociale.
|
|
Tâche 3
|
- Qu'est ce que la régulation ?
|
la régulation désigne l'ensemble des
mécanismes et des moyens d'action dont
dispose un Etat et qui ont pour objectif soit la
stabilité de l'économie dans sa globalité (ce sont les
moyens utilisés par les politiques économiques) soit le maintien
de l'équilibre d'un marché de biens ou de services
(régulation sectorielle)
|
|
Tâche 4
|
Quelles différences faites-vous entre régulation
et réglementation ?
|
La différence qu'il y a entre la réglementation
et la régulation est que la réglementation est un ensemble de
lois, de prescriptions, de règles, régissant une activité
sociale tandis que la régulation désigne l'ensemble des
mécanismes et des moyens d'action dont dispose un Etat et qui ont pour
objectif soit la stabilité de l'économie dans sa globalité
(ce sont les moyens utilisés par les politiques économiques) soit
le maintien de l'équilibre d'un marché de biens ou de services
(régulation sectorielle).
|
|
Tâche 5
|
A l'aide de vos lectures et du document ci-dessous, donnez les
différents moyens d'intervention de l'Etat.
|
Pour réguler une économie les pouvoir publics
utilisent les textes de lois (la réglementation, ou les leviers
économiques, notamment la politique budgétaire de relance et/ou
la politique monétaire
|
Document 2 : La bonne gouvernance
|
libellés
|
Questions
|
Proposition de réponses
|
|
Tache 1
|
Qu'est ce que la bonne gouvernance?
|
C'est la capacité du gouvernement à gérer
efficacement ses ressources, à mettre en oeuvre des politiques
pertinentes, que le respect des citoyens et de l'État pour les
institutions ainsi que l'existence d'un contrôle démocratique
(Banque Mondiale 1999).
|
|
Tache 2
|
Quels sont les principaux acteurs de la bonne gouvernance?
|
Les acteurs de la bonne gouvernance sont tous les agents
économiques (l'Etat, les ménages, les institutions
financières, les entreprises et le reste du monde).
|
|
Tache 3
|
Quels peuvent etre les effets de la bonne gouvernance sur
l'économie?
|
La bonne gouvernance permet d'élever le niveau de
sécurité des transactions économiques et constitue une
source de confiances entre agents économiques.
|
|
Trace écrite
|
|
I- le rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie
1- Définitions des notions
· La réglementation : la
réglementation est un ensemble de lois, de prescriptions, de
règles, régissant une activité sociale.
· La régulation : la
régulation désigne l'ensemble des mécanismes et des moyens
d'action dont dispose un Etat et qui ont pour objectif soit la stabilité
de l'économie dans sa globalité (ce sont les moyens
utilisés par les politiques économiques) soit le maintien de
l'équilibre d'un marché de biens ou de services
(régulation sectorielle)
II- Les moyens de l'intervention de l'Etat
1- La réglementation
La régulation peut être obtenue par la
réglementation c'est-à-dire un ensemble de lois, de
prescriptions, de règles, régissant une activité sociale.
La réglementation peut avoir pour but la régulation.
2- La politique budgétaire
La politique budgétaire de relance : l'Etat peut lancer
une politique de grands travaux (hausse des investissements publics) qui vont
susciter un flux de dépenses et provoquer une accélération
de la croissance de la production ; il peut aussi augmenter les revenus sociaux
des catégories défavorisées de la population car elles ont
une forte propension à consommer ; il peut aussi diminuer la
fiscalité sur les revenus ou sur la consommation afin de redonner du
pouvoir d'achat aux consommateurs pour qu'ils augmentent leur consommation ; il
peut, enfin, subventionner ou défiscaliser les investissements
privés afin d'inciter les agents économiques à investir.
L'augmentation des dépenses publiques va donc accroître les
activités économiques, l'embauche, la distribution de revenus et
la baisse du chômage.
3- La politique monétaire
L'Etat, pour relancer la demande, doit diminuer le taux
d'intérêt afin d'inciter les agents économiques à
emprunter pour dépenser. Cela permet aussi d'accroître la
profitabilité des entreprises et les inciter à investir.
4- La bonne gouvernance
La bonne gouvernance peut etre définie comme la
capacité du gouvernement à gérer efficacement ses
ressources, à mettre en oeuvre des politiques pertinentes, que le
respect des citoyens et de l'État pour les institutions ainsi que
l'existence d'un contrôle démocratique (Banque Mondiale 1999).
Etant qu'instrument de régulation économique, la
bonne gouvernance permet d'élever le niveau de sécurité
des transactions économiques et constitue une source de confiances entre
agents économiques.
|

Leçon du jour : le
rôle de l'Etat dans la régulation de l'économie
Objectif général : A la
fin de la leçon, l'élève devrait être capable
d'analyser le rôle des pouvoirs publics en matière de politiques
économiques et sociales
Séquence d'activité durée :
10 min .
Support d'activités : le
gouvernement gabonais en action.
Sur les routes bitumées, le membre du
Gouvernement a indiqué à l'opinion que depuis 2010, 1500
km de routes aux standards internationaux ont été
engagés. 500 km sur les 1500 km ont
été réceptionnées par le Gouvernement. Avec ce
vaste chantier, qui concerne l'ensemble des provinces du pays, le Gouvernement
veut à terme faire rallier l'ensemble des capitales provinciales
à Libreville en béton bitumineux. (...)
Sur les logements, l'invité de `'Faire
Savoir'' a indiqué que des actions dans ce sens sont en cours de
réalisation. 12 000 logements, visant deux
catégories de gabonais sont en construction. (...) Les
mesures prises lors des dernières assises sociales permettent
déjà de redynamiser l'Office national de l'emploi (ONE) avec la
mise en place incessamment des services de proximité aussi bien à
Libreville qu'à l'intérieur du pays, pour accompagner dignement
les demandeurs d'emplois.
Pour faire face à la dépendance du Gabon
vis-à-vis de l'extérieur en matière de denrées
alimentaires, le Président de la République, Ali Bongo Ondimba a
mis sur pied dix fermes agropastorales.
Dans ses relations avec le Parlement, le Ministre a
présenté, au nom du Gouvernement, plusieurs projets de lois
visant à poser les bases juridiques du Plan stratégique Gabon
émergent (PSGE), cher au Président de la République. Ces
textes, déjà adoptés par les deux chambres du Parlement,
sont actuellement en phase de promulgation. Il s'agit de : la loi portant
modification et suppression de certaines dispositions de la loi n°001/2005
du 04 février 2005 portant Statut général des PME PMI.
Cette loi, qui pose le fondement juridique de l'accès aux marchés
publics, permet désormais, non seulement de réorganiser les
offres des marchés dans un esprit d'équité, de justice
sociale et de transparence, mais surtout de susciter l'esprit saine
émulation et de performance dans le travail..
L'action,
Bimensuel d'Information Gouvernementale, deuxième partie N°02 - 03
au 16 Novembre 2014. P .7
Tache : lire et exploiter le
texte
Objectif spécifique 1 : A
La fin de la leçon, l'élève devrait être capable de
distinguer la régulation de la réglementation
Question 1 : Identifiez les
domaines d'intervention des pouvoirs publique
Réponse-élève/groupe
............................................................................................................................................................................................................
Tache : lire et exploiter le
texte
Question 2 : Qu'est ce que la
réglementation ?
Réponse-élève/groupe
............................................................................................................................................................................................................
Question 3 : - Qu'est ce que la
régulation ?
Réponse-élève/groupe
............................................................................................................................................................................................................
Question 4 : Quelles
différences faites-vous entre régulation et
réglementation ?
Réponse-élève/groupe
............................................................................................................................................................................................................
Objectif spécifique 2 : A
La fin de la leçon, l'élève devrait être capable de
préciser les différents moyens dont dispose l'Etat pour atteindre
ses objectifs
Question 5 : A l'aide de vos
lectures et du document ci-dessous, donnez les différents moyens
d'intervention de l'Etat.
Réponse-élève/groupe
............................................................................................................................................................................................................
Document 2 : La bonne gouvernance

Question 6 : - Qu'est ce que la
bonne gouvernance ?
Réponse-élève/groupe
............................................................................................................................................................................................................
Question 7 : - Quels sont les
principaux acteurs de la bonne gouvernance?
Réponse-élève/groupe
............................................................................................................................................................................................................
Question 8 : Quels peuvent
être les effets de la bonne gouvernance sur l'économie?
Réponse-élève/groupe
............................................................................................................................................................................................................
|
Réponse corrigée :
|
|
Evaluations
|
|
Formative
|
Proposition de réponses
|
|
Répondez par vrai ou faux
· La réglementation
désigne l'ensemble des mécanismes et des moyens d'action dont
dispose un Etat et qui ont pour objectif soit la stabilité de
l'économie dans sa globalité (ce sont les moyens utilisés
par les politiques économiques) soit le maintien de l'équilibre
d'un marché de biens ou de services (régulation sectorielle)
2- Le budget est le seul moyen d'intervention des pouvoirs
publics dans la régulation de l'économie.
|
1- Faux
2- Faux
|
EVALUATION BILAN
|
Liste des interventions publiques
- La construction du pont de Mayumba par l'Etat gabonais,
- La mise en place d'une nouvelle grille salariale;
- Le recrutement de mille agents de force de defense,
- Le vote par l'assemblée nationale du texte
réglementant les offers des marches publics.
|
Identifies dans la liste à quelles grandes fonctions
économiques chacune des interventions publiques renvoie-t-elle?
Justifiez votre réponse.
montrer comment les pouvoirs publics agissent sur la
répartition primaire et secondaire des revenus à travers
l'exemple du SMIG.
Quels sont les differents moyens dont disposent les pouvoirs
publics pour regular l'économie?
|
Annonce de la prochaine leçon
CONCLUSION GENERALE
La présente étude consacrée à
« l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie en classe de première
B » dans le cadre du Gabon, et plus précisément sur le
contenu de la leçon et de la stratégie utilisée dans son
enseignement-apprentissage nous a permis à partir d'une enquête
menée auprès des acteurs de l'éducation de proposer une
nouvelle façon d'aborder cette notion à l'égard des
évolutions engendrées par la mondialisation et une meilleure
stratégie de son enseignement-apprentissage. Ces propositions visent
l'adaptation de la leçon au contexte de la mondialisation et surtout
à faciliter l'enseignement-apprentissage du rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie en classe de première B à
partir d'une meilleure stratégie de son enseignement-apprentissage. Car,
le constat montre un manque d'actualisation de la leçon et l'usage d'une
mauvaise stratégie de son enseignement-apprentissage.
Au terme de cette étude, nos conclusions peuvent se
situer à deux niveaux d'analyse : premièrement au niveau des
approches utilisées par les enseignants pour assurer un meilleur
enseignement-apprentissage et deuxièmement au niveau de l'actualisation
de la notion du rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie.
Il s'est avéré qu'effectivement la grande
majorité des enseignants interrogés n'adopte pas une bonne
stratégie de l'enseignement de la notion. Ceux qui utilisent le format
OPAE comme stratégie d'enseignement, disent ne pas avoir des documents
permettant de rapprocher les élèves avec leur culture. Autrement
dit, ils ne parviennent pas à contextualiser cet enseignement faute des
documents sur les PED en général et le Gabon en particulier.
Tandis que d'autres sortis des universités ou de l'Ecole Normale
Supérieure avant l'année 2010, disent n'avoir jamais appris la
nouvelle stratégie d'enseignement-apprentissage.
Au niveau de l'actualisation du contenu la leçon, les
évolutions entrainées par la mondialisation ne sont pas prises en
compte, rendant ainsi la notion très théorique et parfois
caduque. Le rôle de l'Etat dans la régulation de l'économie
s'est accentué ces dernières décennies, mais sous une
autre forme. L'État régulateur agit désormais comme un
arbitre, un État qui agit plus indirectement que directement, qui est
plus en interaction qu'en action, qui délègue plus qu'il
n'intervient directement, qui pilote et qui oriente plus qu'il ne met en
oeuvre. L'autre évolution, qui découle de la première, est
le renforcement des capacités de contrôle étatique à
travers le développement de l'audit, de l'évaluation, du
contrôle de qualité, en particulier dans le cadre des agences
(Hassenteufel, 2007 : 311-329). Car depuis les accords de Bretton Woods en 1944
la reprise et l'accélération de l'internationalisation des
échanges à partir de 1945, a fait de la bonne gouvernance la
règle d'or de la régulation de l'économie par les
pouvoirs publics. Le rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie est une notion importante en classe de première B. En
effet, comme bien d'autres notions, celle-ci permet de faciliter la
compréhension des élèves en classe de terminale des enjeux
économiques internationaux des trois derniers thèmes.
Les difficultés de contextualisation, le manque
d'actualisation du contenu, la complexité de la notion et une mauvaise
stratégie de son enseignement-apprentissage ont pour conséquence,
la mécanisation des savoirs au détriment de la construction de
ceux-ci comme le préconise les nouvelles stratégies
d'enseignement-apprentissage. Bien que l'enseignement du rôle de l'Etat
dans la régulation de l'économie en classe de première B
soit difficile, la définition d'une meilleure stratégie de son
enseignement-apprentissage ne fait pas l'unanimité. Voilà
pourquoi, après avoir établit les différences et les
similitudes entre les théories (première partie) et la pratique
sur le terrain (deuxième partie : chapitre III) nous avons
essayé dans notre dernier chapitre de proposer une nouvelle leçon
à partir d'une nouvelle stratégie de son
enseignement-apprentissage.
Nous ne finirons pas ce travail sans rappeler le fait que
cette recherche ne nous offre pas des voies de solution assurées, tant
les variables en jeu sont nombreuses et les dimensions à
considérer complexes. C'est pourquoi la prudence est toujours de mise
lorsque vient le temps de proposer des pistes d'action. Cependant, la recherche
n'en demeure pas moins essentielle : elle nous informe, elle nourrit notre
jugement afin que nous puissions prendre des décisions plus
éclairées, mieux fondées et davantage appuyées sur
des faits.
BIBLIOGRAPHIE
SOURCES :
· Institut pédagogique Nationale,
département des sciences économiques et sociales, programme
révisé classe de première B
OUVRAGES
· Bezes, P. ( 2008). « Le tournant
néomanagérial de l'administration française », in
Borraz O. & Guiraudon V. (eds), Politiques publiques. 1, La France
dans la gouvernance européenne.
· Boyert R. (1985). L'Etat et l'éfficacité
économique (p. 348-347)
· Echaudemaison C.D. (2003). Dictionnaire
d'économie et des sciences sociales. Nathan
· Grjebine A. (1981).Théories de la crise et
politiques économiques
· Hassenteufel, P., 2007, « L'État mis à
nu par les politiques publiques ? », in B. Badie &
Déloye, Y. Le temps del'État. Mélanges en l'honneur de
Pierre Birnbaum, Paris, Fayard.
· Nguema Endamne (2011) L'École pour
échouer : Une école en danger. Crise du système
d'enseignement gabonais
· Macaire F. (1979). Notre beau métier, Issy les
Moulineaux
· Majone, G. (1994). Communauté économique
européenne : déréglementation ou re-réglementation
? La conduite des politiques publiques depuis l'Acte unique, in Jobert
B. (ed.), Le tournant néolibéral en Europe, Paris, L'Harmattan
· Noll, R. G. (1985), « Government regulatory behavior.
A multidisciplnary survey an synthesis », in Noll R. G. (ed.),
Regulatory Policy and Social Sciences, Berkeley, University of
California Press.
· Quantin P. (2005), Gouverner les sociétés
africaines. Acteurs et institutions, Paris, Karthala
· Quentin de Mongaryas R F. (2014). L'école
gabonaise en débat. Regards croisés sur une institution sociale
importée
· Selznick, P. (1985). La mise au point de la
régulation organisationnelle : la régulation des politiques
économique et sociales, in Noll R. G. (ed.), Berkeley,
University of California Press.
ARTICLES ET MEMOIRES
· Gauthier & Dembélé. (2004).
Qualité de l'enseignement et qualité de l'éducation: revue
des résultats de recherche
· Koléda G. (2007 -2008). Introduction à
l'analyse économique
· KANOUTE. P.T. (Septembre 2008). Mémoire :
Le Rôle de l'Etat et des organisations professionnelles dans la
régulation du commerce de l'oignon au Sénégal
· Mengue Bidzo, (2012).Taille optimale de l'Etat dans une
union monétaire : le cas de la CEMAC, revue du LEA p. (29-51)
· Mve Essame L.A. (2011-2012). Mémoire :
L'enseignement/apprentissage de l'épreuve orale en Sciences Economiques
et Sociales au baccalauréat en terminale B : Cas du Gabon
· Nguelieutou (2008). L'évolution de l'action
publique au Cameroun : l'émergence de l'Etat régulateur.
Université de Douala vol. n° 15, p.5. En ligne
http//www.google.com/pdf/Ngulieutou2015polisr.c.s.pnuméros1&2.2008/pdf.
Consulté le 20 Février 2015
· Nkoulou Nkoulou J.L. (2012). Les indicateurs de
dépenses publiques : le cas du Gabon
· Tchekoumi L. B. (2012).Le rôle de l'Etat
aujourd'hui au Cameroun : que pouvons-nous attendre ?
WEBOGRAPHIE
· Progression de sciences économiques et sociales
première ES France, (2008).
Pourquoi la puissance publique intervient-elle dans la
régulation des économies contemporaines ? Ministère de
l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (DGESCO).
En ligne :
http://www.eduscol.education.fr/LyceeGT_Ressources_SES_1_eco_5
1_reguler_les_economies_184844 consulté le 13 Mars 2015
P. Meirieu. L'éducation et le
rôle des enseignants à l'horizon 2020. UNESCO : Horizon 2020
A. Harsi. (2005) La nouvelle conception du rôle de l'Etat
au Maroc en ligne
http://www.diplomate.gouv.mar
consulté le 23 février 2015
COURS :
· H. Ndong Bibang, Cours de Didactique de Sciences
économiques et sociales, Master II ENS 2014-2015
· J.L. Nkoulou Nkoulou, Cours de Problèmes
économiques contemporains Master II SES ENS 2014-2015
Tableaux
Tableau 1 : Opinion des élèves
sur la connaissance de la notion.
Tableau 2 : Opinion des élèves
sur les objectifs de la notion.
Tableau 3 : Opinion des élèves
sur la stratégie d'enseignement utilisée par les enseignants.
Tableau 4 : Opinion des élèves
sur le choix de la stratégie approprié pour une bonne
transmission des connaissances sur la notion.
Tableau 5: Opinion des élèves
sur la méthode utilisée pour étudier leur leçon
.
Tableau 6 : Opinion des élèves
sur la qualité des exemples pris par les enseignants sur la notion.
Tableau 7 : Opinion des élèves
sur la problématique de la leçon.
Tableau 8 : Opinion des élèves
sur la connaissance de la notion
Tableau 9 : Opinion des élèves
sur la connaissance des moyens d'intervention dont disposent les pouvoirs
publics pour réguler les activités économiques.
Tableau 10 : Opinion des élèves
sur la précision des moyens d'intervention de l'Etat dans la
régulation de l'économie
Tableau 11 : Opinion des élèves
sur la connaissance de la place de l'Etat dans une économie de
marché.
Tableau 12: Effectif de la population
étudiée
Tableau 13 : Opinion des enseignants sur
l'enseignement de la leçon
Tableau 14 : Difficultés de
l'enseignement du thème le rôle de l'Etat dans la
régulation de l'économie
Tableau 15 : Opinion des enseignants sur
les stratégies d'enseignement
Tableau 16 : Opinion des enseignants
concernant l'approche OPAE
Tableau 17 : l'opinion des enseignants
sur la problématique de la leçon
Tableau 18 : Opinion des enseignants
concernant la place de la réglementation dans la régulation de
l'économie
Tableau 19 : Opinion des enseignants sur
l'enseignement de la leçon
Figures
Figure 1 : Répartition des
élèves sur la connaissance de la notion
Figure 2 : Répartition des
élèves sur la connaissance des objectifs de la notion
Figure 3 : Répartition de l'opinion
des élèves sur la stratégie d'enseignement utilisée
par les enseignants
Figure 4 : Répartition de l'opinion
des élèves sur le choix de la stratégie approprié
pour une bonne transmission des connaissances sur la notion.
Figure 5 : Répartition de l'opinion
des élèves sur la méthode utilisée pour
étudier leur leçon
Figure 6 : Répartition de l'opinion
des élèves sur la qualité des exemples pris par les
enseignants sur la notion.
Figure 7 : Répartition de l'opinion
des élèves sur la problématique de la leçon.
Figure 8 : Répartition de l'opinion
des élèves sur la connaissance des moyens d'intervention dont
disposent les pouvoirs publics pour réguler les activités
économiques.
Figure 9: Répartition de l'opinion des
élèves sur la connaissance de la place de l'Etat dans une
économie de marché.
Figure 10 : Répartition de
l'effectif total de la population étudiée
Figure 11 : Répartition de
l'opinion des enseignants sur la problématique de la leçon
Figure 12 : Répartition de
l'opinion des enseignants sur l'enseignement de la leçon
Table
des matières
DEDICACE.....................................................................................................................................................I
REMERCIEMENTS
.........................................................................................................................................II
AVANT
PROPOS............................................................................................................................................III
INTRODUCTION
GENERALE........................... 4
PREMIERE PARTIE : ELEMENTS CONCEPTUELS LIES A
L'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE ET AU ROLE DE L'ETAT DANS LA REGULATION DE
L'ECONOMIE................................................................. ....................................7
CHAPITRE I : ELEMENTS THEORIQUES DE
L'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE ........8
SECTION 1: DEFINITIONS DES CONCEPTS PEDAGOGIQUES ET
L'APPORT THEORIQUE
...........................................................................
8
1-
1- Définition des
concepts...................................................................
8
1-1-
Définition de
l'enseignement..............................................................
8
1-1-2-
Définition de
l'apprentissage............................................................
9
1-1-3-
Définition de la notion
enseignement/apprentissage ..................................... 9
1-2-
Apports théorique de l'enseignement
apprentissage.................................. 10
1-2-1-
le
Behaviorisme.................................................................
10
1-2-2-
le
cognitivisme........................................................................
10
1-2-3-
le
constructivisme......................................................................
11
1-2-4-
le
socioconstructivisme.....................................................
11
SECTION 2 : LES STRATEGIES D'ENSEIGNEMENT ET
METHODES D'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE ;
.................................................... 12
I-
les stratégies
d'enseignement-apprentissage.................................... 12
I-1- enseignement et apprentissage
coopératif.............................................. 12
I-2- Les discussions de
groupe...............................................................
13
I-3- l'étude autonome
....................................................... 13
II-
LES METHODES D'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE
.......................................13
II-1- La pédagogie
frontale .............................................................
14
II-2- La méthode
active..............................................................................
14
II-3- L'enseignement
programmé........................................................
15
CHAPITRE II : SYNTHESE THEORIQUE DU ROLE DE
L'ETAT DANS LA REGULATION DE L'ECONOMIE
............................................................... 16
SECTION 1 : LE ROLE TRADITIONNEL ET LA
NOUVELLE ORIENTATION DE L'ACTION PUBILIQUE DANS LA REGULATION DE L'ECONOMIE
.......................................... 16
I-
LE ROLE TRADITIONNEL DE
L'ETAT...................................... 16
1-1-
La réglementation : L'Etat minimal du
courant libéral .......................... 16
1-1-1-
les
externalités...................................................
17
1-1-2-
les biens
collectifs...........................................................................
18
1-1-3-
les monopoles
naturels................................................................
16
1-2-
Les politiques économiques de relance et
d'ajustement : L'Etat interventionniste...............18
1-2-1-
John Maynard Keynes : la régulation par
l'Etat.................................. 19
1-2-2-
Friedman et les
néo-classiques..................................................
22
1-2-3-
Les modalités de régulation de
l'activité économique.......................................
22
2-
les fonctions de
Musgrave............................................... 23
2-1-1- la fonction
d'allocation.......................................................
23
2-1-2- la fonction de
redistribution...........................................................
23
2-1-3- la fonction de stabilisation
................................................. 24
II-
LA GESTION DES SERVICES ET LES POLITQUES
SOCIALES : LA NOUVELLE ORIENTATION DE L'ACTION
PUBLIQUE..............................................................26
1-
Le faire-faire comme moyen de rationalisation des
actions étatiques dans la régulation de l'économie (la
gestion des services
publics)..................................................................26
1-1- La théorie du
fédéralisme......................................................................26
1-2-
la théorie de l'efficience-x,
.............................................. 27
1-3-
la théorie du New Public
Management...................................... 27
1-4-
La théorie des coûts de
transaction.......................................... 28
1-5-
la théorie des choix publics
.......................................................... 28
II-
la bonne gouvernance comme renouveau de l'action
publique (politiques sociales) ...............29
2-1-
Considération générale de la
bonne gouvernance................................... 29
2-2-
La bonne gouvernance : un autre moyen de
régulation économique
..............................30
SECTION 2: L'IMPORTANCE DE
L'ETUDE..................................... 31
II-1- Intérêt de l'étude
............................................................... 31
II-2- Problématique de
recherche................................................ 32
II-3- Objectif de
l'étude..................................................................
33
DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DE L'ENSEIGNEMENT DU
ROLE DE L'ETAT DANS LA REGULATION DE L'ECONOMIE EN CLASSE DE PREMIERE
B..................................37
CHAPITRE III : DEMARCHE
METHODOLOGIQUE................................................. 38
SECTION 1 : CONTEXTE DE L'ETUDE ET ELEMENTS
METHODOLOGIQUE................38
I-
ELEMENTS
METHODOLOGIQUES....................................... 38
I-1- le choix de la méthodologie et collecte
des données........................................ 38
I-1-1- cadre
d'étude........................................................................
38
I-1-2- La recherche
documentaire.................................................. 39
I-1-3-
L'enquête................................................ 40
La collecte des
données...........................................................
40
II-1- L'élaboration du
questionnaire......................................................
41
II-2- le guide d'entretien
.....................................................................
41
II-3- Limites et contraintes
méthodologiques........................................... 42
SECTION 2 : ANALYSE DES
RESULTATS................................................ 42
I-
Présentation et interprétation des
résultats.................................... 43
I-1- Les résultats des enquêtes
menées auprès des
élèves................................. 43
I-2- Analyse des résultats de
l'enquête: entretien avec les
enseignants..................................54
Chapitre IV : proposition des nouvelles
approches stratégiques de l'enseignement-apprentissage du rôle de
l'Etat dans la régulation de l'économie en classe de
première B.................................61
Section 1 : Remarques et
suggestions.............................................................
62
1-
Constat
général................................................
62
2- Introduction de la notion de la bonne
gouvernance dans le rôle de l'Etat dans la régulation de
l'économie.
..............................................................................63
3-
Les réalités de l'école
gabonaise et les nouvelles stratégies
d'enseignement........................63
4-
La formation des
enseignants.......................................................
64
Section 2 : proposition d'une fiche de
leçon.................................................................65
CONCLUSION GENERALE....................... 81
BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................83
Tableaux...........................................................................................................86
Figures...................................................
88
ANNEXES
........................................................................................................................................................89
* 1 Mode de gouvernance ou
l'Etat prend en charge la totalité de l'activité
économique et sociale
* 2 Principe qui consiste
à laisser le marché fonctionner sans aucune forme d'intervention
étatique
* 3 Ensemble des
théories pratiques c'est à dire un ensemble de
manières ou de savoirs faire ; c'est une théorie pratique
susceptible de fournir à l'activité d'éducation des
idées qui la dirigent. Selon Emile DURKHEIM
* 4 Selon le dictionnaire
Universel 6e édition
* 5 D'après A.France dans
notre beau métier de F.Macaire
* 6 Le behaviorisme est un des
premiers courants qui s'est développé entre les années
1910 et 1950.
* 7 Le cognitivisme
est un autre courant qui s'est développé à partir
des années, 1950.
* 8 Le constructivisme est un
courant développé par Vygotski en 1970
* 9 Courant
développé par Piaget (1896-1980)
* 10 Ensemble des
mécanismes et moyens dont dispose un Etat ou une instance internationale
et qui ont pour objectif soient la régulation de l'économie dans
sa globalité soient le maintien de l'équilibre d'un marché
de biens ou de services. Selon le dictionnaire toupictionnaire, consulté
en ligne le 23 Aout 2015
www.toupie.org
* 11 Elle fait
référence au rôle traditionnel de l'Etat dans
l'économie. Cette intervention se fait de façon indirecte et
permanente notamment à travers la réglementation, la bonne
gouvernance et le faire-faire.
* 12 L'intervention
conjoncturelle est une intervention directe des pouvoirs publics, elle se fait
souvent pour résoudre un déséquilibre économique
conjoncturel (crise économique, chômage...) à travers
la politique de relance chère à Keynes.
* 13 Situations où
des décisions de consommation ou de production d'un agent affectent
directement la satisfaction ou le profit d'un autre agent, sans que le
marché évalue et fasse payer ou rétribue l'agent pour
cette action
* 14 On dit qu'il y a monopole
naturel sur un marché lorsque pour tout niveau de production, le
coût des facteurs utilisé est minimal lorsque la production est
réalisée par une seule entreprise.
* 15 Le carré magique
est une théorie économique élaborée par
l'économiste keynésien Nicholas Kaldor (1908-1986)
* 16 La théorie du
faire-faire peut être définie comme étant le transfert de
pouvoir et de responsabilité de l'Etat central à des
entités souvent semi-autonomes dans un domaine de responsabilité
bien défini.
* 17 Ensemble des institutions
qui encadre les règles dans une société et qui dirigent
les citoyens et l'Etat.
* 18 Ensemble des institutions
généralement non privées qui apportent des financements
aux gouvernements des pays en difficulté ou des secteurs privés
des pays où l'on veut favoriser les investissements.
* 19 Est une agence
gouvernementale créée en février 2010 sous la tutelle de
la présidence de la république et des ministres en vue de
promouvoir de manière durable, le développement social,
économique et environnemental du Gabon.
* 20 Est une recherche de liste
de références d'ouvrages ou d'autres documents, notamment
d'articles de revues, ayant des caractéristiques communes.
* 21 L'entretien est une
technique de recueil de l'information qui se déroule dans une relation
de face à face.
* 22 C'est une méthode
d'éducation basée sur la confiance et la liberté.



