2.3.4 Les conséquences de la crise économique
sur l'accès aux services de santé au Tchad
Dans un contexte socio-économique
particulièrement contraignant et face aux programmes
d'austérité imposés (à certains pays d'Afrique dont
le Tchad) par les institutions financières (BM, FMI entre autres) qui
ont entraîné la baisse substantielle de la part des budgets
nationaux réservée à la santé, il est
impérieux de rechercher les facteurs sur lesquels des actions doivent
être menées afin de maximiser la rentabilité des
investissements dans le domaine de la santé.
Les services à assurer ne sont par ailleurs ni
élaborés, ni très coûteux et la réduction de
la morbidité et de la mortalité maternelles est l'une des
stratégies de santé publique qui offre le meilleur rapport
coût/efficacité.
Au Tchad, plus du quart de la population vit avec moins d'un
dollar par jour et les dépenses de santé sont souvent
supérieures aux revenus (Banque Mondiale, 2001). Dans ce contexte, les
investissements en matière de santé à travers les
structures sanitaires secondaires comme les dispensaires, les centres
médicaux communautaires, la formation des accoucheuses traditionnelles,
offrent un rapport coût-efficacité satisfaisant et épargne
à l'Etat des gaspillages. Même si les nouvelles perspectives
économiques présagent une relance économique, il convient
de gérer au mieux les ressources qui existent déjà.
L'accès aux services de consultations prénatales est très
limité dans certaines DPS5, notamment celle du
5 Délégation Préfectorale de la
Santé
Salamat, et constitue un problème à
résoudre pour l'amélioration de la santé de la
reproduction. La disponibilité des sages-femmes est très basse
dans toutes les DPS, sauf dans le Chari-Baguirmi et à N'djaména ;
c'est l'obstacle systématique le plus critique pour la fourniture des
services de santé de la reproduction dans ces délégations.
Aucune sage-femme ne travaille dans les DPS du Lac, du Biltine et du BET, zones
parmi les plus pauvres du Tchad. Le manque de continuité dans
l'utilisation des services des soins prénatals, d'accouchement et de
planification familiale arrivent en deuxième position parmi les goulets
d'étranglement à l'amélioration de santé de la
reproduction. C'est un véritable problème pour toutes les DPS.
Dans la DPS du Salamat (zone très pauvre), le taux de continuité
est ainsi de 11,2% (MSP6, 2004).
Enfin, la prise en compte des problèmes de la femme,
notamment les problèmes sanitaires, s'inscrit dans le cadre de sa
considération comme « acteurs » à part entière
dans le processus de développement. Cette prise en considération
passe par le rétablissement de l'équité entre l'homme et
la femme. Au-delà du paradigme biomédical, la
nécessité d'offrir une meilleure santé à la femme
est une question essentielle de « justice sociale ». En effet, les
risques encourus par les femmes en donnant la vie ne relèvent pas
seulement des « caprices » de la nature, mais aussi des politiques
sociales et sanitaires.
A ces souffrances humaines, s'ajoute le fait que les maladies
et les troubles liés à l'accouchement représentent aussi
des pertes en terme de développement social et économique. Les
femmes qui en meurent sont dans la plupart des cas acteurs économiques,
des responsables de famille, responsables du bien-être et de la
santé. Or, parce qu'elles produisent des revenus, se chargent de la
production et de la préparation de la nourriture, leur
décès pèse sur les efforts de lutte contre la
pauvreté. Les études montrent qu'une grande partie de ces
décès maternels pourrait être évitée si
toutes les femmes sont assistées lors de la grossesse et de
l'accouchement par un agent de santé qualifié et si elles ont
accès à des soins obstétricaux d'urgence en cas de
complications (OMS, 2003). En effet, lorsque les femmes consultent
régulièrement un médecin, une infirmière ou une
sage-femme pendant leur grossesse, les agents de santé peuvent les
vacciner contre le tétanos, les inciter à observer une nutrition,
une hygiène et un repos adéquats et à détecter des
complications potentielles.
6 Ministère de la Santé Publique
La plupart des complications liées à la
grossesse et à l'accouchement peuvent être évitées
efficacement ou prises en charge si les signes et symptômes de danger ou
de risque sont décelés à temps et si les services de soins
de santé de qualité sont disponibles et accessibles à
tous, ce à quoi s'emploie la communauté internationale depuis
plusieurs années. Malheureusement l'objectif de maternité sans
risque est loin d'être atteint et, si l'on connaît mieux les causes
des décès maternels et les moyens de les prévenir, il est
à promouvoir, auprès des femmes, des comportements permettant de
les réduire, notamment par un recours aux soins de qualité avant,
pendant et après l'accouchement. La proportion des femmes qui accouchent
dans une maternité est de 40% (UNFPA de 1997. Des efforts restent donc
à faire pour garantir aux femmes un accès universel aux soins
pendant l'accouchement (Rosine ANGUE ELLA, 2005). D'après les
résultats des enquêtes démographiques et de santé,
la proportion des naissances pour lesquelles la mère a
bénéficié d'une assistance médicale à
l'accouchement est de 78% au Gabon, 65% au Bénin, 24% au Tchad, 58% au
Cameroun, 49% en Centrafrique. Cette proportion demeure élevée
même parmi les femmes ayant recours aux CPN : 29% au Cameroun, 43% en
Centrafrique, 53% au Burkina Faso et 45% en Côte d'Ivoire (Rosine ANGUE
ELLA, 2005).
Les facteurs à l'origine de la non assistance
médicale aux soins obstétricaux sont encore mal connus et
documentés d'où l'intérêt de la présente
étude qui tente de les identifier, dans un pays l'un des plus pauvres du
monde.
a) Stratégie tchadienne de réduction de la
pauvreté
La stratégie nationale de la réduction de la
pauvreté (SNRP), élaborée en 2003, préconise que
l'élimination progressive de la pauvreté sera
réalisée par la poursuite de politiques favorables à
l'accélération de la croissance économique, surtout dans
les activités pratiquées par les pauvres ; l'accroissement des
dépenses publiques ciblées sur les contraintes à la
réduction de la pauvreté ; et l'exécution des projets et
programmes sectoriels selon les cinq grands axes stratégiques, pour
lesquelles la SNRP fixe les objectifs, les indicateurs de performance et une
matrice d'actions prioritaires.
Sur le plan économique, la première année
de la mise en oeuvre de la SNRP coïncide avec celle de l'exploitation du
pétrole de Doba. En matière des finances publiques, les secteurs
prioritaires bénéficient, en sus des dotations budgétaires
ordinaires, des fonds IPPT et du bonus pétrolier. La politique visant
à augmenter de 20% chaque année la part du budget

Milieu rural N'djaména Autres villes Zone
ECOSIT7
FCFA $US FCFA $US FCFA $US FCFA $US
151
0,303 311
Seuil de pauvreté alimentaire
0,623 213 0,43 194 0,39
Seuil de pauvreté globale 195
0,39 414
0,83 276 0,55 253 0,51
des secteurs prioritaires s'est poursuivie, et les dotations
budgétaires de ces secteurs représentent 60% des dépenses
totales en 2003 contre 52% des dépenses exécutées en 2002
(SNRP, 2003).
Les difficultés et les contraintes sont celles
relatives à l'insuffisance des ressources financières qui risque
d'entraver le bon déroulement des activités dans le cadre de la
mise en oeuvre de la stratégie, les aléas climatiques qui
constituent un handicap à la production agricole, la faiblesse du
pouvoir d'achat des ménages face aux dépenses des soins de
santé et de scolarisation des enfants des pauvres, et enfin la
rareté de l'énergie électrique disponible et son
coût exorbitant qui dissuadent les opérateurs économiques
privés.
Des différentes consultations conduites dans le cadre
du processus participatif, il est ressorti que la pauvreté est un
phénomène multidimensionnel, que l'on approche en termes de
revenus, de niveau de vie, de capacités (moyens de production entre
autres) ou de risques encourus. Le déficit de productivité est un
attribut de l'essentiel des activités économiques marchandes,
traduisant un déficit, voire un défaut de capacités
lié aux déficiences des systèmes sanitaire et
éducatif. De ce qui précède, la dimension
économique de la pauvreté est très importante donc il
convient de mettre un accent particulier sur le cadre macroéconomique
dans lequel s'exécute la stratégie de la réduction de la
pauvreté afin de définir le cadre et d'en établir le lien
avec l'évolution de la pauvreté. Au total, le Tchad est
profondément touché par la pauvreté et la misère.
C'est le pays le plus pauvre de la sous-région au regard des
différents indicateurs sociaux publiés par les organisations
internationales.
Tableau2.3 Seuils de pauvreté alimentaire
et globale par tête et par jour
7 L'ensemble de la zone couverte par l'ECOSIT
(Enquête sur la Consommation des ménages et du Secteur
Informel)
b) La perception de la pauvreté par la population
tchadienne
Des études ont également été
menées sur la perception de la pauvreté par les populations au
Tchad. Selon ces études (DSEED/ PNUD, EPBEP, 2000), cette perception est
relative au milieu : on se sent pauvre par rapport à quelqu'un d'autre
ou par rapport à sa capacité d'accéder aux
différents marchés de biens et de services disponibles ou encore
par rapport aux possibilités qui sont offertes à l'individu.
Selon les résultats de l'enquête, la perception de la
pauvreté par la population tchadienne apparaît très
différente en milieu urbain et en milieu rural. Tandis que les
populations urbaines placent l'éducation en première position et
le manque d'argent en deuxième, les populations rurales placent, elles,
le manque de matériel agricole en première position et ne
classent le besoin d'éducation qu'en 7e position. Dans les deux cas,
l'insuffisance de structures de santé émerge comme l'une des
trois dimensions majeures de la pauvreté citées par les urbains
comme les ruraux.
c) Les conditions de vie des ménages au
Tchad
Il n'existe à ce jour que peu de données et
d'études sur la pauvreté et les conditions de vie des
ménages au Tchad. L'indice de la pauvreté humaine (IPH) est l'un
des plus mauvais du monde, à 52,1%, selon le PNUD, plaçant le
Tchad en 86e position dans un échantillon de 92 pays (PNUD,
1997). Les données du Rapport sur le développement humain
indiquent également qu'au Tchad, le pourcentage d'analphabètes
est de 49,7%, celui d'individus privés d'accès à l'eau
potable de 76% et le pourcentage des personnes privées d'accès
aux services de santé de 74% (PNUD, 2006).
Les données de l'enquête sur la consommation et
le secteur informel (ECOSIT) réalisée en 1995/1996 ont permis de
caractériser plus précisément le profil de la
pauvreté au Tchad. L'indice de la pauvreté alimentaire
c'est-à-dire la proportion de ménages qui n'arrivent pas à
subvenir à leurs besoins alimentaires, est estimé à 42%.
Cette incidence est plus forte en milieu rural (48%) que dans les zones
urbaines (34 à 38%), mais cette différence est moins
marquée que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, où
les citadins ont typiquement un niveau de pauvreté plus faible. De
même, l'incidence de la pauvreté globale, c'est-à-dire la
proportion de ménages qui ne subviennent pas à leurs besoins
alimentaires, montre une plus forte incidence en milieu rural que dans les
villes. L'extrapolation de ces données au niveau de l'ensemble du Tchad,
on peut estimer que 90% de la pauvreté provient
du milieu rural. Cette mesure du degré de la
pauvreté des ménages est basée sur le manque à
gagner moyen des pauvres dans une région, c'est-à-dire la
différence entre la consommation des ménages et le seuil de
pauvreté utilisé. Les données montrent qu'il y a moins de
pauvres dans les villes, et en particulier dans la capitale, que les campagnes
mais ceux-ci sont en moyenne plus pauvres.
Ce résultat suggère que les ménages
ruraux ont des activités ou des atouts qui leur permettent de maintenir
un certain niveau de vie faible, alors que les ménages pauvres urbains
n'ont pas ces ressources et sombrent dans une pauvreté plus
marquée.
L'enquête démographique et de santé a
permis de dresser une typologie des ménages selon le niveau de
bien-être. Il apparaît que les plus pauvres ont un niveau
d'éducation plus faible que les plus riches.
Les femmes vivant dans de ménages pauvres ont moindre
accès aux services de base que leurs homologues de ménages
riches. On note aussi une pauvreté légèrement plus
prononcée dans les ménages dirigés par une femme.

Part de la population totale (%)
Part de la population en pauvreté (%)
Taux de pauvreté (%) 20,8 34,4 47,8 50,6 70,3 55,0
Source : INSEED/ECOSIT2, 2003-2004
Capitale Villes
secondaires
7,6 2,9 9,6 42,3 37,5 100,0
2,9 1,8 8,4 38,9 48,0 100,0
Autres villes
Rural sud
Rural nord
Pays
Tableau 2.4 Approche absolue (Estimations de la
pauvreté)
2.4 Situation de santé au Tchad
La situation sanitaire du Tchad est plutôt moins bonne
que celle des autres pays d'Afrique subsaharienne et l'évolution dans le
temps des indicateurs de santé du pays ne laisse pas beaucoup d'espoir
pour l'atteinte des objectifs de 2015. Il existe un lien entre l'accès
aux services de santé modernes et niveau de pauvreté. Au Tchad,
les données de l'enquête
démographique et de santé, le bilan commun des
pays et le rapport sur le développement humain révèlent
une situation grave de la mère et de l'enfant ainsi qu'un état de
pauvreté inquiétant qui risque de compromettre le
développement du pays. Les composantes prioritaires retenues pour faire
l'objet d'actions précises sont : la maternité à moindre
risque, le bien-être familial et la planification familiale, la
santé reproductive des adolescents, la lutte contre les Ist/vih /sida,
et la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, les violences
conjugales et sexuelles.
Les indicateurs permettent de jauger de la santé de la
reproduction (SR) ; les plus récents au Tchad sont fournis par
l'Enquête Démographique et de Santé (EDST II) de 2004. Le
ratio de mortalité maternelle est de 1099 décès pour 100
000 naissances vivantes ; autrement dit, le Tchad demeure un des pays où
la maternité expose les femmes aux plus hauts risques. Au Congo Brazza
et le Gabon, ces ratios sont respectivement de 510 et 420. La Suède est
plus proche de l'idéal avec 2 décès maternels pour 100 000
naissances vivantes. Quant aux enfants tchadiens, ils sont logés
à la même enseigne que leurs mères; le taux de
mortalité infantile sont logés à la même enseigne
que leurs mères; le taux de mortalité infantile (enfant de 0
à moins d'un an) est de 102 %o ; celui des enfants de 0 à 5 ans
(mortalité infanto-juvénile) est de 191 %o. Ces taux sont parmi
les plus élevés au monde et le Tchad reste un des pays où
un enfant court le plus de risque de décéder avant son
cinquième anniversaire ! Ces niveaux de mortalité pèsent
lourdement sur l'espérance de vie du Tchadien qui est de 49,6 ans. Ces
chiffres remettent en cause les discours laudatifs sur des bilans des
politiques et programmes socio-économiques souvent servis au peuple. En
effet, les niveaux de mortalité reflètent et découlent des
conditions sanitaires, environnementales, socio-économiques et
culturelles des populations.
Certes, le Gouvernement et les partenaires ont consenti des
efforts certains pour améliorer la santé de la mère et de
l'enfant et le bien-être familial : entre 1994 et 2001, quelque 27,5
milliards de Fcfa ont été investis dans le secteur (Annuaire des
statistiques sanitaires du Tchad, MSP, 2004). Mais ces investissements, quoique
importants en valeur absolue, restent en deçà des besoins qui
sont énormes. Quelques indicateurs de disponibilité et
d'accès aux services de SR permettent de mesurer ce gap. D'abord les
structures sanitaires et les ressources humaines sont très insuffisantes
: la couverture sanitaire théorique de 73,4 % (avec 633 zones de
responsabilité fonctionnelle) cache d'importantes disparités
régionales. En outre, moins de 20 hôpitaux de district sur les 40
fonctionnels offrent des soins obstétricaux
d'urgence complets pendant la grossesse ou à
l'accouchement. Une femme, surtout en zone rurale, doit parcourir en moyenne 15
km pour accéder aux services de SR ou faire vacciner son enfant.
Quant au personnel qualifié, le pays compte un
médecin pour près de 28 000 habitants et une sage-femme pour 9
000 femmes en âge de procréer. Des chiffres bien loin des normes
de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui recommande un minimum
d'un médecin pour 10 000 habitants et une sage-femme pour 5 000 femmes
en âge de procréer. De plus, ce personnel est
inéquitablement déployé avec une forte proportion d'agents
exerçant à N'Djaména. A cela s'ajoute un déficit en
infrastructures et en personnel. La conséquence de cette carence
à la fois structurelle et infrastructurelle est le faible accès
des populations aux services de SR : 8 femmes sur 10 accouchent à
domicile, pour la plupart sans assistance de personnel qualifié;
seulement 2 grossesses sur 10 ont eu des consultations prénatales
complètes. En principe, tous les enfants de 12 à 23 mois sont
censés avoir reçu les vaccins prioritaires du Programme National
de Vaccination (PEV), mais seuls 11% le sont; tandis que 19% des jeunes
tchadiens de cette tranche d'âge n'ont reçu aucun vaccin (Annuaire
des statistiques sanitaires du Tchad, MSP, 2004).
S'agissant de la planification familiale, seules 2% de femmes
en union utilisent une méthode contraceptive moderne. Les Tchadiens
continuent donc, comme au Moyen-Age, à faire des enfants au gré
de la nature, loisible à celle-ci de faire son prélèvement
pour laisser le reste aux parents ! Conséquence : l'indice
synthétique de fécondité (moyenne d'enfants qu'une
Tchadienne arrivée en fin de vie féconde peut avoir) reste parmi
les plus élevés du monde : 6,3 enfants par femme. A ce rythme,
d'ici 2050, le Tchad sera plus peuplé que le Cameroun (31,5 millions
contre 27 millions).
Ces indicateurs sont révélateurs du niveau de la
pauvreté au Tchad. Cette pauvreté agrège certes d'autres
facteurs tels que les aléas climatiques, l'insécurité, la
mauvaise gouvernance, la dégradation de l'environnement, les
considérations socio-culturelles, etc. Mais les aspects liés
à l'accès aux services de SR demeurent fondamentalement
transversaux.
Le document du Bilan Commun des Pays (en anglais Common
Country Assesment - CCA) élaboré en 2004 dans le cadre de
l'assistance des Agences du Système des Nations Unies au Tchad
décrit ainsi la pauvreté sous ses principales manifestations : la
faim et la malnutrition, la forte mortalité maternelle et infantile, le
faible accès à l'eau potable, la forte incidence du
Vih/sida et du paludisme, et la forte déscolarisation
au primaire. Il existe de façon évidente une forte interrelation
entre ces différents facteurs et la santé de la reproduction. Un
seul exemple, l'analphabétisme est un obstacle pour l'accès aux
soins de santé ; à contrario, l'alphabétisation rend les
gens plus ouverts aux perceptions et pratiques positives en matière de
SR, principalement en ce qui concerne l'utilisation des méthodes
contraceptives modernes, l'accès aux services de SR, la perception des
facteurs de risque et le comportement subséquent pour prévenir
les IST et le Vih/sida, le refus des pratiques traditionnelles néfastes
(mutilations/ coupures génitales féminines), etc. Ainsi, l'EDST
II a révélé que 13% des femmes de niveau secondaire et
plus utilisent une méthode de contraception moderne contre 0,5% de
femmes sans instruction.
Cet aperçu des indicateurs met en exergue les liens de
causalité entre développement humain et santé de la
reproduction, d'où la nécessité d'améliorer l'offre
et l'utilisation des services de SR grâce à de lourds, continus et
judicieux investissements. Dans ce sens, on ne devrait pas perdre de vue que la
croissance économique (dopée comme au Tchad par des ressources
pétrolières), n'entraîne pas de facto et à court
terme l'amélioration des indicateurs socioéconomiques, de la
santé de la reproduction notamment. La preuve est fournie pas le Rapport
Mondial sur le Développement Humain 2006. Le classement des pays selon
l'Indice de Développement Humain (IDH) se fonde sur trois
critères : la santé et la longévité, l'instruction
et le niveau de vie de la population mesuré d'après le PIB
(Produit Intérieur Brut). Résultat : le Tchad est classé
171e sur 177 et figure parmi les pays à développement humain
faible), avec un PIB de 2090 $ US pour la période
considérée. Le Soudan dont le PIB n'est que de 1 949 $ US est
classé au 141e rang, parmi des pays à développement moyen
tels que la Russie, le Brésil ou la Chine. Explication : notre
espérance de vie est évaluée à 43,7 ans et le taux
d'alphabétisation des adultes est de 25,7% ; au Soudan, ces indicateurs
sont respectivement de 56,5 ans et 60,9%. Autrement dit, tout en étant
plus riche que le Soudan - du moins pour la période
considérée le Tchadien vit paradoxalement moins bien.
Ce phénomène peut certainement être
relié aux forts niveaux de malnutrition, mais aussi au fait que les
ménages ne font pas appel aux technologies simples comme les
moustiquaires imprégnées, la vaccination, les micro-nutriments ou
les solutés de réhydratation par voie orale. D'importants efforts
restent à faire afin d'assurer une couverture effective pour une large
partie de la population, notamment les groupes les plus pauvres.
Tableau 2.5 Indicateurs de santé Tchad,
2003
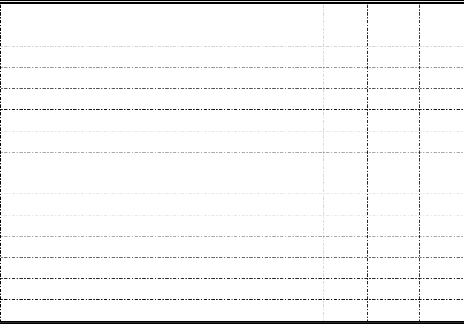
Indicateurs Tchad Pauvres Riches
Mortalité infantile (pour 1 000 naissances) 102,6 79,8
89,3
Mortalité infanto-juvénile (pour 1 000 naissances)
194,3 170,6 172
Taux de mortalité maternelle (100 000 naissances vivantes)
827
Taux de croissance annuelle de la population (%) 2,9
Espérance de vie à la naissance (années)
50
Indice synthétique de fécondité
(enfants/femme) 6,6 7,1 6,2
Femmes recourant à des soins prénatals
dispensés par du
personnel qualifié (%) 41,6 27,7 63,9
Couverture antitétanique chez les femmes enceintes (%)
41,6 33,7 61,5
Accouchements assistés par du personnel de santé
qualifié (%) 16,3 4,6 56,9
Dépenses publiques de santé (% du PIB) 2,62
Dépense publique de santé (% de DST8)
67
Dépenses publiques de santé par habitant ($USD)
5,03
Taux de prévalence d'une contraception moderne (%) 2 0,2
6,1
Source : Statistique sanitaire du
Ministère de la Santé Publique, 2003
| 


