1.3- Milieu scolaire
Le milieu scolaire est l'endroit où
les jeunes passent le plus de temps hors vacances et weekend comme dans nos
écoles où l'on accueille des individus appelés
écoliers ou élèves qui suivent l'enseignement que dispense
les professeurs. Dans le système éducatif Français,
l'enseignement secondaire s'étend sur une durée de 7 ans, de la
classe de sixième (élèves âgés de 11 ans)
à la classe de terminale (élèves âgés de 18
ans). Il se répartit entre deux niveaux d'enseignement : le premier
cycle de l'enseignement secondaire (4 ans), dispensé en collège,
et le second cycle de l'enseignement secondaire (3 ans), dispensé en
lycée.
Selon la Loi N°2003-17 du 11 novembre 2003
portant orientation de l'éducation nationale en
république du Bénin, l'enseignement secondaire
général vise à approfondir chez l'élève les
apprentissages de l'enseignement primaire, le savoir, le savoir-faire et le
savoir-être, notamment le sens de l'observation, le raisonnement logique
et l'esprit de recherche. Il est dispensé dans deux types
d'établissements : le collège d'enseignement
général (CEG) et les lycées.
Dans le cadre de notre étude, nous allons prendre en
compte plusieurs collèges d'enseignements généraux
où l'enseignement a une durée totale de sept (07) ans et est
réparti en deux cycles comme ci- après : un premier cycle de
quatre (04) ans qui est sanctionné par un examen du brevet
d'études du premier cycle (BEPC) et un deuxième cycle de trois
(03) an sanctionné par l'examen du baccalauréat (BAC). Au sein de
ces collèges, notre population va concerner que le deuxième
cycle.
2- LES TRAVEAUX DANS LA LITTERATURE
Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 8
2.1- Dans le monde
Bon nombre d'études ont été
réalisées dans le domaine des pratiques sportives mais aucune n'a
porté sur la pratique sportive des jeunes de la commune de Porto-Novo au
Bénin. Ainsi, avant de faire le point de ces différentes
études, il faut noter que des initiatives tendant à la
réorganisation des pratiques sportives ont été prises au
niveau des institutions nationales et internationales. C'est suite à
cela que notre revue de littérature adoptera un plan qui nous permettra
de recenser tous les travaux étrangers effectués sur les
pratiques sportives des jeunes qui sont contenus dans les articles, dans les
thèses, les mémoires, les rapports de fin de stage. Dans le
même temps nous n'allons pas négliger les autres travaux des
auteurs béninois.
Comme plusieurs études l'ont toujours souligné
depuis les années cinquante en France, les jeunes sont la classe
d'âge la plus sportive. Aujourd'hui près de 80 % d'entre eux
disent pratiquer une activité sportive, même si les rythmes et
l'intensité de celle-ci sont variables (INSEP,2010). La
pratique sportive demeure ainsi un marqueur de la jeunesse, malgré les
diverses affiliations qui se produit à l'adolescence. Cette pratique se
caractérise toutefois par une forte pluralité sportive que sont
les sports de compétitions, les sports de loisirs et les sports
encadré ou libre.
Les travaux de Augustin et Fuchs (2014)
constituent une référence parmi les sociologues
contemporains, parce qu'il identifie quatre temps par tranches de vingt ans
pour caractériser l'évolution des pratiques sportives des jeunes
de 1960 à 2020. Ces pratiques sportives regroupent : le sport de haut
niveau où les jeunes athlètes sont engagés dans les
compétitions fédérales, le sport de masse qui rassemble la
majorité des jeunes licenciés aux seins des
fédérations scolaires et qui sont engagés dans les
compétitions de masse et enfin le sport de loisir qui réunit les
jeunes qui s'adonnent à une pratique sportive dans le but
d'épanouissement ou ludique.
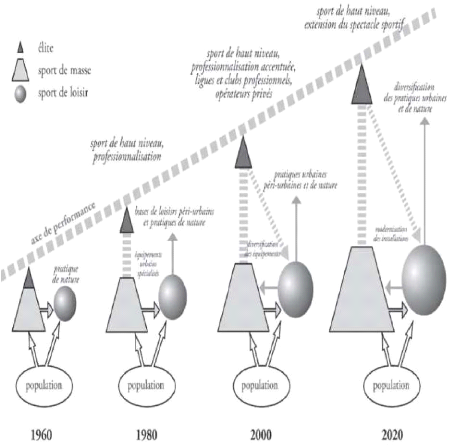
Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 9
Figure 1 : L'évolution des pratiques
sportives des jeunes. (Source : J.-P. Augustin,
2014)
Il faut noter que la pratique sportive des jeunes
dépend avant tout du temps libre dont ils disposent.
Selon Olivier David (2010), la réflexion sur
le temps libre a montré l'importance de ce temps social pour
l'épanouissement des individus ainsi que pour leur réalisation
personnelle. Il offre en effet un cadre propice qui permet de pratiquer des
activités épanouissantes et libératoires tout en se
dégageant de l'ensemble des contraintes sociales, qu'elles soient
liées au travail, à l'école, à la famille ou
à toute autre institution. En ce qui concerne les enfants et les jeunes,
la place
Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 10
occupée par le temps libre dans leur emploi du temps
quotidien est désormais importante. Mais malgré la
disponibilité de ce temps libre que disposent les jeunes en milieux
scolaire, l'engagement à la pratique sportive reste à
moitié.
Pour Claude Lafabrègue (2001), l'amour
de la pratique sportive des jeunes dépend de plusieurs logiques
relationnelles hétérogènes. D'une part il montre que les
jeunes ne peuvent réaliser leurs rêves sportifs sans tenir compte
des contraintes éducatives que souhaitent leurs parents. Certains jeunes
doivent veiller à ne pas reprendre une année scolaire, ce qui
fait qu'ils ont moins d'engagement vis-à-vis des pratiques sportives.
Donc la vocation des jeunes à la pratique sportives n'est pas
définitivement acquise mais dépend avant tout de l'action
éducative des parents ou de la position sociale occupée par les
parents. Le niveau de diplôme des parents est également un facteur
décisif qui influence la pratique sportive des jeunes. Ainsi plus le
niveau de diplôme des parents est élevé plus les jeunes
pratiques une activité physique et sportive. De même que pour le
type de filière choisi par les jeunes dans les lycées, les
élèves des formations professionnelles sont moins sportifs que
ceux des cursus généraux. (Muller, 2005).
En France, selon une enquête
épidémiologique effectuée sur la mesure de
l'activité physique des enfants, il ressort que 50,7% des garçons
et 33.3% des filles âgés de 6-17 ans remplissent les
recommandations de 60 minutes d'activité physique d'intensité
modérée a vigoureuse par jour (Verdot et al., 2020).
Ainsi les filles par rapport aux garçons, ont une diminution
bien plus importante de leur activité physique d'intensité
modérée à partir de 11 ans.
Les données officielles en particulier celles de la
mission statistique de l'INSEP (2010) montrent toujours
l'importance de l'environnement social et du niveau social dans les pratiques
sportives. Pour les deux tiers des adolescents de 12 à 17 ans qui
pratiquent un sport en dehors des cours d'éducation physique,
l'influence sociale est déterminante : c'est dans les milieux sociaux
les plus favorisés que les jeunes font le plus de sport. Les
caractéristiques individuelles, le milieu social d'appartenance et le
lieu de résidence familiale des jeunes influences leurs pratiques. Les
enfants de cadres et de professions intellectuelles restent majoritaires dans
les pratiques individuelles (tennis, golf, voile, etc.) et dans les principales
activités de pleine nature, alors que le football ou les sports de
combat demeurent l'apanage des milieux populaires (Mignon, Truchot,
2002). Le genre et la situation sociale influencent encore fortement
les pratiques sportives, artistiques et culturelles. Les activités
féminines sont plus diversifiées que celles des garçons,
avec une proportion d'activités culturelles plus importante.
Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 11
Le travail de LAVENU (2001) sur la
sociabilité des jeunes à la sortie de l'adolescence montre que le
mode de sociabilité des jeunes à l'âge de la
post-adolescence vers l'âge adulte se traduisent par une réduction
des activités de loisir collective et par une réorientation vers
l'activité individuelle ou solitaire. Donc en ce qui concerne
l'âge, plus les enfants ou les jeunes sont âgés, moins le
taux de pratique sportive est élevé.
Patrick Mignon (2004) soutient les
résultats de cette étude sur la sociabilité des jeunes en
montrant que la pratique sportive est principalement associée à
la jeunesse et au statut d'élèves ou d'étudiants, mais son
augmentation est due à son allongement. La quasi-totalité, 91 %,
des 15-18 ans ont pratiqué une activité physique ou sportive et
la moitié des personnes participant à des compétitions a
entre 15 et 30 ans. La pratique sportive des jeunes diminue de manière
significative après l'âge de 24 ans, notamment pour certaines
activités qui sont spécifiques à cette tranche
d'âge. On peut citer le basket-ball, le handball, le patinage ou des
sports de combat. Par ailleurs, les jeunes constituent les gros effectifs de
sports comme l'athlétisme, les sports collectifs, les nouveaux sports ou
les sports de pleine nature, le tennis ou encore les arts martiaux.
Par ailleurs, la pratique sportive a pour rôle premier
la santé et le bien-être. Ces deux déterminants de la
thérapie non médicamenteuse ont d'abord pour objectif de produire
une capacité réflexive chez l'individus afin qu'ils adoptent un
mode de vie actif. Ainsi l'État dans de nombreux champs d'action
publique fait de la pratique des activités physiques et sportive un
élément majeur de la société (Honta et
Illivi, 2017). Deux préoccupations paraissent dominer
l'entrée dans la pratique sportive. D'un côté, la recherche
du bien-être et d'un équilibre personnel ; de l'autre,
l'affirmation de la sociabilité. Pour la majorité des personnes,
l'attrait du sport est d'être d'abord une pratique sociale, cette
dimension primant sans conteste sur la recherche de la performance, le
désir de compétition ou le goût du risque. Les lieux de
pratique suggèrent aussi, outre la recherche du contact avec la nature,
le refus des contraintes : 63 % des activités se déroulent en
pleine nature, 47 % dans des espaces aménagés, comme les parcs ou
les parcours de santé, 34 % dans la rue, des pourcentages très
supérieurs à celui des pratiques faisant appel à
l'utilisation d'équipements dont l'accès est payant comme les
piscines (26 %) (Mignon, 2004). Les raisons qu'indiquent les
jeunes en faveur d'une pratique sportive sont pour partie semblables : le
plaisir, les rencontres et la santé, mais les garçons
évoquent plutôt la finalité de compétition, de
performance tandis que les filles l'amaigrissement (Choquet,
2001).
Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 12
Selon une étude de l'organisation mondiale de la
santé sur la pratique des activités physiques et sportives chez
les adolescents âgés de 11 à 17 ans, il est
impérieux d'augmenter la pratique physique des jeunes filles et
garçons. Cette étude montre que plus de 80% des adolescents en
milieu scolaire soit 78% des garçons et 85% des filles ne respectent par
la recommandation actuelle, qui est de pratiquer au moins une heure
d'activité physique par jour. Un tel manque d'activité physique
menace la santé des jeunes adolescents. Or la pratique des
activités physiques pendant l'adolescence est bénéfique
pour la santé car il améliore tout d'abord la forme
cardiorespiratoire et musculaire ainsi que l'état des os et la
santé cardiométabolique, et a des effets positifs sur le poids.
Ensuite elle permet de parfaire le développement cognitif et la
socialisation (OMS, 2019).
Par contre toujours pour la même organisation en 2016,
cette différence entre la part de filles et de garçons
obéir à la recommandation. De plus vu la masse des 146 pays
étudiés pendant la période de 2001 à 2016, les
garçons étaient plus actifs que les filles mais avec l'exception
de quatre pays qui sont le royaume des Tonga, le Samoa, l'Afghanistan et la
Zambie. Les Philippines étaient le pays où la prévalence
du manque d'activité physique chez les garçons était la
plus élevée (93 %), et la Corée du Sud était celui
où celle-ci était la plus élevée chez les filles
(97 %) et chez les deux sexes confondus (94 %). Le Bangladesh était le
pays où ces chiffres étaient les plus bas chez les
garçons, les filles et les deux sexes confondus (63 %, 69 % et 66 %,
respectivement). Les pays où le manque d'activité physique est le
plus fréquent chez les filles sont notamment le Bangladesh et l'Inde car
il est dû aux facteurs sociétaux tel que le fait qu'elle assument
d'avantage les travaux domestiques (OMS, 2016).
Il faut noter que le niveau d'activité physique et
sportive diminue avec l'âge surtout dans la période de
puberté où 70% des garçons et 56% des filles
âgés de 6 à 10 ans atteignent les recommandations (une
heure d'APS par jour) contre seulement 34% des garçons et 20% des filles
de 11-14 ans et 40% des garçons et 16% des filles de 15-17 ans
(Verdot et al., 2020).
Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 13
2.2- En Afrique
Sur le continent Africain, le sport est porteur d'enjeux de
développement socio-économiques, un instrument éducatif et
un vecteur d'épanouissement. Cette dynamique est portée d'une
part par la jeunesse qui est au coeur de ce développement et par les
membres de l'élite politique.
Selon Jean-Pierre Augustin (2010) la place du
sport en Afrique n'a pas cessé de s'affirmer depuis les
Indépendances des années 1960. Après une longue
période de mise à l'écart des populations soumises au code
de l'indigénat, les Africains ont bénéficié de
pôles de diffusions civile, militaire et scolaire pour la création
de clubs et de compétitions. Le temps des indépendances leur
donne l'occasion d'utiliser le sport pour affirmer leurs identités
nationales en adhérant au Comité International Olympique (CIO),
à la Fédération Internationale du Football Association
(FIFA), à celle d'athlétisme et à bien d'autres encore.
Ainsi les pratiques sportives comme l'athlétisme et le football sont
devenus le sport préféré des Africains.
La décision des membres de la Fédération
internationale de football association (FIFA), le 14 mars 2004 à Zurich,
d'octroyer l'organisation du Mondial de football 2010 à l'Afrique du Sud
a été perçue comme une opportunité pour le seul
continent n'ayant jamais eu le privilège d'accueillir les Jeux
olympiques ou un Mondial de football, les deux manifestations les plus
médiatisées du village planétaire. Six pays africains sont
qualifiés pour ce Mondial : l'Afrique du Sud, l'Algérie, la
Côte-d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana et le Nigeria. Le continent, par ses
participations et ses performances dans les compétitions de football des
Jeux olympiques et des Coupes du monde devient incontournables en termes de
pratique sportive.
Bouchet et Kaach (2004) travaillant sur
« le modèle sportif dans les pays africains francophones »
sont parvenu à des résultats selon lesquels les pays riches ayant
un fort taux d'urbanisation sont ceux où les sports de
compétition et de loisir sont les plus développés, alors
que dans les pays pauvres, particulièrement les plus enclavés ou
les plus ruraux, le sport a peu pénétré la
société dans son ensemble. Étant considéré
comme un marché du sport sous-développé, l'analyse des
résultats des Jeux olympiques montre à l'évidence que les
nations africaines restent dominées et sous-développées en
raison de quasi mono-pratiques autour du football et de l'athlétisme en
plus de la dépossession des ressources par un marché de joueurs
à sens unique (Augustin,2010). Force est de constater
que le développement du sport dans les pays Africains francophone s'est
souvent réduit à la recherche de la haute performance aux
détriments des
Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 14
pratiques physiques traditionnelles. Ce qui justifie le
sous-développement du sport en général et dans les autres
entités sportives comme, le sport scolaire et universitaire, le sport
fédéral, du tourisme et des loisirs sportifs.
Sur le plan des infrastructures sportives, il y a un
sous-équipement général dans les Pays Africains
francophones. Au Maroc par exemple, il n'y a que 4424 installations sportives
sur un axe urbain Kenitra, Rabat, Casablanca qui regroupe à lui seul
plus de 70 % du parc d'équipements sportifs. Cela donne un ratio de
1,152 m2 par habitant contre 8,5 m2 en France avec un total de 40 160
unités sportives et 9,25 m2 par habitant en Allemagne (Bouchet
et Kaach ,2004).
Andreff (2001), d'après son
l'étude sur l'économie sous développé, sport
sous-développé montre à travers l'UNESCO les 16 pays les
moins avancés en termes d'équipement sportif. Il note donc le
Sénégal, le Bénin et le Congo. Malgré ce
déficit en dotation d'infrastructures, tous les pays Africains
francophones ont au moins un complexe sportif dans la capitale pour accueillir
les grandes compétitions (éliminatoires de la Coupe du Monde et
de la Coupe d'Afrique).
Si le sport scolaire et universitaire est souvent
considéré dans les pays dits développés comme le
vivier ou le réservoir du sport civil permettant aux différentes
fédérations sportives de recruter leurs athlètes, en
revanche, ce secteur connaît beaucoup de difficultés dans les Pays
en voie de développement (PVD) en général et dans les pays
Africains (PAF) en particulier. En effet, le faible taux de scolarisation dans
ces pays ne dépasse pas 60 % des enfants en âge d'être
scolarisés. Il est encore plus faible dans les pays subsahariens avec
seulement 30 à 40 %. Et moins les enfants sont scolarisés, moins
ils ont de chance de pratiquer régulièrement un sport. Et
même ceux qui sont scolarisés actuellement n'ont pas tous la
possibilité ou les moyens de faire du sport. Il est à constater
que dans beaucoup de pays africains, l'EPS est inexistante à
l'école primaire, et même très peu pratiquée dans le
secondaire et à l'université pour des raisons matérielles
(manque d'infrastructure) et humains (faible nombre d'enseignants
formés). Ce sous-développement de la pratique d'EPS dans le
secteur scolaire et universitaire se répercute, d'une manière
négative, sur le nombre de licenciés dans le sport
fédéral (Bouchet et Kaach ,2004).
Vignal, et al (2009) ont
réfléchi sur « les pratiques sportives au Cameroun :
intérêts et spécificités d'une approche par les
formes de pratique ». Le constat fait est que la pratique sportive des
camerounais de la région du centre apparaît comme étant
essentiellement reliée au sexe, à l'âge et au revenu et
plus rarement à la zone d'habitation et à l'ethnie. De plus 71%
de la population d'étude s'adonnent aux pratiques sportives moderne
contre 16% en pratiques traditionnelles.
Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 15
2.3- Au Bénin
Les recherches sur les institutions, les pratiques sportives,
les aménagements sportifs, et l'olympisme en Afrique sont peu
développées et peut être en faire un thème majeur
d'analyse. Ainsi très peu d'étude ont été
réaliser au Bénin sur les pratiques sportives en particulier
celle des jeunes.
Parmi ses études effectuées, on note les travaux
de Baba-Moussa (2004), sur l'organisation du sport au
Bénin : continuité et rupture depuis 1990. Les résultats
de cette étude montrent que l'utilisation du sport comme moyen
d'éducation est donc rendue difficile par l'attitude des dirigeants qui
considèrent souvent que « la fédération et le club
sportif constituent l'un des modes d'organisation parmi les plus
légitimes ». Or, l'éducation physique et sportive au niveau
scolaire et les actions menées par certaines associations
socio-éducatives de jeunesse, dépendant du ministère de la
jeunesse, des sports et des loisirs (MJSL) et dont le sport est un moyen
d'intervention, pourraient être considérées comme des
occasions propices à l'utilisation du sport comme moyen
d'éducation et d'insertion sociale des jeunes.
AKOUETE (2012), en travaillant sur les
politiques sportives au Bénin souligne que les équipements
sportifs construits par l'État privilégient le sport de haut
niveau et sont inégalement répartis dans le pays. Dans les
communes du Bénin, les équipements sportifs sont insuffisants et
inadaptés à la demande du public sportif (associations sportives,
pratiquants auto-organisés et établissements scolaires).
De même, Kakossou (2008), dans son
mémoire intitulé « Place des loisirs dans la vie quotidienne
des étudiants de l'Université l'Abomey-Calavi », nous a
montré que les étudiants aiment bien les activités de
loisirs sportifs mais malheureusement ont des difficultés en ce qui
concerne leur pratique. Ces difficultés sont : le manque de moyens
financiers, le manque d'infrastructures, le manque de centre de loisirs et le
non proximité des centres de loisir du milieu universitaire.
Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 16
| 


