CHAPITRE II : PRESENTATION DU CADRE GEOGRAPHIQUE
I-LES TRAITS PHYSIQUES DU CHAMP D'ETUDE
1-La géologie
La Côte d'Ivoire est formée de deux unités
de surfaces très inégales : un socle ancien qui couvre 97,5 % du
pays et un bassin sédimentaire secondaire et tertiaire qui forme une
mince frange littorale 2.5%. Le socle appartient au vieux bouclier
précambrien de l'Afrique de l'ouest. Les études
géochronologiques ont permis de distinguer un Archéen daté
de 3 000 à 2 300 millions d'années correspondant au cycle
orogénique dit Libérien et un Protérozoïque
inférieur et moyen ou Birrimien s.l. daté de 2 300 à 1 500
millions d'années et correspondant au cycle orogénique dit
éburnéen. Les formations libériennes affleurent dans
l'ouest du pays ; le Birrimien, lui, occupe la presque totalité du
territoire. Le bassin sédimentaire côtier, d'une superficie de 8
000 km2, ne représente que 2,5 % du territoire. Il se
présente sous la forme d'un croissant allongé qui épouse
un rentrant du golfe de Guinée, de part et d'autre d'Abidjan. Recouvrant
une zone de schistes et de granites éburnéens, il est
traversé d'Ouest en Est par une faille très importante qui a
reçu le nom « d'accident majeur de Côte d'ivoire ».
Cette faille sépare deux zones bien distinctes : au nord, une zone
où la couverture très faible atteint rarement 300 m
d'épaisseur ; au sud, un bassin profond dont le socle à la
verticale de la côte atteint 4 à 5 000 m de profondeur. Au nord de
l'accident, les sédiments, très peu épais, appartiennent
au Mio-pliocène continental. Au sud de l'accident, les parties profondes
ne sont connues que par des forages. L'histoire géologique du bassin
débute par le dépôt sur le socle antécambrien d'une
série continentale représentant la base du Crétacé
ou même le Jurassique supérieur et se termine par le
dépôt des formations plioquaternaires (Spengler et Delteil,
1966).
2 - La topographie et la géomorphologie
Au Nord des lagunes, s'étendent les formations
tabulaires argilo-sableuses du continental terminal, désignées
sous le nom de Hauts-plateaux, dont quelques rares témoins sont
conservés dans les îles.
Cet accident divise le bassin sédimentaire en deux
parties, un compartiment nord où le socle est peu profond (1.70 m. sous
Abidjan) et un compartiment sud dont la subsidence est certaine jusqu'au
Miocène au moins.
Le rejet de la faille majeure atteint 3 500 m vers Abidjan.
Cet accident n'est pas unique et il s'agit en fait d'un ensemble de
compartiments séparés par des failles de direction Nord-Sud.
24
Ces compartiments ont pu jouer de façon
indépendante au cours des âges (Spengler et Delteil, 1966).
Du point de vue géomorphologique, le continental
terminal constitue au Nord des lagunes, de hauts plateaux dont l'altitude varie
de 40 à 100 m. Entaillés par des vallées profondes, ces
plateaux sont limités par une véritable falaise sur la côte
nord des lagunes (fig. 1). (Spengler et Delteil 1966)
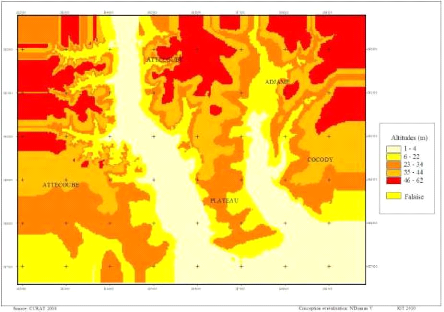
Figure 1 : Carte des altitudes du pourtour des baies de Cocody et
du Banco
3-Le climat et la végétation
La zone d'Abidjan appartient au domaine climatique
guinéen caractérisé par deux saisons des pluies, une
grande centrée sur juin et une petite plus courte, centrée sur
octobre. Ces saisons sont séparées par des épisodes non
pluvieux. La pluviométrie annuelle comprise entre 1 500 et 2 500 mm/an
(YAO Brou 2008) varie le long du littoral de la Côte d'Ivoire. La moyenne
annuelle de la température est de 26°C. Le déficit hydrique
est de l'ordre de 250 mm à 400 mm et l'évapotranspiration est de
1200 mm à 1300 mm (Bilé Eugène 2005). L'humidité
relative est constante toute l'année avec une moyenne de 80 à 85
%. Ce climat est
25
favorable au développement de la forêt dense
sempervirente de type équatorial (ADJANOHOUN, 1965 ; ADJANOHOUN et
GUILLAUMET, 1971).
| 


