Chapitre I
Synthèse bibliographique.
Chapitre I synthèse bibliographique
Chapitre I : synthèse bibliographique
I .1 Définition de la ville:
La ville est un lieu de rencontre et d'échange qui se
développe au détriment du milieu naturel préexistant, Elle
est considérée comme un écosystème urbain
créé par l'homme. Telle que le cadre bâti, les routes et
les espaces verts. Au sein de cet écosystème, il y a des
interactions entre les êtres vivants et leur milieu de vie. (Berkowttz et
al, 2003).
I .2 L'écosystème urbain:
La nature en ville comprend l'ensemble des
éléments vivants au sein de l'espace urbain, par opposition aux
composantes minérales de la ville : faune et flore, mais aussi substance
nécessaire au maintien de la vie (eau, air, sol...). La notion
d'écosystème urbain désigne les espèces vivantes,
leur milieu et les interactions entre ces différents
éléments, qui permettent le développement et le maintien
de la vie. (Mantei et al, 2013).
+

Eau, air, sol
=

Ecosystème urbain

Faune, flore
(mammifères,
arbres
et
arbustes).
I .3 Spécificité de
l'écosystème urbain:
L'écosystème urbain est un milieu
imperméabilisé, artificialisé par les asphaltes et le
béton, et fragmenté par des différentes barrières
telle que les constructions, les routes et les clôtures, est
caractérisé par l'absence de végétation et par la
densité du bâti et de la population. (Louail, 2014).
I .4 La biodiversité en milieu
urbain:
La ville ne convient pas à un grand nombre
d'espèces, elle constitue au contraire un milieu favorable à
certaines d'entre elles, à l'instar des pigeons, rats, et autres
renards. Les politiques menées dans certaines villes contribuent
également au développement des apicultures, qui
bénéficient de la réduction de l'usage des pesticides.
La flore urbaine, composée d'espèces locales et
exotiques, se révèle aussi, selon différentes
études, plus variées que dans les zones
périphériques. Bien que le recensement de la biodiversité
urbaine soit encore à ce jour partiel, on assiste à une prise de
conscience politique et sociétale de cette richesse et des enjeux
paysagers liés à sa préservation. En effet, plus les
milieux sont
Chapitre I synthèse bibliographique
hétérogènes, plus la richesse en
espèces est forte d'où une nécessaire diversification des
paysages urbains. (Mantei et al, 2013).
II .1 L'écologie urbaine:
Selon. Mirenowicz Ph, Garnier Ch (1992), L'écologie
urbaine ne peut se concevoir et se développer scientifiquement sans une
véritable et profonde intégration de l'écologie et des
sciences humaine. Ils ne considèrent plus la ville seulement comme un
simple écosystème, mais comme un éco-socio-système
: « il faut donner d'emblée à l'écologie urbaine,
comme horizon théorique, la compréhension de
l'éco-socio-systéme urbain et la réinterprétation
selon ce point de vue de bon nombre de principes ou concepts, soit purement
écologiques( diversité, stabilité, complexité,
niveaux trophiques, flux de matières et d'énergie), soit issue
des science humaines (cultures, normes, conduites sociales, économiques,
etc.) ou des pratiques urbaines ,architecteur, aménagement de l'espace,
planification.
2. L'objectif de l'écologie urbain:
L'écologie urbaine aurait pour objet
l'amélioration et la production du milieu de vie urbain
(écosystème), du point de vue de l'être vivant -l'homme-
qui le génère, et en relation avec l'ensemble des autres
espèces vivantes, animales et végétales, qui sont
appelées à en faire partie. L'environnement aurait pour objet en
terme urbain d'optimiser les échanges biophysiques entre la ville et les
autres écosystèmes afin de contribuer aux grands
équilibres de la biosphère. (Leturcq, 2001).
3. Les enjeux de l'écologie urbaine:
Lévy J-C. présente les enjeux de
l'écologie urbaine comme multiples et fondamentaux. Ils sont de quatre
ordres : technique, économique, social et politique.
3.1 Les enjeux économiques:
Une bonne gestion environnementale de l'agglomération,
de la ville ou du quartier entraine des retombées en matière de
plus-values foncières, de création d'emploi, de valorisation des
ressources humaines. Il apparait comme nécessaire de les quantifier.
D'autre part, on doit s'interroger sur la manière
d'introduire l'approche environnementale dans les méthodes modernes de
gestion.
Ces enjeux concernent les individus, les groupes sociaux, les
populations locales, les acteurs économiques, le budget municipal, les
autres budgets publics, l'économie générale.
Chapitre I synthèse bibliographique
3.2 Les enjeux politiques et sociaux:
Le nombre important de communes, il semble nécessaire
de mettre en place une cohésion intercommunale. Sinon, il est peu
vraisemblable que l'on aboutisse à des politiques
intégrées d'environnement dans les agglomérations. Ainsi,
il est important de répartir les compétences entre les
différents acteurs de l'environnement. C'était l'objectif des
plans départementaux et des plans municipaux d'environnement mis en
place en 1991. (Leturcq, 2001).
3.3 Les enjeux socioculturels:
La dimension écologique doit absolument être
prise en compte dans le développement urbain. Les
inégalités sociales et les conflits culturels,
révèlent par la crise des banlieues montre que cette dimension
n'est pas prise en compte Lévy. J-C. a écrit: « il convient
d'étudier attentivement la relation entre les questions
matérielles de la vie social et les représentations mentales
qu'ont les habitants des villes afin d'améliorer la relation identitaire
des habitants et de la leur ville ». (Levy, 1992).
Ainsi, au-delà de l'étude des nuisances et des
pollutions, des programmes de recherche en science sociales doivent être
mis en place: étude du rapport à la nature dans l'espace urbain,
des représentations mentales, des conflits liés aux formes de
réappropriation de l'espace urbain (bidonvilles, tags, squats, etc.).
3.4 Les enjeux techniques:
Les agglomérations urbaines connaissent de grandes
difficultés en matière d'élimination des déchets,
d'approvisionnement urbain, de rupture de continuité spatiale, de
dégradation du paysage, de ségrégations sociales. Sur le
plan technique, un des principaux enjeux de l'écologie urbaine est donc
le renforcement des politiques traditionnelles (eau, assainissement,
déchet, espace vert, espaces publics) en évitant la sectorisation
de l'aménagement et de la gestion et en favorisant les politiques
inscrites sur long terme. (Levy, 2001).
III.1 Les espaces verts urbains : contexte et
enjeux:
1. Les espaces verts:
Selon Clergeau Ph (2000), les espaces verts sont les
principaux îlots de nature de surface conséquente dans le tissu
urbain. Entretenus à des degrés divers, ils peuvent abriter un
nombre relativement élevé d'espèces
végétales, plantées et/ou spontanées et ainsi
potentiellement représenter un pôle important du maintien de la
biodiversité (animale et végétale) dans un contexte
urbain.
Chapitre I synthèse bibliographique
Merlin et al (2005) indiquent que l'expression espace vert est
évocatrice mais imprécise. Elle est souvent utilisée en
son sens le plus large, en tant qu'espace occupé par les
végétaux qu'il soit privé ou public localisé
à l'intérieur des zones urbaines ou urbanisables. Actuellement,
le terme espace vert connaît des sens multiples suivant les professions
concernées par ce domaine :
- l'urbaniste l'assimile à l'espace urbain;
- l'architecte parle d'espace libre ou d'espace extérieur
pour désigner les espaces verts ;
- les services techniques des villes associent les espaces
verts aux parcs, aux jardins et aux squares d'une agglomération, ainsi
qu'aux plantations en bordure des voies;
- pour le paysagiste, ce vocable est synonyme de paysage ; il
englobe donc toutes les formes et structures paysagères.
Ainsi dans son acception la plus large l'espace vert englobe :
- toutes les réalisations vertes urbaines telles que
les bois, les parcs, les jardins, les squares et même les plantations
d'alignement et les plantations d'accompagnement (bien que ces deux
dernières expressions évoquent l'aménagement paysager et
non l'espace disponible);
- toutes les superficies vertes péri -urbaines et
rurales, en particulier les massifs forestiers, les coupures vertes ou
celles-ci n'ont de véritable signification qu'à l'échelle
de l'agglomération, elles sont les discontinuités qui
séparent les zones urbaines existantes ou envisagées, elles
peuvent comprendre des forêts, des bois, des zones d'activités
agricoles ou des espaces naturels.
2. Les espaces verts publics urbains:
Les espaces verts sont des zones urbaines non bâties
réservées à la nature alors que les espaces verts urbains
sont les espaces plantés de la ville communément partagés
par tous les habitants ainsi que les visiteurs qui se trouvent dans la ville.
Ils sont destinés à la récréation, à la
détente, aux sports, aux jeux ou à l'agrément visuel. Ils
sont souvent inclus dans ce qu'on appelle les vides constitués par
l'espace non bâti: places, placettes, espaces vert de proximité,
jardins publics, parcs urbains. (Azzouzi, 2011).
Les espaces verts publics urbains sont
considérés comme des équipements urbains à part
entière. Leurs formes, leurs emplacements tout comme leurs superficies
diffèrent en fonction des besoins spécifiques auxquels ils
répondent et de l'environnement urbain auquel ils sont
intégrés.
Ce sont des éléments de l'esthétique
urbaine. Il s'agit d'aménager des espaces naturels de respiration, de
détente et de loisirs à destination des urbains. Les espaces
verts répondent également à d'autres fonctions : ils
peuvent être des espaces de production, tels que les forêts ou
l'agriculture, de préservation des ressources naturelles et humaines,
d'ouverture pour la détente, l'oxygénation ou les loisirs.
3. Chapitre I synthèse
bibliographique
Les catégories d'espaces verts:
La notion d'espace vert recouvre une grande diversité
d'aménagements, il peut s'agir de jardins publics, aires de jeux
d'enfants, parcs d'animaux, jardins botaniques, circuits de promenade, parcours
de santé, stades, terrains de sports, jardins familiaux,
cimetières. (Muret et al, 1987).
4. Typologie des espaces verts:
Les espaces verts proprement dits peuvent prendre des formes
différentes et occuper des superficies et des emplacements variables
selon les besoins auxquels ils répondent, leur aire d'influence et la
diversité du milieu avoisinant (Merlin and Choay, 2009).
De multiples types de classement des espaces verts sont possibles
selon la localisation, le degré d'aménagement de l'espace, le
statut de propriété, le type d'utilisation ou encore la
fréquentation. Les urbanistes font référence à la
typologie regroupant une variété de forme et dimensions.
De ce fait, on peut distinguer divers types de classement,
à différentes échelles :
· de l'unité d'habitation, avec les jardins
d'immeubles et privés (aires de jeux et de repos, pelouses) ;
· de l'unité de voisinage, comme les squares,
places et jardins publics, plaines de jeux, terrains de sport scolaires, parcs
de voisinage ;
· du quartier, avec les parcs et promenades de quartier,
les terrains sportifs
· de la ville, comme les parcs urbains ou d'attractions,
les jardins botanique, zoologique, les équipements sportifs polyvalents
; de la zone périurbaine, avec les bases de plein air et loisir, les
forêts promenade. (Richard, 2013).
Pour les espaces verts urbains, on considère qu'il s'agit
des jardins, squares, arbres d'alignement, plantations, jardinières,
jardins sur dalle, jardins des ensembles immobiliers, places et parkings
plantés... Il s'agit de sites plus ou moins artificialisés par
l'homme.
4.1 Les jardins urbains:
Selon,Friedrich Nietzsche :« Le but de
nos jardins et de nos palais est de mettre hors de notre vue le désordre
et la vulgarité et de bâtir un havre pour la noblesse de
l'âme ».
Le jardin représente la forme la plus ancienne d'espace
vert créée par l'homme.
Les jardins publics qui sont des lieux de repos ou de halte dans
des zones urbaines et qui comportent des massifs fleuris ou des arbres. Cette
catégorie comprend également les squares plantés, ainsi
que les places et placettes publiques arborées. (Art 3. De la loi
n° 07-06 de correspondant au 13 mai 2007). (Voire la figure n°01et
02).
On citera 5 types de jardin:
Chapitre I synthèse bibliographique
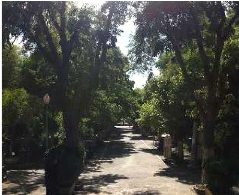
Le jardin botanique, jardin collectif, jardin ornemental, le
jardin résidentiel, et le jardin particulier. (Art4. De la loi n°
07-06 de correspondant au 13 mai 2007).

Figure n°1 .Jardin d'el Emir Abdelkader à
Sétif. Source : l'auteur.
Figure n° 2 : un petit jardin public à Ain Sebt.
Source : l'auteur.
4.2 Les squares:
Le square est un espace vert de dimensions réduites
variant de quelques centaines de m2 pour les plus petits à 4
ou 5 ha pour les plus grands. ((Murret et al, 1987).
Chapitre I synthèse bibliographique
On appelle arbre d'alignement les espèces d'arbres
couramment plantées de manière linéaire et
régulière le long des routes et des rues pour les orner et les
ombrager. (Voire la figure n°02).
4.3 Les parcs urbains:
les parcs urbains et périurbains qui sont
constitués par les espaces verts délimités et,
éventuellement clôturés, constituant un espace de
détente et de loisirs, et pouvant comporter des équipements de
repos, de jeux et/ou de distraction, de sports et de restauration. Ils peuvent
également comporter des plans d'eau, des circuits de promenade et des
pistes cyclables.
(Art4. De la loi n° 07-06 de correspondant au 13 mai
2007).
IV. Les composantes de l'espace vert: se résument en
ce qui suit:
1. Les arbres et les arbustes:
Eléments constitutifs des espaces verts, les arbres
présentent certaines caractéristiques qui permettent
d'établir des critères de classification. Ces critères
sont utiles à connaître pour mener à bien les travaux de
création comme ceux d'entretien.
2. Les grands terrains gazonnés:
Avec les arbres et les fleurs, l'enherbement est le
troisième élément constitutif des espaces verts urbains.
Le terme d'enherbement, peu utilisé, comprend le gazon, la pelouse et la
prairie.
3. Les haies:
Parmi les fleurs ou végétaux à floraison
que l'on peut développer en milieu urbain, il faut rendre aux plantes
grimpantes ou sarmenteuses la place qu'il leur revient. Malheureusement, cette
catégorie n'est pas suffisamment considérée et donc peu
utilisée.
On distingue habituellement trois types d'usage pour ces
végétaux : on peut tapisser des parois minérales surtout
lorsque l'on veut masquer ou verdur des surfaces qui ne sont pas
agréables au regard. Dans les parcs, jardins ou petits squares, on peut
également faire grimper de la végétation sur des pergolas
ou des treilles. (Amireche, 2012).
4. Les plantes d'alignements:
De nos jours, l'arbre en milieu urbain est devenu un sujet de
préoccupation car il représente un enjeu à la fois
patrimonial, écologique, économique, social et politique.
Les écologues estiment qu'il existe environ 100 000
espèces d'arbres dans le monde, soit le quart de toutes les
espèces végétales vivantes. (Gillig et al, 2008).

Chapitre I synthèse bibliographique
Figure n°3. Les arbres d'alignement urbain à Ain
Sebt. Source : l'auteur.
V. Les types et les espèces d'arbre
d'alignement:
L'arbre est l'élément biotique durable de
l'environnement urbain. Augmenter la biodiversité des arbres
d'alignement et choisir les espèces adaptées à ces milieux
et aux fonctionnements attendus, peuvent contribuer à
l'amélioration qualitative du milieu et à la stabilité des
aménagements. (Voire l'annexe N°1).
VI. Les continuités écologiques urbaines,
pour vivre la ville en vert:
Les continuités écologiques en ville ont une double
fonctionnalité. D'une part, elles contribuent au maintien du tissu
vivant en favorisant la reproduction, le repos, la nourriture et le
déplacement des populations animales et végétales.
D'autre part, en étant le support et le lieu de la
réalisation de «services écologiques», elles
participent à l'organisation et au fonctionnement d'un territoire.
La mise en place de continuités écologiques dans la
ville permet de maintenir une biodiversité ordinaire jusqu'au coeur de
la ville. Elle redonne une transparence à l'urbain, permet
d'améliorer le cadre de vie (bien être, création de liens
sociaux) et sert de support pour des transports alternatifs (vélos,
piétons) jusque dans le périurbain (liaison ville-campagne).
Elle permet également d'augmenter les espaces de
récréation, de loisirs et d'éducation et participe
à la régulation de certains problèmes environnementaux
(limitation de l'imperméabilisation du sol, épuration de l'air,
stockage de CO2, diminution de l'îlot de chaleur urbain...). (Mireille,
2015).
Chapitre I synthèse bibliographique
1. Les composantes de la trame verte urbaine: La
trame verte urbaine est constitue :
· d'espaces permettant le cycle de vie des espèces,
appelés noyaux primaires et secondaires (espaces verts de tous
types),
· de corridors permettant le déplacement des
espèces entre deux noyaux (cours d'eau, liaisons vertes
présentant plusieurs strates (arbres, arbustes, herbes) le long
d'infrastructures ferrées et routières ou de rivières.
Au coeur des villes, la trame verte permet aux espèces de
traverser des espaces bâtis hostiles, appelés matrice urbaine (en
gris) et de connecter les espaces verts. (voire la figure n°03).
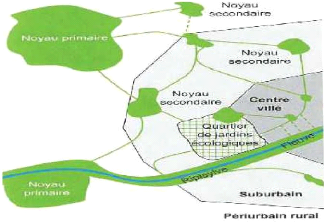
Figure n° 4 : les composantes de la trame verte.
2. Les continuités écologiques se
construisent à tous les niveaux:
· de la rue ou du quartier, elles se traduisent sous forme
d'alignements d'arbres, de préservation de la continuité et des
berges d'un cours d'eau, de toitures végétalisées,
· de la ville et du territoire, elles peuvent s'appuyer sur
le développement d'un réseau de déplacement en mode doux,
la valorisation d'anciennes voies ferrées ou la pratique de gestions
écologiques (gestion différenciée, zéro pesticide,
végétaux locaux...) et leur mise en réseau,
· de la région, elles se traduisent par des
documents de planification et un aménagement de l'espace. (Mireille,
2015).
Chapitre I synthèse bibliographique
Chapitre I synthèse bibliographique
| 


