
UNIVERSITE DE YAOUNDE I
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE
I
FACULTE DES ARTS, LETTRES FACULTY OF ARTS, LETTERS
AND
ET SCIENCES HUMAINES SOCIAL SCIENCES
DEPARTEMENT D'ANTHROPOLOGIE DEPARTMENT OF
ANTHROPOLOGY
PECHE ET CONSERVATION DU POISSON PAR LES POPULATIONS
DE NZIOU ET DE LONDJI I DANS LA REGION DU SUD CAMEROUN: UNE ANALYSE
ANTHROPOLOGIQUE DES CHOIX ET FINALITES DES SAVOIR-FAIRE DES
PECHEURS
Mémoire présenté et soutenu en vue de
l'obtention du diplôme de Master en Anthropologie
Spécialisation: Anthropologie Médicale
Moïse MVETUMBO
Licencié en anthropologie
Sous la Direction de:
Antoine
SOCPA
Maître de Conférences
Mars 2013
i
-A mes parents: Thomas FOMENOP et Pauline SONDEH;
-Ma tante Playne FOUODJING;
-Et à ma grande soeur Sarah NDONKO FOMENAP.
ii
REMERCIEMENTS
Nos remerciements vont tout d'abord au directeur de ce
travail, le Professeur Antoine SOCPA, pour avoir accepté de coordonner
cette étude. Par ses conseils, suggestions, remarques et sa
disponibilité, nous avons pu conduire à terme cette recherche.
Au Professeur MBONJI EDJENGUÈLÈ, Chef du
Département d'Anthropologie, qui nous a inculqué l'esprit de
rigueur scientifique et la recherche de la perfection. Nous sommes
reconnaissant à tous les enseignants du Département
d'Anthropologie de l'Université de Yaoundé I, qui par leurs
enseignements et leur disponibilité à répondre à
nos sollicitations, ont grandement contribué à notre formation
théorique et pratique. Nous pensons notamment au: Pr. Godefroy NGIMA
MAWOUNG, Dr. Luc MEBENGA TAMBA, Dr. Paschal KUM AWAH, Dr. Paul ABOUNA, Dr.
Flavien NDONKO, Dr. Paul Ulrich OTYE ELOM, Célestin NGOURA (Doctorat
3ème cycle), sans oublier M. Déli TIZE, Mme ELOUNDOU
Germaine et Mme Marcelle EWOLO NGAH.
La réalisation de ce travail a été rendue
possible grâce au soutien moral, matériel et scientifique de
plusieurs personnes parmi lesquelles: le Pr. Bernard Aloys NKONMENECK, Jonas
KEMAJOU, Evariste FONGNZOSSIE, Elie NGUEKAM, Judith MAKOMBU et Prospare CHUANSI
DOKO.
Notre gratitude va à l'endroit de toutes les
sympathiques populations de Nziou et de Londji I, qui nous ont reçu et
ont accepté de se prêter à l'enquête.
Je tiens à remercier tous mes camarades, amis,
connaissances et membres de la famille pour leurs conseil, assistance et
encouragement. Je suis particulièrement reconnaissant à Prospare
Chuansi Doko, Alice Poufong, Florence Bekou, Admel Menzepoh,Constance
Kwessié , Victor Kemuze, René Jiofacck, Jean Paul Zoagnong, Diane
Dabové Pambop, Hope Scott Fomenap Wamba, Joseph Mendoko, Violet
Zépop, Françoise Mbokoko, Godwill Tsombo Tsefong, Elisabeth
Tchondap, Florette Kenne, Alphonse Pouokam, Francklin Sabtalla, Ndelle Makoge,
Dieudonné Nguiefembop, George Hubert Menzepo, Mathieu Bilabi, Chanceline
Noghuiewo, Oscar Fendoung, Christelle Wonkam, Junelle Makemteu, Evelyne Siribi,
Marie Gyslène Kamdem Meikeu, Paule Pamela Tabi, Appaulin Pougnon,
Mabelle Nzepghuieko, Verlin Mezepo, Maturin Fomenap, Prisca Maghuieze.
Je prie toutes les personnes de près ou de loin ayant
contribué d'une manière ou d'une autre à la
réalisation du présent travail et dont les noms ne figurent pas
sur cette liste de recevoir l'expression de ma profonde gratitude.
iii
RESUME
Cette étude intitulée: «Pêche
et conservation du poisson par les populations de Nziou et de Londji I dans la
région du Sud-Cameroun: Une analyse anthropologique des choix et
finalités des savoir-faire des pêcheurs», visait à
cerner les facteurs qui sont à l'origine des changements techniques et
du degré de participation des populations locales dans l'activité
de pêche. Dans un contexte où s'applique une multitude de
techniques de pêche et de conservation du poisson, un contraste
demeure entre une adoption tous azimuts des savoirs par les différentes
communautés et une faible participation et production des
pêcheurs locaux dans l'activité de pêche. La
question qui a servi de fil conducteur à cette étude est la
suivante: Quels sont les facteurs socioculturels qui favorisent la dynamique
des techniques de pêche et de conservation du poisson chez les
pêcheurs de Nziou et de Londji I? Comme hypothèse centrale, nous
avons formulé la proposition suivante: Au niveau des villages Nziou et
de Londji I, la place prépondérante du poisson dans la
médecine et l'alimentation des populations, les mariages
interethniques, les rites en rapport avec la pêche devenus de
moins en moins valorisés ont laissé libre cours à la
mutation rapide des techniques de capture et de conservation du poisson chez
les pêcheurs. Pour interpréter les données de terrain, nous
avons convoqué les théories suivantes:
l'ethnométhodologie, la théorie de l'écologie
culturelle et la théorie de l'anthropologie du nouvel
institutionnalisme.
Après analyse et interprétation, il en ressort
que les mutations des techniques de pêche et de conservation du poisson
sont engendrées par des causes endogènes et exogènes au
rang desquelles la place primordiale du poisson dans le système
alimentaire et médical des populations, les mariages
interethniques grâce à l'extension du réseau social de
formation dont ils engendrent, les rites en rapport avec la
pêche qui suscitent de moins en moins l'adhésion des
populations. Cependant, l'efficacité d'une technique, le travail en
synergie, la migration des populations de pêcheurs, le soutien de l'Etat
et des partenaires au développement viennent accélérer le
mouvement. Pour ce qui est du degré d'engagement des acteurs
dans la filière de pêche, l'on note que la situation est
influencée par un certain nombre d'éléments parmi
lesquels: la perception des ressources halieutiques comme une
denrée éternellement disponible par les acteurs locaux, ce qui
élimine tout esprit d'une pêche de compétition de
leur côté, tandis que la diversification des
activités de production amène les différents acteurs
à réserver une portion restreinte de temps à
chacune de leurs occupations. En plus de cela, l'implication massive
et stratégique des migrants dans le secteur des
captures, crée une situation qui leur permet d'avoir une main
mise sur tout le circuit de production. Les mutations des techniques de
pêche et de conservation du poisson engendrent dans le quotidien des
acteurs de pêche, une croissance des revenus, une réduction des
contraintes du travail, une compensation des déficits en produits
halieutiques. Mais aussi, l'on peut mentionner le maintien de
l'hégémonie des acteurs de pêche issus de la
migration, la surexploitation des ressources halieutiques et
l'émergence de quelques conflits entre les pêcheurs.
iv
ABSTRACT
This study entitled «Fishing and fish
conservation by Nziou and Londji I populations in the Southern Cameroon region:
An anthropological analysis of choice and purpose of fishermen
know-how», aimed to identify the factors behind technical changes
and the degree of participation of local fishermen in the fishing activity. In
a context where permanent changes occur at the level of fishing techniques and
fish conservation, contrast remains between an all-out adoption of knowledge
and low participation and production of local fishermen. The main question that
served as guideline of our research was to know what socio-cultural factors
enhance the dynamics of know-how among Nziou and Londji I fishermen? This led
to certain anticipated responses with the main one asserting that at the level
of Nziou and Londji I villages, the preponderant place of fish in medicine and
feeding, inter-ethnic marriages and rites in connection with the fishing which
are losing value, given free rein to the rapidly changing fishing techniques
and fish conservation amount fishermen. The theories on which the data analysis
was carried out included ethnomethodology, cultural ecology and the theory of
anthropology of new institutionalism.
After analysis and interpretation, it was highlighted that the
factors of the dynamics of fishing techniques and fish conservation are both
internal and external. Amongst internal factors are the dominant place of fish
in the feeding and medical system of the population, the interethnic marriages
and fishing rites that are losing progressively their value. Meanwhile external
factors gather the efficiency of a technique, work in synergy, migration, state
and various development partners' support which accelerate the movement.
Regarding the degree of the involvement of stakeholders in the fishing
activities, the perception of availability of fishery resources ever available
as a resource by local actors, the diversification of production activities
leads fishing actors to reserve a small portion of time to each of their
occupations. The massive involvement of migrants in the strategic sector
fishing allowed them to maintain their position in the domain. Furthermore, the
mutation of fishing techniques and fish conservation generates in the daily
life of fishing actors an income growth, a reduction of workload and a
compensation of the deficit of fishing products. But also, they increase the
number of foreigner actors in the activity, the overexploitation of fish and
the emergence of some conflicts between the fishermen.
v
SOMMAIRE Dédicace
Remerciements
Résumé
Abstract
Liste des illustrations
Liste des acronymes et sigles
Introduction
Chapitre I: Description du cadre physique et humain des sites de
l'etude
Chapitre II: Revue de la littérature, cadre
théorique et dfinition des concepts
Chapitre III: Caractéristiques des techniques
endogènes de capture et de conservation des
produits de pêche dans les villages Nziou et Londji I
Chapitre IV: Présentation des techniques
émergentes de pêche et de conservation du poisson
dans les villages Nziou et Londji I
Chapitre V: Contribution à une anthropologie de
la dynamique des techniques de pêche et de
conservation du poisson
Conclusion
Sources
Annexes
vi
LISTE DES ILLUSTRATIONS PAGES
LISTE DES CARTES
Carte 1: Localisation de l'arrondissement de Kribi II .....23
LISTE DES PHOTOGRAPHIES
Photo 1: Centre de santé de Londji ...13
Photo 2: Ecole publique de Londji plage(ou Londji 1). ..18
Photo 3: Course de pirogue entre les jeunes, les
vétérants et les ressortissants nigérians de
Londji I . 21
Photo 4: Une compétition de bras de fer .. 21
Photo 5: Ecole maternelle de Nziou ....26
Photo 6: Ecole publique de Nziou 26
Photo 7: Synthèse du savoir-faire Mabi figurant sur le
pagne de fête du Nguma Mabi. 27
Photo 8: Le chercheur reçoit les explications sur la canne
à pêche. 48
Photo 9: Instrument de pêche à la ligne conçu
avec une grosse ficelle. 49
Photo 10: Matériel de capture à la ligne
conçu avec une petite ficelle 49
Photo 11 : Présentation d'une palangre en réfection
. 51
Photo 12: Opération du `'tirez-tirez» par un groupe
de pêcheurs de Nziou 53
Photo 13: pirogue monoxyle dite «traditionnelle» .
57
Photo 14: Fumoir constitué des piquets en fer . 59
Photo 15: Fumoir constitué d'un saut en fer 59
Photo 16: Fumage du poisson sur un demi-fût ouvert 60
Photo 17: Fumage sur un demi-fût couvert 60
Photo 18: Fumoir en piquet petit modèle ....62
Photo 19: Pirogue chargée du nécessaire pour une
pêche de trois jours. 69
Photo 20: Petite pirogue en planches rassemblées 70
Photo 21: Grande pirogue en planches rassemblées 70
Photo 22: Filets bilolo et friture 71
Photo 23: Filets bar 71
Photo 24: Grande pêche 71
Photo 25: Fumoir en piquet de grande de grandes dimensions 74
Photo 26: Modèle de fumoir amélioré à
un foyer 75
Photo 27: Modèle de fumoir a quatre foyers 75
Photo 28: Ecailles de poisson coloratrices 77
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1: Récapitulatif des pourcentages de
réussites de l'école publique de Londji I
2011-2012 18
Tableau 2: Tableau presentant la saisonnalite
des poissons dans certains village Londji I et
ses environs. . 1
19
Tableau 3: Récapitulatif des pourcentages de
réussite de l'école publique de Nziou 2011-
2012. .....
26
Tableau 4: Production annuelle de poisson au Cameroun.
.....31
Tableau 5: Principales ressources halieutiques marines
exploitées au Cameroun. ......32
Tableau 6: Récapitulatif des dimensions de quelques
modèles fumoirs améliorés . 7575
Tableau 7: Liens entre le détenteur du savoir et
l'apprenant en rapport avec quelques objets. ... 8181 Tableau 8:
Récapitulatif des techniques phares de capture et de conservation du
poisson et les
communautés qui en font usage 95
vii
LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES
A- ACRONYMES
BAD: Banque Africaine de
Développement
CARFAD: Centre Africain de Recherches
Forestières Appliquées et de Développement
CECOPAK: Centre Communautaire de Pêche
Artisanale de Kribi
CEM: Centre d'Estudies del Mar
CEMAC: Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
FAO: Food and Agricultural Organization
IRAD: Institut de Recherche Agricole pour le
Développement
MEM: Musée Ecologique du
Millénaire
MINDEF: Ministère de la
Défense
MINEE: Ministère de l'Eau et de
l'Energie
MINEPIA: Ministère de l'Elevage, des
Pêches et des Industries Animales
MINEPDED: Ministère de
l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développe-
ment Durable
MINRESI: Ministère de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation
MINT: Ministère des Transports
OPED: Organisation Pour l'Environnement et le
Développement Durable
PADPA: Projet d'Appui au Développement
de la Pêche Artisanale
SIDA: Syndrome Immuno Déficience
Acquise
UCAC: Université Catholique de
l'Afrique Centrale
B- SIGLES
CBFF: Congo Basin Forest Fund
IFC: Institut Français du Cameroun
INC: Institut National de Cartographie
IST: Infections Sexuellement
Transmissibles
MST: Maladie Sexuellement Transmissible
ONG: Organisation Non Gouvernementale
PPTE: Pays Pauvres Très
Endettés
SSRHSM: Station Spécialisée de
Recherches Halieutiques et des Sciences Marines
VIH: Virus Immuno Déficience
Humaine
1

INTRODUCTION
1-CONTEXTE
La pêche est apparue dans l'histoire de
l'humanité sous la forme d'une économie spécialisée
tout en s'accompagnant d'un système de production organisée. En
effet, l'exploitation des ressources aquatiques a une importance alimentaire,
sociale et symbolique qui lui est attribuée (ACCÉUS VITALEME,
2009). Au Cameroun, le secteur de la pêche fait vivre directement et
indirectement plusieurs milliers de personnes et contribue à la
consommation nationale de protéine animale. Elle participe pour
près de 298000 tonnes (dont 49,7% issu de la pêche artisanale)
à la satisfaction des besoins alimentaires en produits halieutiques dans
notre pays (MINEPIA, 1996; FAO, 2007). Cette activité se présente
comme un secteur d'avenir et fait intervenir plusieurs catégories
d'acteurs parmi lesquels: les pêcheurs, les fumeuses, les
commerçants des matériels ainsi que des produits de pêche,
etc. La zone côtière de Kribi, localité de pêche par
excellence est une réserve importante en ressources halieutiques. Cette
forte richesse représente une source d'attraction des pêcheurs
nationaux et étrangers en quête des ressources disponibles et
exploitables.
En effet, depuis quelques décennies, l'on observe des
migrations importantes d'étrangers en provenance de la côte ouest
africaine, qui d'ailleurs n'ont pas tardé à devancer les
camerounais dans leur propre territoire. L'enquête-cadre et
l'étude socio-économique réalisée sur le littoral
camerounais en 1995, a dénombré 24136 pêcheurs de
différentes nationalités. Ces pêcheurs comprennent 6847
patrons de pêche et 17289 aide- pêcheurs. Ainsi, 83 % de
pêcheurs recensés sont de nationalité nigériane,
béninoise, ghanéenne et autres (togolaise, malienne...). Ils
exercent d'une manière ou d'une autre une certaine influence sur les
cultures de pêche des populations locales. Ces derniers avec leur nombre
très significatif, intègrent progressivement l'histoire desdites
localités en participant significativement aux diverses activités
qui s'y déroulent. Ce qui fait de ces régions, des
localités en transition, en constant changement ou tout du moins en
construction du point de vue de la connaissance du milieu maritime, des
techniques et savoirs employés dans l'exploitation des produits
halieutiques. Cependant si plusieurs études socio-économiques ont
été menées dans les pêcheries côtières
camerounaises (MINEPIA, 1996; BIGOMBE P. et al., 2002; FAO,2007), l'on note un
faible intérêt de ces travaux sur la dynamique des savoir-faire
mis en oeuvre dans l'activité de pêche. Dans cette logique,
2
l'exploration de la transformation en cours dans la
filière, de la situation de cohabitation et de la
spécificité des techniques utilisées par les
différents acteurs, pourrait nous permettre de rassembler quelques
éléments explicatifs sur la situation critique de
prépondérance des acteurs étrangers dans les
pêcheries côtière au Cameroun.
2-JUSTIFICATION
Plusieurs raisons ont milité en faveur du choix de ce
sujet pour notre projet de mémoire de Master. Elles sont d'ordre
personnel et scientifique.
2-1-Raison personnelle
Le poisson est une composante majeure de notre alimentation,
notamment à travers les protéines dont il nous procure au
quotidien. Depuis quelques décennies en effet, la pénurie de
cette denrée se fait de plus en plus ressentir tant dans les
marchés qu'au niveau des ménages. Et cette carence a une
incidence directe sur le régime alimentaire de plusieurs personnes dont
nous faisons partie. Pour remédier à cette situation, la
recherche est appelée à jouer un rôle primordial. C'est en
ce sens que, nous avons initié cette étude qui vise à
cerner les contours et le mode de fonctionnement de l'activité de
pêche, afin de comprendre ce qui fait défaut dans ladite
filière.
2-2-Raison scientifique
Les zones côtières sont, plus
particulièrement aujourd'hui, au coeur des problématiques de
gestion tant écologiques qu'humaines. Les situations de surexploitation,
de diminution constante des stocks, de réglementation croissante, de
conflits et de compétitions entre pêcheurs artisanaux locaux et
pêcheurs industriels font de la pêche un domaine où se pose
avec acuité une dynamique sans nulle autre pareille. Et puis, le statut
des milieux maritimes et des ressources communes qui s'y trouvent rendent ces
espaces moins évidents à appréhender et à
gérer que les espaces terrestres délimités pour lesquels
les propriétaires sont reconnus; il est donc d'autant plus important de
multiplier les études à leur sujet (CAMPREDON P. et CUQ F., 2001;
STOFFLE B. et STOFFLE R., 2007). Au cours de nos recherches bibliographiques,
nous avons recensé de nombreux écrits dont les différents
contenus tournent au tour de la présentation générale de
la pêche au Cameroun, de la cogestion des pêcheries par les divers
acteurs de pêche, du matériel de pêche utilisé etc.
Cependant, ces études de grande importance n'ont pas
épuisé toutes les questions relatives à la mutation des
savoirs mis en oeuvre par les différents exploitants des pêcheries
et au vécu quotidien des pêcheurs côtiers. C'est pour
combler ce manquement que nous avons proposé de mener une étude
sur la spécificité des connaissances utilisées dans
l'activité de pêche ainsi que le quotidien des acteurs de ladite
filière.
3
3- PROBLEME
La pêche constitue une activité économique
de grande importance dans le quotidien des populations camerounaises en
général et celles des régions côtières en
particulier. Ce domaine d'activité ne date pas d'aujourd'hui et il a
amené à travers le temps, les riverains à inventer ou
à adopter des techniques nécessaires afin d'assurer une bonne
exploitation. Au Cameroun, malgré l'énorme potentialité
des côtes, la production en matière de pêche est très
loin de satisfaire la demande nationale. Parmi les causes
évoquées, plusieurs études (MINEPIA ,1996; EFUET AKOA C.,
2004) ont souligné la faible professionnalisation da la filière
artisanale, les difficultés de transport et de conservation des produits
de pêche, l'absence d'organisation des acteurs de pêche et le sous
équipement dont souffriraient les pêcheurs locaux pour assurer
leur plein épanouissement dans cette activité.
Dans les villages Londji I et Nziou, marqué par une
coexistence humaine et d'exploitation commune des ressources naturelles, chaque
groupe de pêcheurs fait usage de ses connaissances et techniques, de sa
capacité d'adaptation, des échanges d'expérience pour
exploiter au maximum les ressources halieutiques disponibles. Dans ces
localités, une observation de près permet de se rendre compte du
changement radical au niveau des méthodes de pêche et de
conservation du poisson. Cependant, dans ce contexte où s'opère
un dynamisme technique pressant de la part des acteurs de pêche, la
participation et la production des pêcheurs locaux restent faibles.
4-PROBLEMATIQUE
Dans l'exploitation des pêcheries de Nziou et de Londji
I, plusieurs communautés de pêcheurs sont recensées. Dans
le premier village, les Mabi et bien d'autres ethnies camerounaises partagent
avec les ressortissants béninois(Popo) les mêmes ressources,
tandis qu'au niveau du village Londji I, les populations locales
majoritairement Batanga cohabitent avec les pêcheurs nigérians
(Calabar et Ibo). Au-delà des dynamiques inhérentes à
chaque groupe de pêcheurs, l'on note une intégration tous azimuts
des mêmes techniques de capture et de conservation des produits de
pêche, bien qu'avec cependant une tendance remarquable vers une adoption
massive des techniques exogènes. Au niveau de la pêche, l'on peut
mentionner l'intensification de la pratique des opérations de
pêche de longue durée, l'emploi de la technique de sondage,
d'encerclement, l'utilisation des pirogues à moteur, l'emploi des
mêmes types de filets etc. Pour ce qui est de la conservation des
ressources halieutiques, la congélation en mer et sur terre, l'emploi
des mêmes sources d'énergie et de substitution, une adoption des
modes similaires de fumage du poisson entre autres.
4
Après des échanges avec les différents
acteurs de pêche de ces deux villages, il ressort que les mutations des
techniques ont engendré des fortunes diverses chez les pêcheurs
locaux. Ainsi, selon les résultats préliminaires d'une
enquête socio-économique réalisée en 2011 par
l'Organisation non gouvernementale OPED sur les revenus
générés par le fumage du poisson dans les pêcheries
le long des côtes de Kribi, 80% environ de poissons destinés au
fumage sont fournis aux fumeuses du village Nziou par les pêcheurs
béninois, tandis que près 65% environ au niveau de Londji I sont
assurés par les pêcheurs nigérians. S'il y a
décalage entre les changements et l'engagement
déséquilibré des acteurs dans l'activité de
pêche, le contexte socio-économique, les contraintes
écologiques, l'organisation de l'activité et
l'appréhension de la spécificité des savoirs
employés dans la pêche peuvent nous offrir des données
denses à cet effet. Pour y parvenir, nous avons abordé le
problème sous un angle socioculturel et à cet effet, nous avons
fait appel aux approches suivantes:
4 L'accomplissement méthodique nous a permis
d'expliciter la logique et la spécificité des techniques
employées dans l'entretien du matériel de pêche, la
capture, la conservation et la transformation des produits halieutiques au sein
des divers groupes de pêcheurs. Mais aussi, nous avons
procédé à une identification des procédures de
transmission de ces connaissances entre les générations.
4 En faisant appel à la dynamique adaptative, nous
avons exploré les stratégies d'adaptation des populations de
pêcheurs aux contraintes écologiques et sociales de leur
activité telles que vécues par les différents acteurs
impliqués. Nous pensons de ce fait à la situation de carence du
poisson, de la concurrence entre les acteurs et à l'environnement
économique de plus en plus compétitif.
4 A travers la monétarisation de l'activité de
pêche, nous avons eu l'opportunité de cerner l'impact de la
modification du pouvoir de négociation des acteurs sur le degré
de participation des groupes de pêcheurs dans l'exploitation des
ressources halieutiques. A ce sujet, en même temps qu'elle peut
constituer une source de découragement pour les acteurs de pêche
aux revenus limités, les investissements consentis par les autres
artisans, les placent dans une situation d'obligation des résultats.
5-QUESTIONS DE RECHERCHE
Dans le cadre de cette étude, plusieurs questions ont
été formulées dont une principale et trois secondaires.
5-1-Question principale
Quels sont les facteurs socioculturels qui favorisent la
dynamique des techniques de pêche et de conservation du poisson chez les
pêcheurs de Nziou et de Londji I?
5
5-2-Questions secondaires
1-Quelles sont les spécificités des techniques
endogènes et exogènes de pêche et de conservation des
produits halieutiques ?
2-Qu'est-ce qui sous-tend le degré de participation des
populations dans l'activité de pêche ? 3-Quel impact exerce la
dynamique des savoirs en matière de pêche dans le quotidien des
populations de Nziou et de Londji I?
6-HYPOTHESES
Plusieurs hypothèses à vérifier au terme
de l'étude ont été émises. Elles sont
structurées en une hypothèse centrale et en trois autres
secondaires.
6-1-Hypothèse principale
Au niveau des villages Nziou et de Londji I, la place
prépondérante du poisson dans la médecine et
l'alimentation des populations, les mariages interethniques, les rites en
rapport avec la pêche qui deviennent de moins en moins valorisés,
ont favorisé la mutation rapide des techniques de capture et de
conservation du poisson chez les pêcheurs.
6-2-Hypothèses secondaires
1-Les techniques endogènes de pêche et de
conservation du poisson sont caractérisées par leur
facilité d'accès et une production majoritairement
destinée à la subsistance tandis que les parents occupent une
place centrale dans le processus de transmission des savoirs. Par ailleurs, les
techniques émergentes grâce à leurs performances suscitent
beaucoup d'engouement aux yeux des acteurs de pêche. Pour leur
dissémination, le profil des formateurs s'est élargit grâce
à la cohabitation de plusieurs communautés de pêcheurs.
2-Les facteurs de participation des pêcheurs se
trouvent dans la perception des ressources halieutiques, le niveau
économique et la diversification des activités économiques
par les différents acteurs de pêche.
3-Les mutations des techniques de pêche et de
conservation engendrent dans le quotidien de ces derniers, des
conséquences positives et négatives. La contribution à la
satisfaction des déficits en produits halieutiques,
l'amélioration des revenus et des conditions du travail. Mais
également, elles conduisent à une surexploitation des ressources
et engendrent les conflits entre les différents acteurs.
7-OBJECTIFS
Pour mener à bien ce travail de recherche, nous nous
sommes fixés un certain nombre d'objectifs.
6
7-1-Objectif principal
L'objectif principal de cette étude consiste à
déterminer les facteurs socioculturels qui
conditionnent les mutations des savoir-faire en matière
de capture et de conservation des produits
de pêche chez les pêcheurs de Nziou et de Londji
I.
7-2-Objectifs secondaires
1-Présenter les caractéristiques des savoir-faire
endogènes et exogènes en matière de capture, de
conservation du poisson et les modalités de
dissémination au sein des populations de pêcheurs en
présence.
2-Identifier les facteurs de participation des
communautés de pêcheurs dans l'activité de pêche.
3-Identifier les changements dont les diverses mutations
des techniques ont engendrés dans les
activités quotidiennes des populations de Nziou et de
Londji I.
8- METHODOLOGIE
La présente recherche s'est effectuée en plusieurs
phases parmi lesquelles:
8-1-Choix des sites de l'étude et des
informateurs
Ce travail s'est déroulé dans deux villages au
sein desquels plusieurs informateurs ont été
rigoureusement choisis.
8-1-1-Choix des sites de l'étude
Les villages Nziou et Londji I n'ont pas été
choisis comme site d'étude au hasard. En
effet, plusieurs facteurs en ont concouru:
4 Ces villages sont situés dans une localité
côtière, zone dite à «écologie fragile» et
les populations vivent essentiellement de la pêche et des
activités connexes.
4 Dans ces zones respectives, plusieurs communautés de
pêcheurs (notamment les pêcheurs Popo du Bénin qu'on
retrouve au village Nziou et les Calabar et Ibo du Nigérian qui sont
retranchés dans le village Londji I) participent à l'exploitation
des ressources halieutiques. Ce foisonnement de groupements d'humains
génère, partage et échange d'expériences et a
constitué de ce fait un cadre idéal pour notre étude.
4 L'on rencontre aussi dans ces localités les
populations ressortissants des grands groupes ethniques de la région
(les Batanga, les Mabi). Mais aussi toutes les catégories d'acteurs de
la pêche (pêcheurs, fumeuses, commerçants, etc.).
4 Les techniques émergentes (et/ou nouvelles) ont pris
corps dans les activités quotidiennes de ces populations.
Tout cet environnement nous a amené à initier
cette étude afin de cerner les contours de l'activité de
pêche ainsi que le vécu quotidien des principaux artisans.
7
8-1-2-Choix des informateurs
La population d'étude est constituée des
acteurs pêche (pêcheurs et fumeuses de poisson) vivant de la
pêche dans les villages Nziou et Londji I. Nous avons de ce fait,
interrogé 32 personnes à raison de 6 pêcheurs et 6 fumeuses
par village. Les 6 autres personnes interviewées sont issues des
autorités traditionnelles et administratives(ou leurs
représentants). D'une manière générale, les
critères de sélection étaient: l'expérience dans le
métier, le degré d'implication dans l'activité mais aussi
la longévité dans l'activité de pêche et de fumage
du poisson.
8-2-Méthodes et techniques de collecte des
données
Plusieurs méthodes et techniques ont été
adoptées dans le cadre de cette étude.
8-2-1-Méthode de collecte de données
La collecte des données s'est opérée en
deux phases: La recherche documentaire et les
investigations sur le terrain.
8-2-1-1-Recherche documentaire
Cette phase nous a permis de consulter la littérature
disponible et ayant un trait avec notre sujet de recherche. A cet effet les
bibliothèques des structures suivantes ont été
visitées: IRAD KRIBI, CECOPAK, MINEPIA, MEM, CUK, OPED, IFC,
Université de Yaoundé 1. Notre passage dans ces structures nous a
permis de consulter des ouvrages, des articles, des rapports de recherche sur
la vie quotidienne des populations côtières, la pêche et les
techniques mises en oeuvre dans les processus d'exploitation. Cette
démarche nous a donné l'opportunité de circonscrire notre
thème de recherche sur les facteurs de dynamique des techniques de
pêche et de conservation du poisson au sein des communautés de
pêcheurs de Nziou et de Londji I.
8-2-1-2-Recherche sur le terrain
Elle a permis de rencontrer nos potentiels informateurs (les
pêcheurs, les fumeurs et vendeurs des produits de la pêche, les
administrateurs). Au cours de notre séjour sur le terrain, nous nous
sommes servis des outils de collecte prévus pour la circonstance(guide
d'observation, guide d'entretien...) pour entrer en possession des
informations. La collecte des données s'est effectuée du 10
décembre 2010 au 20 février 2011. Le présent travail ayant
pour ambition principale d'identification les raisons qui sous tendent les
mutations des savoir-faire en matière de pêche et de conservation
des produits halieutiques dans les villages Nziou et Londji I, a eu comme
centres d'intérêts les aspects suivants:
4 La spécificité des techniques
endogènes de pêche et de conservation tant pour les
communautés locales que pour celles issues de la migration;
4 Le mode de transfert des connaissances entre les
générations, mais aussi entre les différentes
communautés en présence;
8
4 Les caractéristiques des techniques introduites ainsi
que les agents de promotion;
4 Les facteurs de dissémination des techniques au sein
des différentes communautés qui participent à la
pêche;
4 L'impact des nouvelles techniques dans le vécu
quotidien des populations de pêcheurs. 8-2-2-Technique de
collecte
Au moment de la collecte des informations sur le terrain,
nous avons utilisé la méthode qualitative de collecte de
données, à cet effet, les techniques adaptées à
cette circonstance ont été adoptées. Parmi ces techniques,
nous avons: l'observation et les entretiens.
8-2-2-1-L'observation
C'est l'une des techniques utilisées dans la phase
exploratoire et expérimentale de la recherche. Elle permet à
l'enquêteur de recueillir les informations par la vision, selon les
objectifs fixés. Il existe en fait plusieurs types d'observations parmi
lesquelles nous avons choisi l'observation directe. Cette méthode nous a
donné de vivre de nombreux pans de la culture des populations de cette
région. Elle nous a surtout permis de saisir les informations sur les
comportements des différents acteurs de pêche, le type de
relations qu'entretiennent les pêcheurs, l'occupation de l'espace
terrestre et marin. Grâce à cette méthode, nous avons pu
cerner les modes de préparation et d'exécution des
opérations de pêche, les espaces de transmission des techniques,
les séances de fumage, les motivations des uns et des autres sur le
choix des techniques de pêche et de conservation du poisson.
8-2-2-2-Les entretiens
Les entretiens ont été retenus au début
de notre étude afin de nous permettre de collecter un certain nombre de
données sur le vécu quotidien des différentes
communautés de pêcheurs ainsi que sur la spécificité
et la dynamique des techniques dont emploient ces dernières. Selon LABOV
W. et FANSHEL D. (1977), «un entretien est un `'speech event»
dans lequel une personne A extrait une information d'une personne B,
information qui était contenue dans la biographie de B»
(BLANCHET, A. et al., 1987:82). La biographie renvoyant dans ce contexte
d'échange à l'ensemble des représentations
associées aux événements vécu par la personne
interviewée. C'est ainsi que nous avons fait recours aux entretiens
semi-directifs, l'objectif étant de donner aux informateurs la
liberté de s'exprimer longuement et en profondeur sur les thèmes
dont l'ordre a été librement choisi.
8-2-3-Outils de collecte
Pour entrer en possession des données de terrain, en
dehors d'un guide d'observation, un guide d'entretien a été
élaboré pour chaque groupe d'informateurs que nous avons
préalablement retenu (Pêcheurs locaux, pêcheurs
étrangers, fumeuses camerounaises, fumeuses étrangères,
9
administrateurs). Durant notre séjour, un appareil
photo numérique nous a permis de saisir les faits, les gestes, les
images des cérémonies culturelles et le vécu quotidien des
acteurs de pêche. Nous nous sommes servis d'un magnétophone pour
recueillir l'intégralité des informations. Leur transcription
permanente au côté des images que nous avons saisies nous ont
permis de disposer des informations fiables afin de mieux rendre
fidèlement compte des situations telles que vécues sur le
terrain.
9-ETHIQUE DE LA RECHERCHE
Pour mener à bien cette étude, nous avons pris
un certain nombre de mesures afin de susciter la participation en connaissance
de cause des populations cibles. A cet effet:
4 Le caractère confidentiel des informations
récoltées a été donné au début et
à la fin de chaque entretien. A ce sujet, nous avons pris les
engagements auprès des informateurs sur la nécessité
impérative de protéger l'identité des ces derniers sur
toute information relative à leur vie privée ainsi que sur celle
pouvant engendrer un désordre social;
4 Chaque informateur a eu la possibilité de
décider de la date, du lieu et de l'heure des échanges afin que
ce dernier puisse s'exprimer dans un environnement qui lui convienne le
mieux;
4 Toute prise de vue et l'enregistrement des entretiens
recevaient au préalable l'autorisation de nos informateurs.
10-DELIMITATION DU SUJET
Cette étude intitulée «Pêche et
conservation du poisson par les populations de Nziou et de Londji I dans la
région du Sud-Cameroun: Une analyse anthropologique des choix et
finalités des savoir-faire des pêcheurs» présente les
raisons des changements des techniques de production d'une denrée au
coeur de l'alimentation des populations de Nziou et de Londji I. Elle
relève le contraste entre une homogénéité des
connaissances mises en oeuvre et la faible production constatée chez les
acteurs locaux de pêche. C'est pourquoi cette recherche s'est appesantie
à:
4 L'identification des facteurs de mutation des savoir-faire
utilisés dans l'exploitation des ressources halieutiques. Ce qui nous a
conduit à déceler la place du poisson dans la médecine et
l'alimentation des populations de Nziou et de Londji I, l'importance
accordée aux rites en rapport avec l'activité de pêche, les
facilités d'acquisition des savoir-faire engendrées par la
cohabitation des différentes communautés de pêcheurs en
présence.
4 L'exploration des causes d'une participation variable des
divers groupes de pêcheurs. Et comme facteurs explicatifs à cette
situation, ce travail identifie en dehors des contraintes
10
financières, les motivations individuelles, les
perceptions divergentes des ressources halieutiques par les différents
groupes de pêcheurs.
Au-delà de ces facteurs, le présent travail a
également exploré les aspects suivants.
4 Au niveau de la technologie, nous avons
présenté l'ensemble des outils et techniques de capture et de
conservation des produits halieutiques connus dans nos sites respectifs de
recherche.
4 L'identification des rôles des hommes et des femmes
dans les opérations de capture, la transformation, la commercialisation
du poisson ainsi que dans le processus de transmission des compétences
entre les générations.
4 Pour ce qui est de l'environnement physique, nous avons
présenté les perceptions de la mer, les méthodes de
reconnaissance de l'environnement marin ainsi que les vertus attribuées
aux bois employés dans le séchage du poisson par les
populations.
11-INTERET DE L'ETUDE
Ce travail de recherche présente un double
intérêt théorique et pratique:
11-1-Intérêt
théorique
L'identification des pathologies dont la prise en charge peut
se faire à base de certaines espèces de poisson, ainsi que
l'inventaire des mesures et attitudes utilisées par les acteurs de
pêche pour réduire au quotidien les risques inhérents
à leur activité de subsistance, viennent renforcer les
connaissances en anthropologie médicale. Par contre, la
présentation de l'organisation sociale du travail de pêche entre
les sexes, les générations et les différentes
communautés exploitant les pêcheries d'une part et la description
du processus d'acquisition des techniques de capture et de fumage, le
foisonnement des savoir-faire dans un contexte pluriculturel, constituent une
contribution pour l'avancement des connaissances en anthropologie
culturelle.
11-2- Intérêt pratique
Ce travail constitue à travers la présentation
des mutations en cours dans l'activité pêche, des contraintes et
des facteurs qui limitent ou favorisent la participation des pêcheurs,
une base de données pouvant permettre au gouvernement camerounais et
à ses partenaires au développement de voir dans quel secteur de
la filière, rendre leurs interventions dans la région plus
efficaces et surtout bénéfiques pour les populations.
12-ORGANISATION DU TRAVAIL
Le présent travail est subdivisé en cinq
chapitres repartis de la manière suivante: Le premier porte sur la
description du cadre physique et humain des sites d'étude. Le
deuxième quant à lui présente l'état des
connaissances sur l'activité de pêche, les théories
explicatives et la
11
définition des concepts. Le troisième chapitre
porte sur les caractéristiques des techniques endogènes de
capture et de conservation du poisson. Le quatrième présente les
spécificités des techniques exogènes de pêche et de
conservation des produits halieutiques. Le dernier propose une contribution
à une anthropologie de la dynamique des techniques de capture et de
transformation des produits de pêche. Notre étude s'achève
par une conclusion qui rappelle la démarche adoptée, les
principaux résultats obtenus et quelques perspectives de recherche.

12
CHAPITRE I:
DESCRIPTION DU CADRE PHYSIQUE ET HUMAIN DES SITES DE
L'ETUDE
La localité de Kribi, région touristique de
référence au Cameroun, est une zone dotée d'énormes
richesses naturelles. Elle se trouve au centre de nombreux enjeux
économiques et engendre l'émergence de multiples activités
de subsistance, suscitant de ce fait l'implantation des populations aux
origines diverses. Cette unité administrative couvre plusieurs villages
parmi lesquels nos deux sites d'étude. L'objectif de ce chapitre
consiste à décrire les traits physiques, structurels et humains
des villages Nziou et Londji I.
A-VILLAGE LONDJI I
I-CADRE PHYSIQUE ET GEOGRAPHIQUE
I-1-Le milieu de recherche
Le village Londji I est situé dans l'arrondissement de
kribi II, plus précisément sur l'axe Edéa-Kribi, à
15 km du centre ville, chef lieu du département de l'Océan. Il a
comme localités riveraines: les villages Bibambwé II, Bipaga et
Londji II. Le village est constitué de trois principaux clans parmi
lesquels les Bobenda à l'entrée nord du village, les Bomagiya qui
vivent au niveau de la plage tandis que les Bossena sont situés entre
ces deux blocs. Le pouvoir central est géré par un Chef de
3e degré appartenant au clan des Bobenda. Cependant, la
personne appelée à succéder au trône fait l'objet
d'un consensus entre les délégués des différents
clans. Cette dernière est assistée par des notables issus de ces
grandes familles respectives.
I-2-Le climat
Le village Londji I est influencé par un climat de
type guinéen ayant au passage quatre saisons, deux périodes de
fortes précipitations (de mars-juin et de septembre à
décembre) et deux saisons sèches (de décembre à
février et de juillet à août). Le minimum d'humidité
relative est observé au mois de mars (70%) et le maximum en septembre
(96%). La température qui y prévaut varie entre 23°C et
29,1°C. Notons également que ce climat est propice à deux
cycles de cultures.
I-3-L'hydrographie
Le village Londji I est traversé par le fleuve Londji.
Les riverains reconnaissent en cet espace, la présence des crevettes
d'eau douce et de quelques espèces de poisson. Cependant,
13
suite aux actes de pollution orchestrés en partie par
les riverains, les ressources de cette eau ne sont plus comestibles.
I-4-La végétation
La localité de Londji I est l'un des rares villages de
l'arrondissement de Kribi II à disposer d'une grande superficie de
mangrove. L'importance de cette végétation pour la survie des
populations est bien connue par ces dernières. C'est à juste
titre que les populations dans une politique de
régénération des mangroves, travaillent actuellement avec
CARFAD (Centre africain de recherches forestières et de
développement) dans le cadre du projet de conservation et de gestion
participative des écosystèmes de Mangrove au Cameroun, une
allocation du MINEPDED (Ministère de l'environnement de la protection de
la nature et du développement durable).
I-5-Structure de santé
Le village Londji I dispose d'un centre de santé
intégré dont la date de création remonte à 1982.
Cet hôpital compte 24 pièces (bureaux et chambres). Il a une
capacité de réception de 34 malades. Cependant, ce centre
médical dispose seulement de 15 lits pour la prise en charge des
milliers des populations. Parmi les maladies qui sont soignées sur
place, l'on note le paludisme, les vers intestinaux, l'amibiase, les
bronchites, la fièvre typhoïde, certaines MST et IST, le
rhumatisme. Les cas de tuberculose et de VIH/SIDA sont, une fois
dépistés, transférés dans les centres de
référence du centre ville de Kribi.

Photo 1: Centre de santé de Londji
Source: Mvetumbo(Londji , 2010)
14
II-CADRE HISTORIQUE ET HUMAIN
II-1-Populations locales
Selon plusieurs sources (ONDOUA, P., 1988:27; EMENO, R.,
2005:20), les anciens Batanga établissent leur point de départ de
Mbédi, le créateur et père des côtiers. Ce dernier
avait cinq fils dont Duala-So Mbedi, Isubu Mbédi, Malimba Mbédi,
Ekolé Mbédi et Mutanga. Pour ce qui est de leur itinéraire
et de leur implantation sur la côte, il convient de rappeler
qu'après leur départ de l'Est du Nil, les descendants du
père créateur connurent de multiples difficultés qui se
résument en guerres et divisions. C'est sous ce climat que les fils de
Mutanga Mbedi prirent la route de l'ouest qui les conduisit en bordure de
l'océan atlantique vers la fin du 17ème siècle
(1659-1670). Ces derniers s'installèrent progressivement jusqu'à
la fin du 18ème siècle. Ce n'est qu'à leur arrivée
que chaque sous groupe choisissait son site d'implantation, en fonction des
opportunités qui s'y trouvaient. C'est ainsi qu'une partie des Bapuku du
grand groupe Batanga sont devenus les habitants du village Londji I.
II-2-Communautés étrangères
L'implantation des ressortissants nigérians (Ibo et
Calabar) remonte au début du 20ème siècle notamment dans
les années 1920. Cependant, la vague la plus importante des
pêcheurs se situe autour des années 1970. Ces derniers se sont
détachés de leurs frères installés dans la
région du Sud-ouest du Cameroun à la recherche des zones de
pêche encore sous exploitées.
III-L'ASPECT SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE
Le quotidien des habitants est rythmé par plusieurs
évènements aux spécificités nombreuses.
III- 1-L'Aspect socioculturel
Au village Londji I, la vie des populations est animée
par une multitude de manifestations culturelles.
III-1-1-Organisation sociale
Au-delà des populations locales et d'autres ethnies
camerounaises présentes, la localité de Londji I a vu s'implanter
plusieurs ressortissants nigérians à l'instar des Ibo et Calabar.
Pour faciliter la gestion des personnes et des biens, le village est
subdivisé en cinq blocs dirigés chacun par un chef de bloc
nommé par le chef supérieur. Comme instrument de communication,
les populations utilisent le français, l'anglais et le pidgin comme
langues de dialogue de masse. Cependant, au niveau de chaque groupe restreint,
la langue maternelle est le vecteur d'échange le plus employé.
15
III-1-2-Gestion des conflits
La gestion des différends entre les populations est
soumise à deux types d'instances: Instances traditionnelles et instances
légales.
III-1-2-1-Instances traditionnelles
Lorsqu'un problème surgit dans le village, les
populations peuvent l'exposer aux autorités suivantes: D'abord le chef
de communauté si le problème oppose deux ressortissants
nigérians. Ensuite les chefs de blocs qui ont en charge un secteur
précis du village. Afin de rendre leurs actions plus efficaces, ces
derniers se concertent souvent pour prendre des décisions sur les sujets
dont les mis en cause résident dans leurs zones respectives de
contrôle. Enfin le chef du village est l'autorité qui intervient
en dernier ressort au cas où l'un des mis en cause sollicite son
intervention.
Cependant les initiateurs des poursuites peuvent opter de
porter leur affaire au niveau des instances étatiques.
III-1-2-2-Instances légales
Ce sont entre autre les services de police, de gendarmerie ou
les tribunaux. La particularité de ces dernières
résolutions réside au niveau de la force coercitive dont elles
disposent pour rendre ses verdicts qui sont dès lors contraignants
à toutes les parties en conflit.
III-1-3-Croyances religieuses et associations
culturelles
Dans le village Londji I, la vie est rythmée par des
intenses activités socio-culturelles. III-1-3-1-Le peuple
Batanga et son rapport avec le monde spirituel.
Les Batanga croient en un être suprême
créateur de l'univers visible et du monde des
esprits. Ce dieu auguste et vieillard est installé
derrière les nuages dans un grand village des ancêtres (ONDOUA,
P., 1988:30; EMENO, R., 2005:25). Selon les mêmes sources, Njambe ya
mabongo a deux fils: l'aîné Njamba manga commande sur les eaux,
mers fleuves et lacs; Njamba Eyihi le cadet règne sur les terres. Pour
le peuple batanga, cette entité divine possède en abondance la
force de vie. Les ancêtres en sont pourvus plus ou moins abondamment,
comme les chefs et les anciens; leur sagesse et leur expérience sont
preuves. Quant aux `'Mengu», les esprits des eaux et de la
forêt, c'est une quantité inépuisable qui repose entre
leurs mains. Dans la conception Batanga, les esprits de l'eau ont un aspect
féminin d'une beauté rare avec une chevelure qui leur recouvre
tout le corps jusqu'aux talons. Les Mengu communément
appelé Mami water (EMENO, R., 2005:26), exigent propreté
physique et surtout propreté morale. Mais également, ils
constituent une instance de juridiction sociale, car ils répriment la
malhonnêteté. Ils exercent aussi une influence très
importante sur la disponibilité des ressources halieutiques, ceci en
fonction du degré du respect des normes d'hygiènes dont ils
exigent à ces endroits.
16
III-1-3-2-Vie religieuse
Les fidèles de l'église néo-apostolique,
l'église catholique, la religion musulmane et les églises de
réveil cohabitent pacifiquement dans le village Londji I.
III-1-3-3-Association culturelle
Dans la vie socioculturelle, les associations d'âges
communément appelées «Bétuta»
constituent le socle de la vie collective. Chez les Batanga, les Bétuta
sont des regroupements d'hommes et de femmes de mêmes âges vivant
dans le même village, le même groupement, où dans la
même ville. Ce sont des organisations traditionnelles qui existent depuis
des temps anciens, initiés par l'élite ancestrale. Elles ne
discriminent pas mais plutôt favorisent l'intégration dans la
société. Au départ, l'«étuta»
était un regroupement de personnes de différents âges qui
étaient soit des amis, des parents ou des enfants ayant grandi dans le
même village. Ces dernières prenaient leur repas en commun et
aucun critère de sélection n'était requis pour
l'intégration du groupe. Ce n'est que plus tard que l'intégration
à cette association nécessitait de la bravoure des postulants qui
s'affrontaient à travers la lutte traditionnelle (EMENO, R., 2005:28).
Les rôles et buts visés par les associations d'âges sont
multiformes:
4 Le maintien de la cohésion sociale des clans et
groupements du peuple Batanga et leurs voisins;
4 Le moyen de renforcement de la solidarité et la
maintenance de ce qui restent de valeur traditionnelle après que
l'invasion culturelle occidentale ait forcée par le truchement de la
religion chrétienne à abandonner la production traditionnelle
artisanale (masques et autres formes d'objets d'usage quotidien pour le
maintien et le développement de la société);
4 Le rassemblement des jeunes en vue de développer des
relations d'union de paix et d'amour afin de promouvoir l'esprit de
fraternité, de solidarité et d'entraide.
Cette présentation nous donne de comprendre une
institution de socialisation de la jeunesse et surtout un cadre de
consolidation des valeurs culturelles. Cependant, son impact dans la
dissémination des stratégies d'acquisition des savoirs pourrait
nous permettre de mieux cerner la dynamique des relations entre les
différentes générations et par ricochet le degré
d'implication des populations locales dans l'activité de pêche.
III-1-4-Représentations de la mer dans
l'univers culturel des populations de Londji I La mer couramment
définie comme une vaste étendue d'eau salée,
présente une double dimension aux yeux des populations riveraines.
III-1-4-1-Batanga
Pour les populations locales, l'essence même de la vie,
c'est l'eau, en particulier l'eau de mer. Certains informateurs
n'hésitent pas à estimer que leur vie ne peut avoir de sens, ne
peut
17
être expliquée autrement sans toute fois faire
référence à cet environnement si précieux,
d'où l'importance de cet extrait: «L'homme côtier est
inséparable de la mer. C'est là qu'il passe la plupart de son
temps. Il ne vit que grâce à l'eau, grâce à l'eau de
la mer. Sans mer je ne sais pas ce qu'il ferait». (MADOLA
JOSEPH, Pêcheur Batanga, Londji I, le 13/01/2011). Elle constitue une
source inépuisable en bien alimentaire et de revenu au travers des
ressources halieutiques qui s'y trouvent. La mer constitue aussi un lieu de
loisir et surtout de dissolution de nombreux soucis de la vie quotidienne.
C'est le soulagement, l'assistance et la gaieté qu'apporte la mer aux
riverains qui justifie cet extrait:
Au demeurant, la mer enseigne aux Batanga le rêve,
la poésie, l'évasion, la méditation et l approfondissement
de la pensée de la vie d'ici et maintenant, comme de la pensée de
l'au-delà. La mer enseigne la sérénité et la paix
de l'âme. Celle-ci enseigne tous les jours aux peuples batanga la course
de Dôla (soleil), le lien fondamental qui relie le petit au
grand, le proche au lointain, le visible à l invisible, le clair et
l'obscur lien qui conduit du néant au vécu et à l'abstrait
(EVEMBE, 2003:15) repris par EMENO R. (2005:56).
La mer constitue de ce fait un corps de connaissance,
l'inspiratrice du sens de la raison et de la responsabilité. En effet,
elle assure la liberté, le sens du souci collectif et l'espérance
au sein des communautés riveraines. Cette bonté se manifeste tant
au niveau de l'individu qu'au niveau de la communauté toute
entière à travers leur sécurité dans leurs
activités quotidiennes ainsi que le succès dans la quête
permanente du bien être des ménages.
III-1-4-2-Nigérians
Les informateurs nigérians (constitués
majoritairement des ressortissants Calabar et Ibo) pour leur part pensent que,
la mer est un espace en même temps simple et complexe. Elle rend la
tâche difficile aux personnes habitées par les esprits malfaiteurs
en même temps qu'elle accorde sécurité et pêche
fructueuse aux personnes qui y vont en toute simplicité. En effet, si un
individu se rend en ce lieu avec des idées, des objets qui n'honorent
pas les maîtres des lieux, le traitement retour qu'il recevra sera
proportionnel à ce qu'il mérite. Ils croient tout comme les
ressortissants des autres communautés présentes en l'existence
d'une entité divine qui habite ce lieu et qui est responsable de la
disponibilité des ressources. C'est pourquoi ils participent dans le
cadre qui leur est réservé aux différentes manifestations
culturelles organisées dans la localité.
III-1-5-L'Education
Le village Londji I a en son sein une école maternelle
et une école primaire qui assurent la formation des adolescents. Ces
deux établissements construits en matériaux modernes forment sans
distinction de sexe ni d'origine des jeunes apprenants. C'est ainsi que les
enfants issus des ménages camerounais et nigérians
bénéficient des mêmes programmes d'enseignement.
18

Photo 2: Ecole publique de Londji plage(ou de
Londji 1). Source: Mvetumbo (Londji I, 2010).
D'une manière générale, le taux de
réussite scolaire se situe sensiblement autour de la moyenne. Le tableau
ci-dessous présente les taux de réussite de l'année
scolaire 2011-2012.
Effectifs présentés
|
Admis
|
pourcentage de réussite
|
De la SIL au CMI:302
|
227
|
75%
|
Entrée en 6eme: 8
|
8
|
100%
|
Ière année: 20
|
9
|
45%
|
CEP: 29
|
29
|
100%
|
|
Tableau 1: Récapitulatif des
pourcentages de réussites de l'école publique de Londji I
2011-2012 Source: Eloundou Henri Emmanuel (Directeur, le 27
/09/2012).
Cependant, les responsables de cette structure de formation
font face à quelques difficultés dont la plus importante reste le
non établissement des actes de naissances aux adolescents, ce qui
constitue un frein à l'épanouissement scolaire des jeunes. En
effet, plusieurs enfants sont inscrits et fréquentent sans ce
précieux document jusqu'en classe de CMI. Selon les informations
reçues auprès du directeur de l'école, 80% d'enfants
nigérians et camerounais confondus sont concernés par cette
situation. Cette circonstance est en partie responsable du
phénomène d'abandon des classes favorisant ainsi la sous
scolarisation. Situation qui conduit la jeunesse de Londji dans les pratiques
telles que la consommation des drogues et le tourisme sexuel (BITHA, H.,
2010:3) avec son lot de conséquences sur la santé et la
sécurité dans la localité.
III-2-L'aspect économique
Les populations vivent de plusieurs activités
économiques parmi lesquelles: la pêche, l'agriculture et le
commerce.
19
III-2-1-Pêche.
Dans le village Londji I, la pêche constitue la
principale activité de subsistance des populations locales. Les hommes
sont dominants dans la pêche en mer tandis que les femmes ont une main
mise au niveau de la pêche des crevettes d'eau douce et du fumage du
poisson. Ces dernières en fonction des saisons et de leurs multiples
expériences s'organisent pour maximiser les captures. Car pour les
populations locales, le calendrier de pêche est en partie
maîtrisé. A ce sujet, BROCHET et KOHPE (2007:7) dans une
étude sur la saisonnalité des ressources halieutiques dans
certains campements de pêche de Kribi, ont abouti sur la synthèse
suivante:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOIS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JANVIER
|
FEVRIER
|
MARS
|
AVRIL
|
MAI
|
JUIN
|
JUILLET
|
AOUT
|
SEPTEMBRE
|
OCTOBRE
|
NOVEMBRE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESPECES
DECEMBRE
Bar
Brochet
Carpe
Hareng
Tortue
Requin
Bossu
Mulet
Machiron
Crevette
Tableau 2:Tableau presentant la saisonnalite
des poissons dans certains village Londji I et ses environs.
Source: BROCHET et KOHPE (2007:7).
III-2-2-Agriculture
Dans la région côtière du Cameroun,
l'agriculture est une activité aussi importante que la pêche. Au
niveau de Londji I, elle fournit plusieurs denrées alimentaires à
l'instar du manioc, du macabo, de la banane...
III-2-3-Commerce
L'activité commerciale joue un rôle
indispensable dans le quotidien des populations de Londji I. Parmi les produits
commercialisés, figurent: le poisson (frais et fumé), les
matériels de pêche (filets, pirogues), les produits de
conservation du pêche (la glace pour la conservation du poisson en mer).
Le commerce du bois est un secteur exclusivement contrôlé par les
autochtones au regard de leur facilité d'accès aux ressources
floristiques; il en est de même du sable. Le village Londji I dispose
d'un jour du marché par semaine à savoir chaque lundi. En dehors
de ce jour classique, les mercredis et samedis qui sont des jours de
débarcadère, constituent aussi les grands moments de livraison du
poisson.
20
IV-ACTIVITES CULTURELLES DES POPULATIONS DE LONDJI I
Le 14 février de chaque année, les populations
de Londji I célèbrent aux côtés de leurs
frères Batanga éparpillés dans le Département de
l'océan, une fête mémorable dont les origines et les
finalités sont nécessaires pour mieux comprendre l'importance de
l'évènement.
IV-1-source de l'événement
Selon les sources historiques, au moment où
éclate la première guerre en Europe, Kribi demeure la ville de
prédilection des colons allemands (ONDOUA, P., 1988:63). Par la suite,
les combats pour la prise de la ville avaient fait rage entre les troupes
alliées et les troupes allemandes avec une progression significative des
forces d'occupation. L'étau qui se resserrait progressivement sur les
Allemands aurait eu du succès si ces derniers n'avaient pas pris la
décision d'utiliser les populations locales comme bouclier humain. Cette
situation engendra de nombreuses morts d'hommes, de femmes et d'enfants. Et
face à cette cruauté, les alliées décidèrent
de venir en aide aux populations locales (dont les Bapuku en font partie) afin
de les sauver du massacre. La traversée vers les nouveaux sites
d'accueil fut rude et beaucoup de personnes en moururent. Les passagers furent
entassés dans les cales et sur le pont des bateaux comme de vulgaires
sacs de cacao. Pendant le voyage et l'exil, l'on souffrait de froid,
d'épidémies et surtout de famine.
Toutes ces péripéties traversées par ces
peuples ont servi de coup d'accélérateur et les ont
poussés à instituer la date de leur retour comme un jour de
fête, de commémoration des personnes disparues et comme un moment
d'expression de leurs savoir faire.
IV-2-Commémoration des fêtes
Les populations de Londji I dans leurs manifestations
culturelles exhibent des signes et symboles porteurs de nombreux sens.
IV-3-Activités phares
Parmi les manifestations organisées le jour de la
célébration, les populations mettent l'accent sur un certain
nombre d'actions: la natation, la course des pirogues, le bain populaire, la
lutte traditionnelle, la course de vitesse, la course des pirogues etc.
IV-3-1- La natation.
La compétition permet de tester leur
efficacité, de perfectionner le talent de défense personnelle.
Dans une autre perspective et celle dont les populations mettent en
scène, c'est qu'au moment où ces dernières regagnaient
leur terre natale après une période de déportation,
nombreux étaient ceux qui avaient rejoint les côtes à la
nage. Car, ils ne pouvaient plus attendre la fin des différentes
manoeuvres d'accostage des bateaux. La nage a de ce fait permis
21
aux plus futés d'atteindre rapidement la plage, ce qui
marqua la fin de leur calvaire. C'est la raison principale pour laquelle les
populations côtières y mettent un accent pendant ces
commémorations.
IV-3-2-La course des pirogues
Elle constitue une étape importante dans la vie du
futur pêcheur au milieu des eaux. A travers l'assistance des
aînés pendant la pêche, les jeunes apprennent à
pagayer. Pendant les grandes cérémonies culturelles notamment,
celles relatives à la fête des Batanga, la course des pirogues
occupe une grande place. Elle peut être organisée entre les
personnes de classes d'âges différentes afin de susciter
l'échange d'expérience mais aussi et surtout de mesurer la
performance de la jeune génération. Dans l'ensemble, ce qui
occasionne la victoire d'une équipe réside autour du degré
d'engagement, le courage, la rapidité, la cohérence dans la
coordination des actions ou la maîtrise de l'utilisation de la pagaie. A
cause du caractère cosmopolite du village Londji I, chacune des
entités culturelles présentes participe à la manifestation
en se constituant en une équipe concurrente (photo:5).
IV-3-3- Le bras de fer
La compétition du bras de fer est
régulièrement organisée entre les jeunes de même
tranche d'âge afin d'assurer leur formation physique. Car à
l'image de leur histoire, il est indispensable à tous les citoyens de se
positionner en véritable combattant.

Photo 3: Course de pirogue entre les jeunes, les
vétérans et les Photo 4: Une compétition
de bras de fer
ressortissants nigérians de Londji I entre deux jeunes
batanga
Source: Mvetumbo(2O11) Source
: Mvetumbo (2011)
IV-3-4-Le bain populaire
Au cours des festivités, l'on assiste à une
baignade populaire à laquelle participent toutes populations
présentes. Le coup d'envoi est donné par les hauts dignitaires du
village qui, après les procédures d'usage, donnent l'ordre aux
participants de prendre leur bain de bénédiction.
22
L'eau de la mer renferme en effet pour ces populations une
source de vie et est censée leur apporter pureté,
sécurité et paix. Ainsi, au terme des cérémonies
bien accomplies, les populations espèrent recevoir en retour dans leur
vie quotidienne la santé, la prospérité et la
cohésion sociale. IV-STRUCTURE DE L'HABITAT
Au village Londji I, la structure de l'habitat se
présente d'une manière générale sous deux formes
à savoir: les maisons en carbotte et les maisons en durs.
IV-1-Maison en carabotte
Pour catégorie de maison, les murs sont
constitués en planches rattachées sur les poteaux par des clous.
Les toits sont couverts de tôles ondulées pour la majorité
des résidences. Chaque propriétaire ou résident
aménage son logement en fonction de ses moyens économiques. C'est
ainsi que l'on peut noter par endroit la présence des maisons ayant des
sols nus d'autres cimentés, l'acquisition d'un poste radio, d'une
télévision, d'un réfrigérateur.
IV-2- Maison en dur
Ce sont des maisons construites en matériaux
définitifs et/ou durables (briques de terre, parpaings, du ciment, fers,
etc...). Dans la localité de Londji I, ce type de construction n'a
cessé de se multiplier et l'on le retrouve dans tous les secteurs du
village.
B-VILLAGE NZIOU
I-CADRE PHYSIQUE ET GEOGRAPHIQUE
I-1-Milieu de recherche
Le village Nziou est constitué de six clans à
savoir: les Bikoua, les Bindayili, les Biamankiu, les Bipah, les Bigondo et les
Sassanguié. Ces grandes familles se sont entendues pour confier la
gestion du village aux Sassanguié. Cependant, pour accéder au
trône, ces différents clans se réunissent pour
désigner le nouveau dirigent. Chaque clan est représenté
dans le conseil des notables par deux ou trois personnes dont la
désignation par le chef est sous-tendue par leur esprit d'équipe,
leur sens d'écoute et leur implication dans l'exécution des
travaux d'intérêt commun. Il est principalement habité par
les populations Mabi auxquelles peuvent se joindre plusieurs autres groupes
ethniques camerounaises. A ces derniers s'ajoutent les Popo, ressortissants
béninois implantés depuis quelques décennies. Cette
localité tout comme celle de Lndji I, se trouve dans le
département de l'Océan et plus précisément dans
l'arrondissement de Kribi II. Elle est située sur l'axe lourd
Kribi-Edéa à quelque trois kilomètres de la ville de
Kribi. En dehors de sa proximité à l'océan atlantique, le
village Nziou a comme localités limitrophes: Elabé, Zami et Ngoye
réserve.

23
Source: I.N.C. Fond topo kribi Edéa au
200.000e (2011).
I-2-Le climat
Le climat qui anime le village Nziou est le même qui
règne sur le littorale du Cameroun. Ce climat résulte des effets
combinés de la convergence des basses pressions océaniques
tropicales et le front intertropical à l'intérieur du continent
(FOLACK, J., 1999). Le minimum d'humidité relative est observé au
mois de mars (70%) et le maximum en septembre (96%). La température qui
y prévaut varie entre 23°C et 29,1°C et est propice à
deux cycles de cultures (ONDOUA, P., 1988). En ce qui concerne les
précipitations, nous pouvons noter qu'il pleut
généralement le long de l'année et l'on distingue quatre
(4) saisons reparties d'une manière générale ainsi qu'il
suit:
4 De décembre à février: grande saison
sèche
4 De Mars à juin: petite saison pluvieuse
4 De Juillet à août: petite saison sèche
4 De septembre à décembre: grande saison
pluvieuse
24
Les populations de Nziou en fonction de leurs expériences
s'en servent des différentes variations des saisons et du climat pour
élaborer leur calendrier agricole et de pêche.
I-3-L'hydrographie
Situé à proximité de l'océan
atlantique, le village Nziou est arrosé par deux petits cours d'eaux.
Nous avons le Mbouligoué et le cours d'eau Nziou. Les populations y
capturent entre autre, les crevettes, les poissons tilapia, silures,
machoiron...
I-4-Le sol
Le village Nziou connaît une prédominance des
sols jaunes. Ce sont des sols assez pauvres dont la teneur en argile est assez
forte, les sables y représentent 30 à 50%, le limon ne
dépasse guerre 15% et les teneurs en matières organiques sont
comprises entre 1 et 3%. Ce sont des sols médiocres et souvent
stériles, ces derniers sont épais sur les plateaux. Cette
situation peut expliquer le faible intérêt réservé
à l'agriculture.
II-CADRE HISTORIQUE ET HUMAIN
II-1-L'origine du nom Nziou
Le village Nziou était une localité très
fréquentée par les animaux dont l'espèce la plus abondante
était l'antilope. Ainsi, les populations venaient de partout pour se
livrer à des parties de chasse. Pour les anciens que nous avons
rencontrés, le nom Nziou n'est autre chose qu'une
référence à ce fort potentiel dont disposait cette
zone.
II-2-Implantation des populations
Les populations vivant actuellement sur le territoire se sont
installées en suivant des itinéraires variés.
II-1-2-1-Populations locales
Après le passage des Pygmées dans la
région de Kribi (DUGAST, I., 1949:5; MVENG, E., 1984:38-39), le village
Nziou a connu l'arrivée des populations Mabi sur son site. Ces
dernières font partie des tribus littorales du grand groupe Bantu et
renferment un nombre assez élevé de pêcheurs (MONOD, T.,
1928 :209). En dehors du rapport étroit qui les lie à la mer, ces
populations ont progressivement développé les activités de
chasse et champêtre.
II-1-2-Implantation des communautés
béninoises
Selon les populations du village Nziou, les ressortissants
béninois se sont progressivement installés dans le village entre
1990 et 1995. Mais cette période ne coïncide pas avec leur
participation effective dans l'exploitation des pêcheries
côtières de Kribi. Ce qui fait qu'avant leur implantation, des
relations existaient déjà avec certains pêcheurs locaux
pratiquant la pêche de migration. Depuis lors, de nombreux liens se sont
créés entre ces derniers et les populations locales de Nziou.
25
III-L'ASPECT SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE
III-1-Organisation sociale et gestion des conflits
La vie socioculturelle des populations de Nziou est
meublée par plusieurs activités. III-1-1-Organisation
sociale
Pour faciliter la coordination des actions au sein des
différents groupes présents, les
autorités en charge de l'organisation administrative
et de la gestion des conflits prennent en compte la notion de diversité.
Ainsi, après l'implantation massive des Béninois suivis de leur
implication dans les activités du village, ces derniers ont à
leur tête un chef de communauté à qui plusieurs missions
sont dévolues à savoir: Mettre à jour la liste des membres
de sa communauté d'origine habitant la localité d'accueil,
promouvoir la paix, jouer le rôle d'intermédiaire entre les
autorités traditionnelles et administratives et leurs concitoyens
respectifs, faciliter la cohésion sociale entre les familles et les
communautés de pêcheurs.
III-1-2-Gestion des conflits
Pour la résolution des différends entre les
populations, les problèmes rencontrés peuvent être soumis
aux instances coutumières ou aux instances légales.
III-1-2-1- Instances coutumières
A ce niveau, plusieurs situations peuvent être
réglées à l'amiable entre les personnes mises en cause
sous la conduite des responsables locaux. Parmi ces autorités, nous
avons les chefs des communautés qui sont saisis lorsque le
problème à régler est moins explosif et concerne les
personnes dont ils ont la charge. Le chef du village est quant à lui
l'autorité qui intervient en dernier ressort au cas où l'une des
parties sollicite son arbitrage.
III-1-2-2-Instances légales
En fonction des infractions commises, les plaignants peuvent
se décider de porter plainte au niveau de la police, de la gendarmerie
ou tout simplement devant les tribunaux.
III-2-Vie religieuse
Dans le village Nziou, cohabitent harmonieusement les
fidèles de l'église catholique, de l'EPA (Eglise Protestante
Africaine) de l'église protestante orthodoxe, les musulmans et les
animistes.
III-3-L'Education
Le village Nziou dispose d'une école maternelle et
d'une école primaire. Ces deux institutions assurent l'éducation
de base des enfants issus des différentes communautés des
pêcheurs présentes en l'occurrence les enfants béninois et
camerounais. Ces structures de formation situées à quelques 200 m
de la chefferie sont logées dans la même enceinte ayant toutefois
une direction chacune.
26

Photo 5 : Ecole maternelle de Nziou
Photo 6:Ecole publique de Nziou
Source : Mvetumbo (Nziou, 2010) Source
: Mvetumbo (Nziou, 2010)
Le taux de scolarisation de la jeunesse est sensiblement
élevé. Le problème d'abandon scolaire est très
irrégulier, car peu d'enfants en âge de fréquenter se
livrent à plein temps à une activité autre que
l'école en période de classe. Le tableau ci-dessous
présente les taux de réussite de l'année scolaire
2011-2012 à l'école primaire de Nziou.
Classes et/ou examens
présentés
|
Garçons
|
Filles
|
Moyenne
|
Sil
|
85,75%
|
84,64%
|
85,19%
|
CP
|
96%
|
95%
|
95,5%
|
CEI
|
86,91%
|
63,63%
|
75,37%
|
CEII
|
86,67%
|
96,55%
|
91,61%
|
CMII
|
84,21%
|
100%
|
92,15%
|
Entrée en 6eme
|
40%
|
33%
|
36%
|
Entrée 1ère année
|
35%
|
6,6%
|
20, 8%
|
CEP
|
65%
|
56%
|
60,5%
|
|
Tableau 3: Récapitulatif des
pourcentages de réussite de l'école publique de Nziou 2011-2012.
Source: NDONG Godefroy Nazaire, Directeur, le 26/09/2012.
III-4-Fête commémorative
Chaque année, les populations de Nziou au
côté des autres groupes Mabi de la région organisent
plusieurs manifestations culturelles. Ces festivités qui se
déroulent pendant une période de cinq jours s'étendent du
11 au 15 décembre. Le 11 décembre est le jour d'ouverture au
cours duquel le programme détaillé des différentes
manifestations est déroulé. Cette fête intitulée
`'Nguma Mabi» qui signifie en langue
française `'la dignité de l'Homme mabi''
constitue une cérémonie commémorative du
passé douloureux qu'a traversé ce peuple. En se rappelant de leur
histoire, ces moments représentent un cadre d'expression de leur art,
des lieux de manifestation de leur capacité de résistance face
aux vicissitudes de la vie. C'est en ce sens qu'elles véhiculent un
certain nombre de messages par le truchement des objets, des tenues ainsi que
des repas exposés pendant lesdites cérémonies. Ainsi, l'on
peut aisément comprendre la
27
symbolique de la référence permanente aux
crevettes, aux poissons, aux nasses, aux filets traditionnels
confectionnés à base des lianes, l'arc qui leur servait d'outil
de chasse tout au long de la période de captivité...
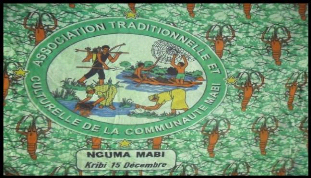
Photo 7: Synthèse du savoir-faire Mabi
figurant sur le pagne de fête du Nguma Mabi. Source:
Mvetumbo (Nziou ,2010).
Cet ensemble d'images symbolise la forte dépendance de
ces peuples de ces produits dans leur quotidien. En effet, pendant leur
période de captivité loin de leur résidence et à
cause du manque d'opportunité d'entrer en possession d'autres
denrées alimentaires, elles ne se nourrissaient que des crevettes, du
poisson et des produits de la chasse. Ils se trémoussent tout en
invoquant les ancêtres de guider leurs pas et de rendre toujours
disponibles les merveilles que leur procure la nature.
Parmi ces manifestations, l'on note les foires d'exposition
et de vente des objets d'arts, la diversité des mets essentiellement
constitués au départ des plats locaux, mais qui avec les
changements voit l'introduction progressive des mets extérieurs à
la communauté. Toujours au cours de ces festivités, une course de
pirogues est souvent organisée entre les différents groupes, mais
aussi les danses traditionnelles, la natation, la lutte traditionnelle
»makiya»... Cependant, la scène la
plus attendue des participants est l'arrivée de l' «homme
poisson». Ce dernier lâché au large est appelé
à rejoindre les rives de l'océan à la nage. Il arrive
toujours avec du poisson reçu des ancêtres symbole du lien
inébranlable entre ces populations côtières et les esprits
de l'eau. Mais aussi, il représente la place inconditionnelle qu'occupe
cette denrée dans leur alimentation. Le 15 décembre, un grand
défilé est organisé dans la ville de Kribi avec la
participation des populations Mabi du village Nziou ainsi que celles du reste
du département de l'Océan.
28
III-5-Représentations de la mer dans l'univers
culturel des populations riveraines de Nziou
Au sein du village Nziou, l'on rencontre plusieurs
communautés de personnes.
III-5-1-Mabi
L'eau fait partie intégrante de la vie des
populations. C'est pourquoi, d'aucuns n'hésitent pas à la
désigner de «second monde» des populations
côtières. Tel est le point de vue de ce pêcheur et
personnalité bien introduite dans la culture locale:«Nous
vivons de la mer. Nous ne sommes rien sans la mer. C'est là que se
retrouve notre vie». (MESSI JULES, Mabi, Nziou, le 17 /01
/2011). Elle signifie pour les populations locales le second refuge, le lieu
où réside leur dieu, qui est au service de toute la
communauté. Ces populations en période de carence de poisson ont
eu par le passé à offrir des dons au dieu afin de solliciter ses
grâces. Cette initiative aboutit lorsque le rite est bien
exécuté au retour du poisson (l'abondance du poisson dans les
eaux). Ils accordent la sécurité à travers la
stabilisation de la mer manifestée par la faiblesse des vagues, signes
annonciateurs de la disponibilité des ressources.
III-5-2-Béninois
La situation n'est pas très différente dans
l'imaginaire des ressortissants des autres
communautés de pêcheurs implantés dans la
localité. Pour les Béninois en effet, la mer parait dans la
localité de Kribi moins mouvementée par rapport à leur
pays d'origine. Cependant, ils estiment et sont convaincus que cet espace est
un monde habité et géré par les dieux, qui le
contrôlent, assurent la sécurité et le bien être des
personnes qui s'y rendent. A cet effet, les riverains qui sont des locataires
bénéficiant de leurs privilèges, doivent en permanence
offrir des sacrifices en guise d'hommage. A ce sujet, suivons le
témoignage de ce pêcheur Popo du Bénin:
L'eau que tu vois et qui donne du poisson est
habitée par des gens. Les gens qui contrôlent l'eau. Ce sont eux
qui donnent du poisson quand ils sont fiers. Quand ils ne sont pas fiers, il
n'y a pas de poisson. Chez nous au Bénin, nous offrons chaque
année à manger aux gens qui habitent là-bas. Nous pouvons
le faire, une ou deux fois par an. Nous donnons à ces gens beaucoup de
choses. Nous pouvons par exemple leur donner du riz, du savon, des boeufs, de
la chèvre [...] tout ce que nous mangeons, nous leur donnons aussi car
ils sont des hommes comme nous et mangent aussi ce que nous mangeons. Nous le
faisons à tout moment, chaque' année et c'est pourquoi il y a
toujours du poisson dans notre mer. Mais ici, les gens ne font pas comme
ça. Maintenant, il n'y a plus de poisson dans l'eau comme avant quand
j'arrivais ici. Mais ils ne comprennent pas qu'il faut donner à manger
à ces gens là, à tout moment, les gens qui habitent dans
l'eau (HUBERT, Pêcheur, Béninois, Nziou, Le 15-01-2011).
29
Pourtant une régularité et le sérieux
dans l'exécution de tels rites constitueraient une voie salutaire face
au problème de carence de poisson ainsi que de certaines situations
d'insécurité des pêcheurs.
III-2-L'aspect économique
Il se décline en plusieurs activités parmi
lesquelles figurent: la pêche, l'agriculture, le commerce.
III-2-1-Pêche
La pêche constitue la principale activité de
subsistance et de revenu pour les populations de Nziou. Elle est un secteur
bien organisé et fait intervenir une multitude d'acteurs. Dans ce
sillage, la pêche en mer est une activité pratiquée
uniquement par les hommes. Au niveau de la transformation des produits
halieutiques, les femmes béninoises et camerounaises assurent pleinement
le fumage des cargaisons de pêche.
III-2-2-Agriculture
L'agriculture occupe une place non négligeable dans le
quotidien des populations du village Nziou. Ces dernières pratiquent
pour la majorité, une agriculture de subsistance et les produits
généralement cultivés sont constitués du manioc et
du maïs en petite quantité. Les excédents de leurs
productions sont destinés à la commercialisation.
III-2-3-commerce
Les activités commerciales occupent une infirme partie
du temps des populations. Les produits de pêche sont
commercialisés sur place et ou dans les marchés environnements.
En l'absence d'un jour d'écoulement spécifique des marchandises
dans le village, le poisson fumé est vendu au niveau de chaque
ménage, dans les marchés du centre ville de Kribi, d' HEVECAM et
de la SOCAPALM. Les grossistes achètent aussi du poisson qu'ils partent
livrer dans les grandes agglomérations que sont Edéa, Douala et
Yaoundé. La détention des débits de poisson et des
boutiques vient diversifier les sources de revenus des populations.
Les données recueillies sur nos sites d'étude
nous ont permis de situer les villages Nziou et Londji I dans l'arrondissement
de Kribi II. Nous avons de ce fait présenté le mode de vie des
populations, leurs principales activités de subsistance, leur mode de
croyance, quelques unes des connaissances dont elles s'en servent au quotidien,
leur vie socioculturelle, etc. Une fois cette étape franchie, la
préoccupation du chapitre suivant sera d'examiner l'état
d'avancement des connaissances relatives à notre thème de
recherche, la présentation du cadre théorique et la
définition des concepts clés de notre sujet.

30
CHAPITRE II:
REVUE DE LA LITTERATURE, CADRE THEORIQUE ET DEFINITION
DES CONCEPTS
L'étude à laquelle nous nous sommes
engagés, exige de faire des recherches sur la littérature
écrite et orale afin de prendre connaissance de l'actualité sur
l'activité de pêche, les techniques employées et les
théories explicatives. Dans ce sillage, nous présenterons tour
à tour une brève revue de la littérature, le cadre
théorique et la définition de quelques concepts clés de
notre sujet.
A-REVUE DE LA LITTERATURE
La recherche documentaire apparaît indispensable et
fondamentale à tout travail de recherche qui se veut scientifique. En
fait, elle est une étape qui permet au chercheur d'avoir une vue
panoramique sur sa problématique afin de mieux orienter son travail.
I-GENERALITE SUR LA PECHE AU CAMEROUN
I-1-Domaines de pêche
La pêche constitue une activité
économique de grande importance dans le quotidien des populations des
localités propices en ressources halieutiques. Elle est une
filière très ancienne et plusieurs contraintes qui lui sont
liées, ont toujours constitué à travers l'histoire une
source d'inspiration et de questionnement aux acteurs. Selon BOUBA M. (1985) et
EFUET AKOA C. (2004), les origines de la pêche se confondent avec celles
de l'humanité où les communautés humaines se soient
installées à proximité de lthydrosphère (sur le
rivage, dans des habitations lacustres, ou sur des embarcations permanentes).
Elles en tirent de l'eau, l'élément indispensable à la vie
mais aussi et surtout de la nourriture. Les meilleures preuves de l'importance
de la pêche pour l'homme préhistorique sont les
«débris de cuisine», ou «Kjoekkenmoeddinger»,
trouvés près de la Scandinavie en Mauritanie, tout le long du
littoral, et qui représentent d'importantes accumulations de
déchets à l'instar des coquilles, os, arêtes, etc. Au
Cameroun, la pêche est une activité subdivisée en deux
grandes entités à savoir, la pêche maritime et la
pêche continentale. La pêche maritime est celle qui s'effectue dans
les mers et les océans tandis que la pêche continentale prend en
compte toutes les autres formes de pêche différentes de celles
citées plus haut. Elle est opérationnelle dans les
rivières, les fleuves, les lacs, les ruisseaux. (VIBERT et
31
LANGLER, 1961). Au Cameroun, les eaux continentales, à
leur niveau annuel moyen, présentent une surface totale estimée
à 35000 Km2 soit environ 7,4% du territoire national. La
répartition approximative est la suivante: Plaines d'inondation et
marais 86%; lacs naturels 4%; retenues de barrages 7%; fleuves 3 %.
Ces données apportent des éclaircis
intéressants quant à la genèse de l'activité de
pêche et les divers espaces opérationnels et dignes
d'intérêt pour le Cameroun d'une manière
générale et pour les populations de pêcheurs en
particulier. Cependant, les connaissances sur les espèces de poissons
disponibles en ces lieux ainsi que les savoir-faire et techniques
utilisés par les acteurs de pêche seraient nécessaires pour
une maîtrise de la place des ressources halieutiques dans le quotidien
des populations.
I-2- Importance de la pêche au Cameroun
La pêche est un secteur important et vital pour les
populations camerounaises du point de vue alimentaire et
socio-économique (NGOK E. et al, 2005; BELAL E. et BABA M., 2006). Sur
le plan alimentaire, le poisson est la source de protéines la plus
accessible aux populations camerounaises. En effet, les produits de pêche
contribuent pour 25,5% environ des apports en protéines dans
l'alimentation des populations. La consommation moyenne de poisson par
tête et par an est de 17,9 kg contre 13,07 Kg/habitant pour la viande. Du
point de vue social, la pêche artisanale relève exclusivement du
ressort des populations rurales, elle procure des emplois directs dans la
capture et indirects dans les activités connexes. A titre d'exemple,
250000 emplois environ avaient été crées en 2003 dont
65000 dans la pêche et 185000 dans les activités qui lui sont
liées. Près de 62,5% de cet effectif étant issu de la
pêche artisanale. Du point de vue économique, la pêche
contribue à la création des richesses à travers la
commercialisation des matériels de déplacements ainsi que des
équipements de pêche et de conservation du poisson.
Activités
|
Production effective/an (en tonne)
|
Pêche artisanale maritime
|
35000
|
Pêche industrielle maritime
|
15000
|
Pêche continentale
|
60000
|
Importation
|
70000
|
TOTAL
|
180000
|
|
Tableau 4: Production annuelle de poisson au
Cameroun. Source : MBILI O. (1999).
Ces différentes études nous renseignent sur les
opportunités qu'offrent les eaux aux pêcheurs en détaillant
la répartition spatiale de quelques ressources halieutiques. Cependant
leurs
32
I-3- Principales espèces ciblées et espaces
de pêche
Dans les différents secteurs de pêche au
Cameroun, il existe une multitude d'espèces de poissons suscitant
l'intérêt des pêcheurs. Parmi ces ressources, les plus
fréquemment capturées sont entre autre les poissons chats
(Clarias), les Silures (Hétérobranchus),
Heterotis, Clariidae (Alestes, Hydrocynus),
Cichlidae (Tilapia,Hemichromis), Barbus
(Labeo), Synodontus, Lates, Mormyrus,
Gymnarchus etc (MINEPDED, 2008). Au niveau de l'identification de ces
ressources, relevons que l'écologie des principales espèces de
poissons, des crevettes et autres crustacés exploités dans la
zone côtière et marine du Cameroun a été
décrite par CROSNIER (1964). De cette immense oeuvre, il ressort que,
plusieurs types sont exploités au rang desquels: le Palaemon
hastatus représentant 16%, les pélagiques 63%, les
démersaux 19% et les penaedés 2% des exploitations. Ces
différentes espèces de poissons en fonction de leurs
spécificités se recrutent dans les secteurs particuliers des
eaux, comme nous révèle le tableau ci-après:
Tableau 5 : Principales ressources halieutiques
marines exploitées au Cameroun. Source : MINEPDED
(2008).
Poisson
|
Ecologie
|
Nature de l'habitat
|
Pseudotolithus typus(bar) P.
Senegalensis(bar)
|
Eaux marines de surfaces
chaudes et légèrement salées.
|
Boueux, sableux et rocheux.
|
Galeoides decadactylus Pteroscionpeli
Brachydeuterus auritus
|
Eaux d'estuaire
|
Boueux sableux jusqu'à 50 m
|
Pseudotolithus elongatus(bar) Arius spp
|
Eaux côtières
|
Sable boueux jusqu'à 150m
|
Depane africana ; pentanemus quinquarius.
|
Eaux côtières
|
Boue sableuse 20-50m
|
Dentex angolensis; D.congolensis
|
Sous la thermocline, eau
froide et salée
|
Roche sableuse 40-50m
|
Lutjanus dentatus ; L.goreensis
|
Base de la thermocline.
|
Fond rocheux
|
Cynoglossus spp
|
Zone de la thermocline
|
Boue sableuse.
|
|
33
auteurs n'ont pas exploré de manière
spécifique les techniques mises en oeuvre pour procéder à
leur identification et leur capture.
II-TECHNIQUES ET MATERIELS DE PECHE ET DE
TRANSFORMATION DU POISSON UTILISES DANS LES PECHERIES CAMEROUNAISES
II-1-Techniques de pêche
Dans les pêcheries camerounaises, plusieurs types de
pêche sont employés (NJIFONJOU, D. et al., 1995; MINEPIA,1996;
FAO,2007). Parmi ces méthodes, nous avons:
4 La pêche au filet maillant de fond ciblant les
espèces démersales en majorité de la famille des
Scianidae, des Aridae, de Polynemidae etc...;
4 La pêche au filet maillant encerclant de surface qui
cible en général l'ethmalose (Ethmalosa fimbriata);
4 La pêche à la senne tournante qui
débarque principalement l'ethmalose et accessoirement la sardinelle
(Sardinella maderensis) et le bossu (Pseudotolithus
elongatus);
4 La pêche au filet maillant de surface
spécialisée pour la pêche des espèces
pélagiques: l'ethmalose et la sardinelle (Illisha africana),
Ethmalosa fimribiala et S. madoensii;
4 La pêche au filet à crevettes
(Nematopalaemon hastatus);
4 La pêche à la senne de plage est un peu moins
utilisée. Les espèces prises sont diverses avec une
prédominance de Carangidae et de Scombridae.
Au niveau de la spécialisation des acteurs de
pêche, MBANGO'O P. (1998) présente une typologie des
méthodes de pêche chez les Badjoue dans la
périphérie nord de la réserve du Dja qui se décline
en techniques masculines, féminines et en techniques mixtes. Non loin de
là, MBILI G. (1999) pour sa part fait un diagnostic
socio-économique et technique de la pêche féminine à
Doumo.
II-2-Outils de capture
Au Nord Cameroun, dans le processus d'exploitation des
ressources halieutiques, les acteurs de pêche s'en servent des
éperviers, des filets maillants, des lignes, des nasses qui se
présentent sous deux composantes majeures à savoir: le GOURRA
fait en tiges de graminées diverses (Cymbopogon, Andropogon, etc...) et
la nasse malienne. Ce dernier outil du fait qu'il soit doté de trois
entrées et qui a en retour un rendement nettement supérieur, a
connu une vaste expansion au sein des populations dont la pêche fait
partie des principales activités de subsistance (BABA, M., 1985). Dans
la partie Sud notamment au niveau des pêcheries côtières,
les engins de capture ayant fait leurs preuves dans le temps sont
essentiellement constitués des filets, des hameçons, des nasses,
des paniers, de la canne à pêche. Mais aussi le barrage des cours
d'eau s'opère chaque fois que l'emploi de la palangre est
envisagé. En toute connaissance de
34
cause, ces outils de capture en dehors de leurs
qualités d'attraction amènent les pêcheurs à
l'adoption des mesures techniques d'accompagnement.
II-3-Méthodes de transformation artisanale du
poisson
Parmi les procédés de transformation de poisson
les plus répandus, figure le fumage dont l'émergence remonte
probablement à la préhistoire et qui constitue l'une des plus
anciennes méthodes connues de conservation des produits carnés
après le séchage et le salage. Dans l'Antiquité en effet,
le poisson était réservé aux populations
côtières. Puis, grâce au procédé de fumage, sa
consommation a pu progressivement gagner vers l'intérieur des terres
(KNOCKAERT, C., 1995). Au Cameroun, plusieurs recherches sur les
méthodes traditionnelles de transformation du poisson ont
été menées. Au rang de ces travaux, on peut citer sans
être exhaustif, BABA M., (1985) qui présente les méthodes
de transformation artisanale du poisson d'eau douce dans la parie
septentrionale du Cameroun. Comme techniques employées en effet,
l'auteur a décrit les spécificités du séchage, la
fermentation, le salage, le fumage etc.
Dans la zone humide du pays par contre, une étude
socio-économique sur les fours employés a été
conduite (TEUTSCHER, F. et al., 1995). Parmi les méthodes fumage
décrites, figurent principalement l'emploi des fumoirs banda (ouvert et
fermé), des fours chokors (faits en blocs de ciment, en argiles et/ou en
briques de terre). L'auteur fait aussi une évaluation estimative des
coûts de réalisation et de réparation, de la durée
de vie, des possibilités de manoeuvrabilité et
d'accessibilité. D'une manière générale, la
transformation artisanale du poisson présente un certain nombre
d'avantages à savoir:
4 Qu'elle donne la possibilité aux consommateurs,
notamment ceux qui sont loin des sites de débarquement et des principaux
circuits de distribution de se procurer du poisson.
4 Elle favorise la perte de poids qui intervient au cours du
processus à cause de la déshydratation. Ce qui facilite la
manutention, la distribution et la concentration des substances nutritives.
Ces écrits nous donnent des informations importantes
sur les méthodes de capture et de fumage employées dans
l'activité de pêche, bien que n'étant pas
spécifiques à notre zone d'étude. Cependant, une approche
centrée sur la détermination des origines des différentes
techniques utilisées, les zones spécifiques de leur mise en
oeuvre ainsi que les mécanismes de transmission de ces divers savoirs
entre les générations ou les communautés nous semble
nécessaire pour mieux expliquer la situation de dynamique des techniques
dans un contexte multiculturel.
35
III-COMMUNAUTES DES PECHEURS ET MODE DE GESTION DES
RESSOURCES HALIEUTIQUES AU CAMEROUN
III-1-Organes en charge de la gestion de l'activité
de pêche au Cameroun
Dans l'organisation de l'activité de pêche au
Cameroun, plusieurs institutions ont été mandatées pour
assurer la gestion. Ce sont:
4 Le Ministère de la Recherche Scientifique et de
l'Innovation (MINRESI) qui, à travers la Station
Spécialisée de Recherches Halieutiques et des Sciences Marines de
Limbe (SSRHSM) est chargé de mener des recherches dans le secteur
pêche. Cette station est placée sous la tutelle de l'Institut de
Recherches Agricoles pour le Développement (IRAD).
4 Le Ministère de Transport (MINT), qui à
travers la Direction de la Marine Marchande contrôle toutes les
opérations de navigation et assure l'immatriculation des navires et des
embarcations de pêche.
4 Le Ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEE), dont
l'avis est nécessaire pour la création des étangs
aquacoles.
4 le Ministère de la Défense (MINDEF),
responsable de la surveillance des eaux territoriales.
III-2-Condition d'accès aux ressources
halieutiques
Les ressources halieutiques font partie des ressources
communément appelées ressources communes (VERMARD, Y., 2009).
Elles se caractérisent par la difficulté d'en interdire l'usage
à des acteurs et le fait que leur utilisation par un individu ou un
groupe implique un manque à gagner pour les autres acteurs. Ces
difficultés à gérer les pêcheries ont abondamment
été décrites dans la littérature concernant
l'économie des pêches (GORDON, 1954; SCOTT, 1955; CRUTCHFIELD et
ZELLNER, 1962) ou plus largement la littérature concernant la
tragédie des communaux (HARDIN, 1968, ORSTOM, 1990). D'une
manière synthétique, les causes du déclin des ressources
naturelles (dont la tragédie) tiennent non pas au caractère
commun de ces dernières, mais à leur libre accès
(STEVENSON, 1991; OSTROM, 1999). Dans cette perspective, la gestion de ces
ressources va donc dépendre de la capacité des gestionnaires
à déterminer à l'avance le nombre et la qualité des
exploitants et les possibilités d'exploitation de chacun. Dans les
côtes camerounaises, la capture du poisson est autorisée à
tous les résidents des campements à la seule condition de
s'adapter aux exigences de la législation de l'Etat. Parmi ces
conditions, nous avons ente autre:
36
4 Un permis de pêche
Cette pièce dont doit disposer tout pêcheur, est
valable pour une période d'un an au prix de 3000 FCFA. Il s'obtient
auprès du responsable du centre de pêche des différentes
localités où prévaut ladite activité. Il est
renouvelable tous les ans avant la fin du premier trimestre sous peine de
pénalités. Il s'établit à partir de la photocopie
du permis de conduire de pirogue à moteur et d'une fiche de
renseignement.
4 Un certificat de navigabilité
Le certificat coûte 42000FCFA et il s'obtient
auprès de la marine marchande. Ce papier se renouvelle tous les ans
moyennant une somme de 22000FCFA.
4 Des lois et arrêtés sur les
modalités d'exploitation des ressources halieutiques
Au Cameroun en effet, la gestion de l'activité de
pêche incombe à l'Etat avec la loi n° 94/01 du 20 janvier
1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.
Dans ce sillage, plusieurs décrets et arrêtés ont
été fixés pour mieux réglementer cette
filière dont l'importance n'est plus à démontrer. Il
s'agit notamment de:
-Décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995, fixant
certaines modalités d'application du régime de pêche.
-Arrêté n° 0026/MINEPIA/DIRPEC/SCPIA/SPA du
11 avril 2000 portant interdiction de certains engins de la pêche.
-Arrêté n° 0002/MINEPIA du 01 août
2001 portant modalités de protection des ressources Halieutiques.
A titre d'illustration, voici quelques engins de pêche
interdits sur toute l'étendue du territoire camerounais. Il s'agit entre
autre des:
-sennes de plage;
-filet épervier;
-masse, paniers, filets maillant dont la maille est
inférieure à 40 mm;
- ligne d'hameçons non appâtés;
- barrages à travers le lit d'un cours d'eau.
Ces différentes mesures permettent aux pêcheurs
de participer à l'exploitation des ressources halieutiques en toute
quiétude. Cependant, identifier leur impact sur le degré
d'implication de chacune des communautés de pêcheurs et sur les
possibilités de collaboration et/ou d'échange entre les
différents acteurs constituera une étape importante dans le cadre
du présent travail.
37
III-3-Communautés de pêcheurs dans les
côtes camerounaises
Depuis plusieurs décennies, l'on observe au niveau des
pêcheries camerounaises, des migrations importantes d'étrangers en
provenance de la côte ouest-africaine. Ces derniers sont
constitués en majorité des ressortissants du Nigeria et du
Bénin. L'arrivée massive de ces acteurs a provoqué
d'importantes transformations dans le système d'exploitation des
pêches au Cameroun en général et au niveau des côtes
en particulier. Notamment avec la motorisation des embarcations et l'adoption
de nouveaux engins de déplacement et de nouvelles pratiques de
pêche. L'enquête-cadre et l'étude socio-économique
réalisées sur le littoral camerounais, ont dénombré
24136 pêcheurs appartenant à plusieurs nationalités. Parmi
les divers acteurs exploitant les pêcheries, l'on dénombre, 6847
patrons de pêche et 17289 aide-pêcheurs dont la plus grande partie
est d'origine ouest africaine (NJIFONJOU, D. et al, 1995). De
manière explicite, les pêcheurs recensés sont de
nationalité camerounaise, nigériane, béninoise,
ghanéenne et autres (togolaise, malienne...).
mathématiquement les proportions suivantes:
|
Ces différents ressortissants représentent
|
Nigérians
|
77,89%;
|
Camerounais
|
17,19%;
|
Ghanéens
|
2,63%;
|
Béninois
|
2,16%;
|
Autres
|
0,09%;
|
|
Au niveau des côtes africaines, l'activité de
pêche est en permanence une filière essentiellement dominée
par les pêcheurs étrangers. A cet sujet, plusieurs études
se sont intéressées à l'identification des
éléments à l'origine de la forte migration des
pêcheurs. Parmi les causes majeures, NJIFONJOU D. et al. (1995); SABINOT
C. (2008) révèlent que:
4 L'accès à la ressource peut être source
de discordes entre les communautés. En effet, dans certaines
régions d'Afrique et du Cameroun, il existe de nombreux conflits
relatifs à l'accès aux ressources halieutiques entre diverses
ethnies. Cette situation amène une bonne portion de pêcheurs
à se rendre en aventure dans les espaces où l'accès
à cette catégorie de biens est moins contraignant.
4 La pression démographique matérialisée
par la présence de nombreux pêcheurs dans leur localité
d'origine. Ces derniers pour trouver un mieux être sont obligés de
se déplacer vers d'autres localités plus propices en poissons.
4 Les conditions du marché (à la fois des
intrants c'est-à-dire des équipements et le marché des
extrants c'est-à-dire le poisson). Les migrants se déplacent pour
éviter la concurrence
38
d'une part dans leur région d'origine, pour aller
à la conquête des nouveaux marchés d'autre part.
Ces réflexions nous renseignent sur les facteurs
potentiels de migration dans un secteur d'activité primordial pour les
populations côtières. Elles ignorent par ailleurs la contribution
de ces nouveaux venus dans leurs sociétés d'accueil à
travers la mise en valeur de leur savoir et technique dans le domaine de la
pêche. Pourtant il convient de remarquer que, les migrants en dehors de
leur impact sur le fonctionnement des unités pêche, exercent aussi
une influence significative sur la diffusion de la technologie, le
savoir-faire, les conflits et le développement des villages et
microzones d'installation (CHABOUD, C. et CHARLEDSO, M., 1991, NEISHEIM, I. et
al. ,2006).
IV-GENERALITE SUR LA TRANSMISSION DES CONNAISSANCES
IV-1-Typologie des connaissances
Des multiples recherches sur la connaissance, les
procédures de transmission des savoirs ont été des
domaines explorés par plus d'un auteur. Année après
année, les chercheurs ont émis des avis et théories
multiformes sur les différents aspects sous lesquels peuvent se
présenter les savoirs. De manière opérationnelle, les
auteurs ont établi des catégorisations des savoirs au rang
desquelles, le « savoir oral », le savoir
«bibliographique», le savoir « scolaire
», le « savoir valorisé », le savoir acquis
« par l'expérience », le «secret»
(BRETON, F.,1991); les savoirs acquis par
«non-apprentissage», «apprentissage par
frayage», «se faire une mémoire»
(«j'ai appris à force de voir»), de ceux de
«l'expérience personnelle et privée» (DELBOS,
G. et JORION, P., 1990); le «savoir procédural»
(efficace dans un contexte spécifique), du « savoir conceptuel
» qui permet une certaine flexibilité et adaptabilité
au contexte (BRIL, B.,1991); les «savoirs potentiels» qui
peuvent être sollicités si un besoin se présente, des
«savoirs traditionnels» «principalement relatifs aux
soins de maladies non reconnues par l'Occident», etc.
De tous ces travaux, il convient de remarquer que ces auteurs
dans leur immense majorité ont construit des catégorisations des
savoirs et ont peu abordé de manière explicite les aspects
relatifs aux facteurs de mutation des connaissances. Dans notre contexte
d'étude, les diverses communautés de pêcheurs s'en servent
des procédés de transmission qui leur conviennent en fonction de
la nature des connaissances à acquérir.
IV-2-Mode de transmission des connaissances.
Plusieurs études ont identifié deux modes
essentiels de transmission des connaissances à savoir: la transmission
verticale et la transmission horizontale. La première s'effectue d'une
manière générale de génération en
génération et est souvent interne à la communauté.
Cette dernière s'exerce plutôt au sein du cercle familial:
père vers fils, mère vers fille, grand-père vers
39
petit-fils etc. Selon l'étude de HEWLETT B. et CAVALLI
S. (1986), c'est un «mode de transmission conservateur», car
il assure une évolution lente permettant des variations individuelles.
La transmission horizontale pour sa part se réalise par
«diffusion» entre communautés et entre les
générations au sein d'une communauté. C'est ce mode de
transmission qui est le plus susceptible de provoquer le changement dans une
société ou simplement dans une activité comme celle dont
nous allons étudier. Dans une étude récente, SABINOT C.
(2008) a remarqué qu'au contact des sédentaires et de migrants,
deux types de transmission horizontale se distinguaient très nettement
sur le littoral gabonais: l'une se fait à la rencontre de l'Autre, en se
déplaçant; l'autre se réalise à la venue de
l'Autre, en recevant l'Autre chez soi. Cet Autre peut être une personne
physique, un groupe de personnes, une communauté de pratique dans son
ensemble, un média, etc.
Ces diverses études nous renseignent sur les modes de
recompositions des connaissances entre les individus et communautés. Une
étude spécifique au niveau des communautés de Nziou et de
Londji I nous permettra d'identifier les aspirations des populations en
quête de nouvelles connaissances, les modes de transfert les plus souples
et les potentielles retombées de la modification des techniques dans le
quotidien des populations de pêcheurs.
B-CADRE THEORIQUE
Le cadre théorique renvoie à un ensemble
d'éléments tirés d'une ou de plusieurs théories
dont le souci est de permettre au chercheur d'analyser et d'interpréter
ses données de terrain. Conçu par ce dernier, il est fonction de
la nature du sujet et au type de recherche qu'il mène. C'est dans cette
logique que le présent cadre théorique se doit d'être,
«un construit et non un prêt à penser» MBONJI
E. (2005:15). A cet effet, plusieurs théories ont été
convoquées, il s'agit notamment des théories de l'écologie
culturelle, de l'ethnométhodologie et de l'anthropologie du nouvel
institutionnalisme.
I- L'ETHNOMETHODOLOGIE
I-1-Origine et émergence de la théorie
L'ethnométhodologie est une mouvance théorique
ayant pris forme dans les années 1960 sous l'impulsion de Harold
Garfinkel. Elle vise à décrire et à comprendre comment
«les acteurs sociaux assurent `'l'intelligibilité'',
l'assignabilité (du sens, de la rationalité) de leurs actions
sociales» (QUERE, L., 1985:8) repris par BLANCHET A. et GHIGLIONE J.
(1987:22). Avant de se présenter sous la forme actuelle, plusieurs
auteurs ont travaillé pour l'émergence de cette
théorie.
40
4 ALFRED SCHUTZ
Alfred SCHUTZ a étudié les sciences sociales
à l'Université de Vienne au début du siècle. Avocat
de son état, ce dernier écrit un ouvrage en 1932, une oeuvre sur
la phénoménologie sociale. Il met l'accent dans cette publication
sur le rapport entre l'interaction sociale et les mécanismes
d'attribution des sens. Son regard vise une plus large appréhension des
procédures d'interprétation permanentes qui permettent de donner
un sens à nos actions et à celle des autres. Ses idées ont
joué un rôle important dans la constitution de
l'ethnométhodologie comme théorie explicative des
phénomènes socioculturels. En effet, il a accordé un
intérêt aux aspects peu explorés des cultures humaines
comme les aptitudes des individus à rendre de manière
intelligible leurs actions quotidiennes. Selon SCHUTZ, « le langage de
tous les jours recèle un trésor de types et de
caractéristiques pré-constituées, d'essence sociale, qui
abritent des contenus inexplorés » (COULON, A., 1987:8), dont le
chercheur est appelé à décrypter.
4 HAROLD GARFINKEL
Harold Garfinkel est né en 1917 et a été
enseignant à l'université de Californie à Los Angeles.
Auteur d'une thèse à Harvard, sous la direction de Talcott
Parsons en 1952. Avec ce dernier, l'ethnométhodologie se veut être
une critique des méthodes de la sociologie conventionnelle. A cet effet,
il ne s'agit plus d'étudier, comme Durkheim, des faits sociaux comme des
choses, mais d'étudier les raisonnements pratiques et le «sens
commun», qui permettent à l'individu de décrypter et
d'ordonner le monde qui l'entoure. On sait que pour Durkheim les faits sociaux
s'imposent aux individus comme une réalité objective, ce qui
permet d'établir des lois sociales. Mais pour Garfinkel, il faut
appréhender cette réalité objective comme une
réalisation pratique continue de chaque société,
procédant uniquement et entièrement, toujours et partout, du
travail des membres, une réalisation naturellement organisée et
naturellement descriptible, produite localement et de manière
endogène.
La production d'un monde social stable, ordonné ne
laisse pas indifférent Garfinkel dans sa démarche
d'interprétation des faits. Il pense en effet que, l'ordre social est
une production. Il est un accomplissement méthodique en ce sens, qu'elle
est orientée vers la tâche d'apprendre de quelle façon les
activités ordinaires réelles des membres d'un groupe consistent
en des méthodes pour rendre les actions pratiques, les circonstances
pratiques, la connaissance du sens commun des structures sociales et les
raisonnements sociologiques pratiques, analysables . Autrement dit, quels sont
les raisonnements pratiques qui sont mis en oeuvre en permanence par les
individus pour vivre dans le monde social ?
Cette théorie intéresse l'anthropologie du fait
de son souci de prise en compte du sens commun dans les explications. Elle peut
de ce fait être interprétée comme la valorisation des
41
savoirs endogènes. C'est à ce titre qu'est
survenue la notion «d'idiots culturels» lorsque les pionniers
affirment que les acteurs sociaux ne sont pas des «Monsieur Jourdain»
pour reprendre MBONJI E. (2005:24); c'est-à-dire que n'étant pas
ignorant de sa culture, chaque acteur ou participant est en mesure de donner
une explication à ses actes ainsi qu'à toute situation
sociale.
Comme toute théorie explicative des
réalités sociales, l'ethnométhodologie dispose d'un
certain nombre de notions phares constituant sa base d'interprétation.
Parmi ces concepts figurent: la notion de membre qui stipule que tout chercheur
doit devenir membre du groupe étudié afin d'avoir une
compréhension intime de ce qui se passe grâce à certaines
méthodes, la manière dont le sens est construit.
L'indexicalité utilisée pour interpeller le chercheur sur la
nécessité de ne saisir le sens ou la signification d'un
phénomène, qu'en le rattachant à son contexte. La
réflexivité vise à l'appréhension d'un
phénomène social en référence aux normes en vigueur
dans la culture des participants à cet évènement. Dans ce
travail, le concept qui sera utilisé dans l'interprétation est
celui des ethno-méthodes.
I-2-Implication des ethno-méthodes dans cette
recherche
Elles renvoient à un ensemble de processus que les
membres d'un groupe, d'une communauté utilisent pour mener à bien
leurs actions pratiques. Selon Garfinkel reprit par MBONJI E. (2005:24), dans
la vie de tous les jours, les membres de tout groupe ont des
«méthodes» ordinaires pour définir leurs situations,
coordonner leurs activités, prendre des décisions, se servent de
leurs connaissances de l'organisation sociale ou de leur environnement pour
exhiber les conduites régulières, typiques. Dans cette
étude, les ethno-méthodes nous ont permis d'identifier les
stratégies ou procédures de mise en scène de la
spécificité des technologies employées par les
différentes communautés de pêcheurs de Nziou et de Londji I
tant dans la capture que dans la conservation des produits halieutiques. Etant
situé dans un contexte de cohabitation de plusieurs cultures, nous avons
aussi essayé de comprendre quelle importance et intelligibilité
accorde chacune des groupes de pêcheurs à ses propres techniques,
aux techniques introduites et enfin au changement des savoirs. Bref comment les
différentes techniques employées sont elles utilisées par
les acteurs de pêche pour relever les défis quotidiens de leur
activité de subsistance.
II- LA NOUVELLE ANTHROPOLOGIE INSTITUTIONNELLE
II-1-Fondement de la théorie
Cette théorie se préoccupe de l'analyse des
changements institutionnels qui influencent la gestion des ressources de
propriété collective. L'institution étant entendue comme
un ensemble de règles durables, stables, abstraites et impersonnelles,
cristallisées dans des lois, des traditions ou des coutumes et
encastrées dans des dispositifs qui implantent et mettent en oeuvre, par
le
42
consentement et/ou la contrainte, des modes d'organisation
des transactions (MENARD, C., 2003). Les théories institutionnelles sont
issues de l'histoire économique, des sciences politiques et de
l'ethnologie, regroupées sous le concept de
Néo-institutionnalisme. Plusieurs auteurs ont travaillé sur les
questions des institutions parmi lesquels HARDIN G. (1968), RUTTAN L. (1998),
ENSMINGER J. (1992;1998). Ces théories étudient les modes de
création de telles institutions et les influencent qu'elles exercent sur
l'action économique. Les approches de ces auteurs ont ceci de
particulier qu'elles considèrent les institutions comme les
règles du jeu sociales ou des contraintes formelles ou informelles qui
régissent l'interaction entre les hommes. Les auteurs de la
théorie de l'anthropologie du nouvel institutionnalisme soutiennent que
la société crée des lois ou les institutions selon leur
comportement et, en retour, ces institutions influencent le comportement
individuel. Pour cerner les changements institutionnels, il est
nécessaire de les aborder sous l'angle de la motivation individuelle des
acteurs et celui des contraintes et incitations qui influencent les aspirations
des membres de la société (ENSMINGER, J., 1992). Pour cet auteur
en effet, il existe une interaction dans le secteur endogène dans lequel
évoluent les individus entre institutions, idéologie,
organisation et pouvoir de négociation. Ces quatre secteurs subissent
des influences mutuelles, mais ils sont également soumis à des
changements provenant du secteur exogène. Plusieurs
éléments figurent dans le secteur exogène parmi lesquels:
l'environnement physique et social, la population et la technologie qui
déterminent et modifient les prix relatifs. La modification du prix
relatif renvoie aux changements intervenus dans les conditions
environnementales, économiques et politiques (infrastructures, moyens de
production, système de commercialisation). Ce qui peut conduire à
l'émergence d'un esprit de concurrence et surtout d'un souci de
renouvellement des stratégies afin d'accéder le plus
aisément possible aux ressources.
II-2-Pertinence du concept emprunté pour notre
étude
Dans cette étude, l'analyse de la modification des
prix relatifs a été utile à plus d'un titre. En fait, ces
changements nous ont permis de comprendre leur incidence sur la participation
des différents acteurs. En effet, il convient de rappeler que par le
passé, les populations pour se déplacer dans les eaux n'avaient
guère besoin de disposer des pièces officielles aussi
coûteux comme c'est le cas sur le terrain. Il en est de même pour
ce qui est des engins de pêche et de déplacements en mer dont les
prix d'achat étaient relativement abordables. Dans ce contexte, les
changements des prix relatifs peuvent jouer deux rôles majeurs à
savoir: un simulant pour une participation plus active et/ou un outil de
découragement. A cet effet, la forte monétarisation en vigueur
dans la filière pêche, peut entériner la suprématie
des acteurs plus assis financièrement, car, disposant des moyens
à mêmes de leur permettre de s'acquitter des documents
légaux, mais
43
aussi et surtout de s'octroyer les matériels de
pêche les plus `'performants». En même temps, les
dépenses une fois engagées peuvent aussi constituer une sorte de
motivation supplémentaire de travail assidu pour les acteurs afin de
recouvrir dans un temps raisonnable les fonds investis.
III-L'ECOLOGIE CULTURELLE
III-1-Emergence de la théorie
L'écologie générale peut être
définie comme l'étude des rapports entre une ou des populations
d'êtres vivants à la fois entre elles et avec un milieu
donné. L'écologie culturelle se présente de son
côté comme l'étude des relations entre une ou des
populations humaines, le milieu physique qu'elle(s) habite (nt) et la (ou les)
culture(s) qui en résulte (nt) (SUTTON, 2004:2). C'est l'étude
des voies par lesquelles la culture est utilisée par les
communautés pour s'adapter à un environnement. Elle est aussi
«l'étude des dynamiques, du comportement humain actif dans le
contexte d'un environnement changeant, des interconnexions parmi les
composantes dynamiques de notre système» (JOCHIM, M., 1981)
repris par SHAHBENDERIAN L. (2009:10). Cette théorie est construite
autour de la notion d'adaptation. L'adaptation culturelle de l'homme à
un environnement donné représente une solution plus fonctionnelle
et surtout beaucoup plus rapide que la mutation génétique, qui
est le mécanisme essentiel de réponse dans les rapports entre les
populations animales et leur milieu.
Elle présente plusieurs modèles explicatifs des
situations d'adaptation des hommes aux conditions écologiques. Au rang
de ces derniers, figurent entre autre: le déterminisme
anthropo-géographique qui peut être illustré à
travers la pensée de F. Ratzel pour qui l'être vivant doit
être envisagé comme le produit de son environnement. Le
modèle de l'écologique de «niche», qui postule que
l'environnement d'un groupe ethnique particulier est défini par le
milieu naturel, mais également par les activités
pratiquées par d'autres groupes. Il permet de comprendre le rôle
des facteurs écologiques dans la distribution des différents
groupes, cultures, et économies et d'expliquer la cohabitation de
plusieurs groupes culturellement différents, de manière
détaillée. Et le modèle de la dynamique adaptative
focalisé sur les intensions et les motivations de chaque acteur social
dans sa stratégie de renouvellement des compétences.
III-2-Modèle choisi et son implication dans notre
travail
L'approche des dynamiques adaptatives se distingue à
deux niveaux: Au premier stade, elle se décline aux «actions by
individuals designed to accomplish ends or effect change in the instrumental
context of life» (BENNETT, W., 2005:270) à l'image des actions
d'un paysan essayant d'augmenter ses rendements, les habitudes de consommation,
ou les techniques d'accumulation de richesses. Au second niveau, elle:
«consist of interactive or transactional behaviour of individuals with
other individuals in groups, often called social exchange, usually
44
governed by rules of reciprocity and by various normative
value components» (BENNETT, W., 2005:270). Cette conduite
transactionnelle peut être adoptée afin d'accomplir un but
précis, créer un environnement favorable pour une meilleure
capitalisation dans l'activité que mènent les personnes
impliquées.
Le recours au modèle de la dynamique adaptative nous a
amené dans ce travail, à cerner les raisons et les
finalités de l'intégration des nouvelles techniques de
pêche et de conservation du poisson par les différents acteurs de
la filière. En d'autres termes, comment à travers les changements
des techniques de pêche et de conservation, les populations des villages
Nziou et Londji I, répondent-elles aux défis de carence des
ressources halieutiques et de compétition entre les différents
acteurs. Nous avons en ce sens mis un accent sur les facilités
d'acquisition des savoirs offertes par la cohabitation, mais aussi sur le
côté dynamique ou état d'éveil de chacune des
communautés de pêcheurs engagée dans la quête des
nouvelles connaissances.
C-DEFINITIONS DES CONCEPTS
Pour mener à terme cette étude, certains
concepts méritent d'être définis au préalable. Il
s'agit notamment de: analyse anthropologique, choix, conservation,
finalité, pêche, savoir-faire, etc.
1-Analyse anthropologique
Dans un contexte de recherche en sciences sociales, l'analyse
renvoie au processus devant conduire à l'extirpation du sens à
partir des données de terrain. Etant donné que nous menons une
étude en anthropologie, notre méthode d'analyse est celle
préconisée dans ce champ de recherche; car chaque discipline
scientifique a sa démarche analytique qui lui est propre. A cet effet,
notre point d'ancrage est de découvrir les perspectives culturelles des
connaissances des pêcheurs.
2-Choix
Il correspond à l'action de choisir, de
sélectionner, de manifester un intérêt particulier pour ou
sur quelque chose. Au cours de cette étude, il a été
question pour nous d'identifier les facteurs et raisons qui sous-tendent les
préférences des populations en matière des techniques de
pêche et de conservation des ressources halieutiques.
45
3-Conservation
La conservation est un processus de transformation des
aliments permettant de les stocker plus longtemps (BRIGITTE, M. et al 2005:6).
Les techniques de conservation renvoient à toutes les connaissances
construites et adoptées par les populations afin de réduire les
pertes, faciliter le transport et assurer la disponibilité permanente
d'une ressource. En d'autres termes, elle renvoie à un ensemble de
procédés servant à prolonger naturellement ou
artificiellement le rythme de dégradation des denrées
périssables. L'exploitation des ressources halieutiques étant au
centre de cette étude, la conservation du poisson par la
congélation et le fumage constitueront notre centre
d'intérêt.
4-Finalité
Elle revoie au but, à l'objectif, à la fin, la
vision, la mission... Il sera question pour nous d'explorer les attentes et
buts visés par les différentes techniques utilisées par
les populations de pêcheurs de Nziou et de Londji I.
5-Pêche
Elle signifie action de pêcher, c'est-à-dire
procéder à la capture des ressources halieutiques. D'une
manière générale, cette activité n'est possible
qu'à travers la détention d'un certain nombre de
paramètres au rang desquels: la technique, les matériels de
pêche et les modalités de leur emploi. La pêche en dehors de
l'action d'exploiter les ressources halieutiques qui lui est imputée,
inclut l'ensemble des mesures, stratégies, pratiques et méthodes
utilisées par les acteurs de la filière pour maximiser leurs
efforts. La pêche dans un sens large renvoie à tout savoir et
expérience que mobilisent les acteurs de la filière afin
d'assurer une bonne opération de capture du poisson. Parmi ceux-ci, nous
pouvons mentionner: les connaissances théoriques et pratiques sur les
captures, le comportement des ressources halieutiques ainsi que le
matériel utilisé à chacune des étapes. Elle inclura
dans notre travail les connaissances utilisées dans l'activité de
pêche ainsi que leurs modes de dissémination au sein des
communautés.
6-Savoir-faire
De prime à bord, le savoir renvoie à un
ensemble de connaissances. Par ailleurs, les savoirs composent une culture,
caractérisent l'individu, et concourent à se réclamer d'un
groupe humain (SABINOT, C., 2008 :5). Le savoir-faire pour sa part, se
résume en habileté, en compétence des personnes ou groupes
de personnes. Il englobe dans notre étude, l'ensemble des
46
techniques, des compétences, des outils dont les
acteurs de pêche s'en servent au quotidien afin de maximiser les captures
et d'assurer une transformation rapide et harmonieux du poisson.
Dans le cadre de ce chapitre qui s'achève, nous avons
consulté un certain nombre d'ouvrages dont la quintessence a
porté sur les connaissances générales relatives à
la pêche au Cameroun, son importance dans le quotidien des populations.
Ensuite une présentation des théories explicatives et la
définition de quelques concepts sont venues clôturer cette partie
du travail. Nous présenterons dans la prochaine articulation ce qui fait
la marque distinctive des connaissances endogènes utilisées dans
l'activité de pêche.
47

CHAPITRE III:
CARACTEISTIQUES DES TECHNIQUES ENDOGENES DE CAPTURE
ET DE CONSERVATION DES PRODUITS DE PECHE ET LEUR MODE D'ACQUISITION DANS LES
VILLAGES NZIOU ET LONDJI I
Les populations côtières dans leurs
activités quotidiennes, mettent sur pieds un ensemble de connaissances
qui leur permettent d'exploiter judicieusement les ressources disponibles dans
leur environnement. Ainsi, dans l'activité de pêche, ces
dernières ont construit des savoirs relatifs à la capture, la
transformation des produits dérivés et à leur
mécanisme de transmission entre les membres de la communauté.
Nous présenterons dans cette partie du travail, les
caractéristiques des techniques endogènes de pêche et de
conservation du poisson connues au sein des acteurs de pêche de Nziou et
de Londji I ainsi que leurs modes de transfert de ces savoirs entre les
différentes générations.
I-TECHNIQUES DE CAPTURE DU POISSON
Pour exploiter les ressources halieutiques dans les
pêcheries de Nziou et de Londji I, plusieurs techniques ont
été mises sur pied par les populations. Parmi ces
méthodes, nous avons entre autres: la pêche à la canne, la
pêche à la ligne, le `'tirez-tirez» ou senne de plage, la
pêche à la palangre... Chacune de ces stratégies de
pêche a ses caractéristiques, ses exigences tant au niveau de la
main-d'oeuvre qu'au niveau des ressources matérielles et
financières à mobiliser.
I-1-La pêche à la canne
La pêche à la canne est une technique de capture
ancienne pour les populations de Nziou et de Londji I. Cette méthode est
et a été dans le temps, une connaissance de transition en ce sens
qu'elle constitue la première étape dans l'acquisition des
savoirs dans le domaine de la pêche. Pour s'approprier les contours de
cette technique de pêche, les parents initient leurs enfants de sexe
masculin à travers un processus structuré en deux phases à
savoir, le montage à domicile suivi de son expérimentation au
bord des eaux. Au niveau du montage, l'accent est mis sur la fixation du
hameçon, la taille normale du fil à utiliser, la qualité
du fil, le mode de confection du flotteur et de son positionnement
stratégique sur le fil, etc.
48

Photo 8: Le chercheur reçoit les
explications sur la canne à pêche. Source :
Mvetumbo (Nziou, 2013)
Dans la phase expérimentale, le parent ou
l'aîné détenteur de la technique, donne les indications sur
le positionnement stratégique de l'outil en mer ou dans les cours d'eau.
C'est cet ensemble de consignes qui permettra au futur pêcheur d'exercer
en toute ingéniosité, une influence attractive sur les poissons
en mouvement. Pour mieux cerner le mode de fonctionnement escompté,
suivons cette description faite par un informateur du village Nziou:
Lorsqu'on met la canne à pêche dans l'eau,
on dit à l'enfant comment la tenir. Parce que l'hameçon ne doit
pas toucher le fond de l'eau. Il doit être un peu en suspension. Parce
que là-bas au fond, il y a du sable et les ordures qui peuvent accrocher
l'hameçon et tu peux croire que c'est le poisson. L'hameçon doit
rester un peu en haut pour suivre les mouvements des vagues. Maintenant, quand
il est en train de chercher la nourriture, il va suivre le mouvement de
l'hameçon et finir par l'avaler (MESSI JILES, Pêcheur, Mabi,
Nziou, le 22/01/2011).
Bien qu'étant généralement perçue
comme une technique réservée aux débutants dans le
métier, la pêche à la canne est utilisée par
plusieurs adultes à coeur joie et ceci pour une diversité de
raisons. En effet, en dehors du facteur coût d'acquisition qui est
relativement bas, elle constitue une technique qui favorise le loisir, mais
aussi qui donne l'opportunité aux riverains de contourner les
contraintes et risques de la pêche en haute mer. Aussi, elle est
très sélective en ce sens qu'elle favorise la capture
individuelle du poisson, étant donné que les espèces
ciblées sont celles correspondantes au type du hameçon
employé. Les pêcheurs peuvent de ce fait capturer les poissons
tels que le bar au niveau de la mer ainsi que le silure que l'on retrouve dans
les cours d'eau et rivières. La durée d'une opération de
pêche à la canne s'étend de quelques secondes à
plusieurs dizaines de minutes. Tout étant fonction de la
disponibilité du poisson dans la zone
49
choisie pour l'opération et de l'expérience du
pêcheur. Elle est une technique applicable en toute saison. Par contre,
les pêcheurs regrettent tout simplement sa faible productivité.
I-2-La pêche à la ligne
La pêche à la ligne est une technique de
pêche bien ancrée dans le quotidien des populations de Nziou et de
Londji I. Ce matériel est historiquement le plus connu et répandu
chez les pêcheurs côtiers et particulièrement les Batanga
(MONOD, T. ,1928:180). Communément désigné sous le nom
d'«ébâna» en langue batanga, il est une ligne
constituée d'une ficelle faite de 4 à 5 fibres, enroulée
autour d'un morceau de bois et dont l'une des extrémités porte un
(ou les) hameçon(s). Le choix de la ficelle est conditionné par
la nature de la ressource visée. C'est pourquoi, les pêcheurs
distinguent deux catégories d'«ébâna»
dont la différence se trouve au niveau de la taille de la corde comme
nous pouvons découvrir sur les photos ci-dessous.

Photo 9: Instrument de pêche à la
ligne conçu Photo10: Matériel de capture
à la ligne conçu avec
avec une grosse ficelle. une petite ficelle.
Source : Mvetumbo(Nziou, 2011) Source
: Mvetumbo(Nziou,2011)
De manière opérationnelle, la pêche
à la ligne peut se dérouler de deux manières en fonction
de l'option préconisée par le pêcheur. Au niveau des
bordures des cours d'eau, le spécialiste
d'«ébâna», après avoir fixé
l'appât adapté sur le hameçon, peut se déplacer
à l'aide d'une pirogue pour déposer son matériel dans les
profondeurs de l'eau. En suivant une autre procédure, le pêcheur
en pleine mer, place sa ligne dans l'eau pour ne rester qu'avec le noeud au
bord de son embarcation. Dans les deux cas, le pêcheur peut, après
quelques heures d'attente, procéder au retrait de sa ligne afin
d'évaluer les quantités de poissons capturées. Pour les
spécialistes de cette méthode de pêche, la durée de
pratique est considérablement réduite. C'est une technique
applicable en toute saison, en suivant un temps relativement court (entre 1
à 3 heures de temps). Mais aussi, elle peut être utilisée
dans le cadre de la pêche dormante. A cet
50
effet, le piège est tendu en soirée par le
pêcheur qui sera appelé à le revisiter le lendemain matin.
La pêche à l'«ébâna» favorise la
capture de la carpe rouge et du bar. Cette méthode de capture constitue
pour bon nombre de pêcheurs, une technique qui favorise la
sélectivité ceci au regard du caractère discriminatoire
des hameçons qu'elle porte; car chaque unité de capture de cet
outil de pêche a ses espèces de poissons ciblées. Seulement
au niveau du rendement, MONOD T. (1928 :182) estime que la faiblesse des lignes
au même titre que la petite taille des hameçons ne permettent de
pêcher que des pièces de petite taille, tandis que les poissons un
peu vigoureux parfois cassent l'engin de pêche.
I-3-La pêche à la palangre
La palangre est communément désignée
sous les noms de «Sambi» et «teli» en
langue Mabi. Les deux dénominations prises par cette technique de
pêche correspondent aux diverses formes possibles sous lesquelles peut se
présenter l'instrument employé dans la capture. Pour ce qui est
du «teli», notons qu'il est constitué d'une corde
dont un hameçon est fixé sur l'une de ses
extrémités et offre la possibilité de capturer un seul
poisson au cours d'une opération. Ainsi, pour multiplier les
opportunités de capture, ces derniers tendent fréquemment une
multitude de pièges le long du cours d'eau où se déroule
l'opération. La durée de chaque séance est variable en
fonction de la disponibilité du pêcheur et de l'expérience
qu'il peut avoir sur les potentielles zones propices en ressources
halieutiques.
Le «Sambi» pour sa part est fait d'une
série de hameçons alignés sur une longue corde (ou fil),
la longueur pouvant aller à plus de 1000 m. Entre la longue corde
maillon essentiel du circuit, se succèdent les petits fils de 30
à 50 cm dont l'une des extrémités porte le hameçon.
La fixation des hameçons suit deux modalités essentielles. Dans
un premier cas de figure, les hameçons peuvent être placés
à 1,5 m l'un de l'autre et d'un bout de corde à l'autre. Dans une
seconde perspective, le pêcheur peut aussi dans un souci de
multiplication des possibilités d'attraction, choisir l'option d'aligner
une série d'hameçons aux mêmes endroits tout en gardant les
écarts similaires.
51

Photo11: Présentation d'une palangre en
refection. Source: Mvetumbo(Nziou, 2010).
Cette seconde option a cet avantage que lorsque le poisson en
mouvement frôle un hameçon, il lui est difficile de
s'échapper car, la pression des vagues au côté de la
multiplicité des pièges dont rencontre le poisson, facilite sa
capture. Pour ce qui du choix du type des cordes, il convient de
reconnaître qu'il est fonction du lieu où sera pratiquée la
pêche ainsi que de la taille probable des ressources recherchées
comme en témoignent les propos de cet informateur:
«Pour pêcher dans les cours d'eaux, nous
utilisons le palan monté avec le petit fil du fait que, nous capturons
d'habitude des petits machoirons entre 5 et 10 kg maximum. Mais s'il faut
pêcher en mer, nous utilisons la grosse corde numéro 4 ce qui peut
supporter le poids des gros machoirons de mer» (NZIEH PASCAL,
Pêcheur, Mabi, Nziou, le 22/12/2010).
Les appâts que portent les hameçons sont
composés des crevettes, du savon (macabo), des crabes, des avaries de
poissons dont le `'bilolo» (Sardinella maderensis)... Ils sont
retenus par les pêcheurs à cause de leur modalité
d'acquisition relativement facile et leur capacité d'attraction sur les
poissons vivants.
Avec la palangre, la mise en oeuvre d'une opération de
pêche s'opère de la manière suivante: le pêcheur
à l'aide de sa pirogue se déplace en mer avec son instrument de
capture constituée d'une suite de hameçons plombés des
appâts rigoureusement sélectionnés. Après avoir
parcouru une distance estimée entre 500m et 1 km, ce dernier
étale la corde à l' horizontale (par rapport aux mouvements des
vagues) dans l'eau avec toute la délicatesse possible; après
quoi, il peut retourner chez lui le temps pour le piège tendu de passer
à l'acte. Ce matériel une foi introduite dans l'eau n'est
reconnaissable par le propriétaire qu'à partir de la couleur et
de la grosseur des flotteurs qu'il a bien voulu utiliser comme identificateur.
Ces instruments sont dans la majorité des cas, fixés sur les
extrémités de la corde servant de support aux pièges. Pour
les pêcheurs, cette technique leur donne l'opportunité de vaquer
à d'autres occupations ou de
52
planifier d'autres opérations de pêche. Cette
méthode est très sélective du fait que le
`'Sambi» est un instrument dont le champ d'action se trouve en
profondeur.
Dans ce contexte, les espèces de surfaces à
l'instar du poisson `'mbounga» (Ethmalosa fimbriata), du
`'bilolo» (Sardinella maderensis) sont d'office exclues, et
seules sont visées les espèces sous marines à l'instar du
bar, de la carpe, de la raie, des machoirons etc... Cette méthode peut
être mise en oeuvre par un ou plusieurs pêcheurs, le plus important
étant la maîtrise des différentes étapes. La
durée d'une opération de pêche à la palangre est
fonction du planning de chaque pêcheur. Certains le placent en
soirée pour le visiter le lendemain matin tandis que d'autres optent
pour des expéditions de courtes durées. Si non, d'une
manière générale le pêcheur peut procéder au
retrait après quatre heures de temps au minimum. En tout état de
cause, le succès d'une opération de pêche à la
palangre, est comme toutes les méthodes de capture fonction de la
capacité de l'acteur principal qu'est le pêcheur, à bien
circonscrire les zones propices en ressources halieutiques, mais du bon
état de son matériel employé.
Par contre, les contraintes les plus visibles et les plus
redoutées de cette technique de capture, restent les blessures qu'elle
peut engendrer lors de son introduction dans l'eau ainsi que du retrait du
poisson capturé. Mais également, le pêcheur court surtout
le risque de se faire entraîner dans l'eau. Pour limiter les
dégâts, il est recommandé dans nos pêcheries
d'étude à toute personne devant effectuer une aventure de
pêche en mer, d'éviter de porter des vêtements à
bouton et/ou à fermeture de peur de se noyer. Selon les explications,
sous le coup de violents vents au large, les mailles des filets ou les
hameçons peuvent aisément s'accrocher sur les boutons ainsi que
la fermeture des habits et dans cette situation, le pêcheur au lieu de
pêcher le poisson se fera pêcher par son instrument de pêche.
Pour ces derniers, cette situation constitue au côté du manque
d'expérience l'une des causes majeures de mortalité chez les
débutants dans l'activité de pêche.
I-3-La pêche à la senne de plage
La pêche à la senne de plage encore
désignée `'tirez-tirez», est une technique de capture qui
consiste à plonger le filet en mer et de le tirer quelques temps
après ; tout ceci en suivant un procédé bien
organisé. Cette méthode de capture du poisson est utilisée
dans les pêcheries de Nziou et de Londji I. Pour sa mise en oeuvre, elle
nécessite la mobilisation des ressources humaines et matérielles
conséquentes.
I-3-1-Ressources humaines
Pour ce qui est des ressources humaines, la pratique du
`'tirez-tirez» nécessite l'engagement d'un nombre important de
personnes. Puisqu' au-delà du propriétaire des matériels
de pêche, huit acteurs en moyenne ayant chacun une bonne
expérience du métier, participent
53
aux différentes étages des opérations de
pêche. Ces pêcheurs se départagent les tâches, en
formant deux équipes de quatre personnes au moins, dont chacune est
chargée de tenir une des cordes portant les deux bouts de filets. La
conjugaison de leurs efforts facilite le retrait du filet de l'eau après
que tous les détails préliminaires aient été
réglés.

Photo 12: Opération du
`'tirez-tirez» par un groupe de pêcheurs de Nziou. Source:
Mvetumbo(Nziou,2011)
Au sein des équipes, les membres se succèdent
à tour de rôle en se plaçant chaque fois devant leurs
collègues afin de donner une nouvelle énergie et assurer de ce
fait la continuité des efforts.
I-3-2-Ressources matérielles
Pour sa mise en oeuvre, le `'tirez-tirez»
nécessite le rassemblement d'un certain nombre de ressources
matérielles. En effet, l'initiateur d'une partie de pêche à
la senne de plage doit disposer d'un filet d'environ 400 m de long et de deux
solides cordes d'environ 200 m chacune. Les grandes dimensions des filets
favorisent la couverture de grandes surfaces et par voie de conséquence
augmentent les opportunités de capture. Les cordes utilisées
servent de liaison entre le filet et le groupe de pêcheurs en attente aux
abords de l'eau. Aussi dans cet exercice, l'emploi d'une pirogue de taille
moyenne pour les opérations préparatoires est indispensable. Elle
permet aux membres de l'équipage de transporter le filet des rives vers
l'intérieur des cours d'eau ou de l'océan afin de l'introduire
stratégiquement une fois que les espaces de pêche soient bien
circonscrits.
I-3-3-Pratique de la pêche à la senne de
plage
Cette technique de pêche s'opère uniquement en
journée et en bordure de l'eau. En période d'abondance, elle
favorise la capture de plusieurs espèces de poisson dont la taille
correspond à
54
la grosseur des mailles des filets utilisés. Selon
KEBE M. et al. (1993:5), les espèces couramment pêchées par
le truchement du tirez-tirez sont les juvéniles de bars, les petits
capitaines, les sardinelles et les ethmaloses. Elle fait partie des techniques
de pêche de rive, collectiviste, expresse et fructueuse. Pour ce qui est
du contexte de la pratique et les différentes étapes d'une partie
de pêche à la senne de plage, un pêcheur Batanga
interrogé sur le sujet nous a donné la description
ci-après:
Le `'tirez-tirez» se fait au bord de la mer [...]
Lorsqu' on veut le pratiquer, on amène tout le matériel au bord
de la mer. Une équipe de deux à trois personnes entre dans la mer
en pirogue pour déposer le filet. Quant elle finit de déposer,
nous attendons quelques heures avant de tirer. Même en trois heures on
peut déjà finir avec la pêche. Avec cette technique, on
capture plusieurs types de poissons comme les carpes, le bar, les capitaines.
(NANGA JEAN, Pêcheur, Batanga, Londji I, le 19 /12 /2010).
Cette technique présente plusieurs avantages au regard
des témoignages de nos informateurs. Au niveau du temps d'exercice, la
durée d'une opération de pêche est d'environ quatre heures,
le temps pour l'équipe d'apprêter le dispositif technique, de
circonscrire la zone propice à la pêche et de procéder
à l'action. Le nombre élevé de participants constitue une
source d'occupation et un lieu d'apprentissage pour les différents
acteurs de pêche impliqués, ceci en fonction des
expériences et des défis qui attendent les uns et les autres.
Cependant, la pêche à la senne de plage demeure très
coûteuse au niveau des moyens financiers à débourser pour
l'acquisition des filets, mais aussi, pour la prise en charge des
participants.
Parmi les techniques de pêche présentées
ci-haut, une remarque frappante se dégage sur les secteurs de leur mise
oeuvre. Elles sont en effet, pratiquées majoritairement au niveau des
rives de la mer ou le long des cours d'eau. Ces méthodes abondamment
utilisées étaient la résultante de l'état de
disponibilité des ressources halieutiques. En effet, par le passé
bien que les aventures en mer fassent partie intégrante du quotidien des
populations côtières, les pêcheurs n'avaient pas besoin de
parcourir de longues distances afin d'attraper du poisson. En plus de cet
état de chose, notons en passant que cette multitude de techniques de
bord permet aux personnes ayant été handicapées par le mal
de mer, l'opportunité de pratiquer la pêche. Cependant, les
populations constatent que ces méthodes de pêche sont de moins en
moins rentables et ne sont opérationnelles dans l'ensemble que dans le
cadre d'une pêche de subsistance. Ce qui peut expliquer leur faible
emploi car, dans un contexte marqué par une réduction
substantielle des ressources halieutiques et une croissance permanente de la
demande du poisson, les acteurs de pêche s'orientent plus vers les
techniques à forts rendements.
55
II-METHODES DE RECONNAISSANCE DE L'ENVIRONNEMENT
MARIN
La relation eau et populations de Nziou et de Londji I
constitue un couple dont leurs liens dynamiques permettent aux pêcheurs
de produire des savoir-faire performants afin d'y tirer le maximum de profit.
Ces connaissances leur donnent l'opportunité de mieux circonscrire les
zones probables de pêche, d'éviter les obstacles et de faciliter
les captures. Pour atteindre cette fin, ces populations ont mis sur pieds des
techniques d'identification basées sur l'observation directe des vagues
et sur l'usage de la pagaie.
II-1-L'Interprétation du mouvement des vagues.
Tout au long de nos entretiens avec les pêcheurs, une
unanimité s'est dégagée sur l'importance des rochers dans
la détermination des zones de pêche en mer. En effet, ces espaces
sont réputés regorger une diversité d'espèces de
poissons à la quête de nourriture. Cette idée est
partagée par tous nos informateurs toute ethnie confondue. Ils
constituent de ce fait des zones privilégiées de pêche et
représentent pour les différents acteurs de pêche, le point
d'atterrissage une fois la direction de la mer prise. Selon leurs explications,
le point de contact entre les vagues qui se matérialise par des jets
d'eau, des bruits (émis par les vagues bien évidemment) leur
servent de point de repère ou de reconnaissance d'un rocher. Ce n'est
qu'à partir de cet instant que le pêcheur peut s'engager dans une
opération de pêche dans un secteur de l'eau avec optimisme comme
nous laisse entendre ce pêcheur: «Lorsqu'on est en mer et qu'on
voit deux vagues qui se rencontrent, ça fait un choc et l'eau monte plus
que sur d'autres endroits. A cet endroit. On peut tendre son filet et
espérer peut être capturé par exemple le bar»
(EKOTONI CLEMENT, Batanga, Pêcheur, Londji I, 19/12/2010). Chacun en
fonction du type de matériel qu'il détient, peut décider
de procéder à une opération immédiate ou de
poursuivre l'exploration.
II-2-L'usage de la pagaie
La pagaie encore désignée
«karpi» en langue batanga, est connue de prime à bord
comme un instrument de propulsion manuelle de la pirogue. Mais au cours des
opérations de pêche, elle permet aussi aux pêcheurs
futés, d'explorer à certains moments particuliers la mer afin
d'identifier la nature du fond marin. Le procédé est le
même que celui du matériel précédent à la
seule différence qu'au delà du son émis et saisissable par
les oreilles, la nature de l'obstacle que rencontre la pagaie une fois
plongée provoque une sensation particulière au niveau des mains
qui la tiennent. En ce sens, le rocher a un état dur, la boue une
tendance à retenir la pagaie tandis que le sable de son
côté reste perméable en présentant un état
glissant.
D'une manière générale, ces
méthodes de lecture à partir des résultats qu'elles
permettent d'obtenir, donnent aux pêcheurs des indications
précises sur la nature du matériel de capture à
56
employer. A ce sujet, SABINOT C. (2008:157) estime par
exemple que l'utilisation du filet nécessite une grande aptitude
à comprendre les variations de l'environnement physique dont les
différents constituants peuvent être le vent, les courants marins,
la consistance des fonds, la présence animale, etc. Inhérents aux
pêcheurs pétris d'expérience, ces talents constituent la
marque distinctive des ces acteurs et leur permettent d'avoir une bonne
appréhension des mouvements des ressources aquatiques. Comme estime
CAROLE B. (2005:62): « Exprimés en termes qualitatifs, les
savoirs des pêcheurs reposent sur leur `'aptitude à voir'': voir
l'affluent, voir la clarté et le niveau de l'eau. Ils mettent ainsi en
relation `'de cause à effet`' la présence du poisson et les
conditions de son milieu de vie».
A cet effet, le développement des formules
spécifiques d'attraction viennent couronner ce processus. Dans ce
sillage, MONOD T. (1928:182) parlant des pêcheurs côtiers du
Cameroun avait fait la remarque suivante:« pour `'appeler'' le
poisson, le pêcheur bat l'eau de la main ou de la pagaie, puis il immerge
ses engins». Par le biais de ces connaissances écologiques,
les pêcheurs estiment avoir plus d'opportunité non seulement de
capturer du poisson en quantité, mais également et surtout leur
permettent de cibler les espèces sollicitées dans leur
alimentation personnelle, sans oublier les poissons enviés sur les
marchés. Il est de ce fait possible pour un pêcheur averti de
s'orienter vers les espèces qui se recrutent autour des rochers comme le
bar (Pseudotolithus senegalensis), ou des espèces de surface
à l'instar `'mbounga» (Ethmalosa fimbriata), du
`'bilolo» (Sardinella maderensis), etc...
III-MATERIELS DE PECHE UTILISES DANS LES PECHERIES DE
NZIOU ET DE
LONDJI I.
Pour assurer leur déplacement en mer et les cours
d'eaux poissonneux, les populations locales s'en servaient comme engins de
déplacement la pirogue.
III-1-Les pirogues
Dans la pêche artisanale, les populations locales
utilisent les pirogues monoxyles dans leurs différentes
opérations de pêche. Elles sont fabriquées à base de
tronc d'arbre creusé à la hache et à l'herminette. Les
espèces de bois utilisées pour sa confection sont essentiellement
le padou ou bois rouge, le bois jaune, préférées pour leur
caractère résistant. Leur coût d'acquisition varie entre
60000(soixante mille) et 85000(quatre vingt cinq) francs CFA. Elles ont une
longueur moyenne de 5 mètres (Longueur hors tout «LHT» =5m) et
sont généralement propulsées par les pagaies et les
voiles. Cet appareil permet aux propriétaires d'effectuer les
pêches de courtes distances compte tenu de l'énergie physique
nécessaire pour son déplacement. Cette marque de pirogue est le
fruit du génie des populations locales notamment les Bantaga et les Mabi
et est essentiellement destinées à la pêche de subsistance
vu sa faible capacité. Elle est
57
le plus souvent montée dans les ménages, en
forêt ou en bordure de mer, tout étant fonction du lieu où
l'arbre est abattu.

Photo 13: pirogue monoxyle dite «
traditionnelle» Source: Mvetumbo (Londji I, 2011).
Cependant, dans un contexte de concurrence marqué par
la tendance à l'emploi des pirogues plus longues, plus larges et plus
mobiles, elle est devenue un matériel de pêche de transition des
jeunes vers un équipement définitif et surtout plus rentable. En
effet, elle donne l'opportunité aux jeunes pêcheurs de faire leur
début dans la pêche à titre individuel, en attendant
rassembler les fonds nécessaires pour l'acquisition d'un matériel
plus sophistiqué.
Son emploi a un impact direct sur le niveau de rendement,
mais aussi sur le temps consacré à la pêche. Ainsi, avec
les pirogues monoxyles, la majorité des pêcheurs qui les
utilisent, font des sorties qui n'excédent généralement
pas une journée, du fait de la pénibilité
rencontrée dans les méthodes de propulsion manuelle,
méthodes fortement dépendantes de la force physique du
pêcheur. Cependant, les pêcheurs lui reconnaissent un certain
nombre d'avantages. D'abord au niveau du prix d'achat, du fait qu'elle est
facilement accessible aux pêcheurs ayant les moyens financiers
limités. En ce qui concerne sa capacité de résistance face
aux aléas climatiques, notons qu'elle constitue l'appareil de
pêche de sécurité en période de mauvaise mer
caractérisée par de violents vents, dont la forte pression peut
engendrer les conséquences néfastes sur les pirogues. A ce sujet,
un informateur vante ses qualités en ces termes: «Les pirogues
à pagaie que j'utilise est mieux, car elle ne peut pas se casser
facilement. S'il y a des vents violents, elles ne peut pas se casser».
(NJOH ADOLPHE, pêcheur, Batanga, Londji I, le 17/12/2010). Cette
pirogue est employée dans la mise en oeuvre des opérations de
pêche dans les cours d'eaux, les rives de la mer ainsi qu'au large.
58
III-2-Spécificité des matériels de
capture
En ce qui concerne les filets, les populations batanga en
utilisaient une gamme variée. Nous avons entre autres: le filet de jet
«Ebunja», employé à l'embouchure des
rivières, le filet commun «epeyé ya bilolo»
utilisé de préférence la nuit, le filet dormant
«épéé é manangé
tubé» qui est employé en hivernage. Pour mieux
capitaliser au cours de leurs aventures en mer, certaines modalités de
capture leur étaient permises, c'est le cas de la pêche à
la mousseline, au couteau ainsi que celle à la nasse (ONDOUA, P.,
1988:23). Selon la même source reprenant MONOD T. (1928:181), le panier
«ésalé» sert parfois à la pêche
dans les ruisseaux; la nasse « éyao » est très
employée pour la capture des crevettes d'eaux douces. En ce qui concerne
les Mabi, la nasse constitue le principal outil employé dans la
pêche. Ces derniers en ont fait de la fabrication de cet engin leur
spécialité. C'est ainsi que leurs voisins Batanga venaient par le
passé se ravitailler auprès d'eux (MONOD, T., 1928:181). Ces
derniers utilisaient aussi des filets, des éperviers tous montés
à base des fibres de certains arbres à l'instar du
«nteh» en Mabi. Ces différents outils en dehors des
nasses n'existent presque plus de nos jours.
IV-METHODES DE CONSERVATION DU POISSON DANS LES
LOCALITES DE NZIOU ET DE LONDJI.
A la mort du poisson, la circulation sanguine s'arrête
et l'oxygène n'est plus véhiculé vers les cellules. Si
aucun système efficace de conservation n'est mis sur pied, la
dégradation microbienne commence progressivement par l'envahissement des
tissus musculaires, après que les enzymes digestifs, tels que les
cathepsines, aient déjà lysé la paroi intestinale.
Simultanément, mais à une vitesse moindre, les microbes de la
peau franchissent facilement les barrières biologiques désormais
inexistantes (BABA, M., 1985:103). Ce processus s'il n'est interrompu à
temps, entraînerait de nombreuses pertes aux acteurs dont les moyens de
subsistance dépendent en grande partie de l'écoulement des
produits de pêche. Comme voie de solution dans cette circonstance, notons
que les méthodes traditionnelles de transformation qui datent de
très longtemps au Cameroun, sont les moyens importants permettant aux
populations, notamment ceux qui sont loin des sites de débarquement et
des principaux circuits de distribution de se procurer du poisson (TEUTSCHER,
F. et al., 1995:11). C'est dans ce sillage que, le fumage du poisson, qui est
une activité économique très ancrée dans le
quotidien des populations de Nziou et de Londji I est connu et pratiqué
par l'ensemble des femmes et constitue le mode de conservation du poisson le
plus employé. Bien que chaque technique de fumage ait ses
spécificités, les différentes méthodes existantes
ont toutes été conçues et pérennisées afin
d'assurer une fourniture permanente de cette précieuse denrée
alimentaire indispensable pour la survie de la population. Pour fumer du
poisson, les acteurs de pêche s'en servent d'une diversité
59
de fumoirs parmi lesquels les demi-fûts, les fumoirs en
bois, les essences de bois aux vertus multiples dont l'impact sur la
qualité des produits fumés est communément reconnu par ces
dernières. Dans la section suivante, nous allons présenter les
spécificités des différentes méthodes
endogènes de fumage et les savoir-faire mis en oeuvre pour l'obtention
des produits fumés de qualités.
IV-1-Techniques basiques de fumage de poisson.
Le fumage comme principal moyen de conservation des
ressources halieutiques, a connu au sein des communautés de
pêcheurs de Nziou et de Londji I plusieurs formes. En effet, les
populations ont en exergue des savoirs tant au niveau du matériel
employé que des processus techniques d'accompagnement. Ainsi chaque
femme au retour de son conjoint ou d'un parent de la pêche, après
avoir déduit la quantité et les espèces destinées
à la consommation familiale, décide en fonction du volume restant
d'employer un type particulier de fumage ou de modèle de séchage.
Il convient de rappeler d'une manière générale que, le
procédé le plus simple est le fumage à feu ouvert au cours
duquel, le poisson est placé au-dessus d'un feu à combustion
maîtrisée. Il s'opère sur un foyer ordinaire
constitué de trois pierres ou de briques et aussi, sur des claies
supportées par des morceaux de fer ou de bois (photo 14). Une
amélioration du procédé du feu ouvert est le fumoir en
saut en fer utilisé comme canalisateur de flammes (photo 15).

Photo 14: Fumoir constitué des piquets
en fer Photo 15: Fumoir constitué d'un saut en fer
Source: Mvetumbo (Nziou, 2011) Source:
Mvetumbo(Londji I, 2011)
Comme atouts, notons que ces méthodes sont
sollicitées et nécessaires lorsque les fumeuses sont en face des
quantités négligeables du poisson; ce qui leur permet de
réduire la consommation du bois qu'aurait pu prendre les fumoirs de
grandes tailles. Elles occupent des espaces réduits dans les
ménages et ne nécessitent pas des investissements lourds pour sa
confection. Cependant le principal inconvénient découlant de leur
emploi reste leur faible productivité, car leur degré de fumage
potentiel ne peut couvrir au delà des besoins du ménage. Mais
aussi, la perte de fumée est grande (BRIGITTE, M. et al., 2005:51), ce
qui peut prolonger
60
le temps de fumage ainsi que les quantités de bois
nécessaires pour conduire le processus à terme.
IV-2-Le fumage par les demi-fûts
C'est un système de séchage du poisson qui
s'opère sur les fumoirs confectionnés à base des
fûts. Les demi-fûts employés ont une taille comprise entre
70 cm et 130 cm selon les différents modèles que nous avons
observés sur le terrain. En plein emploi, ils sont placés sur
trois pierres et/ou briques dont les espaces qui les séparent sont
destinés au passage du bois nécessaire au fumage. Sa confection
relève exclusivement du savoir-faire des hommes. Ainsi, les fûts
sont taillés par ces derniers au niveau des ménages ou dans les
ateliers de soudures situés au centre ville de Kribi. Ce fumoir de
petite taille est dans la majorité des cas placé à
l'intérieur des cuisines; cependant lorsqu'il arrive qu'il soit
positionné en plein air, les fumeuses en fonction de leurs moyens
construisent un hangar ou le couvrent en permanence des tôles afin de
protéger les flammes des méfaits des intempéries.

Photo 16: Fumage du poisson sur un
demi-fût ouvert Photo 17: Fumage sur un demi fût
couvert
Source: Mvetumbo (Londji I, 2011).
Source: Mvetumbo (Nziou, 2011)
Le bois est introduit de la même manière comme
dans les foyers traditionnels de cuisson, c'est-à-dire entre les
supports (les briques ou les pierres). Le fumage s'étend sur deux jours
en moyenne pour les espèces légères de poissons à
l'instar du `'bilolo» (Sardinella maderensis) tandis que celles
ayant plus de chair peuvent passer entre trois et quatre jours, c'est le cas de
la raie (Raja miraletus) du bar (Pseudotolithus
senegalensis). Ce fumoir était beaucoup utilisé dans le
fumage du poisson pimenté appelé « maban »
tant du côté de Londji I que du village Nziou. Du fait qu'il soit
confectionné dans la majorité des cas à partir du
matériel de récupération, il offre l'opportunité
aux fumeuses de procéder à son renouvellement chaque fois qu'il
peut se trouver en état de dégradation. Cependant, selon nos
informatrices, ce fumoir a comme inconvénient sa faible capacité
à contenir le poisson. En effet, la superficie du grillage reçoit
à
61
peine une demi cuvette de poissons frais, mais en terme de
contrainte, il dégage assez de fumée et de chaleur nocives
à leur bien être sanitaire. Pour réduire ces méfaits
de la chaleur, les fumeuses sont appelées en permanence sous pression de
ces aléas, à consommer du lait et de la bière comme
antidote.
IV-3-Le séchage sur les fumoirs `'quatre
poteaux`'
Il est fait de quatre poteaux fixés au sol et
reliés entre eux par des branches moyennes sur lesquelles est
posé le grillage sensé recevoir le poisson. Il est ouvert sur les
quatre côtés et peut recevoir entre une et deux cuvettes de
poissons. Les fumoirs traditionnels ont cet avantage qu'ils sont faits
uniquement des matériaux locaux disponibles dans leur environnement
naturel. Cependant, les fumeuses estiment qu'ils nécessitent l'usage
d'une grande quantité de bois suivie d'une surveillance permanente afin
d'éviter les zones non couvertes par les flammes, zones qui sont
responsables de nombreuses pertes souvent enregistrées après
capture. Pour réduire les dégâts engendrés par ces
ouvertures, un contrôle assidu, une bonne maîtrise de
l'intensité des flammes et une habileté dans la manipulation du
poisson sont nécessaires. A ce sujet, une fumeuse nous a décrit
en ces mots les précautions qu'elle était amenée à
prendre chaque fois qu'elle utilisait le fumoir `'quatre poteaux:
Lorsqu'on fumait avec notre fumoir traditionnel, il
fallait allumer le feu partout dans le fumoir ,mettre du bois à tout
moment et surtout s'assurer que tout le poisson qui est entrain d'être
fumé ressent vraiment le feu ; si non, on va seulement constater que le
poisson a déjà les asticots. Il faut tourner et retourner
à tout moment (MBIMBI ESTHER, Fumeuse, Batanga, Londji I, le
19/12/2010).
La durée du fumage est fonction de la forme du poisson
fumé, tenez à titre d'exemple: avec le fumoir en piquet ouvert de
part et d'autres, le fumage du poisson communément appelé
`'bilolo» (Sardinella maderensis) s'étend sur une
durée de 48h s'il est écaillé, tandis que le temps imparti
au fumage de la même espèce de poisson non écaillée,
est d'au moins trois jours. Comme source complémentaire de
pénibilité, le positionnement du poisson longtemps resté
en vigueur au sein des ménages locaux consistait à poser le
poisson à l'horizontal sur le grillage. En fonction de leurs diverses
expériences, les fumeuses estiment que cette formule ne favorisait pas
la dissémination rapide de la chaleur sur l'ensemble du poisson
posé sur le grillage et de ce fait, ne favorise pas un fumage
accéléré et harmonieux.
62

Photo 18: Fumoir en piquet petit modèle
Source: Mvetumbo (Nziou, 2011)
Aux côtés des fumoirs employés, les
fumeuses s'en servent d'un ensemble de combustibles aux vertus multiformes afin
d'obtenir les produits fumés de qualité. Au cours de nos
entretiens, quelques espèces de bois ont régulièrement
été citées au rang desquelles: L'azobe (Lophira
alata), le sambi (Uapaca spp.), le manguier (Mangifera
indica), le parasolier (Musanga cecropioides), etc... Ces bois
sont choisis en fonction de leur accessibilité et surtout de leur
capacité à imprimer une couleur et une saveur agréable au
poisson. Interrogée sur le sujet, une fumeuse leur reconnaît les
avantages ci-après: «Le bois que j'utilise est un bon bois. Le
sambi et l'azobe donnent une bonne couleur et un bon goût à mon
poisson» (EDJIDJE YVETTE, Fumeuse, Batanga, Nziou, le 10/01/2011).
Reconnues pour leur caractère compact, ces espèces de bois
(spécifiquement l'azobe et le sambi) permettent aux femmes de fumer de
grandes quantités de poisson, à cause de leur rythme de
combustion lent. En plus, ces espèces même étant moins
sèches, se consument et donnent de ce fait l'opportunité aux
femmes de sécher le poisson en plein temps.
Toutes ces formes de savoir sont transmises de
génération en génération à travers un
processus bien structuré.
V-MODE OPERATOIRE DE LA TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE
EN MATIERE DE PECHE ET DE CONSERVATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES A LA JEUNE
GENERATION
Dans les divers processus de transmission des connaissances
relatives à la pêche et la conservation du poisson dans les
villages Nziou et Londji I, plusieurs espaces sont privilégiés en
fonction de la nature des savoirs à dispenser. Ce sont entre autres: les
domiciles, les rives des eaux et la mer.
63
V-1-1-Dans les domiciles
Au niveau des domiciles, l'on assiste au transfert tant des
techniques masculines que celles féminines de travail, chaque parent
étant responsable de transférer les savoirs relevant de sa
compétence. Dans la préparation des opérations de
pêche, les domiciles constituent des espaces privilégiés
pour le montage ou la réparation des filets nouvellement achetés.
A cet effet, sont transmises aux jeunes apprenants (essentiellement de sexe
masculin) les connaissances sur les spécificités des
différents types de filets, le rôle des plombs, les flotteurs
ainsi que de leur mode d'alignement. Dans cet exercice, après une
certaine période d'apprentissage, les parents donnent
l'opportunité aux jeunes d'exprimer les connaissances acquises en leur
permettant de tisser ou d'entretenir un filet de pêche sans leur
intervention, quelle qu'en soit la communauté d'appartenance.
En mêmes temps, les jeunes filles dans la sphère
des activités féminines, assistent leur maman, leur tante et
leurs soeurs aînées dans le fumage du poisson dont les principales
étapes peuvent être déclinées ainsi qu'il suit:
4 L'écaillage du poisson suivi de son rinçage,
afin de le débarrasser de toutes les saletés nocives à la
bonne santé des consommateurs.
4 Le classement sur le grillage qui est fonction des
espèces et de la taille de poisson, mais aussi des formes que les
fumeuses souhaitent donner aux poissons. Les gros poissons sont la plus part de
temps sectionnés en morceaux afin de faciliter leur manipulation et
accélérer le fumage.
4 La sélection de l'espèce appropriée de
bois et des sources complémentaires en tenant compte des critères
suivants: La disponibilité de l'espèce, le rythme de combustion,
la capacité du bois à donner une bonne couleur au poisson.
V-1-2-La plage et les rives des cours d'eaux
C'est à ces endroits précis que les parents
à travers les techniques de capture dont ils ont la maîtrise,
initient les premiers pas de leurs progénitures dans l'activité
de pêche. Elles constituent un espace approprié pour
l'apprentissage de la nage, qui représente le principal moyen de
défense personnelle en cas de difficultés en mer. En effet, il
peut arriver qu'une pirogue chavire suite à des cassures
provoquées par des frappes de chalutiers ou des violents vents. Dans
cette circonstance, le pêcheur à bord se sert tout naturellement
des premiers moyens de défense (la nage). C'est également le lieu
d'embarquement et de débarquement des pirogues, l'occasion pour les
jeunes d'apprendre à charger et à décharger les pirogues,
mais aussi à participer aux opérations d'accostage de la pirogue
ainsi qu'à l'émaillage du poisson.
64
Les diverses activités pratiquées et les
connaissances transmises en ces lieux permettent aux apprenants de gagner en
expérience et de développer les premiers talents indispensables
pour tout pêcheur qui peut envisager une participation ultérieure
aux aventures au niveau de la mer.
V-1-3-En mer
La mer considérée comme la principale
entité pourvoyeuse des ressources alimentaires des populations
côtières, est un milieu complexe, un espace d'acquisition de
l'expérience et d'expression des connaissances en matière de
pêche. L'objectif premier des aînés à ce niveau est,
d'amener les nouveaux venus à se familiariser avec l'atmosphère
marine, un environnement étranger où règnent de violents
vents, des immenses vagues, mais aussi du froid. Au delà de quelques
petits soucis de santé que rencontrent régulièrement les
néophytes, les jeunes acquièrent énormément de
connaissances en ce lieu à l'instar de l'initiation à la conduite
de la pirogue, l'usage de la pagaie et des voiles qui sont les principaux
moyens de propulsion des pirogues monoxyles. C'est également le lieu
d'expérimentation des stratégies de pêche qui se
matérialisent par l'identification des zones riches en poissons, la pose
et le retrait du filet, les observations pratiques sur les opérations
d'émaillage du poisson.
D'une manière générale, la
présence des matériels nécessaires dans la pratique de la
pêche et du fumage aux côtés de la disponibilité des
personnes formatrices, concourt à la facilitation du processus
d'acquisition des connaissances aux jeunes pêcheurs et fumeurs. Au niveau
de nos sites d'étude, les différents objets et contextes
d'acquisition font intervenir, des personnes aux profils et compétences
différents.
En guise de rappel, nous avons présenté le long
de ce chapitre, les caractéristiques des techniques endogènes de
pêche et de conservation des produits halieutiques connues et jadis
utilisées par les populations de Nziou et de Londji I. Au niveau de la
pêche, le `'tirez-tirez», la pêche à la ligne, la
pêche à la palangre, la pêche à la canne
...constituent les principales méthodes de capture. Dans le secteur de
la conservation, le fumage reste le principal moyen de conservation
utilisé. A cet effet, le fumage par les demi-fûts, les fumoirs
`'quatre poteaux», les petits foyers aménagés
(constitués du fer et des seaux en fer) étaient utilisés
comme principales méthodes de conservation du poison. Pour obtenir de
l'esthétique, les populations à travers leurs savoir-faire sur
leur milieu de vie, utilisent des espèces spécifiques de bois
dont les vertus coloratrices sont largement partagées. L'entourage
immédiat de l'adolescent joue un rôle déterminant dans le
processus d'acquisition des techniques de capture ainsi que de conservation du
poisson. Quelles sont les caractéristiques des connaissances
émergentes en matière de pêche dans ces localités ?
La réponse à cette question constituera la quintessence de la
prochaine étape.
65

CHAPITRE IV:
PRESENTATION DES TECHNIQUES EMERGENTES
DE
PECHE ET DE CONSERVATION DU POISSON DANS LES
VILLAGES NZIOU ET LONDJI
I
Dans un contexte pluriculturel et de changement progressif des
pratiques de pêche, les communautés de pêcheurs de Nziou et
de Londji I s'en servent de la multitude de techniques de capture et de
conservation existantes. Chacune de ces méthodes émergentes a ses
origines, ses caractéristiques et ses exigences. Dans ce chapitre, nous
allons nous appesantir à présenter les spécificités
de ces savoirs ainsi que leur mode de recomposition au sein des populations.
I-TECHNIQUES NOUVELLES DE CAPTURE DU POISSON DANS LES
PECHERIES DE NZIOU ET DE LONDJI I
Parmi les connaissances émergentes les plus
utilisées dans les opérations de capture, nous avons entre
autres: l'encerclement ou méthode d'emprisonnement, le sondage ou
technique d'écoute du poisson, la pêche long séjour encore
désignée pêche de trois jours ...
I-1-Technique d'emprisonnement
Après la localisation d'une colonie de poissons dans
une zone précise, qu'elle soit en mer ou dans un cours d'eau, le
pêcheur décide de tendre une embuscade; c'est le piégeage
ou la technique d'emprisonnement du poisson. Selon les pêcheurs
interviewés, cette technique se réalise de
préférence autour des rochers qui sont les sites par excellence
où se réfugient certaines espèces de poissons à
l'instar du bar. Pour la mise en oeuvre, le procédé
nécessite sur le plan matériel, la disposition d'un filet d'une
longueur à même d'encercler les rochers identifiés, elle
peut atteindre un kilomètre voir plus. La seconde étape consiste
une fois le rocher encerclé, à diviser le cercle initial à
l'aide des filets en plusieurs compartiments, ceci afin de réduire de
manière considérable les superficies de déplacement des
poissons ciblés et par voie de conséquence, faciliter leur
capture. Encerclés de part et d'autre, les poissons n'ont aucune chance
de s'échapper, car ces derniers sont chacun à son niveau
entouré par quatre murs de filets dont les mailles sont taillées
à leur mesure.
66
Cependant, la détention par les pêcheurs des
connaissances sur les caractéristiques des espèces de poissons
ciblées ainsi que les instants de mouvements et de stabilité de
celles-ci, est importante. Car, cette maîtrise permet au pêcheur
averti de faire une bonne programmation de sa partie de pêche et de
capturer en quantité le poisson de son choix. Pour illustrer cette
démarche, suivons les propos de ce pêcheur du village Nziou sur sa
manière de mettre en oeuvre ladite technique:
Pour capturer le bar lorsque ma pirogue est en bon
état, je quitte de ma maison à deux heures du matin, pour arriver
à la Lokoundjé autour de 3H30 minutes. Lorsque j'arrive, je
prépare mon piège autour des rochers. J'encercle, le rocher avec
le plus gros filet de plusieurs centaines de mètres, je crée les
divisions avec les petits filets de cinquante mètres environ de long,
et, puisque les bars sortent à quatre heures pour aller chercher de quoi
manger, ils vont tomber dans mon piège. Là, je suis sûr de
tuer beaucoup de poissons (MESSI JULES, Pêcheur, Mabi, Nziou, le
17/01 /2011).
Cette technique était pratiquée dès le
départ en majorité uniquement par les ressortissants
béninois implantés dans les pêcheries
étudiées. Cependant, à travers leurs diverses relations
avec les pêcheurs locaux, ces savoirs ont progressivement
été adoptés par les pêcheurs camerounais.
I-2-La technique d'écoute ou de sondage du
poisson
Comme la technique présentée plus haut, le
sondage du poisson est une méthode de pêche introduite dans les
pêcheries par les pêcheurs béninois. C'est une technique qui
consiste à cibler la présence du poisson à travers le son
qu'il émet afin de procéder au jet du filet avec
précision. Son originalité se trouve autour de l'emploi de la
pagaie dans le processus d'exploration, qui sert d'élément de
liaison entre le son émis par le poisson et le tympan du pêcheur.
De manière opérationnelle, le bout aplati de la pagaie est
plongé dans l'eau à chaque opération de pêche tandis
qu'au même moment, le sommet effilé porteur du message est
placé à l'oreille. Ce n'est que dans cette position que cet
instrument joue pleinement son rôle d'outil de sondage, en faisant
parvenir au pêcheur une sorte de message codé dont ce dernier est
appelé à apprécier la portée. A partir de cet
instant, le pêcheur averti peut prendre la décision de
procéder ou non à une action de pêche. Pour parvenir
à ce niveau de connaissance, le pêcheur façonne à
partir des expériences et de sa régularité dans
l'activité de pêche, son appréciation du son qu'émet
permanemment chaque espèce de poisson, signe grâce auquel le
pêcheur apprenant pourra désormais l'identifier. Cette technique,
fruit d'une connaissance ancestrale, a été transmise aux
pêcheurs de générations en générations par
leurs ascendants. Interrogé sur l'origine et
l'opérationnalité de cette technique de capture, un pêcheur
béninois nous a livré les propos suivants:
Ce sont nos aïeux, nos ancêtres, ce sont eux qui
nous ont appris à écouter le poisson. Lorsqu'ils nous amenaient
en mer, ils nous faisaient écouter, écouter les poissons parler.
Chaque poisson a sa façon de parler .Nous avons appris à
écouter chaque type
67
de poisson qu'on capture. Le mbounga ne parle pas comme
le bar, le capitaine ne parle pas comme le bololo. Ils utilisaient la pagaie,
la simple pagaie, pour sonder dans l'eau s'il y a du poisson à un
endroit. C'est ce qui nous amène à jeter le filet dans l'eau
(HUBERT, Pêcheur, Popo, Nziou, le 15-01-2011).
Surtout que le mode d'acquisition n'est pas si complexe comme
l'affirme cet autre pêcheur: «Cette technique de pêche,
tout le monde peut connaitre, il suffit d'être sérieux et attentif
pour suivre comment çà se passe. J'ai déjà fait
connaitre cette technique à plusieurs pêcheurs d'ici »
(CASSA, Pêcheur, Popo, Nziou, le 09/01/2011).
Les vulgarisateurs de ces connaissances sont reconnus par les
populations d'une manière générale et les fumeuses en
particulier pour leur rapidité dans la pêche. Elle suscite
admiration, respect mais aussi une fierté d'avoir au sein du village les
ressortissants béninois. Par cette ingéniosité, ces
derniers occupent une place centrale dans le circuit de distribution de
poissons frais à en croire cette informatrice:
Les Béninois ne durent pas en mer et pêchent
à tout moment, la nuit et le jour. Ils parlent avec le poisson. Ils
connaissent où se trouve le poisson en mer. C'est pourquoi ils
pêchent vite et pêchent toujours beaucoup de poissons. Nous les
respectons, car sans eux, nous ne devrions pas avoir assez de poissons à
fumer ici au village. Nous ne savons même pas ce que nous allons faire
s'ils partent tous (NGOUNDI ANNE, Fumeuse, Mabi, Nziou, Le 13/01/2011).
Ces propos confirment le point de vue des pêcheurs
béninois pour qui, la pêche fructueuse n'est pas seulement
tributaire de l'arsenal de pêche dont dispose chaque acteur de
pêche, mais elle résulte surtout de l'efficacité des
techniques dont dispose le pratiquant de la pêche. C'est ce qui se
dégage des propos de ce pêcheur béninois interrogé
sur les spécificités de la méthode de pêche par
sondage:
Je ne pêche pas au hasard. Je ne jette pas le filet
en mer au hasard. Je ne pêche pas au hasard comme les autres.
J'écoute le poisson avant de jeter mon filet. J'écoute avec la
pagaie, la pagaie. S'il y a du poisson, je jette le filet. S'il n y a pas de
poisson, je ne jette pas le filet. Ce n'est pas en restant en mer longtemps
qu'on va attraper du poisson. Souvent je vous laisse ici et quelques heures
après, je reviens avec du poisson. Mais parfois aussi sans poisson, je
ne me casse pas. Je préfère rentrer sans jeter le filet au lieu
de le jeter au hasard. (CASSA, Pêcheur, Popo, Nziou, le
09/01/2011).
Cette technique présente aux yeux des pêcheurs,
plusieurs avantages allant du gain en temps à la capture massive du
poisson. Elle est une technique très sélective et permet aux
pêcheurs de capturer les poissons de leur choix, espèces qui
répondent à leur besoin alimentaire ainsi qui leur permettent
d'assurer leur revenu. Le sondage du poisson donne l'opportunité de
réaliser les économies à travers la faible consommation du
carburant vue la réduction des distances à parcourir pour
identifier les zones de pêche, favorise la réduction des
dépenses
68
relatives à la ration alimentaire et offre
l'opportunité d'effectuer plusieurs opérations de pêche en
peu de temps. Ce sont sans doute ces atouts reconnus par les pêcheurs de
diverses communautés qui pourraient en partie expliquer leur
intégration rapide dans les pratiques quotidiennes des pêcheurs
locaux.
1-3-La pêche long séjour ou pêche
de trois jours
La pêche long séjour ou pêche de trois
jours est un mode de pêche qui s'opère deux fois au cours de la
semaine. Dans le village Londji I, les jours de départ en mer reconnus
pour les pêcheurs nigérians et locaux sont le lundi et le jeudi.
Du côté du village Nziou, chaque pratiquant ou groupe de
pratiquants de la pêche de trois jours a son emploi de temps
indépendant. Le jour de départ, après avoir fait le
marché, et acheté le nécessaire pour leur séjour en
mer, les pêcheurs s'engagent dans un voyage de quelques heures
supposé les amener au large où ils seront appelés à
exercer une intense activité de pêche. Le déroulement de la
pêche est guidé par un certain nombre de paramètres
techniques partagés par les différents membres de l'embarcation.
Ainsi, après de longues expériences, les pêcheurs estiment
que l'écart de six heures de temps est nécessaire entre deux
opérations de pêche afin de maximiser la capture. Dans cet
exercice, chaque membre de l'équipage joue des rôles
spécifiques. En effet, le pêcheur principal encore
désigné capitaine de bord ou main droite du propriétaire
de l'embarcation, est responsable de piloter le moteur, de veiller à son
bon état, de cibler les zones propices de pêche. Ce dernier fort
de ses expériences, reste la personne habilitée à donner
des directives au large sur les heures d'introduction et du retrait du filet de
l'eau. Dans la catégorie des personnes qui jouent ce rôle,
figurent des personnes âgés et des jeunes issus des
différentes communautés présentes.
Quant aux pêcheurs assistants, ces derniers suivent les
instructions du chef d'équipe et ont pour missions: l'assistance de leur
supérieur hiérarchique au cours des différentes
étapes de la pêche à savoir l'introduction et le retrait du
filet dans l'eau, l'émaillage du poisson, l'opération de
surveillance permanente du filet et de la pirogue pendant la nuit( afin de
réduire les risques de vol, de contact avec les chalutiers et de
vandalisme de certains collègues mal intentionnés).
Pour ce qui est de la gestion des embarcations de pêche,
les patrons ou propriétaires des matériels de pêche, sont
ceux qui recrutent les personnes avec qui ils peuvent travailler en fonction de
la disponibilité, la loyauté, la transparence dans la gestion du
matériel et des produits de pêche. Pour une descente en mer, ces
derniers mettent à la disposition des pêcheurs les
matériels nécessaires pour la pêche comme une grande
quantité de glace devant servir à la conservation du poisson, une
torche et des piles destinées à l'éclairage du filet la
nuit, une ration alimentaire qui s'élève à cinq mille
francs pour les deux pêcheurs à bord de la pirogue et du
69
nécessaire pour l'entretien de leur corps(savon de
toilette, du rasoir pour le nettoyage de la barbe) . Ces derniers s'assurent
aussi du bon état des filets et de la légalité de leurs
pirogues.

Photo 19: Pirogue chargée du
nécessaire pour une pêche de trois jours. Source:
Mvetumbo (Londji I ,2011).
Ce mode de pêche a été introduit dans le
village Londji I par les ressortissants nigérians qui y sont
implantés depuis plusieurs décennies comme l'ont reconnu plus
d'un pêcheur autochtone:«Avant l'arrivée des
Nigérians, on ne pratiquait pas la pêche de trois jours ici. C'est
avec le temps que nous avons commencé à le faire»
(NANGA JEAN, Pêcheur, Batanga, Londji I, le 19/12/2010). Au niveau de
Nziou, cette formule a intégré l'arsenal de pêche des
populations par le biais des pêcheurs béninois. D'une
manière générale, elle offre selon nos informateurs,
l'opportunité de procéder à plusieurs opérations de
pêche et par ricochet, favorise la capture massive du poisson. Les
pêcheurs du village Londji I capturent au cours de ce long séjour
principalement: le bar, le mbounga, la carpe, la raie, les fritures, le bilolo,
le machoiron. Les pêcheurs de Nziou de leur côté en
compagnie de leur collègues Popo du Bénin en dehors des
espèces citées ci-haut pêchent aussi les petits requins.
Cependant, ces derniers estiment dans leur immense
majorité qu'il est un système de pêche coûteux au
regard des divers investissements dont nécessite une sortie en mer.
II-MATERIELS UTILISES DANS LA PECHE AU SEIN DES
PECHERIES DE NZIOU ET DE LONDJI I.
II-1-1-Les petites pirogues à planches
rassemblées
Si les pirogues à planches rassemblées sont
propulsées aussi bien par les pagaies que par les voiles au même
titre que les premières présentées plus haut, ces
dernières sont différentes des premières par leurs
dimensions ainsi que leur mode de confection. En effet, elles sont
légèrement plus grandes (LHT supérieure à 5m et
inférieur à 8m) et coûtent environ 150000(cent cinquante
mille) francs cfa. Elles offrent aux pêcheurs une double
possibilité au niveau des formules de
70
propulsion à savoir par le truchement de la pagaie ou
du moteur hors bord. Le choix de la formule d'usage est conditionné par
la maîtrise de la manipulation des outils de propulsion, mais aussi les
moyens financiers dont dispose le pêcheur. Elle est utilisée dans
la pêche par les pêcheurs de toutes les communautés en
présence.
II-1-2-Les grandes pirogues à planches
rassemblées
Cette dernière catégorie de d'engin de
déplacement est la forme agrandie des petites pirogues à planches
rassemblées. Elle est propulsée uniquement par les moteurs au
regard de sa taille et de sa capacité à contenir de grandes
charges. Cet outil de déplacement représente la plus grande
pirogue employée dans la pêche artisanale dans toutes les
pêcheries de Nziou et de Londji I. Cette catégorie de pirogue a
une longueur supérieure à 8 m et inférieur à 12 m.
Le prix d'achat varie entre 300000(trois cent mille) et 400000(quatre cent
mille) FCFA.

Photo 20: Petite pirogue en planches
rassemblées. Photo 21: Grande pirogue en planches
rassemblées
Source: Mvetumbo (Londji I, 2011).
Source: Mvetumbo(Nziou, 2011).
Cette pirogue est essentiellement utilisée en haute
mer et joue une multiplicité de rôles. Elle sert de lieu de
stockage du poisson, de lit aux pêcheurs au cours des longues
opérations de pêche (nous faisons ici référence
à la pêche de trois jours), sert également de cuisine,
étant donné que certains pêcheurs ont une
préférence pour la cuisson de leur repas en mer. Ces deux
dernières catégories de pirogues, sont fabriquées par les
Nigérians de qui dépendent tous les pêcheurs de la
localité souhaitant acquérir ces modèles de moyen de
déplacement. Leur savoir-faire dans le domaine est reconnu par tous les
pêcheurs, tout comme l'ensemble des populations et autorités.
Les nigérians, sont les professionnels en la
matière. Pour l'instant, ils sont les seuls spécialistes en
montage des pirogues à moteur à Kribi comme dans les
localités environnantes. Les Camerounais n'ont pas encore l'expertise
nécessaire pour la confection de ce type de pirogue. Ces derniers ne
perçoivent jamais du bon oeil une initiative visant à promouvoir
des échanges d'expériences dans le domaine. Ils sont trop
fermés (NANA, Directeur de la CECOPAK, Kribi, le 21/12/2010).
71
Cette ingéniosité va du montage des pirogues
à la commercialisation en passant par le suivi permanent
(dépannage) comme l'a si bien relevé cet informateur Batanga:
«Si nous voulons les pirogues à moteur, nous achetons chez les
Nigérians. Ils sont les seuls qui fabriquent. Il y a un nigérian
qui ravitaille notre localité. Un Nigérian de Calabar. C'est lui
qui vend et dépanne les pirogues ici» (NANGA Jean,
Pêcheur, Batanga, Londji I, le 19/12/2010).
Pour les pêcheurs, ces pirogues étant
propulsées par un moteur, leur donnent l'opportunité de pallier
à certaines difficultés mentionnées au niveau de l'emploi
de la pirogue monoxyle. Il y a de ce fait la possibilité d'effectuer de
très longues distances en mer, de transporter de lourdes charges,
d'assurer le transport des personnes. Avec l'intensification des captures, les
pêcheurs estiment que l'état des ressources halieutiques n'est
plus du tout le même. A cet effet, pour atteindre et exploiter
efficacement les zones poissonneuses situées à des distances
sensiblement avancées en mer, l'emploi des matériels de pointe
dont la pirogue à moteur (en fait partie) est devenu incontournable.
C'est pourquoi, bien qu' étant au départ, utilisées
exclusivement par les pêcheurs béninois et nigérians, ces
pirogues sont de nos jours employées par tous les acteurs.
III-2-3-La diversité des filets
Dans le quotidien des populations de notre zone
d'étude, les filets font partie des moyens de travail dont a besoin tout
pêcheur afin d'assurer sa survie. Ainsi en fonction des zones de
pêche, la diversité des espèces de poissons disponibles,
chaque pêcheur est appelé à disposer de moyens
diversifiés ou d'adopter une technologie particulière. En terme
de filets employés, nous avons entre autres les filets du bar, des
fritures, des halloge, la grande pêche...).

Photo 22: Filets `'bilolo» et friture
Photo 23: Filets bar Photo 24: Grande
pêche
Source: Mvetumbo (2011) Source:
Mvetumbo (2011) Source: Mvetumbo (2011)
En toute saison et en fonction des moyens économiques,
chaque acteur de pêche peut disposer de cet ensemble de matériels
afin de rester en activité quelle qu'en soit l'espèce de poisson
disponible. Ils sont essentiellement issus des exportations et
commercialisés au niveau local par le centre de pêche de Kribi
ainsi que les détenteurs des quincailleries.
72
III-METHODES DE CONSERVATION EMERGENTES DU POISSON
DANS LES LOCALITES DE NZIOU ET DE LONDJI I.
La conservation des produits halieutiques après la
capture prend des formes spécifiques en fonction des espaces où
se trouve le pêcheur. Ce dernier procède par l'usage de la glace,
de la conservation au niveau de la chambre froide et le séchage par le
fumage.
III-1-La conservation en mer
Les pêcheurs équipés de pirogues
motorisées, prennent lors de leur sortie en mer des congélateurs
usés contenant des glaçons, le tout étant utilisé
comme bac réfrigérant pour préserver la fraîcheur du
poisson et de réduire de manière significative les pertes. Comme
l'a révélé une étude antérieure (BRIGITTE,
M. et al 2005:8), la détérioration du poisson progresse
rapidement après la pêche. Dans le secteur de la pêche
artisanale au Cameroun, de nombreuses pertes de poissons surviennent
après les captures. Cependant, l'une des bonnes pratiques de pêche
qui abîme très peu le poisson est la réfrigération,
au moyen de la glace. Ce qui permet ainsi de prolonger la durée de
conservation du poisson frais. Les glaçons sont produits et
commercialisés dans les multiples chambres froides de la localité
qui se recrutent notamment au niveau de la plage de Londji I, au centre ville
de Kribi. Pour les plus petites pirogues à rame (monoxyles), aucun
système de conservation en mer n'est utilisé étant
donné que leur durée de sortie en mer ne dépasse
guère une journée. Il en est de même des pêches de
rives à l'instar du `'tirez-tirez» ou senne de plage, la
pêche à la ligne, la pêche à la palangre dont les
opérations complètes s'étendent sur une durée assez
courte.
Une fois revenus dans les campements, les pêcheurs ont
trois possibilités majeures pour gérer leurs produits de
pêche. La première consiste à commercialiser directement le
poisson frais sur place, aux divers clients présents. La seconde
possibilité consiste en leur conservation dans les chambres froides
tandis que la troisième option sera de procéder au séchage
par le biais du fumage.
III-2-Caractéristiques de la conservation sur
terre
La conservation du poisson sur terre se fait par le biais de
l'emploi de plusieurs méthodes à savoir: le fumage et l'usage des
chambres froides.
III-2-1-Chambre froide
Dans le village Londji I, les pêcheurs
bénéficient de quatre chambres froides, qui leur servent de lieux
de conservation dès leur retour de la mer. Grâce à leur
émergence, l'adoption des modes de pêche long séjour va
sans cesse croissante. Ce sont ces mêmes points qui les ravitaillent en
glace avant leur départ à la pêche. Ces unités sont
opérationnelles 24h /24 et
73
favorisent une bonne conservation du poisson provenant des
pirogues qui ont accosté la nuit. Il en est de même des poissons
commandés dont les pirogues ont accosté avant l'arrivée
des clients préférentiels. Ce sont des points communément
partagés par l'ensemble des pêcheurs de la localité. Le
facteur commun ici étant l'échange des services et des
devises.
III-2-2-Fumage du poisson
Le fumage est avant tout un processus, dans lequel l'air
servant à déshydrater le poisson est préchauffé
à l'aide d'un feu de bois. La fumée, qui modifie
considérablement le goût du poisson, joue également un
rôle d'«agent de conservation» (BABA, M., 1985:79). Il est une
formule bon marché, consomme peu d'énergie, nécessite un
combustible, exige peu d'équipement, favorise la conservation d'une
qualité et d'une valeur nutritive raisonnables. Au sein des
communautés de pêcheurs de Nziou et de Londji I, plusieurs outils
et techniques de fumage ont progressivement intégré les
stratégies traditionnelles de conservation du poisson par le fumage.
Parmi ces techniques introduites, nous avons noté le fumage sur les
«banda» et le fumage amélioré.
III-2-2-1-Le fumage sur les «banda» ou fumoirs
à larges dimensions
Les fumoirs «banda» ou fumoirs en piquet de grande
taille, ont des dimensions comprises entre 5 et 15 m. Ils permettent aux
ressortissantes nigérianes (majoritairement) de fumer le `'mbounga»
(Ethmalosa fimbriata) en grande quantité. Ces dernières
sont d'ailleurs les grossistes et les Camerounaises les détaillantes. Le
`'mbounga» (Ethmalosa fimbriata) est un poisson dont la capture
est souvent massive et de ce fait, les fumoirs à larges dimensions ont
semblé nécessaires pour relever le défit. Ce fumoir a
comme avantage, le fait qu'il soit confectionné uniquement à base
des matériaux locaux, ce qui donne la possibilité à chaque
personne de se l'offrir en toute période de l'année. Cet outil a
une très grande capacité étant donné qu'il peut
contenir beaucoup de poissons. Pour illustrer cet atout, suivons ce
témoignage de cette informatrice du village Londji I: «Mon
fumoir est large et long, lorsqu'il y a du poisson, je peux fumer même le
poisson de 300000 là dessus» (MOUODOUKOUE ADENY, Fumeuse,
Nigériane, Londji I, le 10/01/2011). C'est ce fumoir qui a
permis en partie aux ressortissantes nigérianes implantées dans
les diverses pêcheries de Londji I, de jouer un rôle central dans
le circuit de commercialisation du poisson fumé avec comme point de
repère, leur main mise sur l'espèce mbounga (Ethmalosa
fimbriata) dont tous les résidents de la zone reconnaissent leur
hégémonie.
74

Photo 25: Fumoir en piquet de grandes
dimensions. Source: Mvetumbo (Londji I, 2011).
Comme contraintes, nos informateurs révèlent
que les fumoirs «banda» consomment assez de bois et prolongent la
durée de fumage à cause de ses nombreuses ouvertures. Le fumage
du `'mbounga» (Ethmalosa fimbriata) à titre d'exemple
s'étend sur trois jours et nécessite une surveillance permanente.
Les utilisatrices ont à cet effet mentionné à plusieurs
reprises les cas d'incendie qu'il est susceptible de provoquer. En effet, au
cours du fumage, la chaleur que provoquent les flammes peut aisément
entrer en contact avec la graisse rejetée par le poisson. Ce fumoir
occupe de grands espaces dans les ménages et dégage assez de
fumée et de chaleur.
III-2-2-2-Le fumage amélioré
La source énergétique à base de bois
représente un intrant fort important dans les charges de transformation
par le fumage. Son usage et son impact constituent une étape
décisive dans l'évolution des technologies de la conservation du
poisson. C'est dans ce contexte qu'est introduit le fumoir
amélioré dans les habitudes des fumeuses de nos sites
d'étude. Il est une construction faite d'un mélange de
matière locale et moderne. Cette technologie est introduite dans les
villages Nziou et londji I par L'OPED (Organisation Pour l'Environnement et le
Développement Durable) avec le financement de la BAD (Banque Africaine
de Développement) et du CBFF (Fond Forestier pour le Bassin du Congo)
dans le cadre du projet «Alternatives à la destruction des
mangroves pour le bien être des femmes de l'Afrique centrale».
Il est construit à base des briques de terre et du ciment. Sa mise en
oeuvre s'opère avec la participation d'une multitude de personnes. Au
niveau de Nziou et de Londji I, les villageois frappent les briques et le
montage est assuré par un maçon tandis que les femmes et les
enfants puisent de l'eau nécessaire pour le montage du fumoir.
75
En ce qui concerne les structures des fumoirs, notons
qu'elles sont de forme rectangulaire avec des longueurs qui sont fonctionnelles
des différents types rencontrés. Ils sont au nombre de quatre.
Ces modèles correspondent aux différents types essentiels avec
les mesures ci-après.
Nombre de fumoirs
|
Longueur
|
Largeur
|
Hauteur
|
Nombre d'entrées
|
Fumoir à un foyer
|
120 cm
|
85 cm
|
100 cm
|
01
|
Fumoir à deux foyers
|
225 cm
|
85 cm
|
100 cm
|
02
|
Fumoir à trois foyers
|
330 cm
|
85 cm
|
100 cm
|
03
|
Fumoir à quatre foyers
|
435 cm
|
85 cm
|
100 cm
|
04
|
|
Tableau 6: Récapitulatif des dimensions
de quelques modèles fumoirs améliorés Source:
OPED(2010).
Ils sont couverts des grillages en fer sur lesquels les
fumeuses déposent le poisson avant de débuter le fumage.

Photo 26: Modèle de fumoir
amélioré à un foyer Photo 27:
Modèle de fumoir a quatre foyers
Source: Mvetumbo (Londji I, 2011).
Source: Mvetumbo (Nziou, 2011).
A Nziou tout comme du côté Londji I, toutes les
communautés de fumeuses l'utilisent et lui accordent un certain nombre
d'intérêts liés à la réduction des
quantités de bois utilisées dans le séchage du poisson, au
gain de temps, la réduction des méfaits de la fumée et
à la bonne canalisation de la chaleur comme en témoigne cette
fumeuse du village Londji I:
Ce fumoir fait beaucoup de chaleur à
l'intérieur et nous permet de fumer beaucoup de poissons mbounga. Quand
j'utilisais seulement le fumoir ancien pouvait mettre trois jours sur le
fumoir. Maintenant comme je fume aussi sur le fumoir amélioré, je
mets le
76
poisson au feu, à midi je tourne et en
soirée, mon poisson est déjà bien fumé.
(MAHEMO MARIE, Fumeuse, Nigériane, Londji I, le 18/12/2011).
A travers ses murs opaques, il accroît la
possibilité d'utiliser les sous produits de bois (copeau, sciure...) et
les écailles de poisson, les brous des noix de coco. Ainsi, en
réduisant de manière significative le temps de fumage, il donne
la possibilité aux fumeuses de multiplier le nombre de fumage
hebdomadaire. Mais aussi il réduit de manière significative les
dégâts de la chaleur surgissant au cours du processus de fumage. A
ce sujet, les déclarations de cette informatrice constituent une
parfaite illustration:
Ici au village, les fumeuses souffrent avec le
problème de chaleur et de fumée qui proviennent tous les jours de
nos fumoirs. Depuis que les fumoirs améliorés sont là,
personnellement, j'ai moins de problèmes liés à la
fumée, je consomme mois de lait et de bière, car je sens mois
chaud pendant le fumage (NGOUNDI ANNE, Fumeuse, Mabi, Nziou, le
13/01/2011).
Cette technologie de fumage n'est pas sans
inconvénient. En effet, les coûts de montage sont très
élevés, par conséquent ne sont pas à la
portée du citoyen moyen. Ils ont un espace de fumage pas assez grand
comme certains fumoirs «traditionnels». Mais aussi, son emploi
nécessite une formation préalable et une sensibilisation
permanente, au cas contraire, ils sont susceptibles d'engendrer des pertes
énormes.
III-2-2-3-Spécificités des fumeuses
nigérianes et béninoises
Les fumeuses béninoises ont une technique
particulière et très attrayante de fumer leurs poissons. Elle est
soutenue par un alignement millimétré suivi de l'utilisation des
sources coloratrices complémentaires au bois. Au niveau de l'alignement,
pour ce qui est par exemple du `'bilolo» (Sardinella maderensis)
leur espèce phare de fumage, ces dernières ont deux positions
particulières de fumage selon que le poisson est écaillé
ou non. Interrogée sur les spécificités de cette
méthode de fumage, une informatrice béninoise nous a donné
la description suivante:
Lorsque le poisson revient de la mer, j'ai deux
manières de fumer: je nettoie tout simplement ou, je l'écaille et
je le nettoie avant de le fumer. Tout dépend en fait des commandes qui
m'attendent. Pour fumer, j'allume d'abord un feu doux qui va progressivement
devenir intensif. Si c'est le non écaillé, je place le poisson la
tête vers le bas, c'est-à-dire la tête fixée dans le
grillage et la queue tournée vers le haut. Dans ce cas, le poisson est
aligné successivement en suivant les lignes de la gauche vers la droite
ou de la droite vers la gauche. Entre les colonnes, je laisse un petit espace
pour faciliter le passage de la chaleur. Pour ce qui est du poisson
écaillé, quand je le nettoie et j'enlève les
écailles, je dépose le poisson sur le grillage en pliant chaque
fois de la main le poisson en rond. Ces ronds me permettent de mieux classer le
poisson en suivant le même alignement. Avec cette méthode, je sais
exactement après combien de temps je dois revenir tourner mon poisson.
Le fumage est très rapide. Le poisson est bien serré sur la
claie. Là, je peux fumer beaucoup de poisson au même moment,
parce
77
que la chaleur traverse bien mon grillage de poisson, bien
je peux aussi doubler d'autres grillages dessus. (AGLIN ANNE, Fumeuse,
Béninoise, Nziou, le 18/12/2010).
En suivant la verticale comme indiqué dans cette
stratégie, les colonnes de poissons sont séparées entre
elles par 1cm d'écart environ. Ces rangées se succèdent
progressivement en partant d'un bout du grillage à un autre. Selon les
informateurs, cette manière de disposer donne l'opportunité
d'estimer aisément les quantités de poissons en fumage, mais
également de fumer des quantités plus élevées de
poisson en superposant sur une même surface au cours d'une même
période. Pour le poisson écaillé, le procédé
de classement est le même à la seule différence qu'au lieu
de la station debout, le poisson est plié et posé sur la claie.
Le principe d'alignement et du respect des écarts est rigoureusement
respecté. Dans cette position avec l'écoulement rapide de l'eau,
le rythme de fumage s'accélère et l'on peut aisément
observer une harmonie dans le séchage du poisson. Ce style de travail a
reçu un intéressement de plusieurs fumeuses et est aujourd'hui
pratiqué et par les ressortissants béninois et les populations
locales.
Pour donner du goût au poisson, ces dernières
ont introduit l'emploi d'un certain nombre de sources alternatives qui non
seulement offre au poisson fumé une couleur et une saveur très
appréciées, mais qui participe de manière efficiente au
réglage des températures nécessaires pour un fumage
homogène. Dans cette suite logique, l'on peut notre l'introduction de la
paille et les écailles de poisson dans le processus de fumage, qui
constituent une originalité des ressortissants béninois.

Photo 28:Ecailles de poisson coloratrices
Source: Mvetumbo(2010)
Elles jouent un rôle spécifique dans la
coloration du poisson. En effet, lorsque le poisson est déjà
posé sur le grillage et le fumage suivant progressivement son cours, les
fumeuses
78
injectent une dose d'écailles de poisson ou de la
paille sur les braises ou les flammes (en fonction de la nature du bois
utilisé dans le fumage). Leur entrée en jeu procure au poisson
une couleur très attrayante ainsi qu'un goût
apprécié à juste titre.
D'une manière générale, chaque technique
qu'elle soit ancienne ou nouvelle a ses spécificités du point de
vue des populations de Londji I et de Nziou. A ce sujet, le choix d'une
méthode de fumage est conditionné par un certain nombre de
facteurs au rang desquels: la spécificité des espèces de
poissons régulièrement fumées dans le ménage, la
capacité des fours à contenir des quantités
appréciables de poissons, l'espace disponible dans les cuisines ou dans
les différentes concessions, la disponibilité des diverses
ressources (humaine, matérielle, financière) nécessaires
à sa confection et le degré d'implication dans l'activité
de fumage de chaque groupe de fumeuses. Ces différents
éléments nous permettent de comprendre pourquoi les fumeuses
utilisent une ou plusieurs catégories de fumoirs.
IV-PROCEDURE ET AGENTS DE TRANSMISSION DES
CONNAISSANCES EN MATIERE DE CAPTURE ET DE CONSERVATION DES PRODUITS
HALIEUTIQUES DANS UN CONTEXTE PLURICULTUREL.
Pour qu'un individu puisse acquérir des techniques
qu'elles soient anciennes ou nouvelles, plusieurs modalités sont
nécessaires. Afin de mieux cerner ces procédures, nous allons
dans les lignes suivantes essayer de comprendre les itinéraires suivis
par quelques uns de nos informateurs.
IV-1-Etude de cas
Pour une entrée en matière, nous proposons
quelques études de cas de trois informateurs issus des grandes
communautés d'acteurs de pêche des pêcheries de Nziou et de
londji I. Cette séance vise à cerner les procédés
d'initiation à l'activité de capture dans les divers groupes
d'appartenance de chacun ainsi que la contribution de la cohabitation dans le
processus d'acquisition ou de perfectionnement des nouvelles connaissances. Les
réponses fournies viennent nous permettre d'appréhender deux
préoccupations essentielles à savoir: Comment se sont
opérés les premiers pas de chaque acteur dans la pêche ?
Toutes les techniques de pêche proviennent-elles de l'entourage
immédiat des intéressés?
IV-1-1-Cas n° 1: MESSI JULES (Pêcheur, Mabi)
MESSI Jules, est âgé de cinquante -et- un an. Il
débute le métier de pêcheur à l'âge de dix ans
par le biais de la pêche à la ligne. Spécialement
motivé par la forte implication de son père dans la pêche
et de sa mère dans l'activité de fumage du poisson, il a acquis
les connaissances dans ce domaine auprès de son père et les a
perfectionnées aux côtés des migrants béninois
avec
79
qui, il a de très bons rapports tant sur terre qu'en
mer. Ce dernier a formulé ses propos en ces termes:
La première des choses sur la pêche que
j'apprends comme tout enfant de chez nous, sur les techniques de pêche,
c'est le montage de la canne à pêche, tailler le flotteur, fixer
le hameçon sur un bâton, et un fil nylon. J'ai appris cela
à partir de l'âge de dix ans et c'est mon père qui m'a
montré tout ça. Après c'était au niveau de la plage
où, j'ai appris à utiliser ma canne à pêche d'abord
avec mon père les premiers jours qu'il me montrait comment je dois tenir
la canne et comment le mettre dans l'eau et savoir qu'il y a quelque chose
dessus (poisson ou objet accroché sur le hameçon).Mais
quand je connaissais déjà, je pouvais maintenant pêcher
seul ou avec mes amis. Pour pêcher en mer, il faut connaître la
nage, c'est la nage qui sauve en cas de problème en mer. Quand
j'étais tout petit, on m'amenait à la plage pour que je me lave
avec les autres, mes grands m'ont appris à nager et quand je savais bien
nager, quand je pouvais nager sur une distance de trente à quarante
mètres dans la mer, mes parents ont compris que je connaissais
déjà un peu la mer, ils m'ont appris à pagayer la pirogue
d'abord au bord de la mer et après à l'intérieur de la
mer. J'avais déjà quinze ans et c'est comme ça que j'ai
commencé à assister mon père quand il partait
pêcher. J'ai appris à mettre le filet dans l'eau, le retirer,
enlever le poisson dessus. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un
pêcheur, un pêcheur complet.
Non, toutes les techniques que j'utilise dans la
pêche, je n'ai pas appris seulement avec mes parents, mais aussi avec les
amis. Il y a la technique du sondage du poisson, que j'ai appris auprès
des Béninois de la plage qui m'ont vraiment appris à le faire.
Avant j'entendais les gens parler, mais je ne croyais pas du tout. Mais, quand
j'avais embauché un Béninois dans ma pirogue et qu'on travaillait
ensemble, il m'a vraiment appris à écouter le poisson et de
connaître le type de poisson qui se trouve à l'endroit où
je me trouve en mer. Avec ces gens, j'ai aussi appris la technique
d'emprisonnement qui te permet d'encercler le poisson avec les filets
(Nziou, le 22/01/2011).
IV-1-2-Cas n° 2: HUBERT (Pêcheur, Popo)
Pêcheur de nationalité béninoise, ce
dernier est implanté dans la localité de Kribi depuis vingt cinq
ans. Il a fait ses preuves de pêcheur dans plusieurs pêcheries de
la localité et fort de son expérience et de son ancienneté
dans le village, il est notable à la chefferie de Nziou. Doté de
nombreuses techniques et connaissances sur la pêche, il est comparable
à une institution de formation pour les pêcheurs qui le
côtoient:
Pour nous, la pêche est une activité qu'on
naît avec, on grandit avec. Chez nous, on apprend à pêcher
bébé, je fais la pêche depuis l'âge d'un an.
Même celui que tu vois devant la pirogue sait déjà ce que
c'est que le poisson. Même comme il ne part pas en mer, mais il sait
déjà pêcher dans la tête. J'ai appris à monter
le filet très tôt près de mon père .Il était
même le plus grand pêcheur de toute la région de Kribi de
Ngoye jusqu'à Mpalla quand on arrivait ici. J'apprenais aussi à
émailler le poisson à la plage toujours avec mon père et
mes frères. Après j'assistais mon père en mer,
c'était au tour de l'âge de dix ou onze ans comme ça. Et
à quatorze, ans je conduisais la pirogue quand mon père me
donnait...
Oui ; j'utilise les techniques que j'ai appris de mon
père. Est-ce que les Batanga savent pêcher? Quant mon père
arrivait ici, ils ne savaient pas pêcher. Ils utilisaient des
80
petites pirogues, on ne peut rien faire avec ça.
Nos techniques, ça me va. Nous travaillons avec eux, nous les apprenons
à pêcher (Nziou, le 15/01/2011).
IV-1-3-Cas n° 3: WILLIAM GODWILL (Pêcheur,
Calabar)
Cet homme aux connaissances variées (pêcheur et
fabricant de pirogue) est un jeune Nigérian né à Londji I
en 1988, des parents nigérians. Il y réside depuis sa naissance
et c'est aussi là qu'il a acquis l'ensemble des techniques dont il
maîtrise. Depuis sept ans, il exerce comme pêcheur principal et est
propriétaire d'une pirogue de taille moyenne.
Quand j'étais petit, je voyais mon père
travailler sur les filets tous les jours, il les arrangeait pour aller
pêcher. Il m'a appris à faire comme lui, j'ai dont appris à
arranger les filets comme lui. J'avais dix ans si je ne me trompe pas. A partir
de quinze ans, il m'a appris à utiliser les rames dans l'eau, et
j'apprenais quant il rentrait de la pêche. Quant il veut partir
pêcher, je rame pour placer la pirogue sur la route de départ.
Comme mon père avait aussi la pirogue à moteur, il m'a pris
aussi, après, à conduire le moteur. Encore à dix sept dix
huit ans, je partais avec mon père en mer et à 20 ans, je partais
seul. Maintenant, j'ai ma pirogue et je travaille, je pêche quant il y a
le poisson...
Mon père m'a appris à pêcher, mais la
pirogue, j'ai appris à fabriquer chez une autre personne. On n'est pas
de la même famille, mais il est du Nigeria comme moi. Mais parfois on
pêche ensemble avec les gens d'ici, ce sont nos amis (Londji I, le
13/01/2011).
Chaque personne en fonction du type de savoir
sollicité, des opportunités disponibles dans son contexte social
suit un itinéraire qui lui est propre.
IV-2-Personnes impliquées dans le processus
transmission des connaissances dans le domaine de la pêche
De ces différentes interventions, il ressort de prime
à bord que le cercle familial constitue le premier stade d'acquisition
et d'expérimentation des techniques en matière de pêche.
Les parents engagés dans ce processus, sont porteurs des talents et des
expériences spécifiques à leur culture que ces derniers
inculquent à leurs progénitures. En ce sens,
«L'apprentissage transmet tout ensemble savoirs efficaces, sens et
identité» (SIGAUT, F., 1988:24 repris par SABINOT, C.,
2008:5). Puisque, les premiers gestes et techniques acquis sont ceux qui sont
mieux maîtrisés par les parents, mais aussi connus et
valorisés dans le groupe d'appartenance. Dans une situation de
cohabitation, de cogestion, mais surtout de quête de techniques de
pointes, il existe des possibilités d'échange et de transfert des
connaissances. Parmi les potentiels lieux d'apprentissage, figurent les
embarcations, qui peuvent regrouper au cours d'une même opération
de pêche, les personnes de même famille, de même
communauté et/ou les personnes des communautés
différentes. De ce fait, la nécessité d'acquérir de
nouveaux savoirs émerge au niveau de chaque communauté afin
d'élever son degré d'engagement et ses ambitions dans la
81
pêche. Pour concrétiser cela, chaque acteur de
pêche est appelé hors des privilèges offerts par le travail
en synergie, à y mettre du sien pour capter le plus rapidement possible
les méthodes de travail qui présentent une certaine valeur
à ses yeux.
Dans un contexte marqué par une diversification des
savoir-faire, nous avons remarqué qu'en fonction des matériels et
des techniques employées dans la pêche et la conservation du
poisson, plusieurs rapports lient les personnes en quête des savoirs
nouveaux et les détenteurs de ces connaissances comme le
synthétise le tableau ci-dessous.
Domaines de
connaissances
|
Statut de l'apprenant dans le groupe
d'appartenance
|
Hameçon
|
Fils, frères cadets du pêcheur (à la
ligne, utilisateur de la canne à pêche et de la palangre).
|
Filets
|
Fils du pêcheur, neveu, cadets du pêcheur,
personne neutre embauchée par le propriétaire du matériel
de pêche (filet)
|
Fabrication de la pirogue
|
Fils, neveu du fabricant, personne neutre qui désire
s'initier au montage de la pirogue.
|
Montage des fumoirs
|
Fils, neveu ou frère cadet de l'expert, un assistant de
l'expert
|
Fumage du poisson
|
Fille, nièce ou soeur cadette d'une fumeuse de poisson
|
Pêche en mer
|
Fils, neveu, ami, assistant d'un pêcheur principal
|
Pêche du poisson dans les cours d'eau
|
Fils, neveu, ami du pêcheur
|
Tissage des nasses
|
Fils, fille, neveu et nièce du tisserand
|
Pêche des crevettes d'eau douce
|
Fils, fille, neveu et nièce du pêcheur des
crevettes
|
Manipulation de la pagaie
|
Fils, fille, neveu, ami, assistant d'un pêcheur
principal
|
|
Tableau 7: Liens entre le détenteur du
savoir et l'apprenant en rapport avec quelques objets.
Les techniques que détiennent les parents
s'acquièrent aisément tandis que celles ignorées par ces
derniers nécessitent une intervention extérieure.
Ce chapitre a présenté les techniques
émergentes de capture et de conservation des ressources halieutiques
dans les villages Nziou et Londji I. A cet effet, nous avons identifié
au niveau des méthodes de capture, la pêche long séjour, le
sondage, la technique d'encerclement. Au niveau de la conservation, la
congélation s'est imposée comme le principal moyen tant en
82
mer qu'au retour de la pêche. A cela s'ajoute le
séchage par le biais des fumoirs dotés d'une grande
capacité de réception et favorisant une rapidité dans le
fumage. Ces connaissances fruits des savoir-faire des différentes
communautés se sont joints aux techniques endogènes existantes
pour donner aux acteurs de pêche de la localité un éventail
de formules d'exploitation des ressources halieutiques.
83

CHAPITRE V:
CONTRIBUTION A UNE ANTHROPOLOGIE DE LA DYNAMIQUE DES
TECHNIQUES DE PECHE ET DE CONSERVATION DES PRODUITS DE PECHE
Généralement, les littoraux constituent des
espaces d'interfaces tant écologiques, qu'humains. De tout temps,
peuplés ou traversés par des hommes de cultures et de langues
différentes, ils sont des lieux où savoirs, savoir-faire et
représentations symboliques sont en constante tension. Au sein des
communautés de pêcheurs de Nziou et Londji I, plusieurs
changements ont eu lieu au niveau des techniques de capture et de conservation
des ressources halieutiques. Comprendre les manifestations, les raisons
sous-jacentes à ces mutations ainsi que les potentiels impacts dans
l'activité de pêche constitueront la quintessence ce chapitre.
I-MANIFESTATION DES MUTATIONS DES SAVOIR-FAIRE EN
MATIERE DE PECHE
Suite aux contraintes environnementales manifestées
par la carence, les techniques de pêche et de conservation du poisson ont
profondément évolué vers des stratégies
d'optimisation de la production et de la diminution des pertes après
capture, le but ultime étant d'assurer une meilleure
disponibilité des produits halieutiques destinés à
l'alimentation et au commerce.
I-1-Dynamiques des techniques de capture
Dans la pêche de manière générale,
la disponibilité de la ressource varie au cours de l'année, et
avec elle la part relative des différentes espèces.
Ce phénomène ne rythme pas seulement l'exploitation, il
conditionne aussi l'adaptation des engins en fonction des espèces
ciblées et du contexte environnemental. C'est en ce sens que l'on
observe l'emploi massif de la technique de sondage, la technique
d'emprisonnement, une intensification de l'usage des instruments sonores dans
le processus d'identification des ressources halieutiques et la diversification
des filets de pêche.
L'on note aussi l'adoption tous azimuts du mode de
pêche de trois jours, qui favorise en fonction de l'expérience et
de l'équipement des pêcheurs, la capture massive du poisson,
ceci
84
grâce aux multiples opérations de captures
orchestrées pendant ces longues heures. Le principe de pêche est
simple, selon ces derniers en effet, après avoir bien circonscrit la
zone de pêche, les filets sont retirés et replongés dans
l'eau en moyenne toutes les six heures de temps, juste le temps
d'émailler le poisson et de procéder à une nouvelle
introduction. Il leur permet en trois jours d'effectuer entre six et huit
opérations de capture. Pour ces derniers, ce mode de pêche a
émergé dans la localité à la suite de
l'implantation des pêcheurs nigérians et béninois avec pour
conséquence directe, la concurrence et la raréfaction des
ressources. Et pour réussir dans cet environnement de défi, les
pêcheurs locaux n'ont pas résisté au charme de la
méthode de pêche dont la rentabilité est
considérable. Les voyages des pêcheurs en mer chaque lundi et
jeudi après midi constituent une preuve tangible de l'uniformisation des
calendriers du côté de Londji I. Cependant dans le village Nziou,
bien que la pratique soit en vigueur, aucun calendrier spécifique commun
n'est établi, chaque groupe de pêcheur prend ses initiatives du
jour et des heures de départ et d'accostage.
Toutes ces techniques endogènes comme exogènes
doivent leur succès en dehors de la qualité d'attraction de
chaque matériel employé, aux savoir-faire des acteurs de
pêche sur le quotidien du poisson. En effet, dans le processus
d'exploitation des ressources halieutiques, les pêcheurs de Nziou et de
Londji I ont une connaissance élargie sur la répartition des
espèces de poissons d'eau douce et de mer en fonction de la profondeur
de l'eau, les heures de repos et de déplacement, les modes et
périodes de reproduction. La spécificité des savoirs sur
l'éthologie de la proie du pêcheur fit dire DESCOLA dans une
étude sur l'activité de chasse que «L'essentiel de l'art
cynégétique chez les Achuar, comme dans de nombreuses autres
sociétés ne réside pas tant dans l'habileté
à se servir des armes que dans la connaissance approfondie des moeurs et
du comportement des animaux chassés» (DESCOLA, P., 1994:293)
repris par CHLOUS D. (2005:52). La maîtrise de ces divers
paramètres permet aux acteurs de pêche de tirer profit de leurs
différentes opérations de pêche garantissant par là,
la survie de toute la filière.
I-2-Adoption des nouveaux engins de
déplacement
Au niveau des engins de déplacement dans les eaux, les
pirogues à moteur ont progressivement intégré les
pratiques de pêche des populations du village Londji I avec
l'arrivée des migrants nigérians (BROCHET, A. et KOHPE, M.,
2007:5), tandis que les ressortissants béninois en ont assuré la
promotion dans le village Nziou. Ce matériel permet de nos jours
à la grande partie des pêcheurs de parcourir de très
longues distances en un temps relativement réduit. Il donne ainsi
l'occasion de sillonner plusieurs zones au cours d'une expédition de
pêche. Ce moyen de locomotion se présente comme une solution
efficace face à la pêche intensive ayant conduit à
l`éloignement progressive des ressources halieutiques. Cette adoption
massive des
85
pirogues à moteur fait disparaître
progressivement l'emploi des pirogues dites «traditionnelles» et par
conséquent les savoir-faire utilisés dans leur confection.
I-3-Dynamique des techniques de conservation
Les techniques de conservation en mer comme sur terre ont
subi des modifications non négligeables. Au niveau de la capture du
poisson, la congélation s'est imposée comme indispensable dans la
pêche `'long séjour» ou `'pêche de trois jours».
En effet, l'emploi des congélateurs favorise la conservation du poisson
en mer pendant une longue période. Elle est pratiquée dans les
villages Nziou et Londji I par les Camerounais, Béninois et
Nigérians. Au niveau des techniques de conservation, le fumage reste le
principal moyen dont s'en servent les populations pour retarder la
dégradation rapide du poisson après capture. Dans cet exercice,
une tendance à l'adoption des fumoirs `'banda» de grandes
dimensions pour leur forte capacité de réception et les fumoirs
améliorés pour leurs multiples avantages tant sur la santé
que sur l'accroissement du chiffre d'affaire des utilisatrices est visible sur
le terrain. Pour ce qui est du procédé d'obtention des produits
fumés de qualité, le croissement des expériences issues
des diverses communautés présentes, conduit à une
homogénéisation des pratiques de fumage. Si BRIGITTE M. et al.
(2005:50) révèle que la meilleure fumée pour le
séchage s'obtient à base du feu de copeaux de bois et de morceaux
de bois dur, nous avons noté une convergence générale sur
l'emploi des mêmes sources d'énergie dont l'azobe (Lophira
alata), le sambi (Uapaca spp.) mais aussi des sources
complémentaires aux spécificités variées au rang
desquels les écailles de poisson et la paille fraîche, sources
d'énergie complémentaires qui constituent des essences
d'esthétique traditionnelle employées en Afrique de l'ouest et
dont les ressortissantes béninoises en ont fait la promotion.
Mais aussi le copeau, les peaux de banane
séchées, les peaux de manioc, les débris des troncs des
noix de coco ainsi que son brou relevant du savoir-faire local, sont aussi
employées pour leurs vertus gustatives et coloratrices. Lorsque ces
sources additionnelles sont beaucoup sèches et facilement
volatilisables, les fumeuses les aspergent des jets d'eaux avant de les
introduire dans le foyer. Ce qui leur donne de maîtriser
l'intensité des flammes en réduisant de manière
significative le degré de consumation du bois. Mais aussi permet
d'assurer une coloration approfondie et harmonieuse des produits en fumage. Le
but ultime dans ces opérations de charme étant obtenir à
la fin des produits fumés conformes aux aspirations alimentaires des
populations car, le choix alimentaire de l'Homme doit avant toute chose
répondre à des besoins nutritionnels guidés par des
stimuli internes et satisfaire sa faim. Selon DE GARINE I. (1979:74) reprenant
MAGNEN J. (1951) et TREMOLIERE J. (1956), les nourritures
qu'«ingère l'Homme doivent posséder certains
caractères sur le plan de l'odeur, de la saveur et du toucher
86
et satisfaire son appétit, c'est-à-dire son
désire de renouveler une expérience sensorielle agréable
et de retrouver son bien être consécutif à
l'alimentation». Sur le plan commercial, cette même devise
constitue un atout significatif qui influence le choix des consommateurs.
II-FACTEURS DE PROPAGATION DES NOUVELLES TECHNIQUES
DE PECHE ET DE CONSERVATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES
Au sein des communautés de pêcheurs de Nziou et
de Londji I, les techniques de pêche et de conservation du poisson se
modifient et se restructurent au jour le jour. Cependant, pour que cette
intégration soit effective, plusieurs facteurs pouvant entraîner
les changements entrent en jeux. Ces derniers se structurent en facteurs
endogènes et exogènes.
II-1-Facteurs endogènes
Parmi les facteurs qui sont endogènes à la vie
socioculturelle des populations de Nziou et de Londji I, figurent la place
prépondérante des ressources halieutiques dans leur alimentation,
les mariages interethniques, le faible intérêt accordé aux
rites relatifs à l'activité de pêche...
II-1-1-Place du poisson dans la médecine et
l'alimentation des populations de Nziou et de Londji I
Les poissons jouent de multiples rôles dans le
quotidien des populations. Sur le plan médicinal, ils peuvent remplir
des fonctions significatives dans le processus de quête de santé,
ceci en fonction de la spécificité des espèces et de la
nature de la maladie dont souffre le patient. A ce sujet les informateurs
notamment les ressortissants Popo du Benin nous ont expliqué que le
poisson communément appelé tétrodon (Tétraondon
biocellatus) loin de la saveur, du goût qu'il procure aux
consommateurs, est un poisson plein de vertus médicinales. En effet,
lorsque qu'il est capturé, la peau est séparée de la chair
au retour dans les ménages. La poudre obtenue de la peau
séchée mélangée à de l'huile rouge constitue
un puissant remède contre la toux. Toutes les douleurs pouvant survenir
au niveau de la gorge peuvent aussi être soulagées si le patient
adopte le même traitement. Certains dont les noms échappent aux
informations sont reconnus des populations à partir des fonctions qu'ils
remplissent. C'est pourquoi, leur efficacité n'a jamais fait l'objet
d'aucun doute aux personnes qui en font usage. Ainsi, en parlant des poissons
aux vertus thérapeutiques, un informateur nous a
révélé les propos ci-dessous:
Il y a un poisson de mer, semblable à la tortue,
lorsque tu finis de le manger, tu sèches sa carapace au soleil, elle
coule de l'huile. Cette huile a beaucoup de vertus médicinales. Elle est
utilisée pour soigner plusieurs maladies, comme le palu ou n'importe
quelle maladie. La composition dépend du mal. Si l'enfant chauffe la
nuit par exemple, tu peux utiliser ce liquide pour le oindre avec. S'il y a la
présence des mauvais esprits dans la maison, tu peux aussi utiliser cela
et tu seras épargné. (CASSA, Pêcheur, Popo, Nziou,
20/01/201).
87
Toujours dans ce même sillage, SABINOT C. (2008:94) en
évoquant les thérapies faites à base du poisson,
remarquait déjà que le poisson-globe, (Ephippion
guttiferum) remplit de nombreuses fonctions médicales chez les Popo
la Nyanga au Gabon. En effet, si les douleurs dues à une angine ou
à tout autre phénomène entraînant l'obstruction de
l'oesophage ou de la trachée surviennent, le patient peut
prélever un morceau de la peau séchée de ce poisson, la
griller au feu, la piler et la mélanger avec un peu d'huile de palme, et
ingérer cette mixture afin que l'obstruction disparaisse. Aussi,
certaines populations estiment que la consommation régulière du
poisson salé est un stabilisateur des crises de tension. Afin de
réduire la carence des espèces de poissons sollicitées
dans la médecine, un ajustement des techniques d'exploitation et de
conservation a constitué une nécessité pour les
détenteurs de ces savoirs.
Pour ce qui est des retombés bénéfiques
des ressources halieutiques dans les menus des consommateurs, certaines
études révélaient déjà que dans
l'alimentation de bien des populations africaines, le poisson joue un
rôle de premier plan, tant par sa valeur nutritive que par sa
quantité et son prix (BABA, M., 1985:1). Les populations de Nziou et de
Londji I n'échappent pas à cette règle. Car, un coup
d'oeil dans le répertoire culinaire des groupes ethniques majoritaires
de ces villages à savoir les Batanga et les Mabi, nous donne de cerner
la place prépondérante du poisson dans leur vie quotidienne.
Chez les Mabi, l'on peut noter la récurrence du
«Doumbobi» (un bouillon ou sauce naturelle composée
du poisson frais assaisonné du piment, du sel, du citron) , du
«Doumboka» (mets de poisson constitué du poisson
frais assaisonné du piment , du citron, du sel suivi de son emballage et
de sa cuisson dans une marmite ou sur de la braise), du «Ndtoua
» ou sauce de mango sauvage (Irvingia Gaboneesis) qui n'est
autre qu'une combinaison de sauce tomate mélangée à la
patte de mango sauvage et du poisson grillé, du
«maban» est le poisson fumé pimenté...Chez les
Batanga, plusieurs mets meublent leur menu quotidien. Au rang de ceux-ci
figurent: l'«Ebanjéa» et le
«Djomba» dont les modes de cuisson sont similaires
respectivement à ceux du «Doumbobi» et du
«Doumboka» décrit plus haut, le
«N'ñukou» (sauce faite de noix, de poisson, du sel et
du piment) constituent des mets les plus régulièrement
consommés. Tous ont comme trait commun ou élément de base,
le poisson et en majorité du poisson fraîchement capturé.
Nous ne saurions oublier dans ce sillage de mentionner le poisson braisé
ainsi que d'autres sauces ordinaires dont le poisson en constitue un
élément indispensable.
D'une manière générale, l'on observe que
le poisson constitue une denrée d'appoint, un aliment de base fortement
valorisé, ce que DE GARINE I. (1979:79) reprenant JILLIFFE D. (1967)
appelle «une super-nourriture culturelle». Le degré
de disponibilité permanente de cette
88
ressource assure une certaine stabilité des
régimes alimentaires des populations concernées tandis que
situation contraire est perçue comme une crise. A ce sujet, FROMENT A.
(1996:41) reprenant MIRACLE M. (1961) et PAGEZY H. (1982) affirmait que:
«Une raréfaction saisonnière du super-aliment le plus
valorisé, comme la viande en forêt ou le poisson sur la
côte, induit un sentiment de faim...» pour les populations de
chacune de ces sociétés respectives. Notre séjour sur le
terrain nous a permis de faire le même constat au niveau des
préférences alimentaires ainsi que de leur rythme de consommation
par les informateurs. En effet, la consommation moyenne des mets à base
du poisson frais est de 4 fois environ par semaine en période
d'abondance, contre 2 en période de vache maigre. A juste titre, afin
d'assurer la disponibilité de cette denrée dans le quotidien des
populations de Nziou et de Londji I, et ceci dans un contexte marqué par
la pénurie et la concurrence accrue entre les différents acteurs
de pêche en présence, le concours des savoir-faire nouveaux n'a
pas rencontré de réticences majeures. Dans cette perspective, la
fusion des techniques de diverses origines vient répondre dans une
certaine mesure aux aspirations naturelles des populations de satisfaire leur
besoin en aliments, car dans toutes les sociétés, «la
quête alimentaire est au centre des activités de l'homme à
la recherche de sa subsistance...» (DE GARINE, I., 1996:26).
II-1-2-Mariage interethnique et intercommunautaire
Plusieurs alliances matrimoniales sont contractées
entre les locaux et les étrangers. Pour une fille, accepter devenir
l'épouse d'un pêcheur béninois et/ou nigérian est un
signe d'engagement dans l'activité de pêche au regard du
degré d'implication de ces communautés dans la filière,
mais aussi de la place qu'occupent leurs épouses dans le circuit de
commercialisation. Il ouvre la voie à des horizons divers dont les
relations entre les membres des familles unis par cette alliance, fait
naître des rapports préférentiels entre les deux blocs dans
les échanges des biens, des offres d'emploi ainsi que des savoirs. En
donnant une perspective nouvelle aux relations entre les familles unies par le
lien du mariage, il donne confiance à l'entourage des personnes
concernées, l'opportunité de mieux se connaître et
d'apprendre la manière et les techniques des autres. Tous ces
différents paramètres engendrent l'élargissement du
réseau social de formateurs dans les différents secteurs de
l'activité de pêche et font disséminer les savoirs. Nous
comprenons dont pourquoi selon SABINOT C. (2008:327) reprenant GERARD L.
(2003), «l'apprentissage culturel est entièrement pris dans
l'écheveau des relations quotidiennes» tant entre les Hommes
par le biais de leurs différents liens dont le mariage en constitue un,
qu'entre ces derniers et leur environnement immédiat d'où
provient l'essentiel de leurs ressources alimentaires et économiques.
89
Ainsi au niveau du transfert des savoirs en matière de
pêche et de fumage, les Nigérianes et Béninoises venues en
mariages dans les ménages autochtones amènent avec elles, leur
savoir-faire en matière de disposition du poisson ainsi que les
connaissances sur l'emploi des sources énergétiques à
forte vertu coloratrice et gustative. La spécificité de leur
connaissance dans ce domaine est reconnue de tous. C'est en ce sens qu'une
informatrice a exprimé toute sa fierté d'avoir à ses
côtés une talentueuse fumeuse nigériane comme belle soeur:
«Nous avons notre Nigériane dans la famille, la femme de mon
frère, elle nous apprend beaucoup de choses sur le fumage du
mbounga» (NGAH JULIE, Fumeuse, Batanga, Londji I, le18/12/2010).
En même temps, les autochtones parties en mariage dans
les communautés (béninoise et nigériane),
acquièrent les premières le fumage intensif en vigueur au sein de
ces groupes, sont les premières à adopter les fumoirs banda de
grandes dimensions, et à se spécialiser dans le fumage de
certaines espèces de poisson à titre illustratif, le mbounga
(Ethmalosa fimbriata) dont les nigérianes sont
désignées comme étant les leaders. En même temps,
elles restent porteuses des techniques en vigueur dans leur groupe d'origine.
C'est ainsi que, le fumage du «maban» (ou poisson
fumé pimenté) dans un premier temps n'était assuré
au niveau des campements nigérians que par les ressortissantes
camerounaises en mariage. Mais, avec le temps, il a progressivement
intégré les habitudes alimentaires de ces derniers. D'une
manière générale, ces différentes relations
viennent agrandir le cadre de concertation entre les acteurs de pêche et
par ricochet, ouvrent un boulevard au changement des techniques de travail.
II-1-3-Les rites en rapport avec l'activité de
pêche de moins en moins valorisés
Dans les sociétés traditionnelles africaines,
l'un des fondements majeurs de la durabilité des ressources repose sur
les croyances surnaturelles portées sur les entités divines
toutes puissantes et garantes de leur subsistance. Il est de ce fait
indéniable de reconnaître avec DEBOUVRY P. (1998:46) repris par
FOUKOU G. (2003:97) qu'en Afrique, l'environnement naturel fait partie de la
cosmogonie traditionnelle et devrait être géré comme tel.
Terre- ciel- eau, divinités majeures ou éléments
sacralisés, sont peuplés de génies bons ou malfaisants,
intermédiaires entre les divinités et les hommes. Ils leur
dictent comportements, principes et interdits. Dans ce sillage et pour revenir
aux pêcheries de Nziou et de Londji I, les ressources halieutiques
appartiennent aux divinités, aux «dieux de la mer»
reconnus sous la désignation de «déesses de
mer» ou «mami water» envers qui les rites ont
été initiés depuis les temps anciens , afin de
régler les situations de désharmonie entre les vivants et le
monde divin, de solliciter leur soutien dans les circonstances d'incertitude.
En effet, «pour mener à bien et à terme leur projet de
vivre, satisfaire leurs besoins primaires, basiques, organiques, fondamentaux,
secondaires et sociaux, les hommes exercent leur intelligence sur
l'environnement naturel dans lequel ils
90
vivent; ils inventent des pratiques, des
institutions[...]» MBONJI E.(2009:9-10). Dans ce sillage, STRAUSS L.
(1964: 343) estime à juste titre que: «Les rites apparaissent
comme un »para-langage» [...] les rites offrent à l'homme, le
moyen, soit de modifier une situation pratique, soit de désigner et de
la décrire». Dans les villages Nziou et Londji I, ceux vers
qui sont orientés les sacrifices ont les possibilités d'agir
positivement ou négativement sur la disponibilité du poisson
ainsi que sur la sécurité des hommes dans la mer. Seulement, pour
atteindre cette fin, l'exploitation judicieuse des ressources doit
s`opérer par l'adoption par les populations de pêcheurs, des
attitudes qui respectent l'éthique liée à l'environnement
marin. C'est en ce sens qu'en parlant des modalités d'exploitation
paisible des espaces communs partagés entre les êtres visibles et
invisibles (à l'instar de la mer), PAGEZY affirme que: «la
gestion n'est pas seulement un problème purement pratique, elle est
surtout une question philosophique... ce qui importe c'est d'éviter une
gestion athée, une gestion qui ne vise que le profit privé, qui
aborde le géré comme la propriété de
Personne» PAGEZY H. (1996 :457) citant SINGLETON M. (1982: 84). A
travers nos différents échanges avec les populations, il ressort
que ces diverses dispositions bien appliquées constituaient par le
passé une sorte de garantie quant à la disponibilité des
ressources halieutiques pour les populations locales.
Seulement, les pêcheurs dans leur immense
majorité estiment que l'efficacité d'antan n'est plus de mise.
Les rites sont pratiqués avec peu de résultats probants à
la fin. En même temps, la carence du poisson s'intensifie. Les causes
d'une telle situation sont imputables selon nos informateurs à l'esprit
d'égoïsme qui anime certains pêcheurs ainsi qu'au recours aux
forces magiques afin de maximiser les chances de capture au cours des
opérations de pêche. Toutes des attitudes contraires aux normes
éthiques recommandées par les «dieux de
l'eau». A juste titre, un de nos informateurs du village Londji I
estime en effet que:
Ce rite perd de sa valeur parce que les gens ne
respectent pas toujours les règles. Lorsqu'on demande aux gens de ne pas
aller en mer, pendant une période, ils partent toujours .Ils ne peuvent
pas supporter tous ces jours sans aller en mer. Ils partent avec leurs
saletés. Ce qui fâche les dieux de l'eau .Quand cela arrive, Ils
[les dieux de l'eau] se demandent si on est venu les tenter en faisant
le rite. C'est pourquoi ils n'envoient pas le poisson. Si on le fait
aujourd'hui et bien, et que les gens respectent les règles, il y aura
beaucoup de poissons, le poisson viendra retrouver les gens sur la plage. Mais
si les choses continuent comme elles sont, il n'y aura rien de bien
(NGOUNDI LUC, Mabi, Londji I, Le 12-01-2011).
A la question de savoir pourquoi certaines connaissances et
pratiques ancestrales en rapport avec la pêche sont de moins en moins
valorisées, les parents estiment que les jeunes sont devenus craintifs
de la tradition, ceci sous l'effet des nouvelles églises et mais aussi
de la modernité ambiante caractérisée par une
montée en puissance des actions individuelles. Ces
91
derniers, dont le rôle dans le suivi des rites à
travers la surveillance des eaux afin qu'elles ne soient violées par des
inconnus mal intentionnés, sont de nos jours devenus les complices des
personnes qui s'y rendent s'ils n'en font pas partie de ces équipes. Le
souci principal de ces derniers comme tout citoyen dans une situation de crise,
consiste désormais à défendre de prime à bord leurs
intérêts personnels avant d'explorer dans quelle mesure le bien
être collectif peut être pris en compte.
Le travail au niveau du cercle familial n'est plus toujours
la chose la mieux partagée par les différents membres qui le
composent. En effet, les jeunes ont la possibilité de travailler en
toute indépendance en occupant une fonction dans la nouvelle
configuration (pêcheur principal, pêcheur assistant, de
chargeur...) auprès des propriétaires des matériels de
pêche implantés dans leur zone de résidence. Ceci
réduit les possibilités d'encadrement parental permanent et
conduit à une situation de méfiance entre les
générations qui sur le plan de la transmission des valeurs
culturelles n'est pas sans conséquence. C'est ainsi que les populations
observent une disparition progressive des maîtres desdites
cérémonies.
Toujours dans la rubrique des causes, un doigt accusateur est
porté sur les autorités traditionnelles censées conduire
en toute honnêteté les cérémonies. Ces
dernières se livrent quelquefois à des opérations
d'escroquerie de la population au détriment d'une réelle
communication avec le monde des ancêtres. En effet, bon nombre
d'informateurs estiment que des contributions financières ont
été exigées aux populations depuis environ dix mois et que
malheureusement, rien n'a été fait de manière
régulière dans le sens d'assurer ces dernières. En
pareille situation d'incertitude, pour répondre aux besoins de
subsistance, la voie du salut la plus recommandée reste pour bon nombre
de pêcheurs, l'adoption des «techniques de pointes» et toutes
les connaissances dont chaque acteur estime à même de lui
permettre de mieux capitaliser ses efforts pendant le temps consacré
à la pêche et /ou au fumage de poisson.
II-2-Facteurs exogènes
Au rang des facteurs de dynamique externe à la culture
des populations locales, nous avons identifié entre autres le travail en
équipe, la migration, la croissance de la demande dans lesdites
localités, les projets de soutien en direction du secteur de
pêche, etc....
II-2-1-Le travail collaboratif entre les
différents groupes de pêcheurs
Dans le processus de transfert des savoir-faire entre les
communautés en présence, le facteur d'une bonne cohabitation et
des relations apaisées entre ces dernières ont joué un
rôle remarquable. En effet, dans un processus dynamique,
l'intimité et la proximité sociale entre les individus,
apprenants et enseignants, constitue une dimension essentielle à
l'apprentissage (SABINOT, C., 2008:307). La situation de collaboration entre
les acteurs crée des opportunités
92
d'assistance, d'entraide et par ricochet des moments
d'échange d'expérience sur les spécificités des
différentes techniques de pêche et de conservation existantes. A
ce sujet les propos reçus d'une béninoise en constituent une
illustration parfaite : «A certains moments, ma voisine d'en haut
vient souvent m'aider à classer quand j'ai beaucoup de poissons. C'est
comme ça qu'elle classe déjà son poisson comme
nous» (CASSA ERNESTINE, Fumeuse, Popo, Nziou, le 15/01/2012).
Cette méthode, introduction béninoise fait
l'unanimité au sein des populations du village Nziou. La preuve avec ce
témoignage d'une fumeuse Batanga: «Ce que les femmes d'ici ont
appris chez les Béninoises, c'est leur façon de disposer le
poisson sur le grillage. Elles alignent bien leur poisson et ça leur
permet de mettre une grande quantité de poisson parce qu'on peut
facilement superposer. Avec cette méthode, on fume bien et
rapidement» (EDJIDJE YVETTE, Batanga, le 10/01/2011). Elle permet
ainsi aux uns et aux autres de compléter leurs savoir-faire ou de revoir
tout simplement leur manière de procéder. La situation
décrite dans le secteur de fumage est transposable au niveau de la
pêche avec la proximité permanente des pêcheurs autochtones
et migrants (Nigérians et Béninois) dans les mêmes
embarcations de pêche, d'où la dissémination rapide des
différents savoir-faire au sein de ces groupes de pêcheurs
respectifs.
II-2-2-La migration
La migration génère la cohabitation et
échange d'expériences entre les différents groupes humains
qui participent dans l'exploitation des mêmes pêcheries. En
évoquant la question sur les causes des changements techniques, une
constante s'est dégagée en attribuant la majeure partie des
innovations en matière de capture et de conservation des produits
pêche à l'avènement des ressortissants ouest africains. Au
rang des ces communautés à l'origine de ces savoirs nouveaux,
figurent les pêcheurs béninois et nigérians. C'est ainsi
que les expressions telles que «quand les
Nigérians/Béninois sont arrivés», «les
méthodes de fumage des Béninois», «c'est
une introduction des nigérians», «ils étaient
les premiers à...», sont apparues à plusieurs reprises
au cours des entretiens que nous avons eus avec les informateurs autochtones
ayant eu à un moment précis, des contacts permanents avec ces
acteurs étrangers. A ce sujet et après observation sur le
terrain, il nous est donné de remarquer que dans la panoplie des
techniques utilisées dans notre zone d'étude, nombreuses sont
introduites par le biais du contact interculturel entre les acteurs de ces
différentes communautés.
Au niveau du fumage à titre illustratif, le classement
du poisson sur les claies a connu d'énormes mutations en quelques
décennies de cohabitation des communautés camerounaises et celles
étrangères. Interrogée sur les origines des changements
relevés dans les pratiques de fumage, une fumeuse Mabi du village Nziou
fait des remarques qu'elle résume en ces termes:
93
«Quand les béninois sont arrivés, nous
avons vu leur façon d'arranger le poisson. Ils plient simplement et
forment le rond avec leurs mains et classent sur la claie. Ça nous donne
moins de travail et le fumage devient rapide. Nous avons dont vu que c'est la
bonne méthode» (BINDELE MARCELLINE, Fumeuse, Mabi, Nziou, le
15/01/2012). Dans le même sillage, l'usage des fumoirs à grandes
dimensions, l'usage des sources alternatives telles que: les écailles de
poisson et la paille font partie du patrimoine technique exogène qui
sont venues se greffer aux stratégies locales d'embellissement des
produits fumés. Cette même situation est vécue dans le
secteur de la pêche avec une multitude de stratégies et
matériels de pêche à l'instar de la technique de sondage,
la technique d'emprisonnement, la pêche long séjour,
l'introduction de la motorisation.
La dissémination rapide de ces techniques
engendrée par une coexistence pacifique entre les acteurs de pêche
originaires des cultures différentes, a significativement impacté
les connaissances utilisées dans les pêcheries de Nziou et de
Londji I. Chose normale puisqu' «en règle
générale, la proximité des cultures quel qu'en soit le
degré, joue comme un facteur positif qui facilite grandement
l'acculturation» (ABOU, S., 1981:53) dont l'influence sur la
dynamique des cultures est non négligeable. C'est à juste titre
que les migrants contribuent par leurs méthodes de travail à la
résolution de certaines contraintes existentielles dans les zones
d'accueil (NEISHEIM, I. et al., 2006) comme c'est le cas dans les villages
Nziou et Londji I. Car, outre leurs conséquences sur le fonctionnement
des unités de pêche, ces acteurs ont une influence significative
sur la diffusion de la technologie et les savoir-faire (CHABOUD, C. et
CHARLEDSO, M., 1991).
II-1-3-Croissance des besoins en ressources halieutiques
dans la région
Le poisson de Kribi qu'il soit frais ou fumé, est
devenu progressivement une denrée très sollicitée, par les
populations locales, celles des grandes métropoles du pays (Douala,
Edéa, Yaoundé), ainsi que les travailleurs et habitants des zones
où sont implantées certaines grandes sociétés
agro-industrielles à l'instar de la SOCAPALM, HEVECAM. Cette situation a
aussi augmenté la demande des populations en produits halieutiques et la
nécessité de procéder à une production de masse.
Pour répondre à cette forte demande sociale en matière de
poisson, le changement des forces et formes de production s'est imposé
aux exploitants des pêcheries comme une nécessité
absolue.
II-2-4- Les initiatives extérieures aux villages
Nziou et Londji I
Pour réduire la dépendance du Cameroun des
importations des produits halieutiques, certains programmes et politiques ont
été envisagés et mis en oeuvre. Parmi ces initiatives, on
peut citer le Projet d'Appui au Développement de la Pêche
Artisanale(PADPA) et Maritime financé par le programme Pays Pauvres
Très Endettés (PPTE) avec ses multiples volets tels que
94
la formation, l'appui des bénéficiaires en
matériels de pêche, la réduction des exportations
informelles des produits de pêche etc... Dans l'ensemble de ces
programmes, les connaissances, les techniques et matériels mis à
la disposition des pêcheurs autochtones se situent dans une logique de
transformation des savoir-faire endogènes (en matière de
pêche) vers les savoirs nouveaux et jugés plus efficaces par les
promoteurs. L'on peut ainsi recenser dans la liste des matériels
d'assistance régulièrement remis aux pêcheurs: les pirogues
à moteur, les moteurs hors bord, les filets, les gilets de sauvetage,
les flotteurs.
L'action des ONG locales à l'instar de l'OPED avec
l'introduction d'une technologie à faible consommation d'énergie
aujourd'hui abondamment adoptée par les fumeuses de Nziou et de Londji
I. Parmi ces communautés figurent les camerounais dans leur
diversité ethnique, les ressortissants béninois et
nigérians. Nous pouvons aussi mentionner dans la même
lancée l'apport des investisseurs autochtones ou allogènes sur
les matériels de pêche (pirogue, moteur, filets) suivi de la
signature des contrats d'exploitation avec les pêcheurs locaux. Ces
initiatives de l'Etat et de ses partenaires aux objectifs et finalités
spécifiques font partie des éléments incitatifs à
l'adoption des nouvelles pratiques dans l'activité de pêche.
III-COMPRENDRE LES MUTATIONS DES TECHNIQUES DE PECHE
ET DE CONSERVATION
III-1-Perception et efficacité des techniques
comme source de changement
Les techniques de pêche et de conservation des
ressources halieutiques propres à chacune des communautés de
pêcheurs présentent dès le départ pour ses
praticiens, des atouts et des limites comme nous l'avons relevé dans les
deux précédents chapitres. Ces remarques portées sur les
techniques propres à chaque communauté de pêcheurs ouvrent
la voie à une potentielle intégration dans l'arsenal existant,
des savoir-faire actualisés ou nouveaux à même de combler
les défaillances constatées. Dans ce sillage, les acteurs de
pêche dans une situation de cohabitation et de contact permanent,
observent et portent des jugements sur la diversité des techniques
existantes dans leur milieu de vie, jugements qui expriment leur degré
d'intéressement ou non aux différents savoirs. Dans cet
élan, les Batanga et Mabi sans toutefois totalement remettre en cause
les qualités reconnues aux techniques endogènes, estiment que les
connaissances en matière de capture des pêcheurs ouest africaines
notamment celles des ressortissants Béninois sont d'une
efficacité sans pareille. Ces derniers en veulent pour preuve la
capacité et la rapidité par lesquelles les pêcheurs ouest
africains capturent et transforment les produits de pêche. De leur
côté par contre, les pêcheurs béninois et
nigérians jugent les techniques employées par les acteurs locaux
de `'techniques en dessous de la moyenne», c'est-à-dire des
savoir-faire «inefficaces» selon leurs expressions. En croisant ces
perceptions mutuelles,
95
l'on peut aisément comprendre pourquoi entre ces
communautés de pêcheurs, une disparité se fait ressentir au
niveau de l'intégration à sens unique des nouvelles connaissances
dans leurs pratiques de pêche. A ce sujet, nous pouvons nous
référer au tableau de synthèse ci-dessous.
Techniques de Capture
|
Batanga
|
Mabi
|
Nigérians
|
Béninois
|
Autres Ethnies du Cameroun
|
pêche à la Canne
|
X
|
X
|
|
|
X
|
pêche à la senne de plage
|
X
|
X
|
|
|
X
|
pêche à la palangre
|
X
|
X
|
|
|
|
Pêche à la ligne
|
X
|
X
|
|
|
X
|
Technique d'empri-
sonnement
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Technique d'écoute Ou de sondage
|
X
|
X
|
|
X
|
|
Pêche de trois jours
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Techniques de conservation
|
|
Congélation
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Fumage par les demi- fûts
|
X
|
X
|
|
|
X
|
Fumage par les
fumoirs en piquets (petites dimensions)
|
X
|
X
|
|
|
X
|
Fumage par les
fumoirs en piquets (grandes dimen-sions)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Fumage amélioré
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
Tableau 8: Récapitulatif des techniques
phares de capture et de conservation du poisson et les communautés qui
en font usage.
A titre illustratif, la pêche au `'tirez-tirez»,
la pêche à la canne, la pêche à la ligne, la
pêche à la palangre pour ce qui relève du domaine de
pêche, l'emploi des fûts, des fumoirs en piquets (petites
dimensions) pour le fumage, tous relevant du savoir-faire local en constituent
une preuve patente. Par contre les savoir-faire introduits à l'instar du
mode de pêche de trois jours, la technique d'emprisonnement ou
d'encerclement, la technique d'écoute ou de sondage, les fumoirs en
piquets de grande dimension, la congélation, le fumage
amélioré, l'emploi des nouvelles sources substitution au bois
etc...se propagent plus rapidement au sein de tous les groupes en
présence.
En toute connaissance de cause, d'autres dimensions relatives
à la spécificité des techniques de pêche entrent en
compte dans le processus d'adoption des nouvelles compétences.
96
Bien que la technologie dans le domaine de la pêche
possède une grande souplesse et une facilité remarquable à
assimiler les nouveautés les plus originales et à les
intégrer à la panoplie traditionnelle (BABA, M., 1985:31), il est
indéniable de reconnaître qu'au delà des qualités
intrinsèques d'une nouvelle technologie, sa force d'imposition se trouve
aussi dans sa capacité à susciter l'adhésion de nombreux
alliés dans un contexte précis. Dans notre situation
d'étude, font partie de ce groupe d'adhérents: les principaux
acteurs de pêche identifiés. Ainsi, dans un environnement
où prévalent la carence ainsi que la concurrence pour
l'accès aux ressources, l'efficacité d'une technique peu importe
son origine constitue une condition stimulante des différents acteurs
qui les adoptent. Au niveau des captures, l'océan principal milieu de
collecte des ressources halieutiques pour les populations est un espace de
liberté ; pour cela, le seul moyen pour les pêcheurs de tirer le
maximum de profit, reste l'acquisition et l'emploi d'un ensemble de savoir
adapté à cet écosystème.
A ce sujet, CHLOUS D. (2005:56) citant DUFOUR A. (1997),
estime qu'étant un: «Bien public, l'espace maritime est, en
effet, inaliénable. Il ne peut être possédé en
propre par un individu ou une collectivité. Si possession il y a, elle
est technique et cognitive et se fonde non sur l'espace lui-même mais sur
un capital de gestes, de savoirs, de mémoire...», dont doivent
disposer les différents groupes de personnes qui fréquentent et
vivent au dépend des ressources qui s'y trouvent. Ces connaissances
construites et/ou acquises, donnent aux acteurs de pêche une assurance et
une autorité sur leur environnement ainsi que les ressources dont il
contient. A juste titre, CHLOUS D. (2005:56) à propos des savoirs des
pêcheurs d'ormeaux, pense que: «Les savoirs participent à
la construction de la légitimité de ces acteurs, ils sont une
forme d'appropriation symbolique du territoire». Dans cette optique,
au sein des communautés de pêcheurs de Nziou et de Londji I, la
technique qui s'impose qu'elle soit au niveau de la pêche ou de la
conservation du poisson, est celle qui apporte dans une certaine mesure du
nouveau dans le quotidien des populations, qui de manière pratique vient
contribuer à l'épanouissement de ces dernières en
réduisant les contraintes inhérentes à leurs
activités.
En d'autres termes, les techniques de capture qui suscitent
l'engouement des populations offrent à ces dernières plusieurs
opportunités. Ainsi, elles peuvent permettre d'alourdir les cargaisons
au cours des opérations de pêche; tandis que la congélation
favorise une disponibilité permanente des produits frais et donne la
possibilité d'effectuer la pêche de longues durées, pendant
que les techniques de transformation améliorée du poisson
augmentent les possibilités d'un séchage rapide et harmonieux des
produits. D'une manière sommaire, la maîtrise des technologies
`'fortes» et `'enviées» en matière de capture par les
acteurs de pêche, favorise aux côtés des habiletés
acquises par expérience, des connaissances individuelles ou de groupe,
«la
97
sûreté du geste, la rapidité de la
décision, l'élimination des temps morts» (DELBOS, G. et
JORION, P., 1990:33). L'ensemble de ces éléments constituent dans
une moindre mesure des sources de motivation en vue d'adopter des savoir-faire
actualisés.
III-2-Dynamique adaptative des populations des
pêcheurs à l'origine du changement
Elle se situe sur un triple aspect: Les contraintes
économiques, l'acquisition des savoirs techniques et l'adaptation
à l'environnement qui se trouve entre la carence des ressources et la
rivalité entre les acteurs. Pour s'adapter au nouvel environnement
économique, afin de conjuguer les efforts, la vie est marquée
dans les villages Nziou et Londji I par une montée en puissance des
regroupements associatifs entre d'une part, les membres d'une communauté
et d'autre part, les ressortissants des communautés différentes.
A cause des potentielles retombées, se retrouver dans un groupe
associatif aux finalités bien indiquées est devenue une mode au
sein des populations. Chose normale car, comme l'affirme MAISONNEUVE J.
(2010:5) «le groupe est associé à l'idée de force
[...] se`' regrouper» exprime bien l'intention de renforcement
mutuel d'individus qui se sentent isolément impuissants». En
effet, ces structures paysannes bien organisées constituent non
seulement des forces de défense des droits des membres, des cadres
d'échange d'expériences entre les collègues sur les
contraintes et opportunités de leur activité, mais
également sont des organes à la quête des programmes d'aide
et d'assistance allouée par l'Etat et/ou ses partenaires sociaux.
Dans les villages étudiés, plusieurs
savoir-faire en matière de pêche et de conservation des produits
halieutiques existent. En fonction des aspirations des uns et des autres,
chaque groupe de pêcheurs prend des initiatives allant dans le sens
d'acquérir des compétences `'fortes»,
bénéfiques et surtout compétitives. Au regard des envies,
des défis quotidiens des communautés en matière de
quête alimentaire, de subsistance et de revenu, l'adoption des cultures
de pêche et de fumage nouvelles par ces dernières doit être
comprise comme la résultante des initiatives individuelles visant
à multiplier les probabilités de capture pour ce qui est de la
pêche, assurer un état de fraicheur durable et une transformation
rapide pour ce qui est de la conservation. Cette sélection des savoirs
nouveaux, des pratiques jugées à tort ou à raison
efficaces, découle même des quêtes permanentes des
populations de toutes les sociétés. Nous pouvons dont comprendre
pourquoi CLAIDIERE N. (2009:160) reprenant RICHERSON et BOYD, (2005) affirme
que la: «culture est le résultat de mécanismes
d'apprentissage originaux qui ont évolué pour permettre à
l'homme de s'accommoder à des environnements variables temporellement et
spatialement». Les communautés de pêcheurs des villages
Nziou et Londji I ne sont pas loin de cette réalité.
Cependant comment s'y prendre dans un environnement où
rien n'est donné d'avance? Pour parvenir à leur fin, les
populations s'en servent de prime à bord des opportunités que
leur
98
offre la cohabitation à savoir: les mariages
interethniques, la situation de contact permanent, le travail en équipes
composées des ressortissants des diverses cultures aux
compétences spécifiques et variées, mais aussi de la
multiplicité des agents de transmission des connaissances au sein de la
communauté. Sur ce dernier point, nous avons relevé dans cette
catégorie d'acteurs qu'en dehors de l'entourage immédiat du jeune
pêcheur ou de la jeune fumeuse de poisson, les ressortissants des autres
communautés présentes sont fortement impliqués dans ledit
processus.
Dans ce contexte, il faut relever avec force que, la
créativité et le dynamisme sont nécessaires aux
différentes parties en cas de résistance, car si les techniques
se répandent assez rapidement bien qu'elles soient à sens unique,
il convient de reconnaître que la combinaison de l'esprit d'initiative
des communautés ou acteurs en quête de nouveaux savoirs et de la
disponibilité d'ouverture de celles détentrices des savoirs
sollicités, a offert dans les villages Nziou et Londji I un climat
propice à l'acquisition de nouvelles compétences ou à la
dynamique permanentes des techniques. Chose juste puisque la conservation ou le
changement rapide des traits culturels d'une manière
générale et des techniques de pêche et de conservation en
particulier, dépend des circonstances contextuelles et des besoins des
différents acteurs ou parties en présence. Car selon GUGLIELMINO
C. et al. (1995:7589), «les mécanismes de transmission
culturelle, avec leurs différents degrés de conservatisme,
déterminent la stabilité des traits culturels». En
fonction des situations et opportunités d'échange qu'offre le
contact tant en mer qu'au niveau des ménages entre les ressortissants
des différentes communautés de pêcheurs (camerounais,
nigérians et béninois) détenteurs des savoirs multiformes,
les acteurs de pêche acquièrent progressivement les techniques
envieuses apportant de ce fait, du nouveau dans leurs méthodes de
travail.
Toutefois, il convient de rappeler que dans une situation
où sévissent la carence et dans une moindre mesure la concurrence
pour l'accès aux ressources, chaque groupe de pêcheurs
présent en fonction de ses besoins, perfectionne au quotidien ses
savoirs, nourrit des ambitions et reste en éveil afin de tirer le
meilleur profit des portions des ressources halieutiques exploitables. Dans cet
élan, l'on note une implication stratégique des
communautés par secteur d'activité. La présence massive
des communautés béninoises et nigérianes au niveau de la
pêche est une manière pour ces derniers de contrôler
l'ensemble de la filière. A ce sujet, c'est le pêcheur qui
décide du choix des clients, des opportunités de pêche et
de vente. Ainsi, dans cette situation, plus un groupe d'acteurs a des
motivations supplémentaires, plus est significative sa fréquence
dans la participation dans l'activité de pêche.
99
III-3-Modification du prix relatif et degré de
participation des différents acteurs de pêche
La pratique de la pêche a connu plusieurs modifications
au niveau des pêcheries côtières de Kribi d'une
manière générale et celles de Nziou et de Londji I en
particulier. Pour exercer en toute liberté la pêche, il faut
désormais disposer d'un certificat de navigabilité au prix de
44000francs CFA renouvelable tous les ans moyennant une somme de 22000 francs
CFA environ, d'un permis de pêche au prix de 3000francs CFA. Et comme ces
contraintes ne suffisaient pas, la concurrence, la carence croissance due
à la dégradation des ressources et à la pollution marine
ont engendré la nécessité d'employer les engins plus
coûteux. En effet, le pêcheur peut acquérir le moteur
moyennant 1500000(cent cinquante mille) FCFA environ, la pirogue à
moteur à 400000(quatre cent mille) FCFA, les ballots de filets
300000(trois cent mille) FCFA. La nécessité de pratiquer une
pêche long séjour avec ses lots de dépenses; le
pêcheur est appelé à débourser pour une sortie en
mer des sommes considérables estimables entre 25000(vint et cinq mille)
et 30000(trente mille) FCFA. Moyens jugés excessifs par bon nombre de
nos informateurs. Ces situations ont entrainé une sorte d' handicap pour
les acteurs qui ne remplissent pas l'intégralité de ces
conditions à jouer le rôle de subalternes. Car, seuls les
détenteurs des matériels de pêche, décident de la
carrière des employés (personnel navigant) et des
opportunités des opérations de pêche sans oublier la
détermination du profil des acheteurs dans certaines circonstances.
D'après les résultats de nos entretiens, il
ressort que dans la catégorie des détenteurs des
matériels, les pêcheurs béninois et nigérians
présents sont majoritaires. Ainsi, au côté de cette
facilité d'accès par rapport aux pêcheurs locaux dont leur
octroie leur statut économique, le souci de recouvrir les fonds investis
amènent ces derniers à rester en permanence en activité.
Ces aspects économiques peuvent en partie expliquer le niveau de
participation limitée des populations locales en dépit des
observations apparentes sur l'uniformisation des techniques de capture et de
conservation des produits de pêche. Puisqu'en réalité, pour
qu'un savoir nouvel puisse intégrer sans anicroche les connaissances
d'un individu et influencer son mode de fonctionnement, il faut en qu'en dehors
de son bien être recherché, que ce dernier dispose du temps, des
moyens de son expérimentation et de sa pérennisation. Sur ce
sujet, CHAREST PAUL estime que:
Le progrès technologique répond au besoin
de tous les hommes de toutes les sociétés d'augmenter leur
bien-être en minimisant leurs efforts tout en augmentant au maximum leur
rendement. Dans cette recherche de la maximisation, les changements
technologiques sont rapidement acceptés à condition que les
avantages en soient apparents et que l'on dispose de capitaux suffisants
(CHAREST, P., 1973:45).
100
Etant sous la domination de leurs collègues
béninois et nigérians plus assis financièrement,
l'engagement des acteurs locaux dans la pêche ne peut être que
limité. En toute connaissance de cause, hors mis ces différents
scénarii, certains éléments sont à prendre en
compte dans cette tentative d'explication. Parmi ces aspects, nous pouvons
mentionner:
4 La diversification des activités de productions des
populations. En effet, si les pêcheurs issus de la migration vivent
essentiellement de la pêche et de ses activités connexes, les
acteurs locaux se livrent en dehors de cette activité principale
à l'exploitation et à la commercialisation du sable et du bois,
mais aussi pratiquent la chasse et l'agriculture. Ces différentes
occupations complémentaires les amènent dans une moindre mesure
à consacrer par moment un temps relativement court à
l'activité de pêche.
4 L'adoption massive des techniques exogènes
nécessite un temps pour leur assimilation et intégration
profondes dans les savoir-faire locaux. Dans ce sillage et à partir de
la panoplie des techniques introduites, valorisées et utilisées
par les différentes communautés, nous pouvons comprendre que les
pêcheurs locaux ne peuvent surpasser dans un écart de temps assez
court les personnes ou groupes d'acteurs promoteurs de certaines techniques
à la «mode». Pour atteindre le but escompté, il leur
faudra en dehors d'une motivation supplémentaire et permanente, plus de
temps afin qu'à travers leur expérience, les différents
acteurs puissent rivaliser à armes égales.
4 Les perceptions de la disponibilité des ressources
halieutiques sont significatrices et donnent quelques indices sur les causes de
leur subordination. Ainsi, la perception du poisson comme une ressource qui
restera éternellement disponible par certains, place la
compétition attendue entre les acteurs des différentes
communautés comme une bataille inopportune. Les propos de ce
pêcheur décrivent mieux cette vision partagée par plus d'un
pêcheur autochtone: «le poisson ne finira jamais dans l'eau. Les
autres pêcheurs sont de passage, nous sommes d'ici et ils iront nous
laisser avec notre mer» (NLEND ALBERT, Pêcheur, Batanga, Londji
I, le 19/12/2010). Dans cette logique, ces derniers ne sont pas dans une
pêche de compétition, mais une pêche de subsistance, car
comme l'avait déjà relevé KEKE M. et al. (1993:23), les
populations camerounaises côtières traditionnellement
tournées vers la mer, ont toujours considéré la
pêche comme une activité de subsistance. Par contre les
pêcheurs béninois et nigérians se livrent à une
pêche de compensation, une pêche axée sur la maximisation
rapide du profit. Fort de leurs multiples obligations, la principale source de
revenu qu'est la pêche, est en permanence en exploitation. C'est
pourquoi, malgré le degré de changement observable dans leur
activité principale de survie, le degré de participation des
locaux dans l'exploitation des ressources halieutiques reste moins important
par rapport aux acteurs issus de la migration.
101
Cependant, le changement des techniques étant
dès lors une réalité vivante, quelles conséquences
entraine-t-il dans le quotidien des populations de Nziou et de Londji I ?
IV-IMPACT DE LA DYNAMIQUE DES TECHNIQUES DE PECHE ET
DE COINSER-VATION DU POISSON DANS LES VILLAGES NZIOU ET LONDJI I.
Que nous soyons au niveau des captures que de la
transformation du poisson, il ressort des entretiens que les techniques
actualisées de pêche et de fumage ont apporté des
nouveautés multiformes au rang desquelles l'adoption d'une nouvelle
organisation des rapports entre les acteurs de pêche, une
réduction des risques de métier de pêche et de fumage,
l'émergence de la pêche de compensation, et des conflits entre les
acteurs...
IV-1-La pêche de compensation aux
conséquences multiples.
Pour réussir dans l'environnement actuel, ce qui
importe pour les utilisateurs c'est d'exploiter le maximum pour gagner de
l'argent indispensable pour les échanges et au recouvrement des
financements engagés dans de l'activité de pêche. A cet
effet, les pêcheurs multiplient le nombre de sections de filets dans
leurs activités quotidiennes. Ainsi, des kilomètres de filets
barrent en permanence l'océan ainsi que les cours d'eaux. Situation qui
ne va pas sans inconvénient, puisque les populations riveraines font
état de la rareté du poisson avec pour point de repère
l'obligation de parcourir de longues distances en mer et d'effectuer de longs
séjours dans l'espoir de capturer une quantité raisonnable de
poissons. Dans ce sillage, le témoignage de cet informateur explique
mieux la situation ambiante: «Avant, on n'avait pas besoin de passer
des jours et nuits en mer pour avoir du poisson. Il y en avait en abondance un
peu partout. Maintenant comme le poisson est devenu rare, les gens sont parfois
obligés de passer deux, trois voir quatre jours en mer afin d'avoir de
quoi se nourrir» (NANGA JEAN, Pêcheur, Batanga, Londji I, le
19/12/2010).
Les raisons d'une telle situation sont partagées entre
la pression croissante des divers groupes qui exploitent ces ressources
(Béninois, Nigérians et pêcheurs locaux). Mais à
cela, les populations font état de la violation des zones de pêche
par les chalutiers qui au delà de la surexploitation et de la
destruction du matériel de pêche des pêcheurs artisanaux,
contribuent à la pollution des eaux à travers les avaries de
poissons qu'ils y déversent. Ceci remet en scène la question
d'accessibilité aux ressources, car il est démontré que la
situation de libre accès à l'exploitation des ressources
côtières a pour effet de diminuer les rendements par unité
de pêche, la dégradation progressive de l'environnement
côtier et à la surexploitation de la plupart des ressources
aquatiques (BREUIL, B., 2000). Dans cette circonstance, bien que l'océan
soit aussi vaste et riche en ressources halieutiques, nous pensons que si rien
n'est fait dans le sens de limiter les effets responsables de la
surexploitation, la situation ira sans cesse croissante avec ses
Les raisons de cette situation résident autour de la
ressource halieutique qui devient de plus en plus rare face à une
montée en puissance du nombre d'exploitants. Mais au cas où le
coupable
102
lots de conséquences sur la nature des relations entre
les acteurs de pêche, les acteurs et leur écosystème et sur
la survie des populations riveraines.
En même temps, l'on remarque que l'adoption des
pratiques similaires de capture, entraîne une uniformisation des
calendriers de pêche dans bon nombre de pêcheries. Ce qui est
à l'origine de la multiplication des opérations et une
présence massive et régulière en mer. Ainsi, le partage
des mêmes modes et zones de pêche fait naître plusieurs
accrochages et des conflits liés à l'exploitation. Parmi ces
conflits figurent: les coups de vol du poisson et du matériel de
pêche, le sabotage des filets des collègues jugés
encombrants. A ce sujet, il convient de reconnaître que l'uniformisation
des opérations de pêche amène les pêcheurs à
se déplacer dans le cadre de la pêche long séjour pendant
les mêmes écarts de temps (nous parlons ici en terme de jour de
départ et d'arrivée), cette situation crée au large une
sorte d'embouteillage au moment de la circonscription des zones de pêche.
Avec l'emploi des filets sous marin, les pêcheurs rencontrent
régulièrement le problème de superposition des filets. Au
moment du retrait, les acteurs dont les filets ont été
superposés ont comme seule option que de couper les filets responsables
de la superposition afin de faciliter la tâche aux autres pêcheurs
de retirer leurs filets; c'est ce qui se dégage des propos de ce
pêcheur sur le sujet: «Parfois en mer, pour aisément
émailler ton filet, tu peux te trouver obliger de couper un filet qui
bloque le tien. Mais ce qu'on fait dans cette situation, c'est de le rattacher
par la suite, afin que son propriétaire ne perde pas son filet et ne
rentre bredouille chez lui» (Pêcheur, Batanga, Londji I, le
14/12/2010).
Ces propos de bonne foi ne sont pas toujours les seules
motivations de tous ceux qui fréquentent la mer. En effet, certains
pêcheurs en période de carence, se livrent carrément aux
opérations de pillage. En ce sens, ces derniers sont à mesure de
diviser le filet et /ou de le faire disparaître avec tout son contenu.
Bien qu'il soit difficile d'identifier les coupables étant donné
que la majorité des infractions se déroule en nocturne, les
victimes dans leur ensemble rejettent la responsabilité sur les
personnes de mauvaise foi, les ennemis qui décident de régler les
comptes, ou simplement sur les ressortissants de la communauté voisine
comme en témoignent les propos de ce ressortissant nigérian:
«Il y a de fois, tu arrives en mer, les gens coupent
ton filet, soit ils enlèvent le poisson dessus, soit, ils partent avec
le tout, le poisson et le filet. Mais ceux qui font ça ce sont plus les
Kribien. Lorsqu'ils font çà, ils vont vendre dans les autres
débarcadères. Chaque fois qu'ils volent ils ne peuvent accoster
dans le débarcadère du propriétaire du filet. Ce n'est
vraiment pas bien, [...]» (Pêcheur, Nigérian, Londji I,
le 13/01/2011).
103
est clairement identifié, la victime peut être
dédommagée à la suite d'un procès ou d'un
arrangement auprès d'une autorité compétente.
IV-2-Modifications des conditions de travail et le
circuit de distribution des produits de pêche
Pour ce qui est de la rémunération, l'on
remarque un impact direct sur le mode de répartition des gains entre les
acteurs de pêche et sur les mécanismes d'exploitation et de
distribution des ressources halieutiques. Dans les villages Nziou et Londji I,
le système de distribution des gains de la pêche, s'appuie sur
l'existence des parts où, le capital investi et le travail fourni par
chacun des membres de l'équipe sont respectivement
rémunérés sur une base équivalente dans laquelle le
montant des revenus individuels est proportionnel au volume d'une cargaison de
pêche. A ce titre, après avoir décompté les
dépenses générées par le carburant et la ration,
les gains sont désormais répartis en cinq parties égales:
Une part pour le propriétaire de la pirogue, une pour le
propriétaire du moteur, l'autre pour le propriétaire du filet,
une ensuite pour le capitaine de bord et la dernière pour le
pêcheur assistant. Si le patron est propriétaire de l'ensemble du
matériel de pêche (filet, pirogue, moteur), il aura droit à
trois parts; s'il est membre de l'équipage, il recevra de manière
proportionnelle, le nombre de part correspondant à ses multiples
casquettes c'est-à-dire quatre.
Au niveau du circuit de distribution, le système de
commercialisation des produits de pêche est devenu très complexe
dans les localités de Nziou et de Londji I. Si par le passé, la
pêche était essentiellement destinée à la
subsistance des populations locales et gérée par les hommes, elle
est devenue une activité lucrative et de ce fait, elle voit
l'intervention dans la filière d'une multitude de personnes au rang
desquelles les pêcheurs, les grossistes du poisson frais, les semi
grossistes, les fumeuses, les détaillantes et les consommateurs.
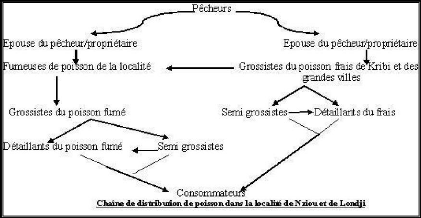
104
Dans cette nouvelle configuration, les femmes d'une
manière générale et celles épouses des
pêcheurs en particulier, occupent une place de choix à travers
leur participation active dans la gestion des produits de pêche. Elles
jouent le rôle d'intermédiaires entre leurs époux en mer,
les fumeuses et les consommateurs de poisson qui se trouvent dans les villages.
A titre d'exemple, les épouses des pêcheurs béninois du
côté de Nziou, tiennent informées à chaque fois que
besoin se fait sentir, les femmes fumeuses du village de l'heure d'accostage,
donnent des indices sur les quantités probables de poissons grâce
à l'usage du téléphone à en croire cette acheteuse:
«Nous achetons le poisson frais aux Béninois. Quant ils sont en
mer, la femme du béninois appelle son mari. S'il y a du poisson, elle
nous dit, même si c'est la nuit. Quand les pirogues arrivent, nous nous
rendons à la plage avec nos cuvettes pour chercher du poisson»
(EDJIDJE YVETTE, Batanga, le 10/01/2011). Au débarcadère de
Londji I, les épouses des pêcheurs nigérians (largement
majoritaires) achètent au retour des pirogues de leurs conjoints de la
pêche, l'ensemble de la cargaison(les espèces destinées au
fumage), pour la revendre aux fumeuses camerounaises. Ces dernières les
revendent directement lorsque les pirogues accostent en journée, tandis
que les ventes sont reportées au lendemain en cas d'accostage nocturne.
Dans cette circonstance, elles les conservent au niveau des chambres froides
existantes afin de garantir leur état de fraîcheur.
En définitive, les mutations des techniques de capture
et de conservation des produits halieutiques sont sous-tendues par un certain
nombre de paramètres parmi lesquels les facteurs internes et externes.
Dans sa manifestation l'on observe une forte adoption des techniques
introduites au détriment des techniques endogènes jugées
moins efficaces. Elles exercent dans le quotidien des populations des impacts
multiformes parmi lesquels l'amélioration des rendements,
l'accroissement des revenus, la réduction des charges du travail. Elles
réconfortent l'hégémonie des acteurs de pêche issus
de la migration, mais aussi en fonction des secteurs, engendrent les conflits
entre les pêcheurs et concourent à la surexploitation des
ressources halieutiques.
105
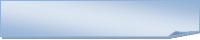
CONCLUSION
Cette étude intitulée: «Pêche
et conservation du poisson par les populations de Nziou et de Londji I dans la
région du Sud-Cameroun: Une analyse anthropologique des choix et
finalités des savoir-faire des pêcheurs», visait
à cerner les facteurs à l'origine des changements techniques et
le degré de participation des pêcheurs dans l'activité de
pêche. Dans un contexte où se produisent des changements
permanents au niveau des techniques de pêche et de conservation du
poisson, un contraste demeure entre une adoption tous azimuts des mêmes
savoirs et une faible production et participation des pêcheurs locaux
dans l'activité de pêche. L'examen de ce problème nous a
amené à ouvrir quelques pistes de recherche structurées
autour de quatre questions. La question centrale est formulée de la
manière suivante: Quels sont les facteurs socioculturels qui
conditionnent la dynamique des techniques de pêche et de conservation du
poisson chez les pêcheurs de Nziou et de Londji I?
Pour mieux cerner cette préoccupation, trois questions
secondaires ont été formulées à cet effet:
1-Quelles sont les spécificités des techniques
endogènes et exogènes de pêche et de conservation des
produits halieutiques?
2-Qu'est-ce qui sous-tend le degré de participation
des populations dans l'activité de pêche?
3-Quel impact exerce la mutation des savoirs en
matière de pêche dans le quotidien des populations de Nziou et de
Londji I?
L'hypothèse centrale de ce travail postulait que chez
les pêcheurs de Nziou et de Londji I, la place indispensable du poisson
dans la médecine et l'alimentation, les mariages interethniques, les
rites en rapport avec la pêche qui deviennent de moins en moins
valorisés, ont favorisé le changement des techniques de capture
et de conservation du poisson.
Comme hypothèses secondaires, les propositions
suivantes avaient été retenues:
1-Les techniques endogènes de pêche et de
conservation du poisson sont caractérisées par leur
facilité d'accès et une production majoritairement
destinée à la subsistance tandis que les parents jouent un
rôle central dans le processus de transmission des techniques. Par
ailleurs, les techniques émergentes grâce à leurs
performances suscitent beaucoup d'engouement aux yeux des acteurs de
pêche. Pour leur dissémination, le profil des formateurs s'est
élargit grâce à la cohabitation de plusieurs
communautés de pêcheurs.
106
2-Les facteurs limitant ou favorisant la participation des
pêcheurs se trouvent dans la perception des ressources halieutiques, le
niveau économique et la diversification des activités de
subsistance des différents acteurs de pêche.
3-Les changements des techniques de pêche et de
transformation engendrent dans le quotidien de ces derniers des
conséquences multiformes. Elles contribuent à la satisfaction des
déficits en produits halieutiques, l'amélioration des revenus;
mais aussi conduisent également à une surexploitation des
ressources et engendrent les conflits.
Pour conduire à terme ce travail, nous nous sommes
fixés un certain nombre d'objectifs. Comme objectif central, nous nous
sommes appesantis à déterminer les facteurs socioculturels qui
justifient les mutations des savoir-faire en matière de capture et de
transformation des produits de pêche chez les pêcheurs de Nziou et
de Londji I. A cet objectif central, se sont greffés trois autres
secondaires:
1-Présenter les caractéristiques des techniques
endogènes et exogènes de pêche et de conservation du
poisson ainsi que leurs modalités de dissémination au sein de la
population.
2-Identifier les facteurs de motivation des
différentes communautés de pêcheurs dans l'activité
de pêche.
3-Décrire les changements engendrés dans le
quotidien des populations de Nziou et de Londji I par les diverses mutations
des techniques de pêche.
Comme technique de collecte des données sur le
terrain, nous nous sommes servis de l'observation directe et des entretiens
semi directifs. La collecte des données a été rendue
possible grâce à l'utilisation des guides d'entretien, d'un
magnétophone et d'un appareil photo numérique.
L'interprétation des données s'est basée sur les
théories suivantes: l'ethnométhodologie avec comme point de
référence les ethno-méthodes, la théorie de
l'écologie culturelle avec le modèle de la dynamique adaptative
et la théorie de l'anthropologie du nouvel institutionnalisme avec un
accent mis la modification du prix relatif. Après analyse et
interprétation des données, les résultats suivants ont
été obtenus:
La dynamique des techniques de capture et de transformation
des produits halieutiques dans les villages Nziou et Londji I est
conditionnée par plusieurs facteurs. Parmi les facteurs internes,
figurent la place primordiale du poisson dans le système alimentaire des
populations, les mariages interethniques avec la possibilité de
dissémination dans les foyers d'accueil des connaissances
détenues par les personnes de différentes cultures unies par
l'alliance matrimoniale, les rites liés à la pêche qui sont
devenus de moins en moins valorisés, la croissance des besoins en
poisson dans les villes environnantes. Comme facteurs externes, nous avons
l'efficacité d'une technique, le travail en synergie, la migration, le
soutien de l'Etat et des
107
partenaires au développement. Ces divers facteurs
constituent les principaux stimulants des mutations techniques en cours dans
l'activité de pêche.
Les techniques endogènes de capture et de
transformation du poisson sont constituées des méthodes
familières aux populations locales tant au niveau des matériels
employés que des connaissances dispensées. Comme techniques de
pêche, nous avons recensé l'emploi de la canne à
pêche, la pêche à la ligne, la palangre, le
`'tirez-tirez» entre autres. L'essentiel de ces techniques de capture est
constitué des méthodes majoritairement applicables en bordure de
mer, en conformité avec leur degré d'efficacité, cela
reflète l'état de disponibilité des ressources en vigueur
dans le passé. Pour le fumage, les méthodes appliquées
sont constituées des demi fûts, des fumoirs en piquets de petites
dimensions sans oublier les formes de base de fumage constituées du
foyer ordinaire, des foyers en fer, ou ceux faits des résidus des
récipients en fer. Pour obtenir les produits fumés
agréables prisés dans leur alimentation, les populations
exploitaient judicieusement les vertus des principaux combustibles disponibles
dans leur environnement et qui leur permettaient ainsi de donner des formes,
des couleurs et saveurs adaptées. Dans la sphère de la
transmission des techniques de capture ainsi que de conservation du poisson
l'entourage immédiat de l'adolescent jouait un rôle
déterminant.
Les techniques émergentes sont constituées des
méthodes aux spécificités nombreuses, une diversification
des modes de conservation. Parmi les techniques, nous avons au niveau de la
pêche, les techniques de sondage, d'encerclement, la pêche `'long
séjour», qui sont toutes introduites par les pêcheurs
béninois et nigérians; l'émergence de la
congélation, les fumoirs «banda», puis les fumoirs
améliorés, une introduction de l'OPED. Pour nos informateurs,
bien que ces techniques présentent à leurs yeux un certain nombre
d'atouts pouvant expliquer leur degré de dissémination rapide,
ces dernières ne vont pas sans inconvénients. Les parents, les
migrants ainsi que les moniteurs engagés dans les programmes de
formations multiformes participent au relèvement du niveau des
populations sur les nouvelles techniques.
Au niveau des facteurs stimulant la participation des acteurs
dans la pêche, nous avons noté que l'idée qui anime les
populations locales dans leur immense majorité sur une
disponibilité éternelle des ressources halieutiques, peut en
partie justifier leur niveau d'engagement dans la filière. Aussi, les
moyens économiques des uns et des autres viennent favoriser une certaine
pérennisation des savoir-faire, car l'essentiel des techniques ne sont
expérimentables qu'à travers un support matériel aux
coûts élevés. Dans le même sillage, la
diversification des activités de production amène les acteurs
à réserver une portion restreinte de temps à chacune de
leurs occupations. Sur ce point, les populations locales impliquées face
à la diversité de la richesse que regorge leur localité
n'échappent pas à cette règle. En plus,
108
l'implication massive et stratégique des migrants dans
le secteur des captures, crée une situation qui leur permet d'avoir une
main mise sur l'ensemble de la filière.
Les mutations des techniques de pêche et de
conservation engendrent dans le quotidien des acteurs de pêche des
impacts divers. Dans un environnement marqué par une course
effrénée pour l'accès aux ressources, les
différents riverains se battent au jour le jour pour s'octroyer des
engins, des techniques de pêche et de conservation les plus performantes
possibles. C'est ainsi que l'on observe une forte adoption des techniques
introduites au détriment des techniques endogènes jugées
moins efficaces, une croissance des revenus des différents acteurs
vivant de la pêche, une contribution à la satisfaction des
déficits en produits halieutiques, une réduction de la charge du
travail. Mais aussi, l'on relève le maintien de
l'hégémonie des acteurs de pêche issus de la migration, la
surexploitation des ressources halieutiques au travers d'une
élévation du rythme d'exploitation, l'émergence de
quelques conflits entre les pêcheurs qui se matérialisent par la
violation des zones de pêche, le vol de matériel, des cargaisons
et du sabotage des outils de pêche.
Au terme de ce travail, nous relevons que certains axes de
recherche dont la finalité peut contribuer à l'approfondissement
des connaissances scientifiques restent ouverts. A ce sujet, des études
ultérieures pouvant inclure des sites, des théories ainsi que des
disciplines différentes pourraient aboutir à une
compréhension approfondie de la zone, de l'activité de
pêche ainsi que de ses potentialités. A cet effet:
4 Une étude approfondie sur les usages
médicinaux des ressources halieutiques peut contribuer à
l'avancement des connaissances en anthropologie médicale. Dans ce
sillage, à l'image des usages faits du tétrodon
(Tétraondon biocellatus), du poisson salé ainsi que
d'autres recettes présentées dans ce travail, bien d'autres
espèces pourraient être identifiées, étudiées
et valorisées.
4 Une recherche sur le comportement alimentaire des
pêcheurs dans les sites différents est susceptible de nous
présenter les motivations des uns et des autres sur les formes de repas
à consommer pendant leur séjour en mer. En effet, les
pêcheurs de la zone de Kribi centre, essentiellement constitués de
pêcheurs autochtones optent pour la cuisson de leur repas en mer tandis
que, ceux de Londji I composés des pêcheurs locaux et
nigérians y vont avec des repas cuits auparavant. Pour cela, un examen
basé sur les raisons économiques des propriétaires des
matériels de pêche, les préférences alimentaires des
pêcheurs, le statut (titulaire ou employé) des
109
pêcheurs à bord des embarcations et bien
d'autres, sont à même de nous fournir des données denses
à ce sujet.
4 Un travail de recherche comparative entre nos sites
d'études et ceux ayant connu un rythme de changement
modéré peut favoriser la confrontation des résultats et
par voie de conséquence, contribuer à l'enrichissement des
connaissances en anthropologie culturelle.
4 La pêche féminine constitue tout un pan d'une
recherche ultérieure avec comme axe d'exploration l'examen des
savoir-faire mis en oeuvre dans la capture et la commercialisation des
crevettes d'eau douce. Car dans le présent mémoire, nous avons
mis l'accent seulement sur les connaissances des femmes dans la transformation
et la commercialisation du poisson.
110
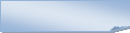
SOURCES
A-SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
I-OUVRAGES GENERAUX
BULEON, P. et DI MÉO, G.
2005: L'espace social. Lecture géographique des
sociétés, Paris, Armand Colin, 304p.
DESCOLA, P.,
1994: La nature domestique. Symbolisme et praxis dans
l'écologie des Achuar, Paris, Editions de la Maison des Sciences de
l'Homme, 450p.
DUGAST, I.,
1949: Inventaire ethnique du Sud-Cameroun, Cahors, Imp.
A., Coueslant, 161p.
LEFEBVRE, H.,
1963: La vallée de Campan. Etude de Sociologie
rurale, Paris, PUF, 220p.
LOMBARD, J.,
1991: Introduction à l'ethnologie, Ed Armand
colin, Paris, coll. cursus Série, 189 p.
MAGNEN, J.,
1951 : Le goût et les saveurs, Paris, PUF, 118
p.
MVENG, E.,
1963: Histoire du Cameroun, Yaoundé, CEPER, 533
p.
PARAIN, C.,
1979: Outils, Ethnies et développement
historique, Paris, Editions sociales, 502p.
PELLERAY, H.,
1984: Fleuves et Rivières du Cameroun, Institut
de Recherches Scientifiques du Cameroun, (O.R.S.T.O.M.), 32p.
II-OUVRAGES SPECIFIQUES
ABOU, S.,
1981: L'identité culturelle, Editions Anthropos,
coll. Pluriel, 249p.
BALANDIER, G.,
1971: Sens et puissance, Paris, PUF, 334p.
BERTHIER, N.,
1998: Les techniques d'enquêtes, méthodes et
exercices corrigés, Armand Colin, Paris, 254p.
111
BLANCHET, A. et al.,
1987: Les techniques d'enquête en sciences
sociales, Paris, Bordas, 197p.
BRIGITTE, M. et al.,
[1994]
[2005]: La conservation du poisson et de la viande,
Digigrafi, Wageningen, 90p.
COMBESSIE, J.,
1996: La méthode en sociologie, Ed la
découverte, Paris, coll Repères, 123p.
DELBOS, G. et JORION, P.,
1990: La transmission des savoirs, Paris, Editions de la
Maison des Sciences de l'Homme, 310p.
EMENO, R.,
2005: Le peuple batanga: de la tragédie à la
renaissance, Yaoundé, Presse de l'UCAC, 93p.
ENSMINGER, J.,
1992: Making a market. Institutional Transformation of an
African Society, Cambridge, Cambridge University Press, 230p.
MAISONNEUVE, J.,
2010: La dynamique des groupes, Paris, PUF, Que sais-je,
123p.
MBONJI, E.,
2005: L'Ethno-perspective ou la méthode du discours
de l'Ethno-Anthropologie culturelle, PUY, Yaoundé, coll.
connaissance, 124p.
MBONJI, E.,
2009: Santé, maladies et médecine africaine.
Plaidoyer pour l'autre tradi-pratique, Yaoundé, PUY, 302p.
MONOD, T.,
1928: Industrie des pêches au Cameroun, Paris,
Coll. Géographiques Maritime et Coloniale, 504p.
RICHARD, M.,
1970: Histoire et promotion de la femme chez les
Batanga, centre d'études ethnologiques bandundu, Congo Kinshasa,
Anthropos, St Augustin, 150 p.
STRAUSS, L.,
1964: Le cru et le cuit, Paris, Plon, 402p.
VIBERT, R. et LANGLER, K.,
1961: Pêches continentales, biologie et
aménagement, Paris, Dunod, 720p.
WOOTTON, R.,
1990: Ecology of Teleost Fishes, London, New York,
Chapman and Hall, 404 p.
112
III-ARTICLES
BIDET, J.,
1974: «Sur les raisons d'être de l'idéologie:
les rapports sociaux dans le secteur de la pêche
», in La
Pensée, n° 174, pp 53-67.
BRETON, F.,
1991: «Savoirs et transmission des savoirs entre les
pêcheurs : discussion de l'approche mé-
thodologique à
partir de l'expérience menée au "Centre d'Estudies del Mar" (CEM)
, Diputacio de Barcelona». In La recherche scientifique face
à la pêche artisanale, édité par J.-R. Durand,
J. Lemoalle & J. Weber: ORSTOM, Paris, pp 576-586.
BRIL, B.,
1991: «apprentissage et culture», in Savoir-faire
et pouvoir transmettre : transmission et
apprentissage des savoir-faire et
des techniques, edité par D. Chevallier, Editions de la Maison des
Sciences de l'Homme, Paris, pp 15-21.
CAMPREDON, P. et CUQ, F.,
2001: «Artisanal fishing and coastal conservation in West
Africa», in Journal of coastal
conservation, n° 7, pp
91-100.
CAROLE, B.,
2005: «les savoirs locaux: entre connaissance et
reconnaissance», in la revue en sciences de
l'environnement,
Vol6, no1, pp 59-64.
CHABOUD, C. et CHARLEDSO, M.,
1991: «Les pêches maritimes artisanales en Afrique
de l'ouest : Etat des connaissances et
évolution de la recherche
», in La recherche face à la pêche artisanale,
Durant J.R, Lemoelle J.,Weber J., éd. Paris, ORSTOM, pp 99-141.
CHAUVEAU, J. et JUL-LARSEN,
E.,
2000: «Introduction. Du paradigme halieutique à
l'anthropologie des dynamiques institu-
tionnelles», in Les
pêches piroguières en Afrique de l'Ouest, Pouvoirs,
mobilités, marchés, Jean-Pierre Chauveau et al., Paris,
Karthala, pp 9-85.
DAGET, J.,
1956: «La pêche dans le Delta central du Niger
», in Journal de la société des Africanistes XIX,
fasc.1, pp 1-77.
DE GARINE, I.,
1979: «Culture et nutrition», extrait de
communication, n° 33, pp 70-92.
DE GARINE, I.,
1996: «Contribution de l'anthropologie culturelle aux
enquêtes pluridisciplinaires sur l'ali-mentation», in Bien
manger et bien vivre. Anthropologie alimentaire et développement en
Afrique intertropicale: Du biologique au social, pp 22-34.
DUFOUR, A.,
1997: «Domestiquer l'espace. Quelques jalons et un
exemple pour une approche ethnologique de la toponymie», in le monde
alpin et Rhodanien, N°97, pp 187-200.
OUMAR, D.,
2004: «Migrations et conflits de pêche le long du
littoral Sénégalo-mauritanienne : le cas
113
DEBOUVRY, P.,
1998: «Décider pour aménager. Gérer les
resources naturelles et l'environnement subsaha-
rienne francophone»,
in Enda-éditions: Dakar. Série Etudes et Recherches, n°
160161.
ENSMINGER, J.,
1998: «Anthropology and the New Institutionalism».In
Journal of Institutional and Théori-tical Economics(JITE), Vol
154, pp 774-789.
GILLY, B.,
1989: «Les modèles bio-économiques en
halieutique: démarches et limites», in Cahiers
Sciences
Humaines, no 25, pp. 23-33.
GOOD, C.,
1972: «Old and Trusted, New and Unknown: Technological
Confrontation in the Shetland
Herring Fishery»,in Andersen R. et Wadel
C., North Atlantic Fishermen, University of Toronto Press, pp
61-82.
GORDEN, H.,
1954: «The Economy Theory of Common Property Resources: The
Fishery », in Journal of Political Economy, pp 124-142.
GUGLIELMINO, C. et al.,
1995: «Cultural variation in Africa: Role of mechanisms of
transmission and adaptation». In Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol.
92, pp 7585-7589.
HALLER, T.,
2002: «Common Property Ressource Managemen: Institutional
Change, and conflits in African Floodplain Wetlands. Presentation of a research
project and reflections on ins-institutional change and conflit», in
The African Anthropologist, vol. 9, No1, pp 25 - 35.
HEWLETT, B. et CAVALLI, S.,
1986: «Cultural transmission among Aka Pygmies», in
American Anthropologist, Vol 88, pp 922-933.
JELLIFFE, D.,
1967: «Parallel food classification in developing and
industrialising countries», Am .J. Nutr
,vol.2, n° 3.
MENARD, C.,
2003: «L'approche néo-institutionnelle: Des concepts,
une méthode, des résultats», in Ca-
hiers
d'économie politique, n°44, pp 103-118.
NEISHEIM, I. et al.,
2006: «What happens to traditional knowledge and use of
natural resources when people migrate ?», in Human Ecology, Vol
34, pp 99-131.
114
des pêcheurs de Guet-Ndar de
Saint-Louis(Sénégal)», in Anales de la Faculté
des lettres, langues, arts et sciences humaines Bamako, N° 4.
PAGEZY, H.,
1996: «Aspects psychoculturels de l'exploitation des
ressources naturelles dans la région du
lac Tumba(Zaïre)»
in Bien manger et bien vivre. Anthropologie alimentaire et
déve-
loppement en Afrique intertropicale: Du biologique au
social, pp 447-458.
PI-SUNYER, O.,
1977: «Two States of Technological Change in a Catalan
Fishing Community» in E. Smith, Those Who Live from the Sea,West
Publishing Co., pp 41-57.
POIRIER, J.,
1968: «Histoire de la pensée ethnologique »,
in J. Poirier, (éd.), Ethnologie générale,
Pa-
Paris, Gallimard, 1968, pp 3-179.
QUERE, L.,
1985: «Présentation du thème», in
ACKERMAN W. et al., Décrire: un impératif ?, Paris, des
Ecoles des Hautes Etudes en psychologie, pp 3-11.
RUTTAN, L.,
1998: «Closing the Commons: Cooperation for Gain or
Restraint?», in Human Ecology, vol 26, No 1, pp 43-66.
SINGLETON, M.,
1982: «De l'intendance indigène du gibier à
une gestion endogène de la faune»,in P.P. Vinc
Vincke et
M.Singleton (Eds) Gestion de la faune sauvage,facteur de
développement? Environnement africain, série Etudes et
Recherches n°71-72, ISE, ENDA, MAB/U-NESCO, pp 69-106.
STOFFLE, B. et STOFFLE, R.,
200: «At the Sea's Edge: Elders and Children in the
Littorals of Barbados and the Baha-
mas», in Human Ecology,
Vol. 35, pp 547-558.
IV-MEMOIRES ET THESES 1- MEMOIRES
ACCEUS, V.,
2009: La pêche traditionnelle, pratiques vodouesques et
croyances afro-hatiennes à Gres-
sier, Université d' Etat d'
Haïti, Institut d'Etude et de Recherches Africaines (IERA-H),
Mémoire de Licence, 75p.
EFUETAKOA, C.,
2004: Socio-economic and technical characteristics of fishing
in the peripheral zone of Ko-
rup natonal Park, End oh course memoir
presented in partial fulfillment of the award of the diploma
»Ingénieur des eaux, forêts et chasses», University of
Dschang, 32p.
FOKOU, G.,
2003: Transformation des institutions de gestion des ressources
de propriété collective dans
les plaines de Waza- Logone (Nord
Cameroun), DEA en anthropologie, 145p.
115
MBILI, G.,
1999: Etude des caractéristiques socio
économiques et techniques de la pêche féminine à
Doumo(Périphérie Nord de la Réserve de faune du Dja) dans
l'Est Cameroun, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles, Option:
Productions Animales, 90p.
MURAMIRA, F.,
2007: Mutation de la technologie du fer en Centrafrique :
Etude comparée de la forge entre Bangui-Bambari, Mémoire de
Master en Anthropologie, Université de Bangui, 149p.
ONDOUA, P.,
1988: Monographie historique d'une ville du Sud Cameroun :
Kribi, des origines à 1960. Mémoire de Maîtrise en
histoire, Université de Yaoundé I, 114p.
SHAHBENDERIAN, L.,
2009: Approche anthropologique de l'adaptation de l'homme au
climat, Université Libre de Bruxelles, Master en Sciences de Gestion de
l'Environnement, 103p.
2- THESES
BABA, M.,
1985: Contributions à l'étude des
transformations artisanales des poissons d'eau douce au
Nord- Cameroun,
Ecole Inter- Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires
de Dakar ,181p.
CLAIDIERE, N.,
2009: Théories darwiniennes de l'évolution
culturelle: modèles et mécanismes, Université
Pierre et
Marie Curie, spécialité: Cerveau Cognition Comportement, 368p.
ETOGA, G.,
2009: La gouvernance de la biodiversité marine et
côtière dans le Golfe de Guinée, Université de
Nice-Sophia Antipolis, 176p.
SABINOT, C.,
2008: Dynamique des savoirs et des savoirs faire dans un contexte
pluriculturel. Etude comparative des activités littorales du Gabon,
Muséum National d'Histoire Naturelle, Département «Hommes,
Natures, Sociétés», Ethno- écologie, 438p.
VERMARD, Y.,
2009: Comportement de pêche et gestion : l'exemple de la
pêcherie pélagique du Golfe de Gascogne, AGROCAMPUS OUEST,
Spécialité : Halieutique, 162p.
V-RAPPORTS
BELAL1, E. et BABA, M.,
2006: Sécurité alimentaire et réduction
de la pauvreté par l'amélioration de la gouvernance
et
l'évaluation des pêcheries des rivières en Afrique. La
cogestion des pêches au Cameroun: Une analyse des politiques qui la sous
tendent, MINEPIA/DIRPEC, Rapport N° 3, 40p.
116
BITHA, H.,
2010: Présentation technique et engins de pêche
utilises dans la côte camerounaise: Cas
de Londji, arrondissement de
Kribi II, MINEPIA /Sous Direction des Technologies de Pêches et des
Industries Animales, 15p.
BROCHET, A. et KOHPE, M.,
2007: Etude de base en vue de l'élaboration d'un programme
d'appui à la pêche artisanale et la protection des mangroves de la
côte atlantique, OPED-PLANETE URGENCE, 21p.
FAO,
2007: Profil de pêche par pays. La République du
Cameroun, Rome, 33p.
KEBE, M. et al.,
1993: Revue sectorielle de la pêche artisanale maritime
au Cameroun. Programme de Développement Intégré des
Pêches Artisanales en Afrique de l'Ouest, DIPA/VP, 48p.
MBANGO'O, P.,
1998: La pêche chez les Badjoue. Interaction entre les
techniques, le temps, les terroirs et
les ressources prélevées
à Doumo, Faculté universitaire des Sciences Agronomiques de
Gembloux, Belgique, second rapport semestriel, 78p.
MINEPIA,
1996: Etude pour une gestion durable des ressources halieutiques,
116p.
MINEPN,
2008: Rapport sur la biodiversité marine et
côtière au Cameroun, 19p.
NGOK, E. et al.,
2005: Contribution économique et sociale de la
pêche artisanale aux moyens d'existence durables et à la
réduction de la pauvreté, rapport, août 2005, 45 p.
NJIFONJOU, D. et al.,
1995: Enquête cadre et étude
socio-économique de la pêche artisanale maritime au Cameroun,
DIPA/FAO /CRHOL/DIRPEC, 64p.
TEUTSCHER, F. et al.,
1995: Rapport de l'atelier sur le thème "A la recherche
des Améliorations en technologie du poisson en Afrique de l'Ouest,
Pointe-Noire, Congo, 7-9 novembre 1994. Cotonou, Projet DIPA, 82p.
VI-DICTIONNAIRES
BONTE, P. et IZARD, M.,
1991: Dictionnaire de l'Ethnologie et de l'Anthropologie, Paris,
PUF, 755p.
2006: Petit Larousse Illustré, Paris, 1855p.
117
VII-TEXTES DE LOIS
MINEPIA,
Décret n° 95/413/PM du 20 juin 1995, fixant
certaines modalités d'application du régime de pêche.
MINEPIA,
Arrêté n° 0026/MINEPIA/DIRPEC/SCPIA/SPA du
11 avril 2000 portant interdiction de certains engins de la pêche.
MINEPIA,
Arrêté n° 0002/MINEPIA du 01 août 2001
portant modalités de protection des ressources Halieutiques.
B- SOURCES ORALES
I-Liste des pêcheurs et fumeuses de Londji I
|
Nom et Prénom
|
Sexe
|
Ages
|
Origine
|
Catégorie d'acteurs
|
Lieu
d'entretien
|
Date
|
|
Ngah Julie Adeline
|
F
|
42 ans
|
Batanga
|
Fumeuse
|
Londji 1
|
18/12/2010
|
|
Godwill Willy
|
H
|
23 ans
|
Calabar
|
Pêcheur/Fabriquant de pirogue
|
Londji 1
|
18/12/2010;
10/01/2011
|
|
Mahemo Marie
|
F
|
45 ans
|
Nigériane
|
Fumeuse
|
Londji 1
|
18/12/2010
|
|
Ismaël
|
H
|
41 ans
|
Nigérian
|
Pêcheur
|
Londji 1
|
18/12/2010;
20/01/2011
|
|
Ekotoni Clément
|
H
|
54 ans
|
Batanga
|
Pêcheur
|
Lindji 1
|
19/12/2010;
15/01/2011
|
|
Nlend Albert
|
H
|
39 ans
|
Batanga
|
Pêcheur
|
Londji1
|
19/12/2010
|
|
Nanga Jean
|
H
|
55 ans
|
Batanga
|
Pêcheur
|
Londji1
|
19/12/2010
|
|
Mbimbi Dénise
|
F
|
43 ans
|
Batanga
|
Fumeuse
|
Londji1
|
19/12/2010
|
|
Yami Victorine
|
F
|
63 ans
|
Nigériane
|
Fumeuse
|
Londji1
|
22/12/2010
|
|
Ebobi Marthe
|
F
|
62 ans
|
Batanga
|
Fumeuse
|
Londji1
|
22/12/2010
|
|
Mouodoukoue
Adeny
|
F
|
56 ans
|
Nigériane
|
Fumeuse
|
Londji1
|
10/01/2011
|
|
Njoh Adolphe
|
H
|
63 ans
|
Batanga
|
Notable/Pêcheur
|
Londji1
|
22/12/2010;
17/01/2011
|
118
II-Liste des pêcheurs et fumeuses de Nziou
|
Nom et Prénom
|
Sexe
|
Age
|
Origine
|
Catégorie
d'acteurs
|
Lieu
d'entretien
|
Date
|
|
Aglin Anne
|
F
|
42
|
Popo
|
Fumeuse
|
Nziou
|
18/12/2010;
|
|
|
|
|
|
|
15/01/2011
|
|
Nzieh Pascal
|
H
|
34 ans
|
Mabi
|
Pêcheur
|
Nziou
|
22/12/2010
|
|
Cassa
|
H
|
58 ans
|
Popo
|
Pêcheur
|
Nziou
|
09/01/2011;
|
|
|
|
|
|
|
20/01/2011
|
|
Edjidje Yvette
|
F
|
44 ans
|
Batanga
|
Fumeuse/
|
Nziou
|
10/01/2011;
|
|
|
|
|
commerçante
|
|
15/01/2011
|
|
Ngoundi Anne
|
F
|
52 ans
|
Mabi
|
Fumeuse
|
Nziou
|
13/01/201;
|
|
|
|
|
|
|
17/01/2011
|
|
Hubert
|
H
|
49 ans
|
Popo
|
Pêcheur
|
Nziou
|
19/12/2010
|
|
|
|
|
|
|
15/01/2011
|
|
Aglil Viviane
|
F
|
45 ans
|
Popo
|
Fumeuse
|
Nziou
|
15/01/2011
|
|
Cassa Ernestine
|
F
|
46ans
|
Popo
|
Fumeuse
|
Nziou
|
15/01/2011
|
|
Bindele Marceline
|
F
|
70 ans
|
Mabi
|
Fumeuse
|
Nziou
|
15/01/2011
|
|
Matagnon Jacques
|
H
|
52 ans
|
Popo
|
Pêcheur
|
Nziou
|
17/01/2011
|
|
Messi Jules
|
H
|
51 ans
|
Mabi
|
Pêcheur
|
Nziou
|
17/01/2011 ;
|
|
|
|
|
|
|
22/01/2011
|
III-Liste des Autorités traditionnelles,
administratives et Responsables des structures
ubliques
|
Nom et Prénom
|
Sexe
|
Fonction/Statut social
|
Lieu
d'entretien
|
Date
|
|
Essomba Laure
|
F
|
En poste à la cellule de communication du
Délégué du Gouvernement auprès de la
Communauté Urbaine de Kribi.
|
Kribi
|
05/10/2010
|
|
Bitha Hugo Fredily
|
H
|
Chef du Centre d' Alevi- nage et de Contrôle de Pê-
che de Londji.
|
Londji1
|
14/12/2010;
17/01/2011
|
|
Madola Joseph
|
H
|
Chef du bloc 7
|
Londji1
|
14/12/2010
13/01/2011
|
|
Nang Joseph
|
H
|
Chef du village Nziou
|
Nziou
|
13/12/2010
|
|
Nana Privat
|
H
|
Directeur de la Centre de
Contrôle de la Pêche Artisanale de Kribi.
|
Kribi
|
21/12/ 2010
|
|
Ngoundi Luc
|
H
|
Pêcheur et Chef d'une com- munauté Mabi
|
Londji 1
|
12/01/2011
|

ANNEXES
119
I-ANNEXE METHODOLOGIQUE
1-Guide d'entretien pour les pêcheurs
locaux
-Identification
-Place de la pêche dans l'activité
quotidienne.
-Mode d'apprentissage du métier de pêcheur.
-Caractéristiques des techniques et matériels
traditionnels propres aux pêcheurs autochtones.
-Mode d'identification des ressources halieutiques.
-Présentation des modes de conservation des ressources
halieutiques.
-Les contraintes de l'activité.
-Place des autres activités de subsistance.
-Symbolique des cérémonies rituelles en rapport
avec l'activité de pêche.
-Motifs d'adoption des nouvelles techniques.
-Spécificité des techniques
émergentes.
-Mode d'acquisition de ces savoirs.
-Conséquences engendrées par la dynamique de ces
techniques.
2-Guide d'entretien pour les pêcheurs
étrangers
-Identification.
-Historique de l'implantation des populations.
-Place de la pêche dans le quotidien.
-Apprentissage du métier de pêcheur.
-Caractéristiques des techniques employées dans
la société d'origine.
-Mode d'identification des ressources halieutiques.
-Présentation des modes de conservation des ressources
halieutiques.
-Les contraintes rencontrées par les pêcheurs.
-Symbolique des cérémonies rituelles en rapport
avec l'activité de pêche.
-Motifs d'adoption des nouvelles techniques.
-Spécificité des techniques utilisées
dans la localité d'accueil.
-Rapport des différentes communautés dans la
cohabitation.
-Techniques actuellement employées dans la zone
d'étude.
120
-Conséquences engendrées par la dynamique des
savoir-faire.
3-Guide d'entretien pour les fumeuses
camerounaises
-Identification.
-Processus d'acquisition des techniques de fumage.
-Spécificités des techniques endogènes de
conservation du poisson.
-Caractéristiques des combustibles utilisés.
-Procédure de fumage du poisson.
-Source d'approvisionnement et difficultés
rencontrées.
-Place du fumage dans votre culture.
-Rapports avec les fumeuses étrangères.
-Apports des autres activités économiques.
-Présentation des techniques nouvelles de fumage.
-Mode d'acquisition de ces savoirs.
-Changements engendrés dans l'activité.
4-Guide d'entretien pour les fumeuses
étrangères
-Identification.
-Apprentissage des techniques de fumage.
-Les techniques endogènes de conservation du poisson.
-Caractéristiques des combustibles utilisés.
-Etapes de fumage du poisson.
-Approvisionnement en poisson et difficultés
rencontrées.
-Place du fumage dans votre culture d'origine.
-Types de liens avec les fumeuses camerounaises.
-Place des autres activités économiques.
-Présentation des techniques nouvelles de fumage.
-Mode d'acquisition de ces savoirs.
-Changements engendrés dans l'activité.
5-Guide d'entretien pour les autorités
traditionnelles et administratives -Identification.
-Historique de l'unité de compétence.
-Implantation des différentes communautés de
pêcheurs.
121
-Organisation administrative.
-Gestion de la cohabitation.
-Modalités d'accès aux ressources
halieutiques.
-Techniques endogènes de pêche et de conservation
des produits halieutiques.
-Méthode d'exploitation nouvelle des ressources
halieutiques.
-évolution des règles de gestion des ressources
halieutiques.
-dynamique des techniques de capture et de conservation dans
votre unité de compétence.
-Place des différentes communautés dans
l'activité de pêche.
-Impact des nouveaux savoirs savoir.
6-Guide d'observation
-Activités pratiquées au sein des campements.
-Principaux mets faits à base du poisson.
-Rapports entre les jeunes et les anciens dans les
activités de productions.
-Nature des relations entre les différents acteurs de
la pêche.
-Nature des relations entre les différentes
communautés de pêcheurs.
-Modalités d'accès aux ressources et mode de
gestion des conflits.
-Spécificités des techniques de capture et de
conservation du poisson utilisées dans la zone.
-Différentes manière de disposer le poisson et
le bois pendant le fumage.
-Manifestations culturelles en rapport à
l'activité de pêche.
II-ANNEXE LEXICALE
1-Principaux mets préparés à base
de poisson
|
Batanga
|
Mabi
|
Français
|
|
Ebanjéa
|
Doumbobi
|
Le bouillon de poisson frais assaisonné du piment, du
sel, du citron.
|
|
Djomba
|
Doumboka
|
Le paquet de poisson assaisonné du piment et du
citron.
|
|
N'ñukou
|
Ndtouá
|
La sauce de mango (Irvingia Gaboneesis) et du
poisson.
|
|
Maban
|
Maban
|
Le poisson fumé pimenté.
|
122
2-Matériels phares utilisés dans la
pêche
|
Karpi
|
Gabi
|
La pagaie
|
|
Bwalo
|
Biali
|
La pirogue
|
|
epe?
|
Pih
|
Le filet
|
|
Mapito
|
Pito
|
Le plomb
|
|
Meyinga
|
Kuoli
|
La corde (ou le fil)
|
|
Essessi
|
Kégui
|
Le morceau de bois/gourdin employé dans la pêche
|
|
Mbwayi
|
Nkua
|
La canne à pêche.
|
|
Ebâma
|
Mbámá
|
La ligne
|
|
Sambi
|
Sambi
|
La palangre
|
3-Matériels employés dans le
fumage
|
Etaka
|
Táng
|
Le fumoir
|
|
Kissini
|
Ndoh-jirèrè
|
La cuisine
|
|
Iye
|
Bvuh
|
Le foyer (pour la cuisson des repas)
|
|
Weh
|
Fu
|
Le poisson
|
|
Léa
|
Yi
|
Le bois
|
|
Aka
|
Mpfuma
|
Le couteau
|
4-Mots régulièrement utilisés dans
le commerce
|
éyamba
|
ngiyara
|
Acheter
|
|
éyayidé
|
shuèro
|
Fumer
|
|
Yobo
|
boulè
|
Pêcher
|
|
éyambi
|
ngiyaro
|
Vendre
|
III-ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE 1-Préparation du
matériel de pêche

-Montage du filet par un Bantanga -Montage du filet par les
enfants béninois -Montage d'une ligne par un pêcheur Mabi
Source: Mvetumbo Moïse (Londji I, Source: Mvetumbo
Moïse (Nziou, 2010) Source: Mvetumbo Moïse (Nziou, 2012)
2012)
123
2-Retour de la pêche et écoulement du
poisson frais

Hommes, femmes et enfants participant à la stabilisation
de la pirogue d'un pêcheur béninois
Source: Mvetumbo Moïse (Nziou, 2010)

Jeunes béninois et camerounais participant à
l'émaillage du poisson Vente du poisson frais à la plage de
Nziou
Source: Mvetumbo (Nziou, 2011) Source: Mvetumbo (Nziou, 2011)
3-Principales phases du fumage du poisson

Un couple Batanga écaillant du poisson mbounga Une
béninoise classe le poisson sur le grillage
Source: Mvetumbo Moïse (Londji I, 2011) Source : Mvetumbo
Moïse (Nziou, le15/01/2011)
124

Le fumage sur un demi-fût Une fumeuse Mabi contrôlant
son fumage Un fumoir quatre poteaux et du bois
Source: Mvetumbo Moïse (Nziou, Source: Mvetumbo Moïse
(Londji I, Source: Mvetumbo Moïse (Londji I
2010) 2011) , 2010)
4-Commercialisation du poisson

Stock de poisson fumé destiné à la vente au
marché de Londji I Poisson fumé en détail sur un
comptoir
Source: Mvetumbo Moïse(Londji I, 2010) Source: Mvetumbo
Moïse(Nziou, 2011).
125
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
RESUME ii
ABSTRACT iv
SOMMAIRE .. v
LISTE DES ILLUSTRATIONS . vi
LISTE DES CARTES vi
LISTE DES PHOTOGRAPHIES vi
LISTE DES TABLEAUX . vi
LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES . vii
A- ACRONYMES .. vii
B- SIGLES . vii
INTRODUCTION 1
1-CONTEXTE 1
2-JUSTIFICATION 2
2-1-Raison personnelle . 2
2-2-Raison scientifique . 2
3- PROBLEME 3
4-PROBLEMATIQUE 3
5-QUESTIONS DE RECHERCHE 4
5-1-Question principale 5
5-2-Questions secondaires
...
5
6-HYPOTHESES 5
6-1-Hypothèse principale . 5
6-2-Hypothèses secondaires .. 5
7-OBJECTIFS 5
7-1-Objectif principal 6
7-2-Objectifs secondaires 6
8- METHODOLOGIE 6
8-1-Choix des sites de l'étude et des informateurs 6
8-1-1-Choix des sites de l'étude . 6
8-1-2-Choix des informateurs . 7
8-2-Méthodes et techniques de collecte des données
7
8-2-1-Méthode de collecte de données 7
8-2-1-1-Recherche documentaire . 7
8-2-1-2-Recherche sur le terrain .. 7
8-2-2-Technique de collecte 8
8-2-2-1-L'observation 8
126
8-2-2-2-Les entretiens 8
8-2-3-Outils de collecte 8
9-ETHIQUE DE LA RECHERCHE . 9
10-DELIMITATION DU SUJET 9
11-INTERET DE L'ETUDE 10
11-1-Intérêt théorique . 10
11-2- Intérêt pratique . 10
12-ORGANISATION DU TRAVAIL 10
CHAPITRE I: DESCRIPTION DU CADRE PHYSIQUE ET HUMAIN DES SITES
DE
L'ETUDE 12
A-VILLAGE LONDJI I . 12
I-CADRE PHYSIQUE ET GEOGRAPHIQUE . 12
I-1-Le milieu de recherche 12
I-2-Le climat 12
I-3-L'hydrographie 12
I-4-La végétation . 13
I-5-Structure de santé . 13
II-CADRE HISTORIQUE ET HUMAIN 14
II-1-Populations locales 14
II-2-Communautés étrangères . 14
III-L'ASPECT SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE 14
III- 1-L'Aspect socioculturel 14
III-1-1-Organisation sociale . 14
III-1-2-Gestion des conflits . 15
III-1-2-1-Instances traditionnelles 15
III-1-2-2-Instances légales 15
III-1-3-Croyances religieuses et associations culturelles . 15
III-1-3-1-Le peuple Batanga et son rapport avec le monde
spirituel 15
III-1-3-2-Vie religieuse 16
III-1-3-3-Association culturelle . 16
III-1-4-Représentations de la mer dans l'univers culturel
des populations de Londji I.. 16
III-1-4-1-Batanga 16
III-1-4-2-Nigérians 17
III-1-5-L'Education 17
III-2-L'aspect économique 18
III-2-1-Pêche. 19
III-2-2-Agriculture .. 19
III-2-3-Commerce .. 19
IV-ACTIVITES CULTURELLES DES POPULATIONS DE LONDJI I 20
IV-1-source de l'événement 20
IV-2-Commémoration des fêtes 20
IV-3-Activités phares 20
IV-3-1- La natation. . 20
127
128
IV-3-2-La course des pirogues 21
IV-3-3- Le bras de fer 21
IV-3-4-Le bain populaire 21
IV-STRUCTURE DE L'HABITAT 22
IV-1-Maison en carabotte 22
IV-2- Maison en dur . 22
B-VILLAGE NZIOU 22
I-CADRE PHYSIQUE ET GEOGRAPHIQUE . 22
I-1-Milieu de recherche . 22
I-2-Le climat . 23
I-3-L'hydrographie 24
I-4-Le sol . 24
II-CADRE HISTORIQUE ET HUMAIN 24
II-1-L'origine du nom Nziou 24
II-2-Implantation des populations . 24
II-1-2-1-Populations locales . 24
II-1-2-Implantation des communautés béninoises
24
III-L'ASPECT SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE 25
III-1-Organisation sociale et gestion des conflits 25
III-1-1-Organisation sociale .. 25
III-1-2-Gestion des conflits 25
III-1-2-1- Instances coutumières 25
III-1-2-2-Instances légales 25
III-2-Vie religieuse 25
III-3-L'Education 25
III-4-Fête commémorative .
26
III-5-Représentations de la mer dans l'univers culturel des
populations riveraines de
Nziou . 28
III-5-1-Mabi .. 28
III-5-2-Béninois . 28
III-2-L'aspect économique 29
III-2-1-Pêche .. 29
III-2-2-Agriculture . 29
III-2-3-commerce 29
CHAPITRE II: REVUE DE LA LITTERATURE, CADRE THEORIQUE
ET DEFINITION
DES CONCEPTS . 30
A-REVUE DE LA LITTERATURE . 30
I-GENERALITE SUR LA PECHE AU CAMEROUN 30
I-1-Domaines de pêche 30
I-2- Importance de la pêche au Cameroun 31
I-3- Principales espèces ciblées et espaces de
pêche 32
II-TECHNIQUES ET MATERIELS DE PECHE ET DE TRANSFORMATION
DU
POISSON UTILISES DANS LES PECHERIES CAMEROUNAISES 33
II-1-Techniques de pêche . 33
II-2-Outils de capture 33
II-3-Méthodes de transformation artisanale du poisson
. 34
III-COMMUNAUTES DES PECHEURS ET MODE DE GESTION DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES AU CAMEROUN 35
III-1-Organes en charge de la gestion de l'activité de
pêche au Cameroun . 35
III-2-Condition d'accès aux ressources halieutiques 35
III-3-Communautés de pêcheurs dans les côtes
camerounaises 37
IV-GENERALITE SUR LA TRANSMISSION DES CONNAISSANCES 38
IV-1-Typologie des connaissances 38
IV-2-Mode de transmission des connaissances . 38
B-CADRE THEORIQUE 39
I- L'ETHNOMETHODOLOGIE 39
I-1-Origine et émergence de la théorie .. 39
I-2-Implication des ethno-méthodes dans cette recherche
41
II- LA NOUVELLE ANTHROPOLOGIE INSTITUTIONNELLE 41
II-1-Fondement de la théorie . 41
II-2-Pertinence du concept emprunté pour notre
étude 42
III-L'ECOLOGIE CULTURELLE . 43
III-1-Emergence de la théorie 43
III-2-Modèle choisi et son implication dans notre travail
43
C-DEFINITIONS DES CONCEPTS 44
1-Analyse anthropologique 44
2-Choix 44
3-Conservation 45
4-Finalité . 45
5-Pêche 45
6-Savoir-faire 45
CHAPITRE III: CARACTEISTIQUES DES TECHNIQUES ENDOGENES DE
CAPTURE ET DE CONSERVATION DES PRODUITS DE PECHE ET LEUR
MODE D'ACQUISITION DANS LES VILLAGES NZIOU ET LONDJI I 47
I-TECHNIQUES DE CAPTURE DU POISSON . 47
I-1-La pêche à la canne 47
I-2-La pêche à la ligne 49
I-3-La pêche à la palangre 50
I-3-La pêche à la senne de plage . 52
I-3-1-Ressources humaines .. 52
I-3-2-Ressources matérielles 53
I-3-3-Pratique de la pêche à la senne de plage .
53
II-METHODES DE RECONNAISSANCE DE L'ENVIRONNEMENT MARIN . 55
II-1-L'Interprétation du mouvement des vagues. 55
II-2-L'usage de la pagaie 55
III-MATERIELS DE PECHE UTILISES
DANS LES PECHERIES DE NZIOU ET DE
129
LONDJI I. 56
III-1-Les pirogues 56
III-2-Spécificité des matériels de capture
58
IV-METHODES DE CONSERVATION DU POISSON DANS LES LOCALITES
DE
NZIOU ET DE LONDJI. 58
IV-1-Techniques basiques de fumage de poisson. 59
IV-2-Le fumage par les demi-fûts . 60
IV-3-Le séchage sur les fumoirs `'quatre poteaux`' ..
61
V-MODE OPERATOIRE DE LA TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE EN
MATIERE DE PECHE ET DE CONSERVATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES A LA
JEUNE GENERATION 62
V-1-1-Dans les domiciles 63
V-1-2-La plage et les rives des cours d'eaux 63
V-1-3-En mer . 64
CHAPITRE IV: PRESENTATION DES TECHNIQUES EMERGENTES DE PECHE
ET DE CONSERVATION DU POISSON DANS LES VILLAGES NZIOU ET
65
LONDJI I 65
I-TECHNIQUES NOUVELLES DE CAPTURE DU POISSON DANS
LES PECHERIES
DE NZIOU ET DE LONDJI I .
I-1-Technique d'emprisonnement . 65
I-2-La technique d'écoute ou de sondage du poisson 66
I-3-La pêche long séjour ou pêche de trois
jours 68
II-MATERIELS UTILISES DANS LA PECHE AU SEIN DES PECHERIES
DE NZIOU
ET DE LONDJI I. 69
II-1-1-Les petites pirogues à planches rassemblées
69
II-1-2-Les grandes pirogues à planches rassemblées
. 70
III-2-3-La diversité des filets 71
III-METHODES DE
CONSERVATION EMERGENTES DU POISSON DANS LES
LOCALITES DE NZIOU ET DE LONDJI I. 72
III-1-La conservation en mer .. 72
III-2-Caractéristiques de la conservation sur terre 72
III-2-1-Chambre froide 72
III-2-2-Fumage du poisson 73
III-2-2-1-Le fumage sur les «banda» ou fumoirs à
larges dimensions . 73
III-2-2-2-Le fumage amélioré 74
III-2-2-3-Spécificités des fumeuses
nigérianes et béninoises 76
IV-PROCEDURE ET AGENTS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES EN
MATIERE DE CAPTURE ET DE CONSERVATION DES PRODUITS HALIEUTI-
QUES DANS UN CONTEXTE PLURICULTUREL . 78
IV-1-Etude de cas 78
IV-1-1-Cas n° 1: MESSI JULES (Pêcheur, Mabi) . 78
IV-1-2-Cas n° 2: HUBERT (Pêcheur, Popo) . 79
IV-1-3-Cas n° 3: WILLIAM GODWILL (Pêcheur, Calabar)
80
130
IV-2-Personnes impliquées dans le processus transmission
des connaissances dans le
domaine de la pêche 80
CHAPITRE V: CONTRIBUTION A UNE ANTHROPOLOGIE DE LA DY-NAMIQUE
DES TECHNIQUES DE PECHE ET DE CON-SERVATION DES
PRODUITS DE PECHE 83
I-MANIFESTATION DES MUTATIONS DES SAVOIR-FAIRE EN MATIERE
DE 83
PECHE
I-1-Dynamiques des techniques de capture . 83
I-2-Adoption des nouveaux engins de déplacement . 84
I-3-Dynamique des techniques de conservation .. 85
II-FACTEURS DE PROPAGATION DES NOUVELLES TECHNIQUES DE
PECHE ET
DE CONSERVATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES 86
II-1-Facteurs endogènes 86
II-1-1-Place du poisson dans la médecine et
l'alimentation des populations de Nziou et
de Londji I 86
II-1-2-Mariage interethnique et intercommunautaire 88
II-1-3-Les rites en rapport avec l'activité de pêche
de moins en moins valorisés . 89
II-2-Facteurs exogènes 91
II-2-1-Le travail collaboratif entre les différents
groupes de pêcheurs 91
II-2-2-La migration 92
II-1-3-Croissance des besoins en ressources halieutiques dans la
région . 93
II-2-4- Les initiatives extérieures aux villages Nziou
et Londji I 93
III-COMPRENDRE LES MUTATIONS DES TECHNIQUES DE PECHE ET
DE
CONSERVATION . 94
III-1-Perception et efficacité des techniques comme source
de changement .. 94
III-2-Dynamique adaptative des populations des pêcheurs
à l'origine du changement 97
III-3-Modification du prix relatif et
degré de participation des différents acteurs de
pêche . 98
IV-IMPACT DE LA DYNAMIQUE DES TECHNIQUES DE
PECHE ET DE COINSER-
VATION DU POISSON DANS LES VILLAGES NZIOU ET LONDJI I 101
IV-1-La pêche de compensation aux conséquences
multiples 101
IV-2-Modifications des conditions de travail et le circuit de
distribution des produits de
pêche 103
CONCLUSION 105
SOURCES
A-SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES 110
I-OUVRAGES GENERAUX 110
II-OUVRAGES SPECIFIQUES 110
III- ARTICLES . 112
IV- MÉMOIRES ET THESES . 114
V- RAPPORTS . 115
VI- DICTIONNAIRES 116
131
VII- TEXTES DE LOIS . 117
B- SOURCES ORALES 117
I-Liste des pêcheurs et fumeuses de Londji I 117
II-Liste des pêcheurs et fumeuses de Nziou 118
III-Liste des Autorités traditionnelles,
administratives et Responsables des structures
publiques 118
ANNEXES . 119
I-ANNEXE METHODOLOGIQUE 119
1-Guide d'entretien pour les pêcheurs locaux 119
2-Guide d'entretien pour les pêcheurs étrangers
119
3-Guide d'entretien pour les fumeuses camerounaises .. 120
4-Guide d'entretien pour les fumeuses étrangères
. 120
5-Guide d'entretien pour les autorités traditionnelles
et administratives 120
6-Guide d'observation 121
II-ANNEXE LEXICALE 121
1-Principaux mets préparés à base de
poisson 121
2-Matériels phares utilisés dans la pêche
122
3-Matériels employés dans le fumage 122
4-Mots régulièrement utilisés dans le
commerce 122
III-ANNEXE PHOTOGRAPHIQUE 122
1-Préparation du matériel de pêche 122
2-Retour de la pêche et écoulement du poisson
frais 123
3-Principales phases du fumage du poisson 123
4-Commercialisation du poisson 124
TABLE DES MATIERES 125



