|
Université ibn zohr
Faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales
Agadir
Département : économie et gestion
|
La gestion des risques dans le secteur
agricoles
|
Mémoire pour l'obtention de licence en économie et
gestion
Réalisé par :
+ Ahmed ABOURI
+ Lahoucine GOUGA + Soufiane HACHIMI
Encadré par :
+ L'enseignant Mr. Saïd AHROUCH
Année universitaire : 2008/2009
Dédicaces
Nous dédions ce travail de fin d'étude à
:
+ Nos chères familles qui, grâce à leur
collaboration, nous ont inscrites et nous ont soutenu au prix des sacrifices
inoubliables.
+ A Dieu à qui nous adressent nos remerciements pour sa
grâce infinie pour nous. + Au feu, le père de notre
collègue dans ce travail Ahmed ABOURI
Remerciements
Nous voulons et nous sommes tenus de remercier tous ceux qui ont
contribué de près ou de loin dans la réussite de ce
travail ; en particulier à :
+ Notre encadrant Docteur AHROUCH Saïd.
+ Nos familles une autre fois.
+ Aux institutions, administrations et entreprises :
+ Office Régionale de Mise en Valeur Agricole : ORMVA
+ Le Centre Régional d'Investissement : CRI
+ Mutuelle Agricole Marocaine d'Assurance : MAMDA
+ Association des Producteurs Exportateurs de Fruits et
Légumes : APEF + Institut agronomique Hassan II complexe horticole d'ait
Melloul
Et à tous amis et collègues qui nous ont
aidés à la naissance de travail.
Sommaire
Dédicaces - 2
Remerciements 3
Sommaire 4
Introduction générale 6
Première partie
La méthodologie de la gestion des
risques
Chapitre 1 : La gestion des risques - 10
I. La notion de risques 11
1. Historique du risque 11
2. Définition de risque 11
II. Classification des risques 12
1. Suivant la fréquence et niveau de gravité
12
2. Suivant l'activité de l'entreprise 14
III. Objectifs de la gestion des risques 18
1. La sécurité 18
2. La qualité 18
Chapitre 2 : La gestion des risques dans l'exploitation
agricole 20
I. L'environnement de l'exploitation agricole 21
1. La sphère économique 21
2. La sphère géographique 21
3. La sphère financière 23
II. Typologie des risques dans le secteur agricole 25
1. Les risques économiques et commerciaux 27
2. Les risques financiers 28
3. Les risques naturels de production 29
4. Les risques institutionnels 30
5. Les risques humains et professionnels 30
III. Le risque : processus de gestion et méthodes de
couverture - 31
1. Processus de gestion des risques agricoles 31
2. Méthode de couverture contre les risques agricoles
39
Deuxième partie : Etude empirique
Chapitre 1 : Méthodologie de recherche
47
I. La problématique 48
II. Objectifs de l'enquête 48
III. L'enquête et l'élaboration du questionnaire
49
IV. Traitement des données 50
Chapitre 2 : L'analyse des résultats
51
I. présentation et analyse des résultats 52
II. Synthèse 58
Conclusion 60
Les références bibliographiques
62
Les annexes 64
Table des matières 66
Introduction générale
La gestion des risques, comme résultat des
évolutions technologiques, l'universalisation des marchés et la
télématique, a devenus dans la majorité des entreprises
une fonction indépendante et une discipline autonome parmi les autres
sciences.
En effet, la gestion des risques s'attache à identifier
les risques qui pèsent sur ce que l'entreprise possède pour sa
pérennité, ses moyens et ses biens c'est-à-dire : les
actifs de l'entreprise ses valeurs au sens large, y compris et peut être
méme avant tout, sur son personnel qui sont aussi bien exposés
aux risques que les actifs matériaux.
On peut définir le risque brièvement comme
étant « la prise en compte par une personne de la
possibilité de réalisation d'un événement contraire
à ses attentes ou à son intérêt. Lorsque la personne
concernée agit malgré cette possibilité et s'expose ainsi
à cette réalisation, on dit qu'il prend un risque.
Le présent mémoire traitera, et comme son titre
indique, et comme thème principale la gestion des risques dans le
secteur agricole marocain, en effet les risques qui affectent le revenu et le
bien- être des agriculteurs du notre pays le Maroc sont nombreux. Les
variations climatiques, les risques du marché, et autres
événements incertains ont un profond effet sur les
opérations des exploitations agricoles.
En matière de la gestion des risques en
général et dans le secteur agricole en particulier, on est devant
la grande problématique posée par Kenneth Arrow, cependant il
s'interroge sur la possibilité d'arriver un jour au monde idéal
ou tous les risques pourraient être assurées.
Des sous questions dérivées de la grande question
près citée peuvent être posés :
1. Quels sont les risques auxquels les agriculteurs sont
exposés ?
2. Existant-t-il des risques peuvent être
évité ?
3. comment peut-on lutter contre les autres risques ?
Ce travail sera articuler comme suit : en premier lieu on va
définir le terme « risque », exposer sa typologie et on
parlera de la gestion des risques en général.
La deuxième partie du mémoire va se baser sur
une étude empirique fondée sur un questionnaire qui sera remplis
par un échantillon des propriétaires des exploitations agricoles,
des directeurs des coopératives et des agriculteurs en
général, cette étude pratique a pour objet d'identifier,
d'analyser et de proposer des solutions.
PREMIER PARTIE
LA METHODOLOGIE DE LA GESTION DES
RISQUES
|
Cette partie vise à présenter dans deux
chapitres une méthodologie de la gestion des risques. Dans le premier;
l'objectif consiste à donner une vision sur la notion de risque de
façon générale et cela se fait dans trois sections. Elle
passe ensuite au deuxième dont nous devons être
particulièrement attentifs à l'évolution permanente de
l'exploitation agricole et à ses conséquences sur
l'évolution des risques et la nécessaire protection que
l'exploitant agricole doit rechercher pour assurer son revenu.
Premier Chapitre :
La gestion des risques
Un cadre conceptuel est nécessaire pour l'étude
de la gestion des risques. Ce premier chapitre est introductif et
général ; il étude la définition de la notion du
risque, typologie du risque et une section sur l'objectif de la gestion des
risques.
I. La notion du risque
1. Historique de la notion du risque
Le risque est inhérent à l'entreprise et
constitue même son essence. Créer une entreprise revient
déjà à prendre un risque, la survie et la
pérennité de l'entreprise n'est jamais assuré quel que
soit sa taille. Historiquement, L'homme a de tout temps été
confronté aux dangers catastrophes naturelles (tremblement de terre,
inondation, éruption volcanique, avalanche, cyclone, etc.), de maladies,
de guerres ou de tout autre manifestation, l'homme fut amené à
réagir face au danger du risque naturel. Au XVII siècle les
philosophes et les moralistes englobaient le risque dans la notion de prudence.
La notion de risque a été introduite dès que les
probabilités ont été développées au XVIII
siècle .Le progrès scientifique et le développement
technologique ont a accru les risques liés au développent
industriel et humain cette ère a vu la naissance de la notion de gestion
des risques. Les organisations ont développé des méthodes
et des moyens pour faire face à l'irréparable. L'inexistence du
risque zéro a accompagné une demande sans cesse de protection et
d'assurance. Parallèlement, les habitudes des consommateurs et des
partenaires de l'entreprise ont changé, les années 1990 marquent
le début d'un rapprochement des aspects qualité,
sécurité, santé et protection de l'environnement. Enfin
l'avènement de l'ère de la mondialisation associé à
l'émergence d'une société d'information entraîne
l'entreprise dans un environnement instable et mouvant source de risques
nouveaux. 1
2 .Définitions de la notion du risque
« [Le risque est l'] Éventualité d'un
événement ne dépendant pas exclusivement des parties et
pouvant causer la perte d'un objet ou tout autre dommage ; par extension, [le
risque est un] événement contre la survenance duquel on s'assure.
»2.
« [Le risque est la] probabilité qu'un effet
spécifique se produise dans une période donnée ou dans des
circonstances déterminées. »3
1 Clusif comment gérer les risques dans
l'entreprise, BORDAS, Pris 1989
2 Petit robert
3 Directive n° 96/82 du Conseil de l'Europe du 9
décembre 1996
Le risque est un « événement dont l'apparition
n'est pas certaine et dont la manifestation est susceptible d'affecter les
objectifs du projet ».4
Par ailleurs, le risque, présenté comme un
événement, a un caractère instantané. Il est donc
caractérisé par deux facteurs prépondérants : la
possibilité d'occurrence et la mesure des conséquences.
II. Classification des risques
Etablir une typologie des risques nous permettons de
structurer l'ensemble des risques par une classification. De plus, avec une
typologie des risques, la mise en oeuvre de la phase d'identification est
facile puisqu'elle s'appuie sur une base de connaissances. Une classification
des risques est un bon point de départ pour identifier les risques
auxquels les entreprises sont confrontées. Il existe plusieurs
manières de classifier les risques. En adoptons la typologie
suivante.
1. Suivant la fréquence et niveau de gravité
5
Il s'agit de classer par ordre d'importance la
vulnérabilité et ensuite analyser les situations à risque,
il s'agit alors pour la firme de développer une cartographie de ses
risques, pour cela l'analyse du risque s'appuie sur deux variables :
gravité et fréquence.

> ce ou probabilité), La fréquence F se mesure
en terme
de probabilité d'occurrence ou de réalisation de
la menace.
> facteur G (gravité ou impact). La gravité G se
mesure en terme d'impact ou de conséquence des effets de la
réalisation de la menace.
La valeur d'un risque s'exprime donc par le produit des deux
facteurs : R = (F x G)
4 Afnor. « Gestion du risque - Norme FD X50-117
». Afnor, 2003.
5
www.memoireonline.com/12/07/795/m_analyse-et-gestion-des-risques4.html

Figure 1 : La fonction de la gravité risque par
rapport à la fréquence
La cartographie des risques se décline en quatre grandes
catégories :
1.1 Risques de fréquence et de gravité
faibles : Sont des risques qui se réalisent
équence
rarement et dont l'impact est limités même s'ils
se réalisent. Les conséquences peuvent être
compensées sans effets négatifs sur les objectifs de
l'entreprise. Ne justifie pas des mesures contraignantes de
sécurité supplémentaires et l'organisation peut vivre avec
ces risques, nous parlerons de risques mineurs.
Ex : Rupture de stock de fournitures de bureau.
1.2 Risques de fréquence faible et de
gravité élevée : ce sont des événements
qui se produisent rarement mais dont les conséquences sont
significatives lorsqu'ils se produisent (Sa réalisation entraîne
parfois la disparition de l'entreprise). En raison de leur faible
fréquence il est difficile de prévoir et d'anticiper leur
survenance. La concrétisation du risque entraîne des
conséquences pouvant affecter sérieusement l'activité
de
Gaté
l'organisation, qui nécessite un plan de traitement
avec plan de redémarrage (l'injection de capitaux extérieurs) ou
plan de survie avec recours à l'assurance. Cette deuxième
catégorie et dénommée risques catastrophiques (Risque fort
ou majeur).
Ex : Risque d'incendie
1.3 Risque de fréquence élevée et de
gravité faible : Ces événements se produisent assez
régulièrement mais leurs conséquences sont relativement
faibles, le risque est généralement prévisible, sa
réalisation fragilise l'entreprise. Les objectifs peuvent encore
être atteints mais avec des mesures supplémentaires
(Nécessite un traitement).cette catégorie peut être
dénommé risque opérationnel.
Ex : Risque d'accident de circulation
1.4 Risques de fréquence et de gravité
élevées : les évènements se produisent
régulièrement et leurs conséquences sont à chaque
fois significatives. Dans la majorité des cas le décideur
abandonne le projet à moins que le projet soit primordial pour le
développement de l'organisation. On parle alors de situation
d'évitement.
Ex : Risque terroriste
2. Suivant la nature d'activité 6
Les risques sont multiples et variés, les entreprises
les classent de différentes façons, en général
selon la nature de leur activité. Pour simplifier nous proposons de les
regrouper en quatre catégories distinctes mais qui recouvrent tous les
risques auxquels peut faire face une entreprise.
2.1 Les risques stratégiques:
Menacent la survie de la firme et sa capacité à
maintenir une activité rentable et de création de valeur pour
l'actionnaire ; ils peuvent faire suite à des changements dans
l'environnement du marché, à une catastrophe naturelle ou encore
résulter de l'activité humaine.
- Choc politique et risque de nationalisation.
- Echec de stratégie : Mauvaise acquisition, échec
marketing, ruptures technologiques, préférence des clients au
paysage compétitif
6
www.memoireonline.com/12/07/795/m_analyse-et-gestion-des-risques4.html
- Chocs externes : épidémie, terrorisme
2.2- Les risques financiers:
Le risque financier est celui qui paraît le plus
évident, dans la mesure où tout dommage s'accompagne en principe
d'une perte et d'une réparation (pour certains, les entreprises ne
connaissent qu'un risque, celui de perdre de l'argent).Il se définit
comme l'événement aléatoire pouvant avoir un impact sur le
résultat de l'entreprise et pouvant affecter son patrimoine. Le risque
financier est un risque initial pouvant entraîner à son tour
l'occurrence d'autres risques.
Les quatre risques les plus courants et qui intéressent
les PME et PMI sont les risques de liquidité, le risque d'impayé,
le risque de change et le risque de taux.
Le risque de liquidité :
Est une carence de trésorerie afin de faire face
à des besoins de moyenne échéance. Ces besoins peuvent
être des échéanciers de remboursement de crédit, des
dettes fiscales ou sociales ou des dettes fournisseurs. Le risque de
liquidité peut s'analyser en tant que risque d'exploitation, endettement
mal maîtrisé ou BFR très important.
Le risque de crédit ou d'impayé :
Constitue un risque financier majeur, son impact est
immédiat outre la perte de chiffre d'affaires l'entreprise ne dispose
pas de compensation des charges engagées (main d'oeuvre, matières
premières, frais de distribution etc.) la gravité de
l'impayé dépend de la dépendance de l'entreprise à
ce client, un seul client représentant 50 % du chiffre d'affaires
constitue un risque financier potentiel.
Le risque de marché :
Contient deux catégories des risques suivants :
- Le risque de change est lié à
l'éventualité de pertes causées par l'évolution des
taux de change. Il provient du fait qu'une partie des échanges est
libellée en devises étrangères. Les variations du cours de
ces devises contre la monnaie nationale entraînent des plus ou moins
values susceptibles de peser sur les résultats. Les entreprises
travaillant à l'export sont plus exposées à ce risque.
- Le risque de taux résulte de la présence de
taux variable dans les divers contrats que souscrit l'entreprise. Quand
l'entreprise est endettée à taux variable la charge
d'intérêt
peut augmenter si les taux augmentent. Ce risque est plus
important pour les entreprises les plus endettées.
2.3- Les risques opérationnels :7
« Le risque opérationnel se définit comme
le risque de pertes résultant de carences ou de défaillances
attribuables à des procédures, personnels et systèmes
internes ou à des événements extérieurs. La
définition inclut le risque juridique, mais exclut les risques
stratégiques et d'atteinte à la réputation »
(définition du comité de Bâle)
Font suite à des défaillances
d'efficacité opérationnelle ou de prestation de service dans le
cours ordinaire des opérations d'une firme, ils sont principalement dus
aux procédures, au personnel et aux systèmes internes
inadéquat ou à des réponses inefficaces aux défis
extérieurs.
L'ensemble des sources majeures des risques
opérationnels sont à l'origine des pratiques mentionnées
ci-après:
Fraude/Légal :
-Fraude interne : Tout acte impliquant au moins une partie
interne à l'établissement et visant à détourner des
biens, des règlements ou des paiements, ou à contourner des
dispositions légales ou réglementaires (informations inexactes
sur les positions, vol commis par un employé, opérations ou
activités non autorisées, transactions sciemment non
notifiées, détournement de fonds, falsification de documents,
délit d'initié, commissions occultes,...).
-Fraude externe : Tout acte imputable à des tiers
visant à détourner des biens, des règlements ou des
paiements, ou à contourner des dispositions légales ou
réglementaires (vol, fraude, dommages liés au piratage
informatique, contrefaçon, falsification de chèques,...).
Politiques :
Toutes pratiques inappropriées en matière
d'emploi et de sécurité sur les lieux de travail ; Tout acte non
conforme au code du travail ou aux conventions collectives. relatives à
l'emploi, la santé ou la sécurité des employés, ou
susceptible de donner lieu à
7
www.fr.wikipédia.org/w/index.php?title=risques_op.1
des demandes d'indemnisation au titre d'un dommage personnel,
d'atteinte à l'égalité des employés ou d'actes de
discrimination, d'activités syndicales ou de responsabilité
civile d'une manière générale.
Opération :
Toutes pratiques inappropriées concernant les clients,
les produits et l'activité commerciale ; Tout manquement, non
intentionnel ou dû à la négligence, à une obligation
professionnelle envers des clients ou imputable à la nature ou la
conception d'un produit donné (violation de la confidentialité
des informations sur la clientèle, blanchiment de fonds, exercice
illégal de certaines activités soumises à agrément,
vente agressive, dépassement des limites d'exposition autorisées
pour un client, ..).
Catastrophe :
Tout dommage aux biens physiques ; Destructions ou dommages
résultant d'une catastrophe naturelle ou d'autres sinistres (vandalisme,
terrorisme,...).
Système interne :
Tout interruption d'activité et pannes de
systèmes ; dysfonctionnement de l'activité (interruption ou
perturbation d'un service) ou des systèmes (matériel
Informatique, logiciel, télécommunication,...).
2.4 Les risques de réputation :
Un risque de réputation est identifié comme
étant « n'importe quel événement ou circonstance
pouvant influer sur la réputation de l'organisation ».c'est
à dire toutes actions ou événements susceptibles de nuire
à la réputation ou à la valeur de l'entreprise aux yeux de
tiers. Dont les sources peuvent être d'origine :
v' Financière : performance et valeur des
investissements à long terme
v' Managériale : Communication et Gestion de crise,
Responsabilisation des dirigeants, Attitude vis-à-vis des
employés, partenaires
v' Réglementaire : Conformité juridique
v' Commerciale : Capacité à répondre aux
attentes des clients.
Pour la société, toute transgression de ses
politiques, de la loi ou des pratiques commerciales conformes à la
déontologie peut avoir des répercussions importantes sur sa
réputation et ses marques et, par conséquent, une incidence
négative sur son rendement financier.
III. Objectifs de la gestion des risques.8
La gestion des risques constitue un ensemble de concepts, de
démarches et d'outils destinés à identifier et à
contrôler les risques qui pèsent sur la vie de l'entreprise afin
de les réduire et de rechercher la meilleure couverture possible. Elle
est aussi un ensemble de processus par lequel un exploitant opérer en
utilisant des ressources et en gérant des situations dont les
conséquences sont incertaines. La gestion des risques s'inscrit dans la
politique générale de l'entreprise notamment la politique
qualité, sécurité et environnement qui est devenu un
aspect stratégique pour toute organisation.
1. La sécurité :
La sécurité est définie comme l'ensemble
des mesures de prévention et de réaction mises en oeuvre pour
faire face à une situation d'exposition au risque. Les objectifs
liés à la sécurité ont évolué avec le
temps, dans les années 1970 les questions de sécurité ne
traitaient pas les questions de l'environnement .A la fin des années
1980 la notion de développement durable voit le jour prenant en compte
des considérations nouvelles telles que le traitement des déchets
et le recyclage. De ce fait, la gestion des risques doit répondre avant
tout à des exigences de sécurité, celle-ci est relative
à la sécurité des biens et des personnes, à la
protection de l'environnement et à l'amélioration des conditions
de travail (hygiène et santé).
2. La qualité :
La qualité se définit comme l'ensemble des
propriétés et des caractéristiques d'un produit qui lui
confèrent l'aptitude à satisfaire un besoin. La qualité
pour l'entreprise est un objectif stratégique moderne. Elle est devenue
si importante à tel point qu'elle est aujourd'hui un préalable
à l'échange économique marchand. La qualité au
début n'englobait
8 John l.Dillon et J.Brian Hardaker, Recherche en
Gestion pour le développement de la petite exploitation, Rome, 1996
que quelques critères restreints tels que la relation
client/fournisseur (Prix d'achat,
caractéristiques et performance de
produit, respect du cahier des charges etc.). Aujourd'huielle nécessite
la considération de l'ensemble des acteurs de l'entreprise (enjeux
organisationnels) et son environnement (partenaires
économiques et financiers, concurrents, institutions et groupes de
pression). La maîtrise des risques de l'entreprise, passe par la prise en
compte de cet aspect.
Deuxième Chapitre :
La gestion des risques dans l'exploitation
Agricole
Nous avons jusqu'ici parlé du risque de façon
générale. Dans les pages qui suivent nous nous
intéresserons singulièrement aux risques touchent le secteur
agricole, non sans avoir traité de leur typologie. Mais tout d'abord en
va mettre sous le microscope l'entreprise agricole pour savoir son
environnement. Ainsi les acteurs des différentes sphères et leurs
rapports avec l'entreprise. Et en fin en passe aux Processus de gestion,
indicateurs et méthodes de couverture de ces risques.
I. L'environnement de l'exploitation agricole9
1. Le sphère économique
Le Maroc, et depuis l'indépendance, a élever le
secteur agricole au premier rang des priorités économiques
nationales de développement en raison de la place qu'il occupe dans le
tissu économique et social du pays.
Les orientations actuelles de la politique agricole cherchent
à consolider les succès acquis et à répondre aux
nouveaux défis de compétitivité, d'ouverture et de
réduction des disparités. Ainsi, la politique agricole s'articule
pour les années avenir autour des quatre orientations suivantes :
v' Contribution à la garantie de la sécurité
alimentaire ; v' Améliorer des revenus des agriculteurs
v' Protection et conservation des ressources naturelle
v' Intégration de l'agriculture au marché national
et International.
Le PIB agricole est de 54 milliards de dirhams en moyenne sur
les 5 dernières années, soit 15% du PIB national.
Avec 4 millions d'actifs occupés, le secteur primaire
représente plus de 45% des emplois actifs au Maroc, une forte
corrélation entre le PIB national et le PIB agricole, près de
1,43 millions d'exploitations agricoles d'une taille moyenne de 6,1 Hectares.
70% des exploitations ont une taille inférieure à 5 hectares. Le
secteur est soumis aux aléas climatiques et caractérisé
par la faiblesse des rendements, en particulier dans les zones Bour.
2. La sphère géographique10 :
9Revue H.T.E. N° 126 -- juin 2003
La superficie du Maroc est estimé à 71 millions
d'hectares dont 39,2 millions d'hectares sont à vocation agricole, soit
55% de la superficie totale.
Selon leur utilisation actuelle, les terres à vocation
agricole sont réparties comme
suit :
|
Terres à vocation agricole
|
Superficie en millions
d'hectares
|
|
Terres cultivables
|
9,2
|
|
Forêts
|
5,8
|
|
Nappes alfatières
|
3, 2
|
|
Parcours
|
21
|
|
Total
|
39,2
|
Tableau 1: la division de terres à vocation agricole
Les superficies cultivables sont estimées en 1997
à 9,2 millions d'hectares dont 2,5 millions d'hectares de
jachère. La répartition des ressources en sols montre que les
terres à haut potentiel agricole sont concentrées essentiellement
dans les plaines et plateaux atlantiques. Dans le reste du Maroc, les
contraintes édaphiques sont d'ordres intrinsèques (profondeur,
croüte calcaire, salinité...) et extrinsèques (relief
accidenté, érosion, lessivage,...). Ainsi. Le climat et le relief
constituent les deux principaux facteurs déterminants de la production
agricole.
10
http://www.madrpm.gov.ma/systeme_information.htm
Ressources présente sur son territoire toutes les
variantes du climat méditerranéen ; ce qui explique la grande
diversité de ses formation végétales allant des acacias
sahariens à faible couvert végétal aux belles
cédraies du Moyen Atlas à potentialités forestières
élevées.
3. La sphère financière :
Afin de mieux appréhender l'évolution du
système de financement, il convient de Présenter les principales
contraintes auxquelles sont confrontée l'agriculture marocaine et leurs
répercussions.
A. Contraintes climatiques forte dépendance à
la pluviométrie :
Sur une SAU de 8,7 millions ha, seuls 1, 25 millions ha sont
irrigués. On constate aussi une forte corrélation entre
l'évolution du PIB agricole et les précipitations. Ces
contraintes impliquent sur le système financier de promouvoir un
système viable de gestion de risques climatiques dans les zones Bour, de
mettre en place une politique de crédit et de subvention qui prend en
considération le potentiel agro climatique des régions à
agriculture pluviale.
B. Contraintes foncières exigüité des
exploitations et absence de garanties. Les statistiques montrent que 70%
des exploitations agricoles ont une superficie de moins de 5 ha. La SAU
extrêmement morcelée (6,4 parcelle / exploitation et 0,92 ha /
parcelle). Il ya aussi l'absence de garanties réelles (insuffisance des
statuts juridiques : Melk adulaire, collectif, Guich, Habous . . .).Ces
contraintes imposent sur le système de financement de segmenter de
manière fine les exploitations agricoles en fonction de critères
permettant d'appréhender le risque et la rentabilité de la
relation.
Elles nécessitent aussi la mise en oeuvre d'une
démarche Marketing et une approche du risque adaptée à
chaque segment. Et finalement de traiter en profondeur la problématique
foncière.
C. Contraintes socioculturelles liées aux
caractéristiques de la population rurale :
A ce niveau, on cite :
v' Niveau d'instruction insuffisant (3,5% = 6 ans
scolarité)
v' Vieillissement des agriculteurs (âge moyenne = 52
ans)
v' Faible niveau d'utilisation des intrants. Rôle de
l'élevage comme moyen de gestion de la trésorerie.
Pour lutter contre ces risques l'Etat a prévu une
politique d'encouragement du regroupement des agriculteurs et d'accès
des jeunes, notamment les plus instruits, à la propriété
agricole. Elle a encouragé également l'utilisation des
technologies adaptées et l'a renfoncé l'encadrement technique des
exploitations.
Mais autre procédures adoptée c'est celle de la
bancarisation progressive du monde moral.
D. Contraintes financière : le surendettement des
agriculteurs :
Le surendettement est dû à plusieurs causes, en
effet la succession des années de sécheresse, la faiblesse
structurelle des rendements (zones Bour) et l'inadéquation des mesures
prises pour le traitement du surendettement (incompatibilité
échéance / revenu) sont les principaux causes de ce
surendettement.
Des mesures ont été mises en place pour faire face
à ces menaces, à savoir v' L'adaptation des mesures
ciblées (non systématique).
v' Adaptation des échéances aux revenus
dégagés par les exploitations agricoles.
v' La restructuration de la culture de remboursement.
Dans le même contexte de résolution des
problèmes de financement dans le secteur agricole, l'Etat a crée
un nouvel établissement financière dont la mission essentielle
est de financer les activités agricoles. On parle du système de
crédit agricole.
Depuis sa création en 1961, le crédit agricole
réalise progressivement l'ensemble des opérations bancaires :
v' Collecter des dépôts.
v' Octroi de crédits de fonctionnement et
d'investissement.
v' Financement du commerce extérieur de la
clientèle agricole. v' Gestion des moyens de paiement.
v' Bancassurance.
Il a accompagné l'évolution du système
bancaire. Deux grandes étapes à retenir : v' 1987 :
assujettissement à l'IS
v' 1993 : soumission à la loi bancaire (règles
prudentielle, normes comptables, modalité de contrôle...)
Des inconvénients ont été marqués
la vie de cet établissement, en effet, on est devant la
généralisation d'une approche occultant les
spécificités régionales et la capacité
d'endettement des clients, on trouve également la distribution de
crédits dans un contexte agro climatique défavorable (abondance
de lignes d'emprunts extérieurs), on cite aussi le recours au
rééchelonnement successif des créances comme seule
réponse à la problématique du surendettement.
Le crédit agricole a entamé, 1998, une
restructuration fondée principalement sur le repositionnement
stratégique, la segmentation de la clientèle, l'adoption de
l'offre globale à chaque segment.
Il a procédé également à un
traitement adapté et en profondeur du surendettement des agriculteurs,
en outre, une approche de financement plus efficiente a été mise
en place.
En 31 décembre 2002, le crédit agricole
représente la 1ère implantation bancaire en milieu
rural avec 344 points de vente, 80% de ses crédits sont octroyés
aux agriculteurs, 19,3 milliards dirhams au secteur agricole (415000 dossiers),
19,7 milliards dirhams de ressources dont 12,1 milliards dirhams de
dépôt de la clientèle.
Le crédit agricole dispose aujourd'hui d'une offre
bancaire complète et compétitive, toutefois, l'accès au
crédit d'un nombre important de PMEA constitue le défi futur
à relever.
II. Typologie des risques dans le secteur agricole
11
Dans l'activité agricole, par nature dépendante
des conditions climatiques et sanitaires, Les risques sont nombreux et divers.
Nous soulignerons dans cette section leur multiplicité, leur typologie
puis nous en définirons les plus usuels. Les risques en
11 O. Harmignie, B. H. de Frahan, P. Polomé, F. Gaspart ;
Gestion des risques-Perspectives pour l'agriculture wallonne ;
Louvain-la-Neuve, décembre 2004
agriculture peuvent être classés selon leurs
principales sources. Sur cette base, en adoptons la typologie suivante.
v' Risques économiques ou commerciaux :
Les risques économiques ou commerciaux se
réfèrent au caractère imprévisible du prix des
intrants et des productions agricoles. De plus en plus, les agriculteurs sont
confrontés à des marchés libéralisés et, par
conséquent, moins prévisibles pour les intrants et les produits
agricoles. En conséquence, le risque de prix devient significatif et
augmente avec le temps. Les risques de change sont repris ici parmi les risques
économiques et commerciaux pour les entreprises exportatrices. Ils
portent sur la réévaluation ou la dévaluation de la
monnaie nationale.
v' Les risques financiers :
Les risques financiers comprennent les risques liés aux
sources de financement de l'exploitation. Les risques financiers comprennent
par exemple, une augmentation inattendue des taux d'intérêts et
des taux de change qui inclut également le risque de nonpaiement et le
risque de liquidité ou le manque de disponibilité d'un prêt
qui s'avère nécessaire.
v' Les risques naturels de production :
Ces risques affectent le rendement agricole et la
qualité des produits. Ils sont issus de la nature imprévisible
des conditions météorologiques et sanitaires ainsi que de
l'incertitude relative aux performances des cultures ou du bétail.
v' Les risques institutionnels :
Les risques institutionnels proviennent de l'incertitude de
l'impact des politiques gouvernementales sur le profit réalisé
par les entreprises. De nombreuses activités agricoles impliquent aussi
des responsabilités qui ont des implications légales, pour
exemple, le respect des contrats en agriculture et la responsabilité
civile dans le domaine environnemental ou sanitaire. Les implications
liées aux changements des normes sanitaires et environnementales sont
ici reprises parmi les risques institutionnels.
v' Les risques humains et professionnels :
Les risques humains et professionnels sont les aléas qui
touchent les personnes qui gèrent l'exploitation. Ces risques
comprennent les maladies, les accidents de travail, les
décès accidentels, vols, dégradation,
destruction des outils de production, communs à toutes les
entreprises
Ces différentes catégories de risque ne sont pas
indépendantes. Les risques peuvent interagir entre eux et se cumuler.
Par exemple, le risque institutionnel peut avoir des conséquences sur
les risques financiers en imposant de nouveaux investissements pour une mise
aux normes.
1. Les risques économiques ou commerciaux12
L'évolution des risques économiques et
commerciaux est étroitement liée à la fluctuation du prix
des produits est plus importante pour les entreprises
spécialisées dépendantes de la fluctuation des prix d'une
seule catégorie de productions.
1.1. Le niveau de spécialisation de
l'agriculture
Les exploitations agricoles sont de plus en plus
spécialisées. Une exploitation est considérée comme
spécialisée si plus des deux tiers de sa marge brute est fournie
par un même type de production. Toute autre chose étant
égale par ailleurs, la spécialisation des exploitations agricoles
accroît encore le niveau des risques de revenu. Toutefois, il peut
exister des diversifications au sein de chaque exploitation et en dehors des
activités agricoles mais la tendance globale semble être la
spécialisation. Compte tenu de la diminution régulière des
prix, la spécialisation permet aux exploitations agricoles de se
concentrer sur les productions pour lesquelles elles sont les plus rentables
et, par conséquent, minimiser les coûts et améliorer la
rentabilité.
1.2. Le risque de rendement (quantité) et le
risque de qualité
Sont liés aux conditions climatiques durant le
processus de production et aux problèmes sanitaires. Enfin le risque de
coût de production est lié aux aléas de prix sur les
facteurs de production, donc sur les conditions d'offre et de demande de ces
produits, mais aussi à la variabilité sur la quantité de
ces facteurs nécessaires à la production
1.3. La variation des prix13
On observe que les variabilités de prix sont plus
élevées pour les productions les moins régulées,
telles que les productions horticoles et les légumes ainsi que les
productions animales issues. La variabilité des prix des
céréales, de la viande bovine et du
12 Flash Agri ; Numéro 104 - 9 novembre 2007;
pp 2-7
13 Flash Agri ; Numéro 136 - 23 juin 2009; pp
6
lait a tendance à augmenter. Le risque de prix ou
risque de marché sur une production est lié aux aléas sur
les fonctions d'offre et de demande sur le marché. L'aléa sur la
demande est lié aux conditions climatiques (en particulier la
température et l'ensoleillement) et à des aléas sociaux
(confiance du consommateur, pouvoir d'achat). Les entreprises
développent des outils de marketing pour influencer la demande et
réduire l'aléa (la communication privée et collective et
la promotion des produits). L'aléa sur l'offre est lié aux
conditions climatiques (températures instantanées et
cumulées, pluviométrie, grêle, vent), et à des
problèmes sanitaires tant pour la production végétale
qu'animale (par exemple la grippe de proc qu'influence les prix de viande de
proc aujourd'hui dans le monde).
1.4 Logistique et Assurances14
Par le fait que ce sont des produits d'exploitation et donc
une source de devise, les fruits et légumes constituent une part
très importante de l'économie agroalimentaire de notre pays.
Certaines particularités des fruits et légumes, la
saisonnalité, la valeur économique élevée et la
grande concurrence des régions productrices font que la
commercialisation de ces produits soit spécialement complexe et
évolue avec rapidité.
A la fois impactés et impactant de cette
évolution, la logistique, également les secteurs de l'assurance
et du transport des produits agricoles qui intéressent de plus en plus
les cadre d'entreprises et les entrepreneurs. Tout le monde, aujourd'hui,
s'accorde le fait que notre plate-forme logistique, en dépit des
défis qu'elle relève, présente un réel atout pour
les entreprises marocaines, notamment les exportatrices.
2. Les risques financiers
Le besoin de financement de l'activité agricole est une
source importante de risque qui amplifie les conséquences des risques de
revenu. Il est important de souligner aussi que le risque financier peut aussi
être une conséquence du risque de revenu. Une entreprise qui
souhaite réaliser un investissement obtiendra moins facilement des
crédits si le résultat de son investissement est incertain.
2.1 L'évolution du taux de
solvabilité
Un des facteurs qui détermine la sensibilité de
l'entreprise aux risques financiers subis est le taux de solvabilité. En
matière de risque, le taux de solvabilité est un facteur
important à prendre en considération. La diminution du taux de
solvabilité démontre la
14 Pack info, N° 73, nov/déc 2008, pp :
45-60
nécessité d'apporter des solutions pour une
meilleure gestion financière des exploitations agricoles. Une
exploitation endettée doit consacrer une partie importante de son revenu
au remboursement du solde de l'emprunt et au payement des charges
d'intérêt. Elle a donc moins de liquidités disponibles et
peut moins facilement emprunter. Elle est aussi plus vulnérable en cas
de variation de revenu. On observe peu de différences des taux de
solvabilité entre régions agricoles ou entre orientations
technico-économiques. Parce que l'on devient propriétaire avec
l'age, les agriculteurs les plus jeunes sont plus sensibles aux risques
financiers.
2.2 Les investissements en présence de
risque
Devant les multiples incertitudes, les agriculteurs
rencontrent des difficultés à réaliser un plan de
financement à moyen ou long terme. Un niveau trop élevé de
risque rend impossible la réalisation d'un projet durable
d'investissement ou d'installation. Il peut aussi décourager des jeunes
à s'engager dans l'agriculture. Ces difficultés justifient la
mise en oeuvre d'une politique volontariste en matière de risque.
3. Les risques naturels de production15
C'est-à-dire résultant des forces de la nature
(tempête, tremblement de terre, sécheresse, incendie de
forêt inondation, et phénomènes d'érosion ou de
glissements de terrain). Bien connus des agriculteurs, les risques naturels
sont responsables pour l'essentiel des fluctuations de production. Ils peuvent
être de nature :
- Climatique : inondations, gelées, sécheresse,
grêle, etc.
- Sanitaire : phytosanitaire, zoo sanitaire (individuel ou
collectif - épizooties).
Toutefois, une meilleure gestion de ceux-ci reste souhaitable
car conjugués aux risques de prix, ils peuvent générer des
risques de revenu importants. De nombreux pays ont développé des
systèmes d'assurance dits 'multi-risques' permettant de couvrir
l'essentiel des risques naturels de production existants.
Le changement climatique est aussi un facteur de risque.
Même s'il n'est pas sûr que les prévisions catastrophistes
se réalisent, on constate que les aléas climatiques se
multiplient, et peuvent provoquer des dégâts sur les actifs de
l'entreprise. Les installations industrielles sont elles-mêmes facteurs
de risque pour le voisinage ou l'environnement. Un
15 Robert G. Aumell, P.Ag., CAC, Aumell
Agri-Consulting, Guide de gestion des risques agricole, CCGEA 2005
aléa peut être désigné comme une
calamité agricole si un aléa semblable n'est pas intervenu au
cours d'un certaines années précédentes. Au Maroc la
fréquence exceptionnelle des calamités intervenues cette
année (les inondations qu'a connu notre pays dans les mois novembre et
septembre provoquent des dégâts dans des plusieurs superficies
agricoles notamment les régions ouest et nord). Aussi parmi ces risques
naturels dont la Maroc est sensible et dont le secteur agricole souffre : la
sécheresse. On parle alors de la sécheresse agricole quand il n'y
a pas assez d'humidité pour les cultures. Cette condition peut avoir
lieu même si les précipitations sont normales à cause des
conditions du sol et des techniques agricoles, ou de choix de plantes
inadaptées (ex : maïs ou riz, très consommateurs d'eau en
zone sèche).
4. Les risques institutionnels16
Les risques institutionnels sont générés
par des changements de politique ou de réglementation qui affectent
l'agriculture. Ce type de risques peut se traduire par des contraintes
productives, sanitaires ou environnementales que les agriculteurs n'ont pas pu
anticiper, telles que des restrictions d'usage des pesticides ou
antibiotiques.
L'imposition de nouvelles normes environnementales
réduit le nombre de techniques de productions disponibles. Elle implique
des investissements dont les coûts peuvent être importants.
L'imposition de telles normes implique aussi un risque de sanction, mettant
directement en danger le revenu des agriculteurs.
Les modifications de ces réglementations en
matière d'environnement sont nombreuses ces dernières
années. L'agriculture doit réaliser un effort important pour
parvenir à se conformer aux différentes législations en
vigueur. Ces législations pourraient entamer les capacités
financières et limiter les possibilités de production des
exploitations agricoles.
5. Les risques humains et professionnels.
Les suites d'un accident peuvent avoir des conséquences
financières importantes pour l'exploitation (frais de soins,
d'assurance, de remplacement de main d'oeuvre et de matériel...), mais
aussi physiques et affectives, à la fois pour la victime de l'accident
et pour son entourage. Cependant, il ne faut pas minimiser cette source
potentiellement
16M.Mouhssine Adnane, contribution a
l'évaluation des impacts du système d'assurance du risque
sécheresse au Maroc, mémoire de 3émé cycle pour
l'obtention de grade d'ingénieur d'état en agronomie, 23 juillet
2004
importante de risques. Les exploitations agricoles restent
très sensibles à tout accident pouvant toucher le chef
d'exploitation.
III. Processus de gestion des risques agricoles et
méthodes de couverture:
1. Processus de gestion des risques agricoles:
La gestion des risques est un processus mis en oeuvre par le
Conseil d'Administration, la direction générale, le management et
l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. L'objectif du processus de
management des risques est le suivant : «La finalité du processus
de management des risques est d'identifier et diminuer les risques de projet
tout au long du cycle de vie d'un projet.»17
Il est pris en compte dans l'élaboration de la
stratégie ainsi que dans toutes les activités de l'organisation.
Il est conçu pour identifier les événements potentiels
susceptibles d'affecter l'organisation et pour gérer les risques dans
les limites de son appétence pour le risque. Il vise à fournir
une assurance raisonnable quant à l'atteinte des objectifs de
l'organisation.
Pour atteindre, cet objectif, on a structuré le processus
de management des risques en 5 phases : la définition de la
stratégie, l'analyse, le traitement des risques, le suivi et la
capitalisation. L'interaction de ces phases est représentée dans
la figure.
17 ISO/CEI TR 15504-5, « Technologie de
l'information - Évaluation de processus de logiciel - Un modèle
d'évaluation et guide des indicateurs », 1998

Analyse des
risques
Identification
Evaluation
Hiérarchisation
Traitement des risques
Définition de la stratégie du management
des
risques


Capitalisation
Figure 2: schéma Processus de gestion des risques ; Source
: ICSSEA 2002 Assises ADELI n°10 Chauveau
1.1 Définition de la stratégie18 :
Dans cette phase, on définit la stratégie du
management des risques pour l'exploitation, c'est à dire le champ
d'action du management des risques d'exploitation. Les modalités, et,
éventuellement, le mode de calcul ou de détermination de
certaines caractéristiques sont définis. Plus
précisément, on définit :
· Les types de risques que l'on va gérer,
c'est à dire les classes de risques auxquelles on va s'intéresser
ou les processus sur lesquels on va concentrer l'effort, en fonction des
objectifs, enjeux et contraintes de l'exploitation;
18 Assises ADELI, n°10,4 décembre 2002,
P6
· Les caractéristiques qui seront
utilisées. En effet, il faut savoir adapter le management des risques en
fonction des spécificités, durée, contraintes, de
l'exploitation ;
· Les méthodes, procédures et outils qui
seront utilisés et en particulier les méthodes d'identification
et d'évaluation. Pour l'évaluation, il faudra en particulier
définir les modalités ou valeurs de la probabilité, de
l'impact et définir le mode de calcul de l'exposition ;
· Les types de stratégies possibles pour le
traitement des risques : transfert (assurance), acceptation active (mise en
place d'actions de prévention), acceptation passive (mise en place
d'actions correctives)...
1.2 Analyse des risques :
1.2.1-
Identification des risques :
Identifier les risques, c'est attribuer à un risque un
libellé, mais aussi mettre en exergue ses causes et ses
conséquences. On lui attribue alors une classe, un propriétaire
et éventuellement un processus lié et d'autres
caractéristiques comme sa période active et sa
répétabilité.
Le libellé
<Description succincte et non ambiguë du risque". Ce
n'est pas une caractéristique à proprement parler mais c'est un
élément essentiel qui décrit le risque. Cette description
ne doit pas être trop générale. En effet une description
trop générale, rendra difficile la détection du risque,
mais surtout son évaluation. Il est préférable de
découper un risque trop général en plusieurs risques bien
identifiés.
Les causes
<Les causes sont l'ensemble des événements,
certains ou non, pouvant conduire à sa manifestation. Les causes d'un
risque peuvent être de plusieurs natures. [...] Les causes d'un risque
peuvent être des faits, des contraintes, d'autres risques.
"19.Les causes sont décrites de manière informelle. De
même que chaque risque peut posséder plusieurs causes, plusieurs
risques peuvent avoir des causes communes.
Les conséquences
< Résultat d'un événement " .Cette
caractéristique décrit de manière informelle et succincte
l'ensemble des impacts potentiels du risque sur le projet. Ces impacts
peuvent
19 DGA/AQ 924, < Manuel du management des risques
dans un programme d'armement ", 1995
affecter le budget, les délais, les charges du projet, la
qualité ou les performances des logiciels produits, voire remettre en
cause l'existence même du projet.20
La période active du risque
« La période active correspond à la
période durant laquelle le risque est susceptible de se manifester
»21. Cette période active peut correspondre, soit
à des intervalles temporels, soit à des phases/activités
du projet.
La répétabilité
« Aptitude du risque à se produire plusieurs fois
» La valeur de cette caractéristique est binaire : le risque peut
se répéter ou non. Par exemple, le risque « Départ
d'un membre de l'équipe projet » est répétable.
Plusieurs sources sont utilisées pour identifier les
risques :
v' Les états comptables et financiers
v' Les documents internes et externes
v' Les questionnaires
v' Les listes types
1.2.2-Évaluation des risques22 :
Le but de cette activité est de donner une
évaluation ou estimation de certaines caractéristiques du risque
telles que la probabilité d'apparition, l'impact ou la
détectabilité. L'évaluation de ces caractéristiques
est basée sur l'analyse des causes et des conséquences des
risques.
Le propriétaire est un acteur majeur de cette phase.
L'évaluation peut être faite de manière qualitative ou de
manière quantitative. Dans le cadre d'une estimation quantitative l'on
donnera une valeur à la caractéristique : pourcentage pour la
probabilité et la détectabilité, valeur financière
pour l'impact coût, et nombre de jours ou de mois pour l'impact
délai. Pour l'impact, on peut utiliser une fonction statistique de
répartition
20 ISO/CEI 73, « Gestion du risque - Vocabulaire
- Principes directeurs pour l'utilisation dans les normes », 2001
21 DGA/AQ 924, « Manuel du management des risques
dans un programme d'armement », 1995
22 Assises ADELI, n°10,4 décembre 2002,
P6
(constante, normale, â, ...). L'estimation qualitative
quant à elle, fournit une valeur sur une échelle ordinale
-La probabilité d'apparition
« Degré de vraisemblance pour que le risque se
produise »23.Cette probabilité peut être
évaluée de manière qualitative ou quantitative.
L'évaluation qualitative consiste à affecter une valeur sur une
échelle ordinale (par exemple : très faible, faible, forte et
très forte). L'évaluation quantitative quant à elle,
affecte une valeur numérique à cette probabilité.
-L'impact ou gravité
« Mesure des conséquences du risque
»24.Cette caractéristique donne une estimation des
conséquences du risque. On peut considérer un impact sur les
coûts, sur les délais et la qualité. On peut aussi, si l'on
travaille en évaluation qualitative, considérer un impact global
en lui attribuant une valeur sur une échelle ordinale (par exemple :
très faible, faible, fort et très fort). Si l'on considère
un impact quantitatif sur les coûts ou les délais, on peut donner
une fonction de répartition statistique de l'impact (loi constante,
normale, â, ...).
1.2.3-Hiérarchisation des risques :
L'objectif de cette activité est de classer les risques
en fonction de leur dangerosité. Pour ce faire, on utilise la
caractéristique d'exposition. L'exposition ou criticité est
« Niveau d'importance d'un risque résultant de la combinaison des
caractéristiques quantifiées du risque, à savoir sa
gravité, sa probabilité d'apparition et/ou sa probabilité
de détection »25
L'exposition est une caractéristique calculée
à partir de la probabilité d'apparition, de l'impact et parfois
de la détectabilité. La fonction ou matrice de calcul de
l'exposition utilisée est déterminée lors de la phase de
définition de la stratégie de management des risques.
Une fois les expositions de tous les risques calculées, on
classe les risques par niveau d'exposition décroissant.
23ISO/CEI 73, « Gestion du risque - Vocabulaire
-- Principes directeurs pour l'utilisation dans les normes », 2001
24 BS 6079-3:2000, « Project Management: Guide to
the management of business related project risk », 2000
25 FD X 50-117, « Management des risques d'un
projet », à paraître
Cette démarche permet alors de hiérarchiser les
risques en les classant, par exemple, en 5 catégories
essentielles26 :
R0. Risque nul ou négligeable. Sa réalisation est
très improbable et n'aurait aucune incidence sur les objectifs de
l'entreprise.
R1. Risque faible. Les conséquences peuvent être
compensées sans effets négatifs sur les objectifs de
l'entreprise. Ne justifie pas des mesures contraignantes de
sécurité supplémentaires.
R2. Risque moyen. Sa réalisation fragilise
l'entreprise. Les objectifs peuvent encore être atteints mais avec des
mesures (et donc des coûts) supplémentaires. Nécessite un
traitement.
R3. Risque fort ou majeur. Sa réalisation compromet
les objectifs de l'entreprise. Nécessite un plan de traitement avec plan
de redémarrage ou plan de survie avec recours à l'assurance.
R4. Risque catastrophique. Sa réalisation entraîne
la disparition de l'entreprise. Traitement indispensable,
généralement avec transfert à l'assurance.
1.3 -Traitement des risques :
Le traitement des risques est la dernière phase de la
gestion des risques. Si l'identification est à juste titre
considérée comme déterminante pour la qualité de
l'analyse et l'évaluation comme la phase la plus difficile de mise en
oeuvre, le traitement des risques est vraisemblablement (avec le choix du seuil
d'acceptabilité) la phase la plus lourde de responsabilité pour
les gestionnaires.
L'objectif du traitement des risques est double. Il s'agit
d'une part de prévenir et de réduire les risques inacceptables
par la mise en place de mesures de prévention ou de protection afin
d'atteindre un niveau de sécurité maximal.
L'objectif de cette phase est de déterminer, pour
chaque risque jugé inacceptable, le type de réponse ou
stratégie permettant de le maîtriser et de définir les
actions à mettre en oeuvre.
Différentes stratégies peuvent être choisies
:
26 Wafabank, N°63, janvier 2002, P8
· Transfert ou partage du risque ;
· Élimination du risque (en supprimant ses causes)
;
· Réduction du risque par des actions visant soit
à diminuer sa probabilité (actions préventives), soit
à diminuer son impact s'il se réalise, soit à combiner les
deux approches. Les risques jugés acceptables seront placés sous
surveillance et réévalués périodiquement.
|
|
|
Eviter/ Eliminer
|
|
|
|
|
Risque total
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Réduire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Transférer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tolérance face au risque
|
|
Figure 3: Traitement des risques ; Source :
http://www.hesge.ch/heg
1.4 Suivi des risques
La phase de suivi des risques à pour but de surveiller
les risques au jour le jour. La veille et plus largement l'Intelligence
Economique (ou IE) entrent dans les éléments moteurs du
développement économique et politique de l'entreprise. Restreint
à la gestion des risques, l'évolution des techniques, des
réglementations, des normes, des pratiques de la concurrence sont des
indicateurs qu'il convient de réévaluer périodiquement
afin de ne pas se laisser "surprendre" par le fait accompli. L'instauration
d'une cellule de veille
permettra d'accroître le flux d'informations pertinentes
recueillies et facilitera l'anticipation des évolutions majeures de
l'environnement d'entreprise.27
On peut distinguer trois éléments
différents dans le suivi :
· Le suivi de l'évolution des risques et des
actions; pour cela on suit la probabilité, l'impact, et l'exposition des
risques et la mise en place et l'efficacité des actions avec la tendance
d'évolution des risques qui est mise à jour
régulièrement (la tendance d'évolution est
initialisée à stable en début de phase) ;
· La détection du risque : elle s'appuie sur la
surveillance des causes des risques et des valeurs des indicateurs. On porte
une attention particulière aux risques de faible
détectabilité. Si un risque se produit, on lance les actions
correctives éventuelles et on met à jour son état (au
début du suivi les états des risques sont initialisés
à latent) ;
· Le lancement périodique de phases d'analyse et de
traitement.
On s'intéresse plus particulièrement aux risques
dont la période active est en cours. Les propriétaires des
risques jouent un rôle très important dans cette phase.
1.5 Capitalisation28
L'objectif de cette phase est de constituer et enrichir des
bases de connaissances portant sur les risques identifiés dans les
projets de l'organisation. Cette phase a pour finalité
d'améliorer la mise en oeuvre et l'efficacité des phases
d'identification, d'évaluation et de traitement des risques dans des
projets ultérieurs. Comme dans la phase d'identification des risques,
les caractéristiques Classe et Processus lié permettent de
structurer la démarche de capitalisation en regroupant des risques de
nature voisine. De plus, pour chaque risque identifié, on enregistrera
:
· son libellé ;
· ses causes ;
27
www.memoireonline.com/12/07/795/m_analyse-et-gestion-des-risques4.html
28 Le processus de management des risques,
n°10,4 décembre 2002, P6
· ses conséquences ;
· les actions de réduction associées ;
· éventuellement, les indicateurs liés aux
risques.
Ces différentes informations seront rendues les plus
génériques possibles en éliminant en particulier toute
référence à des acteurs, phases, outils, produits
spécifiques au contexte du projet. Le caractéristique état
sera utilisée afin d'évaluer l'efficacité (et
éventuellement les limites) des actions de réduction
associées.
2-Méthodes de couverture contre les risques 29:
La gestion des risques agricoles est d'abord de la
responsabilité de l'entreprise agricole. L'objectif de la gestion du
risque consiste à modifier le niveau d'exposition au risque de
l'entreprise afin de le porter à un niveau acceptable. La gestion du
risque consiste souvent à réduire le niveau de risque car les
fonds propres de l'entreprise ne permettent pas de supporter les pertes
potentielles et aléatoires liées à son activité et
à son environnement.
La toute première méthode de gestion du risque
est de disposer de réserves financières et de capacité
d'emprunt afin d'absorber de mauvais résultats économiques
annuels. La capacité d'emprunt dépend du taux d'endettement de
l'entreprise, c'est-à-dire le rapport entre l'endettement courant et les
capitaux propres. Les réserves financières correspondent au
capital social de l'entreprise et aux réserves accumulées. Les
agriculteurs parlent parfois de la récolte d'avance. Cependant
l'intensité capitalistique de la fonction de production limite la
capacité normale des agriculteurs à créer ou à
maintenir un niveau adéquat de réserves financières.
L'État peut cependant favoriser la création d'une épargne
de précaution par des formes incitatrices de défiscalisation des
résultats annuels de l'entreprise.
La seconde méthode de gestion du risque consiste
à le diversifier. Il s'agit d'organiser un portefeuille
d'activités ou de procédures qui permettent des compensations de
pertes et de bénéfices. Le dicton populaire « ne pas mettre
tous ses oeufs dans le méme panier » illustre parfaitement la
méthode de diversification. Concrètement, l'entreprise agricole
peut-elle diversifier ses productions afin d'éviter le cumul des risques
climatiques,
29Note d'études économiques, n°30,
mars 2008, pp. 33-71
sanitaires et de marché ? Si l'entreprise ne peut se
diversifier mais au contraire se spécialise pour réduire ses
coûts de production, elle peut rechercher une diversification commerciale
afin de gérer le risque de marché. Elle répartit ainsi ses
ventes dans le temps afin d'obtenir une valeur moyenne de marché. Les
productions agricoles non saisonnières, comme le porc ou le lait,
permettent naturellement d'obtenir un prix moyen de marché. Les contrats
à terme permettent également de diversifier les ventes pour les
produits saisonniers comme les céréales ou les
oléagineux.
Enfin, la troisième méthode de gestion du risque
consiste à le vendre à un tiers. Cette cession du risque contre
paiement d'une prime se réalise traditionnellement sur le marché
financier à l'aide d'options de vente et d'achat et auprès de
sociétés d'assurance spécialisées sur le risque
concerné. L'ensemble constitué du marché financier et du
marché de l'assurance s'appelle le marché du risque.
L'efficacité de ce marché apparaît historiquement
indispensable au développement économique.
2.1. Les provisions comptables30
Pour lutter contre les risques financiers croissants, il
semble nécessaire d'améliorer la gestion financière des
exploitations. Ces dernières années, l'importance croissante des
capitaux empruntés parmi l'ensemble des capitaux, amène des
risques croissants de surendettement et de défaillance des exploitations
agricoles.
Pour encourager la constitution de provisions et, d'une
façon plus générale, une meilleure gestion des risques
financiers, quatre solutions sont à envisager.
La première solution serait d'améliorer les
compétences en gestion des agriculteurs, en privilégiant les
formations dans le domaine de la gestion.
La deuxième solution serait de prévenir les
risques et détecter des entreprises à risque. La
réalisation d'audits financiers pour les entreprises qui les souhaitent
pourrait permettre de détecter les situations problématiques
avant que des problèmes sérieux n'interviennent.
Ces audits seraient semblables à ceux
réalisés par les banques pour juger de la rentabilité ou
non d'un plan d'investissement. Deux autres solutions consistent à
mettre en place des provisions pour investissement et des provisions pour
aléas. Ces solutions sont précisées ci-dessous.
30Gestion des risques-Perspectives pour l'agriculture
wallonne, OP.CIT.
a. Les provisions pour investissement
Les systèmes de provision sont très souvent
cités comme un élément efficace de gestion individuelle
des risques. Le principal avantage de ce type de système est qu'il
à un coût négligeable voir nul.
La condition d'investissement signifie que la PME doit
investir un montant égal à la réserve d'investissement en
nouvelles immobilisations corporelles et incorporelles amortissables. La
réserve ne peut donc pas servir à financer des investissements
non amortissables.
b. La déduction pour aléa
Cette déduction incite à la constitution d'une
épargne de précaution défiscalisée afin d'aider les
exploitants agricoles à faire face à des investissements futurs
mais aussi à des aléas d'ordre climatiques, sanitaires,
économiques et familiaux affectant la conduite de l'exploitation.
Le principe est le suivant. Un agriculteur constitue une
provision sur un compte prévu à cet effet. Cette provision est
alors déduite de ses revenus pour l'exercice au cours duquel elle a
été constituée. Suite à la survenance d'un
aléa, l'agriculteur peut retirer la
somme contenue sur le compte. Cette somme sera alors
ajoutée aux revenus de l'année oül'aléa
est intervenu.
En cas de survenance d'un aléa, l'utilisation des
sommes épargnées est libre. L'utilisation pourra aussi bien
être affectée dans l'intérêt de l'exploitation que
pour les besoins d'ordre privé de l'exploitant et de sa famille. En cas
d'aléa, la déduction pratiquée est rapportée au
résultat de l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu. La
provision constituée est valable pour cinq ans. Au bout de cinq ans, si
la provision n'a pas été utilisée, elle est
réintégrée aux résultats du cinquième
exercice suivant celui où elle a été pratiquée.
Les aléas auxquels la déduction permet de faire
face sont d'ordre :
· Climatique (gel, sécheresse, inondations),
· Économique (fluctuation des prix,
réglementation des marchés, etc.),
· Sanitaire (épizooties, maladies
végétales),
· Familial (événements affectant la conduite
de l'entreprise
2.2. Diversification de l'exploitation31
La diversification de l'exploitation constitue l'un des plus
anciens outils de gestion des risques liés à la production. La
diversification constitue un moyen efficace de diminuer la fluctuation du
revenu, en ce qu'elle fait appel à différents processus de
production. Par exemple, elle peut comporter diverses productions, une
combinaison de cultures et d'élevage, des produits variés
à la fin d'un même processus de production (comme des produits
vendus en différents formats) ou encore différentes
variétés de la même culture (par exemple, maïs jaune,
maïs blanc ou maïs à haute teneur en protéines).
On peut aussi diversifier en s'assurant un revenu d'autres
sources, comme occuper un emploi extérieur, notamment dans le cas des
plus petites exploitations. Lorsque les maigres recettes d'une exploitation
sont compensées par les recettes élevées d'une autre
exploitation, la diversification est une réussite. Dans les
marchés actuels, la diversification est de plus en plus coûteuse
parce que les besoins d'investissements en capitaux augmentent.
2. 3-Transfert des risques au marché de
l'assurance :
Le principe des systèmes d'assurance consiste à
déléguer la gestion des risques à un tiers, en
l'occurrence à une société d'assurance. Celle-ci met en
commun les primes d'un grand nombre de clients et verse des compensations pour
les pertes réalisées. L'assurance est essentiellement l'un des
moyens de contrôle du risque pur c'est un mécanisme de transfert
contractuel des risques.32
2.3.1-concepts33
2.3.1.1- Aversion au risque et prime
On assume que l'exploitant a une attitude d'aversion au risque
alors que l'assureur est réputé neutre au risque parce qu'il
répartit son risque sur un grand nombre de d'assurés.
L'exploitant est donc prêt à payer plus pour se protéger
d'un certain risque que l'assureur. C'est cette différence qui permet
qu'un marché d'assurance existe. La franchise est la partie des pertes
qui ne sont pas remboursables.
31 Guide de gestion des risques agricoles, OP.CIT
32
www.memoireonline.com/12/07/795/m_analyse-et-gestion-des-risques4.html
33 Gestion des risques-Perspectives pour l'agriculture
wallonne, OP.CIT
La prime est le prix de la couverture du risque. Au minimum,
la prime est le produit de la probabilité d'un aléa
multipliée par la perte causée par cet aléa plus les frais
de l'assureur.
2.3.1.2- Aléa moral
L'aléa moral est la mesure dans laquelle
l'assuré peut cacher des actions d'autoprotection à l'assureur.
Plus l'aléa moral est élevé, plus l'assuré sera
tenté de modifier son comportement par rapport à une situation
sans assurance et plus le coût de contrôle/vérification sera
élevé. Par exemple, si l'assuré est couvert contre les
risques de ravageurs sur une culture, il pourrait mettre moins de produits
phytosanitaires (autoprotection) que s'il n'était pas couvert.
2.3.1.3- Indépendance des risques
On dit que plus le risque est systémique, plus la
probabilité qu'un grand nombre d'assurés soient atteints en
même temps est élevée (dépendance des risques). Il
s'agit essentiellement d'un problème financier : si une proportion
élevée des assurés réclame leur indemnisation,
l'assureur peut se trouver dans l'incapacité de faire face aux paiements
(en général : se trouver en déficit).
2.3.1.4- Auto-sélection
Si l'assurance se fait sur base volontaire, pour une
méme prime il est plus probable que l'assurance attire une personne
à haut risque plutôt qu'une personne à bas risque. C'est
l'auto-sélection (parfois appelée anti-sélection).
Même si l'assureur connaît ces risques, il faudrait aussi qu'il
soit capable de distinguer les deux types de personnes lorsqu'elles souscrivent
un contrat d'assurance.
2.3.2- Quelques contrats d'assurances en agriculture 2.3.2.1-
Assurance récolte - assurance rendement
L'assurance récolte est la plus courante en agriculture ;
les modalités d'application sont multiples. On peut distinguer :
- Les assurances contre un seul risque (grêle), les
assurances multirisques (tous les aléas climatiques) et les assurances
tous risques (rendement en général).
- Les assurances par produit (ou par culture) des assurances
sur l'exploitation entière (les pertes enregistrées sur une
activité pouvant être compensées par les gains
enregistrés pour une autre activité).
- La quantité couverte (une seule parcelle ou une culture
entière). - Le niveau de franchise...
Le principe de ces assurances est généralement
que suite à un déclencheur observable par un tiers (aléa),
les pertes sur la récolte (donc futures au moment de l'aléa) sont
évaluées par l'assureur. L'exploitant est indemnisé
à un certain prix contractuel, soit la moyenne obtenue
antérieurement, soit un prix accordé (fixé par l'une des
deux parties), soit une référence (liée par exemple
à des marchés).
2.3.2.2- Assurance prix
Le risque prix va probablement augmenter dans les
années à venir suite à l'ouverture des frontières
et l'abandon de l'intervention. Etant donné que le risque rendement
n'augmente pas, les politiques publiques en matière de gestion des
risques devraient se concentrer en priorité sur le risque prix. Il est
possible de montrer que dans l'exemple de la pomme de terre, production non
régulée, la variabilité du prix est le principal facteur
explicatif de la variabilité de la recette.
2.3.2.3- Assurance revenu
Etant donnée la corrélation négative
entre prix et rendements, il semble peu utile d'assurer l'un ou l'autre alors
que l'objectif final est la stabilisation des revenus. Néanmoins, on a
vu que les assurances étaient peu adaptées à la gestion du
risque prix. Ceci va se répercuter sur l'assurance revenu et va sans
doute être amplifié par la difficulté de
vérification du sinistre en rendement.
2.3.2.4- Fonds de mutualisation
Le principe d'un fonds volontaire de mutualisation est que des
agriculteurs se regroupent afin de s'assurer entre eux, c'est-à-dire
l'ensemble du groupe indemnise (intégralement ou à concurrence
d'un certain montant) un de ses membres lorsque celui-ci subit un aléa.
Il peut y avoir un grand nombre de fonds de mutualisation afin de couvrir
l'ensemble de la population d'agriculteurs.
Un fonds institutionnel peut être vu comme un
système d'assurance obligatoire dont la gestion est à charge des
pouvoirs publics.
DEUXIEME PARTIE :
ETUDE EMPIRIQUE
|
Premier Chapitre :
La méthodologie de recherche
I. La problématique
L'entreprise agricole comme entité économique
évolue dans un environnement caractérisé par une multitude
de risques. Le développement agricole dans la région Sous Massa
Draa rencontre plusieurs contraintes parmi les principales :
? Climat semi-aride, marqué par des fluctuations
importantes, des sécheresses récurrentes et
l'irrégularité inter-annuelle et saisonnière des
précipitations.
· Structures foncières
caractérisées par la prédominance des
micro-propriétés, par l'exiguïté des exploitations,
la pluralité de leurs statuts juridiques et la précarité
de leurs modes de faire-valoir.
? Capacités financières limitées notamment
chez les petits et moyens agriculteurs.
· Main d'oeuvre qualifiée insuffisante suite
à l'introduction des techniques de pointe et l'exode rural
croissant...
· Problème de commercialisation lié à
la faible organisation des marchés intérieurs et à la
forte concurrence au niveau des marchés extérieurs.
· Faible technicité au niveau des exploitations
agricoles en termes d'encadrement et de gestion.
La présente étude vise la contribution à
l'analyse de la gestion des risques les plus pesants sur l'activité des
entreprises agricoles dans la région Souss Massa Draa.
II. Objectifs de l'enquête
Afin d'avoir une idée complète sur la gestion des
risques dans le secteur agricole, nous avons élaboré notre
questionnaire de sorte à répondre aux objectifs suivants :
· Identifier la forme juridique et type d'activités
de l'entreprise.
· Connaitre l'existante ou non de la fonction de la gestion
des risques au sein des entreprises agricoles.
· Déterminer les environnements constituant des
handicapes pour l'évolution de l'entreprise agricole.
· Déterminer les risques les plus pesants sur
l'activité agricole.
· Connaitre les modes de gestion des risques.
III. l'enquête et l'élaboration du
questionnaire :
1. La rédaction du questionnaire : (voir annexe
I)
Lors de la rédaction de notre questionnaire nous
étions amenés à respecter certaines règles, afin
qu'on puisse le plus possible faciliter les réponses aux
interviewés :
> Le style de rédaction: Nous avons essayé
d'adapter un style clair et précis pour éviter toute
ambiguïté dans l'esprit des interviewés et pour être
accessible à leurs différents niveaux intellectuels.
> Par ailleurs, nos questions étaient
rédigées de façon objective afin de ne pas pousser
l'interviewé à répondre dans un sens qu'on sollicite.
> L'ordre des questions: Nous avons adopté un ordre
qui puisse faciliter les réponses ainsi que le traitement des
résultats :
· Le profit des entreprises ciblées.
· La détection des risques.
2. 4'fQThêtf :
2.1 Phase de pré-enquête
La première étape était consacrée
à la collecte des données concernant les adresses, les
sièges et les catégories des exploitations ou entreprises
agricoles situées dans la région de sous massa Deraa .Ces
données était disponibles au sein des organisations et
autorités responsables (ORMVA, Chambre d'agriculture, AMEFEL, APEFEL,
complexe Horticole d'Ait Melloul).
La deuxième étape est la constitution de
l'échantillon : En théorie, les seules méthodes valables
d'échantillonnage sont celles qui se basent sur un tirage au sort
donnant à chaque individu de la population étudiée une
chance égale (ou du moins une chance connue de faire partie de
l'échantillon).
Concernant notre étude terrain, la méthode
adoptée pour définir la taille de notre échantillon a
été l'échantillonnage aléatoire, car par cause de
diversité des sujets étant concernés par l'étude,
nous avons jugés utile de se tenir à un échantillon
restreint de taille N=25 entreprises agricoles choisis aléatoirement
lors de la préparation du questionnaire.
2.2 Phase de l'enquête
Après avoir reçu l'autorisation
d'enquête34 (voir annexe) auprès de la direction de la
faculté des sciences juridiques économiques et sociales d'Agadir.
Les enquêtes ont étéeffectuées entre le
10 juin 2009 et le 04 juillet 2009 auprès des déférentes
entreprises agricoles. Les lieux principaux où s'est
déroulée l'enquête sont :
1. Zone industrielle ait Melloul 2.Taraudante
3. commune rural Belfaa 4. Biougra ait baha
Nous avons choisi le mode d'administration face à face
Afin qu'on puisse assister plus facilement les interviewés dans leur
réponse aux différentes questions posées.
IV. Traitement des données.
L'analyse a été réalisé par un
traitement des donnés basé sur la statistique descriptive qui
nous a permet de faire ressortir les tendances générales et
l'importance relative des phénomènes observés.
1. Outil informatiques
utilisé
Sphinx : Sphinx est un logiciel
d'enquête et d'analyse des données. Il permet de nous assister
dans chacune des quatre grandes étapes de réalisation d'une
enquête (hors phase de collecte) :
v' la réalisation du questionnaire v' la saisie des
réponses
v' les traitements quantitatifs des données et l'analyse
des données qualitatives
v' la rédaction du rapport d'étude
2. Réalisation de
l'application
Dans notre cas, la mise en oeuvre d'une méthodologie
n'est pas nécessaire pour la réalisation de cette application.
Les étapes de création de cette dernière sont
présentées cidessous :
34 Cette autorisation avait pour l'objectif de
rassurer les enquêtes afin de rependre au questionnaire avec
sincérité
+ Collecte des données : Les informations
relatives aux entreprises agricoles de Souss Massa ont été
recueillies à travers des enquêtes réalisées au
niveau des zones concernées.
+ Saisie des données : la tâche de
saisie consiste à enregistrer le plus rapidement possible les
réponses aux questionnaires. La saisie en mode rapide est
proposée dans Sphinx, dans le stade de la Saisie des réponses, en
sélectionnant l'article Saisie rapide du menu Saisir ou en cliquant le
bouton Saisie rapide de l'écran central.
+ Traitement et analyse des données : Cette
phase consiste à constater la signification des résultats obtenus
et à en dégager des analyses et des interprétations. Elle
commence par le dépouillement à plat des variables fermées
et le traitement des questions ouvertes, considérées
indépendamment les unes des autres, avec possibilité de
compléter ces résultats par une analyse faisant intervenir des
calculs et des tests statistiques, et présentée de la
manière graphique la plus adaptée.
+ Présentation des résultats et du rapport
d'étude : Cette phase concerne la présentation et la
rédaction d'un rapport d'étude indiquant les principaux
résultats et ayant pour objectif d'aboutir sur des recommandations, des
décisions et des actions. Ainsi, vous pourrez présenter de
façon synthétique les résultats extraits du Sphinx dans le
rapport d'étude. En outre, diverses options de présentation des
résultats dans les tableaux (encadrement des résultats
significatifs, affichage des rectangles d'intensité...) sont disponibles
pour améliorer la visualisation. Enfin, ces outils sont
complétés par des fonctions destinées à faciliter
la communication des résultats du Sphinx avec d'autres logiciels.
Deuxième Chapitre :
L'analyse des résultats
I. présentation et analyse des résultats
:
Les données recueillis auprès des entreprises
constituant l'échantillon ont été traitées à
l'aide du logiciel d'analyse SPHINX, les résultats sont
présentés sous forme d'un tri à plat qui consiste à
donner les résultats de l'analyse pour chaque question ou variable
à part, en présentant les pourcentages correspondant à
chaque modalité. Pour plus de précision dans l'analyse un tableau
croisé a été également utilisé.
1. Effectif du personnel :

Tableau 2: l'effectif du personnel dans les entreprises
I

T
Graphe 1: L'effectif du personnel dans les entreprises
Selon les données ci-dessus, la moitie des exploitations
agricoles emploient plus
3 3
de 50 personnes, ce qui engendre chez le secteur agricole, une
augmentation au niveau des
1
risques liée à l'environnement social comme :
accident de travail, des conflits social et 10 besoin de main
d'oeuvre.
Entre -0 Entre
2. La forme juridique :
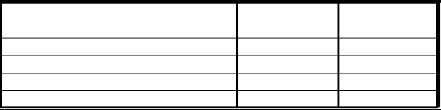
|
J U RI IDICILJE
|
Nib_ cit_
|
Fréci _
|
|
E ntreprise individual
|
5
|
20, 0 a/c)
|
|
E ntreprise scpci atai re RMEFORME
|
1 1
|
44,0°A)
|
|
Cooperate N.e
|
e
|
30,0°A) q
|
|
JURIDIQ CIE% S _
|
25
|
1 00°A,
|
Tableau 3: Répartition en proporti on des entrepri se
sui vant la forme i uridique

Graphe 2: classification des entreprises suivant la forme i
uridique
Il apparaît que le nombre des entreprises individuel au
secteur agricole est faible (20%) au profit des entreprises sociétaire
et coopératives qui présentent 44% et 36% successivement .Les
entreprises sociétaires profitent d'un avantage réglementaire
contre les risques financières et économiques. Les
coopératives elles ont améliorés leur position grâce
à l'Initiative National pour le Développement Humain et l'Office
de Développement Coopératives.
3. Type d'activité :
Tableau 4: les proportions des types d'activités
visés par l'enquête

Graphe 3: type d'activité des entreprises
On observe que les entreprises spécialises dans la
production végétales sont dominantes dans la région
occupant 88%, alors que les entreprises spécialisé dans la
production animale occupent 16%.
4. Les entreprises ayant la fonction de gestion des risques
:
Production vég
|
n
|
|
go
|
s
|
qu
|
éq
|
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
OBS.
|
|
|
|
|
00%
|
|
Tableau 5: le nombre des entreprises visées ayant la
fonction de gestion des risques

Graphe 4: la fonction de la gestion des risques dans les
entreprises
Le tableau montre que 72% des entreprises ont une fonction de
gestion des risques au sein de leur organisation, et 28% des entreprises ne
tiennent pas compte de la fonction gestion des risques. Cela a une relation
directe à la taille de l'organisation.
5. le responsable de la gestion des risques :
|
Le r Fnction de gestion des risq
|
Nip. cit.
|
Freq.
|
|
Direction gé nérale
|
14
|
56,0%
|
|
CA recteur fi n ancier
bl
|
|
4F16,0%
|
|
Gestionnai re de risque
|
3
|
12,0%
|
|
ction g
|
5
|
%
|
|
cteur fi anci _
|
1
|
%
|
Tableau 6: montre le responsable de la gestion des risques
dans les entreprises risque 3 12,0%

Graphe 5: la responsabilité de la gestion des risques
dans les entreprises
Une classification montre que 12% des exploitations seulement
ont un gestionnaire de risques. Pour 16% le directeur financier est le
responsable de cette gestion. Alors que pour la moitie des exploitations la
gestion des risques est fonction de la direction générale.
6. Classification des environnements constituants des
handicaps pour les entreprises agricoles par odre de gravite :
Le res ponsabe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60
|
|
|
|
|
|
10%
|
|
|
|
|
|
120% Nb
|
é
|
N
|
é
|
Nb
|
0%
F
|
N
|
é
|
|
|
|
|
|
q
Tableau 7: Classification des environnements constituants des
handicaps pour les entreprises agricoles par
r q . q. q . q
( 1) ( 2) ( 3) ( 4)
(n 5) (o
ENT
ordre de gravite Directio

Graphe 6: Les environnements des entreprises agricoles
Le tableau précédant, indique pour chaque rang
de gravite (de1 à 5) les environnements qui sont les plus
redoutées par les entreprises. Pour le 1er rang de gravite :
92% des entreprises déclarent que c est l'environnement
économique et l'environnement naturel. Dans le deuxième rang :
l'environnement naturel et social fait la crainte de 52% d entreprises .Au
troisième rang : 72%entreprise doutent trois environnement :
technique,
2
Environnement économique
politico-juridique et social. Au quatrième rang :
l'environnement social et politico-
Envinneme olijuq ( ttionel)
juridique d'un pourcentage 64% des entrepriss. En fin, 72% des
entreprises trouvent
Environnemet natre
l'environnement technique et politico-juridique comme handicap de
cinquième rang.
7. Type des risques
|
Types des risques
|
Nb. cit.
|
Freq.
|
|
Risques sanitaires (maladies an imales ou
xégétales ou infestations parasitaire
|
14
|
56,0%
|
|
%1-MR.Q13:9-11PCIL8211FHXYB-1
|
7
|
28,0%
|
|
Accident de travail
|
6
|
24,0%
|
|
Risque client
|
15
|
60,0%
|
|
Risque foumisseur
|
4
|
16,0%
|
|
Risque de commerce international
|
16
|
64,0%
|
|
Actions de groupes de pression (Conflit social ,Greve
)
|
9
|
36,0%
|
|
Procedures judiciaire
|
5
|
20,0%
|
|
Sécheresse et pénuri es d'eau
|
21
|
84,0%
|
|
les sinistres grazes (incendies, tempetes,
inondations)
|
5
|
20,0%
|
|
Risque financier (de I iquidité,de change et de
taux)
|
14
|
56,0%
|
|
Autre
|
0
|
0,0%
|
|
TOTAL OBS.
|
25
|
|
Tableau 8: types des risques touchent le secteur agricole

mer
ries
e
ta
e
in-doe
s animales ou végétales ou inf
15 600%
9 36,0%
5 20,0%
Graphe 7: types des risques touchent le secteur
agricole
0 00%
ression (Confit social Grève )
Les exploitations agricoles sujettes de l'enqu~te rencontrent
plusieurs contraintes
Procédurs judciaire
et risques qui mettent en menace la survie et le bon
fonctionnement de celles-ci. En se
l it idi ê di)
basent sur les résultats de l'enqu~te, le tableau et la
figure présenté ci-dessus montrent que
Risque financir (de liquiditéde cange et de taux
la sécheresse et pénuries d'eau sont les risques
les plus dominants 18,1% c'est un risque
utre
34%
catastrophique signalé par 84% des entreprise.
Après viennent les risques de commerce
138%
international 13,8%, risque client 12,9%, risques sanitaires
12,1% et risques financières
12,1% ce sont des risques forts ou majeurs, signalés
respectivement par 64%,60%,56% ,et
56% des entreprises. Enfin, dans la
dernière classe il y a le risque fournisseur 3,4%
nommérisque faible.
8. Mode de gestion des risques
Tableau 9: la mode de gestion des risques utiliser par les
entreprises
9 36,0%

DE S RIS QU
Graphe 8: la mode de gestion des risques utiliser par les
entreprises
On remarque que les modes de gestion des risques suivis par
les entreprises agricoles sont repartis à peu prés
également entres les trois méthodes, 36% des entreprises font la
prise en charge de tous les risques (les coopératives) ,32%des
entreprises prennent en charge d'une partie des risques et transfert de l'autre
partie (entreprises sociatries) et 32 % des entreprises qui restent adoptent
une souscription d'assurance (entreprises individuel).
9. 1171ySH117des117rIMes117sIDn
117lI117tISe117WJHBité
|
TYPES D'ACEVITES
Types des risques
|
Production
végétale
|
Production
animale
|
XITAL
|
|
Risques sanitaires (maladies animales ou végétales
ou infestations parasitai re;
|
11,4% (12)
|
16,7% ( 3)
|
12,2% (15)
|
|
°A1-1v1;0111-111P 0C11111-DMI
|
6,7% ( 7)
|
0,0% ( 0)
|
5,7% (7)
|
|
Accident de travail
|
5,7% ( 6)
|
5,6% ( 1)
|
5,7% (7)
|
|
Risque client
|
12,4% (13)
|
16,7% ( 3)
|
13,0% (16)
|
|
Risque fournisseur
|
1,9% ( 2)
|
16,7% ( 3)
|
4,1% (5)
|
|
Risque de commerce international
|
15,2% (16)
|
0,0% ( 0)
|
13,0% (16)
|
|
Actions de groupes de passion (Conflit social ,Greve)
|
8,6% ( 9)
|
0,0% ( 0)
|
7,3% (9)
|
|
Procedures judiciaire
|
3,8% ( 4)
|
11,1% (2)
|
4,9% (6)
|
|
Secheasse et pénuries d'eau
|
17,1% (18)
|
22,2% (4)
|
17,9% (22)
|
|
les sinistres graves (incendies, temp8tes, inondations)
|
4,8%( 5)
|
0,0%( 0)
|
4,1% (5)
|
|
Risque financier (de liquidité,de change et de tau
|
12,4% (13)
|
11,1% (2)
|
12,2% (15)
|
|
Autre
|
0,0% ( 0)
|
0,0% ( 0)
|
0,0% ( 0)
|
|
TOTAL
|
100% (105)
|
100% (18)
|
100% (123)
|
Tableau 10: la répartition des risques selon le type
d'activité

madies anmales 1
Typ
ernational
resonles (Conft soca ,Grèe )
l

, ( ), ( ) , ( )
Graphe 9: la répartition des risques selon le type
d'activité
Selon les statistiques faites on remarque que les risque sont
concentrés surtout
énuries deau
pour la production végétale .Aussi on remarque
des risques qui sont spécifiques pour
chaque' une des deux
activités : risque fournisseur pour la production animale et risque
de
sinistres graves et commerce international pour la production
végétale .Les risques les plus
redoutés pour les deux activités sont les risques
catastrophiques : sécheresse et pénurie d'eau.
II. Synthèse
Suite a cette enquête, et après examination de la
façon dont agissent les sociétés face a ces risques on
peut déduire encore plusieurs contraintes que courent les entreprises
dans la région au sujet de cette gestion.
D'abord, l'absence d'une branche spécifiée dans
la gestion des risques au sein des sociétés (juste 12% ont des
gestionnaires de risques). Ensuite le type d'organisation
(société individuelles et coopératives) ne permet pas
d'avoir une réglementation précise et orientées contre les
risques. La troisième contrainte c'est que plus de deux tiers des
sociétés n'ont pas une politique précise de prise en
charge des risques ni des assurances.
On peut déduire aussi les types des risques
fréquentés et leurs degrés de gravité. Comme ca on
trouve au premier lieu les risques catastrophiques (problème de
sécheresse et d'eau) ensuite les risques forts ou majeurs (climat,
sanitaire, financier, commerce extérieur...) et le risque fournisseur
qui est un risque faible. La plupart des risques affectent le secteur
végétal car il est plus dépendant de l'environnement
économique et naturel. Il faut citer aussi que suite à l'effectif
très grand au sein des sociétés agricoles le risque de
type humain s'impose (accident de travail, conflits...).
On somme on peut dire que les entreprises agricoles de la
région n'ont pas l'idée complet sur l'utilité de la
fonction de gestion des risques. Elles limitent les risques à
gérer sur les risques sanitaires, elles n'inscrivent pas d'assurance sur
les risques climatiques et elles n'adoptent pas un processus de gestion des
risques déterminé.
Pour faire face à ces contraintes, trois idées
suivantes doivent être communiqué :
· La gestion des risques est une nécessité
à la fois pour les acteurs économiques et pour la
collectivité. En l'absence d'instruments adaptés
à cet effet, les entreprises perdent en compétitivité et
le bien-être des consommateurs diminue.
· Aucun instrument de gestion des risques ne peut
répondre, seul, à la variété des
situations. Une combinaison d'outils est nécessaire en
fonction de la nature et de l'ampleur des risques.
· Les pouvoirs publics ont un rôle important
à jouer dans la gestion des risques.
Conclusion
Cette étude mémoire de licence sur la
problématique de la gestion des risques dans le secteur agricole
s'inscrit dans le contexte interdisciplinaire des sciences de gestion. Prenant
acte du rôle de la fonction gestion des risques dans l'atteinte des
objectifs de sécurités et de qualités liées au
développement organisationnels, ce mémoire vise plus
spécifiquement à déterminer si les risques dans
l'agriculture sont bien maîtrisés, d'abord par l'adoption d'un
processus de gestion des risques mais également par l'emploi des
méthodes de couvertures. Cette question a été
étudies par le biais du cas particulier des activités agricoles
à la région ; et des risques potentiels - environnementaux,
sanitaires et socio-économiques --qui y sont associé.
La première étape dans notre démarche
consistait en l'étude d'une méthodologie
de la gestion des risques. D'abord nous avons parlés de
la gestion des risques en général oüon a
donné une définition du risque et l'historique de celui-ci, aussi
on a élaboré une
classification des risques selon deux
critères, le premier suivant la fréquence et la gravite
du
risques (faible, moyen, élève), le deuxième suivant
l'activité de l'entreprise
(stratégique, opérationnel,
financier et de réputation). Puis on a énuméré les
objectifs
principales de la gestion des risques ( la sécurité
et la qualité).Ensuite nous avons parlé de
la gestion des
risques agricoles en particulier à travers trois section ,la premier
évoque les
différents environnements de l'exploitation
(économique ,géographique ,financier),la
deuxième
rappel la typologie des risques agricoles existants (économiques et
commerciaux
, financiers, naturels de production , institutionnels , humains
et professionnels), la dernière
définit un processus de
gestion des risques dont les principaux éléments sont : l'analyse
, le
traitement et le suivie des risques ;ont a aussi cité les
méthodes de couverture des risques
les plus adoptées qui sont
: les provisions comptables , la diversification des exploitations
et la
souscription à l'assurance.
La deuxième étape dans notre démarche
consistait en l'étude des risques potentiels avérés lies
aux activités agricoles à la région Souss Massa Draa .A
l'aide de rapports et d'articles scientifiques, nous avons pu identifier les
principaux risques agricoles et documenter l'état des entreprises et
méthodes de couverture disponibles .Les risques identifiés sont
fruit surtout d'impacts climatiques (liés à la sécheresse
et pénuries d'eau), impacts sanitaires(liés aux maladies animales
et végétales ou infestations parasitaires) , et impacts d'ordre
économique (liés à la clientèle et à la
commerce international).Nous avons
pu constater qu'il existe très peu d'études
concernant les méthodes de traitement des risques agricoles ,notamment
en matière de risques climatiques. Nous avons également
noté que la majorité des entreprises ne disposent pas d'une
fonction de gestion des risques bien définie et claire, et petitesse des
organismes et associations qui s'intéressent à la gestion des
risques dans l'agriculture en tant que étude, ils la déclarent
comme problématique instantanée qui apparaît avec
apparition du risque et annule en l absence de celui-ci.
Enfin, il faut parler de contraintes qui s'opposent à
l'existence d'une gestion claire au secteur agricole. C'est dut aux risques qui
sont multiples et difficiles à classifier, et qui sont surtout de type
variable et évolutif. Aussi le secteur d'assurance se voit encore
alarmé de s'aventurer dans le secteur surtout que les risques sont la
plupart de type catastrophiques. Pour une naissance et existence d'une gestion
de risque, il faut que les pouvoirs publics déploient tous leurs
potentiels pour développer des politiques agricoles
appropriées.
Les références bibliographiques
· M.Mouhssine Adnane, contribution a l'évaluation
des impacts du système d'assurance du risque sécheresse au Maroc,
mémoire de 3émé cycle pour l'obtention de grade
d'ingénieur d'état en agronomie, 23 juillet 2004
· O. Harmignie, B. H. de Frahan, P. Polomé, F.
Gaspart ; Gestion des risquesPerspectives pour l'agriculture wallonne ;
Louvain-la-Neuve, décembre 2004
· Robert G. Aumell, P.Ag., CAC, Aumell Agri-Consulting,
Guide de gestion des risques agricole, CCGEA 2005
· Afnor. « Gestion du risque - Norme FD X50-117
». Afnor, 2003.
· John l.Dillon et J.Brian Hardaker, Recherche en Gestion
pour le développement de la petite exploitation, Rome, 1996
· Clusif comment gérer les risques dans
l'entreprise, BORDAS, Pris 1989
· Petit robert
· ISO/CEI 73, « Gestion du risque --
Vocabulaire -- Principes directeurs pour l'utilisation dans les normes »,
2001
· ISO/CEI TR 15504-5, « Technologie de l'information
-- Évaluation de processus de logiciel -- Un modèle
d'évaluation et guide des indicateurs », 1998
· DGA/AQ 924, « Manuel du management des risques dans
un programme d'armement », 1995
· BS 6079-3:2000, « Project Management: Guide to the
management of business related project risk », 2000
· FD X 50-117, « Management des risques d'un projet
», à paraître
· Directive n° 96/82 du Conseil de l'Europe du 9
décembre 1996
· Flash Agri ; Numéro 104 -- 9 novembre 2007; pp
2-7
· Flash Agri ; Numéro 136 -- 23 juin 2009; pp 6
· Pack info, N° 73, nov/déc 2008, pp : 45-60
· Assises ADELI, n°10,4 décembre 2002, P6
· Wafabank, N°63, janvier 2002, P8
· Le processus de management des risques, n°10,4
décembre 2002, P6
· Note d'études économiques, n°30, mars
2008, pp. 33-71
· Revue H.T.E. N° 126 -- juin 2003
·
http://www.madrpm.gov.ma/systemeinformation.htm
·
www.memoireonline.com/12/07/795/m_analyse-et-gestion-des-risques4.html
·
www.fr.wikipédia.org/w/index.php?title=risques_op.
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : la division de terres à vocation
agricole 22
Tableau 2: l'effectif du personnel dans les entreprises
53
Tableau 3: Répartition en proportion des
entreprise suivant la forme juridique 54
Tableau 4: les proportions des types d'activités
visés par l'enquête 55
Tableau 5: le nombre des entreprises visées ayant
la fonction de gestion de risque 55
Tableau 6: montre le responsable de la gestion des
risques dans les entreprises 56
Tableau 7: Classification des environnements constituants
des handicaps pour les
Entreprises agricoles par ordre de gravite 57
Tableau 8: types des risques touchent le secteur agricole
59
Tableau 9: la mode de gestion des risques utiliser par
les entreprises 60
Tableau 10: la répartition des risques selon le
type d'activité 61
LISTES DES FIGURES ET GRAPHES
Figure 1 : La fonction de la gravité risque par
rapport à la fréquence 13
Figure 2: Schéma Processus de gestion des risques
; Source : ICSSEA 2002 Assises
ADELI n°10 Chauveau 32
Figure 3: Traitement des risques ; Source :
http://www.hesge.ch/heg
37
Graphe 1: L'effectif du personnel dans les entreprises
53
Graphe 2: Classification des entreprises suivant la forme
juridique 54
Graphe 3: Type d'activité des entreprises
55
Graphe 4: La fonction de la gestion des risques dans les
entreprises 56
Graphe 5: La responsabilité de la gestion des
risques dans les entreprises 57
Graphe 6: Les environnements des entreprises agricole
58
Graphe 7: Types des risques touchent le secteur agricole
59
Graphe 8: la mode de gestion des risques utiliser par les
entreprises 60
Graphe 9: la répartition des risques selon le type
d'activité 61
ANNEXES
Table des matières
Dédicaces 2
Remerciements - 3
Sommaire 4
Introduction générale - 6
Première partie
La méthodologie de la gestion des
risques
Chapitre 1 : La gestion des risques 10
I. La notion de risques 11
1. Historique du risque 11
2. Définition de risque 11
II. Classification des risques 12
1. Suivant la fréquence et niveau de gravité
12
1.1. Risques de fréquence et de gravité faibles
13
1.2. Risques de fréquence faible et de gravité
élevée 13
1.3. Risque de fréquence élevée et de
gravité faible 14
1.4. Risques de fréquence et de gravité
élevée- 14
2. Suivant l'activité de l'entreprise 14
2.1. Les risques stratégiques: 14
2.2. Les risques financiers: 15
2.3- Les risques opérationnels : 16
2.4 Les risques de réputation : 17
III. Objectifs de la gestion des risques 18
1. La sécurité 18
2. La qualité 18
Chapitre 2 : La gestion des risques dans l'exploitation
agricole 20
I. L'environnement de l'exploitation agricole 21
1. La sphère économique- 21
2. La sphère géographique 21
3. La sphère financière 22
II. Typologie des risques dans le secteur agricole 25
1. Les risques économiques et commerciaux 27
1.1. Le niveau de spécialisation de l'agriculture 27
1.2. Le risque de rendement (quantité) et le risque de
qualité 27
1.3. La variation des prix 27
1.4. Logistique et Assurances 28
2. Les risques financiers 28
2.1 L'évolution du taux de solvabilité 28
2.2 Les investissements en présence de risque 29
3. Les risques naturels de production 29
4. Les risques institutionnels 30
5. Les risques humains et professionnels 30
III. Le risque : processus de gestion et méthodes de
couverture 31
1. Processus de gestion des risques agricoles 31
1.1 Définition de la stratégie : 32
1.2 Analyse des risques : 33
1.3 -Traitement des risques : 36
1.4 Suivi des risques 37
1.5 Capitalisation 38
2. Méthode de couverture contre les risques agricoles
39
2.1. Les provisions comptables 40
2.2. Diversification de l'exploitation 42
2.3. Transfert des risques au marché de l'assurance :
42
Deuxième partie :
Etude empirique
Chapitre 1 : Méthodologie de recherche
47
I. La problématique 48
II. Objectifs de l'enquête 48
III. L'enquête et l'élaboration du questionnaire
49
1. La rédaction du questionnaire 49
2. L'enquête 49
2.1. Phase de pré-enquête 49
2.2. Phase de l'enquête 50
IV. Traitement des données 50
1. Outil informatiques utilisé 50
2. Réalisation de l'application 50
Chapitre 2 : L'analyse des résultats
52
I. Présentation et analyse des résultats 53
1. Effectif du personnel 53
2. La forme juridique 54
3. Type d'activité 55
4. Les entreprises ayant la fonction de gestion des risques
55
5. Le responsable de la gestion des risques 56
6. Les environnements handicaps pour les entreprises agricoles
57
7. Type des risques 59
8. Mode de gestion des risques 60
9. Types des risques selon le type d'activité 61
II. Synthèse 62
Conclusion 63
Les références bibliographiques
65
Liste des tableaux 67
Listes des figures et graphes 68
Les annexes 69
Table des matières 70
| 


