

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work -
Fatherland
Paix - Travail - Patrie
*****************
****************
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
************
****************
UNIVERSITE DE DOUALA
THE UNIVERSITY OF DOUALA
***********
*******************

FACULTE DES SCIENCES
JURIDIQUES ET
POLITIQUES
FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
**************
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du Diplôme de Master II en
Science Politique
Option : Sociologie Politique
Jean-Pierre Loïc NKULU ATANGANA
Titulaire d'une Maîtrise ès Science
Politique
Supervision de :
Janvier ONANA
Agrégé de Science Politique
Professeur
Titulaire
Sous la Direction de :
Serge Paulin AKONO EVANG
Docteur en Science Politique
Chargé de cours
Jury :
- Président : Monsieur Janvier ONANA
- Rapporteur : Monsieur Nicolas Junior YEBEGA NDJANA
- Membre : Monsieur Serge Paulin AKONO EVANG

PRESIDENTIELLES AU CAMEROUN DE 1992 A 2011
LE MONITORING DES ELECTIONS

Année académique 2012/2013
ii
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
AVERTISSEMENT
L'Université de Douala n'entend donner ni approbation,
ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci
doivent être considérées comme propres à leur
auteur.
iii
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
DEDICACE
A Mes parents, Nsoé Atangana Janvier et
Mbia Mekongo Colette, le premier que ma reconnaissance
éternelle l'accompagne dans le royaume des morts et le second pour tous
les efforts consentis pour l'aboutissement de ce travail.
A Halimatou Youssoufa, pour sa patience.
A toute la famille Nsoé, en particulier
à Adotevi Adoko Dominique Thérèse Ange
épouse Mbarga Nsoé pour son soutien et
son accompagnement vers les chemins de la connaissance et pour tout ce qu'elle
a pu m'apporter.
iv
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
REMERCIEMENT
Je remercie profondément le Pr. Janvier Onana d'avoir
accepté superviser ce travail et le Dr. Serge Paulin Akono Evang,
d'avoir accepté de le diriger. Leurs contributions et réflexions
ainsi que chacune de leurs critiques et remarques ont été d'un
apport incalculable dans la conception ainsi que dans la réalisation de
ce modeste travail.
Je dois beaucoup aux conseils et échanges avec des
camarades de promotion notamment mon ami Joël Rodrigue Soli, Christelle
Tchinda Manka'a, ma délégué de promotion, Benogo Andela
Brice Cyriaque et aussi aux aînés académiques Luc Bekono
Nyimi, Fabilou, Steve Etogo, Max Zache Sinclaire Onambele, Martin Ibock Mbog,
Emerant Yves Omgba Akoudou de l'UCAC, Atangana Emmanuel Alain de
l'Université de Yaoundé 2, une pensée pieuse pour notre
camarade et ami décédé Jérôme Njegweha pour
le repos de son âme.
J'exprime ma profonde gratitude aux Dr. Jean Claude Atangana,
Jean Roger Abessolo Nguema, Hilaire Kamga, Patrick Toumba Haman pour leurs
précieux conseils.
M. et Mme Bukwalaké Alapa Philip, qui m'ont accueilli
durant ma formation, trouvez ici l'expression de ma reconnaissance.
M. Nsoé Atangana Henri Martin pour avoir permis que ce
rêve devienne réalité.
Les cadres de la Division des Affaires Juridiques et du
Contentieux du Ministère de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation, du Ministère des Relations Extérieures,
d'Elections Cameroon en particulier de la Cellule de Communication ainsi que
les responsables d'associations, d'ONG locales et internationales, du Service
National Justice et Paix.
Mme Viviane Toukombe, Responsable de l'Unité
Socio-Juridique de la Commission Diocésaine Justice et Paix de
Yaoundé, d'organismes internationales tels que l'Organisation
Internationale de la Francophonie, le Commonwealth soient sincèrement
remerciés d'avoir répondu à mes préoccupations de
recherche.
A tous mes frères et soeurs.
A mes enfants.
V
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
SOMMAIRE
AVERTISSEMENT I
DEDICACE III
REMERCIEMENT IV
INTRODUCTION GENERALE : 1
PENSER LE MONITORING COMME UN PHENOMENE POLITIQUE 1
PREMIERE PARTIE : 16
LA CONSTRUCTION SOCIOPOLITIQUE DU MONITORING DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 16
CHAPITRE I : REGLES ET ENJEUX DU
MONITORING DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 17
SECTION I : LE MONITORING DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES : UNE
PRATIQUE ENCADREE PAR DES REGLES NORMATIVES ET PRAGMATIQUES
17
SECTION 2 : LE MONITORING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES : UNE
PRATIQUE STRUCTUREE PAR DES ENJEUX MULTIPLES 25
CHAPITRE II
: LES RESSOURCES ET LOGIQUES DU MONITORING DES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU CAMEROUN 31
SECTION 1 : LES
TYPES RESSOURCES ET LES INSUFFISANCES DES ACTEURS
DU MONITORING DES ELECTIONS 31
SECTION 2 : LES LOGIQUES
CONTRASTEES DU MONITORING DES ELECTIONS
: LA DYNAMIQUE DE MISE EN OEUVRE DU MONITORING DES ELECTIONS
36
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 50
DEUXIEME PARTIE : 51
USAGES ET EFFETS DE REALITE DU MONITORING DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES AU CAMEROUN 51
CHAPITRE 3 : LES USAGES
PLURIVOQUES DU MONITORING DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 52
SECTION 1 : LES USAGES INTERNES DU
MONITORING DES ELECTIONS : CAS
DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 1992 52
SECTION 2 : LES
USAGES EXTERNES DU MONITORING DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 61
CHAPITRE 4 : LES EFFETS DE REALITE DU
MONITORING DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 70
SECTION 1 : LES MERITES DES MISSIONS DE
MONITORING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES : ENTRE AMELIORATION DU PROCESSUS
ELECTORAL ET
STABILITE SOCIOPOLITIQUE 70
SECTION 2: LES LIMITES DU
DEPLOIEMENT DES MISSIONS DE MONITORING
DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 80
CONCLUSION GENERALE 89
BIBLIOGRAPHIE 94
vi
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Extrait des lois organisant les
élections présidentielles au Cameroun depuis la loi N°92/10
du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de
suppléance a la présidence de la République
modifiée et complétée par les lois N°97/020 du 09
septembre 1997 et 2011 et loi N°2011/013 du 13 juillet 2011 relative au
vote des citoyens camerounais établis ou résidents à
l'Etranger.
Annexe 2 : Les textes internationaux relatifs
au monitoring des élections
Annexe 3 : Décret N°92/277 du 17
septembre 1992 portant convocation du corps électoral en vue de
l'élection du président de la république,
décret N°97/160 du 12 septembre 1997 portant convocation
du corps électoral en vue de l'élection du président de la
république, décret N°2004/223 du 11
septembre 2004 portant convocation du corps électoral en vue de
l'élection du président de la république,
décret N°2011/277 du 30 août 2011 portant
convocation du corps électoral en vue de l'élection du
président de la république.
Annexe 4 : Décision
N°041/ELECAM/DGE du 15 septembre 2011 fixant l'organisation des bureaux de
vote à l'intérieur du pays et Arrêté
N°001/DIPL/CAB du 24 août 2011 fixant la liste des
représentations diplomatiques et des postes consulaires dans lesquels
sont organisées les opérations électorales relatives
à l'élection du président de la république en
2011et arrêté N°0000094/A/MINATD/DAP du 07 octobre 2011
réglementant l'exercice de certaines libertés et activités
à l'occasion de l'élection présidentielle du 09 octobre
2011 et liste des bureaux de vote pilote destinés aux électeurs
handicapés.
Annexe 5 : Liste des pièces pour la
constitution des dossiers de candidature à l'élection
présidentielle au Cameroun, candidats et résultats aux
élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011 et
liste des partis politiques ayant signé le code de bonne conduite
élaboré en prélude à la présidentielle du 09
octobre 2011. Annexe 6 : Liste des pièces constitutives
du dossier d'accréditation des observateurs et Liste des organismes
nationaux et internationaux ayant déployé des observateurs
électoraux aux élections présidentielles au Cameroun de
1992 à 2011.
Annexe 7 : Outils d'observation et
questionnaires d'enquête.
Annexe 8 : Cycle Electoral, extraits du code
de conduite de l'observateur et quelques images du scrutin présidentiel
du 09 octobre 2011.
vii
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
SIGLES ET ABREVIATIONS
1MA : Un monde avenir
ACCT : Agence de coopération culturelle
et technique ADD : Alliance pour la démocratie et le
développement AFP : Alliance des forces
progressistes
AMEC : Action pour la méritocratie et
l'égalité des chances
APDHAC : Association pour la promotion des
droits de l'homme en Afrique centrale
BIDDH : Bureau des institutions et des droits de
l'homme
CADEG : Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance
CADHP : Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples
CE : Conseil de l'Europe
CE : Conseil électoral
CEEAC : Communauté économique des
états de l'Afrique centrale
CEL : Commissions électorales locales
CEMAC : Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale
CENC : Conférence épiscopale
nationale du Cameroun
CENI : Commission électorale nationale
indépendante
CIRCPRE : Cercle international pour la promotion
de la création
CNC : Congrès national camerounais
CNC : Conseil national de la communication
CNDHL : Comité national des droits de
l'homme et des libertés
CNDHL : Commission nationale des droits de
l'homme et des libertés
CNS : Conférence nationale souveraine
CODESRIA : Conseil pour le développement
de la recherche en sciences en Afrique
CPF : Conseil permanent de la francophonie
Viii
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CPP: Cameroon people's party
CRC: Children's rights Cameroon
DAJC : Division des affaires juridiques et du
contentieux
DEA : Diplôme d'études
approfondies
DGE : Direction générale des
élections
DIPESII : Diplôme de professeur de
l'enseignement secondaire 2ème grade
DUDH : Déclaration universelle des droits
de l'homme
ELECAM : Elections Cameroon
FSJP : Faculté des sciences juridiques et
politiques
FUC : Front uni du Cameroun
GC : Grand Cameroun
GERDDES-Cameroun : Groupe d'études et de
recherches sur la démocratie et le développement
économique et social
IEP : Institut d'études politique
IMET: International military education and
training
IDEA : Institut international pour la
démocratie et l'assistance électorale
IRIC : Institut des relations internationales du
Cameroun
LA DYNAMIQUE
LGDJ : Librairie générale de droit
et de jurisprudence
MANIDEM : Mouvement africain pour la nouvelle
indépendance et la démocratie MEC : Mouvement
des écologistes du Cameroun
MERCI : Mouvement pour l'émergence et le
réveil du citoyen
MINAT : Ministère de l'administration
territoriale
MINATD : Ministère de l'administration
territoriale et de la décentralisation
MINCOM : Ministère de la communication
MINREX : Ministère des relations
extérieures
MOE : Missions d'Observation Electorale
ix
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
MOETI-C : Mission d'observation de
élections de transparency international À Cameroun
MP : Mouvement progressiste
NDI: National democratic institute for
international affairs
OCE : Observateurs chrétiens des
élections
OCT : Observateur court terme
OGE : Organe de gestion des élections
OIF : Organisation internationale de la
francophonie
OIG : Organisation intergouvernementale
OLT : Observateur long terme
ONEL : Observatoire nationale des
élections
ONG : Organisations non gouvernementales
ONU : Organisation des nations unies
OSC : Organisations de la société
civile
OSCE : Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe
OUA : Organisation de l'unité
africaine
PADDEC : Parti patriotique pour le
développement du Cameroun
PAP : People's action party
PIDCP : Pacte international relatif aux droits
civils et politiques
PNUD : Programme des nations unies pour le
développement
PSU : Parti socialiste unifié
PUF : Presses universitaires de France
RAPDDH : Réseau africain pour la
promotion de la démocratie et des droits humains
RDPC : Rassemblement démocratique du
peuple camerounais RECODH : Réseau camerounais des
organisations des droits de l'homme
X
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
RGDIP : Revue générale de droit
international public
RFSP : Revue française de science
politique
SDF : Social democratic front
SEP : Service oecuménique pour la
paix
SIGE : Système d'information et de
gestion cartographique des élections
SLC: Social liberal congress
SNJP : Service national justice et paix
TI-C: Transparency international Cameroun
UA: Union africaine
UCAC : Université catholique d'Afrique
centrale
UDC : Union démocratique du
Cameroun
UE : Union européenne
UFDC : Union des forces démocratiques
du Cameroun
UFP : Union pour la fraternité et la
prospérité
UIP : Union interparlementaire
UNDP : Union national pour la
démocratie et le progrès
UPA : Union des populations africaines
xi
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
RESUME
L'objectif de la recherche est de considérer le
monitoring des élections présidentielles comme étant un
phénomène politique socialement construit.
Phénomène encadré par des normes juridiques et
pragmatiques, structuré par des enjeux multiples, qui connaît des
usages internes et internationaux produisant des effets de
réalité. Le problème central est de savoir comment se
pratique le monitoring des élections présidentielles au Cameroun.
L'hypothèse de départ stipule que le monitoring des
élections présidentielles au Cameroun se pratique de deux
manières, à savoir : l'observation des élections
présidentielles et l'intervention. Le constructivisme et la comparaison
en termes de démarche ont été retenus comme modèle
explicatif. Ces théories l'ont été à partir de la
combinaison des méthodes quantitatives (sondage non aléatoire sur
trois cent acteurs nationaux et dix internationaux du monitoring des
élections présidentielles et élections tout court au
Cameroun) et qualitatives (observation in situ, observation
participante, entretiens semi-directifs). Au terme de notre étude, il
ressort que le monitoring des élections présidentielles est une
articulation à la promotion de la démocratie, de l'Etat de droit
et des Droits de l'Homme au Cameroun.
Mots clé : monitoring des
élections, observation, élections, démocratie, droits de
l'Homme, Etat de droit, légitimité.
ABSTRACT
The objective of the research is to consider the monitoring of
the presidential elections as a socially constructed political phenomenon. This
phenomenon is framed by legal and pragmatic regulations and is structured by
multiple issues, that know internal and international practice, producing
effects of reality. How to practice monitoring of presidential elections in
Cameroon is the central problem. The hypothesis states that monitoring of the
presidential elections in Cameroon is done in two ways namely: observation
presidential elections and intervention. The constructivism and comparison in
terms of action were selected as explanatory model. These theories were from a
combination of quantitative methods (international monitoring of the
presidential elections while short non-random surveyed three hundred and ten
national actors and elections in Cameroon) and qualitative (in situ
observation, participant observation and semi-structured interviews). At
the end of our study, it appears that the monitoring of the presidential
elections is a joint promotion of democracy, rule of law and human rights in
Cameroon.
Key Words: observation, monitoring elections,
democracy, Human Rights, rule of law, legitimacy.
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
INTRODUCTION GENERALE :
PENSER LE MONITORING COMME UN
PHENOMENE POLITIQUE
« La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics : cette volonté doit s'exprimer
par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du
vote »1.
1
1Assemblée Générale des
Nations-Unies, Déclaration universelle des droits de l'Homme
(article 21.3), 10 décembre 1948, Résolution 21 A(III).
2
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Dans cette introduction, nous présenterons la
construction de l'objet d'étude
(I) et le cadre théorique et opérationnel et les
hypothèses de recherche (II).
I. Eléments de problématisation du
sujet
Les éléments de problématisation qui
participe de la construction de l'objet à ce niveau sont la
contextualisation et la justification du sujet (A), la revue critique de la
littérature (B) et la problématique (C).
A. Contexte et justification
Depuis le retour du multipartisme au Cameroun dans les
années 90, toutes les élections organisées ont
été, selon les partis politiques d'opposition et de nombreux
observateurs nationaux et internationaux, entachées de nombreuses
irrégularités parmi lesquelles l'incompétence, le
défaut de culture démocratique, les problèmes logistiques
et organisationnels le tout conduisant à l'intensification de la
fraude2. Dans son article intitulé La déviance
politique comme catégorie discursive de construction de la
réalité politique en Afrique, Janvier Onana, pose la
question de savoir d'où vient-il que, les restaurations chaotiques du
pluralisme politique en Afrique noire au début des années 1990,
aucune élection ne se soit déroulée sans que, pour de
bonnes ou de mauvaises raisons, des voix ne s'élèvent pour crier
à la fraude ?3 A cette interrogation nous pouvons tout
simplement dire que la majoritaire des pays africains ayant pendant longtemps
connu le régime de parti unique ne s'accommode pas au changement ; alors
pour conserver ou tout au moins se maintenir au pouvoir ils ont recours
à la fraude. Celle-ci constitue une violation du droit des peuples
à leur autodétermination, vue comme une entrave à la loi
pour favoriser un candidat ou une liste de candidats au détriment des
autres. Ainsi la fraude devient donc, ce que Janvier Onana appelle une
déviance politique et un instrument de pratique politique4.
Cette pratique est enracinée dans l'histoire politique du Cameroun. Elle
a été utilisée dès les premières
années de la vie politique du pays aussi bien dans la partie orientale
sous administration française que dans la partie occidentale sous
administration anglaise lors du référendum sur la
réunification du Cameroun en 19615. En effet, pour
empêcher l'expression de la volonté populaire et surtout
sauvegarder ses intérêts, les autorités coloniales firent
recours à la fraude électorale. Cette pratique a continué
avec les premiers leaders politiques camerounais pendant toute la
période du parti unique allant de 1966 à 1990.
La persistance de la fraude électorale dans le jeu
démocratique au Cameroun dès 1992, avec le retour au
multipartisme, n'est donc que l'actualisation d'une habitude. Elle reste
possible du fait que de nombreux systèmes électoraux sont loin de
faire le consensus. Malheureusement, elle a jeté un discrédit sur
les élections au Cameroun6, entraînant ainsi souvent un
désintéressement de la population de la
2 Friedrich Ebert Stiftung, Prévenir et
lutter contre la fraude électorale au Cameroun Manuel pratique,
Yaoundé, Edition Clé, 2012, pp. 9 À 10.
3 Onana, (J), « La déviance politique
comme catégorie discursive de construction de la réalité
politique en Afrique », in Cahier Africain des Droits de l'Homme
n° 9, 2003, pp. 85-114.
4 Onana, (J), « Art.cit. », pp. 85-114.
5 Entretien avec Monsieur Nsoé Armand
Célestin, enseignant d'histoire et géographie et ancien Proviseur
à la retraite.
6 Friedrich Ebert Stiftung, Op. cit., pp. 9
À 10.
3
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
chose électorale, et par conséquent l'apathie
électorale7 ; les dirigeants n'ayant pas la
légitimité nécessaire pour exercer leurs
fonctions8. Elle peut également être une source de
conflits et de chaos comme l'illustrent bien de cas à travers le
monde9.
L'analyse du monitoring des élections au Cameroun offre
l'occasion d'initier la discussion sur le rôle des acteurs
impliqués dans cette activité et la problématique de
l'organisation des élections libres, justes, périodiques et
transparentes dans notre pays.
D'abord, au plan sociopolitique, étudier le monitoring,
un phénomène lié aux élections et à la
démocratie, doit susciter la prise de conscience collective et la
participation de tous à l'édification d'un pays épris des
valeurs démocratiques. Il ne s'agit pas seulement d'une exigence venant
de l'extérieur comme d'aucuns le pensent, mais d'une volonté de
promouvoir des valeurs communes à l'humanité.
Au plan scientifique ensuite car, notre étude se situe
dans une approche critique de la pratique électorale dans un pays
où la loi électorale a connu plusieurs modifications et où
la démocratie est sans cesse en transit10. En effet, alors
que les études sur les différents processus de
démocratisation en Afrique abondent, l'on peut affirmer que très
peu d'écrits sont connus en ce qui concerne le monitoring des
élections au Cameroun. Notre travail s'inscrit donc dans une
démarche pouvant contribuer à l'analyse scientifique du processus
démocratique au Cameroun à travers le monitoring des
élections de 1992 et 2011. Mais, il s'agit surtout de contribuer
à combler un vide épistémologique du contrôle
partisan et non-partisan du monitoring des élections
présidentielles.
Notre étude se limite au Cameroun et couvre la
période allant de 1992 à 2011, une période pendant
laquelle quatre élections présidentielles y ont été
organisées : les élections présidentielles du 11 octobre
1992, du 12 octobre 1997, du 11 octobre 200411 et du 09 octobre
2011. Ces scrutins ont connu la présence de nombreux observateurs tant
nationaux qu'internationaux parmi lesquels : le National democratic institute
for international affairs12, comme acteur de la
société internationale, l'administration à travers le
MINAT, des administrations indépendantes et les organisations de la
société civile camerounaise. C'est aussi la période au
cours de laquelle un véritable coup d'accélération fut
donné pour le passage du Cameroun au modèle démocratique
de gestion de la cité13 au début de la décennie
90. Un déploiement considérable d'acteurs internationaux et
nationaux dans le champ électoral camerounais. C'est le
7 C'est ce que nous révèle les
rapports d'observation de Transparency International Cameroun
(présidentielle 2011), Cameroon Ô'Bosso (présidentielle
2011), justice et paix (municipales et législatives 2007).
8 Entretien avec Mme Toukombe Viviane, Responsable
de l'Unité Socio-Juridique de la Commission Diocésaine Justice et
Paix de Yaoundé (Mvolyé).
9 Lire Konadje, (J-J), L'intervention de l'ONU
dans la résolution du conflit intraétatique ivoirien,
Thèse de Doctorat en Science Politique, Université de Toulouse,
2010, pp. 94-96.
10 Eboussi Boulaga, (F), La démocratie en
transit au Cameroun, Paris, L'Harmattan, 1997, 4ème de
couverture.
11 Bougueli, (G), « Cameroun les nerfs
à fleur de peau, A cinq mois de l'élection présidentielle,
Paul Biya laisse planer le mystère sur sa candidature. En attendant, le
pouvoir fait feu de tout bois pour juguler la grogne sociale », in
Jeune Africaine Economique n° 2628, du 22 au 28 mai 2011, pp.
30-32.
12 Lire à ce sujet le Rapport de la mission
des observateurs internationaux du NDI, Élection
présidentielle anticipée du 11 octobre 1992 au Cameroun, in
Le livre Blanc de la République du Cameroun, 1993, p. 245.
13 Le Cameroun est perçu à tort ou
à raison comme anti-modèle en matière de
libéralisation de la vie politique, lire à ce sujet : Chege, (M),
« Between Africa's extermes », in Journal of Democracy,
January, 1995, vol. 6, pp. 44-51, ou encore Monga, (C), « L'indice de
Démocratisation : Comment défricher le nouvel aide-mémoire
de l'autoritarisme », in Afrique 2000, juillet-septembre 1995, p.
63, Sindjoun (L) « la culture démocratique en Afrique subsaharienne
: comment rencontrer l'arlésienne de la légende africaniste, in
Francophonie et démocratie, symposium sur le bilan des pratiques de la
démocratie des droits et des libertés dans l'espace francophone
», Paris, Pedone, 2001, pp.522-530, Sindjoun (L), « Cameroun : le
système politique face aux enjeux de la transition démocratique
», Afrique politique, Paris, Karthala, 1994, pp.143-165.
4
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
cas du NDI Organisation non gouvernementale (ONG)
américaine, qui a célébré en 2013 ses trente ans de
promotion de la démocratie à travers le monde par sa
participation à l'organisation des élections libres,
honnêtes, justes, périodiques et transparentes.
Nous avons aussi opté de travailler sur
l'élection présidentielle, non pas pour dire que les autres
élections14 sont moins importantes, mais tout simplement
parce que ce type d'élection renferme un enjeu majeur, surtout pour
celle du 11 octobre 1992. Elle a été la plus disputée et
la plus convoitée d'une part par les acteurs internationaux comme la
France, les Etats-Unis15, d'autre part par les acteurs nationaux
tels les partis politiques de l'opposition ayant pris part au dit scrutin.
Monsieur Paul Biya, l'occupant actuel de ce fauteuil, a obtenu 39,98%, son
challenger et chef de file de l'opposition camerounaise, Monsieur Ni John Fru
Ndi, suivait avec 38, 97% et Monsieur Bello Bouba Maïgari quant à
lui obtiendra 19%, représentant ainsi la troisième force
politique du pays16. En mai 1997, alors que l'élection
présidentielle de cette année se prépare, un des ministres
du gouvernement du président et futur candidat à sa propre
succession démissionne et déclare sa candidature à
l'élection présidentielle17. L'élection de
1997, connaîtra une autre issue et la particularité de cette
élection réside dans le fait que le principal chef de
l'opposition, Monsieur Ni John Fru Ndi l'a boycottera, ainsi une alliance va se
nouer entre UNDP et le RDPC, jusqu'à son dénouement lors des
élections sénatoriales du 14 avril 201318. Alors qu'en
2004, lors du scrutin présidentiel le chef de l'opposition fera son
retour et obtiendra 17,40%, le candidat sortant obtiendra 70,92%.
De ce qui précède il convient de faire
l'état des savoirs critiques sur la question.
B. Revue critique de la littérature
Notre revue de la littérature est constitué
à analyser les travaux mettant en exergue la clarification conceptuelle
et la question des acteurs du monitoring des élections d'abord (a)
ensuite sur ceux consacrés aux méthodes et aux stratégies
de ces acteurs (b), et enfin sur les travaux portant sur les usages du
monitoring des élections
(c).
a. La littérature consacrée à la
clarification et aux acteurs du monitoring des élections
Pour comprendre les questions des acteurs, il est judicieux de
donner sens à cette expression, dans ses nuances et sa
sémantique.
Janvier Onana19 pense que le monitoring
électoral est un mode courant de gestion préventive de la fraude.
Alors si le monitoring est une sorte de prévention contre la fraude,
Mathias-Eric Owona Nguini et Jean-Bosco Talla le qualifient de
14 Elections municipales, législatives ou
encore sénatoriales.
15 Lire National Democratic Institute for
international Affairs (NDI) à ce sujet le Rapport de la mission
d'observateurs internationaux, Élection présidentielle
anticipée du 11 octobre 1992 au Cameroun, in le livre Blanc de la
République du Cameroun, 1993, pp. 246-247.
16Bougueli, (G), Op. cit., , pp. 30-32.
17 Cameroun 1997-2014 : Retour sur l'affaire Titus
Edzoa,
http://237online.com/article-49603-cameroun--1997-2014-retour-sur-l-affaire-titus-edzoa-cameroon.html,
consulté le 19 mai 2014, Ngando,(A), L'affaire Titus Edzoa,
revue de la presse camerounaise, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 68.
18À ce sujet beaucoup de débats ont eu lieu dans
les médias camerounais.
19 Onana, (J), « Art. cit.», pp. 85-114.
5
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
« Sida électoral20 ». Il
faut donc envisager le monitoring sous un autre angle, celui beaucoup plus
global, qui prenne en compte d'autres aspects des élections hormis la
fraude.
Sylvain Ollier21 relève que le monitoring
électoral est parfois considéré par la littérature
anglo-saxonne comme une activité distincte de l'observation des
élections. La différence entre les deux concepts, ne se retrouve
toutefois pas dans la doctrine francophone22. Pour certains, le
monitoring des élections différerait de l'observation car il
comporterait une fonction supplémentaire consistant en une
évaluation de la performance de l'administration électorale et du
bien-fondé des procédures23. Les experts
électoraux joueraient donc un rôle plus actif que les observateurs
classiques, car étant investis d'un pouvoir d'intervention lorsque des
règlementations ou des procédures ont été
violées ou ignorées24. Certains estiment
également que les missions d'observation impliqueraient une
présence plus limitée dans le temps que le
monitoring25. Pour d'autres enfin, election monitoring
renverrait plutôt au travail des observateurs nationaux et
internationaux26. Néanmoins, cette différenciation
apparaît assez inconsistante et se révèle nettement plus
rare depuis la fin des années 1990. Les objectifs de cette
activité étant de renforcer l'intégrité des
processus électoraux à travers la dissuasion et la
dénonciation des fraudes et irrégularités, par des
recommandations visant à l'amélioration de ces processus. Ces
objectifs visant également à renforcer la confiance des citoyens,
la compréhension nationale et internationale par le partage de
données d'expérience et d'informations relatives au
développement démocratique27. Les deux expressions
sont généralement employées de façon alternative
pour désigner l'observation nationale et internationale des
élections, comme dans la Déclaration de principes de
200528, et seront considérées comme synonymes dans
cette étude. Par ailleurs le monitoring soit aussi être
considéré comme un ensemble de rôles
institutionnalisés et différenciés.
De nombreux acteurs internationaux et nationaux, ayant chacun
des rôles et des responsabilités différentes, interviennent
dans l'observation internationale et nationale des élections. S'agissant
des acteurs du monitoring des élections, Stéphane Monney
Mouandjo29 présente deux catégories d'acteurs,
à savoir : le Commonwealth et la Francophonie. Pour lui, ces deux
organisations oeuvrent en Afrique en général et au Cameroun en
particulier depuis le retour au multipartisme, à travers leurs
différentes missions internationales d'observation des élections.
Stéphane Monney
20 C'est une expression que nous empruntons
à Mathias-Eric Owona Nguini et Jean-Bosco Talla, dans leur article,
« Présidentielles 2011 ! Comment vaincre le sida électoral
au Cameroun », in Editorial du journal Germinal, n° 058, pp.
3-4.
21 Ollier, (S), L'observation internationale
des élections dans la région de l'OSCE : contribution à
l'étude de l'effectivité du contrôle électoral
international, Paris, L'Harmattan, Collection Logiques Juridiques, 2012,
p. 17.
22 Idem.
23 Ibidem, p.18.
24 Code of conduct : Ethical and Professional
Observation of Elections, International IDEA, 1997, §8, p. 17.
25 Bjrnulund, (E), Beyond Free and Fair.
Monitoring election and building democracy, Woodrow Wilson Center Press,
John Hopkins University Press, 2004, p. 40.
26 Diamond, (L), The spirit of democracy. The
struggle to build free societies throughout the world, Henry and Company,
2008, p.123.
27 Déclaration de principe pour
l'observation des élections et Code de conduite des observateurs
internationaux, 2 novembre 2005, CDL-AD (2005) 036, paragraphe 4. Pour une
étude du document, voir infra. Partie 1, Titre 2, Chapitre 1.
28 OSCE /ODIHR, Election Observation. A decade of
monitoring elections: the people and practice.
29 Monney Mouandjo (S), La démocratie au
Sud et les Organisations Internationales : analyse comparée des missions
internationales d'observation des élections des pays membres du
Commonwealth et des pays membres de l'organisation Internationale de la
Francophonie, Thèse de Doctorat en Droit public nouveau
régime, Université de Reims Champagne Ardenne, 2007-2008, p.
201.
6
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Mouandjo présente ces acteurs comme étant tout
d'abord des partenaires du Cameroun dans les relations diplomatiques. Ensuite,
comme deux acteurs qui travaillent pour la promotion de la démocratie et
par conséquent, s'impliquent dans le monitoring des élections.
Allant dans le même sens, Fabien Désiré
Ndoumou30 présente non seulement la Francophonie et le
Commonwealth comme faisant partie des acteurs de l'observation des
élections en Afrique. Mais mentionne également l'ONU, ainsi que
d'autres acteurs comme le Conseil de l'Europe (CE) et l'Union Européenne
(UE).
Abdoulkarimou31, quant à lui, nous
présente deux catégories d'acteurs : d'une part les acteurs
nationaux, qui se regroupent autour des associations religieuses, des ONGs et
les acteurs internationaux constitués des ONGs internationales, des
missions diplomatiques accréditées au Cameroun32 et
des institutions internationales telles le Commonwealth, la Francophonie,
l'ONU, l'OUA (l'UA ensuite depuis 2002) et aussi les médias. Selon lui,
les associations religieuses comme le Service National Justice et Paix (SNJP),
par le biais de la Conférence Episcopale Nationale du Cameroun (CENC)
participe au monitoring des élections depuis 2002 sous la
bannière des « Observateurs Chrétiens des Elections
(OCE)»33, le Service OEcuménique pour la Paix (SEP). Des
ONGs et associations comme le Cercle International pour la Promotion de la
Création (CIRCPRE) se déploient aussi sur le terrain lors des
consultations électorales.
Bien ces travaux ont le mérite nous intéressent
parce qu'ils nous présentent tous les acteurs qui apportent leur
concours et leur contribution à l'organisation des élections
libres, justes, honnêtes, transparentes et périodiques afin de
promouvoir la démocratie et les droits de l'homme34.
Cependant, il faut souligner que dans cette énumération d'acteurs
ces auteurs ont omis de mentionner une catégorie particulière
d'acteurs, les ONGs étrangères notamment américaines qui
ont joué un rôle important pendant l'élection
présidentielle35. Ils connaissent une certaine limite parce
qu'ils abordent toutes les élections en général, mais se
limite à un seul aspect de la question du monitoring des
élections, à savoir, l'observation, et ne renseignent pas comment
ces mêmes acteurs se déploient pour intervenir dans le cas
spécifique de l'élection présidentielle et les usages dont
ils sont l'objet. Notre apport dans ce travail porte à la fois sur
l'observation des élections présidentielles dans laquelle de
nombreux acteurs sont déjà impliqués et engagés,
d'une part et d'autre part sur l'intervention qui est un volet peu ou mal connu
de ces mêmes organisations. Par ailleurs, nous allons aborder aussi le
rôle des ONG américaines, notamment le NDI.
b. La littérature consacrée aux
méthodes et stratégies des acteurs
La présence d'observateurs ne va pas sans soulever des
questions d'ordre éthique. Le simple fait de se trouver au coeur d'une
campagne électorale et sur les
30 Ndoumou, (F ÀD), Les missions
d'observation des élections, Paris, Edition L'Harmattan, 2012, p.
10.
31 Abdoulkarimou, La pratique des
élections au Cameroun 1992 - 2007. Regards sur un système
électoral en mutation, Yaoundé, Edition Clé, p.
92.
32 Parmi ces missions diplomatiques
accréditées au Cameroun pour les élections qui sont
l'objet du présent mémoire on peut citer en 1992 : Les
Etats-Unis, la France, le Haut-Commissariat du Canada ; 1997 : Les Etats-Unis,
la France ; 2004 : La France, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, le
Haut-Commissariat ; en 2011 : La France, l'Angola, les Etats-Unis, la CEEAC, le
Commonwealth, la Grande Bretagne, le Haut-Commissariat du Canada, le
Haut-Commissariat de la République Fédérale du Nigeria....
Etc. (voir liste complète en annexe).
33 Abdoulkarimou, Op. cit., p. 92.
34 Ibidem, p. 93.
35 National Democratic Institute for international
Affairs (NDI), L'élection présidentielle du 11 octobre 1992
au Cameroun.
7
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
lieux du scrutin peut amener un observateur à se
trouver dans des situations parfois fort délicates. Certaines
organisations internationales qui se consacrent à la promotion des
droits démocratiques et parrainent des missions de monitoring des
élections ont élaboré, à l'intention des
observateurs, des codes d'éthique qui concourent à un plus grand
professionnalisme de l'observation. Il s'agit notamment de l'Institut
International pour la Démocratie et l'Assistance Electorale, de
l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en
Europe, de l'Union Interparlementaire, de l'Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF)36 et du Commonwealth.
L'Institut international pour la démocratie et
l'assistance électorale (IDEA), précise que les devoirs de
l'observateur se résume à la reconnaissance et au respect de la
souveraineté du pays hôte ; les agissements de l'observateur
doivent se faire dans l'indépendance et l'impartialité ;
l'observateur doit faire preuve d'exhaustivité et prendre en compte
toutes les circonstances pertinentes ; la pratique de l'observation doit se
faire avec la plus grande transparence et l'exactitude37 dans le
processus électoral.
L'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) a aussi élaboré un certain
nombre de règles éthiques que devraient respecter les membres
d'une Mission d'Observation Electorale (MOE). Elle recommande aux observateurs
d'adopter les conduites suivantes : une plus grande impartialité,
c'est-à-dire qu'aucune préférence à l'égard
des autorités nationales, des partis, des candidats, ou tout ce qui fait
l'objet de la campagne électorale38. Pour cette organisation,
les observateurs doivent poursuivre leurs activités sans
interférer dans le processus électoral, les procédures, le
jour du scrutin ou le dépouillement et la compilation des
résultats. Ils doivent être munis des pièces
d'identification prescrites par le gouvernement hôte ou la commission
électorale, et doivent s'identifier auprès des autorités
compétentes sur demande. Ils ne doivent pas porter ou afficher de
symboles, couleurs ou bannières associés à un parti
politique ou un candidat. Ils peuvent porter à l'attention des membres
du personnel électoral local certaines irrégularités, mais
ne doivent jamais leur donner des instructions ou contredire les
décisions des responsables électoraux. Et c'est à cela que
se réduit le pouvoir d'intervention des acteurs non étatiques.
Ils doivent observer si toutes les lois et tous les règlements du pays
hôte39 sont respectés.
Quant aux principes de conduite que recommande l'Union
interparlementaire, ils sont similaires à ceux qui
préconisés par les autres organisations internationales
impliquées dans le domaine de la promotion des droits
démocratiques. Ainsi, de façon générale, le Code de
conduite pour les élections recommande que «Le comportement des
observateurs internationaux, outre qu'il doit être respectueux de la
législation nationale, est régi par les principes
généraux de la responsabilité : les observateurs doivent
s'en tenir à leur mandat, faire preuve de professionnalisme, être
honnêtes et impartiaux40». Pour cela, il
énonce les règles à respecter par les observateurs : agir
avec la plus stricte neutralité et sans parti pris à
l'égard des autorités nationales, des partis et des candidats,
des électeurs, de la presse et des
36 Le Directeur Général des Elections
du Québec, L'observation électorale, Guide pratique à
l'intention des membres des missions d'observation électorale à
l'étranger, Québec, 1997, p. 5.
37 Institut International pour la Démocratie
et l'Assistance Electorale, (IDEA), Code de conduite. Observation
électorale éthique et professionnelle, p. 10.
38Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (OSCE), Election Observation Handook,
2ème Edition, Varsovie, 1997, p. 39.
39Ibidem, pp. 5-6.
40 Goodwin-Gill, (G.S), Codes de conduite pour les
élections, Genève, 1998, Union Interparlementaire, p. 45.
8
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
médias et de l'organisation des observateurs
électoraux ; s'abstenir de tout acte pouvant porter préjudice au
système électoral ou à l'administration électorale
; faire connaître tout fait qui pourrait donner lieu à un conflit
d'intérêts ou à l'apparition d'un conflit
d'intérêts, pendant l'observation ; fonder toutes ces conclusions
sur des faits vérifiables et utiliser les normes de
référence reconnues41.
L'OIF s'est dotée de principes directeurs devant guider
l'envoi d'une mission d'observation d'élections. Ces principes ont
été adoptés par le Conseil permanent de la Francophonie
(CPF), à Marrakech, les 17 et 18 décembre 1996. On y
précise que les observateurs doivent avoir une réputation
d'indépendance d'esprit, d'impartialité et
d'objectivité42.
Ces travaux ont le mérite de nous montrer
qu'au-delà des particularités de l'un ou l'autre de ces codes de
conduite, il faut comprendre que le comportement43 des membres des
missions d'observation électorale est un facteur déterminant pour
assurer la crédibilité de la mission et, partant, son
succès. La connaissance des codes de conduite et le respect des
règles d'éthique reconnues internationalement dans ce domaine
sont donc un impératif. La mission d'observation, qui s'inscrit dans le
cadre plus large de l'appui au processus de démocratisation
engagé par nombre de pays francophones, doit se dérouler dans le
respect de la souveraineté de l'État demandeur et de la
législation en vigueur44. Munis des termes de
références et ordres de missions appropriés, les membres
de la mission doivent avoir une réputation d'indépendance
d'esprit, d'impartialité et d'objectivité. Ils doivent plus
particulièrement avoir une bonne connaissance des règles et
techniques électorales. On attend de plus qu'ils aient une connaissance
du pays demandeur ou tout au moins de la région où doit se
dérouler la mission. Cependant cet ensemble de codes et règles
éthiques est standards aux différentes élections pour
lesquelles elles sont le plus souvent invitées à
couvrir45.
Notre apport consistera donc dans le cadre de notre recherche
à évaluer le rapport, entre la théorie et la pratique, de
l'appropriation de ces codes de conduite et des règles éthiques
dans le cadre de l'élection du Président de la République
au Cameroun depuis 1992 à 2011.
c. La littérature consacrée aux usages du
monitoring des élections
L'un des éléments majeur de convergence autour
du déploiement des missions internationales d'observation des
élections dans les pays du Commonwealth et dans les pays de la
Francophonie peut être entendu comme un consensus autour des
finalités. Cette double considération se justifie par la
difficulté à séparer l'observation des élections de
ces deux exigences : l'exigence éthique en ce qu'elle permettait de
limiter la fraude électorale par exemple, et l'exigence politique parce
que toute élection s'inscrit nécessairement dans une perspective
d'acquisition du pouvoir46. Il faut seulement faire un bond en
arrière pour se souvenir des incidents majeurs qui ont
émaillé le scrutin présidentiel de décembre 2010 en
Côte-d'Ivoire. L'Organisation des nations unies (ONU) qui a
géré cette crise post-électorale et dont le but premier
41 Ibidem, pp. 45-46.
42Conseil Permanent de la Francophonie (CPF),
Document portant principes directeurs devant guider l'envoi d'une mission
d'observation d'élections. Adopté par le CPF réuni en
sa 32ème session, les 12 et 13 novembre 1996, (CPF-23/96/D
299), p. 5.
43 Partialité ou impartialité.
44Union Interparlementaire, (UIP),
Déclaration sur les critères pour les élections libres
et régulières. Adoptée à l'unanimité
par le Conseil Interparlementaire à Paris, le 26 mars 1994,
Genève. (Dépliant).
45 Goodwin-Gill, (G.S), Op. cit., pp.
45-46
46 Monney Mouandjo, (S), Op cit., p. 155.
9
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
est de maintenir la paix et la sécurité
internationales dans le monde47 a été au coeur de
cette situation qui a duré un peu plus de quatre mois et plongé
le pays dans une grave crise humanitaire. Présente en Côte
d'Ivoire en vue d'une contribution à la résolution de la crise
sociopolitique née de la tentative de coup d'Etat du 19 septembre 2002
qui s'est muée en une rébellion armée48, l'ONU
n'a cessé de déployer des efforts aussi bien politiques,
diplomatiques que militaires pour un retour à la paix durable dans le
pays. Son implication dans la gestion de la crise post-électorale
ivoirienne ainsi que son dénouement lui ont valu une salve de critiques
acerbes aussi bien dans l'opinion publique nationale
qu'internationale49.
Cette crise ivoirienne, et la façon dont elle a
été gérée nous amènent à conclure et
à nous interroger sur le rôle des missions de monitoring des
élections en Afrique, surtout celui des puissances occidentales et de
l'ONU dans les processus électoraux, à travers les missions
d'observation des élections présidentielles. Ces missions ne
sont-elles pas plus des sources d'instabilités politiques, que de voies
idoines de promotion de la démocratie et des Droits de l'Homme ? Nous
sommes quelque peu, d'avis avec Komi Tsakadi qui se pose la question de savoir
s'il ne faut pas supprimer les missions d'observation électorales en
Afrique ?50 A défaut de les supprimer, il faudrait repenser
leur avenir pour adapter leur méthodologie aux réalités de
l'Afrique et non aux intérêts des puissances qui gouvernent le
Conseil de Sécurité de l'ONU51.
Bien que les Directives pour les missions d'observation et de
suivi des élections de l'Union africaine prévoient la
médiation électorale au point 4.3 en ces termes :
« La mission d'évaluation doit d'abord
décider de la portée ou du mandat de la mission
électorale. Les différents types de mandat sont, entre autres,
les suivants : (...) la médiation, c'est-à-dire l'intervention
d'une tierce partie dans le contentieux électoral afin d'aider les
parties en litige à trouver
des issues ou solutions mutuellement acceptables à
leur contentieux électoral... »52.
Dans le cas de la crise, les mécanismes de l'UA n'ont
pas été assez efficaces, c'est sans doute pour cette raison que
l'ONU et les puissances membres du conseil de Sécurité de l'ONU
ont géré la crise.
Le mérite de ces travaux nous permet aussi de voir que
le rôle des missions d'observation des élections ne se limite pas
à la simple lutte contre les irrégularités des scrutins ;
cela pourrait s'interpréter comme une nouvelle forme de recolonisation
de l'Afrique. Elles ne sont pas gage de bon déroulement
d'élections, et par conséquent ne s'inscrivent peut être
plus à l'école de l'apprentissage de la démocratie qui est
le gage de la tenue des élections libres, honnêtes, justes, et
périodiques, transparentes et démocratiques53. Pour
nous, l'aide financière à la démocratie doit viser le
renforcement des capacités des institutions chargées d'organiser
les élections comme Elections Cameroon (Elecam), en lui dotant des
moyens humains et techniques pour lui permettre de publier les résultats
le soir du vote ou au plus tard le lendemain en vue d'éviter les
tripatouillages des résultats, les tensions et les
47 Voir Charte des Nations Unies.
48 Konadje (J-J), L'intervention de l'ONU dans
la résolution du conflit intraétatique ivoirien,
Thèse, Science Politique, Toulouse, 2010, pp. 94-96.
49 Idem. Voir aussi,
http://www.onuci.org/pdf/faqcertification.pdf
site internet consulté le 26 mai 2014, Treizième rapport du
Secrétaire général sur l'Opération des Nations
Unies en Côte d'Ivoire, p. 8.
50Komi Tsakadi « Faut-il supprimer les
missions d'observation électorales (MOE) de l'Union européenne en
Afrique ? »,
http://www.agora.vox.org/, site
consulté le 26 mai 2014.
51 Konadje (J-J), Op. cit., pp. 94-96.
52 Union Africaine, Directives des missions
d'observation et de suivi des missions de l'UA, point 4.3, p. 12.
53 Goodwin-Gill, (G.S), Op. cit., pp.
45-46.
10
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
contestations traditionnelles post-électorales, surtout
afin d'éviter la situation ivoirienne de décembre
201054. Ici et là il s'agit des usages internes et externes
du monitoring à des fins politique, individuelle, collective ou
étatique, ce qui aboutit parfois à des crises sociopolitiques
violentes qui problématisent le processus démocratique, et
partant l'organisation des élections
Au terme de notre revue de la littérature, il apparait
que les acteurs du monitoring des élections sont à la fois
internationaux et nationaux. Bien qu'ils concourent à la promotion de la
démocratie et des Droits de l'Homme en Afrique en général
et au Cameroun en particulier, ils mettent parfois aussi en berne les principes
qu'ils se sont fixés pour guider leurs actions dans cette
activité, lorsque les intérêts et les enjeux de leurs
pourvoyeurs de fonds sont menacés55. Si rien n'est fait, il y
a lieu de craindre que les MOE de l'ONU, l'UE et bien d'autres en Afrique ne
soient dévoyées pour consolider le pouvoir de certains Chefs
d'Etats au nom d'une soi-disant stabilité à laquelle aspire la
communauté internationale ou pour simplement constater des fraudes
(comme au Nigéria) jusqu'à ce que les populations africaines
à l'instar des européens de l'Est (Serbie, Géorgie,
Ukraine, Kirghizistan, Ouzbékistan), soient en mesure de faire tomber
leurs dictateurs par des mouvements de résistance non violente
(révolutions colorées ou de velours)56. Nous allons
analyser toutes ces interactions dans le cas des élections
présidentielles de 1992 à 2011 au Cameroun.
A partir de cette revue de la littérature, il convient
d'élaborer notre problématique.
B. Problématique
Bien que la possibilité de choisir ses
représentants par le biais de scrutins libres et transparents semble
aujourd'hui naturelle dans certaines sociétés, elle ne constitue
qu'une évolution relativement récente, même au sein des
Etats considérés comme d'anciennes
démocraties57. En raison de la place importante
progressivement accordée à la légitimité
démocratique des gouvernants dans les relations internationales depuis
1945, et bien plus depuis la fin de la Guerre froide58, de
nombreuses activités sont développées pour promouvoir la
démocratie à travers le monde. Parmi ces activités il y a
le monitoring des élections dont les acteurs sont devenus
incontestablement plus importants. Cette évolution n'est guère
étonnante dans la mesure où la tenue d'élections libres et
équitables est désormais très largement
considérée comme le premier indicateur de développement
démocratique au sein d'un Etat59.
De tout ceci, découle alors la question suivante :
comment se pratique le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun?
Autour de cette question centrale gravitent deux questions
secondaires, à savoir : quelles règles et enjeux,
ressources et logiques d'acteurs structurent le monitoring des élections
au Cameroun ? Quels usages et
54 Konadje (J-J), Op cit., pp. 94-100.
55 Lire à cet effet le rapport du NDI,
Election présidentielle du 11octobre 1992, pour comprendre que cette
organisation était le prolongement des actions non officielles des
autorités américaines à Yaoundé pendant
l'élection présidentielle ; c'est aussi le même rôle
qu'a joué la France, ainsi que les observateurs de l'Union
européenne pour l'élection présidentielle de
décembre 2010 en Côte d'Ivoire.
56Komi Tsakadi, Faut-il supprimer les missions
d'observation électorales (MOE) de l'Union européenne en Afrique
?,
http://www.agora.vox.org/, site
consulté le 26 mai 2014.
57 Ollier, (S), Op. cit., p. 9.
58 Ibidem, p. 10.
59 Idem.
11
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
quels effets de réalité du monitoring
des élections présidentielles au Cameroun ?
II. Cadre théorique et opérationnel
Il intègre le cadre théorique et
opérationnel de la recherche (A), déterminer les méthodes
et techniques de collecte des données (B) et enfin dégager les
hypothèses les grands axes de notre recherche (C).
A. Cadre théorique
Le cadre de notre étude se bâtit autour du
constructivisme (1) et du comparatisme (2) afin de nous permettre d'analyser
l'enchevêtrement des acteurs et d'apporter des réponses à
nos hypothèses.
1. Le monitoring comme un phénomène
socialement construit et produisant des effets de réalités
L'analyse constructiviste met en relation la production, la
reproduction des pratiques et usages sociaux avec leurs caractères
situés dans les contextes particuliers60. Elle permet
d'appréhender les réalités du monitoring des
élections présidentielles comme le produit des acteurs sociaux
conditionnés par la conjoncture qui prévaut lors de sa
construction. Par elle, nous avons observé la manière et compris
comment les acteurs du processus électoral et les structures se
construisent réciproquement. Dans cette optique, les
réalités sociales sont appréhendées comme des
constructions historiques et quotidiennes des acteurs individuels et
collectifs61.
Cette méthode a l'avantage de permettre la
quantification et l'utilisation d'échelles numériques et des
données statistiques car, l'utilisation d'échelle
numérique a permis d'évaluer le degré de déviation
par rapport aux limites idéales, malgré le fait que les
réalités dans lesquelles nous vivons sont conceptualisées
par le constructivisme comme socialement construites62, elle donne
la possibilité d'expliquer l'origine des intérêts et les
conditions dans lesquelles ces acteurs agissent. D'où la question de
savoir qui sont les acteurs et que font-ils d'important ?
En définitive, le constructivisme a contribué
à l'examen de l'implication effective des moniteurs électoraux
dans une permanente dialectique de construction et de
déconstruction63 du monitoring des élections
présidentielles. Cependant, il a été aussi important de
souligner la conjoncture particulière qui prévaut dans le
processus de construction et sa logique comparative.
60 Klotz, (A) et Lynch, (C), 1999, Le constructivisme dans
la théorie des relations internationales : critique internationale,
n°2-1999.pp. 51-62, pour une connaissance plus détaillée des
différentes variantes du courant constructiviste, lire Corcuff, (P),
« Eléments d'épistémologie ordinaire du
syndicalisme », Revue française de science politique, vol. 41,
n° 4, 1991, pp. 515-556.
61Tala Wakeu, (A), L'abstentionnisme
électoral au Cameroun à l'ère du retour au
multipartisme, Université de Dschang-Cameroun - Master en Science
Politique 2012, p.24.
62 A ce propos lire le document sur le
constructivisme, sur le site
www.revues.org consulté le
21/10/2013, p. 10.
63 Rapport Général de l'ONEL sur le
déroulement des opérations électorales des
élections législatives et municipales, 2002, p. 14.
12
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
2. Penser le monitoring des élections sous le
prisme du néo-institutionnalisme
Il est question ici de faire appel à l'approche
néo-institutionnaliste et non pas l'existence, au début du XXe
siècle, d'un ancien institutionnalisme lequel a été
occulté par le behaviorisme triomphant de l'après Deuxième
Guerre mondiale. Les behavioristes, qui trouvaient cette approche trop
empreinte d'idéalisme et de formalisme, ont alors proposé une
explication des phénomènes politiques en termes de comportements
et de valeurs. Cette approche a connu des excès et c'est essentiellement
contre ces excès que les pionniers du néo-institutionnalisme ont
voulu réagir. Le nouvel institutionnalisme se rapproche de l'ancien et
diffère du behaviorisme par l'utilisation des institutions comme
variables explicatives autonomes, mais il s'en distingue par une acception plus
complexe de l'institution, donc par un champ d'investigation plus vaste que la
démocratie et ses institutions formelles qui étaient au coeur de
l'ancienne version64.
L'approche néo-institutionnaliste postule que, les
institutions entendues comme « des répertoires de pensée
ou de comportements cohérents et de long terme qui déterminent
les politiques »65, influencent les
phénomènes sociopolitiques. Il s'articule d'abord sur la
problématique qui concerne l'influence des institutions sur l'action
c'est-à-dire qu'il conduit à examiner l'impact des institutions
sur le comportement des acteurs, leurs stratégies, leurs
préférences, leurs identités, leur nature voire même
leur existence. Ensuite, il pose la question du développement
institutionnel c'est-à-dire qu'il s'interroge sur les origines et le
caractère des institutions en examinant comment leur production et leur
reproduction s'inscrivent dans un processus où le paysage institutionnel
existant à un certain moment dans le temps et dans l'espace conditionne
la possibilité et la trajectoire de changement
institutionnel66. L'approche néo-institutionnaliste comporte
trois branches sur lesquelles elle s'appuie pour expliquer les
phénomènes sociopolitiques ce sont notamment :
l'institutionnalisme historique, sociologique et du choix
rationnel67. L'institutionnalisme historique repose sur
l'idée selon laquelle les règles politiques formelles et les
politiques publiques établies sont la source de contraintes
institutionnelles qui infléchissent les stratégies et les
décisions des acteurs politiques c'est-à-dire que les
phénomènes sociopolitiques sont fortement conditionnés par
des facteurs contextuels et exogènes aux acteurs. L'institutionnalisme
du choix rationnel contribue à analyser les institutions en fonction des
occasions et des contraintes qu'elles offrent aux acteurs. L'institutionnalisme
sociologique qui développe l'idée selon laquelle les institutions
incarnent et reflètent des symboles et des pratiques culturelles tenaces
qui façonnent les perceptions des acteurs et informent la reproduction
institutionnelle.
Le recours à l'approche néo-institutionnaliste
pour l'explication du monitoring des élections présidentielles au
Cameroun permet de distinguer les ressorts politiques des ressorts
sociologiques, de différentier les acteurs sociopolitiques dudit
64 Gazibo, (M), « Le
néo-institutionnalisme dans l'analyse comparée des processus
démocratique », in Politique et Société, vol.21,
n° 3, 2002, pp. 139-160, lire aussi Rizza (R), «
Néo-institutionnalisme sociologique et nouvelle sociologie
économique : quelles relations ? », Revue Interventions
économiques [En ligne], 38 | 2008, mis en ligne le 01
décembre 2008, consulté le 15 juin 2015.URL :
http://interventionseconomiques.revues.org/292
65 Stone (A), « Le
néo-institutionnalisme, Défis conceptuels et
méthodologiques», Politics and Society, University of
California, Politics, N°20, 1992
66 Lecours (A), « L'approche
néo-institutionnaliste : unité ou diversité ? »,
Politique et Société, Université Concordia, Vol.
21, N°23, 2002.
67 Peter A. Hall et Rosemary C.R.Taylor, « La
science politique et les trois néo-institutionnalismes », in Revue
francaise de science politique, 47ème année,
n°3-4, 1997, pp.469-496.
13
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
monitoring. En mettant un accent sur les institutions, cette
approche participe en grande partie à démontrer et surtout
à expliquer que des facteurs institutionnels, mais aussi certaines
conjonctures politiques et historiques qui ont favorisé le
phénomène de monitoring des élections, les acteurs en
situation et en interaction. Cette approche renforce notre analyse dudit
phénomène et devient un outil indispensable qui permet de montrer
que les institutions, une fois créées, prennent vie et donnent
lieu à des dynamiques et des situations provoquant chez des acteurs
sociopolitiques des actions et des interactions parfois non voulues.
B. Techniques de collecte des données
Les techniques de recherches ont permis de collecter les
données utiles à l'analyse. Par technique il faut entendre
l'ensemble des procédés grâce auxquels la collecte des
informations sur un objet d'étude est rendue possible. Elle implique la
façon dont on accède à l'information, on la traite et les
moyens intellectuels permettant de l'analyser et de l'interpréter afin
de crédibiliser le résultat d'une recherche. La
crédibilisation de cette analyse procède donc de la valorisation,
principalement de l'analyse documentaire et des entretiens. La méthode
est un « ensemble de démarches que suit l'esprit pour
découvrir et démontrer la vérité68
» et, plus largement, un « ensemble de démarches
raisonnées, suivies, pour parvenir à un but »69.
Selon Jacqueline Freyssinet-Dominjon la méthode est un « ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles un chercheur veut atteindre
les vérités qu'il poursuit, les démontre et les
vérifie »70. Pour Madeleine Grawitz elle trouve sa place
à tous les niveaux de la recherche71
Par technique il faut entendre, l'ensemble des
procédés grâce auxquels la collecte des informations sur un
objet d'étude est rendue possible. Elle implique la façon par
laquelle on accède à l'information, comment on la traite et les
moyens intellectuels permettant de l'analyser et de l'interpréter afin
de crédibiliser le résultat d'une recherche. La
crédibilisation de cette analyse procède donc de la valorisation,
principalement de l'analyse documentaire et des entretiens.
Nous avons procédé à une recherche
bibliographique dans les villes de Douala, et de Yaoundé. Dans la
première, ces recherches ont notamment eu lieu dans les
bibliothèques de l'Université de Douala bibliothèque
centrale de l'ESSEC et celle du Campus. Dans la seconde ville, ces recherches
se sont déroulées dans la bibliothèque de l'UCAC à
Yaoundé sans oublier la bibliothèque du CNUDHD-AC, au centre
documentaire de l'Ambassade des Etats-Unis. Donc cette technique d'observation
était indirecte, avec notamment la technique documentaire. Il s'est agi
de dépouiller, les ouvrages scientifiques, les articles des revues, les
articles des journaux, les dictionnaires généraux et
spécialisés, les rapports des OSC et des OIG ont
été les sources de première et les textes
réglementaires nationaux et internationaux, portant directement ou
indirectement sur notre objet de recherche.
A partir de nos lectures, nous avons découvert les
points de vue de différents auteurs sur notre objet d'étude.
Ensuite, nous nous sommes rendu sur le terrain pour effectuer une enquête
en adoptant la technique de l'entretien semi-direct, en ce sens
68 Dictionnaire le Petit Robert, 1998, p.
1034.
69 Idem.
70 Freyssinet-Dominjon, (J), Méthodes en
sciences sociales, Paris, Montchrestien, 1997, p. 12.
71 Grawitz, (M), Op. cit., p. 124.
14
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
qu'il n'a pas été ni entièrement ouvert
ni canalisé par un grand nombre de questions prévues.
Avant d'aller sur le terrain, nous avons élaboré
des guides d'entretien qui ont servi à questionner les observateurs des
élections et ceux qui ont au moins observé une élection
présidentielle sur un nombre de questions posées. Ce guide
d'entretien contient d'une part des questions standard qui sont introduites au
fur et à mesure que l'entretien progresse et, d'autre part, des
questions libres ayant permis de relancer le débat ou de
réorienter, à chaque fois que la personne enquêtée
sortait de son véritable sujet.
Toutefois, nous accordions plus d'importance à la
progression de l'entretien lui-même, l'ordre important peu. Cette
méthode appelée semi-directe a facilité le dialogue et a
permis garder toujours ouverte la possibilité d'obtenir des
clarifications sur l'un et l'autre point. Elle a offert aussi une certaine
liberté, tout en écartant le risque de dispersion. En outre, elle
a permis d'éviter de passer à côté des points
importants abordés de manière spontanée par les personnes
interrogées. Les attitudes d'hésitation, de doute ont
été repérées. La méthode a eu pour but de
laisser venir l'interlocuteur afin que celle-ci parle ouvertement dans les mots
qu'elle souhaite et dans l'ordre qui lui convenait.
Ensuite, durant notre enquête qui a duré tous les
mois de juillet et d'août 2013, les demandes que nous avons
adressées aux OSC d'une part et aux OIG d'autre part et n'ayant pas
toujours trouvé réponse favorables, nous avons travaillé
avec ceux qui ont répondu présents à notre sollicitation.
Malgré ces écueils, nous sommes parvenus à étudier
le phénomène de manière objective.
Nous avons mobilisé le modèle de la science
politique de sociologie politique, et surtout de sociologie électorale,
mieux encore de science électorale72, de droit international
ainsi que des relations internationales.
Deux techniques de recherche nous ont donc permis de
bâtir notre développement : la recherche empirique et la recherche
documentaire.
A l'issue de ce travail méthodologique nous avons
arrêté l'hypothèse et les axes de la recherche.
C. Hypothèses et axe de recherche
Il s'agit ici de dégager les hypothèses
et de préciser les axes de la recherche. a. Hypothèse centrale et
hypothèses secondaires
L'idée-force de ce mémoire est explicité
en ces termes : le monitoring des élections présidentielles au
Cameroun de 1992 à 2011 par l'observation et l'intervention est
sociopolitiquement construit et produit des effets de réalité au
regard des usages plurivoques dont il fait l'objet.
72 Les élections et le monitoring des
élections présidentielles s'inscrit dans le cadre de la science
électorale, entretien avec Hilaire Kamga, Un expert des questions
électorales et de l'observation des élections (Note de
terrain).
15
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Cette hypothèse centrale est spécifiée par
deux hypothèses secondaires :
La première hypothèse secondaire est que
le monitoring des élections présidentielles est une pratique
encadrée par des règles, structurées par des enjeux
multiples et que ces acteurs usent de multiples et inégales ressources
et de nombreuses logiques.
La seconde hypothèse est que le monitoring des
élections présidentielles est déterminé par des
usages plurivoques internes et internationaux, produit des effets de
réalité à la fois positifs et négatifs.
b. Les axes de la recherche
L'analyse menée ici, en dépit de sa
complexité ainsi que de la diversité des questionnements qu'elle
suscite, nous conduit tour à tour, à étudier le monitoring
des élections présidentielles comme une construction
sociopolitique (Première partie) d'abord, par les règles qui
l'encadrent et les enjeux qui justifient (Chapitre 1) et, ensuite par les
ressources et des logiques de déploiement des acteurs (Chapitre 2).
D'autre part, il y a l'analyse des usages plurivoques
(Chapitre 3) et les effets de réalités (Chapitre 4) du monitoring
des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
qui constituent l'objet de la seconde partie.
16
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
PREMIERE PARTIE :
LA CONSTRUCTION SOCIOPOLITIQUE DU MONITORING DES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
« Le plus grand défi d'une mission
d'observation des élections est « d'être sûr de ne pas
se tromper » »73, Peter Eicher74.
« La création d'Elecam est venue consacrer une
étape décisive dans la modernisation de notre système
électoral. Le rôle des partis politiques a été
renforcé et la société civile est maintenant
impliquée dans la gestion du processus électoral. Les
administrations publiques prêter leur concours à Elecam dans
l'exécution de ses missions, et le pouvoir judiciaire peut intervenir en
amont du processus électoral avant tout contentieux éventuel
»75.
Le monitoring des élections présidentielles
s'appuie sur une certaine spécificité, à savoir, celle de
la quête de l'efficacité. Dans cette dynamique, il ne nie pas
l'impératif de conciliation de cette tension vers la réalisation
d'un certain objectif avec l'application d'un certain nombre de règles
et d'enjeux (Chapitre 1) ainsi qu'un ensemble de ressources et de logiques
(Chapitre 2) qui animent les acteurs qui contribuent à cette
activité.
73 Organisation pour la Sécurité et
la Coopération en Europe (OSCE), L'observation des élections,
Varsovie, 2006, publié par le Bureau des Institutions et des Droits de
l'Homme (BIDDH) de l'OSCE, p. 18.
74 Ancien premier Directeur adjoint du Bureau des
Institutions et des Droits de l'Homme (BIDDH), Chef principal de plusieurs
missions d'observations.
75 Extrait du discours du Président National
du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), lors du
Congrès Extraordinaire de ce parti le 15 septembre 2011, à 24
jours de l'élection présidentielle du 09 octobre 2011.
17
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CHAPITRE I : REGLES ET ENJEUX DU MONITORING DES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
« Les observations électorales (...) sont
largement acceptées dans le monde. Elles sont menées par les
organisations intergouvernementales, des organisations
non gouvernementales nationales, internationales et des
associations chargés d'évaluer avec impartialité et
précision les processus électoraux dans l'intérêt de
la
population du pays où l'élection a lieu et
dans celui de la communauté internationales. »76
Un phénomène, qu'il soit politique ou social, se
construit autour des règles et
enjeux qui animent chaque acteur. Dans le cadre de notre
étude sur le monitoring des élections présidentielles qui
obéit à cette logique selon Philipe Braud77,
l'explication
qu'il donne d'un phénomène politique, passe par
analyse des règles et des enjeux. Tel est le cas du monitoring des
élections. Il est opportun de le concevoir comme une pratique
socialement encadrée par des règles aussi bien normatives, que
pragmatique (Section 1), bien qu'étant structurée par des enjeux
multiples (Section 2).
SECTION I : LE MONITORING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
: UNE PRATIQUE ENCADREE PAR DES REGLES NORMATIVES ET PRAGMATIQUES
Le monitoring des élections présidentielles peut
être envisagé comme un phénomène socialement
construit, encadré par des normes juridiques (Paragraphe 1)
ainsi que par un ensemble de règles pragmatiques
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les normes d'encadrement du monitoring des
élections
présidentielles
Le monitoring des élections présidentielles est
fondamentalement encadré par le droit international (A) et
accessoirement par le droit national (B).
A. Le monitoring des élections
présidentielles : une pratique encadrée par le droit
international
Le développement récent des activités
visant à poursuivre et encourager la démocratie trouve son
fondement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le
Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui
promeuvent le respect des valeurs démocratiques et des
droits de l'homme. L'article 21 de la DUDH fait état de trois principes
:
« 1) Toute personne a le droit de prendre part
à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement,
soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 2)
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 3) La
volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou
76 Organisation des Nations Unies (ONU),
Déclaration de principes pour l'observation internationales
d'élections et code de conduite des observateurs internationaux, p.
12.
77Braud, (P), Sociologie politique, Paris,
Montchrestien, 6ème Edition, 2006, p. 613. Lire aussi Onana,
(J), Initiation à la science politique, Paris, Harmattan,
2009.
18
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
suivant une procédure équivalente assurant
la liberté du vote
»78.
Comme le mentionne la communication de la Commission sur les
missions d'assistance et d'observation électorales de l'Union
Européenne (CMAO-UE), l'article 6 affirme clairement que «
l'Union Européenne est fondée sur les principes de la
liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, ainsi que l'Etat de droit ». De
même, un objectif majeur de la politique de coopération au
développement, précisé sous le titre II du traité,
est de « contribuer à l'objectif général de
développement et de consolidation de la démocratie et de l'Etat
de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales »79.
Ensuite, l'article 25 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques de 197680, en qualité de
traité, crée des obligations légales exigeant des Etats le
respect de ses dispositions. L'article 25 de ce Pacte dispose que :
« tout citoyen a le droit et la possibilité
(....) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis ; de voter d'être élu, au cours d'élections
périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au
scrutin, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs
d'accéder, dans des conditions
générales d'égalité, aux
fonctions publique de son pays »81.
Cette disposition formule le droit et la possibilité
pour tout citoyen de participer à la gestion des affaires publiques,
directement ou par l'intermédiaire de représentants librement
choisis. Les éléments nécessaires à la tenue d'une
élection sont définis en termes généraux. La notion
de cycle électoral, et donc le droit permanent de participer à la
gestion des affaires publiques, est clairement introduite par
référence à des élections périodiques.
Toutefois, une telle disposition formelle serait difficilement applicable et
aurait un impact restreint, faute de droits politiques et du droit de faire
campagne qui caractérise des élections honnêtes. Le droit
à la participation politique présuppose l'adhésion
à des droits de l'homme fondamentaux tels que la liberté
d'expression, de circulation, de réunion pacifique et d'association qui
sont des éléments indispensables au monitoring des
élections ou du moins à une de ces variantes qu'est l'observation
du scrutin. Au niveau régional de l'Afrique, tout commence avec la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 28 juin 1981 accorde
seulement à ses citoyens « le droit de participer librement
à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement,
soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce,
conformément aux règles édictées par la loi
»82. Ce cadre régional africain ainsi que celui
universel ont été les seuls cadres de base sur lesquels de
nombreux acteurs ont pris appui pour déployer des
observateurs83 durant
78Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de
l'Homme, Centre pour les Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique
Centrale, Déclaration universelle des droits de l'Homme : 20 ans au
travail pour vos droits, Journée des Droits de l'Homme 2013,
(article 21), p. 13.
79 Pour plus de renseignements, consulter
www.europa.eu.int/ac/treaties_en.htm,
consulter le 15 mai 2014.
80 Adopté le 16 décembre 1966 par
l'Assemblée Générale des Nations-Unies.
81 Organisation des Nations Unies (ONU), Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PICDP), PDF,
Consulté sur le site
www.ohchr.org, p. 11.
82 Organisation de l'Unité Africaine (OUA),
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article 13), Nairobi, 28
juin 1981.
83 Il s'agit ici de GERDDES-Cameroun, ou encore
Hilaire Kamga, un expert sur les questions électorales et de
l'observation des élections que nous avons interrogé, ou encore
les responsables de l'ancien Comité National des Droits de l'Homme et
des Liberté aujourd'hui Commission Nationale des Droits de l'Homme et
des Libertés acteur ayant observé l'élection
présidentielle du 11 octobre 1992, lire à ce sujet Le livre
Blanc de la République du Cameroun sur l'Etat des Droits de l'Homme
au Cameroun, novembre 1993, lire aussi, Etongue Mayer (E. J),
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
l'élection présidentielle du 11octobre 1992.
Etant donné que le Cameroun est un Etat ayant adhéré
à tous ces instruments qui protègent les Droits de l'homme et la
démocratie au niveau universel d'une part et africain d'autre part.
Ayant ainsi ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous
les acteurs que nous avons pu rencontrer et qui ont pris part de manière
directe ou indirecte au moins à une élection
présidentielle se sont appuyés sur ces textes juridiques
internationaux, étant donné que les lois nationales sur la
question n'étant pas assez claires sur le monitoring des
élections en général et présidentielles en
particulier au Cameroun.
B. Le monitoring des élections
présidentielles : une pratique encadrée par le droit national
Conformément à la loi camerounaise n°91-20
du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des
députés à l'Assemblée nationale énonce que
« chaque liste de candidats peut désigner un
délégué par arrondissement, lequel a libre accès
dans tous les bureaux de vote de la circonscription. Il ne peut être
expulsé qu'en cas de désordre provoqué par lui. Mention en
est faite au procès-verbal. Il peut présenter à la
commission locale de vote des observations sur le déroulement du
scrutin. Ces observations sont consignées au procès-verbal
»84 , et par ailleurs la loi camerounaise 92/10 du 17
septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance
à la Présidence de la République, modifiée et
complétée par la loi n° 97/20 du 9 septembre 1997 et la loi
n°2011/002 du 6 mai 2011 énoncé qu' « il est
créé pour chaque bureau de vote une commission locale de vote
composée ainsi qu'il suit :
« Un représentant de l'administration,
désigné par le Préfet ;
· Membres ;
· Un représentant de chaque parti. A cet
effet, chaque candidat peut, au plus tard le sixième jour avant le
scrutin, désigner pour chaque bureau de vote son représentant
parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale
correspondant audit bureau »85.
La présence de ces représentants de candidats ou
de liste contribue à garantir l'impartialité du bureau de vote
dans la mesure où ils sont désignés par les candidats ou
listes en présence. Par exemple, en France, selon les termes de
l'article R. 42 du code électoral, chaque bureau de vote doit être
composé d'au moins quatre représentants. Dans le cas où le
nombre de représentants ainsi désignés est
inférieur à quatre, le bureau de vote est complété
à due concurrence par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau
ou, à défaut, par les électeurs parmi ceux présents
qui savent lire et écrire. Une irrégularité dans la
composition du bureau de vote peut entraîner l'annulation de
l'élection : ainsi, le refus d'un maire de confier la présidence
d'un bureau de vote à un conseiller municipal plus ancien dans l'ordre
du tableau traduit une présomption de fraude que doit sanctionner
l'annulation de l'opération électorale du bureau de
vote86.
« Le comité national des droits de l'homme et des
libertés au Cameroun », in Cahier africain des droits de
l'homme, n°9, Mai 2003, APDHAC, Yaoundé, Presses de l'UCAC,
2003, pp. 229-266.
84 Loi fixant les conditions d'élections des
députés à l'Assemblée Nationale , loi n° 91-20
du 16 décembre 1991, modifiée par la loi n° 97-13 du 19 mars
1997, in Code électoral édition revue et corrigée (1997),
Yaoundé, Imprimerie Nationale, 1997, p. 41.
85 Elections Cameroon, Présidentielle
2011, Recueil des textes législatifs et
réglementaires, Loi n°92/10 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à la
Présidence de la République, modifié et
complétée par la loi n° 97/20 du 9 septembre 1997 et la par
la loi n°2011/002 du 6 mai 2011, article 13 alinéa 1-9, pp. 8-9.
86 Kamga, (H), Op. cit., p.20.
19
20
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
A la différence des représentants, les
délégués des candidats ou des listes ne font pas partie du
bureau de vote. Le code électoral français dans son article L. 67
et R. 4787, permet à chaque candidat de désigner un ou
des délégués, ainsi que leurs suppléants, parmi les
électeurs du département. Il peut être
désigné un seul délégué pour plusieurs
bureaux de vote. Leurs noms doivent être portés à la
connaissance du maire dans les mêmes conditions que ceux des
représentants. Ils sont autorisés à être
présents en permanence dans les locaux où a lieu le scrutin. Ils
assurent ainsi, au nom des candidats, le contrôle des bureaux de vote. La
possibilité de désigner des délégués
étant un droit garanti par le législateur, elle ne peut
être indûment restreinte. Ainsi le maire ne peut pas refuser de
délivrer un récépissé de la liste des
délégués adressé par un candidat, même si la
liste ne comporte pas, pour chaque délégué, le
numéro et le lieu d'inscription sur les listes électorales, alors
que les articles R 47 et R 46 exigent que les délégués
soient électeurs dans le département. Au Cameroun par contre pour
assurer la gestion et le contrôle des élections, on est parti de
la loi qui prévoit des commissions locales et l'administration
d'après, la loi de 1992 sur les élections présidentielles,
institue des Commissions électorales locales (CEL), le
déroulement des opérations électorales doit être
organisé de façon à assurer la régularité du
scrutin. Pour assurer ce rôle, il est créé une institution
impartiale ad hoc. Son rôle est non seulement de veiller, à la
régularité et l'impartialité des élections, et
à ce titre elle contrôle les opérations
d'établissement de conservation et de révision des listes
électorales, mais aussi d'être informée de toutes les
réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes
électorales. Cependant, elle assure le contrôle et la distribution
des cartes électorales et ordonne toutes les rectifications rendues
nécessaires à la suite de l'examen.
Toutefois, aucune clause dans la loi électorale
camerounaise n'autorise la présence des observateurs non partisans dans
les bureaux de vote ; il n'y a non plus aucune loi qui exclut la
présence d'observateurs nationaux et internationaux88. En
réalité l'esprit de la loi vise plutôt à autoriser
de manière tacite leur présence. La responsabilité, au
niveau national, de la protection des droits de l'homme et des libertés
des populations, qui est clairement indiquée dans la
Constitution89, donne une latitude pour une présence
d'observateurs nationaux non-partisans pourvu qu'ils soient des
électeurs inscrits sur les listes du bureau de vote concerné. Au
pire des cas les observateurs nationaux non-partisans peuvent être
confinés au bureau de vote de leur localité où ils sont
automatiquement autorisés à travailler. Mais il serait juste, et
il appartient à l'Assemblée nationale de remanier la loi pour
permettre aux observateurs nationaux non-partisans de visiter par exemple cinq
bureaux de vote dans leur circonscription électorale et
d'élaborer des rapports sur le déroulement des opérations
dans ces bureaux de vote, pour permettre d'évaluer le processus
électoral dans le cadre d'un échantillonnage viable sur
l'ensemble du territoire national. En attendant, il n'y a aucun obstacle
réel à ce que les Sous-préfets et les commissions
électorales locales ne s'opposent pas à la présence
d'observateurs nationaux non-partisans90.
Il va sans dire, naturellement, que les observateurs doivent
se comporter avec le maximum de bon sens et de sérénité
pour ne pas remettre en question leurs missions. Il est recommandé, pour
éviter toute confusion au sujet du silence de la loi sur ce point
précis, et pour permettre la mise en oeuvre de l'esprit de la
Constitution,
87 Cité par Ndoumou, (F.D), Op cit.,
p. 371.
88 Kamga, (H), Op cit., p. 21.
89 Mouangue Kobila (J), « Le préambule
du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : de l'enseigne décorative
à l'étalage utilitaire », in Lex Lata, n°
23-24, février-mars 1996, pp. 33-38.
90 Kamga, (H), Op cit., p.22.
21
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
qu'il soit délivré aux observateurs des
documents d'accréditation écrits les autorisant à observer
toutes les opérations électorales sans restriction, tant qu'ils
ne s'ingèrent pas dans le processus ; il peut leur être fourni des
documents d'accréditation en qualité d'invités du
Sous-préfet ou du Chef de District91.
La loi ne se prononce non plus sur les observateurs
internationaux, mais n'exclut pas non plus leur présence. C'est une
pratique internationale générale acceptée que des
observateurs internationaux soient invités et qu'il leur soit
délivré des laissez-passer pour l'ensemble du territoire
national, par le Ministre de l'Administration Territoriale après avis du
Ministre des Relations Extérieurs, sans aucun frais pour le gouvernement
du pays hôte. Cette situation est celle des premières
années des élections multipartites au Cameroun, notamment les
législatives du 1er mars 1992 et la présidentielle de la
même année. Les lois sur les élections et en occurrence sur
le monitoring des élections n'y étaient assez claires sur les
observateurs nationaux comme internationaux. Les principales limites de ces
commissions électorales résident dans la définition de
leurs pouvoirs et de leurs compositions. On leur reproche aussi une certaine
lourdeur administrative. Il importe que les commissions électorales ne
disposent pas de compétences réelles et d'indépendance
face au pouvoir, afin de favoriser l'émergence de cette confiance du
peuple, indispensable à tout gouvernement démocratique. Les
commissions doivent, par exemple, avoir l'autorité de proclamer les
résultats de l'élection présidentielle et, ce
indépendamment de toute ingérence de la classe politique de
l'Etat.
Paragraphe 2 : Le monitoring des élections : une
pratique encadrée par des règles pragmatiques
Face à la routinisation progressive des missions de
monitoring des élections par d'autres organisations internationales,
ainsi que d'autres acteurs, et, surtout avec le travail des Nations unies et de
l'Organisation internationale de la francophonie en matière
d'observation électorale internationale, il y a une avancée
significative dans ce sens. Ainsi, l'adoption de la déclaration de
Bamako en 2000 et la publication de la Déclaration de principes pour
l'observation internationale d'élections et le Code de conduite à
l'usage des observateurs électoraux internationaux (A), ainsi qu'un
autre ensemble de convention entre les acteurs au niveau interne (B) en 2005,
se sont érigés comme documents de référence pour
toutes les missions d'observations électorales initiées par la
pluralité d'acteurs du monitoring des élections.
A. Les règles pragmatiques internationales : la
Déclaration de Bamako et la déclaration de principes pour
l'observation internationale d'élection et le code de conduite des
observateurs électoraux internationaux : cas des élections
présidentielles de 2004 et 2011
Bien qu'aucun instrument international n'impose l'observation
des élections ou ne réglemente les droits, les
responsabilités et la conduite des observateurs92, les «
bonnes pratiques » de nombreux acteurs ont conduit peu ou prou
à sa normalisation. Tant d'efforts on aboutit à l'adoption de la
Déclaration de Bamako ainsi la déclaration de principes pour
l'observation internationale d'élection et le
91 Cf. MINATD, sur les prérogatives des
Sous-préfets en période électorale entre 1992 et 2004.
92 Comillon, (P), Secrétaire
général de l'Union Interparlementaire, « Droits et
responsabilités des observateurs électoraux », document
présenté à la conférence internationale de la
Laguna sur la liberté des élections et l'observation
internationale des élections (Tenerife, 27 février-2 mars
1994).
22
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Code de conduite des observateurs électoraux
internationaux ouverts à la participation d'autres organisations
intergouvernementales et non gouvernementales. L'avantage de cette souscription
massive et ouverte à d'autres organisations réside dans le fait
que ces deux instruments couvrent toutes les régions du monde et les
principes contenus orientent et situent la place du monitoring des
élections93, et s'applique ainsi à toutes les
différentes élections. C'est en vertu de la Déclaration et
du Code de conduite précités que l'ensemble des acteurs
signataires du monitoring des élections agissent, bien entendu sur
invitation, pour les OIGs et sur accréditation pour les ONGs et de la
société civile internationale, de l'institution chargée
des opérations électorales dans un Etat. C'est sur la base de
cette Déclaration que de nombreux organismes de la communauté
internationale, tant institutionnels que non se sont déployés
lors de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004, et c'est
cette Déclaration qui a servi de base d'évaluation dudit
scrutin.
La Déclaration de Bamako, quant à elle, marque
un tournant décisif du travail effectué par l'Organisation
internationale de la francophonie en matière de démocratie et
notamment d'observation internationale des élections en dépit du
texte de Marrakech de 1996 consacré à la définition des
principes devant guider l'envoi d'une mission de monitoring des
élections. En effet, c'est elle qui donne un sens nouveau et une
portée novatrice au projet démocratique francophone, en ce
qu'elle ne nie pas la difficulté de la tâche, et ne minimise pas
les enjeux. Mais bien au contraire, elle assume cette difficulté tout en
affirmant les valeurs de la Francophonie.
Les missions de monitoring des élections des pays de la
Francophonie n'est dès lors pas aliénée par cette
Déclaration. Bien au contraire, celle-ci lui donne toute sa
valeur, parce qu'elle lui sert en définitive de cadre
juridique, mais aussi de repère
nécessaire en cas de « violation successive des
droits de l'homme »94. Ce texte présenté comme
exceptionnel démontre, en effet, que la problématique de la
séparation entre la
démocratie et la Francophonie n'est pas qu'un slogan
mais une véritable tension vers
un nouvel enracinement de l'organisation sur ses valeurs. Lors
de la mission exploratoire de septembre 2004 en prélude à la
préparation de l'élection présidentielle
du 11 octobre de la même année, cette mission
s'est appuyée sur cette déclaration pour évaluer le niveau
d'internationalisation de ladite déclaration95. Celle-ci a
servi de même base pour le scrutin présidentiel du 09 octobre
201196.
Ces règles pragmatiques universelles (soft law)
déterminent la définition de l'observation internationale dont la
substance demeure la même dans le cadre non universel. Ainsi, selon la
Déclaration de Bamako et la Déclaration des principes et
directives des Nations unies auxquelles adhèrent de nombreuses
organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales dont
l'Organisation des nations unies (ONU), l'Union africaine (UA), l'Union
européenne (UE), le NDI, le
93 Pour un approfondissement sur la portée
de l'observation internationale des élections lire la contribution de
Dodzi Kokoroko,(K), « La portée de l'observation internationale des
élections », in Démocratie et élections dans
l'espace francophone, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp.755-765.
94 Bourgi, (A), L'OIF et les processus
électoraux dans l'espace francophone, 2005 (inédit).
95 Lire à ce sujet le rapport des missions
exploratoire et d'observation proprement dite du scrutin présidentielle
du 11 octobre 2004. Cette mission exploratoire avait pour mandat de rencontrer
tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, à
savoir les autorités politiques et administratives, les responsables des
structures concernées, ceux des partis politiques, des organisations de
la société civile et des médias, afin d'établir un
état des lieux circonstancié des préparatifs de
l'élection, et d'identifier, sur la base des engagements et des
paramètres consignés dans la Déclaration de Bamako, les
domaines susceptibles de faire l'objet, en liaison avec les différents
partenaires au développement, d'un concours de la Francophonie,
notamment pour ce qui avait trait au renforcement des capacités des
structures impliquées dans le processus électoral.
96 Voir rapport joint OIF-UA, à l'occasion de
l'élection présidentielle du 09 octobre 2011.
23
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Centre Jimmy Carter conçoit ainsi le concept de
l'observation électorale internationale :
« (...) l'observation internationale des
élections est un élément de la surveillance internationale
du respect des droits de l'homme et, à ce titre, doit répondre
aux plus hautes exigences d'impartialité concernant les forces
politiques nationales et ne tenir compte d'aucune considération
bilatérale ou multilatérale contraire à ces exigences.
Elle consiste à évaluer les processus électoraux
conformément aux principes internationaux qui gouvernent les
élections honnêtes et démocratiques et au système
juridique du pays où ils se déroulent, étant entendu que,
en dernière instance, ce sont les citoyens qui
déterminent
la crédibilité et la légitimité
d'un processus électoral »97.
A travers cette Déclaration, l'Organisation
internationale de la francophonie démontre avec une grande
acuité, comme l'indique à juste titre Albert Bourgi, que
« La démocratie ne conduit jamais à une
stabilité qui se révèlerait rapidement illusoire : elle
est avant tout un mouvement qui doit sans cesse permettre des
améliorations, elles-mêmes fonction des circonstances. C'est ainsi
qu'il n'existe pas de mode de scrutin idéal et que dans les plus vieux
régimes démocratiques les règles varient parfois
considérablement
d'une élection à une autre (...)
»98.
B. Les règles pragmatiques internes : les
concertations entre les acteurs du processus électoral et l'adoption du
code de bonne conduite au processus électoral de 2011
En vertu des dispositions légales insuffisantes et
claires sur le monitoring des élections au Cameroun, et en vertu de la
loi portant création d'Elecam, il revient au Conseil électoral
(CE), la responsabilité d'organiser des concertations avec les autres
acteurs du processus électoral. Ledit organe a tenu une concertation
avec les acteurs du processus électoral le 29 septembre 2010, plus d'un
an avant l'élection présidentielle. Y ont pris part
l'administration, la justice, les partis politiques et les Organisations de la
société civile (OSC)99.
Cette assise avait pour objectif de lever des
équivoques et de dissiper les soupçons en vue d'un
déroulement apaisé du processus électoral et d'une
participation optimale de tous les acteurs. Les participants ont exprimé
leurs préoccupations sur divers aspects de la gestion du processus
électoral et reçu d'amples explications de la part du Conseil
électoral100. A l'issue de cette première
concertation, un projet de bonne conduite des acteurs du processus va
être abordé et soumis à la lecture de tous les participants
; c'est pour cette raison qu'une deuxième concertation sera
organisée un an plus tard, c'est-à-dire le 29 septembre 2011,
quelques jours avant l'élection présidentielle. A la suite de
cette concertation on va aboutir à l'adoption du code de bonne conduite
devant régir le comportement de tous les acteurs devant prendre part
à l'élection présidentielle de 2011. Ledit code
s'inscrit
97 Déclaration de Principes pour
l'observation internationale d'élections et le Code de conduite à
l'usage des observateurs électoraux internationaux. Cette
Déclaration ainsi que le Code de conduite sont hébergés
sur différents sites internet dont
http://eeas.europa.eu/human_rights/election_observation/docs/code_conduct_fr.pdf,
consulté le 10 mai 2014.
98 Bourgi, (A), L'OIF et les processus
électoraux dans l'espace francophone, 2005 (inédit).
99 Elections Cameroon, Rapport
général sur le déroulement de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011, p.
26.
100Elections Cameroon, Rapport
général sur le déroulement de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011, p.
27.
24
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
en droite ligne de la Constitution, ainsi que de l'ensemble
des instruments juridiques internationaux notamment la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union
africaine (CADEG-UA), que le Cameroun a ratifié en juillet 2011, quelque
mois avant l'élection présidentielle. Les signataires dudit
document ont pris l'engagement formel de le respecter
scrupuleusement101. Les jalons étaient par conséquent
posés pour une gestion sereine des candidatures (voir en annexe le code
de bonne conduite ainsi que la liste des signataires).
Hormis les concertations entre le Conseil électoral
d'Elections Cameroon, les acteurs de la société civile nationale
entre eux ont établi de nombreux accords pour assurer un meilleur
déploiement sur le terrain. C'est par exemple le cas de la mise sur pied
en janvier 2010, avec l'appui du Programme des nations unies pour le
développement dans le cadre du projet de renforcement des
capacités nationales en Droit de l'Homme piloté par la Commission
nationale des droits de l'homme et des libertés (CNDHL), du
Réseau camerounais des organisations des droits de l'homme (RECODH).
Celui-ci compte en sein environ 60 organisations à sa constitution en
2010 et va coordonner en 2011, une équipe de 179 observateurs sur
l'ensemble de l'étendue du territoire national. C'est aussi le cas de la
coalition mise sur pied entre l'ONG Un monde avenir (1MA)102 et un
ensemble d'organisations dans les dix régions, à l'occasion de
l'élection présidentielle du 09 octobre. Cette coalition a
coordonné une équipe de 700 observateurs.
Cette section cherchait à expliciter les règles
normatives du monitoring des élections et partant des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011. Les règles qui
ont été appliquées à ces scrutins ont
été à la fois normatives, c'est-à-dire un ensemble
d'instruments juridiques internationaux et nationaux, ainsi qu'un ensemble de
règles pratique relativement récente du monitoring des
élections. Cet encadrement des différentes élections peut
donner lieu à un encadrement des élections présidentielles
au Cameroun. Cela s'applique donc à notre étude qui est comme
nous l'avons souligné, les élections présidentielles au
Cameroun de1992 à 2011. Depuis les années 90, en période
de l'effondrement du bloc soviétique, et la vague de
démocratisation qui s'en est suivie, la promotion de la
démocratie est devenue un impératif à la fois pour des
organisations internationales à caractère intergouvernemental ou
non, des agents politico-administratifs de l'Etat, des Organisations de la
société civile nationale. Ces organisations constituent un
ensemble hétérogène d'acteurs qui oeuvrent au
succès des missions de monitoring des élections tels que nous
l'avons dit. Par leur méthodologie et leurs habitudes de terrain, ces
différents acteurs ont façonné au fil des années un
monitoring des élections. Comme preuve il y a les quelques documents
officiels comme la Charte internationale des droits de l'homme,
constituée de la DUDH et de la PIDCP jusqu'aux Déclaration de
Bamako de 2000 dans le cadre des pays ayant en commun l'usage de la langue
française ; et de la Déclaration de principes de l'observation
internationale des élections et du Code de conduite à l'usage des
observateurs électoraux internationaux de 2005, pour l'ensemble des pays
du système des Nations unies en sont l'aboutissement.
101 Lire à ce sujet Elections Cameroon, (Conseil
Electoral), Le Code de bonne conduite des acteurs du processus
électoral au Cameroun, Yaoundé, 20 septembre 2011.
102 ONG Un Monde Avenir, Mission d'Observation Electorale
de présidentielle du 9 octobre 2011, rapport national d'analyse, p.
4.
25
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
SECTION 2 : LE MONITORING DES ELECTIONS : UNE PRATIQUE
STRUCTUREE PAR DES ENJEUX MULTIPLES
Le monitoring des élections présidentielles se
structure autour de multiples enjeux. Une analyse des faits laisse
transparaître un ensemble d'enjeux de la part des acteurs du monitoring
des élections, notamment les Etats-Unis et la France, à
l'occasion de l'élection présidentielle du 11 octobre 1992. Pour
comprendre ces enjeux, il convient d'analyser d'une part les enjeux
politico-stratégiques, (Paragraphe 1) et d'autre part les enjeux
économiques et culturels (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le monitoring des élections : une
pratique structurée par les enjeux politiques et stratégiques
économiques cas de l'élection présidentielle de 1992
L'élection présidentielle du 11 octobre 1992 au
Cameroun nous servira de cadre d'analyse les enjeux politiques et
stratégiques (A), d'une part et d'autre part des enjeux
économiques et culturels (B), à la fois des Etats-Unis et de la
France.
A. Les enjeux politiques du monitoring des
élections : Cas de l'élection présidentielle de 1992
Le Cameroun représente un enjeu politique et
avéré pour de nombreux acteurs du monitoring des
élections, notamment les Etats-Unis et la France. Situé au plan
géographique à la charnière respectivement de l'Afrique
Centrale et Occidentale, de l'Afrique francophone et anglophone, «
pièce centrale » de la zone CEMAC, ce pays s'identifie en
un maillon important de la zone d'influence française en Afrique
noire103.
Dans le cadre de l'élection présidentielle du 11
octobre 1992, les enjeux politiques des Etats-Unis et de la France sont
considérés comme vitaux dans la mesure où leur
négligence compromettrait la sécurité de la nation, voire
son existence en tant qu'entité souveraine104. Pendant que la
France jouait la carte de l'incertitude, la stratégie américaine
était la recherche de nouveaux partenaires sociaux. Dans une large
mesure, cette recherche est consubstantielle au double visage
hégémonique et pragmatique de la politique
étrangère des Etats-Unis et de la France depuis la fin de la
guerre froide. En effet, dans un texte de janvier 1995 qui définit la
« stratégie de sécurité américaine,
d'engagement et d'élargissement », le Président Clinton est
formel :
« La ligne de partage entre les politiques
intérieure et extérieure est en train de disparaître. Nous
devons revitaliser notre économie si nous voulons préserver nos
capacités militaires et notre influence à l'étranger. II
nous faut nous engager activement sur la scène internationale, si nous
voulons voir s'ouvrir des marches et se créer des emplois pour
les travailleurs
américains»105.
Ainsi, en s'engageant en faveur de 1'instauration d'une «
démocratie de marché » en Afrique en général
et au Cameroun en particulier, la diplomatie américaine joue à
fond le jeu de la préservation de l'intérêt national. Car,
pourquoi ne
103 Sur la création et le maintien d'une zone
d'influence française en Afrique, lire, entre autres, Djoba, (S), Les
interventions militaires françaises en Afrique Centrale : Etude de cas
(Gabon, Zaïre, Centrafrique et Tchad), Thèse de Doctorat
3ème Cycle en Relations Internationales, Université de
Yaoundé, IRIC, 1987, p. 138.
104 Bonnefous (M), «Les enjeux nationaux : quelques
repères», in Défense Nationale, janvier 1991, p.
141.
105 Faure, (M), « Le Monde selon Washington », in
L'Express, n° 2329, du 22 au 28 février 1996, p. 23.
26
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
pas reconnaître que la libre entreprise,
consubstantielle à la démocratie favorise la promotion des
investissements d'un pays dont les entreprises sont en mesure de rivaliser avec
n'importe quelle autre entreprise exerçant en Afrique ? Au Cameroun,
l'on a pu relever à la fois une certaine sympathie américaine
à l'endroit de l'opposition radicale et une tendance à traiter
directement avec les acteurs sociaux non officiels. Ainsi, l'on a vu
l'activisme de 1'ambassadeur américain d'alors, madame Frances Cook en
faveur du SDF et la condamnation, sans réserve, de l'instauration de
l'état d'urgence dans la province du Nord-ouest par la
déclaration du Département d'Etat du 13 novembre 1992
susmentionnée. Par ailleurs, il y a lieu de signaler les multiples
tournées de monsieur Ni John Fru Ndi aux Etats-Unis et surtout son
invitation à assister à la cérémonie de la
première investiture du Président Clinton le 20 janvier
1993106.
Cette main tenue en direction des acteurs non officiels
participe de la multiplication des occasions de contact ou d'échange
avec le « pays réel » en dehors du carcan officiel
pas trop formaliste. Les activités de l'Agence américaine
d'information et des relations culturelles (USIA) participent, à n'en
pas douter, de l'opération de charme en direction de toutes les
composantes de la société camerounaise. En effet, cet important
organisme gouvernemental s'emploie à apporter aux ressortissants
Grangers, une meilleure connaissance des Etats-Unis et des valeurs propres
à la société américaine107. Ainsi qu'en
est-il des différents programmes des visiteurs étrangers aux
Etats-Unis, destinés non seulement à permettre une meilleure
connaissance des aspects formels et informels du système politique
américain, mais aussi à favoriser le maximum de relations avec la
diversité d'acteurs officiels et privés au cours d'un
périple de s'étalent généralement sur
différents Etats de la fédération ?
Pour son soutien aux acteurs non officiels lors de
l'élection présidentielle du 11 octobre 1992, une
délégation d'une ONG américaine le NDI, composée de
19 membres, a effectué une mission d'observation au Cameroun. A l'issue
de la proclamation, par la Cour Suprême le 23 octobre de la même
année, de la victoire du Président Biya, le NDI publia un rapport
qui critiquait assez sévèrement, à 1'instar des prises de
position de l'Ambassadeur américain de l'époque, les conditions
d'organisation et le déroulement effectif de la consultation. Dans ce
rapport, il apparaît que :
« le NDI a obtenu des preuves irréfutables et
tangibles qu'avant le scrutin, les hauts responsables de l'administration ont
été informés que leurs compétences devraient
être appréciées en fonction du nombre des voix obtenues par
le candidat président Biya dans les territoires relevant de leur
compétence juridictionnelle respective. Consigne leur avait
été donnée de tacher d'obtenir un score de 60% par tous
les
moyens possibles »108.
106 Le cerveau de CAP - Liberté, Dominique Djeukam
Tchameni fut accueilli aux Etats-Unis comme exilé politique après
avoir été condamné à 20 (vingt) mois
d'emprisonnement pour ses relations suspectes avec des ex-officiers rebelles de
1'Armée camerounaise installés au Burkina - Faso.
107 L'USIA constitue avec l'USAID, le Corps de la paix,
l'Agence Centrale de Renseignement (CIA), l'Agence pour le Contrôle des
Armements et le Désarmement (ACDA), l'Administration des Petites
Entreprises, l'Action, la Banque Export-Import (EXIMBANK) et le Bureau du
Personnel (OPM), 1'ossature des Agences gouvernementales chargées
d'assurer, à côté des 14 Départements ou Ministres,
Certains Aspects Particuliers du Fonctionnement de l'appareil Administratif
Américain. Afrique - Etats-Unis, n° 10/89. 31 octobre 1989, pp.
6-7. 108Les Droits de l'Homme au Cameroun. Livre Blanc publié
par le Gouvernement de la République du Cameroun, Yaoundé, les
Editions de l'Imprimerie Nationale, 1994, Lors de l'élection
présidentielle du 11octobre 1992, cette ONG, sur invitation du
gouvernement du Cameroun a organisé une mission d'experts internationaux
en matière d'élections qui s'est rendue au Cameroun, p. 243.
27
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
On peut, tout de même, se poser la question de savoir si
telles étaient les instructions du pouvoir, pourquoi le
candidat-Président n'a-t-il finalement obtenu qu'un score aussi modeste
(40% environ des suffrages exprimées), largement en deçà
du pourcentage donné par le NDI?109
B. Les enjeux stratégiques des acteurs : Cas de
l'élection présidentielle de 1992
Dans le domaine des activités militaires, au sens
large, l'on peut signaler l'existence d'une assistance militaire
américaine dans le cadre de 1'International Military Education and
Training (IMET) pour lequel des dotations de 0,275 million de dollars et de
0,100 million de dollars furent allouées au Cameroun respectivement en
1991 et 1996. Il y a lieu de mentionner la formation des personnels cadres et
1'équipement des forces armées camerounaises pour laquelle aucun
chiffre n'est donné. De plus aucun accord formel ne lie le Cameroun et
les Etats-Unis dans le domaine de la coopération
militaire110.
Prisonnière des considérations
géostratégiques, la France ne veut pas prendre le risque de
soutenir la démocratisation du continent, démocratisation
susceptible de remettre en cause ses intérêts sur le continent.
Mais pour contenter l'opinion africaine, elle adopte une posture
progressiste111 : « Le discours de la Baule, abusivement et
surtout idéologiquement considéré comme le
détonateur du processus de démocratisation en Afrique
»112, n'est rien d'autre qu'un exercice
géostratégique de transformation des contestations politiques
africaines du début des années 1990 au mieux des
intérêts de la France. Dans le même temps, pour des raisons
géostratégiques, elle ne pouvait courir le risque de voir les
populations africaines devenir maîtresses de leur destin politique et par
conséquent, les Etats de son pré-carré s'émanciper
de sa tutelle politique, stratégique et économique au moment
même où, après avoir déclaré le nouvel ordre
mondial, les Etats-Unis venaient de proclamer la libre concurrence politique
entre les anciens de la guerre froide.
Soulignant cette duplicité française, monsieur
Jean Pierre Cot, ancien ministre français de la coopération
affirmait que « c'est très caractéristique de la
politique française (en Afrique) et notamment celle de monsieur
François Mitterrand que de tenir, d'un côté, un discours
généreux, d'entretenir des espoirs, et d'autre part, de
pérenniser une pratique qui vise exactement le contraire
»113. En clair, malgré ses prises de position en
faveur de la démocratisation du continent, la France devait garantir la
survie de ses « amis fidèles », même au prix du
maintien des Etats africains dans l'immobilisme et l'archaïsme politique.
De la survie politique des régimes africains dépendait la survie
des intérêts français en Afrique.
109 Lire à ce sujet le rapport de la mission
internationale des observateurs du NDI, Election présidentielle du 11
octobre 1992 au Cameroun, p 245-246, op cit. Lire aussi la déclaration
post-électorale préliminaire du 14 octobre 1992 et du Rapport
provisoire de la Mission d'Observateurs Internationaux du NDI aux
présidentielles du 28 octobre 1992.
110 Ebolo (M-D), Op.cit.,p. 57.
111 Fogue Tedom, (A), Enjeux géostratégiques
et conflits géopolitiques en Afrique Noire, Paris, L'Harmattan,
collection Défense, relation internationale, 2008, p. 109.
112 Ibidem, pp. 14-15.
113 Fogue Tedom, (A), Op. cit., p. 109.
28
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Paragraphe 2 : Les enjeux économiques et culturels
du monitoring des élections : cas des élections
présidentielles de 1992 et de 1997
L'enjeu peut s'entendre comme la chose pour la possession ou
le contrôle duquel une entreprise est engagée114. C'est
ce que l'on gagne ou perd dans un jeu. Dans le cadre du présent travail,
il s'agit d'analyser tour à tour les enjeux économiques (A) et
les enjeux culturels (B) des acteurs du monitoring.
A. Les enjeux économiques des acteurs du
monitoring des élections
L'analyse des relations franco-africaines depuis la
période des années 90 laisse paraître un soutien multiforme
et quasi permanent de la France aux régimes
africains. Cela se vérifie par exemple à travers
l'élection présidentielle de 1992 au Cameroun. A l'issue de cette
première élection présidentielle pluraliste, qui mettait
aux prises Monsieur Paul Biya, soutenu par la France et Monsieur Ni John Fru
Ndi
soutenu par la diplomatie américaine, Monsieur LeFloch
Prigent, président d'ELF de l'époque fait des déclarations
selon lesquelles c'est avec l'appui de sa compagnie que
le président Paul Biya a pu s'imposer115.
Par ailleurs, après la longue période de défiance
née après l'élection présidentielle de 1992 et afin
de mieux servir leurs intérêts dans le pays, les Etats-Unis
décident de changer d'attitude et de cohabiter harmonieusement avec le
pouvoir de Yaoundé. Le soutien américain au régime du
président Paul Biya s'illustre à la veille de
l'élection présidentielle de 1997. Redoutant les trucages
électoraux, l'opposition refuse de se présenter devant les
électeurs, tant
que les garanties de transparence ne seront pas données
par le pouvoir. Dans l'espoir que les Etats-Unis fassent pression sur le
président Paul Biya pour garantir la transparence du scrutin, un des
leaders de l'opposition, Monsieur Samuel Eboa
rencontre le successeur de Madame Frances Cook (ancienne
ambassadrice des Etats-Unis au Cameroun) qui lui répond que «
c'est la stabilité politique du Cameroun qui
intéresse les Etats-Unis et non le soutien à
tel ou tel candidat ou formation politique »116. Selon
Alain Fogue Tedom :
« la réponse du diplomate américain, en
fait un revirement au regard de 1992, (...) et annonçait par le fait
même le renoncement de son pays par rapport à sa volonté
initiale et officielle de ramener aux africains en même temps que le
libéralisme économique, la démocratie. Elle
dévoilait la réconciliation intervenue entre le gouvernement
camerounais et les intérêts américains. C'est donc sans
surprise qu'après la création en 1999 de la multinationale
américaine EXXONMOBIL, fruit de la fusion d'ESSO et de MOBIL, jusqu'ici
limité en Afrique Noire dans le raffinage et la distribution, on
apprendra qu'elle a obtenu des autorités camerounaises le permis de
prospecter du pétrole sur deux gisements off-shore : Ebodjé et
Ebomé Marine »117.
114 Dictionnaire encyclopédique, Paris, Quillet,
1985, p.878.
115 Fogue Tedom (A), Op.cit., p. 82.
116 Fogue Tedom, (A), Op.cit, p. 84.
117 Idem.
29
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
B. Les enjeux culturels du monitoring des
élections
Les positions culturelles de ces acteurs notamment les
Etats-Unis et la France sont appelées à s'étoffer. En
effet, ces pays ont été les principaux clients du Cameroun entre
1990 et 1993118. Cette relative prospérité des
échanges commerciaux semble liée à la priorité
accordée au commerce au détriment de l'aide à l'Afrique
par l'administration de Monsieur Bill Clinton.
De par son caractère biculturaliste, le Cameroun
constitue un enjeu culturel non négligeable à la fois pour les
anglophones et les francophones. En effet, certaines sources avaient
confié que l'administration du président Georges Bush père
souhaitait « ardemment une scission du pays en zone francophone et
anglophone, d'où le soutien massif apporte à l'homme de Bamenda
»119. Certes, il est difficile d'attester de la
fiabilité d'une telle allégation. Pourtant, l'on doit
reconnaître que le processus de construction de l'empire
démocratique universel120 donne lieu à un affrontement
culturel susceptible d'engendrer des conflits internationaux121.
Il paraît évident que la politique
étrangère des Etats-Unis d'après la chute du mur de Berlin
ait considérablement changé la façon de penser la
politique et de penser les politiques. Il ne fait non plus de doute que le
partage d'une langue bien qu'instrument de communication puisse tout aussi
être l'un des moyens les plus importants de transmission et de partage
d'une certaine culture122.
Au plan culturel, le Cameroun est un champ d'influence non
négligeable pour les acteurs du monitoring des élections,
notamment les américains et les français qui les puissances en
rivalité au Cameroun pendant l'élection présidentielle
anticipée du 11 octobre 1992 cela a conduit a assisté à la
confrontation entre l'offensive de l'angloculturelle ici
représenté par les Etats-Unis au détriment de la
francophoculturelle représenté par la France.
118 En effet, ces pays ont occupés les rangs de
sixième client du Cameroun en 1990-1991, puis cinquième en
1991/92 et 1992/93, pour se stabiliser au sixième rang en 1993/94 et
1994/95. Pour les produits comme le café robusta, le beurre de cacao, le
caoutchouc naturel et, bien entendu, le Pétrole brut qui sont les
principaux produits exportes par le Cameroun vers les Etats-Unis et la France.
Du troisième rang en 1990/91 et 1991/92, les Etats-Unis et la France
sont passés au quatrième rang des fournisseurs du Cameroun en
1992/93 avant de se retrouver au deuxième rang en 1993/94 et 1994/95,
cf. à ce sujet document de l'ancien Ministère de l'Economie et
des Finances, notamment la Direction de la Statistique et de la
comptabilité Nationale, 1996, voir aussi GATT, Cameroun : Examen des
politiques commerciales, 1995, vol. I et II, Tableau 3, pp. 172-174.
119 Africa Intemational, n°. 260, avril 1993 p.
14.
120 Valladao (A.G.A), Le XXème siècle sera
américain, Paris, la Découverte, 1993, p. 148.
121 Huntington, (S.P), "The clash of civilization?", in
Foreign Affairs, Summer 1993, vol. 72, n°3, pp. 22-49.
122 Monney Mouandjo, (S), Op.cit., p. 271.
30
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CONCLUSION PARTIELLE
Ce chapitre est fondamental dans la mesure où il permet
de restituer les règles qui encadrent et les enjeux qui structurent le
monitoring des élections présidentielles depuis 1992 jusqu'en
2011. Il nous permet de comprendre la construction d'un phénomène
politique. En effet, il nous a permis de comprendre que le monitoring des
élections est une pratique encadrée par des règles
juridiques à la fois internationales et nationales, d'une part ; et
d'autre part par des règles pragmatiques tant internationales que
nationale d'autre part.
Ensuite, le monitoring des élections
présidentielles est aussi une pratique aux enjeux multiples ; il
convient donc de dire que d'un point de vue stratégique, les enjeux qui
structurent cette pratique sont à la fois politiques,
géostratégiques et aussi économiques et culturels qui
peuvent mettre en accord des puissances hier, et en désaccord
aujourd'hui.
31
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CHAPITRE II : RESSOURCES ET LOGIQUES DU MONITORING DES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU CAMEROUN
« Un groupe électique de personnes issues de
milieux divers se trouvent derrière ces activités d'observation.
Mais elles ont un point commun : leur compétence, des années
d'expérience, un esprit et leur dévouement. »123
S'il est facile de discuter des règles des enjeux et du
monitoring des élections, il l'est moins en ce qui concerne les
ressources ainsi que les logiques de la dynamique de mise en oeuvre des
missions de monitoring des élections présidentielles. Les
missions de monitoring des élections présidentielles ne peuvent
en effet être comprises que dans la dynamique réelle des
circonstances particulières à chaque élection et à
chaque pays124. Dans le cas du Cameroun et en ce qui concerne les
élections présidentielles, il s'agit donc pour nous d'affirmer
que comprendre la dynamique de mise en oeuvre des élections qui
s'applique aux élections présidentielles, c'est comprendre
comment est organisée l'élection du Président de la
République au Cameroun. La dynamique de mise en oeuvre du monitoring des
élections présidentielles peut ici être intéressante
parce qu'elle permet d'examiner les questions liées aux ressources des
acteurs du monitoring des élections présidentielles et à
leur inégalité (Section 1), et ensuite d'analyser le
déploiement réel des acteurs sur le terrain (Section 2).
SECTION 1 : LES TYPES RESSOURCES ET LES INSUFFISANCES
DES ACTEURS DU MONITORING DES ELECTIONS
L'organisation et le déploiement des missions de
monitoring des élections présidentielles recours à la
mobilisation des ressources à la fois financière, humaine et
matérielle (Paragraphe 1), l'organisation d'un scrutin
présidentiel peut mettre en évidence certaines insuffisances
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les types de ressources des acteurs du
monitoring des élections
L'organisation des élections, tout comme leur
monitoring nécessite des ressources à la fois financières
(A), humaines (B) et matérielles (C). Ces ressources permettent aux
acteurs d'assurer une bonne préparation d'une part et d'autre part un
bon déploiement sur le terrain.
A. Les ressources financières
Les ressources financières pour le monitoring des
élections, pour certains acteurs, proviennent de l'Etat, du moment
où l'organisation des élections incombe à l'Etat, à
travers le Ministère de l'administration territoire et de la
décentralisation (MINATD). Elles sont prélevées dans le
budget de l'Etat, c'est-à-dire du contribuable125. Ces fonds
camerounais, ces fonds sont généralement destinés
à
123 Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (OSCE), L'observation des élections,
p.5.
124 Monney Mouandjo, (S), Op. cit., p. 283.
125 L'imprimerie nationale avait réalisé en dix
jours, cinquante millions de bulletins de vote pour les huit candidats en lice.
Quatre-vingt-dix tonnes de papier et des équipes de travail se sont
relayées 24/24 heures pour préparer ce scrutin. Mais il faut dire
qu'aucun chiffre n'est clairement avancé pour dire combien a
coûté
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
l'organisation matérielle des élections. En
année électorale l'élaboration d'un budget des
élections, après l'évaluation des besoins et les
estimations des dépenses par opération, est assurée par le
MINATD du moment où est encore ce département ministériel
qui était en charge de l'organisation des élections comme ce fut
le cas lors de la première élection présidentielle
anticipée du 11 octobre 1992, ou encore celle du 12 octobre 1997 et le
11 octobre 2004126. Au-delà des dépenses liées
à l'informatisation des opérations électorales, le budget
des élections a permis au MINATD d'acquérir du matériel
pérenne127. En ce qui concerne les acteurs non
étatiques comme la société civile nationale ou
internationale, les ressources financières pour le monitoring de
l'élection présidentielle anticipée du 11octore 1992 leurs
ont été octroyées par leurs organismes de leur budgets de
fonctionnement. C'est le cas du Comité national des droits de l'homme et
des libertés, qui est une institution indépendante de
l'administration mais qui fonctionne sur le budget de l'Etat voté par
l'Assemblée nationale (AN) ; par contre le NDI, une Organisation non
gouvernementale américaine qui reçoit les fonds dans sa
quête de promouvoir la démocratie dans le monde. Ces ONGs
américaines sont chargés de déposer un rapport
auprès ce département d'Etat américain à la fin de
leur mission de monitoring des élections ; c'est pour cette raison que
nous pensons que les acteurs non officiels comme ces ONGs sont le prolongement
de la politique américaine dans les Etats et leur intervention peut
conduire à des changements dans ces Etats-là. Les ressources
financières d'autres acteurs comme les institutions diplomatiques
accréditées au Cameroun viennent des fonds liés à
la promotion de la démocratie128. A l'occasion de
l'élection présidentielle du 11 octobre 2004, hormis le budget
voté par l'Etat pour la préparation de ce scrutin, l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF) a mis à la disposition du
Cameroun une somme d'un montant de 53.000 milles euros, soient environ
34.765.721 millions de francs CFA destiné à un appui financier
à l'organisation matérielle de cette
élection129. De nombreuses organisations de la
société civile camerounaise qui ont participé au
monitoring de cette élection l'on fait sur fonds propre, d'autres avec
l'appui financier et des appels à fonds des programmes de certaines
organisations internationales comme la Délégation aux droits de
l'homme de l'OIF, qui a appuyé des ONGs à travers son fonds
d'appui à la démocratie et à la société
civile130.
Seules les ressources financières ne suffisent pas pour
mener à bien une mission de monitoring des élections ; d'autres
ressources sont aussi importantes telles que les ressources humaines et
matérielles.
l'organisation des élections présidentielles au
Cameroun depuis celle de 1992. Par contre, en ce qui concerne les autres
élections c'est-à-dire les élections couplées
législatives et municipales de 2002 ainsi que les partielles qui s'en
sont suivies on les évalue à 17. 761.529.943 FCFA en terme de
dépenses ; le double scrutin du 22 juillet 2007 quant à lui a
coûté un peu plus de 26.803.344.958 FCFA, Lire à ce sujet
Abdoulkarimou, Op.cit., pp. 124128.
126 Abdoulkarimou, Op.cit.,p. 125. Lire aussi le
rapport de l'administration et le rapport du NDI, sur l'élection
présidentielle anticipée du 11 octobre 1992.
127 Idem.
128 Voir Ebolo (M-D), « L'implication des
puissances occidentales dans les processus de démocratisation en Afrique
: analyse des actions américaine et française au Cameroun
(1989-1997) », in Polis, Revue camerounaise de Science politique,
vol. 1, Numéro spécial, février 1996, pp. 51-56.
129 Cf. Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
Rapport de la mission d'observation de l'élection
présidentielle du 11 octobre 2004, p. 28 ; lire aussi, La
Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL),
Le Rapport Général sur l'observation de l'élection
présidentielle du 11 octobre 2004.
130 L'Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF), Election présidentielle du 11 octobre 2011 au Cameroun,
p. 4.
32
33
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
B. Les ressources humaines
La disponibilité des ressources humaines peut
constituer un meilleur déploiement des observateurs sur le terrain. Mais
cependant, une mission de monitoring doit recruter un personnel pour se
déployer sur le terrain. Cette ressource humaine, est souvent issue soit
des membres des organisations qui sollicitent observer les élections,
soit parmi la population. Dans le cadre de l'élection
présidentielle du 11 octobre 1992, l'ONG américaine NDI, sur
invitation du gouvernement a déployé un panel d'experts
internationaux, appuyés par des acteurs locaux de la
société civile, des partis politiques. Ces observateurs se
déploient sur le terrain, dans une zone bien délimitée par
une accréditation131 qu'ils reçoivent du MINATD, pour
les OSC nationales et internationales. Par contre, pour déployer leurs
observateurs, les OIG comme le Commonwealth, la Francophonie, l'Union africaine
ou encore tout autre représentation diplomatique
accréditée au Cameroun, une invitation du Cameroun suffit et fait
office d'accréditation ; c'est le cas de l'OIF à l'occasion de l'
élection présidentielle du 11 octobre 2004, à la suite de
l'invitation des autorités de la République du Cameroun, par une
lettre en date du 7 mai 2004 de Son Excellence François-Xavier
Ngoubeyou, alors ministre d'Etat chargé des Relations
Extérieures. Le Secrétaire Général de l'OIF, Son
Excellence Abdou Diouf a décidé d'envoyer une mission
d'observation au Cameroun pour cette élection
présidentielle132, mission que présidait un ancien
Président de la République par intérim, ancien Premier
Ministre et ancien Président de la Haute Cour Constitutionnelle de
Madagascar, composée de personnalités d'Afrique133.
Pour les organisations locales qui s'impliquent dans le monitoring des
élections présidentielles, leur personnel se recrute tout d'abord
parmi leurs membres, et aussi parmi des citoyens de différents horizons,
par des appels à candidatures pour le recrutement des observateurs pour
une élection ou une autre. Dans le cadre de l'élection
présidentielle du 11octobre 2011, l'ONG Un monde avenir (1MA) a
lancé un appel à candidature pour recruter des
observateurs134 ; il existe un profil type que ces organisations
recherchent chez les personnes qu'elles recrutent, mais une fois retenus et
pour leur assurer une meilleure qualité de la collecte d'informations le
jour du scrutin, les observateurs doivent suivre une formation et celle-ci
porte sur le cadre juridique applicable à l'élection
présidentielle, sur les techniques d'observation des élections,
les différentes opérations électorales ou encore le
contentieux électoral135. Toujours dans le cadre de cette
élection présidentielle, la CNDHL a reçu un renforcement
de capacités de la part des experts de l'OIF, qui portait
essentiellement les techniques de l'observation des
élections136. Ces formations permettent à tous les
observateurs d'être imprégnés à la fois sur
l'environnement de l'élection présidentielle et, par
conséquent, de bien comprendre leur rôle, leurs
responsabilités sur le terrain. C'est le même scénario pour
toutes les autres organisations locales impliquées dans le monitoring
des élections. Cependant, les OIG, elles, ont besoin d'un personnel
assez compétent pour leurs missions. Pour elles, la compétence
131 Voir en annexe la procédure d'obtention des
accréditations au MINTAD pour déployer des observateurs sur
le terrain.
132 L'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
Le rapport de la mission d'observation de l'élection
présidentielle du 11 octobre 2004, p. 4.
133 Idem.
134 Cf. Les termes de références d'1MA, pour la
sélection des observateurs électoraux pour l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011. Voir aussi en annexe
les conditions à remplir ainsi que les pièces à fournir
pour faire partir d'une mission nationale de monitoring des
élections.
135 Lire à ce sujet CNDHL, Le rapport
général sur l'observation de l'élection
présidentielle du 11 octobre 2004, p 11.
136 Idem.
34
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
présente un critère majeur requis pour faire
partie d'une mission de monitoring des élections présidentielles.
Si le critère de compétence n'est pas forcément
obligatoire pour les observateurs nationaux, à l'inverse des
observateurs internationaux, tous sont soumis à l'indépendance,
à l'impartialité et surtout à la
neutralité137.
C. Les ressources matérielles
Il s'agit de la mise en place de tout le matériel
nécessaire à la conduite régulière d'une mission de
monitoring des élections et au travail des observateurs : conception des
formulaires, manuels de formation, fiches de décompte des
voix138. Ces fiches permettent de récolter des informations,
la liste des bureaux de vote de la zone d'accréditation de
l'organisation. Le matériel des observateurs de terrain est aussi
constitué de l'ensemble des textes juridiques régissant
l'élection présidentielle, ainsi que du code de conduite de
l'observateur. Depuis l'élection présidentielle de
2004139, le MINTAD met à la disposition de tous les
observateurs accrédités ces deux documents, qui sont la base de
travail des observateurs. Cependant, en ce qui concerne les Organes de gestion
des élections (OGE), les ressources matérielles pour
l'organisation et le monitoring des élections, il s'agit ici d'une
diversité d'objets dont l'usage est indispensable dans les bureaux de
vote concurremment avec les documents électoraux pertinents. C'est une
exigence de la loi électorale qui a l'avantage de garantir certains
fondamentaux de la démocratie, à savoir, la transparence et la
sincérité du scrutin, la liberté du choix, le secret du
vote. Ce matériel est composé d'isoloirs, de pagnes pour
l'isoloir, de scellées, de sacs à rebuts, des boîtes
d'encre indélébiles, de machines à calculer, de lampes
tempêtes et de badges d'identification ; de véhicules pour les
agences départementales, de motos tous terrains pour les antennes
communales, de groupes électrogènes, d'urnes, d'ordinateurs,
d'imprimantes de grande capacité140.
C'est pratiquement le même matériel
électoral qui a toujours été produit lors des
élections présidentielles au Cameroun depuis 1992, avec des
variances en moins. La présidentielle du 09 octobre 2011 a
été la toute première qui a vu la participation des
camerounais de la diaspora, suite à la loi n° 2011/013 du 13
juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais établis ou
résidant à l'étranger.
Paragraphe 2 : Les insuffisances structurelles et
conjoncturelles des ressources
L'organisation, la gestion ou encore le monitoring des
élections présidentielles ou toute autre élection
connaît des insuffisances d'une part structurelles (A) et d'autre part
conjoncturelles (B).
A. Les insuffisances structurelles
Pour se déployer sur l'arène du monitoring d'une
élection présidentielle, il faut une planification des acteurs de
cette activité, qu'il s'agisse des OGE, des OIG, des OSC tant nationales
qu'internationales. Si les OGE, bien structurer c'est-à-dire une
137 Code de conduite de l'observateur, à l'occasion de
l'élection présidentielle du 09 octobre 2011. Lire aussi la
déclaration de principes pour l'observation internationale
d'élections et le code de conduite à l'usage des observateurs
électoraux internationaux, pp 6-10.
138Brothers, (J), Soeryadinata Wibawa, (A), Fenzel,
(M), Méthodes systématiques pour faire avancer l'observation
électorale, disponible en ligne PDF, sur le site
www.ndi.org consulté le 14 mai
2014.
139 Il faut dire c'est depuis les élections
couplées législatives et municipales de 2002, que le MINATD, met
à la disposition des observateurs l'ensemble des lois d'une
élection ainsi que le code de conduite de l'observateur, mais que c'est
en 2004, que cela a été fait dans le cadre d'une élection
présidentielle.
140 Elections Cameroon, (ELECAM), Rapport
général sur le déroulement de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011, p 29.
35
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
organisation du sommet à la base et
représentatif sur l'étendue du territoire national et dispose
d'un personnel parfois peu mal qualifié pour gérer le processus
électoral. Cependant on relève quand même des insuffisances
structurelles liées à ces OGE. Ces insuffisances, il convient de
signaler à ce titre, peuvent être liées à l'arrimage
du nombre de démembrements territoriaux au découpage
administratif qui réduit considérablement l'efficacité des
antennes communales dans le cadre d'ELECAM141. Les acteurs qui
connaissent le plus de problèmes d'insuffisances structurelles sont des
OSC nationales. Certaines d'entre elles n'ont pas assez de membres ou
d'observateurs. Durant la préparation de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011, certaines organisations n'ont obtenu
des accréditations que pour dix observateurs. Cela dénote d'un
niveau de structuration assez truffé de failles. Nos recherches dans le
cadre de cette étude nous ont conduit à découvrir que
certaines de ces organisations n'ont pas de siège officiel, ne dispose
même pas parfois d'un rapport d'activités annuel142.
L'ONEL par exemple, ne disposait pas de démembrements territoriaux sur
l'ensemble du territoire pour mieux se déployer sur le terrain et mieux
faire le monitoring des élections présidentielles. Elle a
dû recruter et utiliser de personnes sur le terrain pour assurer
certaines fonctions dans les bureaux de vote143.
B. Les insuffisances conjoncturelles
Ces insuffisances sont d'ordre humain, matériel et
financier, et peuvent être considérées comme des obstacles
à la fois internes et externes aux missions de monitoring des
élections présidentielles. Le financement des observateurs
nationaux ne pose pas grand problème. Ceux-ci peuvent être
considérés comme des bénévoles. Ils militent pour
la cause de leur parti ou de leur candidat. Ensuite, ils sont choisis ou
délégués par rapport à leur proximité avec
le bureau de vote. Par contre, les missions de monitoring des acteurs
internationaux nécessitent des frais de voyage et de séjour. Les
déplacements dans le pays sont généralement à la
charge de l'OIG ou de l'ONG qui a été invitée ou qui a
sollicité les accréditations pour se déployer sur le
terrain144. Tous les acteurs ne disposent pas toujours des
mêmes moyens pour se déployer sur le terrain. Il faut dire
qu'avant l'élection présidentielle du 09 octobre 2011, l'ONG
Transparency international-Cameroon (TI-C) avait signé un contrat avec
la délégation de l'Union européenne à
Yaoundé d'un montant de 196 millions de francs CFA pour observer et
assurer le suivi de l'élection présidentielle prévue en
2011 afin de s'assurer que le scrutin serait libre et
transparent145.
Par contre on estime à vingt un milliards (21) de
Francs CFA le montant dépensé par ELECAM pour organisation de la
même élection de 2011. Il faut dire que dans l'ensemble des
élections organisées au Cameroun entre 1992 et 2011, près
21.149.185.225 (vingt milliards cent quarante-neuf millions cent
quatre-vingt-cinq mille deux vingt-cinq)146. La logistique
administrative et technique pose bien de soucis, quant au monitoring des
élections : contact des observateurs à inviter,
141 Lire le rapport général sur le
déroulement de l'élection présidentielle du 09 octobre
2011, p. 85.
142 Il y a des OSC, qui n'existent que sur les papiers et dans
la mallette du président, qui est à la fois le président,
le Secrétaire Général ; bref le président
représente tout dans l'organisation.
143 Lire à ce sujet le rapport de CNDHL, Election
présidentielle du 11 octobre 2004, p. 16.
144 Ces précisions sont faites dans le code de conduite
des observateurs qu'élabore le MINIATD depuis l'élection
présidentielle du 11 octobre 2004, cf. Abdoulkarimou, Op.ct. ,
pp. 88-89.
145 Nguiamba, (E. P), « Cameroun
présidentielle 2011:l'Union Européenne donne 196 millions CFA a
Transparency International Cameroun »,
www.journalducameroun.com,
mis en ligne le 28 juillet 2011, consulté le 10 juin 2014.
146 Abdoulkarimou, Op.cit., pp. 124-125.
36
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
réservation dans les avions, les hôtels, demande
de visas147 causent de grands problèmes lorsque les
observateurs ont été accrédités. Si certains
aspects peuvent être réglés au niveau des OIG
concernées, d'autres par contre ne se résolvent que sur le
terrain. Il faut donc un personnel spécialisé, compétent
et dévoué. Ce qui n'est pas du tout facile car une mission de
monitoring selon les standards a besoin d'un minimum de
compétence148 et dévotion. Ce qui n'est pas du tout
car l'équipe d'une mission de monitoring des élections doit
généralement être diversifiée et composée de
juristes, d'experts d'avocats... En outre, certaines demandes sont parfois
très courtes, entravant ainsi des institutions dans le choix des
observateurs149.
Tout ce qui précède rend évidemment plus
difficile le travail des observateurs dont la bonne volonté et le
courage sont difficilement indéniables. Les acteurs sont donc bien des
fois obligés de se limiter à quelques régions ou villes
lors de la sollicitation des accréditations de leurs observateurs. Les
travaux de ces missions indiquent d'ailleurs à ce propos que
« pour l'aspect qui nous intéresse à
savoir les moyens destinés au monitoring des élections
présidentielles, pour le cas de l'OIF et d'autres OIG n'a jamais
disposé (et ne dispose pas) en la matière de personnel cadre
à même de prendre à côté du premier
responsable en charge la tâche de conception, d'orientation,
d'encadrement et de gestion que d'un expert
»150.
Il faut préciser que ces problèmes autrefois
évoqués restent encore actuel et s'ajoutent à d'autres
tout aussi importants.
SECTION 2 : LES LOGIQUES CONTRASTEES DU MONITORING DES
ELECTIONS : LA DYNAMIQUE DE MISE EN OEUVRE DU MONITORING DES ELECTIONS
Cette dynamique commence par une répartition des
rôles à l'intérieur de la mission et par la
définition d'une stratégie de travail. Cette phase est
très importante parce qu'elle constitue le coeur même de toute la
stratégie de monitoring des élections présidentielles.
C'est en effet elle qui donne le ton de l'observation. Elle se divise en deux
étapes majeures : à savoir le déroulement des missions de
monitoring des élections (Paragraphe 1) et la fin de la mission de
monitoring des élections présidentielles (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le déroulement de la mission de
monitoring des élections Le déroulement de la
mission de monitoring des élections commence d'abord par les
activités préélectorales (A), ensuite les activités
électorales (B), et enfin par les activités
post-électorales (C).
147 A l'occasion de l'élection présidentielle
anticipée du 11 octobre 1992, certains même de l'équipe des
experts du NDI n'ont pas pu arriver au Cameroun pour défaut de visa, et
parfois même ceux qui avaient un visas il était de très
courte durée, lire le rapport provisoire, p. 65.
148 Le chef de la mission, le chef adjoint de la mission,
l'analyste électoral, l'analyste juridique, l'analyste politique, le
spécialiste des medias, le statisticien, le coordinateur des
observateurs à long terme, le responsable financier, le responsable de
liaison parlementaire, lire à ce sujet Le manuel des missions
d'observation électorale de l'Unions Européenne, disponible
sur
www.ue.org consulté le 13 juillet
2013, 132 p, PDF.
149 La francophonie donne un délai de trois mois avant
la tenue des élections, Voir document portant « principes directeur
devant guider l'envoi ou le déploiement des missions de monitoring des
élections, document adopté par le CFP en sa
2ème session, les 12 et 13 novembre 1996 ; Voir aussi
Karlheinz, (N), « Bilan de l'observation des élections
», in Liberté des élections et observation
internationale des élections, p. 117, The OSCE/ODIHR, Election
oservation Handbook, 2ème Edition, 1997.
150Karlheinz, (N), « Art. cit.»,
pp.11-12.
37
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
A. Les activités
préélectorales
Les préliminaires à la tenue d'une
élection présidentielle depuis 1992 au Cameroun ont
impliqué de nombreux acteurs tant nationaux qu'internationaux. Ces
activités commencent essentiellement par l'inscription sur les listes
électorales151. Pour l'élection présidentielle
de 2004, une refonte des listes électorales a été
ordonnée par le Ministre d'Etat en charge de
l'administration territoriale et de la décentralisation (MINATD), car
une nécessité d'un toilettage, voire d'une
reconstitution des listes électorales s'imposait,
notamment en vue d'une bonne organisation de l'élection
présidentielle, préalable à l'informatisation
envisagée du fichier électoral152. Cette
opération a été la même pour l'élection
présidentielle du 09
octobre 2011, par ELECAM. Pendant cette période de
l'opération d'inscription, de révision ou de refonte des listes
électorales les OSC impliquées dans le monitoring
des élections présidentielle ont pour rôle
veiller à ce que seules les citoyens camerounais et en âge de
voter soient véritablement enregistré153. Il en est de
même pour la gestion des candidatures154, la
détermination et la localisation des bureaux de vote155, la
production et la mise à la disposition des électeurs des listes
électorales pour la consultation, l'établissement et la
distribution des cartes d'électeurs ainsi que l'impression et
l'acheminement des bulletins de vote et de campagne156.
Pour la première fois dans l'organisation d'une
élection présidentielle, ELECAM, à travers la DGE, a
conçu et mis à la disposition des antennes communales des
documents électoraux adaptés, véritables supports
matériels des opérations de
révision des listes électorales, conformes aux
dispositions légales. Ces documents sont constitués :
« des listes électorales issues du fichier de
2007, des carnets de récépissés d'inscription à
délivrer aux nouveaux inscrits, les registres d'inscription
réservés aux électeurs nouvellement inscrits, tableaux de
modification permettant de procéder à la mise à jour des
listes électorales existantes, tableaux de radiation permettant
d'extirper des listes électorales existantes
151 Dans un premier temps et aux termes des lois 91/020 du 16
décembre 1991 relative aux élections des députés et
92/010 du 17 septembre 1992 relative à l'élection du
présidentielle, l'inscription se déroulent annuellement du 1er
janvier au 30 avril de chaque année ; lire aussi Abdoulkarimou,
Op.cit., pp. 98-99.
152 Arrêté n°014/A/MINATD/DAJC du 22 janvier
2004. Cette Arrêté demandait à tous les chefs
d'unités administratives de faire tenir au MINATD, toutes les deux
semaines, une évaluation chiffrée des opérations de
refonte des listes électorales et de porter à la connaissance du
chef de ce département ministériel, le cas échéant,
les difficultés rencontrées dans ce processus.
153 Lire les rapports des acteurs suivants : 1MA, CNDHL,
MOETI-C, RECODH, MC, SNJP, relative aux inscriptions notamment pour les
élections présidentielle de 1992, 1997, 2004, 2011.
154 Selon la loi électorale sur l'élection
présidentielle, ces déclarations de candidature doivent se
déposer au plus tard le 25ème jour
précédant le scrutin. Les déclarations, revêtues de
la signature légalisée des candidats, doivent indiquer les nom,
prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des
intéressés, ainsi que la couleur, le sigle et le titre choisi
pour l'impression des bulletins de vote et campagne (Voir en annexe la
composition des dossiers de candidature à l'élection
présidentielle et la liste de déclaration des candidatures
à l'élection présidentielle depuis 1992 à 2011).
155 A l'occasion de l'élection présidentielle du
11 octobre 1992, on comptait 13100 bureaux de vote, pour celle du 11 octobre
1997 on en dénombrait 17000 bureaux de vote, alors qu'en 2004, le nombre
de bureaux de vote est passé à 23.000 ; c'est le même de
bureaux de vote que l'on a aussi dénombré pour l'élection
du 09 octobre 2011 :lire Nkainfon Pefura (S), Le Cameroun du multipartisme
au multipartisme, Collection Points de vue concrets, Edition L'Harmattan,
1996, p. 230.
156Elections Cameroon (ELECAM), Rapport
général sur le déroulement de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011- Direction Générale
des Elections (DGE), p. 41.
38
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
les noms des personnes
décédées157 ou ayant perdu la
capacité
électorale »158.
Ensuite, ces activités ont aussi consisté
à la mise en place des commissions de révision des listes
électorales, et a connu une faible participation des autres acteurs du
processus électoral. Aussi, ELECAM, dans le cadre de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011, amené des campagnes de
sensibilisation avec pour objectif de mobiliser les électeurs en faveur
d'une participation effective et massive au scrutin présidentiel de
2011. Il s'agit d'amener la population à rompre avec son apathie
électorale, observées à la faveur des scrutins
précédents, afin d'accomplir en toute conscience le devoir
civique, celui de choisir son Président de la République. La
stratégie adoptée par la DGE a consisté en une
communication tous azimuts, axée sur une campagne d'explication et
d'information. Des messages adoptés ont été
diffusés à travers une multitude de canaux médiatiques
tels : la radio, la télévision, la presse et le
web159. L'élection présidentielle de 2011 a
été la toute première au cours de laquelle on a pris en
compte l'approche genre. S'agissant de cette approche genre, ELECAM a
fondé sa gestion de la période préélectorale sur un
accès égalitaire des femmes et des hommes à toutes les
étapes. Plusieurs stratégies ont été conçues
et mises en oeuvre.
En matière de handicap, sur l'ensemble des
électeurs inscrits sur les listes électorales de
l'élection présidentielle du 09 octobre 2011, l'on
dénombrait 8367 personnes handicapées160. Dans le
souci d'informatisation du fichier électoral, et grâce à la
coopération entre le Cameroun et les partenaires au
développement, le PNUD fera un don à ELECAM, le 03 mai 2010, d'un
logiciel de gestion des opérations électorales,
élaboré par un cabinet d'experts camerounais. Ce logiciel,
dénommé « Système d'information et de gestion
cartographique des élections (SIGE)», a été au
préalable suffisamment sécurisé et paramétré
avant d'être déployé sur l'ensemble des 58 centres
départementaux de saisie et de traitement informatique des
données électorales mis en place par ELECAM161. En
vertu des dispositions légales en la matière, ELECAM, à
travers le Conseil électoral (CE) a organisé une première
concertation avec les autres acteurs du processus électoral, notamment
le 29 septembre 2010 à Yaoundé, concertation au cours de laquelle
ont pris part l'administration, la justice, les partis politiques et la
société civile. Une deuxième concertation a ensuite
été organisée un an plus tard en septembre 2011, au cours
de laquelle un code de bonne conduite a été signé par tous
les acteurs y ayant pris part.
En ce qui concerne la CNDHL, la phase préparatoire a
été marquée par les activités de sensibilisation,
d'informatisation et de participation à la révision du fichier
électoral, les inscriptions sur les listes électorales, les
activités de campagne et la distribution des cartes
d'électeurs162. Ces sont les mêmes activités
qu'ont menées respectivement la Mission d'observation électorale
de Transparency international-Cameroon (MOE TI-C) ainsi que le Réseau
camerounais des organisations des droits
157 Pour réussir cette opération d'exclure les
personnes décédées le PNUD avait fourni un logiciel
à l'ELECAM pour mener à bien une opération de toilettage
du fichier électoral.
158 Elections Cameroon (ELECAM), Rapport
général sur le déroulement ..., pp. 22-23.
159 Ibidem, p. 22 ; lire aussi Ndoumou (F-D), Op.cit.,
p. 114.
160 Ibidem), p. 25.
161 Parmi les fonctionnalités dudit logiciel, celles
qui ont été utilisées ont permis à ELECAM de
prendre en compte, entre autres, la gestion des nouvelles unités
administratives créées à la suite de l'éclatement
de certaines communes, bureaux de vote existant en 2007, la dislocation du
fichier électoral de 2007 en 360 fichiers communaux,
l'intégration des fichiers communaux disloqués, le traitement des
doublons, l'établissement des listes électorales
révisées et fiables ainsi que l'établissement des cartes
d'électeurs correspondantes et des listes de bureaux de vote.
162 Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDHL),
Rapport général de l'observation de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011, pp. 9-13.
39
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
(RECODH) ou encore l'ONG Un monde avenir (1MA)163.
A l'occasion de l'élection présidentielle anticipée du 11
octobre 1992, les activités préélectorales du NDI ont
essentiellement consisté à la formation à la fois des
scrutateurs en faveur des partis politiques et des observateurs issus des OSC.
Cette formation a pu se faire avec la collaboration du Groupe d'études
et de recherches sur la démocratie et le développement
économique et social en Afrique (GERDDES-Afrique), organisation
régionale, non-partisane, pour la démocratie et le
développement. Toutefois, dans le cadre des missions de monitoring des
élections des OIG, l'OIF, les activités
préélectorales de l'OIF ont porté sur le
déploiement d'une mission exploratoire164et celle de l'UA
Mission d'évaluation des besoins (MEB).
Les missions exploratoires sont des missions mandatées
avant la tenue effective du scrutin. Le principe N°3 du texte de 1996 de
Marrakech indique que si mandat a été donné à
L'ACCT165, tenant compte de chaque situation, cette mission
exploratoire a notamment pour tâches :
a. De collecter l'ensemble des textes et documents
pertinents, afférents à l'élection présidentielle,
(constitution, déclaration, statut et programme des partis, loi
électorale, etc.) ;
b. D'analyser :
? les mesures prises ou envisagées en vue de cette
consultation ; ? le contexte et environnement sociopolitiques166
;
c. De remettre un rapport au président du Conseil
permanent de la Francophonie par l'intermédiaire du Secrétaire
Général de l'ACCT sur le contexte général et
particulier de cette consultation de manière à préciser
les modalités optimales de l'intervention de la communauté
francophone. C'est donc à l'issue de cette mission et après en
avoir analysé le rapport que le Conseil permanent de la Francophonie ou
son président décide sur avis de la commission politique de la
suite à donner à la mission exploratoire.
Ces précisions faites par le principe directeur-3
mérite néanmoins quelques éclairages tant certains termes
restent pour le moins équivoques et ce, notamment au paragraphe C
où on peut lire : « remettre un rapport au président du
Conseil permanent de la Francophonie par l'intermédiaire du
Secrétaire général de l'ACCT sur le contexte
général et particulier de cette consultation de manière
à préciser les modalités optimales de l'intervention de la
communauté francophone ». Il y a dans cette énonciation une
grande ambiguïté dans l'idée de préciser les
modalités optimales de l'intervention de la communauté
francophone surtout lorsqu'on sait le nombre de consultations
électorales décriées de part et d'autre simplement parce
que les populations n'ont pas forcément compris le sens de
l'intervention des observateurs mandatés. Il faut dire ici qu'une telle
énonciation peut signifier, sans faire de procès d'intention
à institution francophone, autant une intervention partisane, qu'une
intervention de transparence optimale. Les quelques cas de missions
d'exploration non suivies de missions d'observation jusqu'alors en notre
163 Cf. à ce sujet les rapports de fin de mission
d'observation de l'élection présidentielle du 09 octobre 2011.
164 En 2004, une mission exploratoire avait été
envoyée au Cameroun.
165 Agence de Coopération culturelle et technique.
166 Voir à ce sujet le rapport de la mission
exploratoire à l'occasion de la préparation de l'élection
présidentielle du 11 octobre 2004.
40
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
possession n'ont malheureusement pas été des
exemples de réussite pas plus qu'ils n'ont été des
exemples de mascarades absolues en témoignent notamment la mission
d'exploration, au Cameroun, du 24 au 31 juillet 2004.
Certaines organisations vont plus loin, en accordant une
importance sur le rapport des missions exploratoires. L'OSCE, l'OIF et l'UA
estiment que cette mission doit précéder la véritable
mission d'observation167. Les donneurs de fonds ou des organisations
qui parrainent l'envoi des missions d'observation estiment que la
période préélectorale sera le meilleur moyen pour eux de
juger s'il faut ou non allouer les fonds pour une quelconque mission
d'observation le jour du scrutin.
Il est vrai que la période préélectorale
est aussi délicate que le jour du scrutin.
Aujourd'hui la vieille technique de bourrage des urnes est en
train de tomber en désuétude avec la présence
d'observateurs nationaux et internationaux. L'attention
devrait être portée sur le découpage
électoral et les listes électorales (opérations
préalables pour la tenue d'un scrutin). Certains pays connaissent encore
des difficultés liées à l'absence d'un fichier
d'état civil. Aucune différence n'est faite entre un majeur en
âge de voter et un mineur, entre un « étranger » et un
« national »168. Mais un auteur considère que
« les membres de la mission exploratoire ne se
contentent pas de collecter les textes élaborés par les
autorités locales, mais plutôt suggèrent, voire imposent,
une approche, un ensemble de textes et de techniques qu'ils maîtrisent
déjà. Le code électoral, le découpage des
circonscriptions électorales, l'encre indélébile, les
urnes, les bulletins de vote, les enveloppes, etc., sont en fait
arrêtés par la mission exploratoire »169.
Ne serait-il pas une reconnaissance factuelle ou un
mérite pour cette pratique « occidentale » ? Par ailleurs la
méconnaissance, même sommaire, des moeurs du pays de la part des
observateurs de la mission exploratoire qu'évoque cet auteur n'a pas de
sens. Il suffit qu'il se rapporte au principe directeur 4 du document de base
de son texte sur la composition d'une mission: « L'équipe
d'observateurs doit assurer une représentation satisfaisante des
différents régions qui composent la Francophonie, avec une
attention particulière à la représentation des pays du sud
»170. Notre auteur s'est tout simplement limité au
principe directeur 3. Aucune mission n'est imposée, toutes, mêmes
exploratoires, doivent recevoir une accréditation du pays
hôte171. La veille ou quelques jours avant l'élection
proprement dite, la mission se répartit le territoire par groupes. Ces
derniers procèdent à la reconnaissance des bureaux de vote avec
une attention particulière sur le mode de couverture des campagnes, la
forme de la communication et notamment la présentation des listes
électorales. C'est une phase importante dans la mesure où on a
quelquefois reproché aux missions de ne se concentrer que sur quelques
grandes villes et de présenter des rapports très partiels.
167 Après une mission exploratoire, les OIG n'ont plus
besoin de déployer des Observateurs Long Terme (OLT). Elles
déploient une petite équipe le jour du scrutin, constituée
des Observateurs Courts Termes (OCT).
168 Agence de la Francophonie, consultations
électorales Afrique 1990-1997, sessions d'échanges à
Bordeaux en 1995 et à Dakar en 1997, pp. 19-45.
169 Ouattara (F.N), «L'observation des élections
en Afrique», in Revue de la recherche juridique, droit
prospectif, 1998, 23ème année, n° 72, pp.
301-325.
170 Document portant « principe directeur devant guider
l'envoi d'une mission d'observateur des élections », p. 4.
171 L'une des rares missions exploratoires qui s'est
présente dans un pays hôte sans invitation est celle conduite par
la Fédération Internationale des Droits de l'Homme et la
Fondation Danielle Mitterrand à l'occasion des élections du 29
novembre 1987 en Haïti. Voir rapport de la mission avec Alain Raymond et
J.C Fougue.
41
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
L'enjeu de cette opération de repérage
préalable des bureaux de vote par les missions de monitoring des
élections est justement de mieux préparer une observation en
bonne et due forme par le moyen d'une descente effective sur le terrain le jour
du scrutin.
A. Les activités électorales proprement
dites
Que ce soit les scrutins présidentiels du 11 octobre
1992, du 11 octobre 1997, du 11 octobre 2004172 ou encore du 09
octobre 2011, du temps du MINATD, de l'ONEL ou encore de l'ELECAM, la mission
confiée à ces organisations était pour ainsi dire,
à son paroxysme : l'organisation, la gestion et la supervision des
opérations de vote. Le défi majeur consistait à assurer le
bon fonctionnement de tous les bureaux de vote établis sur
l'étendue du territoire national à l'occasion des scrutins
présidentiels, du déroulement des opérations de vote des
opérations de dépouillement des élections
présidentielles (le respect des horaires d'ouverture et de
clôture, le déroulement des opérations de vote, le
dépouillement du scrutin et la transmission des résultats).
L'heure d'ouverture d'une élection, fut-elle
présidentielle est fixé par décret convoquant le corps
électoral173. Elle est généralement
fixée à huit heures. Dans la pratique, l'heure ainsi fixée
n'est pas toujours respectée. En effet, dans de nombreux cas, des
intempéries et aléas sont à l'origine de l'arrivée
tardive du matériel, d'une partie du matériel, du
président ou d'un membre de la commission locale de vote. A l'occasion
de l'élection présidentielle du 11 octobre 1992 par exemple, les
bureaux de vote avaient ouvert avec un retard à Tibati à cause de
l'accident du véhicule transportant le matériel
électoral174. Quant au déroulement du vote, avant le
début des opérations de vote, les contrôles d'usage sont
faits et des concertations rapides ont généralement lieu. Le plus
important de ces contrôles a trait à l'examen de l'urne. L'urne
est ainsi ouverte et présentée aux différents membres du
bureau de vote, ainsi qu'aux observateurs présents. Lorsque l'urne en
bois était encore utilisée175, elle était
ensuite fermée et les clés des cadenas remises à des
personnes différentes176.
Après toutes les vérifications, le premier
électeur rentre dans le bureau de vote. Il est procédé
à la vérification de son identité et à sa
présence sur la liste électorale. Il prend par la suite
lui-même les bulletins de vote des différents candidats en lice
pour
172 La mission d'observation s'est déployée sur le
territoire du Cameroun, selon la répartition ci-dessous, ce qui
lui a permis de visiter, 303 bureaux de vote aussi bien en ville
qu'à la campagne. Les annulations de vols
intérieurs l'ont malheureusement empêchée de
se rendre dans les provinces du Nord.
Mme Agathe Okumba d'Okwatsegue, Provinces du Centre et du
Littoral
et M. Bertrand Salifou (Yaoundé À Douala)
MM Assane Seck et Théophile Adoua, Province du Sud et MM.
Pierre Scharff et Jean Claude Hounyvi,
Province de l'Est
MM. Norbert Ratsirahona et Province du Centre
MM. Xavier Michel (appui technique) et Abraham Zinzindohoue,
Province du Littoral
Mohamed Traore (appui technique) (Douala)
MM. Gustave Dodin et Roger Mengue, Province du Nord-Ouest
M. Dominique Caillaud, Province de l'Ouest
David Bongard (appui technique)
M. Rosario Marchese, Province du Sud-Ouest
Abdoulaye Diarra (Limbé)
173 Lire décret n°2011/277 du 30 aout 2011 portant
convocation du corps électoral en vue de l'élection du
Président de la République.
174 Cameroon tribune du 1 novembre 1992.
175 Les urnes en bois ont été utilisées pour
la dernière fois lors de l'élection présidentielle du 11
octobre 1997.
176 L'on imagine un seul instant les difficultés
supplémentaires qu'engendrait l'introduction du bulletin de vote unique
qui, avec des candidatures multiples, pourrait bien atteindre des mètres
!
42
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
le scrutin, ainsi qu'une enveloppe vide, et se dirige vers
l'isoloir ou il met le bulletin de son choix dans l'enveloppe et jette les
autres dans le sac-poubelle prévu à cet effet. A sa sortie de
l'isoloir, il fait constater aux membres du bureau de vote qu'il n'est porteur
que d'une enveloppe qu'il introduit dans l'urne. Il appose ensuite son
empreinte digitale qu'il a au préalable trapper dans un bocal d'encre
sur sa carte d'électeur, à l'endroit prévu à cet
effet, et appose sa signature sur la liste électorale
d'émargement. Il est important de relever qu'en zone rurale, et parfois
même en zone urbaine, des électeurs ne savent pas toujours comment
voter. D'où des questions du genre « qu'est-ce que je dois faire ?
», posées régulièrement le jour de l'élection.
Cette situation a pour conséquence les lenteurs constatées
parfois dans les opérations de vote. D'où ce constat fait par un
candidat, monsieur Garga Haman Adji, lors de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011 : « chaque électeur, pris
individuellement, prend plus de trois minutes. Conséquence, on risque de
ne pas faire la moitié des électeurs avant 18 heures ».
La suspicion entre le président de la commission locale
de vote et les membres représentants des partis politiques et des
candidats, ceux de l'opposition particulièrement, est à l'origine
de l'ambiance électrique qui règne parfois au sein des bureaux de
vote. Au fil du temps, ces relations sont devenues de plus en plus conviviales.
Lors de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004 par exemple,
l'on a vu le représentant local du Social democratic front (SDF) relayer
l'information faisant état du nombre insuffisant des bulletins de vote
du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) dans la zone
de Bonamoussadi-Douala.
En principe, le vote prend fin à 18 heures. Aucun
électeur arrivé après cette heure ne doit plus voter. Par
contre, les électeurs présents devant le bureau de vote à
cette heure sont admis à voter. L'heure de la fin des opérations
de vote est mentionnée sur le procès-verbal. Le
dépouillement le décompte se font dans le bureau de vote, en
présence des électeurs qui le désirent, des observateurs
encore présents dans ledit bureau, dans la mesure où la salle
peut les contenir. L'urne est ouverte et les bulletins de vote sont
comptés. Un scrutateur extrait, l'un après l'autre, les bulletins
des enveloppes, les passe à un autre qui lit à haute voix le nom
du candidat. Deux scrutateurs relèvent les résultats sur une
feuille de pointage. Les procès-verbaux de dépouillement sont
rédigés sur place, et chacun des membres de la Commission locale
de vote en reçoit un exemplaire, celui détenu par les
représentants du MINATD d'abord, de l'ONEL ensuite, d'ELECAM depuis la
dernière élection présidentielle de 2011. Cette innovation
date de la création de l'ONEL et de l'ELECAM. Elle était un
acquis, voire, un gage de transparence et une limite aux fraudes. Lors des
premières échéances électorales au Cameroun, entre
1992 à 2011, l'on a noté des situations ou, pour des raisons
diverses, les urnes étaient transportées à la
Sous-préfecture pour le dépouillement. Cette situation, bien que
prévue par la loi, est en voie de disparaître.
Traditionnellement, le MINATD faisait une déclaration
le soir des élections pour présenter au public un bilan global du
déroulement des élections. C'était
généralement l'occasion pour lui de remercier tous les acteurs du
processus électoral et d'annoncer, si possible, les premières
tendances issues des urnes177.
177 Parce qu'elle peut influer sur les résultats, la
publication des tendances méritait d'être encadrée par la
loi, ce d'autant plus que la proclamation des résultats relève
d'institutions bien précises.
43
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
B. Les activités post-électorales
Les activités post-électorales résument
toues les modalités de proclamation des résultats et de la
gestion du contentieux post-électoral. Elles relèvent de la
compétence de certaines institutions qui, suivant un canevas bien
précis, déclarent élu un candidat. Pour les
élections, objet de la présente recherche, le Cameroun a
opté pour un scrutin majoritaire uninominal à un tour. A ce
titre, est déclaré élu à l'issue du scrutin, le
candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, la majorité pouvant
être absolue ou relative. Le Conseil constitutionnel est l'institution
compétente pour proclamer les résultats de l'élection
présidentielle178. Entre 1992 et 2011, quatre
élections présidentielles ont été organisées
au Cameroun. En ce concerne les résultats des élections
présidentielles au Cameroun voir en annexe du présent
mémoire.
Au lendemain de l'élection présidentielle du 11
octobre 1992, une confusion avait été créée par la
publication des chiffres attribuant la victoire au candidat Monsieur Ni John
Fru Ndi tandis que l'annonce des tendances par le MINAT faisant état de
l'avance du candidat Monsieur Paul Biya179. La proclamation des
résultats est d'abord faite au niveau de chaque bureau de vote. Ensuite,
sur la base des procès-verbaux à elle transmis par la commission
locale de vote, la commission départementale compile les
résultats au niveau départemental. Elle transmet par la suite les
résultats et procès-verbaux à la commission nationale de
recensement général des votes. Ainsi, au vu des
procès-verbaux et des pièces annexés, la commission
nationale de recensement général des votes analyse les
différents résultats, corrige éventuellement les erreurs
matérielles et transmet tous les procès-verbaux et pièces
annexés au Conseil constitutionnel qui proclame les résultats
officiels et définitifs. Les résultats officiels proclamés
par la Cour suprême donnaient la victoire au candidat Monsieur Paul Biya
avec 39,97% des suffrages valablement exprimés. L'élection
présidentielle suivante, celle du 12 octobre 1997, a marqué le
triomphe du candidat Paul Biya, sans doute fait de l'absence des grosses
pointures de l'opposition tels Messieurs Ni John Fru Ndi, Bello Bouba et Adamou
Ndam Njoya. L'échec du mot d'ordre de boycott lancé par ces
leaders et le fort taux de participation (81,35%) a donné plus de
légitimité et facilité la tâche au candidat Paul
Biya, d'être réélu avec plus de 92% des voix.
La présidentielle de 2004 a confirmé
l'implantation nationale du RDPC et le triomphe de son candidat arrivé
en tête dans toutes les provinces du Cameroun, à l'exception du
Nord-Ouest. Monsieur Ni John Fru Ndi pour sa part a confirmé son
hégémonie, tout en maintenant sa présence dans l'Ouest et
le Littoral. L'UDC réalisa son meilleur score dans la province de
l'Ouest, notamment dans le Noun. En l'absence de monsieur Bello Bouba
Maïgari, principal challenger dans les trois provinces septentrionales
(Adamaoua, Nord et Extrême-Nord), le plébiscite était
ouvert au candidat du RDPC, monsieur Paul Biya.
Le contentieux électoral quant à lui se rapporte
à l'ensemble des litiges ou contestations relatifs à
l'organisation, au déroulement ou/et aux résultats de
l'élection présidentielle. Ceux sur la régularité
des opérations électorales, sont souvent soumis au juge.
178 Cela est la fonction dévouée à cet
organe depuis la Constitution du 18 janvier de 1996. Par contre pour la toute
première élection présidentielle pluraliste du 11 octobre
1992, ce fut la cour suprême qui était chargé de cette
tâche.
179 L'annonce de la victoire du candidat Ni John Fru Ndi avait
été faite par l'état-major du candidat, puis
amplifiée par les médias internationaux.
44
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Paragraphe 2 : La fin de la mission de monitoring des
élections présidentielles
La fin d'une mission de monitoring des élections
présidentielles se déroule en deux phases quasiment identiques,
à savoir : la préparation et la présentation d'un
communiqué final (A) la préparation et la présentation
d'un rapport de fin de mission (B).
A. La préparation et la présentation du
communiqué final
Aux termes de l'acte portant principes directeurs devant
guider l'envoi d'une mission internationale d'observation d'élections de
1996, « aussitôt après le dépouillement des votes,
le porte-parole de cette mission diffuse sur place un communiqué de
presse préalablement transmis au président du Comité
permanent de la francophonie (CPF) »180. Cette
formalité a été jusqu'alors l'une des plus
respectée dans le cadre de l'observation internationale des
élections. Ainsi, nous allons analyser tour à tour la
préparation et la présentation du communiqué final.
Elle se fait généralement en accord avec les
différents membres de la délégation des observateurs
constituant la mission. En réalité, elle est le plus souvent
l'oeuvre de l'un des membres de la délégation mandaté
à cet effet. Dans le cadre d'un accord avec une autre organisation, la
préparation du communiqué final se fait en accord avec le ou les
membres de l'organisation associée à l'occasion. C'est notamment
ainsi qu'ils s'accordent sur le contenu final de ce communiqué. Ce
contenu s'analyse généralement en quelques aspects, à
savoir :
- Le rappel de la procédure ayant donné lieu au
déploiement de la mission d'observation ;
- La composition de la mission ;
- Le mandat de la mission ;
- Le déroulement de la mission au regard du mandat qui lui
a été confié ;
- Les difficultés rencontrées ;
- Les différentes rencontres ;
- Le climat général de l'observation de
l'élection ;
- Une appréciation
générale181.
La procédure de la présentation du
communiqué final obéit à la règle de l'aval
préalable de celui-ci fixé par le président du CPF tel que
défini par le texte de Marrakech de 1996. C'est en réalité
une procédure apparemment sans incidence majeure sur le cours normal du
déroulement d'une mission de monitoring des élections en mais il
s'agit véritablement d'une procédure très importante en la
matière parce que c'est aussi à ce niveau qu'intervient une sorte
de filtre politique. En effet cet aval préalable du CPF et du
Secrétaire général de l'organisation en l'occurrence
témoigne de la place importante que peuvent avoir ces communiqués
dans les relations que l'organisation francophone peut à terme
entretenir avec certains Etats. C'est ainsi qu'on peut par exemple relever dans
certains communiqués autant une présentation
générale du scrutin assortie de quelques observations qu'une
sorte de philosophie même de l'observation des élections de la
francophonie en général.
180 Cf. document portant principes directeurs devant guider
l'envoi d'une mission d'observation d'élections, in Francophonie et
démocratie, p.18.
181 C'est donc à l'issue de ce travail préalable
que la/les personnes mandatées pour cette missions finissent par
présenter un communiqué détaillé retraçant
effectivement et en détail ces différentes articulations.
45
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Ainsi à l'occasion de la présidentielle du 11
octobre 2004 au Cameroun, on a par exemple pu relever que le communiqué
final de la mission de l'OIF était autant axé sur la
présentation de la philosophie générale de ce qu'ils
appelaient alors « l'approche renouvelée » de
l'observation des élections que sur un regard sur le déroulement
effectif. On pouvait notamment lire :
« cette mission a déployé ses
activités dans le cadre de la mise en oeuvre, à la fois des
principes directeurs de la Francophonie dans ce domaine et de la
déclaration de Bamako qui a servi de trame en sa partie «
élections » pour une première approche renouvelée de
l'observation. Cette approche consiste à prendre plus
systématiquement en compte dans l'observation, durant les trois phases
(avant pendant et après le scrutin), le rôle et le fonctionnement
des institutions, notamment au Cameroun, la cour suprême, l'ONEL, le
Conseil national de la communication (CNC) et des acteurs partis politiques,
médias, société civile, etc.) Associés directement
ou indirectement, à l'organisation et au bon déroulement du
processus électoral »182.
De même qu'on pouvait lire :
« Il ressort de cette observation :
- La forte mobilisation des électeurs,
- La présence des membres des bureaux de vote et des
représentants des candidats, dès l'heure légale
d'ouverture... »183
Cette double forme de présentation du communiqué
final a en effet considérablement évolué dans la mesure,
où depuis lors, il ne s'agit plus d'expliquer la philosophie
générale de la mission d'observation mais il s'agit davantage de
rendre compte du déroulement effectif du scrutin en tenant notamment
compte des
principes définis par l'organisation et d'en tirer les
conclusions.
Un troisième type de présentation du
communiqué final a eu lieu à l'occasion
de la présidentielle du 11 octobre 2004 au Cameroun. Au
plan formel, on pouvait déjà observer une division en quatre
parties intitulées : Principes pour la première partie,
phase préélectorale pour la deuxième,
déroulement pour la troisième et conclusion
pour la quatrième. Mais en dehors de cette
spécificité formelle, on relève par ailleurs une
satisfaction générale sur le déroulement du scrutin,
« l'atmosphère
particulièrement et sereine ayant
caractérisé le scrutin tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur des bureaux de vote... » Et «
le sérieux et la sérénité de la majorité
des
membres des bureaux de vote et de leurs présidents
malgré l'insuffisance de formation de certains membres de bureaux
»184.
La quatrième catégorie de présentation
des communiqués est celle qu'on n'a pu observer toujours à
l'occasion de l'élection présidentielle du 11octobre 2004 au
182 Communiqué de la mission de l'Organisation
Internationale de la Francophonie relatif à l'observation de
l'élection présidentielle du 11 octobre 2004 au Cameroun.
183 Communiqué de la mission de l'Organisation
Internationale de la Francophonie relatif à l'observation
d'élection présidentielle du 11 octobre 2004 au Cameroun.
184 Communiqué de la mission d'observation
mandatée par l'organisation Internationale de La Francophonie à
l'occasion de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004 au
Cameroun. Voir aussi le Communiqué des observateurs internationaux du
1er tour de l'élection présidentielle au Tchad, 20 mai
2001, Communiqué de la mission d'observation conjointe des
délégations mandatées par l'Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF) et l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA)
à l'occasion du 1er tour des élections
législatives du 9 décembre 2001 au Gabon. Le Communiqué de
la mission francophone d'observation des élections parlementaires au
Rwanda du 29 septembre au 2 octobre 2003.
46
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Cameroun. La première observation qu'on a pu faire est
qu'elle n'avait pas été mandatée par l'organisation
internationale de la Francophonie mais par l'Agence intergouvernementale de la
francophonie. En outre, on constate que l'élection présidentielle
s'est déroulée conformément à la loi
électorale camerounaise.
De ces différents communiqués de presse des
missions internationales et nationales monitoring des élections, on
observe que la présentation des communiqués n'est pas
homogène ni dans la forme ni dans le contenu. S'il est vrai au regard
notamment du cas de l'élection présidentielle camerounaise de
2004 que le monitoring était encore à sa phase
expérimentale, cette réflexion ne peut pas être retenue
dans tous les cas de figure. L'expérience tend d'ailleurs à
démontrer que de nouvelles variantes de présentation du
communiqué de fin de mission ont vu le jour depuis lors. C'est le signe
que le processus du monitoring des élections par les acteurs à la
fois internationaux et nationaux est incontestablement dynamique mais d'un
dynamisme qui n'éclaire pas davantage les rapports de fin de mission
dont la forme et le fond eux évoluent considérablement.
B. La préparation et la présentation du
rapport final
En général, la préparation et la
présentation du rapport final sont deux mouvements du monitoring des
élections confiées à une ou plusieurs personnes faisant
partie de la mission mandatée sur le terrain, et convient de les
analyser respectivement.
Dans le cadre des missions des OIG comme l'OIF, l'UA ou encore
le Commonwealth comme dans le cadre des missions nationales, la
préparation du rapport final se fait autant en amont qu'en aval de
l'organisation ou de l'institution. Ainsi la ou les personnes chargées
à cet effet est ou sont-elles tenues de se référer au
principe directeur n°5 en vertu duquel.
« Dans les 15 jours suivant son retour ou la fin du
scrutin, la
mission fait le rapport au président du CPF par
l'intermédiaire du Secrétaire Général de la
Francophonie dans le cas de l'OIF, et dans les autres cas au responsable
administratif de l'organisation. Ce rapport doit contenir notamment :
- Les objectifs de la mission ;
- La liste des observateurs ;
- Les termes de références ;
- Le contexte global et l'importance des élections
;
- L'itinéraire des observateurs dans le pays demandeur
;
- Les méthodes d'observation utilisées
;
- Les résultats des élections ;
- Les modalités de la coopération avec les
autres missions internationales sur place ;
- Les conclusions de la mission et ses
recommandations»185 .
185 Document portant principes devant guider l'envoi d'une
mission d'observation d'élection. Désireuse de donner corps
à la solidarité francophone et d'accompagner le processus
électoral, par la valorisation et l'échange des
expériences de ses pays membres, et à la lumière des
constats rappelés ci-dessus, la mission de la Francophonie a émis
un certain nombre de recommandations en vue d'améliorer, avec le
concours des partenaires internationaux, la préparation et la tenue des
prochaines consultations électorales. Dans ce sens, elle a
souligné l'importance de :
- renforcer les pouvoirs de contrôle et de supervision
de l'ONEL, afin d'en assurer l'indépendance sans en faire un organe
concurrent du Conseil constitutionnel ;
- revoir le statut et les compétences du Conseil
National de la Communication (CNC), pour en faire un organe indépendant
de régulation des médias ;
- poursuivre le dialogue politique et mieux structurer
l'opposition, en préparant une loi, si possible consensuelle
(majorité / opposition) portant statut de l'opposition ;
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
L'enjeu de cette présentation est de «proposer
les réformes appropriées, de contribuer au renforcement des
capacités locales et de fonder, le cas échéant, les
stratégies d'assistance institutionnelle et électorale ainsi que
les programmes de coopération en matière de développement
»186.
Une fois ce canevas de base établis et respecté,
les rédacteurs du rapport le soumettent pour appréciation au
responsable administratif de l'organisation au Secrétariat
général dans le cadre de l'OIF, du Commonwealth et au
président de la Commission de l'UA. Il faut dire ici que, le plus
souvent, celui-ci émet quelques réserves sur certains d'entre eux
pour des raisons diverses187. Il faut par exemple relever que la
publication des rapports de fin de mission de monitoring des élections
reste une question assez complexe au sein de l'organisation francophone parce
qu'ici celle-ci requiert pour ce faire « une haute tenue »
et une incontestable « fiabilité »188.
Mais la question reste tout de même celle de définir les
critères de haute tenue et de fiabilité pourtant pas aussi
évidents à déterminer ici. Car en effet, si jusqu'alors il
n'a pas encore été procédé à la publication
des rapports des missions monitoring des élections de 2003 au Togo et
celle de 2004 au Cameroun, cela pourrait sans doute signifier que la
qualité de la tenue de ces derniers présentent quelques
défauts de « fiabilité et de tenue ». Ceci
expliquant cela on comprendrait presque les raisons de cette observation faite
au rapport provisoire présenté par Son excellence Monsieur
Norbert Ratsirahonana à l'issue de la mission monitoring de
l'élection présidentielle camerounaise du 11 octobre 2004.
En vertu des dispositions du principe n°5 (2) des
principes de Marrakech de 1996,
a) « Dès réception du rapport de la
mission d'observation, le Président du CPF le fait diffuser notamment
à l'Etat demandeur aux membres du CPF et au Président de l'AIPLF.
Il le rend public.
- rationaliser le financement des partis politiques et
règlementer le contrôle de leurs dépenses, de façon
à assainir la vie politique, en particulier en période
électorale, notamment en vue de décourager les candidatures de
complaisance ou les désistements tardifs ;
- explorer la piste du bulletin de vote unique ;
- afficher au moins trente jours à l'avance les listes
des bureaux de vote, avec indication de leur emplacement, et les communiquer
aux partis politiques et aux candidats ;
- s'engager résolument dans la voie de la refonte de
l'état civil (registre) et de l'informatisation d'un fichier
électoral permanent, à travers la mise en oeuvre d'un projet du
type « Liste Électorale Permanente Informatisée »
(LEPI). Il conviendrait de se baser sur un recensement électoral
approfondi (REA), le dernier recensement datant de 1987 et de s'appuyer sur des
données géographiques issues de la cartographie censitaire
convertie en cartographie électorale, à l'aide d'un
Système Informatique Géographique (SIG) approprié. Le
fichier géographique électoral devrait en effet faciliter les
discussions sur le découpage électoral ou sur ses modifications.
Il contribuerait également à rendre plus efficace l'organisation
des scrutins, surtout pour la distribution du matériel et la
répartition du personnel. Il permettrait en outre une visualisation
rapide des résultats. Ces différents efforts, s'ils sont
effectivement conduits, ne manqueront pas d'améliorer le processus
électoral au Cameroun, dans le sens de sa démocratisation. Mais
chacun sait que les recommandations ne suffisent pas. Encore faut-il en assurer
le suivi et la mise en oeuvre concrète.
186 Symposium de Bamako, 3ème Réunion
préparatoire, 2003, p. 11.
187 Il convient de noter que selon des sources
présentes sur le terrain des élections, le projet de rapport
consécutif à l'élection présidentielle camerounaise
du 11 octobre 2004 a fait l'objet de quelques observations de la part du
Secrétariat Général de l'organisation francophone au motif
que celui-ci laissait planer quelques doutes sur la fiabilité des
résultats obtenus à l'issue du scrutin. Il en est de même
pour le rapport du chef de mission du Commonwealth à l'occasion de la
présidentielle du 09 octobre 2011.
188 Cf. Note sur l'observation internationale des
élections à l'attention de la commission politique du conseil
permanent de La Francophonie, 1er mars 1994, p. 18.
47
48
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
b) La commission politique examine ce rapport et, si
possible, entend le responsable ou le rapporteur de la mission à son
retour pour donner un avis au CPF, y compris sur les actions de
coopération qui pourraient faire suite au scrutin.
c) Le CPF prend acte du rapport et se prononce sur la
suite à lui donner »189.
Derrière les principes posés par le texte de
1996, se greffe une réalité pas nécessairement identique.
En effet, les usages de la francophonie ne sont pas en tout point les
mêmes. La diffusion du rapport n'est aussi systématique que semble
le dire le texte. Celui-ci passe d'abord par le filtre de la commission
politique qui, elle, statue sur la pertinence du texte rendu par le rapporteur
peut, dans ce cas, le transmettre à l'AIF pour une éventuelle
publication. Le caractère automatique de la publication n'est donc pas
absolu comme semble l'indiquer le texte, même si les instances de la
francophonie pense de plus en plus s'y orienter. C'est dire ici
qu'au-delà du texte en vertu duquel « les missions
francophones, à l'instar des autres observateurs internationaux publient
toujours un ou plusieurs communiqués de presse, notamment à
l'issue du processus électoral ; de même (qu') elles
rédigent un rapport au Secrétaire général de
l'organisation de la francophonie, lequel est systématiquement rendu
public »190. Il n'y a pas, à l'AIF de
publication systématique des rapports de fin de mission de monitoring
des élections même si en revanche les communiqués sont par
contre systématiquement publiés. Le principe n°5 l'indique
clairement : le CPF prend acte du rapport et se prononce sur la suite
à lui donner. Par cette seule formulation on comprend que la
question de la publication du rapport de fin de mission prend une signification
différente et assume par là même la flexibilité
pragmatique des missions internationales ou nationales de monitoring des
élections. Dans cette organisation aussi bien que dans d'autres, la
question de la publication des rapports est une question pas toujours
aisée pour des raisons pratiques comme le rappelle d'ailleurs la note du
13 octobre 2004 dans laquelle il est relevé qu' « il semble
difficile de répondre positivement aux nombreuses dispositions
nationales qui prévoient que les comptes rendus des missions soient
déposés auprès de la structure nationale compétente
avant leur départ »191. En plus, il y a
la crainte de voir la francophonie « impliquée dans des
contentieux électoraux»192. Il y a sans
doute ici une grande lucidité de la part des autorités de
l'organisation. C'est d'ailleurs le signe que le monitoring des
élections n'est pas une catégorie entièrement à
part du fonctionnement des rapports internationaux tant au plan juridique que
politique. Elle leur est complètement liée. Cette imbrication des
missions de monitoring des élections dans les relations internationales
et au-delà de l'importance qu'elles peuvent avoir dans le débat
juridique et notamment celui relatif à leur statut reste tout au moins
tributaire des rapports de forces qui s'expriment dans les relations
internationales et a priori bien au-delà de ce qu'on peut, bien
que très improprement, qualifier de la « bonne pensance »
politique et juridique internationale.
189 Cf. Note sur l'observation internationale des
élections à l'attention de la commission politique du conseil
permanent de La Francophonie, 1er mars 1994, p. 18.
190 Etat et pratiques de la démocratie des droits et
des libertés dans l'espace francophone : éléments pour un
premier rapport au Secrétaire général de l'organisation
internationale de la Francophonie, Doc francophone, p. 47.
191 Lire à ce sujet le rapport de la mission
exploratoire du 24 au 31 juillet 2004, en prélude à
l'élection présidentielle d'octobre 2004.
192 Note sur l'observation des élections à
l'attention de la commission politique..., 13 octobre 2004, p. 18.
49
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CONCLUSION PARTIELLE
Il s'agit ici, de répondre à la question des
ressources et des logiques des acteurs du monitoring des élections
présidentielles. Nous avons analysé d'une part les ressources des
acteurs du monitoring des élections et d'autre part les logiques. A ce
sujet, nous avons identifié à la fois les ressources
financières, matérielles et humaines nécessaires pour les
acteurs dans leurs activités de monitoring des élections. Toutes
ces ressources réunis donnent aux acteurs des logiques de
déploiement sur le champ électoral camerounais à
l'occasion d'une élection présidentielle.
50
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
L'intérêt de cette partie réside dans le
fait qu'elle nous a permis en premier lieu assurément et ambitieusement
de comprendre que les phénomènes sociaux sont en effet d'une
particulière complexité, notamment par rapport à ceux de
l'ordre physique ; ils doivent souvent une part de leur existence à des
micro-logiques individuelles qui demeurent insaisissable dans leur
totalité et leur instantanéité par les acteurs
eux-mêmes.
Nous avons analysé sur le monitoring des
élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
étant donné que celui-ci se conçoit comme un
phénomène politique socialement construit par des règles
juridiques et pragmatiques d'une part et socialement structuré par des
enjeux d'autre part, nous a permis ainsi de mieux comprendre comment s'explique
un fait politique.
En deuxième lieu, celui des ressources de leur
répartition dans une situation socialement construite, pour comprendre
les logiques de déploiement des acteurs sur le terrain des
élections présidentielles au Cameroun.
51
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
USAGES ET EFFETS DE REALITE DU MONITORING
DES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU CAMEROUN
« La présence d'observateurs internationaux
à des élections, à l'invitation d'Etats souverains, peut
faire toute la différence en ce sens qu'elle permet d'assurer que les
élections fassent réellement avancer le processus
démocratique. Leur seule présence peut dissuader de mauvaises
conduites, assurer la transparence et inspirer la confiance dans ce processus
»193
L'un des éléments majeurs de convergence autour
de l'envoi et du déploiement des missions de monitoring des
élections présidentielles peut être entendu comme un
consensus autour des finalités, celles-ci plus proches de
l'efficacité entendue comme la combinaison entre la théorie et la
pratique. Cette double considération se justifie par la
difficulté à séparer le monitoring des élections de
ces deux exigences : l'exigence éthique en ce qu'elle permet de limiter
la fraude électorale par exemple, et l'exigence politique parce que
toute élection s'inscrit nécessairement dans une perspective
d'acquisition du pouvoir. L'objectif d'efficacité se trouverait alors
atteint s'il s'orientait vers la satisfaction d'un résultat autour
duquel serait déterminée toute l'activité de monitoring
des élections présidentielles.
Analyser les usages et les effets des réalités
du monitoring des élections présidentielles reviendrait à
s'intéresser aux usages plurivoques du monitoring des élections
présidentielles (Chapitre 3), aussi bien qu'à ses effets de
réalité (Chapitre 4).
193Kofi Annan, huitième secrétaire
général des Nations-Unies de 1997 à 2006.
52
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CHAPITRE 3 : USAGES PLURIVOQUES DU MONITORING DES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
« La présence d'observateurs internationaux et
nationaux à des élections, soit à l'invitation des Etats,
soit par accréditation, peut faire toute la différence en ce sens
qu'elle permet d'assurer que les élections fassent réellement
avancer le processus démocratique. Leur seule présence peut
dissuader de mauvaise conduite, assurer la transparence et inspirer la
confiance dans ce processus.»194
Pendant longtemps, la communauté internationale,
à travers les grandes puissances et les institutions internationales, a
été très permissive sur la gestion
politico-économique souvent chaotique des États du Tiers-Monde,
notamment des États post-coloniaux africains195.
Analyser les usages plurivoques du monitoring des élections
présidentielles revient à examiner les usages internes du
monitoring des élections présidentielles (Section 1) et les
usages externes du monitoring des élections (Section 2).
SECTION 1 : LES USAGES INTERNES DU MONITORING DES
ELECTIONS : CAS DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 1992
Le monitoring des élections présidentielles
comme instrument de préservation d'une autonomie d'action dans la mise
en oeuvre du processus de démocratisation (Paragraphe 1), aussi bien que
la transparence sont des usages majeurs internes du monitoring des
élections Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le monitoring des élections comme
instrument de préservation d'une autonomie d'action dans la mise en
oeuvre du processus de démocratisation
Les pays et les organisations du nord prennent actuellement
des positions dont l'objectif est non seulement de faire respecter les droits
de l'homme, mais surtout une conditionnalité démocratique au
sud196. Ainsi, face à l'interférence de
l'environnement externe, le nationalisme gouvernemental qui, dans une certaine
mesure, s'abreuve aux sources du tiers-mondisme, se porte en faux de la
tendance à l'universalisation de la démocratie libérale
célébrée avec une bonne dose d'optimisme par Francis
Fukuyama197. Il pourrait aussi s'agir d'une affirmation
de son identité face à l' « impérialisme »
inhérent à toute tendance homogénéisatrice.
Mais, dans la mesure où le processus de
démocratisation camerounais s'apparente à une «
performance démagogique de la formation dirigeante
»198, en ce sens qu'« il s'agit de
fabriquer l'image d'un régime qui n'a pas été contraint de
libéraliser par la force des pressions intérieures et
extérieures »199 deux leviers permettent au pouvoir
en place de s'assurer une marge d'autonomie dans la conduite du processus de
démocratisation qui suit son cours. A n'en pas douter, il s'agit
194 Koffi Annan, huitième Secrétaire
Général des Nations Unies de 1997 à 2006.
195 Dodzi Kokoroko, « Souveraineté étatique
et principe de légitimité démocratique », in
Revue québécoise de droit international, 2003, p. 39.
196 Moss, (TO), « La Conditionnalité
Démocratique dans les Relations entre l'Europe et l'Afrique », in
l'Évènement Européen, n° 19, septembre 1992,
p. 75.
197 Fukuyama, (F), La Fin de l'Histoire et le Dernier
Homme, Paris, Flammarion, 1992, p. 231.
198Sindjoun (L), Construction et
Déconstruction Locales de l'Ordre Politique au Cameroun. La
Sociogénèse de l'Etat, Thèse de Doctorat d'Etat en
Science Politique, Université de Yaoundé II, F.S.J.P,
Année académique 1993-1994, p. 254.
199 Idem.
53
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
d'envisager le monitoring des élections comme moyen de
disqualification des modèles véhiculés par l'environnement
international d'une part (A), et d'autre part, d'analyser le monitoring des
élections présidentielles comme primat d'une volonté de
pilotage exclusif de la dynamique politique interne (B). Les deux
réalités sont tellement imbriquées qu'il n'a pas
été aisé d'opérer un distinguo.
A. Le monitoring des élections comme moyen de
disqualification des modèles véhiculés par l'environnement
international : cas de l'élection présidentielle de 1992
Depuis la fin de la guerre froide, le monde a
été balayé par une vague démocratique de grande
envergure. Partie de l'Est, cette « onde de choc » atteint
l'Afrique de plein fouet. Le cas béninois a constitué un
précédent de taille dans la mise en oeuvre des processus de
démocratisation qui déferlent par la suite en
Afrique200. Suite à une réunion des instances
dirigeantes du parti, de l'Etat et de l'armée, le Président
Mathieu Kérékou du Bénin cède, le 07
décembre 1989, à la pression conjuguée de la rue et des
bailleurs de fonds. Il annonce l'abandon du Marxisme-léninisme et du
rôle dirigeant du parti ainsi que la convocation d'une Conférence
nationale réunissant toutes les forces vives du pays201.
D'autres pays d'Afrique francophone s'engagent dans cette voie202.
Pourtant, l'influence de ces facteurs semble difficile à attester pour
le cas camerounais203. Les forces extérieures qu'on peut
directement associer au processus de démocratisation au Cameroun sont la
France, les Etats-Unis et plus généralement la communauté
des créanciers204. Face à leur poussée, le
pouvoir central camerounais va moduler sa réaction en fonction de sa
provenance.
La récession économique que traverse le
continent africain depuis le début des années 80 et la
disparition des rivalités géopolitiques Est-ouest dans cette aire
géographique ont amené les bailleurs de fonds occidentaux
à réévaluer les fondements de leur aide205.
Par-delà cette révision, c'est tout particulièrement le
cas du Cameroun qui était ainsi visé206. En ce qui
concerne les donateurs de l'aide bilatérale, on a coutume d'insister sur
le fameux discours de la Baule, prononcé en 1990, par le
Président français, monsieur François Mitterrand et les
multiples mises en garde des Etats-Unis voire de la Grande Bretagne. Mais, on a
tout aussi coutume de passer sous silence l'action de la République
fédérale d'Allemagne dont le Ministre de la Coopération
économique et du développement de cette époque-là,
monsieur Carl Dieter Spranger, a énoncé en octobre 1991 cinq
nouveaux critères207 en matière de coopération
au développement avec les pays du Tiers-monde. C'est en application
200 Ebolo, (M.D), Op. cit., p. 51.
201Raynal (J.J), « Le Renouveau
Démocratique Béninois : Modèle ou Mirage ? » in
Afrique Contemporaine, n° 160, 4ème trimestre,
1991, la Documentation Française, pp. 6-7.
202 Congo, Gabon, Niger, Togo...
203 Mehler, (A), Op. cit., p. 29.
204 Idem.
205 Biagiotti (I), « Afrique, Droits de l'Homme,
Démocratie et Conditionnalité : Éléments des
discours allemands » in L'Afrique Politique. Vue sur la
Démocratisation à marée basse. CEAN, Paris, Karthala,
1995, p. 203.
206 Idem.
207 Il s'agit du respect des droits de l'homme, de la
participation de la population au processus politique, de la garantie de la
sécurité juridique, de l'institution d'un système
économique « compatible avec le marché » et de
l'orientation de l'action de l'Etat sur le développement.
54
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
de ces prescriptions que ce pays suspendit ses
négociations intergouvernementales sur la coopération
financière et technique d'avec le Cameroun en 1992208.
Quant aux organismes multilatéraux, outre la clause de
protection des droits de l'homme incorporée dans le dispositif de la IVe
Convention de Lomé (1989)209 par les pays membres de la CEE,
le Parlement européen, dans sa résolution 981 du 5 mai 1992
relative aux relations Nord-Sud, s'est voulu plus ferme : « l'aide
officielle doit en principe être réservée aux pays qui
s'orientent vers la démocratie, le respect des droits de l'homme et la
mise en place d'une administration responsable et efficace un bon gouvernement.
Il faut cesser de soutenir des dictateurs. Il faut suspendre l'aide officielle
aux pays où le processus démocratique s'est arrêté,
sauf urgence humanitaire » 210.
Cette machine infernale a été mise en branle
aussi bien par la Banque mondiale que par d'autres organismes du système
onusien. Face à ce déferlement de pressions directes et
indirectes, le gouvernement camerounais oppose l'argument nationaliste. Les
prestations publiques du Chef de l'Etat seront l'occasion de tempérer
les ardeurs des partisans d'un universalisme de façade. Aussi, à
l'occasion de l'ouverture officielle de la 87ème Conférence de
l'union interparlementaire, le 06 avril 1992, le Président Paul Biya
n'a-t-il été formel : « c'est à chaque peuple
qu'il appartient, en dernier ressort, de décider de ce qui est bon pour
lui, pour sa liberté, pour son mieux être
»211. Jl s'agit, en réalité, d'une mise en
garde à l'endroit de « ceux qui seraient tentés de
donner des leçons... »212, car ils « (...)
devraient comprendre que des Etats libres et indépendants n'ont de
compte à rendre qu'à leurs citoyens »213. Ce
discours, dont le caractère dissuasif est sans embellissement,
apparaît comme un moyen, pour le pouvoir central, de se dérober
face aux pressions extérieures en faveur de la
démocratisation.
La récurrence des propos appelant à la
sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation et de sa
souveraineté s'analyse en un refus de la transposition et/ou de
l'imposition de modèles venus d'ailleurs : « nous ne pouvons
transposer, chez nous, aveuglement, sans discernement, des recettes
étrangères toutes faites, des modèles d'emprunt,
eussent-ils réussi ailleurs, car le Cameroun, je l'ai dit en d'autres
circonstances, a son identité propre »214.
Déjà, à l'occasion de son discours d'investiture devant
l'Assemblée nationale et la Cour suprême le 03 novembre 1992,
après son élection le 11 octobre 1992 le Président Paul
Biya, après avoir épilogué sur l'ouverture de son pays
à la coopération internationale, déclarait que celui-ci
« entend voir respecter ses options et sa souveraineté
»215. Ces propos étaient probablement
orientés vers les représentations diplomatiques des pays amis qui
avaient manqué de réserve lors des péripéties
marquant l'organisation de l'élection présidentielle du 11
octobre 1992216. Autant le Chef de l'Etat a joué un
rôle de premier plan dans la
208 Ebolo, (M.D), Facteurs Extérieurs et
Démocratisation en Afrique : le cas de l'action allemande au
Cameroun, Mémoire de Maîtrise Professionnelle en Relations
Internationales, Université de Yaoundé II, IRIC, octobre 1994,
p.80.
209 Se référer au Texte de la Convention contenu
dans Le Courrier ACP-CEE, n° 120, mars-avril 1990, p. 11.
210 Texte de la Résolution dans la Revue Africaine de
Droit International et Comparé, vol. 5, 1993, p. 465.
211 Cameroon Tribune n° 5108, mardi 07 avril 1992,
p. 3.
212 Idem.
213 Idem.
214 Discours du Président Biya, in Cameroon Tribune
n° 5746, vendredi 16 décembre 1994, p. 2.
215 Cameroon Tribune n° 5253, mercredi 04 Novembre
1992, p. 3.
216 De plus, le lundi 19 octobre 1992, Jacques Roger Booh
Booh, Ministre camerounais des Relations Extérieures rappelle à
tous les Ambassadeurs accrédités à Yaoundé,
capitale du Cameroun, les principes de la non-ingérence dans les
affaires intérieures du Cameroun. De même, l'activité
diplomatique s'est aussi déployée par l'envoi des missions
d'explication de haut niveau à travers le monde dès le 04
novembre 1992 (France,
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
formulation du nationalisme face aux pressions de la
communauté internationale dans son ensemble, autant les ministres
semblent avoir été perspicaces et tenaces vis-à-vis des
pressions exercées par les Etats-Unis
d'Amérique217.
Deux faits majeurs retiennent notre attention à ce
niveau de l'analyse. La réaction du gouvernement camerounais suite au
fameux rapport du NDI à l'issue de l'élection
présidentielle anticipée du 11 octobre 1992 ainsi que son
attitude vis-à-vis des nombreux communiqués-presses
diffusés par les services d'information de l'ambassade des Etats-Unis
à Yaoundé.
Les rapports du National democratic institute for
international affairs (NDI) s'inscrivent dans le sillage de l'action de
l'ambassadeur américain au Cameroun d'alors, madame Frances Cook, qui
non seulement « condamnait les violations des droits de l'homme au
Cameroun pendant les années 90-92 » 218, mais aussi
prenait part, au grand dam du pouvoir en place, aux activités de
certains grands partis politiques de l'opposition, notamment du Social
democratic front (SDF) du « Chairman » monsieur Ni John Fru
Ndi.
Les rapports219 présentés par les
experts du NDI sur la dynamique de l'élection présidentielle
anticipée du 11 octobre 1992 ont été à l'origine de
ce que le gouvernement camerounais a appelé « Un malentendu
malheureux »220. Ces rapports critiquaient assez
sévèrement les conditions d'organisation ainsi que le
déroulement effectif du scrutin. Ils insistaient, par ailleurs, sur la
« gravité des irrégularités et le
caractère massif des fraudes »221. Suite à
ces prises de position, la réaction du gouvernement camerounais
interviendra deux jours plus tard222.
Plusieurs communiqués-Presses de l'ambassade des
Etats-Unis à Yaoundé sur les droits de l'Homme et le processus de
démocratisation au Cameroun ont, à certains
Belgique, Allemagne, Grande Bretagne, Espagne, Etats Unis,
Canada, Chine, etc.). Il s'agissait, en effet, de rassurer la communauté
internationale que le processus démocratique en cours est en bonne
voie.
217 Des représentants officiels des Etats-Unis se sont
prononcés clairement au sujet de la démocratisation en Afrique.
En 1990, Hermann Cohen, alors Sous-Secrétaire d'Etat Adjoint aux
Affaires Africaines, déclarait qu'à un avenir proche, la
démocratie serait la pré-condition nécessaire pour obtenir
une aide au développement. Cet héritage est assumé par
l'Administration Monsieur Clinton depuis 1993. Le Gouvernement de
Yaoundé apparaît comme l'un des destinataires de ce message, ce
d'autant plus qu'en 1988/89, le Cameroun comptait parmi les pays-clé de
l'aide bilatérale américaine en Afrique subsaharienne.
218 Mehler (A), Op. cit. p. 31.
219 Il s'agit de la Déclaration post-électorale
préliminaire du 14 octobre 1992 et du Rapport provisoire de la Mission
d'Observateurs Internationaux du NDI à l'élection
présidentielle du 28 octobre 1992.
220 Cf. Les Droits de l'Homme au Cameroun. Livre Blanc
publié par le Gouvernement de la République du Cameroun,
Yaoundé, les Editions de l'Imprimerie Nationale, 1994, p. 243.
221 Ibidem, p.253.
222 Lors d'un point de presse organisé le 30 octobre
1992 point de presse auquel prenaient activement part les Ministres Douala
Moutome de la Justice et Robert Mbella Mbappe de l'Education Nationale le
Ministre de la Communication, Augustin Kontchou affirme sans ambages que le
rapport du NDI « est un véritable scandale intellectuel ». Par
conséquent, il constitue « un tissu de mensonges ». Cette
disqualification de l'objectivité du rapport du NDI apparaît comme
une stratégie du gouvernement à se dérober des pressions
qui pourraient en découler. La fibre nationale s'identifiant en l'ultime
recours, étant entendu que « certains étrangers agissent de
manière hostile à l'endroit du Cameroun » En outre, face aux
journalistes qui l'accusent d'avoir reconnu lors d'un entretien à
Cameroon Tribune que l'élection présidentielle anticipée
du 11 octobre 1992 a été entachée
d'irrégularités, le Ministre Douala Moutome pense beaucoup plus
que « le rapport du NDI pose un problème de respect de notre
souveraineté et de notre indépendance ». Quant au Ministre
Robert Mbella Mbappe, le Cameroun n'étant pas une colonie, il est
inadmissible pour un Camerounais d'accepter qu'un organisme qui n'a «
aucune valeur » puisse émettre un jugement qui « manifestement
porte atteinte à la souveraineté du pays... » . Le paroxysme
des appels à la fibre nationaliste est atteint lorsque Douala Moutome
déclare : « Le Cameroun n'a pas besoin de ce genre de donneurs de
leçons qui nous fourvoient. Le NDI est venu ici pour nous fourvoyer.
[...] Lorsque le NDI n'arrive pas à respecter la chose jugée
camerounaise, qu'est-ce qu'ils viennent faire au Cameroun ? Ils ne nous
considèrent pas comme un Etat ! » .
55
56
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
moments, suscité la réaction des
autorités gouvernementales. Nous nous en tiendrons à celui du 22
novembre 1994 au motif qu'il a provoqué un sursaut d'orgueil
nationaliste qui fera date223. Usant et même abusant parfois
de leur statut de « Maître du monde »224,
les Etats-Unis déclarent par communiqué-presse du 22 novembre
1992 appuyer « fortement la mise en oeuvre de mesures maintes fois et
depuis longtemps promises et ajournées par le gouvernement du Cameroun,
visant à faire avancer la démocratisation »
225. Pis encore, ils vont jusqu'à esquisser le
schéma à suivre : « Pour être significatives, ces
mesures doivent donner lieu à un processus transparent, ouvert à
la participation de tous, et conduire à la séparation des
pouvoirs exécutif, législatif , judiciaire et à la
décentralisation »226. Le comble de l'injonction
est atteint lorsque les Etats-Unis « demandent instamment au
gouvernement du Cameroun d'aller jusqu'au bout de ses promesses,
d'éliminer la censure des médias, et de cesser le
harcèlement et la détention des journalistes
»227. En fait, il s'agit d'un texte dont le contenu se
situe aux antipodes de la communication entre deux partenaires reconnus de la
société internationale.
Par communiqué-presse en date du 03 décembre
1992, le gouvernement camerounais estime que celui diffusé par
l'Ambassade américaine « n'est acceptable ni pour le ton, ni
pour le contenu »228 . Ainsi, face à une action qui
« présente les allures d'une leçon d'instruction civique
»229, aux banbins de l'école primaire, le
gouvernement a tenu à « rappeler à ceux qui feignent de
ne pas le reconnaître, qu'aucune étape de son processus
démocratique n'a été la conséquence d'une pression
extérieure, mais est toujours restée l'oeuvre pleine et
entière d'un peuple fier et jaloux de sa souveraineté
»230.
Ainsi, qu'on le constate aisément, le gouvernement
camerounais n'a eu de cesse, par l'entremise de l'argument nationaliste, de
dénoncer, parfois avec véhémence les pressions
extérieures en faveur de la démocratisation. Cette
stratégie a pour corollaire la volonté de « pilotage
» exclusif de la dynamique politique interne. B. Le
monitoring des élections comme volonté relativement
contestée de pilotage exclusif de la dynamique politico-électoral
interne
Le processus de démocratisation camerounais s'analyse
en une « offensive de la formation dirigeante » 231 aussi
bien face à la « volonté subversive » de la
société civile que face aux pressions extérieures. En tout
état de cause, deux facteurs auront permis au pouvoir central de «
nationaliser » la problématique de la
démocratisation au Cameroun : l'argument d'un processus graduel et
l'attachement en l'existence d'une « exception camerounaise
». Cet argument a pour objectif la disqualification des tenants de la
thèse d'une imbrication entre les démocratisations d'Afrique
et
223 Ebolo, (M.D), « Art. cit. », p. 52.
224 L'expression est tirée de l'ouvrage de Valence (G),
Les Maîtres du Monde. Allemagne, États-Unis, Japon,
Paris, Flammarion, 1992, p.295.
225Cameroon Tribune n° 5737 du 05
décembre 1994, p.3. Voir aussi Afrique - Etats-Unis, n°
12/1994, p. 2.
226 Idem.
227 Idem.
228 Idem.
229 Idem.
230 Idem.
231 L'expression est de Sindjoun (L), Construction et
Déconstruction Locales..., p. 534 ; Lire le même auteur
« Le système politique camerounais face aux enjeux de la transition
démocratique », in l'Afrique politique, Paris, Karthala,
1994.
57
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
l'évolution brusque des relations internationales
actuelles232. Ce faisant, le pouvoir en place procède en la
construction du « mythe de l'antériorité
présidentielle de l'offre libérale »233.
Ainsi, il essaie de fabriquer l'image d'un régime qui n'a pas
été contraint de libéraliser la vie politique par la force
des pressions intérieures et extérieures234. Le 20
juillet 1990, le Président Paul Biya était formel : «
nous avons commencé à libéraliser notre vie politique
depuis 1985, avant que le vent de l'Est ne se lève
»235. Cet argument d'une approche gradualiste est
savamment entretenu par Cameroon tribune, l'organe d'expression
gouvernementale. Esquissant le chemin parcouru, ce journal écrit :
« Lorsqu'il décide de la fondation du Rassemblement
démocratique du peuple camerounais (RDPC) en mars 1985 à Bamenda,
monsieur Paul Biya, sans attendre que la démocratie apparaisse aux
peuples de l'Est de l'Europe comme principe universel, part d'un constat
annonciateur d'une époque nouvelle pour le Cameroun
»236. Ce recours en un langage spécifique a pour
objectif de stimuler la « conscience de former un groupe et d'imposer
son existence à l'environnement extérieur
»237.
Certes, il est indéniable que l'accession au pouvoir de
monsieur Paul Biya en novembre 1982 coïncide avec un discours au contenu
libéral et l'adoption de quelques réformes. Mais, la rupture avec
l'autoritarisme ne fut jamais radicale238. L'attitude du pouvoir
central participe de la dynamique de la gouvernance magistralement
décrite par Philippe Braud : « gouverner, c'est réagir,
sans doute ! Mais beaucoup plus fréquemment, c'est prendre en charge des
processus décisionnels complexes, c'est avaliser des décisions
prises ailleurs... ou nulle part. C'est subir l'événement en
donnant l'illusion de le régenter »239. Quelques
faits permettent de démontrer que le pouvoir en place n'a cessé
de prétendre en la maîtrise de la situation. La poussée
subversive de la société civile commence avec l'affaire monsieur
Yondo Black et ses acolytes, condamnés le 5 avril 1990 par le Tribunal
de Grande Instance de Douala, à un emprisonnement de trois ans ferme
pour « avoir tenu des réunions clandestines et diffusé
des tracts hostiles au régime ». Les 17 et 18 mai de la
même année, le SDF, formation politique non
légalisée, appelle à une manifestation publique en se
fondant sur l'article 3 de la Constitution du 02 juin 1972. Le 26 mai, la
manifestation est réprimée non sans une dose de brutalité.
Le 20 juin 1990, a lieu l'ouverture solennelle de la célèbre
Conférence de la Baule avec le message que l'on sait.
C'est dans cette foulée que se tiendront les assises du
tout premier congrès ordinaire du Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (RDPC), parti unique au pouvoir, le 28 juin 1990 au palais
des congrès de Yaoundé. Afin d'administrer la preuve de sa
volonté libérale, le Président Paul Biya invitera ses
camarades à se « préparer à affronter une
éventuelle concurrence »240. Cet argumentaire
s'enrichit de quelques actions concrètes, à l'instar de la
pluralité de candidatures au sein du parti lors des élections
législatives de 1988, de la levée de l'Etat d'urgence dans le
Haut-Nkam, le Ndé, les localités de Nkondjock et de
Makénéné en 1987.
232 Garcin (T), « La France et la Démocratisation
en Afrique » in Le Trimestre du Monde, 1er Trimestre 1992, p.
138.
233 Idem.
234 Idem.
235 Cf. Cameroon Tribune n° 4683 du 22 et 23
juillet 1990.
236 Obam-Assam (S), « D'un Congrès à l'autre
», in Cameroon Tribune, n° 5947 du 06 octobre 1995, p. 3.
237 Braud (P), La Vie Politique, Paris, Presses
Universitaires de France, 1985, p. 63.
238 Idem.
239 Braud (P), Op. cit., p. 63.
240 Cameroon Tribune n° 4670 du 3 et 4 juillet
1990, p. 13.
58
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
La session ordinaire de l'Assemblée nationale du mois
de novembre de la même année permettra au pouvoir de poser les
jalons de l'infrastructure juridique du multipartisme au Cameroun. C'est au
cours de cette session, dite « des libertés », que
seront adoptées les lois sur les partis politiques, la liberté
d'association et l'abrogation de l'ordonnance n° 62/OF/18 du 12 mars 1962
portant répression de la subversion, pour ne s'en tenir qu'à ces
textes. Ce nouvel environnement juridique va favoriser la légalisation
de plusieurs formations et associations politiques dès les premiers mois
de l'année 1991. D'entrée de jeu, les nouveaux partis politiques
vont revendiquer la convocation d'une Conférence nationale souveraine.
Cette revendication a sérieusement secoué les bases du pouvoir,
sans pour autant « réduire sa capacité et sa
technicité à conduire un changement selon son rythme, ses projets
et sa volonté »241. C'est dans cette logique que
fut convoquée la rencontre tripartite à partir du 30 octobre
1992. La suite des péripéties de la dynamique politique
camerounaise sera marquée par le souci constant du pouvoir de se
soustraire aux pressions de toutes sortes242.
L'argument d'une démocratisation progressive est
renforcé par le recours au mythe de « l'exception camerounaise
». Univers de communication, la scène politique mobilise de
multiples langages pour signifier le pouvoir. De façon extensive, le
langage s'entend de tout système de signes porteurs de
sens243. La validité d'une telle analyse pourrait s'appliquer
au cas camerounais dans la mesure où l'autorité investie du
pouvoir de direction du pays utilise à fond la symbolique d'une «
exception camerounaise » pour pouvoir disqualifier les arguments
de tous ceux qui, au Cameroun comme ailleurs pensaient (ou pensent encore) que
ce pays aurait dû se mettre au diapason d'une mode symbolisée par
la Conférence Nationale Souveraine. « Le Cameroun, c'est le
Cameroun ! », lançait Paul Biya le 27 juin 1991, à
l'Assemblée nationale pour justifier son refus de la conférence
nationale et amener les partisans de cette désormais fameuse formule
à comprendre que les contingences inhérentes aux
réalités camerounaises n'imposent pas forcément un
mimétisme à tout vent. Cette prise de position du Chef de l'Etat
rejoignait celle d'une frange non négligeable de la formation au pouvoir
qui se résume en ces termes : « nous ne voulons pas de
modèles importés ».
Au-delà des slogans, il convient de relever la
résurgence d'une certaine forme de vanité
nationale244. Mais soutenir qu'un tel nationalisme est bien
dérisoire étant donné qu'il a pour fonction essentielle
d'offrir un fondement « philosophique », «
juridique » et « intellectuel » au maintien du
système répressif245 peut être contestable.
Aucun gouvernement au monde n'accède facilement aux injonctions,
même voilées, des autres acteurs de la scène
internationale. L'attitude du pouvoir central français, face aux
réactions de la communauté internationale suite à la
reprise des essais nucléaires, en dit long. De surcroît, pour un
Etat tiers-mondiste, il pourrait s'agir d'un subterfuge devant la «
tentative de reprise en mains des pays du Sud par les pays du Nord,
à travers la culture... »246. Car, comment
convaincre et se convaincre qu'une telle action internationale ne tend pas
prioritairement à
241 Lire Onana, (J), Op. cit., p. 590.
242 Lire le Discours du Président Biya à
l'ouverture du 2ème Congrès ordinaire du RDPC le 07
octobre 1995, in Cameroon Tribune n° 5948 du 09 octobre 1995, p.
3.
243 Idem.
244 Monga, (C), Op. cit., p. 68.
245 Idem.
246 Sob (P), « Le Principe d'universalité
des droits de l'homme : mythe et limites », in Afrique 2000,
n° 22 juillet-septembre 1995, p. 15.
59
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
sauvegarder un intérêt national ?247
En effet, l'établissement fréquent des liens entre l'aide
étrangère et les progrès réalisés dans le
domaine de la démocratie et des droits de l'homme constitue une
indication incontestable de la difficulté à poursuivre un tel
objectif sans arrière-pensées248.
En clair, le nationalisme gouvernemental s'analyse en une
volonté affichée, de la part du pouvoir en place, de
préserver une marge d'autonomie considérable dans la gestion de
l'agenda démocratique Camerounais. Cependant, cette autonomie est
partiellement assurée du fait de l'ouverture, voire de l'extraversion du
système politique camerounais.
Paragraphe 2 : Les usages politiques du principe de
transparence dans la dynamique interne du monitoring des élections
présidentielles
L'un des éléments d'analyse des usages internes
du monitoring des élections présidentielles peut aussi se faire
en examinant de près le défi et le souci, un tant soit peu la
transparence et la stabilité comme gage de cette action (A), et aussi
d'envisager cela comme un appel à un dialogue politique des
différents acteurs de la scène politique camerounaise (B).
A. L'argument de transparence comme vecteur de
stabilité sociopolitique : cas de des élections
présidentielles de 1992
L'élection constitue un mode de désignation par
les citoyens de leurs représentants ou de leurs
délégués soit à l'échelon local, à
l'échelon national, soit à la désignation ou au choix de
son président. Elle constitue un mode de participation du citoyen
à la vie politique de son pays. La transparence dans un tel processus
confère une légitimité au Président élu.
L'importance des mécanismes d'accès aux positions de pouvoir
politique se mesure aux conflits qui marquent régulièrement les
élections dans notre pays depuis le début des années 90.
Et cela ne réside pas seulement dans l'organisation du scrutin
présidentiel en soi, mais aussi dans une périodicité fixe
et de dates convenues, depuis 1992, date du retour au
multipartisme249. Ces représentants des citoyens acceptent en
effet de confronter leurs différences, selon une règle commune :
la méthode démocratique.
Au Cameroun, comme dans le reste des pays africains, les
élections cessent d'être ce que Max Weber appelait « des
chances de puissances »250, mais deviennent l'occasion de
conflits internes qui déchirent l'unité nationale au grand dam
des populations. Ces dernières sont victimes d'une mise à
l'écart dans le déroulement du processus électoral, et
payent les conséquences désastreuses des affrontements dont elles
ne sont pas à l'origine.
Le début des années 90 voit émerger au
Cameroun des organisations nationales et internationales s'impliquant de plus
en plus dans l'organisation et la tenue d'élections libres et
transparentes. L'action des organisations à travers le monitoring des
élections a été marquée par « une
intensification des luttes et une contestation de plus en plus violente des
systèmes autoritaires. Ces mouvements ont
247 Ibidem, p. 19.
248 Sob (P), «Art. cit.», p 20.
249 Nkainfon Pefura, (S), Op. cit., première de
couverture.
250 Olivier(I), Le vote, 2ème Edition
Montchrestien, 2000, p. 23.
60
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
mis dans la rue des capitales et principales villes
africaines de nouvelles procédures de mobilisations et une nouvelle
thématique idéologique »251.
L'opposition qui dénonçait la fraude a
intensifié sa campagne pour une réforme du code électoral,
notamment. La mise en place d'une Commission Indépendante pour la
conduite et la gestion des élections au Cameroun. Face à toutes
ces revendications, les propositions de la tripartite ne seront pas prises en
compte ; et pour signifier son mécontentement, on assiste au boycott par
les grandes figures de l'opposition de l'élection présidentielle
du 12 octobre 1997252. Le rôle de la société
civile ne doit pas consister à se rallier derrière un opposant
pour combattre un régime donné. Elle doit plutôt être
impliquée en amont du processus électoral en encourageant les
populations à s'inscrire sur les listes électorales ; elle doit
aussi éclairer les citoyens sur les projets des différents
candidats en vue de favoriser des choix rationnels.
B. Accords et désaccords sur la transparence
électorale dans le contexte de monitoring des élections
présidentielles comme maintien du dialogue politique
L'espace sociopolitique camerounais est marqué par une
hétérogénéité des acteurs : les tenants du
pouvoir, les partis d'opposition et les mouvements de la société
civile. La rencontre tripartite pouvoirs publics À partis politiques
À société civile d'octobre-novembre 1991 inaugure le
dialogue politique entre le gouvernement et les partis d'opposition. C'est
l'amorce d'une dynamique des transactions collusives253, pour parler
comme Michel Dobry, marquant l'autonomisation de la classe politique par
rapport aux citoyens. En effet, l'ordre du jour officiel de la
conférence tripartite est constitué par la négociation de
l'avant-projet de la loi portant organisation des élections à la
fois législatives et de l'avant-projet de décret portant
accès des partis politiques aux médias publics pendant la
campagne électorale254. Ce dialogue politique, c'est le
référentiel d'une marque de multipartisme et de prise en compte
de tous les acteurs politiques dans l'élaboration et la
régulation du jeu politique, ainsi que leur implication. Certes l'ordre
dirigeant conserve une marge de manoeuvre dans la phase de vote parlementaire
et de promulgation du code électoral. C'est sans pour cela que monsieur
Adamou Ndam Njoya président de l'Union démocratique du Cameroun
(UDC) et monsieur Ni John Fru Ndi président du SDF ont accusé les
gouvernants d'avoir détourné le consensus, d'avoir la mainmise
sur la procédure électorale ; mais il est indéniable qu'il
y initialement a eu un marchandage institutionnel au sujet de l'abaissement de
l'âge électoral de 21 à 20 ans, du scrutin majoritaire avec
une pondération proportionnelle, les commissions mixtes de supervision
et de dépouillement des résultats. L'argument du dialogue
politique est d'autant plus pertinent qu'initialement le code électoral
devrait être adopté par le parlement monopartisan en juillet, sans
concertation ; de même, l'élection
251 Diouf, (M), « Libération politiques ou
transitions démocratiques : perspectives africaines »,
CODESRIA, 1998, p. 32.
252 Sindjoun, (L), « Elections et politique au Cameroun :
Concurrence déloyale, coalitions de stabilité
hégémonique et politique d'affection », African Journal
of Political Science, vol. 2, n°1, 1997, pp. 81-121. Ainsi, à
la suite de l'élection du 11 octobre 1992, des émeutes ont
éclaté dans la province du nord-ouest après la
proclamation des résultats, ce qui portera un coup dur à la
démocratie naissante du Cameroun.
253 Dobry, (M), Sociologie des crises politiques,
Paris, Presses de la Fondation Nationale de Science Politique, 1992,
cité par Sindjoun, (L), « Elections et politique au
Cameroun : Concurrence déloyale, coalitions de stabilité
hégémonique et politique d'affection », in African
Journal of Political Science, vol. 2, n°1, 1997, pp. 81-121.
254 Sindjoun, (L), «Art. cit.», pp. 90-94.
61
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
présidentielle était anticipée en octobre
1992. Au terme de la Conférence Tripartite, le comité technique
de rédaction de l'avant-projet de loi portant code électoral
comprend les représentants des partis politiques255, des
pouvoirs publics256 et les personnalités
indépendantes257. La composition du comité technique
de rédaction de l'avant-projet de décret portant accès des
partis politiques aux médias audiovisuels publics est
variée258.
Le dialogue politique influence le référentiel
de la compétition électorale. Après les élections
législatives du 1er mars 1992, le parlement deviendra pluraliste. En
d'autres termes, c'est de manière pluraliste que se construit le
référentiel multipartisan ou concurrentiel de politique
électorale et d'ouverture au dialogue politique.
SECTION 2 : LES USAGES EXTERNES DU MONITORING DES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
A priori difficilement conciliables, souveraineté de
l'État et principe de légitimité démocratique
peuvent toutefois se rencontrer, dès lors que les tenants de la
première et les défenseurs du second ne s'accotent pas sur des
approches maximalistes. Toutefois, le monitoring des élections comme
astuce de promotion de la démocratie par la communauté
internationale (Paragraphe 1), et à l'intégration du monitoring
des élections dans le dispositif global de sécurité
collective (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le monitoring des élections comme
astuce de promotion de la démocratie par la communauté
internationale
Il n'y a pas atteinte à la souveraineté
étatique de l'État lorsque les limitations à sa
souveraineté résultent de son libre consentement. Toutefois, on
peut se demander si une telle conciliation iréniste259 ne
cacherait pas une bien pénible réalité (A). Ainsi,
à défaut d'une réelle volonté politique des Etats
visant à pérenniser le principe de légitimité
démocratique, il est nécessaire le recours au monitoring des
élections comme mesures non-coercitives pour l'établissement de
la démocratie (B).
A. Une incompatibilité dans les faits : cas de
l'élection présidentielle de 1992
Quel que soit son contenu, le monitoring des élections
présidentielles, fleuron majeur du principe de légitimité
démocratique, n'est pas contraire à la souveraineté
étatique si son contenu concret est accepté volontairement
suivant même des pressions venant de la communauté internationale
ou conventionnellement de l'État260. Aussi, le monitoring des
élections, à travers des accords de paix, consécutifs
à des conflits armés ou à des crises politiques, voire
dans le cadre d'appui aux pays en transition démocratique,
apparaît-elle compatible avec la souveraineté étatique
255 Mbah Philipe, Issa Tchiroma Bakary, Me Bobbo Hayatou.
256 Eyebe Ayissi, Gwanmessia.
257 Le chef Ngompe et Victor Ayissi Mvondo.
258 Représentants des pouvoirs publics, des partis
politiques et les personnalités indépendantes.
259 Nous empruntons cette expression à Dodzi Kokoroko,
« Souveraineté étatique et principe de
légitimité démocratique », Revue
québécoise de droit international, 2003, p. 45.
260 Il faut ce soit le Cameroun qui invite les OIG à
s'impliquer dans le monitoring des élections et qui accrédite les
OSC.
62
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
puisque étant expressément prévue ou
consacrée, voire consentie. Ainsi, plutôt que de
l'appréhender comme un abandon de la souveraineté
étatique, serait-il nécessaire de la considérer comme une
restriction volontaire de la souveraineté261? Dans ces cas de
figure précités, il y a bien conciliation entre
souveraineté étatique et principe de légitimité
démocratique.
En effet, l'intervention de la communauté
internationale dans le monitoring des élections se fait à la
demande de l'État directement concerné, une façon de
montrer qu'il dispose d'un instrument lui permettant de
choisir et non d'ouvrir au regard extérieur un aspect de ses affaires
intérieures. Elle doit être ainsi analysée comme une
limitation volontaire de sa souveraineté par
l'État262. À ce propos, Jean
Combacau écrit que :
« le droit international n'est pour chaque Etat que
la somme de ces limitations de sa liberté légale primitive.
Partout où il l'a laissé intervenir, il a consenti à voir
les autres Etats s'intéresser licitement à son comportement,
même le plus intime en apparence, dès lors qu'un Etat s'est
engagé internationalement envers un ou plusieurs autres fût-ce sur
un objet aussi interne que le traitement de ses propres sujets sur son propre
territoire ou l'organisation de ses pouvoirs publics constitutionnels, ses
partenaires sont aussi parfaitement fondés à lui demander des
comptes sur la façon dont il s'en acquitte qu'il l'est de son
côté dans ses relations avec eux : rien dans ses regards
réciproques ne heurte la souveraineté
»263.
Le monitoring des élections présidentielles ne
saurait donc être analysé comme une contradiction à
l'article 2 §7 de la Charte des Nations unies ou une
ingérence démocratique264, puisque
d'ailleurs les diverses résolutions onusiennes visant l'affermissement
du principe d'élections libres et démocratiques insistent toutes
sur le respect à accorder à la souveraineté de
l'État. Ces résolutions
réaffirment, par ailleurs, que les processus
électoraux ressortissent aux affaires relevant exclusivement de la
compétence interne des Etats et constituent l'expression
de la souveraineté politique de ces derniers ;
même si cette volonté politique doit être analysée
comme une protection de l'individu et non de l'Etat, afin d'assurer la garantie
de l'autodétermination interne des peuples à laquelle les Etats
se sont engagés à travers de nombreux instruments
internationaux265. Toutefois, au-delà du
261Les critiques les plus véhémentes
adressées jusqu'ici à l'observation internationale des
élections se fondent sur la souveraineté étatique,
fondement du domaine réservé. Or, ce concept est aujourd'hui
marqué d'un caractère évolutif. Ainsi, c'est le droit
international qui détermine l'étendue des compétences
discrétionnaires des États, l'étendue du domaine
réservé dépend de la portée des engagements
internationaux de chaque État et des interventions « autoritaires
» des organisations internationales. En ce sens.
262L'autolimitation prise dans son sens
littéral est le fait de n'obéir qu'à des normes qu'on
s'est soi-même données. Dire de l'État qu'il est autonome
signifie donc que seules sont légalement efficaces à son
égard les règles et les situations de droit à
l'opposabilité desquelles il a consenti. L'exigence du respect du droit
international par les Etats est un des principes limitant leur liberté
d'action dans la mesure où elle garantit les autres corollaires de la
souveraineté. Si c'est en vertu du droit international que l'Etat peut
exercer la plénitude des compétences internationales, ce ne peut
être que dans les limites fixées par le droit international. La
soumission au droit international est inséparable de la
souveraineté.
263 Combacau, (J), « Pas une puissance, une
liberté : la souveraineté internationale de l'État »,
in Pouvoirs, n°67, 1993, p. 52; Dupuy, (P-M), « Situation et
fonctions des normes internationales », in Le devoir
d'ingérence, Paris, Denoël, 1987, p.155 et pp. 158 et ss.
264 De Raulin, (A) «L'action des observateurs
internationaux dans le cadre de l'ONU et de la société
internationale», in R.G.D.I.P., 1995, p. 592.
265 Certains Etats s'offusquent de voir d'autres États
ou Organisations internationales subordonnés à un plus grand
respect des droits de l'homme. Il ne paraît cependant pas douteux que la
protection des droits fondamentaux de l'individu échappe, depuis
longtemps, au domaine réservé des Etats. Il suffit, de
considérer le
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
rôle de l'ONU, des organisations internationales
régionales, des organisations non-gouvernementales et des États
eux-mêmes dans une relative mise au pas de la souveraineté de
l'État et dans la promotion d'un ordre démocratique
international, il reste des obstacles à surmonter, dont certains se
résument en ces nombreuses mesures prises par certains gouvernements au
nom de leur souveraineté étatique afin de corseter le travail des
observateurs internationaux.
B. Le recours au monitoring des élections comme
mesures non-coercitives pour l'établissement de la démocratie :
cas de l'élection présidentielle de 1992
L' « euphorie démocratique » s'inscrit dans
un contexte marqué du sceau de la mondialisation de
l'hégémonie occidentale et de l'extraversion des acteurs du jeu
politique local266. Centre du système international dont
elles ont organisé la mondialisation, les sociétés
d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord semblent occuper une
même position de pouvoir et sont réunies par une même
grammaire politique à prétention universaliste : la
démocratie représentative267. C'est cette
prétention à l'universalité démocratique qui
justifierait l'action des organisations internationales et les puissances.
Ainsi, afin de mieux cerner les différents contours de cette offensive
dans le processus de démocratisation camerounais, il est opportun, de
prime abord, d'en analyser le contexte.
Trois faits majeurs sont révélateurs du
caractère non équivoque de l'engagement du gouvernement
américain en faveur du changement démocratique au Cameroun.
D'abord, les Communiqués de Presse et/ou les
Déclarations du Département d'Etat sur le processus de
démocratisation camerounais qui, de toute évidence, font partie
des leviers par excellence de la pression américaine sur le pouvoir, en
même temps qu'ils constituent un soutien psychologique indéniable
aux organisations partisanes oppositionnelles et /ou à la «
société civile ». Ainsi, faisant suite à la
proclamation des résultats des élections présidentielles
du 11 octobre 1992 et à la décision du pouvoir de
décréter l'état d'urgence dans la Province du Nord-ouest,
la déclaration du 13 novembre 1992 du porte-parole du Département
d'Etat, monsieur Richard Boucher, critique, non sans véhémence,
le recours à l'intimidation de la part du gouvernement camerounais
après l'« élection présidentielle anticipée du
11 octobre entachées de sérieuses irrégularités
»268. Quant au communiqué de presse du 22 novembre 1994
dont la quintessence et la réaction camerounaise ont judicieusement
été examinées dans une étude non lointaine, il
intimait l'ordre au pouvoir d'initier un processus transparent et de mettre fin
au harcèlement et à la détention des journalistes. Par
ailleurs, le communiqué du 31 août 1995, du porte-parole du
Département d'Etat, monsieur Nicolas Burns, reprend en quelque sorte
l'argumentaire du précédent sur l'urgence de la
libéralisation de la presse tout en exhortant le pouvoir à
promouvoir la démocratie : « le gouvernement des Etats-Unis
nombre et l'importance des instruments conventionnels
consacrés à la question, le développement sur cette base
de règles coutumières sinon même de normes de jus
cogens.
266 Sindjoun, (L), Construction et déconstruction
locales de l'ordre politique au Cameroun. La Sociogénèse de
l'Etat, Thèse de Doctorat d'Etat en Science Politique,
Université de Yaoundé II, F.S.J.P, Année académique
1993-1994, p. 134.
267 Ebolo, (M.D), La dynamique de paix en Afrique
Centrale, Mémoire de Maîtrise en Science Politique,
Université de Yaoundé, F.D.S.E, septembre 1989.
268 Déclaration post-électorale
préliminaire du 14 octobre 1992 et du Rapport provisoire de la Mission
d'Observateurs Internationaux du NDI à l'élection
présidentielle anticipée du 11 octobre 1992.
63
64
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
exhorte le gouvernement du Cameroun à abandonner les
pratiques qui limitent la liberté d'expression, et à adopter des
mécanismes administratifs qui édifieront la confiance
générale dans l'attachement du Gouvernement camerounais à
la démocratie »269.
Ensuite, les Rapports annuels du Département d'Etat sur
les Droits de l'homme au Cameroun : ils sont la résultante d'une
décision du congrès, en 1974, qui demanda au Département
d'Etat de produire un rapport annuel en la matière sur chaque pays dans
le monde. Longtemps resté sans échos et sacrifié à
l'autel de la « real politik », le contenu de ces rapports a
désormais un impact sur la politique étrangère des
Etats-Unis depuis la fin de la guerre froide. Des quatre rapports (1993, 1994,
1995, 1996) que nous avons pu examiner, apparaît clairement une
perception négative du processus de démocratisation camerounais.
En guise d'introduction à tous ces rapports, se profile une phrase
identique : « République multipartite seulement de nom, le
Cameroun continue à être gouverné en réalité
par le Président Biya et son cercle de conseillers, issus principalement
de son groupe ethnique et son parti, le Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (RDPC) »270.
Enfin, parallèlement à ces actions visant
à infléchir la position du pouvoir, existe un Fonds pour la
démocratie et les droits de l'homme destiné à soutenir la
"société civile" et les institutions démocratiques. Le
montant des subventions allouées par ce fonds peut atteindre la somme de
25.000 dollars US271. Placé directement sous
l'autorité de l'ambassadeur, ce fonds, qui a déjà
financé plusieurs projets, dénote de l'importance accordée
par cette puissance à l'émancipation de la «
société civile », passage obligé de l'enracinement de
l'Etat de droit démocratique.
Paragraphe 2 : La souveraineté étatique et le
principe de légitimité démocratique
L'instauration d'un ordre démocratique international
dont le fleuron majeur demeure le monitoring des élections
présidentielles est-elle universelle ? Au regard du semi-échec
d'une telle lecture, il convient de prendre la teneur du concept de
souveraineté de l'Etat en l'état actuel du droit international
public (A) et du principe de légitimité démocratique
(B).
A. La souveraineté étatique,
qualité de l'Etat
Le principe de non-ingérence, un des corollaires de la
souveraineté de l'Etat, a été le fondement juridique de
l'inertie et de l'indifférence de la communauté internationale.
Il a surtout servi à légitimer une interprétation minimale
d'autres droits internationalement consacrés comme le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes272.
269 Cf. Documents de l'ambassade des Etats-Unis à
Yaoundé, novembre 1992.
270 Déclaration post-électorale
préliminaire du 14 octobre 1992 et du Rapport provisoire de la Mission
d'Observateurs Internationaux du NDI à l'élection
présidentielle anticipée du 11 octobre 1992.
271 Cf. Fonds pour la Démocratie et les Droits de
l'homme. Documents de 1'ambassade des Etats-Unis à Yaoundé,
1998.
272 Batailler-Demichel, (F), « Droits de l'homme et
droits des peuples dans l'ordre international », in, Le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes. Méthodes d'analyse du droit
international, 1984, Paris, Pedone, pp. 23-34 ; Christakis, (T), Le
droit à l'autodétermination en dehors des situations de
décolonisation, Paris, La Documentation française ;
Aix-en-Provence, Université d'Aix-Marseille III, Centre d'études
et de recherches internationales et communautaires, 1999.
65
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
La combinaison du principe de non-ingérence et du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes avait donné naissance
à un droit, noble dans sa formulation, indiqué dans sa pratique,
à savoir « le droit inaliénable » qu'a tout Etat de
« choisir son système politique, économique, social et
culturel sans aucune forme d'ingérence de la part d'un autre Etat
». A l'occasion de l'élection présidentielle
anticipée du 11
octobre 1992, de nombreux acteurs se sont impliqués dans
ce processus électoral. L'interprétation qui en a
résulté est que chaque Etat détermine
souverainement, discrétionnairement son statut
politique, la forme de son régime et les modalités d'exercice du
pouvoir politique273. Le choix du Cameroun fut
considéré comme une affaire « relevant essentiellement de la
compétence nationale »274 de
chaque Etat, pour reprendre la formule de l'article 2 §7
de la Charte des Nations Unies275. En conséquence, comme le
constate Hector Gros-Espiell :
« à l'organisation constitutionnelle de
l'État, à la forme de gouvernement et au système
d'intégration des pouvoirs de l'État L...] les élections,
en tant que procédé d'intégration des organes
législatif et exécutif prévus par la constitution,
relevaient du seul domaine du droit interne. Le droit de participer aux
élections, d'être électeur et d'être élu,
était une question que chaque pays résolvait exclusivement au
moyen de son système constitutionnel et juridique. Que les
élections aient lieu ou non, qu'elles aient été
ajournées ou non, qu'elles aient été authentiques et
libres, frauduleuses et viciées, voilà qui laissait le droit
international indifférent »276.
L'Assemblée générale de l'ONU, au
paragraphe 5 de sa résolution 2131 du 21
décembre 1965 portant « Déclaration sur
l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures
des États » affirmait que « tout Etat a le droit de
choisir son
système politique, économique, social et
culturel sans aucune forme d'ingérence de la part de n'importe quel Etat
». Le scrutin présidentiel du 11 octobre 1992 a
été une illustration parfaite de ce principe de
l'inadmissibilité de l'intervention des
puissances occidentales et des organisations internationales
dans le processus de démocratisation du Cameroun.
La Cour internationale de justice, dans son arrêt du 27
juin 1986 sur l'Affaire des activités militaires et paramilitaires au
Nicaragua, a reconnu valeur coutumière à un tel principe et
considéré que « l'intervention interdite doit donc
porter sur des
matières à propos desquelles le principe de
souveraineté des Etats permet à chacun de se décider
librement », et la Cour d'ajouter qu'il en est ainsi du choix du
système
politique, économique, social et culturel : «
les orientations politiques internes d'un Etat relèvent de la
compétence exclusive de celui-ci (...). Chaque État
possède le droit fondamental de choisir et de mettre en oeuvre comme il
l'entend son système politique, économique et social (...)
». L'élection présidentielle anticipée du 11
octobre
1992, était justement l'occasion pour le Cameroun
d'expérimenter ce choix après plusieurs années de
régime de parti unique277. Conclure autrement reviendrait
à
273 Ebolo, (M. D), « Art. cit.», pp. 51-56.
274 Idem.
275 Feuer, (G), « Nations Unies et démocratie »,
in Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1977, p. 1073.
276 Gros-Espiell, (H), « Liberté des
élections et observation internationale des élections. Rapport
général», dans Colloque de la Laguna, Liberté
des élections et observation internationale des élections,
Bruylant, Bruxelles, 1994, p 79. Toutefois, on peut signaler des interventions
unilatérales de certaines puissances occidentales dans les affaires
intérieures d'un autre État. De telles interventions peuvent se
fonder sur des irrégularités électorales.
277 Lire Talla, (B-P) « Les principes de l'alternance
» in Jeune Afrique Economie, n° 165, mars 1993, p. 3 ; Voir
aussi Monga, (C), «L'indice de Démocratisation: Comment
déchiffrer le nouvel aide-mémoire de l'autoritarisme», in
Afrique 2000, n° 22, juillet-septembre 1995, p. 63.
66
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
priver de son sens le principe fondamental de la
souveraineté des Etats sur lequel repose tout le droit international et
la liberté qu'un État a de choisir son système politique,
social et culturel278.
Ainsi, la liberté du choix du système politique
est consacrée. Il s'agit d'une liberté reconnue au Cameroun, et
non plus vraiment aux « citoyens ». De ce fait, le droit
international n'a pas consacré un droit de l'homme au choix du
système politique et des gouvernants de son pays, c'est-à-dire le
droit d'élire, d'être élu et d'être consulté
directement sur les grands choix de société ; ou du moins les
instruments internationaux qui l'ont prévu l'ont fait de manière
si insuffisante et timide qu'il n'en a pas résulté de
conséquences pratiques. Le principe d'autonomie constitutionnelle et
d'indifférence du droit international vis-à-vis de la forme
interne de gouvernement a ainsi, de manière générale,
étouffé l'aspect interne de l'autodétermination, le «
voile de la souveraineté » n'étant levé que pour des
cas particuliers. A titre illustratif, nous évoquerons la question de
l'Espagne franquiste qui, en 1946, a fait couler beaucoup d'encre au sein de
l'hémicycle onusien. Les débats ont révélé
deux tendances parmi les délégués des États
participant aux débats. La première tendance était
favorable à la non-admission de l'Espagne à l'ONU, du fait de la
nature de son régime politique (dictature militaire du
Général Franco), qui menaçait la paix et la
sécurité internationales. En effet, selon l'avis du
délégué de la Tchécoslovaquie, la présence
de l'Espagne à l'ONU était de nature à contrarier les
desseins de la construction d'une société internationale
fondée sur les bases « d'un ordre mondial démocratique et
juste ». Une telle prise de position ne serait pas contraire au principe
de non-intervention279. La seconde tendance, qui influencera la
position officielle de l'ONU, comptait parmi ses ténors le
délégué colombien. Ce dernier arguait qu'il n'était
pas envisageable d'accepter l'idée que la création d'un
gouvernement et sa forme ne soient plus une affaire exclusivement de la
compétence nationale de chaque État tel que le prévoit le
§ 7 de l'article 2 de la Charte de l'ONU280.
Cette constance de la communauté internationale
était résumée ainsi en 1974 par Charles Chaumont : «
il n'y a pas de légalité internationale des gouvernants : il
n'y a qu'une légalité interne que les États
étrangers n'ont pas le droit de contrôler
»281. Néanmoins, il n'est pas exclu, comme le
souligne Jean Combacau la même année, que l'organisation
internationale tient compte de tous les indices qui peuvent lui permettre de se
faire une opinion sur tous ces points. Le caractère non
démocratique d'un gouvernement pourrait être invoqué
à ce titre, si les Nations unies considéraient en fonction de
l'idéologie politique dominante que les obligations de la Charte sont
trop contraires aux exigences d'un régime non démocratique pour
qu'on puisse raisonnablement présumer qu'il accepte sincèrement
de s'y conformer282.
278 Affaires des activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua, supra note 1 à la p. 133: « la seule
dérogation reconnue à la règle concerne les régimes
nazis et racistes, autrement dit, « toutes les idéologies et
pratiques totalitaires ou autres, en particulier, nazies, fascistes,
néo-fascistes fondées sur l'exclusivisme ou l'intolérance
raciale ou ethnique, la haine, la terreur, le déni systématique
des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; Caroline
Lang, L'affaire Nicaragua c. États-Unis devant la CIJ, Paris, Librairie
générale de droit et jurisprudence, 1990; Eisenmann, (P-M),
« L'arrêt de la CIJ du 27 juin 1986 dans l'affaire des
activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
», 1986, 32 A.F.D.I., pp. 153.
279 Doc. Off. AG NU, 1ère session,
séances plénière, 10 janvier au 4 février 1946, p.
352.
280 Doc. Off. AG NU, 1ère session,
58ème séance plénière, 23 octobre au16
décembre 1946, p. 1182.
281 Chaumont, (C), Le consentement à
l'ingérence militaire dans les conflits internes, Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1974, p. 176.
282 Combacau, (J), Le pouvoir de sanction de l'ONU. Etude
théorique de la coercition non militaire, Paris, Pedone, 1974, pp.
176 et ss; Burdeau, (G), « Régime politique et
communauté internationale », (1953), R.G.D.I.P. p. 528.
67
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Outre la définition de la souveraineté
étatique, il convient de s'intéresser au principe de
légitimité démocratique.
B. L'émergence d'un principe de
légitimité démocratique
Si l'on peut, sans grandes difficultés, cerner ce
qu'est l'autonomie constitutionnelle des États, il apparaît plus
difficile de donner une définition précise de
légitimité démocratique. Pour cause, l'état des
relations internationales a mis entre parenthèses, a refoulé une
contradiction inhérente au droit international contemporain qui
éclate aujourd'hui au grand jour, à la faveur de la
transformation de l'ordre politique international. Elle oppose le principe de
souveraineté des Etats et son implication majeure, le principe de
l'autonomie constitutionnelle des Etats, aux droits de l'homme et au droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes283. Il est donc clair
aujourd'hui que la forme de gouvernement des membres de la communauté
internationale que sont les États-Nations est devenue, dans une mesure
croissante, un élément majeur de l'agenda politique
international284.
La légitimité démocratique est de nature
politique, contenu d'une doctrine politique ou encore un principe de relations
internationales ou de politique extérieure de certains Etats. Elle peut
aussi être consacrée par le droit, auquel cas, elle est le contenu
d'une norme qui élève la valeur au rang d'obligation juridique.
Et si elle est consacrée par le droit international, elle peut
être le contenu d'une norme régionale ou universelle. La
consécration du principe de légitimité
démocratique, même si elle n'est pas universelle, a suivi une
évolution et se justifie assez largement. A titre illustratif, on peut
citer un certain nombre de conventions internationales ou régionales qui
mettent en exergue l'exigence démocratique comme condition sine qua
non de l'application desdites conventions ou accords à l'image de
la Convention ACP/UE signée le 23 juin 2000 à Cotonou
(Bénin) avec à l'appui la « conditionnalité
démocratique » de l'aide au développement si chère
à l'UE, appliquée, de façon discutable, par le Fonds
monétaire international ou la Banque mondiale285.
Cette vision de la scène internationale emporte
l'assentiment de Hubert Thierry lorsqu'il écrit en 1997 que le principe
de l'égale légitimité des régimes politiques,
envisagé comme un corollaire de la souveraineté tend à
céder le pas à un principe de légitimité
démocratique, soit que les États affaiblis dans le tiers Monde et
à l'Est :
283 La notion de « domaine réservé »
est une notion directement fondée sur le droit international et la
souveraineté étatique et demeure un concept juridique et non
politique. A l'origine, la thèse dominante sur la notion comprenait les
matières se rattachant à la vie « intime », «
domestique » selon la terminologie anglo-saxonne de l'Etat. En
particulier, toutes les questions liées à son régime
politique ou à la législation sur l'octroi de la
nationalité. Cette thèse du « domaine réservé
» par nature sera battue en brèche par une approche traditionnelle
qui s'est révélée par le truchement du Traité
francoanglais du 14 octobre 1903, la Convention I de La Haye. Cette approche
sera confirmée par l'article 15 § 8 du Pacte de la
Société des Nations (SDN) et par l'article 2 §7 de la Charte
des Nations Unies. Il ne paraît cependant pas douteux que la protection
des droits fondamentaux de l'individu échappe depuis longtemps au
domaine réservé des États. Il suffit, pour s'en
convaincre, de considérer le nombre et l'importance des instruments
conventionnels consacrés à la question, le développement
sur cette base de règles coutumières sinon même de normes
de jus cogens. (Voir Combacau, (J) et Sur, (S), Droit international
public, 5ème éd., Paris, Montchrestien, p.
254).
284 Jankowitsch, (P), « Suites nationales et
internationales à donner au rapport des observateurs électoraux
», in Colloque de la Laguna, Liberté des élections et
observation internationale des élections, Bruylant, Bruxelles, 1994, p.
259; Gounelle, (M) « La démocratisation, politique publique
internationale », in Mélanges, Thierry, (H),
L'évolution du droit international, Paris, Pedone, 2001, aux pp.
203 et ss.
285 Feuer, (G), « Le nouveau paradigme pour les relations
entre l'UE et les Etats ACP : l'accord de Cotonou du 23 juin 2000 », in
R.G.D.I.P., 2002, p. 269.
68
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
« aient pris conscience de l'échec des
régimes non-démocratiques et du lien entre les exigences du
développement et celle des droits de l'homme, soit qu'ils cèdent
à la pression exercée par les puissances démocratiques.
L'évolution en ce sens est naissante mais de façon plus radicale
le libre choix des modèles (...) des politiques qui apparaissaient,
particulièrement de la souveraineté, cède le pas à
des choix économiques guidés ou imposés par les
dispensateurs d'aides et de concours au Cameroun »286.
A priori difficilement conciliables, souveraineté de
l'État et principe de légitimité démocratique
peuvent toutefois se rencontrer, dès lors que les tenants de la
première et les défenseurs du second ne s'arc-boutent pas sur des
approches maximalistes. Toutefois, les faits démentent cette vision des
rapports souveraineté étatique-principe de
légitimité démocratique.
286 Thierry, (H), «L'État et l'organisation de la
société internationale », in L'État souverain
à l'aube du XXIème siècle. Actes du Colloque de Nancy
: XXVIIe colloque de la Société française pour le droit
international, Paris, Pedone, 1994 p. 146.
69
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CONCLUSION PARTIELLE
Ce troisième chapitre est capital puisqu'il permet
d'élucider l'investissement politique et l'usage que les acteurs font du
monitoring des élections tant au niveau interne (national) qu'au niveau
externe (international). Les logiques stratégiques de participation de
chacun permettent de comprendre la perception que les acteurs ont du champ
politique et surtout électoral camerounais, et la rationalité
attachée à ces champs en termes de motivations et d'enjeux. Il
apparaît alors que le monitoring des élections
présidentielles est largement fondée sur un dessein
hégémonique de l'Etat dans la gestion des affaires
intérieures d'une part et d'autre part sur la recherche par les autres
acteurs de l'imposition d'un modèle venu d'ailleurs au nom d'une
certaine conditionnalité démocratique au Cameroun.
70
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CHAPITRE 4 : LES EFFETS DE REALITE DU MONITORING DES
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
« L'un des fondements de l'observation
électorale repose sur l'engagement de la communauté nationale et
internationale à oeuvrer pour la promotion et la sauvegarde de la
démocratie, des droits de l'homme et de la justice de par le monde.
»287
La dynamique des missions de monitoring des élections
présidentielles a peu transformé le mode de fonctionnement des
régimes politiques dans les Etats ou elles se sont
déployées. Elle a nécessairement donné
matière à de nombreuses interventions ainsi qu'à
d'innombrables réflexions autant au Cameroun qu'ailleurs et parfois au
sein même de ces missions288.
L'analyse des effets de réalité du monitoring de
ces missions, dans le cadre des élections présidentielles
reviendrait un tant soit peu à s'interroger sur les mérites et
les limites de ces nouveaux acteurs sur le processus de démocratisation
en Afrique en général et au Cameroun en particulier, depuis le
retour du multipartisme dans notre pays depuis les années
90289.
S'il est vrai que l'exercice n'est pas aisé au regard
de la force des déterminismes culturels, et parfois des fluctuations
existantes d'un scrutin à un autre, et pour des besoins de logique
méthodologique, nous avons choisi d'analyser successivement les
mérites (Section 1) et les limites (Section 2) des missions de
monitoring des élections présidentielles.
SECTION 1 : LES MERITES DES MISSIONS DE MONITORING DES
ELECTIONS : ENTRE AMELIORATION DU PROCESSUS ELECTORAL ET STABILITE
SOCIOPOLITIQUE
Il y a incontestablement des mérites au
déploiement des missions de monitoring des élections en
général et, qui plus est, des élections
présidentielles parce que portées par un ensemble de principes et
valeurs propres et parce que conduites quelquefois avec une certaine
lucidité dans un contexte où la différence de vue est
désormais de plus en plus souvent perçue comme une faiblesse
devant la tendance à l'uniformisation universelle de ce que certain ont
par moment traduit idéalement par la formule de «
communauté mondiale »290. Les
mérites du déploiement de ces missions se fondent dès lors
autant sur cette capacité de singularisation que sur cette adaptation
constante à un monde devenu plus complexe et surtout face aux Etats et
à des peuples eux-mêmes en quête de repères
idéologiques, politiques et culturels et en pleine reconstruction de
leur histoire et de leurs positionnements dans une mondialisation dans laquelle
ils sont, à quelques exceptions près, moins mondialisateurs que
mondialisés291. Ces mérites peuvent
dès lors être classés en deux catégories, à
savoir : les mérites de fond (Paragraphe 1) et les mérites de
forme (Paragraphe 2).
287 Crochetet, (M), Op.cit., p.48.
288 Monney Mouandjo, (S), Op. cit., p. 197.
289 Idem.
290Kissinger, (H), La nouvelle puissance
américaine, Paris, Fayard, 2003, p. 223.
291 Hugon, (P), Géopolitique de l'Afrique,
Paris Armand Colin, 2006, p.30 ; voir aussi Bourgi, (A) et Colin, (P.J),
L'organisation internationale de La Francophonie : un instrument pour
l'expansion de la démocratie, Questions internationales n°
22.
71
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Paragraphe 1 : Les mérites de fond des missions de
monitoring des élections présidentielles
Au fond, le déploiement des missions de monitoring des
élections présidentielles s'appuie sur deux axes majeurs dont la
consécration et les constants rappels constituent les
éléments déterminants. Il s'agit notamment de la
consécration de l'indissociabilité prescrite par les instruments
internationaux et nationaux en matière de démocratie et
d'élections (A), matérialisée par une lente mais
déterminante conversion de la majeure partie des Etats aux valeurs
démocratiques (B).
A. La consécration du principe de
l'indissociabilité de la démocratie par les instruments
internationaux et nationaux et l'évaluation des organes de gestion de
l'organisation et de la conduite des élections
Il faut dire que dans le cadre des missions de monitoring des
élections de l'OIF et ce, depuis les sommets de Chaillot et de Maurice,
il s'est opéré au sein de l'organisation francophone de
réelles mutations institutionnelles ainsi qu'une incontestable mutation
dans la philosophie même des Etats francophones en général
et du Cameroun en particulier. On peut d'ailleurs et à juste titre
convenir avec Albert Bourgi, en soutenant notamment que parmi les nombreuses
institutions qui, depuis 1989, se sont attachées à permettre la
généralisation de la démocratie à travers le monde,
la Francophonie occupe une place de choix en élevant au plus haut niveau
le débat « interdisant tout retour en arrière
»292.
Bien plus, poursuit Albert Bourgi, « par leur
Déclaration de Bamako, en date du 3 novembre 2000 les gouvernements des
pays ayant le français en partage ont affirmé que «
Francophonie et démocratie sont indissociables» et qu'il ne saurait
y avoir approfondissement du projet francophone sans une progression constante
vers la démocratie et son incarnation dans les faits
»293. Ces seules affirmations témoignent
de la volonté du Cameroun à s'inscrire dans une dynamique
nouvelle fondée à la fois sur l'affirmation des principes
textuels sur la base de la Déclaration sus-citée et sur la
volonté de traduire ces principes dans les
faits294.
En effet, c'est cette Déclaration qui donne un sens
nouveau et une portée novatrice au projet démocratique
francophone, en ce qu'elle ne nie pas la complexité de la tâche,
pas plus qu'elle n'en minimise les difficultés des enjeux. Mais bien au
contraire, elle assume cette complexité tout en affirmant les valeurs de
l'OIF. Et ce sont ces principes et exigences que reprend la loi n° 2011/02
du 6 mai 2011 fixant les conditions d'élections et de suppléance
à la Présidence de la République, qui organisait ainsi
l'élection présidentielle du 09 octobre 2011.
Le principe de l'indissociabilité entre les textes
internationaux et nationaux en matière de démocratie et
d'élections, au regard du déploiement des missions de monitoring
des élections présidentielles, reste néanmoins
limitée dans la mesure où ce principe reste autant qu'un
principe. Tout dépend donc de ce qu'on met derrière
292 Bourgi, (A), L'OIF et les processus électoraux
dans l'espace francophone, 2005, (inédit).
293 Idem.
294 La loi électorale camerounaise a connu à
chaque scrutin des améliorations, bien que cela soit perçu par
l'ensemble des acteurs politiques comme une manoeuvre du pouvoir en place de
conserver le pouvoir en façonnant la loi électorale en sa faveur.
Depuis 1992, la loi organisant l'élection du président de la
république a subi plusieurs modifications, en notamment trois au
total.
72
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
chaque notion295. Car si on peut se
féliciter de cette affirmation, il faut néanmoins relever que la
théorie même du déploiement des missions de monitoring des
élections présidentielles vient atténuer en quelque sorte
l'optimisme qu'aurait pu susciter la notion d'indissociabilité
formulée par la Déclaration. S'il est en effet vrai que les
élections permettent dans bien de cas de sortir des situations de
belligérance comme ce fut encore le cas récemment au Congo
démocratique, force est de reconnaître que ces
éléments de sortie de crise ne se font pas seulement sur la base
de ce principe dit démocratique296.
D'autres paramètres entrent nécessairement en
ligne de compte et parmi eux de longues négociations comme lors des
élections sénatoriales du 14 avril 2013, avec l'appel du parti au
pouvoir, recalé dans l'Adamaoua à ses grands électeurs de
voter pour le SDF ou encore le cas en juillet 2007 en Côte d'Ivoire
où l'ex rébellion menée par Guillaume Soro a réussi
à sceller un accord de paix avec son ex-rival Laurent
Gbagbo297.
Plus encore cette reconnaissance ouvre les mérites du
déploiement des missions de monitoring des élections
présidentielles au plan formel et notamment à travers une lente
mais déterminante émergence des valeurs démocratiques dans
les pays de l'organisation francophone. Il faut d'emblée relever que le
respect des règles de conduite d'une élection constitue un
impératif. L'évaluation des règles en vigueur permet de
porter un jugement sur la qualité du scrutin en général et
notamment sur la qualité des institutions, des règles ainsi que
de leur degré de neutralité et de leur
objectivité298. L'évaluation des
institutions chargées de l'organisation et de la conduite des
élections fait donc partie des priorités des missions de
monitoring des élections. Cette évaluation des organes de gestion
des élections peuvent à elles seules suffire à juger de la
liberté et la transparence d'une élection présidentielle.
En 1992 par exemple, lors de l'élection présidentielle
anticipée du 11 octobre, le NDI ainsi que l'ensemble des acteurs et des
parties prenantes à cette élection estimaient que le MINAT
roulait pour le candidat du parti au pouvoir, et jugeait qu'il fallait que
cette administration soit exclue de l'organisation et de la gestion des
élections299. Comme l'a aussi relevé l'ONG 1MA, une
organisation des élections autour du MINATD est de nature à
entraver le fonctionnement régulier de la démocratie parce que
peu propice à une consultation électorale
fiable300.
Pareille observation démontre en effet la rigueur du
monitoring qu'aucun élément ne doit être pris à la
légère. Tous contribuent à l'observation et sont objet
d'observation et d'évaluation. Car, une institution trop puissante peut
effectivement donner lieu à des élections biaisées, de
même qu'une loi léonine peut difficilement
295 Monney Mouandjo, (S), Op.cit.,p. 357.
296 Idem.
297 Konadje, (J-J), L'intervention de l'ONU dans la
résolution du conflit intraétatique ivoirien, Thèse
de Doctorat en Science Politique, Université de Toulouse, 2010, pp.
94-96. L'on peut aussi voir les cas de la République Centrafricaine en
2005 et la Mauritanie où le scrutin de 2007 a été
présenté par nombre d'observateurs comme l'un des plus brillants
succès démocratiques de ces dernières années, comme
en témoigne la note de l'organisation non gouvernementale, Article XIX
qui, dans un communiqué de presse en date du 12 mars 2007, indique que :
« Article 19 se félicite de la tenue de ce scrutin et invite
les nouvelles autorités qui seront issues des urnes à tout mettre
en oeuvre pour consolider les acquis démocratiques en Mauritanie
».
298 Transparency International Cameroon, Rapport final de
la mission d'observation électorale, élection
présidentielle du 09 octobre 2011, p. 4.
299 Rapport provisoire de la mission d'observateurs
internationaux du NDI, « Election présidentielle anticipée
du 11 octobre 1992 », in Les Droits de l'Homme au
Cameroun. Livre Blanc publié par le gouvernement de la
République du Cameroun, Yaoundé, Editions de l'Imprimerie
Nationale, 1994, p. 249.
300 Un Monde Avenir, Mission d'observation électorale
de la présidentielle du 9 octobre 2011, rapport national d'analyse.
73
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
être considérée comme démocratique,
d'où la nécessité de la mise en place des institutions
fiables pour la construction d'une culture des principes démocratiques
et l'observation des instruments juridiques électoraux.
B. La mise en place d'institutions de plus en plus
fiables, la construction d'une culture des principes démocratiques et le
monitoring des instruments juridiques électoraux
Il faut rappeler que les missions de monitoring des
élections présidentielles ont considérablement
réformé les pratiques politiques et juridiques au Cameroun. L'une
des fiertés majeures reste pour le moment le dessaisissement de
l'organisation des élections au MINATD depuis la création de
l'ONEL en 2000 d'ELECAM en 2006 d'autre part. Les suspicions qui ont toujours
pesé sur le MINATD ont conduit les acteurs politiques camerounais
à remettre en cause cette administration dans la gestion. Cette
récusation du MINATD dans la conduite des processus électoraux en
général a animé la première moitié des
années d'ouverture démocratique au Cameroun. La méfiance
nourrie à l'égard de cette administration est justifiée
par son inféodation par le parti au pouvoir et les forfaitures commises
par cet organe au Cameroun.
L'obligation de rendre compte qui pèse sur lui
s'étend également à ses représentants, dans les
circonscriptions administratives, en charge du pilotage, à la base, du
processus électoral. Ce noyautage de toute la chaîne du processus
électoral et ses démembrements territoriaux par le gouvernement a
été très vite perçu comme un facteur négatif
limitant l'épanouissement du jeu démocratique dans la toute
nouvelle démocratie en construction au Cameroun, à l'occasion de
l'élection présidentielle de 1992. Cette administration a
joué un rôle majeur dans la gestion de ce scrutin, qui a connu une
issue somme toute trouble avec des résultats
différents301. Il n'est nullement de nature à offrir
les traditionnelles garanties minimales de neutralité,
d'impartialité, de transparence et de sincérité dans
l'expression du suffrage et du scrutin du 11 octobre 1992. Or, l'existence d'un
cadre organisationnel crédible permettant un déroulement
harmonieux du processus électoral emportant la confiance et
l'adhésion de tous les protagonistes du jeu électoral à
des règles consensuelles est le gage minimal d'une élection
régulière, transparente, sincère et
loyale302.
La suspicion ou la méfiance qui pèse sur le
Ministère de l'Intérieur n'est pas dénuée de tout
fondement. Ainsi, comme précédemment souligné, l'appareil
étatique en charge de l'organisation des élections a, pendant
longtemps au Cameroun, fait
301 Le résultat proclamé par la Cour
suprême à l'issue du recensement de tous les votes donnait
vainqueur le candidat du parti au pouvoir, alors que les observateurs du NDI
donnaient vainqueur le candidat de l'opposition. Toutefois, il faut souligner
que la Cour suprême relevait que les irrégularités
constatées dans l'organisation de l'élection ne pouvaient pas
entacher le résultat de ce scrutin. Cependant, les observateurs du NDI
mettaient en cause les responsables de l'administration d'avoir manipulé
les résultats en faveur du candidat au pouvoir vu le score et
l'écart entre les deux candidats. Lire à ce sujet NDI,
Déclaration post-électorale préliminaire du 14 octobre
1992 et du Rapport provisoire de la Mission d'Observateurs Internationaux du
NDI à l'élection présidentielle du 28 octobre 1992
pp. 259-263. Lire aussi Déclaration du Pr. Kontchou Kouomegni Augustin,
exemple de malentendu à éviter : réponse du
gouvernement du Cameroun du 30 octobre 1992, pp. 255-256.
302 Le spectacle très peu reluisant de
l'élection présidentielle anticipée du 11octobre 1992 a
poussé les principaux acteurs de la scène politiques camerounaise
à ne pas se présenter à l'élection
présidentielle suivante c'est-à-dire celle du 12 octobre 1997,
étant aussi donné que beaucoup de leurs revendications n'avaient
pas été pris en compte, à savoir, par exemple, la mise sur
pied d'un organe indépendant de gestion du processus
électoral.
74
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
preuve d'imperfections, de fraudes et de partialité. En
effet, la contestation du rôle de l'administration dans la gestion des
élections s'est engagée suite aux irrégularités et
autres fraudes ayant entaché l'élection présidentielle
anticipée du 11 octobre 1992303. Ce sont ces raisons qui ont
poussé les acteurs politiques, dans le cadre du renouveau
démocratique, à engager un dialogue politique pour dessaisir
l'administration, à travers le MINTAD, de l'organisation des
élections en général et présidentielles en
particulier.
Ce dessaisissement partiel304 dans certains cas et
total dans d'autres305 ne s'est pas fait au premier au coup il a
fallu attendre les années 2000 pour voir la mise sur pied de l'ONEL. Si
ce nouvel organe créé pour la gestion des processus
électoraux bénéficie de tous les pouvoirs
nécessaires pour l'accomplissement de sa mission dans le cadre du
dessaisissement total, il ne joue que le rôle de
supervision306. Si nous parlons la construction d'une culture des
principes démocratiques, c'est parce que nous établissons une
distinction entre la culture démocratique qui est intériorisation
et la traduction effective des principes démocratiques dans le
fonctionnement des régimes politiques par une adaptation des instruments
juridiques et des mécanismes politiques au Cameroun307. Les
institutions politiques reflètent cette culture nouvelle et cette
ambition. Plus simplement, l'habillage démocratique existe bel et bien
au Cameroun. Il n'y a qu'à voir la diversité d'opinions,
même si la remise en cause du pouvoir politique reste encore très
partiellement admise par ceux qui exercent le pouvoir. Cela témoigne des
effets des longues années de parti unique et parfois de
répression que l'histoire et les changements en cours permettront
certainement de résoudre. Quoiqu'il en soit, le déploiement des
missions de monitoring des élections présidentielles aura au
moins eu deux mérites de fond : celui de la matérialisation de
l'indissociabilité des principes de la démocratie et des
élections d'une part et celui de la faveur de l'émergence
progressive d'une culture démocratique d'autre part. Cette double
évolution de fond a inéluctablement eu des conséquences
sur la forme.
Quant à l'évaluation des instruments juridiques,
les observateurs sont tenus de coller à ces derniers car c'est en effet
eux qui déterminent les travaux de la mission et ce sont eux qui
permettront, par exemple, de porter un jugement fiable sur la mission qui leur
aura été confiée. Cette évaluation rigoureuse des
instruments juridiques et des institutions mises en place existe à cet
effet tant du point de vue de l'organisation que de celui du déroulement
effectif de scrutin. En plus des institutions et de leurs compétences,
les missions de monitoring des élections procèdent à
l'évaluation des lois électorales proprement dites. Ainsi
vont-elles être amenées à se prononcer sur leur
capacité ou non de garantir la liberté, la fiabilité et
l'indépendance d'une élection308. En effet, on est
toujours responsable devant celui dont on tient la
303 Rapport provisoire de la mission d'observateurs
internationaux du NDI, « Election présidentielle anticipée
du 11 octobre 1992 », in Les Droits de l'Homme au
Cameroun. Livre Blanc publié par le gouvernement de la
République du Cameroun, Yaoundé, Editions de l'Imprimerie
Nationale, 1994, p. 259.
304 Au Sénégal et au Cameroun.
305 Cas du Togo, du Benin, du Gabon...
306 C'est le cas de l'ONEL au Cameroun qui jouit d'un
dessaisissement partiel alors que toutes les opérations
matérielles sont encore à la charge de l'administration
étatique.
307 En ce qui concerne l'élection présidentielle
du 11 octobre 2004, le Cameroun, étant Etat partie à la
Déclaration de Bamako, a honoré ses engagements en arrimant le
scrutin présidentiel selon les principes de cette déclaration,
ainsi qu'au respect de la déclaration de Harare. Lire à ce sujet
l'OIF, Rapport de la mission d'observation de l'élection
présidentielle du 11 octobre 2004 au Cameroun, pp. 10-25.
308 Cf. Rapport de l'élection présidentielle du 11
octobre 2004 au Cameroun.
75
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
légitimité. Tout ceci démontre que les
missions de monitoring des élections peuvent être amenées
à remettre en question une loi électorale309 qui
serait susceptible d'entraver même indirectement la
régularité du scrutin. Le monitoring des élections n'est
donc pas ici une simple formalité. Elle est davantage le lieu
privilégié de l'évaluation de l'adéquation des
valeurs démocratiques avec les lois camerounaises régissant
l'élection présidentielle ou toute autre élection. Il
s'agit en effet d'un véritable test d'évaluation des
capacités à l'assimilation des valeurs démocratiques.
Il faut dire que ces mérites de fond ont conduit
à une amélioration des mérites de forme.
Paragraphe 2 : Les mérites de forme du monitoring
des élections présidentielles
La mise en place d'institutions électorales
indépendantes par les gouvernements apparaît comme une
réponse appropriée à la méfiance manifestée
à l'égard des administrations électorales formatées
dans la culture du système du parti unique, de fait ou de droit, et des
régimes militaires d'exception310. Qualifiées par
certains comme étant la manifestation de l'imagination africaine en
matière d'ingénierie juridique311, ces nouvelles
institutions, quel que soit le nom qui leur est attribué (d'une part
l'ONEL (A) et d'autre part ELECAM (B)) sont venues appuyer et enrichir le
décor institutionnel et politique de la troisième
génération de la plupart des régimes politiques africains
en général et du Cameroun en particulier 312.
A. L'Observatoire National des Elections (ONEL)
L'élection est l'unique mode de dévolution du
pouvoir dans tout système qui se réclame de la
démocratie313. Elle est une période charnière
de la vie politique de tout Etat pendant laquelle le citoyen exerce l'un de ses
droits constitutionnellement reconnus, le droit de vote, et un autre de ses
attributs non moins importants, la liberté de candidature. Le Cameroun
se veut un Etat dans lequel ces libertés fondamentales sont reconnues au
citoyen et dans lequel un contentieux peut être ouvert à la suite
des consultations électorales. Ce contentieux est au premier abord un
contentieux complexe, car assorti de multiples spécificités. Dans
ce contexte de crise de confiance à l'égard des organes
traditionnels devant assurer la régularité des élections
au Cameroun, le législateur crée le 19 décembre 2000, par
une loi n° 2000/016, une structure sensée apporter un souffle
virginal au processus électoral, l'Observatoire national des
élections du Cameroun (ONEL). Ce texte est d'emblée perçu
comme « un énième monument d'illusionnisme normatif et
de remplissage institutionnel »314 qui institue une
structure « mort-née ». C'est que l'ONEL naît
alors
309 Idem.
310 El Hadj Mbodj, « Faut-il avoir peur de
l'indépendance des institutions électorales en Afrique ?
» p. 32.
311 Du Bois de Gaudusson (J.), «Les élections
à l'épreuve de l'Afrique », in Cahier
Constitutionnel, no 13 /2002, p. 11.
312 La première génération correspond aux
régimes directement hérités de la colonisation, la seconde
génération aux régimes politiques monolithiques civils ou
militaires, alors que la troisième est celle des régimes
pluralistes nés de la vague de démocratisation de la
dernière décade du second millénaire. Voir Somali (K)
Le parlement dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique : essai
d'analyse comparée à partir des exemples du Bénin, du
Burkina Faso et du Togo, Thèse de Doctorat en Droit
Constitutionnel, Université de Lille 2, 2008, p. 11.
313 Ndoumou, (F.D), Op. cit., p. 178.
314 Olinga, (A.D), « L'ONEL : Réflexions sur la
loi camerounaise du 19 décembre 2000 portant création d'un
Observatoire national des élections », Yaoundé,
Presses de l'UCAC, 2001, p. 7.
76
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
qu'aucun consensus entre le gouvernement et l'opposition sur
la structure à retenir n'est observé, pas plus qu'on observe une
participation de la société civile à cette
édification d'une structure sensée garantir la
sincérité des scrutins au Cameroun315. Cette
institution reçoit alors un accueil mitigé auprès des
milieux politiques, en raison de l'ambiguïté de son statut et de sa
structuration, mais surtout des difficultés
liées à sa mission dans le processus
électoral camerounais. Le statut et la structuration de l'ONEL, la loi
n° 2000/016 du 19 décembre 2000 crée l'ONEL, et
censé garantir à tous les citoyens,
électeurs comme acteurs politiques, la sincérité et la
transparence des scrutins. Or, de l'avis d'Alain Didier Olinga,
« une institution est charpentée en fonction
de l'idée d'entreprise qui lui sert de boussole, de principe actif et de
régulateur. Entre l'idée d'oeuvre et la structure de la faire
accéder à l'effectivité, il y a une relation dialectique
forte : l'idée n'est rien sans une institution de concrétisation
adaptée, l'institution n'est rien sans une idée qui lui insuffle
une âme »316.
S'agissant du statut de l'ONEL, on peut être
amené à penser que l'idée pionnière était
d'en faire une structure autonome de l'administration. L'article 1er de la loi
est à cet égard révélateur puisqu'il énonce
qu'il est institué une structure
indépendante317
chargée de la supervision et du contrôle des opérations
électorales et référendaires, dénommée ONEL.
C'est l'article 3 en ses alinéas 1 et 2 qui énonce la
durée du mandat de l'institution qui débute dès la
convocation du corps électoral et
s'achève une fois les résultats
proclamés, soit par la Commission Communale de Supervision (CCS) pour
les élections locales, soit par le Conseil constitutionnel pour les
élections nationales318.
Cependant, quand on s'attarde sur sa dénomination,
l'institution est un observatoire, c'est-à-dire, selon les termes
d'Alain Didier Olinga, « une structure de vigilance de l'ensemble du
processus électoral, avec un rôle de rassemblement de
l'information utile à transmettre aux décideurs, à l'effet
d'éclairer leurs décisions et démarches futures
»319. Sa nature juridique dans l'ordre juridique
camerounais est dès lors évidente ; c'est un organe consultatif
qui de par sa structuration officie comme une juridiction, car pouvant
connaître des réclamations non examinées au niveau des
commissions mixtes de supervision. Le problème de l'indépendance
de l'institution semble alors se poser avec acuité, un problème
qui aura un impact
315 Lors de la 1ère législature de
l'ère multipartite en 1992, l'Union Nationale pour la Démocratie
et le Progrès (UNDP) avait déposé une proposition visant
à l'institution d'une Commission électorale nationale autonome
(CENA) qui restera lettre morte. Par la suite, en 1997, les différents
partis de l'opposition rassemblèrent les signatures de leurs élus
en vue de proposer une révision de la Constitution à l'effet d'y
insérer une Commission Electorale Indépendante (CENI).
Proposition une fois de plus contrecarrée par le président de
l'Assemblée nationale. Sur ces propositions d'instauration d'une
Commission électorale au Cameroun, voir Olinga, (A.D), Op.
cit., pp 7-13.
316 Olinga, (A.D), «Art. cit.», p. 13.
317 C'est nous qui soulignons.
318 Bedjoko Mbassi, « Le vote au Cameroun depuis 1992 :
Exigences normatives et pratiques sociales », in Cahier africain des
droits de l'homme, n° 9 p. 142.
319 Olinga (A.D), «Art. cit.», p. 14.
77
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
évident sur la conduite de sa mission320. Au
regard de la structure de l'ONEL, qu'elle soit centrale ou
déconcentrée, aucun rattachement formel à une autre
structure de l'Etat n'est observé, ce qui dénote d'une relative
autonomie vis-à-vis de toute structure étatique. Cependant,
l'ensemble des membres est nommé de façon discrétionnaire
par le président de la République, même lorsque ce dernier
est candidat à sa propre succession, ce qui est critiquable et pour le
moins incohérent. Une garantie est toutefois offerte aux membres,
relativement à leur mandat, car celui-ci court tout au long de celui de
l'institution et qui plus est, ils sont inamovibles. Mais, ainsi que le
relève Alain Didier Olinga, ils n'ont aucune garantie de retrouver leur
poste à la prochaine mise en place de l'institution321. Le
pouvoir discrétionnaire du président de la République sur
l'institution est prépondérant, car il peut nommer, selon son bon
vouloir, des membres pour une année électorale précise et
ceux-ci forcément ne seront pas reconduits lors de la mise en place
prochaine de l'institution. N'ont-ils pas ainsi intérêt à
oeuvrer pour la stratégie mise en place par le pouvoir en place afin
d'espérer être reconduits à leur poste ? Les membres de
l'ONEL bénéficient d'immunités pour les opinions ou actes
commis dans l'exercice de leurs fonctions et il est prévu un certain
nombre d'incompatibilités à l'exercice de celles-ci, ce qui, en
principe, est susceptible de renforcer l'indépendance de la structure.
Toutefois, certaines incohérences de la loi de 2000 remettent en cause
cette autonomie de l'institution322. Au plan financier et
matériel, la totalité des moyens mis à la disposition de
l'ONEL viennent de l'Etat. Son budget est inséré dans le budget
général de l'Etat, ce qui a conduit Alain Didier Olinga à
écrire que « l'Etat maîtrise intégralement les
moyens de l'indépendance de l'ONEL »323.
L'institution n'a pas la possibilité de s'autofinancer ou de
procéder à des appels de fonds étrangers à ceux de
l'Etat camerounais324 et les indemnités allouées
à ses membres ainsi que les frais de mission qu'ils perçoivent
sont accordés sur des conditions fixées par décret
« du président de la République vraisemblablement
», précise Alain Didier Olinga325.
Si dès lors on peut effectivement admettre que le
président de la République a un pouvoir important en ce qui
concerne la nomination des membres de l'ONEL et que l'Etat est le principal
bailleur de fonds de l'institution, on est amené à penser que
l'ONEL doit, par son propre engagement et des actions concrètes,
bâtir progressivement son indépendance. Elle a eu à le
faire, au demeurant, en s'acquittant de sa mission lors de certaines
consultations électorales. C'est l'article 2 de la loi de 2000 qui
éclaire sur la mission de l'ONEL. Celle-ci, aux termes de cette
disposition, est de « contribuer à faire respecter la loi
électorale de manière à assurer la
régularité, l'impartialité, l'objectivité, la
transparence et la sincérité des scrutins, en garantissant aux
électeurs, ainsi qu'aux candidats en présence, le libre exercice
de leurs droits ». L'ONEL, qui se greffe aux différentes
structures existant déjà dans le processus électoral,
devrait s'assurer que l'ensemble de ces structures font ce que les
320 De l'avis des membres de l'opposition camerounaise, l'ONEL
ne peut qu'être une structure inféodée au pouvoir en place,
au regard de l'autorité qui nomme les membres, de l'origine des moyens
qui lui sont alloués et de son mandat.
321 Olinga (A.D), «Art. cit.», p. 21.
322 Dime Li Nlep, (Z.P), La garantie des
droits fondamentaux au Cameroun, Mémoire de DEA en Droit
international des Droits de l'Homme, Université Abomey-Calavi,
Bénin, 2004, pp.80-87, disponible sur
www.memoireonline.com
consulté le 19 juin 2014.
323 Ibidem. p. 21.
324 A l'inverse de cette situation, la CENI au Tchad peut
compléter son budget par des concours financiers extérieurs,
cité par Olinga, (A.D), Op. cit., p. 22.
325 Idem.
78
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
textes prévoient. Pour Célestin Sietchoua
Djuitchoko, il ne fait « que s'ajouter, par sédimentation, au
dispositif électoral existant déjà...
»326. L'ONEL a ainsi une mission de supervision et de
contrôle de l'ensemble du processus électoral et ses pouvoirs
d'action sont sensés lui permettre de mener à bien cette mission.
Il a, à cette fin, des pouvoirs d'injonction aux autorités
administratives en vertu de l'article 12 alinéa 2 de la loi de 2000 et
peut même saisir les juridictions compétentes en matière de
contentieux électoral dans les cas de violation de la loi
électorale. Lors des élections municipales et législatives
du 30 juin 2002, l'ONEL a aidé à signaler de graves
irrégularités qui ont justifié l'annulation des
élections dans le département du Nkam, en vertu de l'article 12
alinéa 3 de la loi de 2000327. C'est ce rôle-là
qu'il a joué à l'occasion de l'élection
présidentielle du 11 octobre 2004.
Du reste, l'ONEL a, malgré ces difficultés, des
actions dans le domaine de la protection des droits électoraux des
citoyens camerounais. Ainsi, afin de mener à bien sa mission de
supervision et de contrôle des opérations électorales au
Cameroun, et pour la sincérité du double scrutin
présidentielle du 11 octobre 2004, cette institution avait
demandé et obtenu que les bureaux de vote ne soient pas installés
dans des domiciles privés328. Il a pu se déployer sur
l'ensemble du territoire national, recruter des délégués
pour le jour du vote et a véritablement procédé à
une campagne d'information à l'attention du public329,
participant, à n'en point douter à un contrôle strict de la
transparence du scrutin et partant, de la sincérité du vote des
électeurs camerounais. Mais si l'ONEL veut participer à la
construction d'un processus électoral crédible au Cameroun, il
doit pouvoir, de l'avis de Bedjoko Mbassi, « être une structure
permanente, dotée de moyens propres en vertu d'une loi votée par
le Parlement. Une telle autonomie, poursuit-il, le conduirait non
seulement à être indépendant vis-à-vis du pouvoir,
mais à intégrer dans son programme la formation de cadres
électoraux indépendants et du personnel de soutien,
immédiatement opérationnels, une fois que les circonstances
l'exigent »330. Ces différents critères lui
permettront d'acquérir son autonomie et de pouvoir former son propre
personnel qui serait ainsi rompu aux complexités de la chose
électorale. Mais, la transparence des consultations électorales,
qui voient la consécration du principe « un électeur,
une voix »331, passe au Cameroun par une nécessaire
implication de tous les acteurs concernés par le processus
électoral : les électeurs, les candidats, l'administration qui
organise les élections, les commissions mixtes à caractère
non juridictionnel, les juridictions compétentes en matière de
contentieux électoral, l'ONEL, pour ne citer que ceux-là. Elle
nécessite aussi, à notre avis, une relecture par le juge
constitutionnel des différentes lois électorales en vigueur et
qui ne lui ont pas été déférées, afin que
soient expurgées de l'ordre juridique les normes non conformes à
la loi fondamentale332. En effet, celles-ci contribuent grandement
à fausser la compétition électorale et, partant de
là, violent les droits fondamentaux des citoyens. Il est à noter
toutefois que de toutes les différentes structures de vigilance du
326 Sietchoua Djuitchoko, (C), « Introduction au
contentieux des élections législatives camerounaises devant la
Cour Suprême statuant comme Conseil constitutionnel », Juridis
périodique, n° 50, Avr.-Mai-Juin 2002, p. 92.
327 Selon cette disposition, « les manquements commis
par les partis politiques, les candidats ou les électeurs peuvent (...)
être portés par l'ONEL devant les autorités judiciaires
», cité par Olinga, (A.D) « Art. cit», p. 75.
328 Lire à ce sujet, Observatoire National des
Elections (ONEL), Rapport général sur le déroulement
de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004, p. 134.
329 Ibidem, p. 77.
330 Bedjoko Mbassi, «Art. cit. », p. 143.
331 Dime Li Nlep, (Z.P), Op. cit., p.79, disponible
sur
www.memoireonline.com,
consulté le 19 juin 2014.
332 Dime Li Nlep, (Z.P), Op. cit., pp. 90-101.
79
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
processus électoral, l'ONEL est la seule
composée de personnalités indépendantes. Il lui revient
donc d'écrire ses lettres de noblesse à chaque fois que
l'occasion lui est donnée, notamment lors des différentes
consultations électorales et pourquoi pas en dehors, en se forgeant
par-là un caractère de quasi-permanence. Cette
caractéristique de permanence est tout de même affectée
à un autre organe nouvellement entré en vigueur : ELECAM.
B. Elections Cameroon (ELECAM)
Le gouvernement du Cameroun, accédant aux multiples
requêtes et revendications a, par la loi n° 2006/011 du 29
décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'
« Elections Cameroon », institué un nouvel organe
indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la
supervision de l'ensemble du processus électoral, y compris le processus
de désignation du président de la république. Sa mise en
place effective par la nomination des responsables de ladite structure,
conformément à ladite loi ne pouvait excéder dix-huit
mois, c'est-à-dire, au plus tard le 30 juin 2008. Mais un jour avant le
29 juin 2008 la date réglementaire de nomination desdits responsables
qui a fait suite à une large concertation réalisée par le
Premier Ministre, les partis politiques et la société civile, le
Président de la République a signé une loi prorogeant de
18 à 24 mois le délai de mise en place effective d'ELECAM. Ce
report a été de nature à renforcer, dans une certaine
mesure, les réserves émises par l'opposition et la
communauté internationale sur la volonté politique du
gouvernement de mettre en place une structure indépendante pour la
gestion des affaires électorales. La mission d'ELECAM est définie
de manière succincte par la loi comme visant à « assurer
la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la
transparence et la sincérité des scrutins
»333. En son article 4 alinéa 1, la loi n°
2006/011 du 29 décembre 2006 confère à ELECAM la
responsabilité : « de préparer, d'organiser, de gérer
et de superviser en toute indépendance et transparence, le processus
électoral et référendaire au Cameroun ». A ce titre,
elle se voit également confier l'organisation des opérations de
révision ou de refonte du fichier électoral. La loi
prévoit en outre que ELECAM « contribue à
l'élaboration du cadre juridique nécessaire à la tenue des
consultations électorales en faisant des propositions ».
Jusqu'en 2004, lors du dernier scrutin présidentiel
avant celui de 2011, la supervision et le contrôle des élections
étaient confiés à l'ONEL, tandis que l'organisation
matérielle des scrutins relevait du MINATD. Cette situation, fortement
critiquée par l'opposition, a conduit le législateur camerounais,
dans un souci d'apaisement et de consensus, à mettre en place, à
travers la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006, un organe
indépendant, Elections Cameroon (ELECAM). ELECAM dispose d'un Conseil
Electoral (CE) de dix-huit membres et d'une Direction Générale
des Elections (DGE). Dotés de moyens humains et financiers
conséquents, avec une administration centrale et des
démembrements territoriaux, qui vont jusque dans les communes, ELECAM a
vocation à jouir d'une indépendance incontestable334.
Au plan
333 Les fonctions précises d'ELECAM sont
définies par la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006,
modifiée et complétée par la loi n°2008/005 du 29
juin 2008, modifiée par la loi n° 2011/001 du 06 mai 2011, Onana,
(J), « Elecam, le pari de l'impartialité et de la transparence
», in l'Année du Président, les voies de
l'émergence, impressions Galma, Yaoundé, 2010.
334 Toujours pour garantir l'indépendance d'ELECAM, la
loi prévoit des immunités judiciaires pour ses membres qui sont
par ailleurs inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ainsi, les
membres d'ELECAM ne peuvent être poursuivis, recherchés,
arrêtes, détenus ou jugés en raison des opinions
émises dans le cadre de leurs fonctions. Tout autant, ils ne peuvent pas
faire l'objet de poursuites pendant l'exercice de leurs fonctions,
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
financier, la loi considère le financement d'ELECAM
comme une dépense prioritaire pour le gouvernement. ELECAM dispose ainsi
d'un budget annuel et, pendant les années électorales, d'un
budget des élections dont le Directeur Général des
élections est l'ordonnateur. La mise à disposition de ce budget
est rendue obligatoire335.
Le Conseil électoral a des similitudes avec l'ONEL dans
ses missions et dans son fonctionnement, mais avec des compétences plus
élargies. Le Conseil électoral, même s'il veille à
la nomination du personnel des démembrements de la DGE, n'a pas de
démembrements sur le terrain. Ce qui limite son action et sa marge de
manoeuvre dans la supervision des opérations électorales. Il
compte dix-huit membres, dont un Président du Conseil et un
vice-président. Avant le scrutin du 09 octobre 2011,
l'indépendance et l'impartialité d'ELECAM ont été
mises en doute par une grande partie de la classe politique camerounaise, la
société civile, les médias, ainsi que les observateurs
nationaux et internationaux, du fait que la quasi-totalité des membres
du Conseil électoral, neuf sur les douze, étaient des membres ou
des sympathisants du parti au pouvoir336. La nomination, en juillet
2011, de six nouveaux membres issus de la société civile et du
clergé, a très peu contribué à redorer le blason de
cette institution, à nouveau ternie par l'affaire Pauline Biyong, l'un
des nouveaux membres, limogés pour conflit d'intérêt.
La Direction Générale des Elections
(DGE)337 est la branche technique et opérationnelle d'ELECAM.
Elle joue le rôle antérieur du MINATD, avec des
démembrements sur l'ensemble du territoire, jusqu'aux bureaux de
vote.
ELECAM a finalement tenu son pari d'organiser un scrutin
présidentiel délicat, en parvenant à limiter les risques
de dérapage politico-sécuritaire. En effet, en dehors de deux
incidents meurtriers de Limbé et de Bafoussam, le scrutin a pu se tenir
dans le calme, permettant à la structure d'en assurer essentiellement le
déroulement pacifique.
Si ELECAM a finalement pu organiser le processus
électoral en minorant les risques de déstabilisation, cela ne
s'est pas passé sans problèmes. En effet, de nombreux
dysfonctionnements ont émaillé la tenue de cette élection.
Très clairement ELECAM a fait montre d'importantes défaillances
logistiques et matérielles dans l'organisation de ce scrutin du 09
octobre 2011, occasionnant de nombreuses situations de désordre qui ont
incontestablement affecté la qualité des opérations
électorales et remis en question le caractère équitable et
loyal de ce processus électoral.
SECTION 2: LES LIMITES DU DEPLOIEMENT DES MISSIONS DE
MONITORING DES ELECTIONS
S'il est tout à fait admis que le déploiement
des missions de monitoring des élections présidentielles a eu de
mérites certains, il ne fait pas non plus de doute que ces
mérites portent inévitablement quelques limites. Les limites du
déploiement des
sauf cas de flagrant délit. Pareil pour que les membres
du Conseil Electoral, nommés pour quatre ans renouvelables, le Directeur
Général et le Directeur Général Adjoint, dont les
mandats sont de cinq ans éventuellement renouvelables, que
bénéficient des garantis d'inamovibilité. Pour asseoir son
fonctionnement, ELECAM est doté de deux organes : Le conseil Electoral
(CE) et la Direction Générale des Elections (DGE).
335 La loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant
création, organisation et fonctionnement d' ELECAM dispose que «
Après l'adoption du budget de l'Etat par le Parlement, le Ministre
chargé des finances effectue des déblocages de fonds au profit
d'Elections Cameroon, au titre des dépenses prioritaires de l'Etat,
conformément aux dotations inscrites dans la loi de finances
».
336 Cf. section 8,2 de la loi portant création
d'ELECAM.
337 Voir en annexe composition de la DGE.
80
81
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
missions de monitoring des élections
présidentielles pourraient ainsi être de deux ordres majeurs,
à savoir les limites de fond (Paragraphe 1) et les limites de forme
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1: Les limites de fond des missions de
monitoring des élections
Au-delà des objectifs officiellement communiqués
pour justifier l'envoi ou le déploiement d'une mission nationale ou
internationale de monitoring des élections présidentielles, il
demeure. Une difficulté qui procède essentiellement de cette
association entre l'exigence pratique et celle de la réalité qui,
de fait, ne se situe pas dans le même ordre. Cette démarche abouti
fatalement à des hésitations qui finissent malheureusement
parfois par biaiser les objectifs initiaux visés par ces missions de
monitoring des élections présidentielles et en même temps,
créent de nouvelles difficultés338. Les limites de
fond du déploiement des missions de monitoring des élections
présidentielles tiennent donc d'abord à un inconfort conceptuel
(A) autant qu'à un inconfort épistémologique (B).
A. L'inconfort conceptuel des missions de monitoring
des élections
L'inconfort conceptuel des missions de monitoring des
élections présidentielles est tributaire des a priori de
base fondés sur une interprétation stricte de la Charte des
Nations Unies, de la DUDH, du PIDCP et des différentes chartes
continentales dans leurs dispositions relatives au principe de
non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, et la
réalité de l'impératif du maintien des liens de
coopération avec les anciennes colonies et au refus d'un alignement
systématique à une ligne définie parfois par les
puissances occidentales par le biais des organisations internationales ayant
une influence sur les Etats du Sud en général et sur le Cameroun
en particulier dont les régimes politiques sont en quête de
repères idéologique claires depuis la chute du mur de
Berlin339.
Cet inconfort est donc fondamentalement conceptuel en ce qu'il
ne parvient pas à donner un contenu satisfaisant au mécanisme de
monitoring des élections présidentielles qui risque de mettre
entre parenthèses d'autres enjeux pourtant non négligeables.
Cette situation a conduit, à termes, à des
remises en cause, et du rôle même, des missions de monitoring des
élections au Cameroun depuis la toute première élection
présidentielles anticipée du 11 octobre 1992 au cours de laquelle
nous avons pu observer plutôt une bataille entre les puissances
occidentales cherchant soit à s'affirmer, soit à se trouver une
place dans l'environnement économique, politique, stratégique
parfois géostratégique et culturelle ; au lieu de se
préoccuper réellement des avancées démocratiques au
Cameroun340.
La problématique de la juridicité des missions
de monitoring des élections présidentielles naît de la
volonté de leur trouver à tout prix une justification juridique
alors qu'en réalité le monitoring des élections
présidentielles n'est pas, à proprement parler, une notion
juridique341 mais d'abord et fondamentalement un mécanisme
338 Ndoumou, (F.D), Op. cit., p. 265.
339 Monney Mouandjo, (S), Op. cit., p.345.
340 Ebolo, (M.D), Op. cit., p.175.
341 Cf. rapport de la 3ème réunion
préparatoire du symposium de Bamako où le rapporteur
précise que les missions internationales d'observation des
élections ne procèdent d'aucun texte juridique objectif.
82
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
politique autant par nature que par destination et qu'il
n'appartient qu'au droit d'encadrer. Car en effet, les différents textes
traitant des propositions de code de conduite devant guider l'envoi ou le
déploiement des missions de monitoring des élections
présidentielles dont la valeur juridique n'est jusqu'alors pas
établie, ne suffisent pas à faire de ce mécanisme une
technique juridique. Or, rechercher absolument l'essence du monitoring des
élections présidentielles nous semble inopportun, dans la mesure
où cela ne résout absolument pas le problème de la
définition juridique de ce monitoring mais ne fait, de notre point de
vue, qu'influencer la philosophie générale du droit aux
élections libres tel que prescrit dans les différents instruments
juridiques internationaux y relatifs. Mais le problème n'est pas
résolu pour autant dans la mesure où les acteurs de cette
activité recherchent une orientation claire sur la juridicité de
ce mécanisme à laquelle se heurte aussi la problématique
de l'opportunité de ces missions.
Dans sa volonté d'appliquer à toute force la
règle de droit et devant l'inconfort avéré au sujet de la
juridicité des missions de monitoring des élections
présidentielles, se pose naturellement la question de
l'opportunité de ces missions. Cette situation s'est essentiellement
fait remarquer au début, dans la deuxième partie de la
décennie 1990, à travers les premiers rapports de fin de
mission342. On voyait systématiquement revenir cette formule
désormais rituelle dans certaines organisations, à savoir
notamment que « malgré les quelques insuffisances
constatées, l'élection s'est déroulée dans le calme
et la sérénité sur toute l'étendue du territoire
»343. Cette série d'interrogations sans
réponses satisfaisantes a donc donné lieu à son tour
à une sorte d'incapacité objective à donner une
orientation claire à ce mécanisme et du coup à rendre
encore plus difficile une réelle évaluation de la pratique au
sein de l'organisation.
De la même manière, le défaut de vision
claire de ce mécanisme a donné lieu quelques fois à des
sarcasmes dans certains pays d'Afrique où les missions de monitoring des
élections n'ont été le plus souvent en
réalité que des moyens de conforter les intérêts de
certaines puissances occidentales comme la France ou encore les Etats-Unis, au
mépris du respect de la volonté réellement exprimée
par les peuples344. Il y a là une sérieuse accusation
qui témoigne autant de la difficulté des acteurs du monitoring
des élections de se situer par rapport à une approche
consensuelle et rigoureuse du mécanisme de monitoring des
élections et des finalités réellement attachées
à celui-ci dans la confrontation aux réalités de l'action
politique, elle aussi, quelquefois soumises à des pressions et
contraintes juridiques.
B. L'inconfort épistémologique des
missions de monitoring des élections
Il y a en effet un réel inconfort à
l'idée de répondre à la question de savoir quelle est la
destination des missions de monitoring des élections. En effet en
342 Lire à ce sujet la réponse du gouvernement
à la suite de la présentation du rapport provisoire de la mission
d'observateurs internationaux du NDI, Election présidentielle du 11
octobre 1992 au Cameroun, pp. 259-302. Cette réponse du gouvernement
explique et démontre que les agissements de cette organisation ne sont
rien d'autre que la manifestation des Etats-Unis, une autre manière pour
cette puissance occidentale de s'ingérer dans les affaires
intérieures du Cameroun.
343 Lire à ce sujet l'OIF, Le rapport de la mission
d'observation de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004 au
Cameroun, pp. 15-27.
344 Exemple du Cameroun en 1992, de la Cote d'Ivoire en 2010,
de la République Démocratique du Congo 2010, lire Jeune
Afrique Economique, « Spécial en Côte d'Ivoire, Laurent
Gbagbo », n° 319, du 6 au 19 novembre 2000, p 9, Jeune Afrique
Economique, « L'impasse ivoirienne », n° 383, avril-mai
2011, pp. 245-305, Jeune Afrique Economique Hors-Série n°
20 : Spécial élection présidentielle 2011, pp. 105-195.
83
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
choisissant d'opter pour une sorte de déploiement
pratique, les finalités des missions de monitoring deviennent aussi
variables que pourrait l'être la composition même des missions. Il
n'y a désormais plus qu'un objectif assigné à celles-ci.
Tout dépend du climat politique, de la relation avec les responsables
administratifs pour les OIG, des responsables d'OSC nationales et des
intérêts en jeu345 dans l'un ou l'autre contexte.
Ainsi, ces missions ont-elles parfois pu prendre des formes plus rigides dans
certains cas, comme elles sont parfois apparues plus formelles dans
d'autres346. Il n'y a qu'à voir tout le travail de
préparation des rapports de fin de missions qui se fait et les filtres
à travers lesquels ces rapports passent ainsi que les formes qu'ils
peuvent prendre d'un pays à un autre347.
C'est donc dire au fond que l'inconfort
épistémologique des missions de monitoring des élections,
et quant aux finalités celles-ci, tient en réalité
à l'inadéquation objective entre les finalités
officiellement présentées par les différents acteurs et
les finalités spécifiques visées348. Ces
missions seraient donc par moments plus un mécanisme de consolidation
d'acquis et de rapports particuliers qu'un moyen unique de promotion de la
démocratie, même si sur cet aspect spécifique, Albert
Bourgi et Jean Pierre Colin s'en défendent en estimant notamment
«Qu'il convient pour autant de ne pas se méprendre sur les
missions d'observation de l'OIF ; (estimant par ailleurs) qu'elles n'ont rien
d'une mission officieuse envoyée auprès des autorités
locales pour arrondir les angles»349. Même si on ne
saurait mettre en doute la véracité et surtout la bonne foi
d'Albert Bourgi et Jean Pierre Colin, il reste toutefois que l'absence de
véritable communication autour des rapports de fin de mission ainsi que
les communiqués quelquefois sommaires de fin de missions peuvent
conduire à nourrir de la suspicion. On en vient à croire
même à tort à la priorité des connivences et de la
consolidation des acquis sur le besoin d'établir la vérité
des urnes.
345 La reconnaissance au niveau international, la
capitalisation des ressources financières, pour les missions des OIG et
les puissances occidentales, la recherche du rayonnement et de
l'hégémonie en matière de promotion de la
démocratie et des droits de l'homme. Lire Ndoumou, (F.D), Op.
cit., Monney Mouandjo, Op. cit.
346 Cas de l'élection présidentielle du 11
octobre 1992 au Cameroun, ou encore le cas de la Cote d'Ivoire à
l'occasion de l'élection présidentielle de 2010 ; dans l'un des
deux cas, l'ONG NDI, a montré toute sa détermination à
faire invalider le résultat de l'élection présidentielle
de 1992, alors que dans l'autre cas la communauté internationale a
refusé de recompter les voix entre le candidat Laurent Gbagbo et
Alassane Dramane Ouattara, alors qu'il y a eu précédent aux
Etats-Unis en 2000 entre Al Gore et Georges Bush fils.
347 Cf. Communiqué de presse de la Francophonie,
à l'issue de l'élection présidentielle du 11 octobre 2004
au Cameroun. Il n'y a qu'à voir aussi le contenu des projets de
communiqués provisoires et/ou de rapports provisoires et
définitifs. On pourrait même encore voir l'exemple de la
présidentielle sénégalaise dont le projet de rapport aura
été critiqué parce qu'il laissait planer des doutes,
a-t-on semblé dire, sur la fiabilité et la transparence du
scrutin. Seulement même si un consensus a difficilement pu être
retenu entre l'opinion des observateurs et celle de l'organisation francophone
à ce sujet, le taux de participation aux législatifs
subséquents est venu comme pour rendre témoignage du
véritable sentiment des électeurs face aux adeptes du « tout
est parfait ». Cette baisse significative du taux de participation entre
la présidentielle et les législatives pourrait en effet bien
démontrer une forme de désenchantement des populations
sénégalaises et la volonté de celles-ci de le signifier
à l'opinion et au président élu.
348 Bien que le gouvernement ait invité le NDI à
venir au Cameroun au moment de la préparation de la première
élection présidentielle multipartite, cette organisation, au
regard de la réponse du gouvernement à son rapport, était
le bras armé des Etats-Unis, en vue de déstabiliser le Cameroun
pour des intérêts purement autre que électoraux. Lire la
réponse du Cameroun, les droits de l'homme au Cameroun, Livre Blanc
publié par le gouvernement de la République du Cameroun (version
française), pp. 278-305.
349 Cf. Bourgi (A) et Colin, (J. P), Op. Cit., p.175.
84
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Paragraphe 2 : Les limites formelles des missions de
monitoring des élections
Les missions de monitoring des élections
présidentielles souffrent d'un préjugé fondé sur le
refus de se subordonner à des règles précises. C'est ce
qu'ont d'ailleurs relevé les rapporteurs de la troisième
réunion préparatoire du symposium de Bamako, en affirmant
notamment qu' « on exagère en disant qu'en la matière la
seule règle soit l'absence de règle »350,
bien qu'ils finissent par reconnaître que cette «
exagération contient une part de vérité
»351. Or, en reconnaissant que cette observation contient
une part de vérité, cela atteste de la véracité du
défaut de lisibilité des méthodes des missions de
monitoring des élections. C'est une illisibilité qui finit
malheureusement par déboucher sur le reproche d'inefficacité
pratique des missions de monitoring des élections.
A. L'ambiguïté des pratiques des missions
de monitoring des élections
L'ambiguïté des pratiques des missions de
monitoring des élections présidentielles tient de
l'incompréhension que suscitent parfois certains agissements en
confrontant ceux-ci aux textes qui régissent l'envoi ou le
déploiement de ces missions sur le terrain352. Le premier
d'entre eux est notamment celui lié à la transparence des
rapports de fin de mission à l'issue des scrutins comme c'est notamment
le cas au Commonwealth353. Ce seul défaut de transparence des
rapports de fin de mission et quelquefois le silence des acteurs au moment
où justement cette transparence pourrait affirmer leurs positions dans
des situations de doute, finit par leur donner un caractère purement
partiel et à entretenir des doutes qu'ils auraient pu lever par une
communication moins ambiguë. Il faut dire qu'en vertu des principes de
Marrakech relatifs à la conduite des missions de monitoring des
élections, les rapports de fin de mission ne sont pas
expressément destinés à la publication. En revanche,
l'évolution de la pratique et les revendications toujours plus grandes
des populations a fini par faire entrer la publication des rapports au nombre
des règles quasiment obligatoires de conduite du monitoring des
élections354.
Seulement malgré l'adoption, bien qu'a posteriori, de
l'idée de la publication des rapports de fin de mission par les
différents acteurs du monitoring des élections, la question reste
encore posée aujourd'hui. Car l'accès à ces rapports de
fin de mission continue de bénéficier d'un certain nombre de
réserves. On se souvient d'ailleurs qu'à l'occasion des
réunions préparatoires au symposium de Bamako, un des
représentants canadiens avait longuement discuté l'idée de
diffusion au grand public des rapports de fin de mission en prétextant
qu'ils pourraient donner lieu à des
350 Rapport de la 3ème réunion
préparatoire au symposium de Bamako.
351 Idem.
352 Dans le cadre des missions OSC nationales comme
internationales, il s'agit des accréditations, tandis que dans des
missions des OIG, il s'agit des invitations (voir en annexe la liste des
pièces à fournir pour le dossier de demande
d'accréditation).
353 Lire, pour plus d'informations, Groupe d'Experts du
Commonwealth élection présidentielle du Cameroun, 9
octobre 2011, communiqué de presse « Une
élection pacifique : certains objectifs de référence pour
une élection démocratique ont été atteints, bien
qu'il reste à créer un pied d'égalité plus
étendu afin de renforcer la confiance dans le processus électoral
», pdf, consulté sur le site
www.commonwealth.org/reports
le 15 mai 2014.
354 A l'occasion de l'élection présidentielle du
09 octobre 2011, sur près de 90 organisations ayant reçu des
accréditations, moins de 50 ont pu déposer un rapport de fin de
mission. Voir en annexe la liste des organisations ayant déposé
un rapport auprès de la DGE d'ELECAM.
85
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
instabilités politiques et sociales355.
Cette position, pour le moins étonnante pour un ressortissant canadien,
démontre bien l'embarras qu'ont souvent certains acteurs avec la
transparence. On est d'ailleurs en droit de se demander ce que vaudrait bien
une observation des élections si le rapport devait rester secret et en
quoi un tel rapport pourrait-il se transformer en un secret d'Etat.
Le caractère partiel des missions de monitoring des
élections présidentielles est en effet une autre limite des
missions de ce monitoring au Cameroun. A l'observation, il est apparu que
l'objet d'une mission de monitoring des élections pouvait à terme
varier les scrutins et que, au-delà des apparences officielles, cette
mission pouvait parfois couvrir d'autres enjeux encore plus complexes. C'est ce
que pourraient révéler le scrutin présidentiel de 1997,
les législatives et municipales de 2002, la présidentielle de
2011 au Cameroun ainsi que celle de 2003 au Togo dont les rapports de fin de
missions ne sont malheureusement pas encore mis à la disposition du
public. C'est ce qui conforte les positions d'Albert Bourgi, pour qui
«les rapports des observateurs ne constituent jamais une certification
en bonne et due forme des consultations »356. Albert
Bourgi poursuit que «dans l'ensemble il est raisonnable de penser que
la plupart des élections suivies depuis quelques années par les
observateurs dépêchés par les organisations internationales
n'ont pas été de pures mascarades... ».
B. L'inefficience relative des missions de monitoring
des élections
Il faut d'emblée préciser que l'inefficience
relative des missions de monitoring des élections tient à la
fluctuation effective de chacune d'elles dans la mesure où comme on a pu
le constater, ces missions ont néanmoins réussi à changer,
même partiellement, la culture du pouvoir politique357. Mais
au-delà de ces quelques points qu'on peut considérer comme
positifs, il convient d'indiquer que ces missions restent malheureusement
très disputées même à l'intérieur des Etats
d'Afrique où elles ne font pas encore complètement consensus.
Dans chacun des cas, les raisons invoquées sont multiples, à
savoir, notamment un cloisonnement ou la dispersion des acteurs et une
démultiplication de celle-ci en micro organisations à plusieurs
vitesses avec d'une part les OIG et s'autre part les puissances
occidentales.
Dans le même ordre d'idées, les missions de
monitoring des élections sont moins perçues à la base
comme un mécanisme efficace capable d'instaurer la démocratie.
Les populations et les observateurs de la scène politique y croient de
moins en moins, même si d'une manière générale les
acteurs du monitoring estiment aussi que leur rôle n'est pas de changer
les choses, mais de surveiller et d'apporter leur concours et assistance au bon
déroulement des élections. L'ambiguïté dans laquelle
se trouvent ainsi les missions de monitoring des élections
déteint naturellement sur les initiatives que celle-ci peuvent prendre.
Car à défaut d'affirmer des positions claires et fortes, elle se
consacre pour le moment plus à sauver sa place fortement mise à
mal par l'émergence et l'affirmation d'une puissance politique et
355 Le Cameron a failli connaître une situation de crise
sociopolitique en 1992. Il est arrivé que le NDI, en présentant
son rapport provisoire est déclaré élu le candidat du SDF,
alors que le processus électoral de cette élection n'était
pas encore arrivé à son terme. Cette publication provisoire des
résultats a emprunté les voies de la violence. De violentes
manifestations de rue avec la destruction des biens de certains dignitaires du
pouvoir et le meurtre d'un sous-préfet et du responsable d'un parti
allié au président Paul Biya ont eu lieu dans les villes de
Bamenda et de Muyuka après que le NDI ait publié des
résultats non officiels de l'élection présidentielle.
356Bourgi, (A), Op. cit., p. 75.
357 Monney Mouandjo, (S), Op cit., p. 345.
86
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
culturelle anglo-américaine fortement
entreprenante358. On a notamment pu observer bon nombre d'Etats,
jadis considérés comme des chasses gardées francophones,
s'ouvrir progressivement et de façon déterminante aux Etats-Unis
et, par extension, à la culture anglo-saxonne, même s'il faut
reconnaître que la Chine pourrait constituer une brèche capable
d'atténuer les effets d'une trop grande influence de cet
ordre359.
358 La France partie colonisatrice du Cameroun a connu cette
situation à l'occasion de l'élection présidentielle
anticipée du 11 octobre 1992. Mais c'est ressaisi face à la
montée en puissance des Etats-Unis, qui soutenait ouvertement le
candidat de l'opposition Ni John Fru Ndi. Lire Ebolo (M.D), L'implication
des puissances étrangères dans le processus de
démocratisation au Cameroun : l'expérience française et
américaine (19901997), Thèse de Doctorat
3ème cycle, IRIC/UYII, 1997.
359 Hugon, (P), « Les nouveaux acteurs de la
coopération en Afrique », International Development Policy |
Revue internationale de politique de développement, 1 2010, Online since
14 December 2009, connection on 17 June 2014. URL :
http://poldev.revues.org/118
; DOI : 10.4000/poldev.118
87
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CONCLUSION PARTIELLE
En somme dans ce chapitre nous avons analysé la
dynamique des effets que peut produire le monitoring des élections
présidentielles, il s'agit concrètement d'examiner les
mérites et les limites de cette activité. Comme mérite
nous pouvons dire que le monitoring des élections présidentielles
a permis des avancées certaine par petits coups, mais ces
avancées sont non négligeables tant dans l'organisation des
élections présidentielles proprement dit ; que
l'amélioration des structures chargées de l'organisation desdits
élections.
Cependant elle n'est pas sans heurt au regard de nombreuses
controverses dont elle a souvent fait l'objet, ici comme ailleurs montre
qu'elle a encore du chemin à parcourir.
88
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Cette partie a soulevé la question des mérites
et des limites des missions de monitoring des élections du fait de la
configuration dynamique du champ électoral camerounais. Il a
été possible d'envisager que le monitoring des élections a
eu des mérites certains sur la forme comme sur le fond. En ce sens qu'Il
a eu le mérite d'apporter, dans certains cas, des expertises
nécessaires à l'organisation des élections
présidentielles, à savoir l'évaluation des
procédures de vote, des lois régissant l'élection
présidentielles. Au fond, le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun a permis le dessaisissement du MINATD de
l'organisation des élections, malgré son droit de regard, au
profit d'un OGE, bien que ne faisant pas l'unanimité des acteurs
politiques.
89
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
CONCLUSION GENERALE
90
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
La présente étude relative au monitoring des
élections présidentielles au Cameroun, de 1992 à 2011,
s'est appuyée sur l'épistémologie de la sociologie
politique, de la sociologie électorale ou de la science
électorale360. Ainsi, les méthodes comparatives et
constructivistes ont été particulièrement adéquates
pour comprendre ce phénomène, qui est un phénomène
politique socialement construit.
Monsieur Boutros Boutros-Ghali déclarait en 1991, alors
Secrétaire général des Nations unies que
« les élections en soi ne sont pas la
marque de la démocratie, pas plus qu'elles ne l'instaurent (...). La
démocratie signifie bien plus que le simple fait d'exprimes
périodiquement un suffrage, et s'applique à l'ensemble du
processus de participation des citoyens à la vie politique de leur pays
».
Mais l'on constate que parmi les piliers de la
démocratie, les élections sont des plus redoutés. Les
élections libres et régulières constituent, pour ainsi
dire, la base fondamentale d'une démocratie. Il faut garantir la tenue
d'élections libres. Le Cameroun démocratique met des structures
qui permettent soit de contrôler, soit de juger les contentieux
électoraux.
Pour les observateurs nationaux, leur situation est identique.
Ils sont amenés à porter la caution à telle ou telle autre
partie aux élections. Ceci est d'autant plus explicite que chaque
individu a, avant tout, les convictions personnelles. Par ailleurs, leur mode
de désignation, lorsqu'il est institutionnalisé prête au
doute de leur crédibilité361. Tout comme leur
appartenance à une ONG ou à une OGE n'est pas synonyme
d'impartialité362.
Partant de l'interrogation centrale363 : comment se
pratique le monitoring des élections présidentielles au Cameroun
? Les objectifs de cette étude étaient de mettre en
lumière les règles juridiques et pragmatiques internationales et
nationales, les enjeux internes et externes du monitoring des élections
présidentielles, d'une part, et de comprendre les mécanismes et
les modalités de déploiement des acteurs des missions de
monitoring des élections présidentielles, ainsi que les usages et
les effets que cette pratique peuvent produire d'autre part. Au détour
de toutes ces analyses, nous avons formulé nos questions de recherche.
Ainsi nous avons établi, à titre d'hypothèse principale,
que le monitoring des élections présidentielles au Cameroun de
1992 à 2011 se pratique de deux manières, à savoir : par
l'observation des élections et par l'intervention est sociopolitiquement
construit et produit des effets de réalité au regard des usages
plurivoques dont il fait l'objet. L'on a fourni quatre hypothèses
secondaires.
La première hypothèse connexe postule que le
monitoring des élections présidentielles est une pratique
encadrée par des règles et structurée par des enjeux
multiples. Cet encadrement commence à prendre corps avec la DUDH et le
PICDP, qui sont là les premières règles que la
majorité des acteurs brandit pour initier le déploiement ou
l'envoi des missions de monitoring des élections présidentielles.
Ces
360 Cf. entretien avec Kamga, (H), un expert sur les questions
électorales et de l'observation des élections, (Notes de
terrain), op cit.
361 Ndoumou, (F.D), « Cameroun, l'observatoire national
des élections », in Africa international, p. 63. IDEA, The
Future of international Electoral Observation, op cit. p. 14.
362 Que ce soit l'élection présidentielle du
11octobre 1992, ou celle du 12 octobre 1997 ou même celles de 2004 et du
09 octobre 2011, au Cameroun, les responsables de l'administration et/ou de
l'ONEL et de ELECAM ont été accusé de partialité
à cause de leur engagement comme ancien cadre du parti au pouvoir. Lire
le rapport de C'est ce que nous révèle les rapports d'observation
de Transparency International Cameroun (présidentielle 2011), Cameroon
Ô'Bosso (présidentielle 2011, SNJP.
363 Atangana, (E.A), Le positionnement politique des
élites éwondo de Yaoundé, Mémoire de DEA,
Université de Yaoundé 2, Soa, Année Académique
2007-2008, p. 120.
91
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
missions commencent, dans le cas du Cameroun, avec les
élections législatives du 1er mars 1992 et vont se poursuivre
avec l'élection présidentielle du 11 octobre de la même
année. Avec les acteurs internationaux comme l'OIF, ce fut l'une des
périodes les plus importantes avec notamment en 2000 l'adoption de la
Déclaration ainsi que du programme d'action de Bamako à l'issue
du symposium tenu les 1er, 2 et 3 novembre364. La principale
innovation ici fut l'inscription de l'indissociabilité de la
démocratie avec la francophonie dans un texte de cette organisation. Par
cette inscription, la démocratie ne fut plus simplement un projet
abstrait, mais elle devenait partie intégrante de l'éthique
même de l'organisation et qu'il ne fallait plus que traduire dans les
faits comme l'indique les dispositions de la Déclaration de
Bamako365.
Elles sont partagées entre la fidélité
aux valeurs et objectifs initiaux et la nécessité d'une
adaptation à l'évolution actuelle du monde. Elles sont tout
autant partagées entre l'impératif du respect des règles
conventionnelles du droit international et fondées notamment sur le
principe du respect de la souveraineté des Etats, du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes impliquant aussi le droit des peuples
à déterminer librement leurs régimes politiques ainsi que
leurs modes de désignation de responsables politiques et l'obligation de
s'aligner aux engagements internationaux qu'ils prennent ainsi que des
implications de ces derniers dans la vie même de leurs Etats. Il ne
s'agissait, d'espérer une forme de démocratie par le biais des
missions de monitoring des élections présidentielles, mais au
contraire, il s'agissait ici, de consolider et de renforcer les acquis de
mutations institutionnels initiés autour des années 90 par le
moyen de ces missions. Ainsi et progressivement, il ne se passait presque plus
d'élections dans notre pays de ces organisations qui ne voyaient arriver
des observateurs366. On pouvait ainsi croire qu'enfin la
démocratie avançait, se renforçait et faisait
éclore de nouvelles dynamiques politiques à l'intérieur du
Cameroun.
La deuxième hypothèse, relative aux acteurs du
monitoring des élections présidentielles usent de multiples et
inégales ressources et des logiques. Différents acteurs
s'impliquent dans l'activité de monitoring des élections
présidentielles, avec chacun ses ressources propres qui peuvent
financières, matérielles ou humaines lui permettant ainsi de
mouvoir sur le champ des élections. Ces ressources des acteurs peuvent
être des ressources provenant des Etats comme dans le cas des OGE, qui
assurent l'organisation et la supervision des élections, pour d'autres
provenir des donateurs, des organisations internationales qui appui de la
promotion de la démocratie dans le monde et d'autres encore des fonds
propres comme dans le cas des associations et ONG nationales et
internationales. Les ressources matérielles quant peuvent être
tout ce matériel permettant aux observateurs bien faire leurs
observations. Il faut tout aussi que les observateurs soient qualifiés,
c'est pourquoi les missions de monitoring des élections ont besoin des
ressources humaines, dans le cadre de leur mission. Tous ces aspects permettent
aux missions de monitoring des élections de se déployer sur le
terrain pour assurer que les élections respectent les principes de
transparence, d'honnêteté et de
sincérité367.
364 Cf. Déclaration de Bamako du 1er au 3
novembre 2000, op cit.
365 Lors de la mission exploratoire en prélude à
l'élection présidentielle du 11 octobre 2004, la mission de l'OIF
dans l'évaluation du cadre juridique devant régir cette
élection les membres de la mission se rassure que le scrutin se
prépare dans le respect des principes et des dispositions de la
Déclaration de Bamako.
366 Depuis les élections législatives de mars
1997 jusqu'aux sénatoriales du 14 avril 2013, il ne s'est plus
déroulé d'élection sans la présence des
observateurs de la Francophonie.
367 CNDHL, et ELECAM, les rapports d'observation de
l'élection présidentielle du 09 octobre 2011, pp 156-158.
92
93
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
La troisième hypothèse quant à elle
postule que le monitoring des élections présidentielles est
déterminé par des usages plurivoques internes et internationaux.
Le monitoring des élections en tant que phénomène
politique. Au plan interne, les pays et les organisations du nord prennent
actuellement des positions dont l'objectif est non seulement de faire respecter
les droits de l'homme, mais surtout une conditionnalité
démocratique au pour les Etats du sud368. Ainsi, face
à l'interférence de l'environnement externe, le nationalisme
gouvernemental, qui dans une certaine mesure s'abreuve aux sources du
tiers-mondisme, se porte en faux de la tendance à l'universalisation de
la démocratie libérale célébrée avec une
bonne dose d'optimisme comme l'écrit Francis Fukuyama369. Il
pourrait aussi s'agir d'une affirmation de son identité face à
toute tendance homogénéisatrice.
Les usages externes du monitoring trois situations
divergentes, attachées à une même racine, se posent ici
:
La première, au Cameroun on peut bien organiser des
élections. Mais, des garanties existent-ils pour le gouvernement
légitimement élu ? Cette question concerne, comme le souligne
Peter Jankowisch, les cas négatifs dans lesquels les résultats
des élections ont été ignorés, comme il a
été le cas de l'élection présidentielle du 11
octobre 1992, ou encore en Haïti, en Angola ou encore en
Birmanie370
Charles Zorgbibe avait proposé l'application d'une
résolution similaire à celle de l'OEA (résolution 1080)
dans le cadre de l'UA, « Le conseil exécutif paraît donc
l'organe le mieux adapté à cette concertation sur la
démocratie (...). Une résolution 1080 "à l'africaine"
pourrait donc être mise en oeuvre de manière très
pragmatique »371.
La deuxième situation concerne le cas où les
élections ont été organisées mais avec des fraudes
massives et des graves irrégularités. Faut-il laisser la
situation comme c'est le cas actuel ou agir ? Quel serait donc l'organe
compétent ?
Pour le moment, aucun organe n'est compétent au plan
international en cas de violation des règles
électorales372. La communauté internationale comptait
sur la maturité des Etats et sur les sanctions économiques.
Cependant, chaque pays comme organisations envoient leurs représentants
(missions) pour des élections données. Les divergences
nées entre différentes missions corroborent les prises de
positions des mandants. Un pays peut soutenir une sanction pour cause de
fraudes alors qu'un autre infirme cette position au vu des rapports et des
allégations de sa mission. Ils convient donc de mettre sur pied une
structure internationale pour le monitoring des élections. Cette
structure pourra non seulement contrôler les élections mais
s'occuper aussi du contentieux électoral international et des
libertés démocratiques373.
En 1981 à l'Assemblée générale de
l'ONU, le ministre autrichien des affaires étrangères proposait
la création d'un corps international d'observateurs judiciaires. Or, une
structure dépendant d'un corps de métier risque d'être
transformée en corporation. Le projet s'est cependant heurté
à une opposition résolue et très vive de plusieurs ONG des
droits de l'homme qui y ont vu une atteinte à leur propre pratique,
totalement libre, de l'observation judiciaire374.
368 Moss, (T.O), « La Conditionnalité
Démocratique dans les Relations entre l'Europe et l'Afrique », in
l'Évènement Européen, n°19, septembre 1992,
p. 75.
369 Fukuyama (F), La Fin de l'Histoire et le Dernier
Homme, Paris, Flammarion, 1992, p. 231.
370 Jankowisch, (P), Op. cit., p.75
371 Zorgbibe, (C), « Impératif
démocratique et relations internationales », in
Géopolitique africaine, p. 65.
372 Si cette situation se présente au niveau
international dans le contexte camerounais le contentieux électoral est
gérer par la Cour Suprême en lieu et place du Conseil
Constitutionnel.
373 Ndoumou, (F.D), Op. cit.,
374 Vasak, (K), Contrôle international des
élections, p. 12.
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
La troisième situation, enfin, concernent les pays ou
la démocratie n'existe pas du tout. Faut-il les laisser sombrer dans
l'anarchie ?375 Dans ce cas, d'autres pays suivront aussi leur
exemple376. Alors que de le doute de l'universalité de la
démocratie est presque levé377, la communauté
internationale doit agir sans attendre que la situation soit
irrémédiablement compromise378.
Enfin notre quatrième hypothèse quant à
elle postule que le monitoring des élections présidentielles
produit des effets de réalité à la fois positifs et
négatifs. Le monitoring des élections présidentielles au
Cameroun appartient à l'une des catégories. Mais depuis sa
renaissance au début des années 90, elle a connu un
résultat mitigé379.
Les missions de monitoring des élections
présidentielles souvent accusées de tous les maux (touristes
aventurier...) ne peuvent pas aller au-delà de leur mission
(observateur) et sont des mandataires des institutions ou des organisations.
L'espoir que les populations ont placé en elles s'est
estompé380. Les observateurs internationaux sont devenus
« la risée »381 et considérés parfois
à tort ou à raison comme « un mode d'accompagnement des
processus démocratiques et un soutien aux processus électoraux...
Comme une forme de complicité avec les pouvoirs en place, voire comme un
des nombreux ingrédients contribuant à maintenir des liens d'un
type particulier entre ancien colonisateur et ancien
colonisé382.
375 La situation qu'a connu la Côte d'Ivoire entre 1999
et 2010, lire Jeune Afrique Economique, « L'impasse ivoirienne
», n° 383, avril-mai 2011, p .305, Jeune Afrique Economique,
« Spécial en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo », n°
319, du 6 au 19 novembre 2000, p. 99. Jeune Afrique, « Côte
d'Ivoire, Présidentielle 2010, le destin de Soro », n°
2598-2599 du 24 octobre au 6 novembre 2010, p.212. Jeune Afrique,
«Côte d'Ivoire, Présidentielle 2010, Dans les coulisses de
l'élection», n° 2596-2597 septembre-octobre 2010, p. 212. Il
faut dire c'est la situation qui serait au Cameroun lors de la première
élection présidentielle de 1992.
376 La limitation du nombre de mandats présidentiels
introduis dans la constitution du 18 janvier 1996 a été
supprimé avant la fin du mandat du Président Paul Biya, en 2008,
avec la révision constitutionnelle du 14 avril 2008, donc trois ans
avant l'élection présidentielle du 09 octobre 2011. Certains
partis de l'opposition avaient adressé des motions de soutien à
cette action, tandis d'autre et aussi certains intellectuels camerounais
condamnait cet acte. D'autre même ont appelé au boycott à
l'inscription sur les listes électorales pour préparer ce
scrutin.
377 Pour l'ancien Secrétaire Général de
l'OUA, Salim Ahmed, « Les principes fondamentaux de la démocratie
sont universels et dès lors pour tous », in Panafrican news
agency, du 1er décembre 1997, p. 4.
378 Bettati, (M), Le droit d'ingérence : mutation
de l'ordre international, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 65, voir aussi
Mengue Ekome, (R), Droit d'ingérence limites et controverses,
Thèse de Doctorat en Droit Public International, Université de
Reims, 1997, p.618.
379 Ouattara, (F), Op cit., p. 13.
380 Pilon, (M), « L'observation internationale des
élections en Afrique » in Observatoire permanent de la
coopération française, p. 79.
381 Ndoumou, (F.D), Op.cit.,p. 354.
382 Cf. entretien avec Hilaire Kamga, expert des questions
électorales de l'observation des élections, (Notes de
terrain), op cit, lire aussi, Pilon, (M), « Art.cit », Op.
cit., p. 83.
94
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
BIBLIOGRAPHIE
95
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
I. Ouvrages généraux
Ackerman, (B), Au nom du
peuple. Les fondements de la démocratie américaine,
Paris, Calmann-Lévy, 1998.
Aristote, Le
politique-Garnier-Flammarion-1990.
Batailler-Demichel, (F),
« Droits de l'homme et droits des peuples dans l'ordre
international», Méthodes d'analyse du droit
international, 1984, Paris, Pedone.
Chaumont, (C), Le
consentement à l'ingérence militaire dans les conflits
internes,
Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1974.
Badie, (B), L'Etat
importé, Paris, Fayard, 1992.
Bayart, (J.F), L'Etat en
Afrique, nouvelle édition, Paris, FAYARD, 2006.
Braud, (P), Sociologie
Politique, Paris, Montchrestien, 6ème Edition, 2006.
Dobry, (M), Sociologie des
crises politiques, Paris, Presses de la Fondation
Nationale de Sciences Politiques.
Feuer, (G), « Nations
Unies et démocratie », in Mélanges offerts Burdeau,
(G), (dir)
« Le pouvoir », Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1977.
Fogue Tedom, (A), Enjeux
géostratégiques et conflits géopolitiques en
Afrique
Noire, Paris, L'Harmattan, collection Défense,
relation internationale, 2008.
Hugon (P),
Géopolitique de l'Afrique, Paris Armand Colin, 2006.
Huntington (P. S), Le choc
des civilisations, Paris, Odile Jacob, 2001.
Kissinger (H), La nouvelle
puissance américaine, Paris, Fayard, 2003.
Kouna Metala, (L.-M), Les
opérations de maintien de la paix de l'ONU et la
condition du militaire, Yaoundé.
Manga Kuoh, Cameroun : un nouveau
départ, Paris, L'harmattan, 1996.
Mbock, (C.-G), Cameroun,
l'intention démocratique, Yaoundé, SOPECAM, 1992.
Moukoko Priso, Cameroun/Kamerun, la
transition dans l'impasse, Paris,
L'Harmattan, 1994.
Ndi Mbarga, (V), Ruptures
et continuités au Cameroun, Paris, L'Harmattan, 1993.
Ngando, (A), L'affaire
Titus Edzoa, Revue de la presse camerounaise, Paris,
L'Harmattan, 2000.
Thierry, (H),
L'évolution du droit international, Paris, Pedone, 2001.
Valladao (A.G.A), Le XXème siècle sera
américain, Paris, la Découverte, 1993.
Onana (J), Initiation à la science politique,
Paris, Harmattan, 2009.
II. Ouvrages de Méthodologie
Badie, (B),
Hermet, (G), Politique
comparée, Paris, Armand Colin, 2001.
Barrue-Belou (R.),
Méthode et enjeux de la démarche comparative : la question de
la comparabilité, Communication au 8ème Congrès
français de droit constitutionnel, Nancy 2011,
http://www.droitconstitutionnel.org/congres,
Nancy
Bloc, (M), Apologie pour
l'histoire et le métier d'historien, Paris, Armand Colin, 1993.
David (R),
Jauffret-Spinosi (C), Les grands
systèmes de droit contemporains, Dalloz, Paris, Coll.
Précis, 11ème Ed. 2002.
Derosier (J.-Ph), « La
fin justifie les moyens ou la détermination d'une méthode
comparative par l'objectif de comparaison », Proposition de Rapport
à l'atelier n°17, Le droit constitutionnel comparé est-il
comparé ?, VIII Congrès de l'Association internationale de droit
constitutionnel, pp. 1-12
Dogan, (M), et
Pelassy, (D), (dir), La comparaison
internationale en sociologie politique, Paris, Litec, 1980.
Gazibo, (M), et
Jenson, (J), La politique comparée,
Montréal, PUM, 2004.
Grawitz, (M),
Méthode des sciences sociales, Dalloz, Paris, 2001.
96
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Legeais (R), Grands
systèmes de droit contemporain. Approche comparative, Litec, Paris,
Coll. Manuel, 2ème Edition, 2008.
Lichbach, (M.I),
Zuckerman, (A.S) (eds), Comparative Politics.
Rationality, Culture and Structure, Cambridge, Cambridge University Press,
1997.
Meny, (Y) et Surel, (Y), La politique
comparée, 7ème édition, Paris, Montchrestien,
2004.
Mogba, (Z.R)
Moukadas (N), Eléments pratiques
de méthodologie à l'usage des étudiants en sciences
sociales, Université de Bangui, Inédit, 1995.
Nkainfon Pefura (S), Le
Cameroun du multipartisme au multipartisme, Collection Points de vue
concrets, Edition L'Harmattan, 1996.
Seiler, (D-L), La
méthode comparative en science politiques, Paris, Edition Armand
Colin, 2004.
III. Ouvrages Spécialisées
Aano, (J), Le rapport
des observateurs électoraux, dans Liberté et observation des
élections, Bruxelles, Bruylant, 1994.
Abdoulkarimou, La pratique des
élections au Cameroun 1992 - 2007. Regards sur un système
électoral en mutation, Yaoundé, Edition Clé, 2012.
Beigbeder, (Y),
International monitoring of plebiscites, referenda national elections,
Boston, Nijhoff, 1994.
Beigbeder, (Y), Le
contrôle international des élections, Paris, Bruxelles,
Bruylant, 1998.
Bettati, (M), Le droit
d'ingérence : mutation de l'ordre international, Paris, Odile
Jacob, 1996.
Bourgi (A),
L'observation internationale des élections en question, ouvrage
collectif Kathala, 1997.
Bourgi (A), L'OIF et le processus
électoraux dans l'espace francophone (inédit)
Braconnier, (C), Dormagen, (J.Y), La
démocratie de l'abstention. Aux origines de
la démobilisation en milieu populaire, Paris,
2007 Gallimard (cou.Folio Actuel
Inédit).
Brechon, (P), Les
présidentielles. Elire un président sous la Ve
République, Aubanel, 2007.
Brothers, (J),
Soeryadinata Wibawa, (A),
Fenzel, (M), Méthodes systématiques
pour faire avancer l'observation électorale, disponible en ligne
PDF, sur le site
www.ndi.org consulté le 14 mai
2014.
Cot, (J.P),
Pellet, (A) et Forteau,
(M), La Charte des Nations Unies, Commentaire article par
article À Economica À 3ème édition, 2005,
tomes 1 et 2.
Diamond, (L), The spirit
of democracy. The struggle to build free societies through out the world,
Henry and Company, 2008.
Diamond, (L), Linz, (J.J) et Lipset, (S.M),
(sous la direction de) Les Pays en développement et
l'expérience de la démocratie, Nouveaux horizons, 1991.
Drago, (R), (dir),
Souveraineté de l'Etat et interventions internationales, Paris,
Dalloz, 1996.
Garber, (C), Principes
directeurs pour l'observation internationale des élections, le
groupe juridique sur les droits de l'Homme internationaux,
Washington D.C, 1998. Goodwin-Gill,
(G.S), Elections libres régulières
droit-international et pratique,
Union interparlementaire, Genève, 1994.
Goodwin-Gill, (G.S),
Codes de conduite pour les élections, Union Interparlementaire,
Genève Suisse, 1999.
Lauvau, (Ph), Les
grandes démocraties contemporaines À PUF À Droit
fondamental À 3ème édition, 2004.
97
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Le Directeur Général des Elections du
Québec, L'observation électorale, Guide pratique
à l'intention des membres des missions d'observation électorale
à l'étranger, Québec, 1997.
Kaba Mbaye, Les Droits de l'Homme en
Afrique, 2ème édition, Paris, Pédone, 2002.
Klein, (P), Le droit aux élections
libres en droit international : Mythes et réalités (la recherche
du nouvel ordre mondial), Bruxelles, Edition Complexe, 1993.
Kolm, (S), Les
élections sont-elles la démocratie ?, Paris, Edition
Complexe, 1993. Morange, Droits de l'homme et
libertés publiques, PUF, Droit fondamental, 5ème
édition, 2000.
Ndoumou (F. D), Les
missions d'observation des élections, Paris, L'Harmattan, 2012.
Observatoire permanent de la coopération
française, La coopération judiciaire, l'observation
internationale des élections suivie de la coopération
militaire, Paris, Karthala, 1997.
Ollier, (S),
L'observation internationale des élections dans la région de
l'OSCE : contribution à l'étude de l'effectivité du
contrôle électoral international, Paris, L'Harmattan,
Collection Logiques Juridiques, 2012.
Pastor Ruduejo (J.A), «
Le droit international à la veille du XXIe siècle : normes faits
et valeurs », RCADI, n°274, 1998, pp 21-305.
Petiteville, (F), La
politique Internationale de l'Union Européenne, Paris, Presses de
Science Po, 2006.
Quantin, (P), (dir),
Gouverner les sociétés africaines. Acteurs et
institutions, Paris, Karthala, 2005.
Santiso, (J), (Sous la
direction), A la recherche de la démocratie, Paris, Karthala,
2002.
Sen, (A), La
démocratie des autres, Paris, PAYOT, 2005.
Sindjoun (L), L'Etat
Ailleurs, Paris, Economica, 2002.
Sindjoun (L) Sociologie
des relations internationales africaines, Paris, Karthala, 2002.
IV. Thèses et Mémoires
A. Thèses
Abessolo Nguema, (J.R),
Gouverner les personnes réfugiées : essai de sociologie de
l'action publique de l'asile au Cameroun, Thèse de Doctorat/Ph D,
en Science Politique, Université de Douala, Année
Académique 2011-2012.
Andriollo-LeBlanc, (A),
L'assistance internationale et les Nations Unies 19891999,
Thèse de Doctorat en Droit Public International, Université de
Paris I, Panthéon-Sorbonne, Novembre 2000.
Beau (O), Etat et
souveraineté pour une théorie de l'Etat, Thèse de
Doctorat d'Etat en Droit Public interne, Université de Paris II,
1989.
Charnay (J), Le
contrôle de la régularité des élections
parlementaires, Thèse de Doctorat en Droit Public,
Université de Paris, 1964.
Ebolo (M.D),
L'implication des puissances étrangères dans le processus de
démocratisation au Cameroun : l'expérience française et
américaine (1990-1997), Thèse de Doctorat 3ème cycle,
IRIC/UYII, 1997.
Mengue Ekome, (R), Droit
d'ingérence limites et controverses, Thèse de Doctorat en
Droit Public International, Université de Reims, 1997.
Kassere Afo Sabi, La transparence des
élections en droit public africain, à partir des cas
béninois, sénégalais et togolais, Bordeaux 4 en
cotutelle avec l'Université de Lomé. Faculté de droit.
Togo, Mars 2013, consulté sur
www.theses.fr
98
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Kokoroko, (D),
Contribution à l'étude de l'observation internationale des
élections, Thèse de Doctorat en Droit Public International,
Université de Poitier, 2005, consulté sur
www.theses.fr
Konadjé, (J-J),
L'intervention de l'ONU dans la résolution du conflit
intraétatique ivoirien, Thèse de Doctorat, Science
Politique, Université de Toulouse, Année 2010, consulté
sur
www.theses.fr
Moine, (A), Emergence
d'un principe d'élections libres en Droit International Public,
Thèse de Doctorat de Droit Public International, Université de
Nancy II, 1998, consulté sur
www.theses.fr
Monney Mouandjo (S), La
démocratie au Sud et les Organisations Internationales : analyse
comparée des missions internationales d'observation des élections
des pays membres du Commonwealth et des pays membres de l'organisation
Internationale de la Francophonie, Thèse de Doctorat en Droit
public nouveau régime, Université de Reims Champagne Ardenne,
2007- 2008, consulté sur
www.theses.fr
Omar Diop El Hadj, Partis politiques et
processus de transition démocratique en Afrique noire : recherche sur
les enjeux juridiques et sociologiques du multipartisme dans quelques pays de
l'espace francophone, Paris, publibook université, 2006, 755p,
consulté sur
www.theses.fr
Sindjoun (L),
Construction et Déconstruction Locales de l'Ordre Politique au
Cameroun. La Sociogénèse de l'Etat, Thèse de Doctorat
d'Etat en Science Politique, Université de Yaoundé II, F.S.J.P,
Année académique 1993-1994.
Somali (K), Le parlement
dans le nouveau constitutionnalisme en Afrique : essai d'analyse
comparée à partir des exemples du Benin, du Burkina Faso et du
Togo, Thèse de Doctorat en Droit constitutionnel, Université
de Lille 2, 2008, consulté sur
www.theses.fr.
Sono Bivegnono, (E),
Analyse des moyens nationaux et internationaux de contrôle du
processus électoral en Afrique, Thèse de Doctorat de Droit
Public International, université de Cergy-Pontoise, 2008,
consulté sur
www.theses.fr
Tabi Akono, (F), Le
discours de la Baule et les processus démocratiques en Afrique :
contribution à la problématique de la démocratie et du
développement dans les pays d'Afrique Noires, Thèse de
Doctorat en Science Politique, Université de Clermont Fernand, 1995.
Tong (P), Les
conférences nationales en Afrique noire francophone : les chemins de la
démocratie, Thèse de Doctorat en Science Politique,
Politologie, Université de Lille II, 1997.
Zamuna, (A),
Ingérence humanitaire et droit international, Thèse de
Doctorat en Droit Public International, Université de Nice 1998.
B. Mémoires
Atangana, (E.A), Le
positionnement politique des élites éwondo de
Yaoundé, Mémoire de Diplôme d'Etudes Approfondies en
Science Politique, Université de Yaoundé 2, Année
Académique 2007-2008.
Boof-Reichenbac, Le concept de la
souveraineté de l'Etat considéré dans le cadre de
l'observation des élections, Mémoire de Diplôme
d'Etudes Approfondies, de Science Politique, Université, Paris II Assas,
1997.
Crochetet, (M), La
sociogenèse de l'observation électorale internationale : le
rôle des missions d'observation électorale internationale dans la
promotion de la démocratie, Mémoire Master II recherche en
Science Politique, IEP de Toulouse, Année Académique, 2013,
consulté sur
www.memoire.sciencespo-toulouse.fr/memoireccrochetet
99
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Ebolo, (M.D), «
Facteurs Extérieurs et Démocratisation en Afrique : le cas de
l'action allemande au Cameroun », Mémoire de Maîtrise
Professionnelle en Relations Internationales, Université de
Yaoundé II, IRIC, octobre 1994.
Dime Li Nlep, (Z.P), La
garantie des droits fondamentaux au Cameroun, Mémoire de
Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit international des Droits de
l'Homme, Université Abomey-Calavi, Bénin, 2004, disponible sur
www.memoireonline.com.
Fokou, (F.M), Le symbole
de la paix dans le processus de démocratisation des régimes
monolithiques d'Afrique noire. Le cas du Cameroun, Mémoire de
DIPEII, Ecole normale supérieure de l'Université de
Yaoundé I, disponible sur
www.memoireonline.com
Mbassi Bedjoko, Le processus
électoral au Cameroun, Mémoire de Master II en Droits de
l'Homme et Action Humanitaire, Université Catholique d'Afrique Centrale
(UCAC), 2004, disponible sur
www.memoireonline.com.
Monney Mouandjo, (S), La
démocratie à l'épreuve du Sud : analyse comparée
des missions internationales d'observation des élections dans les pays
du Commonwealth et dans les pays de la Francophonie, mémoire
soutenu à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, déc.
2005.
Omgba Akoudou, (E.Y), La
gestion des risques de crise par les agences onusienne et européenne de
coordination humanitaire : cas de la sécheresse de la corne de
l'Afrique, Mémoire de Master II, Université Catholique
d'Afrique Centrale (UCAC), juillet 2013.
Tala Wakeu, (A),
L'abstentionnisme électoral au Cameroun à l'ère du
retour au multipartisme, Université de Dschang-Cameroun - Master en
Science Politique 2012, disponible sur
www.memoireonline.com.
Wella, (M), Processus
électoraux en Afrique noire francophone, Mémoire de
Diplôme d'Etudes Approfondies, Droit Public 2011, Université de
Lomé, disponible sur
www.memoireonline.com
Zebla Djaba, Le parlement dans la
démocratisation au Tchad : analyse sociopolitique d'une scène et
d'une arène institutionnelles, Mémoire de Master II en
Science Politique, Université de Douala, année 2010/2011.
V. Articles et Revues
Aano (J), « Le rapport
des observations électoraux (élaboration, continue, publications
», Bruexlles Bruylant, 1994.
Ali Diabaté Tadjoudine, « La
problématique des élections après un conflit et de la
certification, Séminaire de l'Organisation Internationale de la
Francophonie »,
New York, USA, 11 décembre 2008.
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENTTEXTE/4424.pdf.
Bedjoko (M), « Le vote
au Cameroun depuis 1992 : Exigences normatives et pratiques sociales »,
Cahier africain des droits de l'homme, Droit à la démocratie
en Afrique Centrale, 9, Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2003.
Beland, (D), «
Néo-institutionnalisme historique et politiques sociales : une
perspective sociologique », Politique et Sociétés,
vol. 21, n° 3, 2002, pp. 21-39.
Biagiotti (I), «
Afrique, Droits de l'Homme, Démocratie et Conditionnalité :
Éléments des discours allemands » in L'Afrique
Politique. Vue sur la Démocratisation à marée basse.
CEAN, Paris, Karthala, 1995, p. 203.
Bokatola, (I), « Un
exemple d'observation internationale des élections : la commission des
communautés européennes et commission internationale des
100
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
juristes », élections
présidentielles à Madagascar de 1993, Liberté des
élections et observation internationale, Bruxelles, Bruylant,
1995.
Bougueli, (G), «
Cameroun les nerfs à fleur de peau, A cinq mois de l'élection
présidentielle, Paul Biya laisse planer le mystère sur sa
candidature. En attendant, le pouvoir fait feu de tout bois pour juguler la
grogne sociale », in Jeune Africaine Economique n°
2628, du 22 au 28 mai 2011, pp. 30-32.
Bourdieu, (P), « La
représentation politique [Éléments pour une théorie
du champ politique] », in Actes de la recherche en sciences
sociales. Vol. 36-37, février/mars 1981. La représentation
politique-1. pp. 3-24. doi : 10.3406/arss.1981.2105
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-
5322_1981_num_36_1_2105
Bourgi (A) et Colin (J-P),
« L'organisation internationale de la Francophonie : un instrument pour
l'expansion de la démocratie », in Questions
internationales, N°22, la documentation française,
Novembre-décembre 2006, pp.103-110.
Bourgi, (A), « L'observation internationale des
élections en question », in observatoire permanent de la
coopération française, Paris, Karthala, 1997.
Boutros Boutros-Ghali (P), Le droit
international à la recherche de ses valeurs : Paix développement
démocratie, RCADI, n°286, 2000, pp. 13-37.
Buijtenhuijs (R), Tchad.
Le referendum constitutionnel du 31 mars 1996, Politique Africaine
n°6, juin 1996
Chege, (M), «Between
Africa's externes» in Journal of Democracy, January,
1995, vol 6, pp. 44-51
Christakis, (T), « Le
droit à l'autodétermination en dehors des situations de
décolonisation », Paris, La Documentation
française, Aix-en-Provence, Université d'Aix-Marseille III,
Centre d'études et de recherches internationales et
communautaires, 1999.
Combacau, (J), «
Pas une puissance, une liberté : la souveraineté
internationale de l'État », 1993 n°67, Pouvoirs.
Cornillon, (P), «
Droits et responsabilité des observateurs électoraux
», in Liberté et observation des
élections, Bruylant, 1994.
De Raulin, (A) «
L'action des observateurs internationaux dans le cadre de l'ONU et de la
société internationale », 1995, R.G.D.I.P, p.
592-675.
Dedieu, (J-P), « Les
élites africaines, enjeu de la diplomatie scientifique des Etats-Unis
», Politique Etrangère, 1/2003.
Diamond (L), «Promoting
democracy in the 1990's. Actors and instruments, issues and
imperatives», Washington, Carnegies Commission on preventing
dealy conflict, 1995.
Diouf, (M) «
Libération politiques ou transitions démocratiques : perspectives
africaines », CODESRIA, 1998, p. 32.
Dodzi Kokoroko, « Souveraineté
étatique et principe de légitimité démocratique
», Revue québécoise de droit international, 2003,
p. 39.
Dogan, (M), « L'analyse
quantitative en science politique : us et abus », Revue
internationale de politique comparée, Vol 1, n° 1, 1994.
Dogan, (M),
Pelassy, (D), « Sociologie politique
comparative : problèmes et perspectives », Paris,
Economica, 1982. pp. 97-121.
Du Bois de Gaudusson (J),
« Les élections à l'épreuve de l'Afrique » in
Cahier Constitutionnel n° 13 /2002, p. 11
Dupuy (P-M), «
Situation et fonctions des normes internationales », in Bettati
(M) et Kouchner, (B), (dir), Le devoir
d'ingérence, Paris, Denoël, 1987, 155 aux pp. 155158
101
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Ebolo (M-D), «
L'implication des puissances occidentales dans les processus de
démocratisation en Afrique : analyse des actions américaine et
française au Cameroun (1989-1997) », in Polis, Revue
camerounaise de Science politique. Vol. 1, Numéro spécial,
février 1996, pp. 51-56
Ebolo, (M.D), «
Nationalisme gouvernemental et pressions extérieures dans le contexte de
démocratisation : Le cas camerounais », in Polis, Revue
camerounaise de Science politique. Vol. 1, Numéro spécial,
février 1996, p. 51.
Eisenmann, (P-M), «
L'arrêt de la CIJ du 27 juin 1986 dans l'affaire des activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci », 1986, 32
A.F.D.I. pp. 153-173.
Elles, (L), «
Utilité d'un modèle international de rapport d'observation sur le
déroulement des élections », Bruxelles, Bruylant,
1994, pp.387-405.
Engueleguele (M), «
Opinion publique et sondages au Cameroun », Revue internationale des
sciences sociales, 2001/3 n° 169, p. 519-531. DOI :
10.3917/riss.169.0519.
Feuer, (G), « Le
nouveau paradigme pour les relations entre l'UE et les États ACP :
l'accord de Cotonou du 23 juin 2000 », 2002, R.G.D.I.P. pp. 106-269.
Frognier, (A-P), Logique(s) de
l'explication comparative, Revue internationale de politique
comparée, Vol 1, n° 1, 1994.
Gazibo, (M), « La
contribution du néo-institutionalisme à l'analyse comparée
des processus des transitions », colloque de la Revue
internationale de politique comparée, Bordeaux, février 2002. pp.
72-102.
Gazibo, (M), « La
démarche comparative binaire : éléments
méthodologiques à partir d'une analyse de trajectoires
contrastées de démocratisation », Revue
internationale de politique comparée, vol.9, N°3, 2002, pp.
427-449.
Gazibo, (M), « Le
néo-institutionnalisme dans l'analyse comparée des processus
démocratique », in Politique et Société, vol.21,
n° 3, 2002, pp. 139-160.
Giraud, (O), « Le
comparatisme contemporain en science politique : entrée en dialogue des
écoles et renouvellement des questions », in Lallement,
M., Spurk, J. (dirs), Stratégies de la comparaison
internationale, Paris, Editions du CNRS, 2003, pp. 87-106.
Glele-Ahanzo, (M), « Organisation de
l'observation internationale des élections, (désignation des
observateurs, accréditation, garanties, minima etc.) » in
Liberté et observation des élections, Bruxelles,
Bruylant, 1994, pp. 274-285.
Goybet (C), « Aide au
développement, démocratie et Droits de l'Homme : premier bilan
», in Revue du marché commun et l'Union
Européenne, n°372, novembre 1993, pp. 775-777.
Griffiths (C), « Pour
un appui résolu au processus électoral dans les pays avec une
expérience démocratique limitée », in
Liberté et observation internationale des élections,
Bruxelles, Bruylant, 1994.
Gros-Espiell, (H), «
Liberté des élections et observation internationale des
élections. Rapport général», in Colloque de la
Laguna, Liberté des élections et observation internationale des
élections, Bruylant, Bruxelles, 1994.
Hassenteufel, (P), «
Deux ou trois choses que je sais d'elle : remarques à propos
d'expériences de comparaisons européennes », in
CURRAP, Les méthodes au concret, Presses universitaires de
France, 2000, p. 105-124.
Hugon, (P), « Les
nouveaux acteurs de la coopération en Afrique», International
Development Policy | Revue internationale de politique de
développement, 12010, Online since 14 December 2009, connection on
17 June 2014. URL :
http://poldev.revues.org/118,
DOI : 10.4000/poldev.118
102
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Jankowiitsch (P), «
Suites nationales et internationales à donner au rapport des
observateurs électoraux », in Liberté et
observation internationale des élections, Bruxelles, Bruylant,
1995.
Karlheinz, (N), « Bilan
de l'observation des élections », in Liberté des
élections et observation internationale des élections, p
117, The OSCE/ODIHR, Election observation Handbook, 2ème Edition,
1997.
Klotz, (A) et
Lynch, (C), « Le constructivisme dans la
théorie des relations internationales », Critique
internationale, n°2-1999, pp. 51-62.
Kpoti Topanou, (V) « De
la Démocratie en Afrique » in Afrique 2000, n° 19,
Octobre-Décembre 1994, pp. 53 -73.
Leca, (J), « Pour une
analyse comparative des systèmes politiques méditerranéens
», Revue française de science politique, Vol 27,
n° 4-5, 1977.
Lecours (A), «
L'approche néo-institutionnaliste : unité ou diversité ?
», Politique et Société, Université
Concordia, Vol. 21, N°23, 2002.
Maurice, (M),
Méthode comparative et analyse sociétale : Les implications
théoriques des comparaisons internationales, Sociologie du travail,
Vol XXI, n°2, 1989.
Mentong (H- L), « Vote
et communautarisme au Cameroun : « un vote de coeur de sang et de raison
», in Politique africaine, N° 69, Paris Karthala, 1998, pp
40-52.
Monga, (C) « L'indice
de Démocratisation : Comment déchiffrer le nouvel
aide-mémoire de l'autoritarisme » in Afrique 2000, n°
22, Juillet-Septembre 1995, pp. 63.
Monney Mouandjo (S),
«L'analyse Comparée des missions internationales d'observation des
élections des pays du Commonwealth et des pays de la Francophonie»,
Cahier d'Etudes Internationales, n°1 Novembre, Pur, 2006, pp
21-39.
Moss, (T.O), « La
Conditionnalité Démocratique dans les Relations entre l'Europe et
l'Afrique », in l'Évènement Européen,
n° 19, septembre 1992, p. 75.
Nguiamba, (E. P), «
Cameroun présidentielle 2011: l'Union Européenne donne 196
millions CFA a Transparency International- Cameroon »,
www.journalducameroun.com,
mis en ligne le 28 juillet 2011, consulté le 10 juin 2014.
Olinga, (A.D) « Bilan
des élections législatives et municipales du 30 juin 2002 au
Cameroun et impact sur l'évolution démocratique du pays »,
Cahier africain des droits de l'homme, n° 9, pp 75-115.
Olinga, (A.D) « L'ONEL
: Réflexions sur la loi camerounaise du 19 décembre 2000 portant
création d'un Observatoire national des élections »,
Yaoundé, Presses de l'UCAC, 2001, pp 7-27.
Onana, (J), « La
déviance politique comme catégorie discursive de construction de
la réalité politique en Afrique », Cahier Africain des
Droits de l'Homme n° 9, 2003, pp 85-114.
Onana, (J), « Elecam,
le pari de l'impartialité et de la transparence », in
l'année du Président, 2010, les voies de
l'émergence, impressions Galma, Yaoundé.
Otayek, (R), « Les
élections en Afrique sont-elles un objet scientifique pertinent ?
», Politique Africaine n° 16, 1981, pp. 3 À 11.
Ouattara, (F.N), «
L'observation des élections en Afrique », in Revue de la
recherche juridique, droit prospectif, 1998, 23ème année,
n°72, pp 301-325.
Owona Nguini, (M-E) et
Talla, (J- B), « Présidentielles
2011 ! Comment vaincre le sida électoral au Cameroun », Editorial
du Journal Germinal n° 058 pp. 3-4.
103
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Peter A. Hall et Rosemary
C.R.Taylor, « La science politique et les trois
néo-institutionnalismes », in Revue francaise de science politique,
47ème année, n°3-4, 1997, pp.469-496.
Pilet, (J-B), « Les
nouveaux souffles dans l'analyse des systèmes électoraux »,
Revue française de science politique, vol. 85, n°1, 2008,
pp. 141-147.
Pilon, (M),
«L'observation internationale des élections en Afrique» in
Observatoire permanent de la coopération française,
pp.79-99.
Quantin (P), Pour une
analyse comparative des élections africaines, in Politique
africaine, N° 69, Paris, Karthala, 1998, pp 12-28
Quantin, (P), « Pour
une analyse comparative des élections africaines », in
Politique Africaine n° 69, Paris, Karthala, 1998, pp. 12-28.
Raynal, (J.J), «Le
Renouveau Démocratique Béninois : Modèle ou Mirage ?»
in Afrique Contemporaine, n° 160, 4ème trimestre, 1991,
la Documentation Française, pp. 6-7.
Rizza (R), «
Néo-institutionnalisme sociologique et nouvelle sociologie
économique : quelles relations ? », Revue Interventions
économiques [En ligne], 38 | 2008, mis en ligne le 01
décembre 2008, consulté le 15 juin 2015.URL :
http://interventionseconomiques.revues.org/292
Salim Ahmed Salim, « Les principes
fondamentaux de la démocratie sont universels et dès lors pour
tous », in Panafrican news agency, du 1erdécembre 1997, p.
4.
Sartori, (G), « Bien
comparer, mal comparer, Revue internationale de politique comparée
», vol.1, N°1, 1994, pp. 19-36.
Sietchoua Djuitchoko, (C),
«Introduction au contentieux des élections législatives
camerounaises devant la Cour Suprême statuant comme Conseil
constitutionnel», Juridis périodique, n° 50,
Avril-Mai-Juin 2002, p. 92.
Sindjoun, (L) « La
culture démocratique en Afrique subsaharienne : comment rencontrer
l'arlésienne de la légende africaniste, in Francophonie et
démocratie, symposium sur le bilan des pratiques de la démocratie
des droits et des libertés dans l'espace francophone »,
Paris, Pedone, 2001, pp 522-530.
Sindjoun, (L) « La
culture démocratique en Afrique subsaharienne : comment rencontrer
l'arlésienne de la légende africaniste, in Francophonie et
démocratie, symposium sur le bilan des pratiques de la démocratie
des droits et des libertés dans l'espace francophone », Paris,
Pedone, 2001, pp.522-530.
Sindjoun, (L), «
Cameroun : le système politique face aux enjeux de la transition
démocratique », Afrique politique, Paris, Karthala, 1994,
pp.143-165
Sindjoun, (L), « Elections et politique
au Cameroun : Concurrence déloyale, coalitions de stabilité
hégémonique et politique d'affection », African Journal
of Political Science, volume 2, n°1, 1997, pp. 81-121.
Sindjoun, (L), « La
loyauté démocratique dans les relations internationales :
sociologie des normes de civilité internationale », Revue
Etudes internationales », volume XXXII, n°1 mars 2001
pp.31-49.
Sindjoun, (L), « Cameroun : le
système politique face aux enjeux de la transition démocratique
», Afrique politique, Paris, Karthala, 1994,
P.143-165.
Sindjoun, (L), « La
loyauté démocratique dans les relations internationales :
sociologie des normes de civilité internationale », Revue
Etudes internationales, volume XXXII, n°1 mars 2001 pp. 31-49.
Sob, (P), « Le Principe
d'universalité des droits de l'homme : mythe et limites » in
Afrique 2000, n° 22 juillet-septembre 1995, p. 15.
Stone (A), « Le
néo-institutionnalisme, Défis conceptuels et
méthodologiques», Politics and Society, University of
California, Politics, N°20, 1992
104
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Sur (S), « Le
Royaume-Uni, Après le déclin le retour », in
Questions internationales, n° 20, documentation française,
Juillet-Août 2007 pp. 4-9.
Thierry, (H), «
L'État et l'organisation de la société
internationale», in L'État souverain à l'aube du
XXIème siècle. Actes du Colloque de Nancy : XXVIIe colloque
de la Société française pour le droit international,
Paris, Pedone, 1994 p. 146.
Zorgbibe, (C),
«Impératif démocratique et relations internationales»,
in Géopolitique africaine, pp. 65-85.
VI. Documents officiels et rapports de fin de
missions
d'observation des élections des
élections
Etat des pratiques démocratiques de la
démocratie des droits de l'homme et des libertés dans l'espace
francophone : éléments pour un premier rapport au
Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la
Francophonie, Délégations des droits de l'homme et de la
démocratie, 2004.
L'observation des élections dans l'espace Francophone,
(synthèse des termes fondateurs d'une problématique et
éléments constitutifs de bilan), 3ème Réunion
préparatoire au symposium de Bamako, AIF, 2000.
Déclaration sur les critères pour des
élections libres et régulières, Union parlementaire
internationale, 154e session, paris, 26 mars 1994.
Déclaration Universelle sur la Démocratie,
Conseil interparlementaire lors de la 161e session, UIP, le Caire, 16 sept
1997.
Boutros-Boutros Ghali, discours d'ouverture de la
conférence mondiale de vienne sur les droits de l'homme, (14-25 juin
1993).
A. Rapports de fin de missions, des organisations
internationales
Cameroon presidential election 2004, Report of the Commonwealth
observer Group, 21st october 2004.
B. Rapports et communiqué de fin de missions de
La Francophonie
Election présidentielle au Togo, 15 Nov. 1998
Election législatives et municipales au Cameroun
(Communiqué conjoint OIF-OUA)
juin
2002.
Election présidentielle au Cameroun, 11 octobre 2004
C. Rapport des acteurs nationaux et internationaux
étatiques et non étatiques
CNDHL, Le rapport général sur l'observation de
l'élection présidentielle du 11 octobre 2004.
105
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
National Democratic Institute for International Affairs,
Rapport de la mission d'observateurs internationaux sur l'élection
présidentielle anticipée du 11 octobre 1992 au Cameroun.
Transparency International Cameroon, Election
présidentielles du 09 octobre 2011 au Cameroun, rapport de la mission
d'observation électorale.
Election Cameroon, Rapport général sur le
déroulement de l'élection présidentielle du 09 octobre
2011.
Réseau Camerounais des Organisations des Droits de
l'Homme, Rapport d'observation de l'élection présidentielle du 09
octobre 2011.
Mouvement Citoyen, Rapport d'observation de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011.
Service National « Justice et Paix » de la
Conférence Episcopale Nationale du Cameroun, « De la
souveraineté du peuple camerounais en question », in Rapport
de synthèse sur l'observation de l'élection présidentielle
du 11 octobre 2004, Presse Universitaire d'Afrique ?
VII. Revues et journaux divers
Annuaire de Jeune Afrique 94, Rapport annuel sur de l'Afrique.
Afrique Education, « Présidentielle en Côte
d'Ivoire : Vers un duel Ouattara-
Koulibaly », n° 391, du 16 au 31 mai 2014.
Cameroon Tribune n° 4670 mardi 3 juillet 1990.
Cameroon Tribune, n° 4683 22-23 juillet 1990.
Cameroon Tribune n° 5108, mardi 07 Avril 1992.
Cameroon Tribune n° 5251, lundi 2 novembre 1992.
Cameroon Tribune n°5231, 7 octobre 1992.
Cameroon Tribune n°5252 mardi 3 novembre 1992.
Cameroon Tribune n° 5253 mercredi 4 novembre 1992.
Cameroon Tribune n° 5746, vendredi 16 Décembre
1994.
Cameroon Tribune n° 5948 du Lundi 09 octobre 1995.
Cameroon Tribune n°9523/5724 10 janvier 2010.
Le Jour, « Les ambassadeurs des Etats-Unis et la
Cameroun de Paul Biya : Leurs
coups de gueule », n° 1507, mardi 27 aout
2013.
Jeune Afrique, Hebdomadaire international indépendant
51ème année n° 2628 du 22
au 28 mai 2011.
Jeune Afrique Economique Hors-Série n° 20 : «
Spécial élection présidentielle
2011 ».
Jeune Afrique Economique, « L'impasse ivoirienne
», n° 383, avril-mai 2011.
Jeune Afrique Economique, « Spécial en Côte
d'Ivoire, Laurent Gbagbo », n° 319, du
6 au 19 novembre 2000.
Jeune Afrique, « Côte d'Ivoire,
Présidentielle 2010, le destin de Soro », n° 2598-2599
du 24 octobre au 6 novembre 2010.
Jeune Afrique, «Côte d'Ivoire,
Présidentielle 2010, Dans les coulisses de
l'élection»,
n° 2596-2597 septembre-octobre 2010.
Jeune Afrique, «Côte d'Ivoire dans la tête
de Laurent Gbagbo, Comment l'ex-Chef
d'Etat a vécu sa défaite, et pourquoi il a
décidé de ne pas l'accepter», n° 2605 du
12 au 18 décembre 2010.
Jeune Afrique, « Cameroun les nerfs à fleur de
peau», n° 2628 du 22 au 28 mai 2011.
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
VIII. Sites Internet
www.commonwealth.org/reports
www.lafrancophonie.org
www.ipu.org/french/pressarc00.htm
www.article19.org/publications/index.html
www.fratmat.info
www.ndi.org/globalp/elections/elections.as
www.idea.int
www.theses.fr
www.memoireonline.com
www.journalducameroun.com
106
LISTE DES ANNEXES
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
107
Extrait des Lois organisant les élections
présidentielles au Cameroun depuis la loi n° 92/10 du 17
décembre 1992 fixant les conditions d'élection et de
suppléance à la présidence de la République
modifiée et complétée par les lois n°97/020 du 09
septembre 1997 et 2011
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Titre premier : Dispositions générales.
«Article 1er. (Nouveau) (1) Le Président de la
République est élu pour un mandat de sept (07) ans au suffrage
universel direct, égal et secret.
(1) Il est rééligible.
(2) L'élection a lieu au scrutin uninominal
majoritaire à un tour, vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours
au plus avant I' expiration des pouvoirs du Président de la
République en exercice.
(3) Est élu, le candidat ayant obtenu la
majorité des suffrages exprimés.
Chapitre premier : Des commissions chargées des
opérations préparatoires
Article 11. À Sont considérées comme
opérations préparatoires, l'établissement et la
révision des listes électorales ainsi que l'établissement
et la distribution des cartes électorales. SECTION PREMIÈRE : Des
commissions de révision des listes électorales
Article 12 (nouveau) Les listes électorales sont
établies par les démembrements territoriaux d'Elections Cameroon,
en relation avec les commissions mixtes compétentes.
Article 13 (nouveau) (1) Il est créé dans chaque
commune, une commission chargée de la révision des listes
électorales. Lorsque l'étendue ou le chiffre de la population de
la commune le justifie, le Directeur Général des Elections peut
créer plusieurs commissions de révision des listes
électorales.
(2) La commission de révision des listes
électorales est composée ainsi qu'il suit:
Président: Un représentant d'Elections Cameroon
désigne par le Directeur General des
Elections;
Membres
- Un représentant de l'Administration,
désigné par le sous-préfet;
- Le maire, un adjoint ou un conseiller municipal
désigné par le maire;
- Un représentant de chaque parti politique
légalisé et présent sur le territoire de la commune
concernée.
(3) Le sous-préfet, le maire et chaque parti politique
doivent notifier au moins quinze (15) jours avant le début des
opérations de révision des listes électorales, au
démembrement
108
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
communal d'Elections Cameroon, les noms de leurs
représentants désignés pour siéger au sein de la
commission.
(4) Si un parti politique n'a pas désigné de
représentant en temps utile, le responsable de l'antenne communale
d'Elections Cameroon peut, après une mise en demeure restée sans
effet, adjoindre à la commission une personnalité issue de la
société civile. (5) Si le Maire n'a pas désigné de
représentant en temps utile, le responsable de l'antenne communale
d'Elections Cameroon, après une mise en demeure restée sans
effet, saisit le Préfet qui désigne un responsable de la commune
pour siéger au sein de la commission en qualité de
représentant de la commune.
Section II : Des commissions de contrôle de
l'établissement et de distribution des cartes électorales
Article 14.-(nouveau) (1) Il est créé au niveau
de chaque commune, une ou plusieurs commissions chargées du
contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes
électorales.
(2) La commission de contrôle de l'établissement et
de la distribution des cartes électorales est
composée ainsi qu'il suit:
Président: Un représentant d'Elections Cameroon
désigné par le Directeur Général des
Elections;
Membres:
- Un représentant de l'Administration,
désigné par le sous-préfet ;
- Le maire, un adjoint au maire ou un conseiller municipal
désigné par le maire;
- Un représentant de chaque parti politique
légalisé, présent sur le territoire de la commune
concernée.
(3) La composition de la commission de contrôle de
l'établissement et de la distribution des cartes électorales est
constatée par décision du Directeur Général des
Elections qui, au moins quinze (15) jours avant le début des
opérations de distribution des cartes électorales, transforme les
commissions de révision des listes électorales en commissions de
contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes
électorales.
(4) A l'issue de ses travaux, la commission de contrôle
de l'établissement et de la distribution
des cartes électorales dresse un procès-verbal
signé du président et de ses membres.
Chapitre II : Des commissions locales de vote.
Article 15 (nouveau) (1) II est créé pour chaque
bureau de vote, une commission locale de
vote composée ainsi qu'il suit:
Président : une personnalité désignée
par le Directeur Général des Elections ;
Membres :
- un représentant de I' Administration,
désigné par le sous-préfet;
- un représentant de chaque candidat.
(2) Au plus tard le sixième jour avant le scrutin, les
noms des représentants de l'Administration et des candidats, choisis
parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale
correspondant au bureau de vote concerné, sont notifiés au
démembrement communal d'Elections Cameroon.
(3) La composition de chaque commission locale de vote est
constatée par décision du Directeur General des Elections.
Article 16. À Chaque candidat peut, en outre,
désigner deux électeurs pour servir comme scrutateurs dans chaque
bureau de vote et deux suppléants.
Article 17. À Si un ou plusieurs représentants
désignés par les candidats font défaut à
l'ouverture du scrutin, le président de la commission doit par
décision consignée au procès-verbal, désigner, pour
la compléter, des électeurs inscrits sur la liste
électorale correspondant au bureau de vote et se réclamant du ou
des candidats.
Il désigne par priorité les électeurs
sachant lire et écrire le français ou l'anglais.
109
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
A défaut de tels électeurs sachant lire et
écrire, il est fait appel aux autres électeurs du même
bureau de vote et, mention en est faite au procès-verbal.
Article 18. À Trois membres de la commission au moins
doivent être présents dans le bureau ou à proximité
immédiate pendant tout le cours des opérations
électorales.
Cependant, s'il éprouve des difficultés
insurmontables pour constituer la commission, le président peut ouvrir
le bureau à l'heure d'ouverture du scrutin ; il mentionne au
procès-verbal l'heure à laquelle les membres de la commission
désignés ont pris leurs fonctions.
Article 19. À Les représentants des candidats
qui, sans motif valable, ne seraient pas présents, à l'heure de
l'ouverture du scrutin et qui auraient été remplacés par
le président dans les conditions prévues aux articles 17 et 18
ci-dessus ne peuvent pas prétendre siéger au sein de la
commission locale de vote.
Article 20. À Chaque candidat peut désigner
trois (3) représentants par arrondissement ou district, lesquels ont
libre accès dans tous les bureaux de vote de l'arrondissement ou du
district. Ils ne peuvent être expulsés qu'en cas
de désordre provoqué par eux. Mention en est faite au
procès-verbal. Ils peuvent présenter à la commission
locale de vote des observations sur le déroulement du scrutin. Ces
observations sont consignées au procès-verbal.
Article 21. À Le président de la commission
locale de vote assure seul la police du bureau de vote.
Il doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui
n'a pas la qualité d'électeur du ressort dudit bureau de vote,
à l'exception des candidats, des chefs de circonscriptions
administratives dans le ressort desquelles se trouve le bureau, et de leurs
représentants.
Il interdit tout stationnement encombrant devant le bureau de
vote. Il peut requérir la force publique pour faire rétablir
l'ordre ou faire évacuer le bureau.
Nul électeur ne peut entrer dans le bureau s'il est
porteur d'une arme quelconque.
Article 22. À La commission se prononce sur toute
difficulté liée à l'organisation, au déroulement et
au dépouillement du scrutin; en cas de partage des voix, celle du
président est
prépondérante. En cas de contestation de sa
décision, soit par un membre de la commission, soit par un
électeur intéressé, soit par un candidat, il est fait
mention au procès-verbal de la contestation et de la décision
motivée.
Article 23.-(nouveau) (1) La commission locale de vote dresse
un procès-verbal de toutes les opérations du scrutin. Ce
procès-verbal est signé du président et des membres
présents.
(2) Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la
clôture des opérations de vote, le responsable de l'antenne
communale d'Elections Cameroon transmet un exemplaire des procès-verbaux
des commissions locales de vote, assorti des pièces annexes, à la
commission départementale de supervision.
(3) La commission départementale de supervision
transmet le procès-verbal de ses travaux à la Commission
nationale de recensement général des votes dans les
soixante-douze (72) heures.
Chapitre III : Des commissions départementales de
supervision.
Article 24.-(nouveau) Il est créé au niveau de
chaque département, une commission départementale de supervision
chargée de veiller au bon déroulement des opérations
préparatoires aux élections et des opérations
électorales proprement dites. A ce titre, la commission
départementale de supervision:
- Contrôle les opérations d'établissement, de
conservation et de révision des listes électorales ; -
Connaît des réclamations ou contestations concernant les listes et
les cartes électorales; - Assure le contrôle de la distribution
des cartes électorales
- Ordonne toutes rectifications rendues nécessaires
à la suite de l'examen des réclamations ou contestations
dirigées contre les actes des commissions compétentes concernant
les listes et les cartes électorales.
110
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
- Centralise et vérifie les opérations de
décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de
vote ainsi que de tout document y relatif. En cas de simple vice de forme, elle
peut en demander la régularisation immédiate aux membres de la
commission locale de vote. Article 25.-(nouveau) (1). La commission
départementale de supervision, dont le siège est fixé au
chef-lieu du département, est composée ainsi qu'il suit:
Président : le président du tribunal de grande
instance du ressort ;
Membres :
- Trois (3) représentants de l'Administration,
désignés par le préfet;
- Trois (3) représentants d'Elections Cameroon,
désignés par le Directeur General des Elections;
- Un (1) représentant de chaque candidat.
(2) La composition de la commission départementale de
supervision est constatée par résolution du Conseil Electoral.
(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1)
ci-dessus, la commission départementale de supervision est
présidée par un magistrat désigné par le
président de la Cour d' Appel territorialement compétent, dans
tout département non pourvu d'un tribunal de grande instance ou en cas
d'empêchement du président du tribunal de grande instance, suivant
le cas.
(4) Le membre défaillant peut-être
remplacé par l'autorité ou le candidat qui l'a
désigné, par
simple notification au président de la commission
départementale de supervision.
Article 26.- (nouveau) (1) La liste des membres de la commission
départementale de
supervision est tenue en permanence au greffe du tribunal de
grande instance, à la préfecture
et au démembrement départemental d'Elections
Cameroon.
(2) Elle peut être consultée par tout
électeur de la circonscription.
Article 27. À - Les fonctions de président et de
membre de la commission de supervision sont
gratuites.
Chapitre IV : De la Commission nationale de recensement
général des votes.
Article 29.-(nouveau) (1) II est créé une
commission nationale de recensement général des
votes, composée ainsi qu'il suit:
Président:
- Un(1) membre du Conseil Constitutionnel, désigné
par le président du Conseil
Constitutionnel ;
Membres:
- Deux (2) magistrats de l'ordre judiciaire,
désignés par le Premier Président de la Cour
Suprême;
- Cinq (5) représentants de l ' Administration,
désignés par le Ministre chargé de
l'administration territoriale ;
- Cinq (5) représentants d'Elections Cameroon,
désignés par le Directeur Général des
Elections;
- Un (1) représentant de chaque candidat en
compétition, désigné par le candidat ou le parti
politique l'ayant investi.
(2) La composition de la commission nationale de recensement
général des votes est constatée par résolution du
Conseil Electoral.
(3) La liste des membres est communiquée au Conseil
Constitutionnel, et tenue à la disposition du public.
Article 30. (Nouveau) (1) La commission nationale de
recensement général des votes procède au décompte
général des votes, au vu des procès-verbaux et des
pièces annexes transmis par les commissions départementales de
supervision.
(2) Elle redresse les erreurs matérielles
éventuelles de décompte des votes. Elle ne peut toutefois annuler
les procès-verbaux correspondants.
111
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
(3) Le recensement général des votes est public
est effectué au siège du conseil constitutionnel.
(4) La commission nationale de recensement
général des votes dresse procès-verbal de toutes ses
opérations. Ce procès-verbal, signe du Président et des
membres, est transmis dans un délai de cinq (05) jours au Conseil
Constitutionnel, accompagné des pièces annexes.
(3) Les militaires et assimilés de toutes armes sont
inscrits sans condition de résidence sur les listes électorales
du lieu où se trouve leur unité ou leur port d'attache.
Article 4. (Nouveau) (1) Peuvent également être
inscrit sur les listes, les citoyens qui justifient de leur inscription au
rôle des contributions directes dans la circonscription électorale
concernée pour la cinquième année consécutive.
(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1)
ci-dessus, la demande d'inscription doit obligatoirement être
accompagnée d'un certificat de non-inscription sur les listes
électorales ou de radiation, délivré par le
démembrement communal d'Elections Cameroon du lieu du domicile ou de
résidence habituelle de l'intéressé.
Article 5. À Les citoyens camerounais établis
à l'étranger conservent, s'ils en font la demande, le droit
d'être inscrits sur la liste électorale sur laquelle ils
étaient inscrits avant leur expatriation.
Chapitre II : Des incapacités
électorales
Article 6. À Ne doivent pas être inscrits sur la
liste électorale et ne peuvent voter :
a) Les personnes condamnées pour crime, même par
défaut;
b) Les personnes condamnées à une pièce
privative de liberté sans sursis supérieure à trois (3)
mois ;
c) Les personnes condamnées à une peine
privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation
supérieure à six (6) mois;
d) Les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt
;
e) Les faillis non réhabilités dont la faillite
a été déclarée soit par les tribunaux camerounais,
soit par un jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire
au Cameroun;
f) Les aliénés mentaux et les faibles
d'esprit.
Article 7. À(1) Ne peuvent être inscrites sur la
liste électorale pendant un délai de dix (10) ans, sauf
réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour
atteinte à la sécurité de l'Etat. (2) Le délai de
dix ans prévu à l'alinéa 1er ci-dessus court pour compter
du jour de la libération pour les condamnés à une peine
privative de liberté ou, le cas échéant, pour compter du
jour du paiement de l'amende.
Titre III: Conditions d'éligibilités et
incompatibilités
Article 8. À Les candidats aux fonctions de
président de la République doivent jouir de la plénitude
de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans
révolus à la date de l'élection. Ils doivent être
citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue
dans le territoire national d'au moins douze (12) mois consécutifs et
d'une inscription sur les listes électorales à la date du
scrutin.
Article 9.- (nouveau) Les fonctions de Président de la
République sont incompatibles avec toute autre fonction publique
élective ou toute activité professionnelle.
Titre IV : Des commissions électorales.
Article 10. À Il est créé des commissions
électorales mixtes chargées respectivement des opérations
préparatoires aux élections, de l'organisation et de la
supervision des opérations électorales, des opérations de
vote et du recensement général des votes.
Chapitre premier : Des commissions chargées des
opérations préparatoires
Article 11. À Sont considérées comme
opérations préparatoires, l'établissement et la
révision des listes électorales ainsi que l'établissement
et la distribution des cartes électorales.
112
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Titre V (nouveau) : Du rôle du Conseil
constitutionnel
Article 31.-(Nouveau) (1) Le Conseil Constitutionnel veille
à la régularité de l'élection
présidentielle. Il veille à la sincérité du
scrutin.
Titre VIII : Des préliminaires des
opérations électorales. Chapitre premier : De la
convocation du corps électoral. Article 51.-(nouveau) (1) Le
corps électoral est convoqué par décret du
Président de la République.
(3) Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est
déclaré férié et chômé. II ne peut
durer qu'un jour.
(4) Le décret convoquant le corps électoral
précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.
Chapitre II : De la déclaration de candidature.
Article 52. À Les candidats à la
Présidence de la République sont tenus de faire une
déclaration de candidature revêtue de leur signature
légalisée.
Article 53. À Les candidats peuvent être :
(1) Soit investis par un parti politique ;
(2) Soit indépendants, à condition d'être
présentés comme candidat à la présidence par au
moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les
provinces, à raison de trente (30) par province et possédant la
qualité soit de membre de l'Assemblée nationale ou d'une chambre
consulaire, soit de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier
degré. Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures
légalisées par les autorités administratives
territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une
même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour
un seul candidat.
Article 54. À(1) Les déclarations de
candidatures doivent indiquer.
a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
profession et domicile des intéressés :
b) La couleur, le sigle et le titre choisis pour l'impression
des bulletins de vote. (2) La déclaration de candidature est
accompagnée :
a) De la liste de 300 signatures des personnalités
requises à l'article 53 ci-dessus, le cas échéant ;
b) D'un extrait d'acte de naissance du candidat datant de
moins de trois mois;
c) De la lettre de présentation et d'investiture du
parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant
;
d) D'une déclaration sur l'honneur par laquelle le
candidat s'engage à respecter la Constitution ;
e) D'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de
moins de trois (3) mois ;
f) D'un certificat d'imposition;
g) D'un certificat de nationalité;
h) L'original du certificat de versement du cautionnement.
(3) Est interdit le choix d'emblème comportant à
la fois les trois (3) couleurs : vert, rouge, jaune.
Article 55.-(Nouveau) (1) Les déclarations de
candidature doivent être faites en double exemplaire, dans les cinq (05)
jours suivant la convocation du corps électoral.
(2) Les déclarations de candidatures sont faites
auprès de la Direction Générale des Elections. Elles
peuvent également être faites auprès des
démembrements régionaux d'Elections Cameroon, qui les
transmettent dans les vingt-quatre (24) heures à la Direction
Générale des Elections.
(3) Copie en est immédiatement tenue au Conseil
Constitutionnel par le candidat ou son mandataire, contre accusé de
réception.
113
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
(4) Les déclarations de candidature peuvent
également être faites par lettre recommandée, avec
accusé de réception, adressée à la Direction
Générale des Elections avec copie au Conseil Constitutionnel,
à condition qu'elles y parviennent dans le délai prévu
à l'alinéa (1) ci-dessus.
(4) Lorsque les déclarations de candidature sont
déposées, il en est donne récépissé
provisoire. Lorsqu'elles sont adressées par lettre recommandée,
l'accusé de réception en tient lieu.
Article 56.-(nouveau) (1) Le candidat doit verser au
Trésor public un cautionnement fixe à cinq millions (5 000 000)
de francs CFA.
(2) Suite au versement vise à l'alinéa (l), il
est établi en triple exemplaires par les services du Trésor, un
certificat dudit versement. Un de ces exemplaires doit être
immédiatement transmis par les services du trésor au Conseil
constitutionnel ; l'original et l'autre exemplaire sont remis au candidat.
Article 57.-(nouveau) (1) Le Conseil Electoral peut accepter
ou déclarer irrecevable une candidature.
(2) La notification de la décision motivée de
rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par le
Directeur General des Elections. Une copie de ladite décision est
immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel.
(3) La décision de rejet d'une candidature ou celle
portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le
Conseil Constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 61,
62 et 63 ci-dessous.
Article 58.-(nouveau) vingt (20) jours au moins avant la date
du scrutin, le Conseil Electoral arrête et publie la liste des candidats.
Notification en est faite immédiatement au Conseil Constitutionnel.
Article 59.-(nouveau) (1) Lorsqu'un candidat investi par un
parti politique décède avant l'ouverture de la campagne
électorale, il peut être remplacé à l'initiative
dudit parti.
(2) Le remplacement visé à l'alinéa (1)
ci-dessus n'est possible que si la nouvelle candidature est
déposée à la Direction Générale des
Elections au plus tard le vingtième jour précédant le
scrutin.
(3) Les candidats indépendants ne peuvent être
remplacés.
Article 60 (nouveau),- (1) Si un candidat
présenté par un parti politique est déclaré
inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication
des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat
proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions
d'éligibilité prévues par la présente loi.
(2) Ce remplacement doit intervenir dans un délai
maximum de trois (3) jours suivant la décision du Conseil
constitutionnel.
Article 61 (nouveau).- Les contestations ou les
réclamations relatives au rejet ou à l'acception des candidatures
ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou aux symboles
adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil
constitutionnel par tout candidat. Tout parti politique ayant pris part
à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du
Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux
(2) jours suivant la publication des candidatures.
Titre XI : Proclamation des résultats
Article 98 (nouveau).- Le Conseil constitutionnel arrête
et proclame les résultats de l'élection présidentielle
dans un délai maximum de quinze (l5) jours à compter de la date
de clôture du scrutin.
Article 99 (nouveau).- (1) Lorsqu'à l'issue de
l'élection, aucun candidat n'est proclamé élu
Président de la République, le Président sortant reste en
fonction jusqu'à l'élection et la prestation de serment du
Président élu.
(2) Dans ce cas, une nouvelle élection est
organisée dans les délais prévus à l'article 96
ci-dessus, à compter de l'expiration du délai légal de
proclamation des résultats.
114
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Article 100 (Nouveau).- (1) Les résultats de
l'élection sont publiés suivant la procédure d'urgence,
puis insérés au Journal Officiel en français et en
anglais.
(2) La publication prévue à l'alinéa (l)
est applicable à toute décision du Conseil constitutionnel
modifiant ou annulant lesdits résultats
Titre XII : De la prestation de serment.
Article 101 (Nouveau).- (1) Le Président élu
entre en fonction dès sa prestation de serment dans un délai
maximal de quinze (15) jours à compter de la proclamation des
résultats par le Conseil constitutionnel.
(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en
présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la
Cour Suprême réunis en séance solennelle, dans les formes
et termes suivantes :
a) Le Président de l'Assemblée Nationale
reçoit le serment après une brève allocution qui se
termine par la formule suivante :
« Monsieur le Président de la République,
vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que
le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et
devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver,
protéger et défendre la Constitution et les lois de la
République du Cameroun, à veiller au bien général
de la Nation, à soutenir et à défendre l'unité,
l'intégrité et l'indépendance de la Patrie camerounaise.
»
b) Le Président élu, debout, la main
levée, face aux membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de
la Cour Suprême, en prend l'engagement en répondant :
« JE LE JURE »
Article 102 (Nouveau).- (1) Il est dressé, de l'acte du
serment, cinq (5) originaux authentiques signés par le Président
de l'Assemblée Nationale et cosignés par les Présidents du
Sénat, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême.
(2) L'un des originaux de l'acte visé à
l'alinéa (1) est conservé par le Secrétariat
général de l'Assemblée Nationale. Trois (3) sont
déposés et conservés au rang des archives ou des minutes
du greffe, respectivement au Sénat, au Conseil constitutionnel et
à la Cour Suprême.
(3) Un exemplaire est remis au Président de la
République.
L'Assemblée Nationale a délibéré
et adopté, le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit
Article premier : Les citoyens établis ou
résidants à l'étranger exercent leur droit de vote par la
participation à l'élection du Président de la
République et aux référendums.
Article 2 : (1) Les citoyens camerounais établis ou
résidants à l'étranger sont inscrits sur les listes
électorales ouvertes auprès des représentations
diplomatiques et des postes consulaires dans les pays de résidence ou de
rattachement.
(2) Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques et
remplir toutes les conditions légales requises pour être
électeur.
(3) Des bureaux de vote sont créés au niveau
des représentations diplomatiques et des postes consulaires, sur
proposition du gouvernement.
Article 3 : (1) En vue de la participation des citoyens
camerounais établis ou résidant à l'étranger
à l'élection du Président de la république ou au
référendum, il est créé au niveau des
représentations diplomatiques et des postes consulaires :
· Des commissions chargées de l'établissement
et de la révision des listes électorales ;
· Des commissions chargées de
l'établissement et de la distribution des cartes électorales ;
· Des commissions locales de vote.
(2) Le Conseil électoral d'Election Cameroon (ELECAM)
organise des consultations avec les représentations diplomatiques, les
postes consulaires et les parts politiques en vue de la constitution des
commissions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.
115
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
(3) La composition des commissions visées à
l'alinéa (1) ci-dessus est constatée par le directeur
général des Elections.
(4) La composition et les modalités de fonctionnement
des commissions visées à l'alinéa (1) fixées par
voie réglementaire.
Article 4 : Les modalités spécifiques aux
opérations préparatoires à l'élection du
Président de la République et aux référendums,
à l'organisation et à la supervision des opérations
électorales et référendaires, aux opérations de
vote ainsi qu'au recensement des votes des citoyens camerounais établis
ou résidant à l'étranger sont fixées par voie
réglementaire. Article 5 : Des textes réglementaires
précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de
la présente loi.
Article 6 : Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires.
Article 7 : La présente loi sera enregistrée,
publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 13 juillet 2011
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
L'Assemblée Nationale a
délibéré et adopté, le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : Les citoyens établis ou
résidants à l'étranger exercent leur droit de vote par la
participation à l'élection du Président de la
République et aux référendums.
Article 2 : (1) Les citoyens camerounais établis ou
résidants à l'étranger sont inscrits sur les listes
électorales ouvertes auprès des représentations
diplomatiques et des postes consulaires dans les pays de résidence ou de
rattachement.
(2) Ils doivent jouir de leurs droits civils et politiques et
remplir toutes les conditions légales requises pour être
électeur.
(3) Des bureaux de vote sont créés au niveau
des représentations diplomatiques et des postes consulaires, sur
proposition du gouvernement.
Article 3 : (1) En vue de la participation des citoyens
camerounais établis ou résidant à l'étranger
à l'élection du Président de la république ou au
référendum, il est créé au niveau des
représentations diplomatiques et des postes consulaires :
? Des commissions chargées de l'établissement et de
la révision des listes électorales ;
? Des commissions chargées de l'établissement et
de la distribution des cartes électorales ;
? Des commissions locales de vote.
(2) Le Conseil électoral d'Election Cameroon (ELECAM)
organise des consultations avec les représentations diplomatiques, les
postes consulaires et les parts politiques en vue de la constitution des
commissions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.
(3) La composition des commissions visées à
l'alinéa (1) ci-dessus est constatée par le directeur
général des Elections.
(4) La composition et les modalités de fonctionnement
des commissions visées à l'alinéa (1) fixées par
voie réglementaire.
Article 4 : Les modalités spécifiques aux
opérations préparatoires à l'élection du
Président de la République et aux référendums,
à l'organisation et à la supervision des opérations
électorales et référendaires, aux opérations de
vote ainsi qu'au recensement des votes des citoyens camerounais établis
ou résidant à l'étranger sont fixées par voie
réglementaire. Article 5 : Des textes réglementaires
précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de
la présente loi.
Article 6 : Sont abrogées toutes les dispositions
antérieures contraires.
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Article 7 : La présente loi sera enregistrée,
publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 13 juillet 2011
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
116
DECLARATION DE BAMAKO
Nous, Ministres et Chefs de délégation
des Etats et gouvernements des pays ayant le français en partage,
réunis à Bamako pour le Symposium International sur le bilan des
pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans
l'espace francophone ;
Nous fondant sur les dispositions de la
Charte de la Francophonie, qui consacrent comme objectifs prioritaires l'aide
à l'instauration et au développement de la démocratie, la
prévention des conflits et le soutien à l'Etat de droit et aux
droits de l'Homme ;
Rappelant l'attachement de la Francophonie
à la Déclaration universelle des droits de l'Homme et aux Chartes
régionales, ainsi que les engagements des Sommets de Dakar (1989), de
Chaillot (1991), de Maurice (1993), de Cotonou (1995), de Hanoi
Inscrivant (1997) et de Moncton (1999) ;
Considérant notre action dans le cadre
de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation aux Droits de
l'Homme (1995-2004) ;
Soucieux l'action d'accompagnement des
processus démocratiques menée par la Francophonie ces dix
dernières années ;
Souhaitant de progresser vers la
démocratie par le développement économique et social et
une juste répartition des ressources nationales pour un accès
égal à l'éducation, à la formation, à la
santé et à l'emploi ;
Répondre à l'objectif
fixé au Sommet de Moncton, de tenir un Symposium International sur le
bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés
dans l'espace francophone, pour approfondir la concertation et la
coopération en
117
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
faveur de l'Etat de droit et de la culture
démocratique, et d'engager ainsi une étape nouvelle dans le
dialogue des Etats et gouvernements des pays ayant le français en
partage, pour mieux faire ressortir les axes principaux tant de leur
expérience récente que de leur spécificité ;
1- Constatons
que le bilan des pratiques de la démocratie, des droits
et des libertés dans l'espace francophone, au cours de ces dix
dernières années, comporte des acquis indéniables :
consécration constitutionnelle des droits de l'Homme, mise en place des
Institutions de la démocratie et de l'Etat de droit, existence de
contre-pouvoirs, progrès dans l'instauration du multipartisme dans
nombre de pays francophones et dans la tenue d'élections libres, fiables
et transparentes, contribution de l'opposition au fonctionnement de la
démocratie, promotion de la démocratie locale par la
décentralisation ;
que ce bilan présente, aussi, des insuffisances et des
échecs : récurrence de conflits, interruption de processus
démocratiques, génocide et massacres, violations graves des
droits de l'Homme, persistance de comportements freinant le
développement d'une culture démocratique, manque
d'indépendance de certaines institutions et contraintes de nature
économique, financière et sociale, suscitant la
désaffection du citoyen à l'égard du fait
démocratique ;
2- Confirmons notre adhésion aux principes
fondamentaux suivants
1. La démocratie, système de valeurs
universelles, est fondée sur la reconnaissance du caractère
inaliénable de la dignité et de l'égale valeur de tous les
êtres humains ; chacun a le droit d'influer sur la vie sociale,
professionnelle et politique et de bénéficier du droit au
développement ;
2. L'Etat de droit qui implique la soumission de l'ensemble
des institutions à la loi, la séparation des pouvoirs, le libre
exercice des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que
l'égalité devant la loi des citoyens, femmes et hommes,
représentent autant d'éléments constitutifs du
régime démocratique ;
3. La démocratie exige, en particulier, la tenue,
à intervalles réguliers, d'élections libres, fiables et
transparentes, fondées sur le respect et l'exercice, sans aucun
empêchement ni aucune discrimination, du droit à la liberté
et à l'intégrité physique de tout électeur et de
tout candidat, du droit à la liberté d'opinion et d'expression,
notamment par voie de presse et autre moyen de communication, de la
liberté de réunion et de manifestation, et de la liberté
d'association ;
4. La démocratie est incompatible avec toute
modification substantielle du régime électoral introduite de
façon arbitraire ou subreptice, un délai raisonnable devant
toujours séparer l'adoption de la modification de son entrée en
vigueur ;
5. La démocratie suppose l'existence de partis
politiques égaux en droits, libres de s'organiser et de s'exprimer, pour
autant que leur programme et leurs actions ne remettent pas en cause les
valeurs fondamentales de la démocratie et des droits de l'Homme. Ainsi,
la démocratie va de pair avec le multipartisme. Elle doit assurer
à l'opposition un statut clairement défini, exclusif de tout
ostracisme;
6. La démocratie requiert la pratique du dialogue
à tous les niveaux aussi bien entre les citoyens, entre les partenaires
sociaux, entre les partis politiques, qu'entre l'État et la
société civile. La démocratie implique la participation
des citoyens à la vie politique et leur permet d'exercer leur droit de
contrôle ;
3- Proclamons
1. que Francophonie et démocratie sont indissociables :
il ne saurait y avoir d'approfondissement du projet francophone sans une
progression constante vers la démocratie et son incarnation dans les
faits ; c'est pourquoi la Francophonie fait de l'engagement
118
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
démocratique une priorité qui doit se traduire
par des propositions et des réalisations concrètes;
2. que, pour la Francophonie, il n'y a pas de mode
d'organisation unique de la démocratie et que, dans le respect des
principes universels, les formes d'expression de la démocratie doivent
s'inscrire dans les réalités et spécificités
historiques, culturelles et sociales de chaque peuple ;
3. que la démocratie, cadre politique de l'Etat de
droit et de la protection des droits de l'Homme, est le régime qui
favorise le mieux la stabilité à long terme et la
sécurité juridique ; par le climat de liberté qu'elle
suscite, la démocratie crée aussi les conditions d'une
mobilisation librement acceptée par la population pour le
développement ; la démocratie et le développement sont
indissociables : ce sont là les facteurs d'une paix durable ;
4. que la démocratie, pour les citoyens - y compris,
parmi eux, les plus pauvres et les plus défavorisés conditions
essentielles à leur adhésion aux institutions et à leur
motivation à devenir des acteurs à part entière de la vie
politique et sociale ;
5. que, pour préserver la Démocratie, la
Francophonie condamne les coups d'Etat et toute autre prise de pouvoir par la
violence, les armes ou quelque autre moyen illégal ;
6. que, pour consolider la démocratie, l'action de la
Francophonie doit reposer sur une coopération internationale qui
s'inspire des pratiques et des expériences positives de chaque Etat et
gouvernement membre ;
7. que les principes démocratiques, dans toutes leurs
dimensions, politique, économique, sociale, culturelle et juridique,
doivent également imprégner les relations internationales ;
4- Prenons les engagements suivants :
A. Pour la consolidation de l'Etat de droit
1. Renforcer les capacités des institutions de l'Etat
de droit, classiques ou nouvelles, et oeuvrer en vue de les faire
bénéficier de toute l'indépendance nécessaire
à l'exercice impartial de leur mission ;
2. Encourager le renouveau de l'institution parlementaire, en
facilitant matériellement le travail des élus, en veillant au
respect de leurs immunités et en favorisant leur formation ;
3. Assurer l'indépendance de la magistrature, la
liberté du Barreau et la promotion d'une justice efficace et accessible,
garante de l'Etat de droit, conformément à la Déclaration
et au Plan d'action décennal du Caire adoptés par la
IIIème Conférence des Ministres francophones de la justice ;
4. Mettre en oeuvre le principe de transparence comme
règle de fonctionnement des institutions ;
5. Généraliser et accroître la
portée du contrôle, par des instances impartiales, sur tous les
organes et institutions, ainsi que sur tous les établissements, publics
ou privés, maniant des fonds publics ;
6. Soutenir l'action des institutions mises en place dans le
cadre de l'intégration et de la coopération régionales, de
manière à faire émerger, à ce niveau, une
conscience citoyenne tournée vers le développement, le
progrès et la solidarité ;
B. Pour la tenue d'élections libres, fiables et
transparentes
7. S'attacher au renforcement des capacités nationales
de l'ensemble des acteurs et des structures impliqués dans le processus
électoral, en mettant l'accent sur l'établissement d'un
état-civil et de listes électorales fiables ;
8. S'assurer que l'organisation des élections, depuis
les opérations préparatoires et la campagne électorale
jusqu'au dépouillement des votes et à la proclamation des
résultats, y inclus, le cas échéant, le contentieux,
s'effectue dans une transparence totale et relève de la
compétence d'organes crédibles dont l'indépendance est
reconnue par tous ;
119
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
9. Garantir la pleine participation des citoyens au scrutin,
ainsi que le traitement égal des candidats tout au long des
opérations électorales ;
10. Impliquer l'ensemble des partis politiques
légalement constitués, tant de la majorité que de
l'opposition, à toutes les étapes du processus électoral,
dans le respect des principes démocratiques consacrés par les
textes fondamentaux et les institutions, et leur permettre de
bénéficier de financements du budget de l'Etat ;
11. Prendre les mesures nécessaires pour s'orienter
vers un financement national, sur fonds public, des élections ;
12. Se soumettre aux résultats d'élections libres,
fiables et transparentes ;
C. Pour une vie politique apaisée
13. Faire en sorte que les textes fondamentaux
régissant la vie démocratique résultent d'un large
consensus national, tout en étant conformes aux normes internationales,
et soient l'objet d'une adaptation et d'une évaluation
régulières ;
14. Faire participer tous les partis politiques, tant de
l'opposition que de la majorité, à la vie politique nationale,
régionale et locale, conformément à la
légalité, de manière à régler pacifiquement
les conflits d'intérêts ;
15. Favoriser la participation des citoyens à la vie
publique en progressant dans la mise en place d'une démocratie locale,
condition essentielle de l'approfondissement de la démocratie ;
16. Prévenir, et le cas échéant
régler de manière pacifique, les contentieux et les tensions
entre groupes politiques et sociaux, en recherchant tout mécanisme et
dispositif appropriés, comme l'aménagement d'un statut pour les
anciens hauts dirigeants, sans préjudice de leur responsabilité
pénale selon les normes nationales et internationales ;
17. Reconnaître la place et faciliter l'implication
constante de la société civile, y compris les ONG, les
médias, les autorités morales traditionnelles, pour leur
permettre d'exercer, dans l'intérêt collectif, leur rôle
d'acteurs d'une vie politique équilibrée ;
18. Veiller au respect effectif de la liberté de la
presse et assurer l'accès équitable des différentes forces
politiques aux médias publics et privés, écrits et
audiovisuels, selon un mode de régulation conforme aux principes
démocratiques ;
D. Pour la promotion d'une culture démocratique
intériorisée et le plein respect des droits de
l'Homme
19. Développer l'esprit de tolérance et
promouvoir la culture démocratique dans toutes ses dimensions, afin de
sensibiliser, par l'éducation et la formation, les responsables publics,
l'ensemble des acteurs de la vie politique et tous les citoyens aux exigences
éthiques de la démocratie et des droits de l'Homme ;
20. Favoriser, à cet effet, l'émergence de
nouveaux partenariats entre initiatives publiques et privées, mobilisant
tous les acteurs engagés pour la démocratie et les droits de
l'Homme ;
21. Ratifier les principaux instruments internationaux et
régionaux relatifs aux droits de l'Homme, honorer et parfaire les
engagements ainsi contractés, s'assurer de leur pleine mise en oeuvre et
former tous ceux qui sont chargés de leur application effective ;
22. Adopter en particulier, afin de lutter contre
l'impunité, toutes les mesures permettant de poursuivre et sanctionner
les auteurs de violations graves des droits de l'Homme, telles que
prévues par plusieurs instruments juridiques internationaux et
régionaux, dont le Statut de Rome portant création d'une Cour
Pénale Internationale ; appeler à sa ratification rapide par le
plus grand nombre ;
23. Créer, généraliser et renforcer les
institutions nationales, consultatives ou non, de promotion des droits de
l'Homme et soutenir la création dans les administrations nationales de
structures consacrées aux droits de l'Homme, ainsi que l'action des
défenseurs des droits de l'Homme ;
120
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
24. Prendre les mesures appropriées afin d'accorder le
bénéfice aux membres des groupes minoritaires, qu'ils soient
ethniques, philosophiques, religieux ou linguistiques, de la liberté de
pratiquer ou non une religion, du droit de parler leur langue et d'avoir une
vie culturelle propre ;
25. Veiller au respect de la dignité des personnes
immigrées et à l'application des dispositions pertinentes
contenues dans les instruments internationaux les concernant.
A ces fins, et dans un souci de partenariat
rénové, nous entendons :
Intensifier la coopération entre l'OIF et les
organisations internationales et régionales, développer la
concertation en vue de la démocratisation des relations internationales,
et soutenir, dans ce cadre, les initiatives qui visent à promouvoir la
démocratie ;
Renforcer le mécanisme de concertation et de dialogue
permanents avec les OING reconnues par la Francophonie, particulièrement
avec celles qui poursuivent les mêmes objectifs dans les domaines de la
démocratie et des droits de l'Homme ;
5- Décidons de recommander la mise en oeuvre
des procédures ci-après pour le suivi des pratiques de la
démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone
:
1. Le Secrétaire général se tient
informé en permanence de la situation de la démocratie, des
droits et des libertés dans l'espace francophone, en s'appuyant
notamment sur la Délégation à la Démocratie et aux
Droits de l'Homme, chargée de l'observation du respect de la
démocratie et des droits de l'Homme dans les pays membres de la
Francophonie ;
Une évaluation permanente des pratiques de la
démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone
sera conduite, à des fins de prévention, dans le cadre de
l'Organisation internationale de la Francophonie, sur la base des principes
constitutifs énoncés précédemment.
Cette évaluation doit permettre :
? de définir les mesures les plus appropriées
en matière d'appui à l'enracinement de la démocratie, des
droits et des libertés,
? d'apporter aux Etats et gouvernements qui le souhaitent
l'assistance nécessaire en ces domaines,
? de contribuer à la mise en place d'un système
d'alerte précoce ;
2. Face à une crise de la démocratie ou en cas
de violations graves des droits de l'Homme, les instances de la Francophonie se
saisissent, conformément aux dispositions de la Charte, de la question
afin de prendre toute initiative destinée à prévenir leur
aggravation et à contribuer à un règlement. A cet effet,
le Secrétaire général propose des mesures
spécifiques :
Il peut procéder à l'envoi d'un facilitateur
susceptible de contribuer à la recherche de solutions consensuelles.
L'acceptation préalable du processus de facilitation par les
autorités du pays concerné constitue une condition du
succès de toute action. Le facilitateur est choisi par le
Secrétaire général après consultation du
Président de la Conférence ministérielle, en accord avec
l'ensemble des protagonistes. La facilitation s'effectue en liaison
étroite avec le CPF ;
? il peut décider, dans le cas de procès
suscitant la préoccupation de la communauté francophone, de
l'envoi, en accord avec le CPF, d'observateurs judiciaires dans un pays en
accord avec celui-ci.
3. En cas de rupture de la démocratie ou de violations
massives des droits de l'Homme383, les actions suivantes sont mises
en oeuvre :
Le Secrétaire général saisit
immédiatement le Président de la Conférence
ministérielle de la Francophonie à des fins de consultation ;
383 Interprétation de la Tunisie : par « rupture
de la démocratie », entendre « coup d'Etat » par «
violations massives des droits de l'Homme », entendre «
génocide ».
121
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
La question fait l'objet d'une inscription immédiate et
automatique à l'ordre du jour du CPF, qui peut être
convoqué d'urgence en session extraordinaire, et, le cas
échéant :
· confirme la rupture de la démocratie ou
l'existence de violations massives des droits de l'Homme,
· les condamne publiquement,
· exige le rétablissement de l'ordre
constitutionnel ou l'arrêt immédiat de ces violations, Le CPF
signifie sa décision aux parties concernées. Le Secrétaire
général se met en rapport avec les autorités de fait. Il
peut envoyer sur place une mission d'information et de contacts. Le rapport
établi dans les plus brefs délais par cette mission est
communiqué aux autorités nationales pour commentaires. Le rapport
de la mission, ainsi que les commentaires des autorités nationales, sont
soumis au CPF, pour toute suite jugée pertinente.
Le CPF peut prendre certaines des mesures suivantes :
· refus de soutenir les candidatures
présentées par le pays concerné, à des postes
électifs au sein d'organisations internationales,
· refus de la tenue de manifestations ou
conférences de la Francophonie dans le pays concerné,
· recommandations en matière d'octroi de visas
aux autorités de fait du pays concerné et réduction des
contacts intergouvernementaux,
· suspension de la participation des
représentants du pays concerné aux réunions des
instances,
· suspension de la coopération
multilatérale francophone, à l'exception des programmes qui
bénéficient directement aux populations civiles et de ceux qui
peuvent concourir au rétablissement de la démocratie,
· proposition de suspension du pays concerné de
la Francophonie. En cas de coup d'Etat militaire contre un régime issu
d'élections démocratiques, la suspension est
décidée.
· Lorsque des dispositions sont prises en vue de
restaurer l'ordre constitutionnel ou de faire cesser les violations massives
des droits de l'Homme, le CPF se prononce sur le processus de retour au
fonctionnement régulier des institutions, assorti de garanties pour le
respect des droits de l 'Homme et des libertés fondamentales. Il
détermine les mesures d'accompagnement de ce processus par la
Francophonie en partenariat avec d'autres organisations internationales et
régionales.
Si besoin est, le CPF saisit la Conférence
ministérielle de la Francophonie par le canal de son
Président.
La question de la rupture de la démocratie ou des
violations massives des droits de l'Homme dans un pays et des mesures prises,
reste inscrite à l'ordre du jour du CPF aussi longtemps que subsistent
cette rupture ou ces violations.
Nous, Ministres et chefs de délégation
des Etats et gouvernements des pays ayant le français en
partage,
Adoptons la présente Déclaration ;
Demandons au Secrétaire général de
l'Organisation internationale de la Francophonie d'en assurer la mise en oeuvre
;
Transmettons, à l'intention des Chefs d'Etat et de
gouvernement, en vue de leur 9ème Sommet à Beyrouth, le projet de
Programme d'action ci-joint en annexe.
Bamako, le 3 novembre 2000
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
122
DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A
L'OBSERVATION
INTERNATIONALE D'ELECTIONS
Commémoration à l'Organisation des
Nations unies, le 27 octobre 2005 New York L'organisation
d'élections honnêtes démocratiques est une expression de
souveraineté qui appartient aux citoyens d'un pays; l'autorité et
la légitimité des pouvoirs publics reposent sur la volonté
librement exprimée du peuple. Le droit de voter et celui d'être
élu lors de scrutins démocratiques, honnêtes et
périodiques sont des droits fondamentaux internationalement reconnus.
Lorsqu'un gouvernement tire sa légitimité de telles
élections, les risques d'alternatives non démocratiques sont
réduits.
La tenue de scrutins honnêtes et démocratiques
est une condition préalable de la gouvernance démocratique car
elle est l'instrument permettant aux citoyens de choisir librement, dans un
cadre juridique établi, ceux qui, en leur nom, les gouverneront
légitimement et défendront leurs intérêts. Elle
s'inscrit dans le contexte plus général de l'instauration de
processus et d'institutions visant à assurer la gouvernance
démocratique.
Par conséquent, si tout processus électoral doit
traduire les principes universels régissant les élections
honnêtes et démocratiques, les scrutins ne peuvent pour autant
être dissociés du contexte politique, culturel et historique dans
lequel ils se déroulent. Il ne peut y avoir d'élections
honnêtes et démocratiques si un grand nombre d'autres
libertés et droits fondamentaux ne peuvent être exercés de
façon permanente, sans distinction aucune, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation, dont les handicaps, et sans restrictions arbitraires et
déraisonnables. Tout comme la démocratie et les droits de l'homme
en général, ces scrutins ne sont envisageables que dans le cadre
de l'état de droit. Ces préceptes sont énoncés dans
des instruments internationaux, notamment ceux relatifs aux droits de l'homme,
et d'autres et repris dans les textes de nombreuses organisations
intergouvernementales. C'est ainsi que l'organisation d'élections
honnêtes et démocratiques fait aujourd'hui partie des
préoccupations des organisations internationales comme des institutions
nationales, des candidats aux élections, des citoyens et de leurs
associations.
L'observation internationale d'élections est
l'expression de l'intérêt que la communauté internationale
porte à la tenue d'élections démocratiques
s'insérant dans le cadre du développement démocratique,
notamment le respect des droits de l'homme et de la primauté du droit.
Visant à garantir le respect des droits civils et politiques,
l'observation internationale des élections est un élément
de la surveillance internationale du respect des droits de l'homme et, à
ce titre, doit répondre aux plus hautes exigences d'impartialité
concernant les forces politiques nationales et ne tenir compte d'aucune
considération bilatérale ou multilatérale contraire
à ces exigences. Elle consiste à évaluer les processus
électoraux conformément aux
123
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
principes internationaux qui gouvernent les élections
honnêtes et démocratiques et au système juridique du pays
où ils se déroulent, étant entendu que, en dernière
instance, ce sont les citoyens qui déterminent la
crédibilité et la légitimité d'un processus
électoral.
L'observation internationale d'élections peut renforcer
l'intégrité des processus électoraux, soit par la
dissuasion et la dénonciation des fraudes et des
irrégularités, soit par des recommandations visant
l'amélioration de ces processus. Elle peut également renforcer la
confiance des citoyens, s'il y a lieu, encourager la participation aux scrutins
et réduire le risque de conflits autour des élections. Elle
contribue par ailleurs à renforcer la compréhension
internationale par le partage de données d'expérience et
d'informations relatives au développement démocratique.
Aujourd'hui largement acceptée dans le monde,
l'observation internationale des élections joue un rôle important
parce qu'elle permet d'effectuer des évaluations fiables et impartiales
des processus électoraux fondées sur des méthodes
crédibles et sur la coopération établie, entre autres,
avec les pouvoirs publics, les forces politiques en présence dans le
pays (partis politiques, candidats et partisans de positions dans le cas de
référendums), les organisations nationales de surveillance des
élections et tout autre organisme international d'observation
électorale crédible.
Les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales internationales qui souscrivent à la présente
Déclaration et au code de conduite destiné aux observateurs
électoraux internationaux joint à la Déclaration
déclarent donc que :
1. L'organisation d'élections honnêtes et
démocratiques est une expression de souveraineté qui appartient
aux citoyens d'un pays; l'autorité et la légitimité des
pouvoirs publics reposent sur la volonté librement exprimée du
peuple. Le droit de voter et celui d'être élu lors de scrutins
démocratiques, honnêtes et périodiques sont des droits
fondamentaux internationalement reconnus. Les élections honnêtes
et démocratiques, fondamentales pour le maintien de la paix et de la
stabilité, constituent le préalable à toute gouvernance
démocratique.
2. Conformément à la Déclaration
universelle des droits de l'homme, au pacte international relatif aux droits
civils et politiques et à d'autres instruments internationaux, toute
personne
a le droit et doit avoir la possibilité, sans aucune
des discriminations visées par les principes internationaux des droits
de l'homme et sans restrictions déraisonnables, de prendre part à
la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, par la
participation à des référendums, en se portant candidat
à un mandat électoral ou par tout autre moyen, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
3. La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer
par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du
vote. Ces élections doivent garantir le droit et la possibilité
de voter librement et d'être élu à l'issue d'un scrutin
régulier, et leurs résultats doivent être rigoureusement
établie, annoncés et respectés. La tenue
d'élections honnêtes et démocratiques implique donc le
respect d'un nombre considérable de droits, de libertés, de
procédures et de lois, ainsi que l'intervention de certaines
institutions.
4. par observation internationale d'élections, on
entend : la collecte systématique, exacte et exhaustive d'informations
relatives à la législation, aux institutions et aux
mécanismes régissant la tenue d'élections et aux autres
facteurs relatifs au processus électoral général;
l'analyse professionnelle et impartiale de ces informations et
l'élaboration de conclusions concernant la nature du mécanisme
électoral répondant aux plus hautes exigences d'exactitude de
l'information et d'impartialité de l'analyse. L'observation
internationale d'élections doit, dans la mesure du possible,
déboucher sur des recommandations visant l'amélioration de
l'intégrité et de l'efficacité des processus
électoraux et autres procédures
124
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
connexes sans que cela ne perturbe ou n'entrave ces processus.
Par mission d'observation électorale internationale, on entend l'action
concertée des associations et organisations intergouvernementales et non
gouvernementales internationales chargées de l'observation
internationale d'élections.
5. L'observation internationale des élections sert
à évaluer la situation avant et après les
élections, ainsi que le jour même du scrutin, grâce à
diverses techniques d'observation générale à long terme.
Dans le cadre de l'action menée, les missions d'observation
spécialisées peuvent analyser des questions ponctuelles
concernant la période précédant ou suivant les
élections ainsi que certains processus (délimitation des
districts électoraux, inscription des électeurs, utilisation de
l'électronique et fonctionnement des mécanismes de
dépôt de plaintes pour fraude électorale). Des missions
d'observation autonomes et spécialisées peuvent également
être utilisées, à condition qu'elles s'engagent
publiquement et clairement à limiter la portée de leurs
activités et de leurs conclusions et qu'elles ne tirent aucune
conclusion concernant l'ensemble du processus électoral à partir
de l'action limitée qu'elles auront menée. Toutes les missions
d'observation doivent s'efforcer de placer le jour du scrutin dans son contexte
et de ne pas surestimer l'importance des observations faites ce jour-là.
L'observation internationale des élections permet de faire le point de
la situation quant au droit d'élire et d'être élu,
notamment la discrimination ou les autres obstacles qui entravent la
participation au processus électoral et qui sont fondés sur des
distinctions d'opinion politique ou autre, de sexe, de race, de couleur,
d'appartenance ethnique, de langue, de religion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, tels que les
handicaps physiques. Les conclusions des missions d'observation
électorale internationales fournissent un point de
référence commun factuel pour toutes les parties
intéressées par les élections, y compris les candidats
politiques. Elles sont particulièrement précieuses en cas de
contestation électorale, des conclusions fiables et impartiales pouvant
alors contribuer à atténuer les risques de conflits.
6. L'observation internationale des élections est
menée dans l'intérêt des citoyens du pays où se
déroulent les élections et de la communauté
internationale. Elle porte sur le processus proprement dit et non sur un
résultat électoral particulier, si ce n'est pour s'assurer que
les résultats ont été comptabilisés de façon
honnête et exacte, dans la transparence et le respect des délais.
Nul ne peut faire partie d'une mission internationale d'observateurs
électoraux s'il se trouve dans une situation de conflit
d'intérêts politique, économique ou autre susceptible de
nuire à l'exactitude et à l'impartialité des observations
ou des conclusions relatives à la nature du processus électoral.
Ces critères doivent être remplis par les observateurs durant de
longues périodes, mais aussi pendant des périodes plus courtes
correspondant au jour du scrutin, ces différentes périodes
présentant des problèmes particuliers quant aux exigences
d'indépendance et d'impartialité. Les missions ne peuvent
recevoir ni des fonds ni un appui logistique de l'état dont le processus
électoral est observé, pour éviter les conflits
d'intérêts et préserver la confiance dans
l'intégrité de leurs conclusions. Les missions d'observation
électorale internationales doivent être disposées à
révéler leurs sources de financement en réponse à
toute demande raisonnable et justifiée.
7. Les missions d'observation électorale
internationales doivent publier sans retard des déclarations
précises et impartiales (et en fournir des copies aux autorités
électorales et à toute autre entité nationale
compétente) et y présenter leurs constatations et leurs
conclusions ainsi que toute recommandation jugée utile pour
l'amélioration du processus électoral général.
Elles doivent annoncer publiquement leur présence dans le pays, en
précisant le mandat, la composition et la durée de la mission,
présenter des rapports périodiques s'il y a lieu, rendre
publiques leurs premières conclusions à l'issue du scrutin et
publier un rapport final au terme du processus électoral. Elles peuvent
tenir des réunions privées avec toute partie
intéressée par l'organisation d'élections honnêtes
et démocratiques dans un pays donné, pour discuter de
125
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
leurs constatations ainsi que de leurs conclusions et
recommandations. Elles mission peuvent également faire rapport à
leurs organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
internationales respectives.
8. Les organisations qui adoptent la présente
Déclaration et le code de conduite destiné aux observateurs
électoraux internationaux joint à la Déclaration
s'engagent à coopérer entre elles dans le cadre des missions
d'observation électorale internationales. L'observation peut être
effectuée, par exemple, par des missions individuelles, par des missions
d'observation conjointe ad hoc ou des missions concertées. En toutes
circonstances, les organisations qui adoptent la Déclaration s'engagent
à coopérer pour tirer le plus grand parti de l'action de leurs
missions d'observation.
9. Les missions d'observation électorale
internationales doivent être menées dans le respect de la
souveraineté du pays où se déroulent les élections
et des droits fondamentaux des citoyens de ce pays. Elles doivent respecter les
lois et les autorités nationales, notamment les institutions
électorales, du pays qui les accueille et axer leur action sur le
respect et la promotion des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
10. Les missions d'observation électorale
internationales doivent s'employer à coopérer avec les
autorités électorales du pays d'accueil et ne pas faire
obstruction au processus électoral.
11. La décision d'une organisation de mettre sur pied
une mission d'observation électorale internationale ou de l'envisager ne
signifie pas obligatoirement que ladite organisation estime crédible le
processus électoral en cours dans le pays en question. Aucune
organisation ne doit envoyer une telle mission dans un pays s'il apparaît
probable que les conditions de la présence de cette mission serviront
à légitimer un processus électoral clairement non
démocratique. Dans de telles circonstances, la mission doit publier une
déclaration établissant clairement que sa présence ne
légitime nullement le processus électoral.
12. Pour qu'une mission d'observation électorale
internationale puisse remplir sa tâche de manière crédible
et efficace, un certain nombre de conditions doivent être réunies.
Ainsi, une telle mission ne doit être organisée que si le pays
où ont lieu les élections :
a- adresse une invitation ou indique de toute autre
manière sa volonté d'accueillir une mission d'observation
électorale internationale dans le respect des critères
établis par l'organisation concernée, et ce suffisamment
tôt avant les élections pour permettre l'analyse de tous les
processus qui concourent à l'organisation d'élections
honnêtes et démocratiques;
b- garantit le libre accès de la mission d'observation
à tous les stades du processus électoral et à tous les
outils techniques du système électoral, y compris les outils
électroniques, les systèmes de vérification du scrutin
électronique et autres technologies, sans obliger les missions de
conclure des accords de confidentialité ou de non-divulgation
d'informations relatives à ces technologies ou au processus
électoral, et accepte que les missions peuvent certifier que ces
technologies ne sont pas acceptables;
c- garantit l'accès sans entraves à toutes les
personnes liées au processus électoral, y compris:
i. le personnel électoral à tous les niveaux, si
une demande raisonnable est faite;
ii. les membres des organes législatifs, les agents de
l'état et les responsables de la sécurité qui, par leur
fonction, ont un rôle à jouer dans l'organisation
d'élections honnêtes et démocratiques;
iii. les personnes et membres des partis politiques et des
organisations qui ont manifesté leur volonté de participer aux
élections (y compris les candidats retenus, les candidats
disqualifiés et ceux qui ont retiré leur candidature) ou qui se
sont abstenus d'y participer;
iv. le personnel des médias et
v. les personnes et les membres d'organisations souhaitant la
tenue d'élections honnêtes et démocratiques dans le
pays;
d- garantit la libre circulation dans le pays de tous les membres
de la mission d'observation;
126
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
e- garantit à la mission d'observation toute
liberté de faire des déclarations publiques et de publier des
rapports sur ses conclusions et recommandations au sujet de l'ensemble du
processus électoral et de l'évolution de la situation;
f- garantit qu'aucune autorité publique ou
électorale, ni aucun service chargé de la sécurité,
n'interviendra dans le choix des observateurs ou d'autres membres de la mission
d'observation ou ne tentera d'en limiter le nombre;
g- garantit une accréditation complète
(délivrance de pièces d'identité ou de tout autre document
requis pour observer le déroulement des élections), couvrant tout
le territoire du pays, à toute personne désignée comme
observateur ou autre par la mission d'observation dès l'instant que
celle-ci se conforme à des exigences d'accréditation clairement
définies, raisonnables et non discriminatoires;
h- garantit qu'aucune autorité publique ou
électorale, ni aucun service chargé de la sécurité,
ne s'immiscera dans les activités de la mission d'observation; et i-
garantit, conformément aux principes internationaux régissant
l'observation électorale, qu'en aucun cas, les pouvoirs publics
n'exerceront de pression sur les citoyens de leur pays ou sur les
étrangers qui travaillent pour le compte de la mission d'observation,
lui apportent une aide ou lui fournissent des informations, ne les menaceront
de poursuites ou ne les exposeront à des représailles.
Comme condition préalable à l'organisation d'une
mission d'observation électorale internationale, les organisations
intergouvernementales et non gouvernementales internationales peuvent exiger
que ces garanties soient définies dans un mémorandum d'accord ou
un document similaire en accord avec les pouvoirs publics ou les
autorités électorales concernées. L'observation
électorale est une activité civile et son utilité est
discutable lorsque les circonstances présentent des risques graves pour
la sécurité, limitent la possibilité de déployer
des observateurs dans des conditions sûres ou empêchent
l'utilisation de méthodes d'observation électorale
crédibles.
13. Les missions d'observation électorale
internationales doivent obtenir, voire exiger, de tous les principaux candidats
politiques qu'ils acceptent leur présence.
14. Les parties prenantes politiques - partis, candidats et
partisans d'une position en cas de référendum - sont directement
intéressées par les processus électoraux vu leur droit
d'être élues et d'exercer des fonctions publiques. Elles devraient
donc être autorisées à surveiller lesdits processus et
à observer les mécanismes y relatifs, notamment le fonctionnement
des technologies électorales électroniques et autres dans les
bureaux de vote, les centres de dépouillement du scrutin et d'autres
installations électorales, ainsi que le transport des bulletins de vote
et autres documents sensibles.
15. Les missions d'observation électorale internationales
doivent :
a- prendre contact avec tous les candidats politiques aux
élections, dont les représentants des partis politiques et les
candidats susceptibles d'avoir des informations sur l'intégrité
du processus électoral;
b- accueillir favorablement toute information que ceux-ci
leur fournissent sur la nature du processus;
c- évaluer ces informations de façon
indépendante et impartiale; et d- déterminer, car c'est un
important aspect de l'observation électorale internationale, si les
candidats politiques sont en mesure, sur une base non discriminatoire, de
vérifier l'intégrité de tous les éléments et
étapes du processus électoral. Dans leurs recommandations, qui
peuvent être soumises par écrit ou présentées
à divers stades du processus électoral, les missions
d'observation électorale internationales doivent préconiser
l'absence de toute restriction ou acte d'ingérence visant les
activités des candidats politiques pour protéger
l'intégrité des élections.
16. Les citoyens jouissent des droits internationalement
reconnus de libre association et de participation aux affaires gouvernementales
et publiques dans leur pays. Ces droits peuvent
127
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
être exercés par l'intermédiaire
d'organisations non gouvernementales chargées de surveiller les
processus électoraux et les mécanismes y relatifs, notamment le
fonctionnement des technologies électorales électroniques et
autres dans les bureaux de vote, les centres de dépouillement du scrutin
et d'autres installations électorales, ainsi que le transport des
bulletins de vote et autres documents sensibles. Les missions d'observation
électorale internationales doivent vérifier si les organisations
nationales non partisanes chargées de l'observation et de la
surveillance des élections sont en mesure, sur une base non
discriminatoire, de mener leurs activités sans restriction ou acte
d'ingérence injustifié et faire rapport sur la question. Elles
doivent défendre le droit des citoyens de procéder à une
observation électorale non partisane dans le pays, sans aucune
restriction ou acte d'ingérence injustifié et, dans leurs
recommandations, préconiser l'élimination de ces restrictions ou
acte d'ingérence.
17. Les missions d'observation électorale
internationales doivent recenser les organisations nationales non partisanes de
surveillance électorale crédibles, communiquer
régulièrement avec elles et, le cas échéant,
coopérer avec elles. Elles doivent encourager ces organisations à
fournir des informations sur la nature du processus électoral.
Après avoir été évaluées de façon
indépendante, ces informations peuvent utilement compléter les
conclusions des missions d'observation électorale internationales,
encore que celles-ci doivent rester indépendantes. Avant de faire une
quelconque déclaration, les missions d'observation doivent donc faire
tout leur possible pour tenir des consultations avec ces organisations.
18. Les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la
présente Déclaration reconnaissent que d'importants
progrès ont été accomplis dans la formulation des normes,
principes et obligations régissant l'organisation d'élections
honnêtes et démocratiques et s'engagent à respecter ces
principes, notamment celui de la transparence quant aux méthodes
d'observation utilisées, pour émettre leurs observations,
jugements et conclusions sur la nature des processus électoraux.
19. Les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la
présente Déclaration reconnaissent qu'il existe toute une gamme
de méthodes crédibles d'observation des processus
électoraux et s'engagent à mettre en commun et, le cas
échéant, à harmoniser leurs méthodes. Elles
reconnaissent par ailleurs que les effectifs et la durée des missions
d'observation électorale internationales doivent être suffisants
afin d'évaluer en toute indépendance et impartialité, dans
un pays donné, les processus électoraux et toutes leurs
composantes critiques À période préélectorale, jour
des élections et période postélectorale - sauf si
l'observation ne porte que sur une seule composante ou un petit nombre d'entre
elles. Elles reconnaissent en outre qu'il ne faut pas trop mettre l'accent sur
les observations faites le jour du scrutin et que celles-ci doivent être
placées dans le contexte plus large de l'ensemble du processus
électoral.
20. Les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la
présente Déclaration reconnaissent que les membres des missions
d'observation électorale internationales doivent avoir des
compétences politiques et professionnelles suffisamment diverses et
posséder une réputation et des qualités
d'intégrité éprouvées pour pouvoir observer et
juger les processus et principes électoraux à la lumière
de leurs connaissances en la matière, mais aussi en ce qui concerne les
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, le droit
électoral comparé, les pratiques administratives (y compris
l'utilisation de l'ordinateur et autres technologies électorales), les
processus politiques comparés et la situation propre à chaque
pays. Ces organisations reconnaissent également qu'il importe que les
hommes et les femmes et les différentes nationalités soient
représentés de manière équilibrée au sein
des missions d'observation électorale internationales, au niveau des
membres mais aussi des dirigeants.
128
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
21. Les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la
présente Déclaration s'engagent à :
a- familiariser tous les membres de leurs missions
d'observation électorale internationales avec les principes d'exactitude
de l'information et d'impartialité politique qui doivent présider
à la formulation de jugements et de conclusions;
b- définir les objectifs de la mission, sous forme de
mandat ou dans un document;
c- donner des informations sur les lois et
réglementations nationales pertinentes, le climat politique
général et d'autres questions, en particulier celles liées
à la sécurité et au bien-être des observateurs;
d- familiariser tous les membres de la mission d'observation
avec les méthodes à employer;
e- exiger de tous les membres de la mission d'observation
qu'ils s'engagent à lire et à respecter le code de conduite des
observateurs électoraux internationaux qui accompagne la présente
Déclaration, et qui peut être modifié quant à la
forme mais non quant au fond pour satisfaire aux exigences de l'organisation,
ou qu'ils s'engagent à respecter un code de conduite préexistant
de l'organisation qui soit essentiellement le même que le code de
conduite joint à la présente Déclaration.
22. Les organisations intergouvernementales et les
organisations non gouvernementales internationales souscrivant à la
présente Déclaration s'engagent à ne ménager aucun
effort pour respecter les dispositions de la Déclaration et du code de
conduite des observateurs électoraux internationaux qui l'accompagne.
chaque fois qu'une organisation ayant approuvé la présente
Déclaration jugera nécessaire de s'écarter d'une
quelconque disposition de la présente Déclaration ou du code de
conduite qui l'accompagne pour procéder à une observation
électorale dans le respect de l'esprit de la Déclaration, elle
précisera dans une déclaration publique pourquoi elle a dû
procéder de la sorte et devra être disposée à
répondre aux questions pertinentes émanant d'autres organisations
ayant approuvé la présente Déclaration.
23. Les organisations souscrivant à la présente
Déclaration reconnaissent que des gouvernements envoient des
délégations chargées d'observer des élections dans
d'autres pays et que d'autres parties observent également des
élections. Elles accueilleront favorablement tout observateur qui
acceptera ponctuellement la présente Déclaration et respectera le
code de conduite des observateurs électoraux internationaux qui
l'accompagne.
24. La présente Déclaration et le code de
conduite des observateurs électoraux internationaux qui l'accompagne
sont des documents techniques ne nécessitant aucune action de la part
des organes politiques des organisations y souscrivant - assemblées,
conseils ou conseils d'administration - encore qu'une telle action serait
favorablement accueillie. D'autres organisations intergouvernementales et
organisations non gouvernementales internationales peuvent souscrire à
ces documents, leur adhésion devant être enregistrée
auprès de la Division de l'assistance électorale de
l'Organisation des nations unies.
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
129
Décret n°92/277 du 17 septembre 1992 portant
convocation du corps électoral en vue de l'élection du
président de la république
Le Président de la République,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à la
Présidence de la République ;
Décrète:
Article premier : Les électeurs sont
convoqués le dimanche 12 octobre 1992 à l'effet de
procéder à l'élection du Président de la
République.
Article 2 : Le scrutin sera ouvert à 8
heures et clos à 18 heures.
Article 3 : Le présent décret sera
enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 19 septembre 1992 Le Président
de la République,
(é) Paul Biya
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
130
Décret n°97/160 du 12 septembre 1997 portant
convocation du corps électoral Le Président de la
République,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à la
Présidence de la République, modifiée et
complétée par la loi n° 97/020 du 9 septembre 1997 ;
Décrète:
Article premier : Les électeurs sont
convoqués le dimanche 12 octobre 1997 à l'effet de
procéder à l'élection du Président de la
République.
Article 2 : Le scrutin sera ouvert à 8
heures et clos à 18 heures.
Article 3 : Le présent décret
sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 12 septembre 1997 Le Président
de la République,
(é) Paul Biya
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
131
Décret n°2004/223 du 11 septembre 2004
portant convocation du corps électoral Le Président de la
République,
Vu La Constitution ;
Vu La loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à la
Présidence de la République, modifiée et
complétée par la loi n° 97/020 du 9 septembre 1997 ;
Décrète:
Article 1er : Les électeurs
sont convoqués le lundi 11 octobre 2004 à l'effet de
procéder à l'élection du président de la
République.
Article 2 : Les bureaux de vote seront ouverts
à 8 heures et fermés à 18 heures.
Article 3 : La journée du 11 octobre
2004 est en conséquence déclarée fériée et
chômée sur toute l'étendue du territoire national.
Article 4 : Le présent décret
sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 11 septembre 2004 Le Président
de la République,
(é) Paul Biya
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
132
Décret N°2011/277 du 30 août 2011
portant convocation du Corps électoral en vue de
l'élection du
Président de la République.
Le Président de la République,
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992
fixant les conditions d'élection et de suppléance
à la Présidence de la République,
modifiée et complétée par la loi n° 97/020 du 9
septembre 1997 et par la loi n° 2011/002 du 06 mai 2011 ;
Vu la loi n°2006/011 du 29 décembre
2006 portant création, organisation et fonctionnement d'« Elections
Cameroon » (ELECAM), modifiée et complétée par la loi
n°2008/005 du 29 mai 2008, par la loi n°2010/005 du 13 avril 2010 et
par la loi n°2011/001 du 06 mai 2011 ; Vu la loi n°
2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote des citoyens camerounais
établis ou résident à l'étranger.
Décrète :
Article 1er : Les électeurs sont
convoqués le dimanche 09 octobre 2011 à l'effet de
procéder à l'élection du Président de la
République.
Article 2 : Les bureaux de vote seront ouverts
à huit (8) heures et fermés à dix-huit (18) heures.
Article 3 : Le Présent décret sera
enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 30 août 2011
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
133
Arrêté n° 0000094/A/MINATD/DAP DU 07
octobre 2011 réglementant l'exercice de certaines
libertés et activités à
l'occasion de l'élection présidentielle du 09 octobre
2011
LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA
DECENTRALISATION,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 92/010 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à
la Présidence de la République, ensemble ses
modificatifs subséquents ;
VU la loi n° 2006/011 du 29 décembre 2006 portant
création, organisation et fonctionnement
d' « Elections Cameroon » (ELECAM), ensemble ses
modificatifs subséquents ;
VU la loi n° 2011/013 du 13 juillet 2011 relative au vote
des citoyens camerounais établis
ou résidant à l'étranger ;
VU le décret n° 2004/320 du 08 décembre
2004 portant organisation du Gouvernement,
modifié et complété par le décret
n° 2007/268 du 07 décembre 2007;
VU le décret n° 2004/322 du 08 décembre
2004 portant formation du Gouvernement,
ensemble ses modificatifs subséquents ;
VU le décret n° 2005/104 du 13 avril 2005 portant
organisation du Ministère de
l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
;
VU le décret n° 2011/277 du 30 août 2011
portant convocation du corps électoral en vue de
l'élection du Président de la
République,
ARRETE
Article 1er : (1) Le
présent arrêté réglemente l'exercice de certaines
libertés et activités à
l'occasion de l'élection présidentielle du 09
octobre 2011.
(2) A ce titre, il fixe les mesures relatives notamment
à :
La liberté de circulation des personnes et des biens
;
L'exercice des activités lucratives ;
La pratique des jeux ;
La sauvegarde de la liberté et du secret du vote.
CHAPITRE I DE LA LIBERTE DE CIRCULATION DES PERSONNES
ET DES
BIENS
Article 2 : (1) Les frontières
nationales sont fermées quarante-huit heures (48) avant le jour
du scrutin.
(2) Elles sont rouvertes le lendemain de la clôture du
scrutin.
Article 3 : (1) La circulation des personnes
et des biens par voie routière, ferroviaire ou
aérienne est interdite du 08 octobre 2011 à
partir de dix-huit (18) heures, au 09 octobre 2011 à
dix-huit (18) heures.
(2) Les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus ne sont
pas applicables :
a) aux personnes et aux biens circulant dans un
périmètre urbain ou dans la même localité
située en zone rurale ;
134
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
b) aux conducteurs de véhicules automobiles, notamment
ceux des services de sécurité et des ambulances, munis d'un
laissez-passer spécial délivré par le gouverneur de la
Région ou le Préfet territorialement compétent ;
c) aux aéronefs munis du laissez-passer visé au
paragraphe (b) lorsque leur mise en circulation est liée au
fonctionnement des services de sécurité, à une
évacuation sanitaire ou aux opérations d'acheminement du
matériel électoral ;
d) aux aéronefs effectuant des vols internationaux
;
e) aux membres et délégués d' «
Elections Cameroon » ainsi qu'aux observateurs et journalistes nationaux
et internationaux dûment accrédités et munis de leurs
badges et de l'attestation d'accréditation.
CHAPITRE II DE L'EXERCICE DES ACTIVITES LUCRATIVES ET
LA PRATIQUE DES JEUX
Article 4 : (1) L'exercice des
activités lucratives et la pratique des jeux sont interdites le jour du
scrutin.
(2) L'interdiction édictée à l'alinéa
(1) concerne notamment :
a) les débits de boisson ;
b) les boutiques ;
c) les magasins ;
d) les marchés ;
e) les activités industrielles ;
f) les établissements de production des biens ou des
services ;
g) les salles de jeux de divertissement ;
h) les salles de jeux de hasard.
Article 5 : L'autorité administrative
du ressort peut, en tant que de besoin, ordonner l'interdiction de l'exercice
de toute activité, lucrative ou non, de nature à perturber le bon
déroulement du scrutin.
CHAPITRE III DE LA SAUVEGARDE DE LA LIBERTE ET DU SECRET
DU VOTE Article 6 : (1) L'autorité administrative du ressort
peut, en tant que de besoin, prendre ou prescrire toutes mesures tendant
à sauvegarder la liberté et le secret du vote.
(2) Les mesures visées à l'alinéa (1)
concernent notamment la lutte contre l'intimidation des électeurs, et
toute violence, menace ou manoeuvre frauduleuse tendant à influencer le
choix des électeurs.
Article 7 : Les attroupements, clameurs ou
manifestations menaçants devant les bureaux de vote ou de nature
à porter atteinte à l'exercice du droit ou à la
liberté du vote, sont interdits le jour du scrutin.
CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES
Article 8 : Les Gouverneurs de Région,
les Préfets, les Sous-Préfets sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Article 9 : Le présent
arrêté sera enregistré, publié suivant la
procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en
français et en anglais.
YAOUNDE, LE 07 OCTOBRE 2011 LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE
DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION (é)
MARAFA HAMIDOU YAYA
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
135
LISTE DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE A LA
PRESIDENTIELLES DU 11 OCTOBRE 1992 REÇUES PAR LE MINISTERE DE
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
|
N°
|
Candidats
|
Partis Politiques
|
|
1
|
Bello Bouba Maïgari
|
UNDP
|
|
2
|
Biya Paul
|
RDPC
|
|
3
|
Eboua Samuel
|
MDP
|
|
4
|
Ekindi Jean Jacques
|
MP
|
|
5
|
Ema Otu Hygin Pierre Philiphe William's
|
RFP
|
|
6
|
Hogbe Nleng Henri
|
UPC
|
|
7
|
Ndam Njoya Adamou
|
UDC
|
|
8
|
Ni John Fru Ndi
|
SDF
|
LISTE DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE A LA
PRESIDENTIELLES DU 11 OCTOBRE 1997 REÇUES PAR LE MINISTERE DE
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
|
N°
|
Candidats
|
Partis Politiques
|
|
1
|
Biya Paul
|
RDPC
|
|
2
|
Dzongang Albert
|
PPD
|
|
3
|
Eboua Samuel
|
MDP
|
|
4
|
Essaka Gustave
|
DIC
|
|
5
|
Hogbe Nleng Henri
|
UPC
|
|
6
|
Kamgang Hubert
|
UPA
|
|
7
|
Mbelé Jean-Pierre
|
|
|
8
|
Ndemanou Antoine de Padoue
|
RDPF
|
|
9
|
Tabi Owono Joachim
|
AMEC
|
|
10
|
Mila Assoute
|
RCNR
|
|
11
|
Mack-Kit Samuel
|
UPC
|
|
12
|
Liopoe Jean-Robbert
|
PLD
|
|
13
|
Onaana François
|
UNITOC
|
|
14
|
Ngouel Banga
|
FPN
|
|
15
|
Eteki-Otabela Marie-Louise
|
CFA
|
|
16
|
Loutono Marcus
|
CNS
|
|
17
|
Matip Libam Henri Issac
|
MERCI
|
|
18
|
Agbor Ashu Emmanuel
|
RP
|
|
19
|
Kari Hamadou
|
MSC
|
|
20
|
Tina Dieudonné
|
MLJC
|
|
21
|
Bouba Youssoufa
|
ANC
|
136
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
|
22
|
Mbock Mbegde Daniel
|
USP
|
|
23
|
Kamga Rameline
|
FSN
|
|
24
|
Nocty Tchokwago
|
AFP
|
|
25
|
Tonye Jean Alphonse
|
Independent
|
|
26
|
Issac Michel Enow Oben
|
CIP
|
|
27
|
Fombad Mujem
|
RCPU
|
|
28
|
Keme Wangue Arnold
|
MAS
|
|
29
|
Onana Marcus
|
Independent
|
|
30
|
Ouafo
|
Independent
|
|
31
|
Bizole Dieudonné
|
POUC
|
|
32
|
Tabi Owono Jaochim
|
AMEC
|
|
33
|
Gamel Adamou Issa
|
MDCP
|
|
34
|
Hameni Bieleu Victorin François
|
UFDC
|
|
35
|
Edzoa Titus
|
Independent
|
NB : Pour plusieurs raisons
telles que l'absence de la caution financière exigée, les
dossiers incomplets, l'absence des trois cents signatures exigées pour
les candidatures indépendantes ou l'absence de lettres d'investiture de
leurs partis, la non-inscription du candidat sur une liste électorale de
son domicile déclaré, l'investiture irrégulière,
l'absence de la déclaration sur l'honneur de respecter la Constitution,
l'absence du bulletin n°3 du casier judiciaire, du certificat
d'imposition, du certificat de nationalité, ou même de la
déclaration de candidature revêtue de la signature
légalisée du candidat, pour dossier non-constitué ou pour
dossier déposé auprès d'une structure incompétente
de nombreuses candidature furent rejetées. Cette élection est
celle qui a connu la première candidature féminine bien qu'ayant
été rejetée.
Source : Abdoulkarimou, La
pratique des élections au Cameroun 1992 - 2007. Regards sur
un
système électoral en mutation, Yaoundé, Edition
Clé, p. 193.
LISTE DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE A LA
PRESIDENTIELLES DU 11 OCTOBRE 2004 REÇUES PAR LE MINISTERE DE
L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
|
N°
|
Candidats
|
Partis Politiques
|
|
1
|
Biya Paul
|
RDPC
|
|
2
|
Djeukam Tchameni
|
MDI
|
|
3
|
Ekamè Anicet Georges
|
MANIDEM
|
|
4
|
Ekindi Jean Jacques
|
MP
|
|
5
|
Essaka Gustave
|
DIC
|
|
6
|
Forbin Boniface
|
JDP
|
|
7
|
Garga Haman Adji
|
ADD
|
|
8
|
Hameni Bieleu Victorin Francois
|
UFDC
|
|
9
|
Kamgang Hubert
|
UPA
|
|
10
|
Mouafo Justin
|
NPC/BUSH
|
|
11
|
Ndam Njoya Adamou
|
UDC
|
|
12
|
Ngo Fritz Pierre
|
MEC
|
|
13
|
Ni John Fru Ndi
|
SDF
|
|
14
|
Nymnadi George Dobgima
|
SLD
|
|
15
|
Tekam Jean Michel
|
PDS
|
137
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
|
16
|
Yondo Black Mandengue
|
MSND
|
LISTE DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE A LA
PRESIDENTIELLES DU 09 OCTOBRE 2011 REÇUES PAR ELECTIONS
CAMEROON
|
N°
|
NOMS ET PRENOMS
|
PARTI POLITIQUE
|
|
1
|
Assignana Tsimi Moise Fabien
|
Mouvement Républicain (MOREP)
|
|
2
|
Atangana Nsoé Simon Pierre
|
Grand Cameroun (GC)
|
|
3
|
Ayah Paul Abiné
|
People's Action Party (PAP)
|
|
4
|
Benz Enow Bate
|
Cameroon Democratic Party (CDP)
|
|
5
|
Bilé Olivier Anicet
|
Union pour la Fraternité du Peuple (UFP)
|
|
6
|
Bilong Samuel Jace
|
Mouvement Réformateur (MR)
|
|
7
|
Biya Paul
|
Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais (RDPC)
|
|
8
|
Boo Daniel Dieudonné
|
Parti des Fourmis (PDF)
|
|
9
|
Dang Bayibidio Esther
|
Bloc pour la Reconstruction et l'Indépendance
Economique du Cameroun (BRIC)
|
|
10
|
Dangwe Luc
|
Mouvement Démocratique des Déshérités
du
Cameroun (MDDC)
|
|
11
|
Djapa Charly
|
Parti Socialiste et des Ecologistes Camerounais
(PSEC)
|
|
12
|
Dzongang Albert
|
LA DYNAMIQUE
|
|
13
|
Ebene Albert Léopold
|
Union Républicaine pour le Salut (URSA)
|
|
14
|
Egono Valentin
|
Union Camerounaise pour la Démocratie et
l'Innovation (UCDI)
|
|
15
|
Ekindi Jean-Jacques
|
Le Mouvement Progressiste (MP)
|
|
16
|
Ekamè Anicet Georges
|
Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la
Démocratie (MANIDEM)
|
|
17
|
Enoh Dieudonné
|
Parti de la Renaissance Nationale (PARENA)
|
|
18
|
Feuzeu Issac
|
Mouvement pour l'Emergence et le Réveil du Citoyen
(MERCI)
|
|
19
|
Fomo Ngota Jean Marie Philippe
|
Renaissance Sociale Démocratique du Cameroun (RSDC)
|
|
20
|
Fouda Essomba Vincent Sosthène
|
Mouvement Camerounais pour la Social-Démocratie
(MCPSD)
|
|
21
|
Fru Martin Mantohmbang
|
Union des Populations du Cameroun (UPC-N)
|
|
22
|
Garga Haman Adji
|
Alliance pour la Démocratie et le Développement
(ADD)
|
|
23
|
Hameni Bieleu Victorin Francois
|
Union Des Forces Démocratiques Du Cameroun (UFDC)
|
|
24
|
Kamgang Hubert
|
Union des Populations Africaines (UPA)
|
|
25
|
Kisob Bertin
|
Cameroon Party for Social Justice (CPSJ)
|
|
26
|
Kodock Augustin Fréderic
|
Union des Populations du Cameroun (UPC)
|
138
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
|
27
|
Lontouo Marcus
|
Congrès National Camerounais (CNC)
|
|
28
|
Mbem Jean Delor
|
Egalité Sociale Démocratique du Cameroun (ESDC)
|
|
29
|
Mbetebe Eyebe Justin
|
Cameroon National Democratic Party (CNDP)
|
|
30
|
Mbida Louis Tobie
|
Parti des Démocrates Camerounais (PDC)
|
|
31
|
Mboungueng Bernard
|
Parti Libéral Camerounais (PLC)
|
|
32
|
Mebada Antoine Emmanuel
|
Front Patriotique de Libération du Peuple (FPLP)
|
|
33
|
Mila Assoute Pierre
|
Rassemblement Démocratique pour la Modernité du
Cameroun (RDMC)
|
|
34
|
Momo Jean de Dieu
|
Les Patriotes Démocrates pour le Développement
du Cameroun (PADDEC)
|
|
35
|
Mouaffo Justin
|
Nationalisme des Pacifistes du Cameroun pour le
Bien-être et l'Unité Réelle contre les Souffrance des
Humains (NPC-BUSH)
|
|
36
|
Muna Acho Bernard
|
Alliances des Forces Progressistes (AFP)
|
|
37
|
Ndam Njoya Adamou
|
Union Démocratique du Cameroun (UDC)
|
|
36
|
Ndjoumov Léopold Steave
|
L'Union pour le Redressement du Cameroun
(UREC)
|
|
38
|
Ndoumbe Quasimodo
|
Parti Nationaliste Républicain du Cameroun (PNRC)
|
|
39
|
Ngo Fritz Pierre
|
Mouvement des Ecologistes Camerounais (MEC)
|
|
40
|
Ni John Fru Ndi
|
Social Democratic Front (SDF)
|
|
41
|
Njeunga Jean
|
Front Uni du Cameroun (FUC)
|
|
42
|
Njeunga Jean
|
Front Uni du Cameroun (FUC)
|
|
43
|
Nymnadi George Dobgima
|
Social Liberal Congres (SLC)
|
|
44
|
Sapack Nguele Ayamar Patrick
|
Peuple Uni pour la Rénovation Sociale (PURS)
|
|
45
|
Soh Fone Daniel
|
Parti Socialiste Unifié (PSU)
|
|
46
|
Tabi Owono Joachim
|
Action pour la Méritocratie et l'Egalité des
Chances (AMEC)
|
|
47
|
Tapeo Fouotsagoung Napoléon
|
Opinion Publique Démocratique du Cameroun
(OPDC)
|
|
48
|
Tchana Lamartine
|
La Dynamique Conquérante Libérale des
Indomptable du Cameroun (DCLIC)
|
|
49
|
Tekam Jean Michel
|
Parti Démocrate Socialiste (PDS)
|
|
50
|
Teuabo André
|
Parti Socialiste Populaire Camerounais (PSPC)
|
|
51
|
Tonye Jean Alphonse
|
Rassemeblement des Citoyens Camerounais (RCC)
|
|
52
|
Walla Khabang Edith
|
Cameroon People's Party (CPP)
|
NB : Parmi ces
déclarations de candidature, l'on note une (01) de la diaspora et trois
candidatures féminines pour l'élection présidentielle du
09 octobre 2011.
Source : Rapport
Général sur le déroulement de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011, pp. 129-132.
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
LISTE DES BUREAUX DE VOTE PILOTE DESTINES AUX ELECTEURS
HANDICAPES
|
REGION
|
LIEU
|
|
ADAMAOUA
|
- Centre de santé de l'Université de
Ngaoundéré
|
|
CENTRE
|
- Lycée de la Cité Verte
- Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun
(CJARC)
- Centre des Handicapés Cardinal Emile Léger
|
|
EXTREME- NORD
|
- Ecole Publique de Salak Maroua I
- Ecole Publique de Goli, Méri
|
|
LITTORAL
|
- Ecole Publique de Bonabéri, Groupe I et II
- Ecole Publique New Bell
|
|
OUEST
|
- Collège Notre Dame, Dschang
- Collège de la Cité, Bafoussam
|
|
SUD-OUEST
|
- Mamfe Town Hall
- Mile 14, Dibanda
|
139
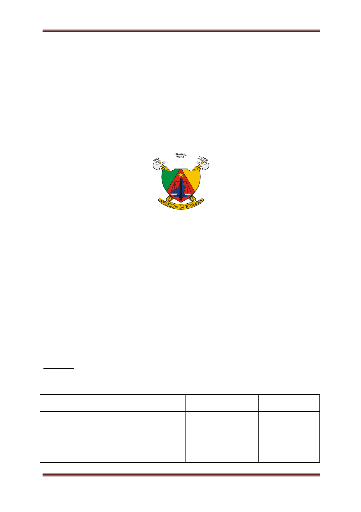
Le monitoring des élections présidentielles
au Cameroun de 1992 à 2011
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
***
REPUBLIC OF CAMEROON
***
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
***
PEACE-WORK-FATHERLAND
***
ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
***
ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
***
CONSEIL ELECTORAL
***
ELECTORAL BOARD
***
***
Arrêté N°001/DIPL/CAB du 24
août 2011 fixant la liste des représentations
diplomatiques et
des postes consulaires dans lesquels sont organisées les
opérations
électorales relatives à l'élection du
président de la république en 2011
LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°92/010 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à la
Présidence de la République modifiée et
complétée pat la loi n° 97/020 du 09 septembre 1997 et la
loi n°2011/002 du 06 mai 2011 ;
Vu la loi n°2011/013 du 13 juillet relative au vote des
citoyens camerounais établis ou résident à
l'étranger ;
Vu le décret n°2007/340 du 08 décembre 2004
portant organisation du Gouvernement, modifié et complété
par le décret n°2007/260 du 07 septembre 2007 ;
Vu le décret n°2007/237 du 08 aout 2011 fixant les
modalités d'application de la loi n°2011/013 du 13 juillet relative
au vote des citoyens camerounais établis ou résident à
l'étranger ;
ARRETE
Article 1er Les opérations
électorales relatives à l'élection du Président de
la République en 2011 sont organisées dans les
Représentations Diplomatiques et les Postes Consulaires du Cameroun
classé, par zones et par pays, conformément à la liste
ci-après :
|
Zones
|
Pays
|
Représentations
diplomatiques
|
Postes
consulaires
|
|
Afrique
|
Afrique du Sud Algérie Congo Cote d'Ivoire Ethiopie
Egypte
|
Pretoria Alger Brazzaville Abidjan Addis-Abeba Le Caire
|
|
140
141
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
|
Gabon Guinée Equatoriale Libéria Maroc Nigeria
République Centrafricaine République
Démocratique du
Congo
Sénégal
Tchad
Tunisie
|
Libreville Malabo Monrovia Rabat Abuja Bangui
Kinshasa
Dakar
N'djamena Tunis
|
Bata
Lagos et Calabar
|
|
Europe
|
Allemagne Belgique Espagne Etat du Vatican
France
Italie
Pays Bas
Royaume Uni de
Grande Bretagne et
d'Irlande du Nord Fédération
de Russie
Confédération Helvétique
|
Berlin Bruxelles Madrid Rome Paris Rome Le Haye
Londres Moscou Berne
|
Paris et Marseille
|
|
Amérique
|
Bresil
Canada
Etas-Unis d'Amérique
|
Brasilia Otawa Washington New York
|
|
|
Asie
|
Arabie Saoudite Chine Israël Japon
|
Riyad Beijing Tel-Aviv Tokyo
|
Djeddah
|
Article 2 Le présent arête sera
enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 24 août 2011, Le Ministre des
Relations Extérieures (é) Henri EYEBE AYISSI
Source : Rapport
Général sur le déroulement de l'élection
présidentielle du 09 octobre 2011
pp 133-134
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
142
LISTE DES ORGANISMES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
AYANT
DEPLOYE DES OBSERVATEURS ELECTORAUX A L'OCCASION DES
ELECTIONS
PRESIDENTIELLES ORGANISEES AU CAMEROUN DE 1992 A 2011
I. Election présidentielle du 11 octobre
1992
|
N°
|
Dénomination Pays rattachement
|
|
Organisations locales
|
|
1
|
La Ligue nationale des Droits de l'Homme
|
Cameroun
|
|
2
|
Le comité Nationale des Droits de l'Homme et des
Libertés
|
Cameroun
|
|
3
|
L'Association Camerounaise des Femmes Juristes
|
Cameroun
|
|
4
|
Tribus sans Frontières
|
Cameroun
|
|
Organisations internationales
|
|
5
|
National Democratic for International Affairs
|
Etats-Unis
|
|
Missions diplomatiques
|
|
6
|
Ambassade des Etats-Unis
|
|
|
7
|
Ambassade de France
|
|
|
8
|
Haut-Commissariat du Canada
|
|
II. Election présidentielle du 12 octobre
1997
|
N°
|
Dénomination Pays rattachement
|
|
|
9
|
Service OEcuménique pour la paix et la promotion
Humaine
|
Cameroun
|
|
10
|
Le comité Nationale des Droits de l'Homme et des
Libertés
|
Cameroun
|
|
Consciences Africaines
|
Cameroun
|
|
Missions diplomatiques
|
|
11
|
Ambassade de France
|
|
|
12
|
Ambassade des Etats-Unis
|
|
|
13
|
Haut-Commissariat du Canada
|
|
III. Election présidentielle du 11 octobre
2004
|
N°
|
Dénomination
|
Pays rattachement
|
|
|
|
14
|
Service OEcuménique pour la paix et la promotion
Humaine
|
|
Cameroun
|
|
15
|
Le comité Nationale des Droits de l'Homme et des
Libertés
|
|
Cameroun
|
|
Organisations locales
|
Pays rattachement
|
|
16
|
Association Culturelle Islamique
|
|
Cameroun
|
|
17
|
Association des Démocraties et Libertés
|
|
Cameroun
|
143
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
|
18
|
Association Nationale des Avocats pour la Promotion du Droit
et la Défense des Libertés
|
Cameroun
|
|
19
|
Association Nationale des Droits et Libertés de l'Homme et
Enfants
|
Cameroun
|
|
20
|
Association pour la démocratie et la Promotion des Droits
de l'Homme
|
Cameroun
|
|
21
|
Association pour le Développement du Dja
|
Cameroun
|
|
22
|
Barreau : Ordre Nationale des Avocats du Cameroun
|
Cameroun
|
|
23
|
Centre International pour la Promotion de la Création
|
Cameroun
|
|
24
|
Child Protect Internatinal
|
Cameroun
|
|
25
|
Civic Education on Human Rights association
|
Cameroun
|
|
26
|
Consciences Africaines
|
Cameroun
|
|
27
|
Ecumenical Youth Peace Initiative
|
Cameroun
|
|
28
|
Fédération Internationale pour la Défense
des Droits de la Femme
|
Cameroun
|
|
29
|
Fondation Alpha Oméga
|
Cameroun
|
|
30
|
Help Out
|
Cameroun
|
|
31
|
Human Rights Association
|
Cameroun
|
|
32
|
Human Rights Center for Legal Education
|
Cameroun
|
|
33
|
Human Rights Defense Action
|
Cameroun
|
|
34
|
Human Rights Defense Group
|
Cameroun
|
|
35
|
Ligue des Droits et Libertés
|
Cameroun
|
|
36
|
Ligue pour l'Education de la Femme et de l'Enfant
|
Cameroun
|
|
37
|
Mouvement pour l'Action d'Evangélisation en Afrique
|
Cameroun
|
|
38
|
Mouvement pour la Défense des Droits de l'Homme et des
Libertés
|
Cameroun
|
|
39
|
Office de Santé Efficace
|
Cameroun
|
|
40
|
Paix pour les Nations
|
Cameroun
|
|
41
|
Programme de Développement et de Valorisation des
Cultures des Langues Baka Bantou
|
Cameroun
|
|
42
|
Sos Droits de l'Homme et Démocratie
|
Cameroun
|
|
43
|
Union des Consommateurs du Cameroun
|
Cameroun
|
|
44
|
La Une des Droits de l'Homme
|
Cameroun
|
|
45
|
Association Post-Juris
|
Cameroun
|
|
46
|
Missions diplomatiques
|
|
|
47
|
Ambassade de France
|
|
|
48
|
Ambassade des Etats-Unis
|
|
|
49
|
Commonwealth
|
|
|
50
|
Haut-Commissariat de Grande-Bretagne
|
|
|
51
|
Haut-Commissariat de la République d'Afrique du Sud
|
|
|
52
|
Haut-Commissariat de la République Fédérale
du Nigeria
|
|
|
53
|
Haut-Commissariat du Canada
|
|
|
54
|
Organisation internationale de la francophonie
|
|
|
55
|
Union Africaine
|
|
|
56
|
Union Européenne
|
|
VI. Election présidentielle du 09 octobre 2011
|
N°
|
Dénomination Pays rattachement
|
|
Organisations locales
|
|
57
|
Association Bien-Etre Universel
|
Cameroun
|
|
58
|
Association of Cameroon Patriots
|
Cameroun
|
|
59
|
Association Camerounaise des Pasteurs
|
Cameroun
|
144
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
|
60
|
Association Camerounaise des Pasteurs pour la paix,
Intégrité et le Développement
|
Cameroun
|
|
61
|
Association Camerounaise pour la Paix
|
Cameroun
|
|
62
|
Alliance Citoyenne Camerounaise pour la Bonne Gouvernance
|
Cameroun
|
|
63
|
ACDHDP
|
Cameroun
|
|
64
|
Association Camerounaise pour le Dialogue et le
Développement Inter Communautaire
|
Cameroun
|
|
65
|
ACPDL
|
Cameroun
|
|
66
|
Association Droits et Devoirs
|
Cameroun
|
|
67
|
ADES
|
Cameroun
|
|
68
|
AFPRO
|
Cameroun
|
|
69
|
AHAAC
|
Cameroun
|
|
70
|
AJEP
|
Cameroun
|
|
71
|
ANPDH
|
Cameroun
|
|
72
|
Association pour la Paix la Justice et le Bien-Etre Social
|
Cameroun
|
|
73
|
APREHR
|
Cameroun
|
|
74
|
APRODEJE
|
Cameroun
|
|
75
|
ARMN
|
Cameroun
|
|
76
|
ASPREF-CA
|
Cameroun
|
|
77
|
Association Children's Rights Cameroon
|
Cameroun
|
|
78
|
Association Droits Humains
|
Cameroun
|
|
79
|
Association Nationale des Messagers de la Paix
|
Cameroun
|
|
80
|
Commission Electorale Citoyenne Indépendante
|
Cameroun
|
|
81
|
CEDACAM
|
Cameroun
|
|
82
|
Civic Education on Human Rights association
|
Cameroun
|
|
83
|
CELASRIMA
|
Cameroun
|
|
84
|
Conférence Episcopale Nationale du Cameroun
|
Cameroun
|
|
85
|
CERESS
|
Cameroun
|
|
86
|
CGCI
|
Cameroun
|
|
87
|
CIDDD
|
Cameroun
|
|
88
|
Commission Nationale des Droits de l'Homme et des
Libertés
|
Cameroun
|
|
89
|
COMINSUD
|
Cameroun
|
|
90
|
Commonwealth Gentlmen's Club
|
Cameroun
|
|
91
|
Commonwealth Women's Nethwork
|
Cameroun
|
|
92
|
CONASIC
|
Cameroun
|
|
93
|
Consistoire Ntem EPC
|
Cameroun
|
|
94
|
DDHLCI
|
Cameroun
|
|
95
|
DPM
|
Cameroun
|
|
96
|
Dynamique Citoyenne
|
Cameroun
|
|
97
|
DYPADA
|
Cameroun
|
|
98
|
FNCD
|
Cameroun
|
|
99
|
FAJPDF
|
Cameroun
|
|
100
|
FDHD
|
Cameroun
|
|
101
|
FEDASES
|
Cameroun
|
|
102
|
FERAFCAM
|
Cameroun
|
|
103
|
Fondation Conseil Jeune
|
Cameroun
|
|
104
|
GRC
|
Cameroun
|
|
105
|
Groupe Africain de l'Excellence
|
Cameroun
|
|
106
|
GCJ
|
Cameroun
|
145
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
|
107
|
GFDHRAC
|
Cameroun
|
|
108
|
God Cameroon
|
Cameroun
|
|
109
|
HAI
|
Cameroun
|
|
110
|
Health and Environment Program
|
Cameroun
|
|
111
|
Help Out
|
Cameroun
|
|
112
|
HGA
|
Cameroun
|
|
113
|
Horizons Femmes
|
Cameroun
|
|
114
|
HENC
|
Cameroun
|
|
115
|
HURIFEACAM
|
Cameroun
|
|
116
|
Forum des Etudiants en Etudes Politiques et
Stratégiques
|
Cameroun
|
|
117
|
International Governance Institue
|
Cameroun
|
|
118
|
JEPAC
|
Cameroun
|
|
119
|
Jeunesse Volontaire des Nations Unies pour la Promotion des
Droits de l'Homme
|
Cameroun
|
|
120
|
LAC
|
Cameroun
|
|
121
|
Les Guyannais
|
Cameroun
|
|
122
|
LINAPRODHOD
|
Cameroun
|
|
123
|
MASA MM
|
Cameroun
|
|
124
|
Mouvement pour la Défense des Droits de l'Homme et des
Libertés
|
Cameroun
|
|
125
|
MOHUCA
|
Cameroun
|
|
126
|
MOPAJEF
|
Cameroun
|
|
127
|
Mouvement Citoyen
|
Cameroun
|
|
128
|
MUL-PADH
|
Cameroun
|
|
129
|
ODLD
|
Cameroun
|
|
130
|
Observatoire des Droits de l'Homme
|
Cameroun
|
|
131
|
OCDLC
|
Cameroun
|
|
132
|
OCPG
|
Cameroun
|
|
133
|
Organisation Nationale des Droits de l'Homme
|
Cameroun
|
|
134
|
OPEEC
|
Cameroun
|
|
135
|
PHRIDE
|
Cameroun
|
|
136
|
Réseau Camerounais des Organisations des Droits de
l'Homme
|
Cameroun
|
|
137
|
Réseau des Femmes Actives de la Cemac
|
Cameroun
|
|
138
|
RESEVOCOM
|
Cameroun
|
|
139
|
Solution Cameroun
|
Cameroun
|
|
140
|
Sos Corruption
|
Cameroun
|
|
141
|
SOUALT
|
Cameroun
|
|
142
|
SUDAHSER
|
Cameroun
|
|
143
|
TRANSPAN
|
Cameroun
|
|
144
|
Transparency International-Cameroon
|
Cameroun
|
|
145
|
Un Monde Avenir
|
Cameroun
|
|
Organisations Internationales
|
|
146
|
Académie Diplomatique Africaine
|
Sénégal
|
|
147
|
Africa Solidarité
|
France
|
|
148
|
Africa Vie
|
|
|
149
|
Afrique Développement
|
Burkina-Faso
|
|
150
|
Activisme pour la Supervision des Elections en Afrique
|
Congo
|
|
151
|
Cercle Africain pour la Bonne Gouvernance Electorale
|
Bénin
|
|
152
|
Cabinet d'Experts Electoraux
|
Bénin
|
146
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
|
153
|
Conseil Africain d'Actions Concrètes
|
|
|
154
|
Coordination de l'Observatoire de la Société Civile
Africaine
|
Cote d'Ivoire
|
|
155
|
Cercle des jeunes pour l'Intégration et le
Développement des Communautés de Base
|
Bénin
|
|
156
|
Conscience Citoyenne
|
Bénin
|
|
157
|
Centre de Solidarité des Jeunes pour la Formation et le
Développement
|
Tchad
|
|
158
|
Diaspora-Guinée-Benelux
|
Guinée
|
|
159
|
Diaspora Africaine en Asie pour une Nouvelle Vision
|
Malaisie
|
|
160
|
Diaspora-Africaine Europe
|
|
|
161
|
DPDEV
|
|
|
162
|
Excellence Démocratique en Afrique
|
|
|
163
|
EDS ONG
|
|
|
164
|
Front Populaire Togolais pour la Démocratie et le
Développement
|
Togo
|
|
165
|
Groupe International pour la Promotion de la Démocratie
et du Système Electoral
|
Côte d'Ivoire
|
|
167
|
Groupe de Recherche-Développement et Sondage
|
Bénin
|
|
168
|
IBM-BELVIDA
|
Bénin
|
|
169
|
Institut Panafricain d'Assistance Electorale
|
Burkina-Faso
|
|
170
|
Mouvance Africaine pour la Représentation Seniors
|
Sénégal
|
|
171
|
Mission d'Observation Electorale de la Société
Civile
|
|
|
172
|
Journal Moreq Info
|
Bénin
|
|
173
|
Mouvement Panafricain pour la Paix et le Soutien à l'Union
Africaine
|
|
|
174
|
Militant pour la Paix et l'Environnement
|
|
|
175
|
Nouvel Africa
|
Mali
|
|
176
|
Observatoire Africain pour la Paix et le Développement
|
Bénin
|
|
177
|
Organisation Africaine de la Jeunesse de l'enfance et de la
Femme
|
|
|
178
|
Observation National pour la Bonne Gouvernance la Citoyenne et
l'Assistance Electorale
|
Tchad
|
|
179
|
Observatoire Panafricain des Missions d'Observation
|
Togo
|
|
180
|
OPAJEPAD
|
|
|
181
|
Paix et Développement dans le Monde
|
Bénin
|
|
182
|
Paix pour Tous
|
Burkina-Faso
|
|
183
|
PIPDA
|
|
|
184
|
Plafond
|
|
|
185
|
Planète Verte
|
|
|
186
|
Rassemblement Africain pour la Paix
|
France
|
|
187
|
Réseau International des Observateurs Electoraux
|
Burkina-Faso
|
|
188
|
Réseau Jeunesse de Centrafrique pour la Culture de la
Paix
|
République Centrafrique
|
|
189
|
Reveilles-Toi Africa
|
Sénégal
|
|
190
|
Sahel et Démocratie
|
Bénin
|
|
191
|
Sauver la Démocratie Africaine
|
|
|
192
|
Sauver la Monde
|
Italie
|
|
193
|
Save Africa
|
Ghana
|
|
194
|
Tiers Monde et Développement
|
Bénin
|
|
195
|
Union-Jeunesse de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
|
République Centrafricaine
|
|
195
|
International Socialiste
|
|
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
|
191
|
Une Afrique Nouvelle
|
Allemagne
|
|
192
|
Univers Afric
|
|
|
193
|
Univie-ONG
|
|
|
194
|
Vision Femmes
|
Bénin
|
|
195
|
Women's Voice
|
Côte d'Ivoire
|
|
Missions diplomatiques
|
|
196
|
Ambassade de France
|
|
|
197
|
Ambassade de la République d'Angola
|
|
|
198
|
Ambassade des Etats-Unis
|
|
|
199
|
Commission Economique des Etats de l'Afrique Centrale
|
|
|
200
|
Commonwealth
|
|
|
201
|
Haut-Commissariat du Canada
|
|
|
202
|
Haut-Commissariat de Grande-Bretagne
|
|
|
203
|
Haut-Commissariat de la République Fédérale
du Nigeria
|
|
|
204
|
Haut-Commissariat de la République d'Afrique du Sud
|
|
|
205
|
Organisation Internationale de la Francophonie
|
|
|
206
|
Union Africaine
|
|
|
207
|
Union Européenne
|
|
147
148
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

Les trois phases du cycle électoral
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011


Une urne défectueuse (sans couvercle) Tentative de
rafistolage d'une urne
149
Affichages non conformes (taille et emplacement des
affiches non respectés)

Affichages non conformes devant un centre de vote, le
jour du scrutin
(délai de campagne non respecté)
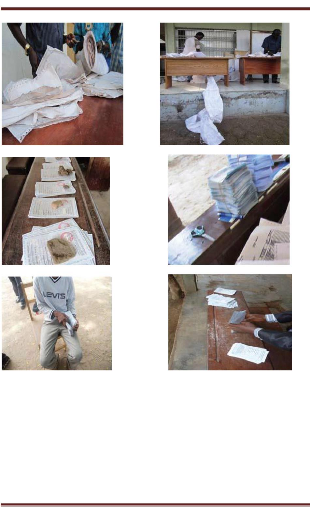
150
Le monitoring des élections présidentielles
au Cameroun de 1992 à 2011
ANARCHIE AUTOUR DE L'AFFICHAGE DES LISTES
ELECTORALES
CARTES D'ELECTEURS EN SOUFFRANCE DANS UN BUREAU DE
VOTE
Cartes d'électeurs non retirées dans la
cour d'un centre de vote et dans le bureau de
vote
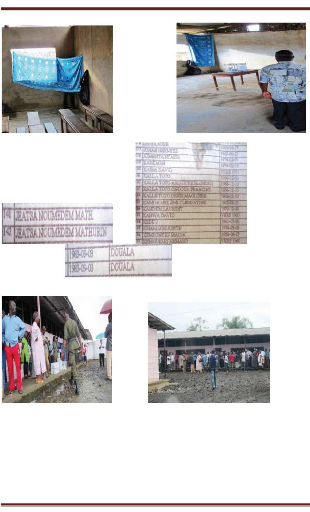
151
Le monitoring des élections présidentielles
au Cameroun de 1992 à 2011
Isoloirs non conformes (Poubelles à
l'extérieur)
Cas de doublon et de quadruplons sur le fichier
électoral
Electeurs attendant l'ouverture des bureaux de vote (Il
est 13 heures)
152
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

L'encre utilisée le jour du scrutin était
de l'encre à Tampons. Elle n'était tout, sauf
indélébile.

Tampon encreur dans lequel les électeurs
imbibaient leur doigt après le vote. Tout à
côté, une
chamoisine pour le nettoyage de l'encre pour les
électeurs qui le désiraient
153
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

Quelques observateurs de Transparency International
Cameroon
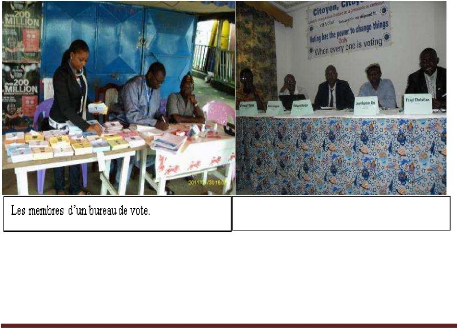
Une vue de la conférence de presse
post-scrutin
Source : Transparency
International-Cameroon, Rapport final de la mission d'observation
électorale, élection présidentielle du 09 octobre 2011 au
Cameroun, pp 58-61.
154
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

|
Des électeurs consultant les listes électorales
Des
listes électorales trainant au sol
|
|
Des listes électorales trainant au
sol
|
(Bafoussam, octobre 2011)

Forte présence des forces de l'ordre au centre
de vote de
Bamenda 2 Congress Hall
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

Acheminement des urnes et Procès-verbaux
de
dépouillement (Douala 1er)
Cas de bureau de vote avec plusieurs urnes
(Ecole
Publique Deido, Douala)
155
Source : Un Monde Avenir,
mission dobservation él p e
2011rapport national d'analyse, pp14,17,21,22,31 et 34.
156
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
MISSION D'OBSERVATION ELECTORALE
DES PRESIDENTIELLES
DU 9 OCTOBRE 2011
RAPPORT NATIONAL D'ANALYSE
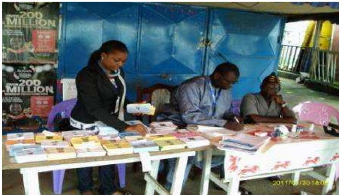
Cette publication a été
réalisée avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la
Démocratie. Le contenu de ce rapport est la responsabilité
exclusive de l'ONG Un Monde Avenir et ne reflète pas
nécessairement les vues des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies
pour la démocratie ou de son Conseil Consultatif.
157
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
INTRODUCTION
Le Cameroun est un pays de l'Afrique centrale qui a obtenu son
indépendance en Janvier 1960 et compte 17 463 836
habitants384 en 2005, avec deux langues officielles que
sont le français et l'anglais. Les religions qui y sont les plus
pratiquées sont le christianisme, avec énormément de
déclinaisons, l'islam et le bouddhisme. Le pays compte plus de 70% de sa
population qui est jeune, et le chômage a atteint des niveaux recours; la
pauvreté est perceptible dans tous les domaines d'activités Le
multipartisme a connu une éclosion particulièrement prolifique
depuis 1990 (près de 300 partis politiques répertoriés),
éclosion qui ne saurait occulter sa naissance avant
l'indépendance de 1960, où le pluralisme politique était
déjà fortement présent et remarquable, de par les
batailles et les enjeux divers inhérents à cette phase de
l'histoire du Cameroun. L'élection présidentielle du 9 octobre
2011 est donc la 12ème élection présidentielle
organisée depuis l'indépendance de ce pays, l'un de ses enjeux
majeurs était de voir un leadership nouveau s'imposer pour
répondre de manière crédible et lisible aux besoins
d'épanouissement des populations qui ont subi de plein fouet la crise
économique des années 80 et les affres des multiples programmes
de redressement économiques proposés au Cameroun par les
institutions occidentales. Elle s'est déroulée alors que le
Président Paul Biya, candidat à sa propre succession est au
pouvoir depuis 29 ans.
Contexte politique
Le Président de la République du Cameroun a
annoncé lors du discours radio télévisé, du 31
décembre 2007, la modification de la constitution de 1996. Cette
modification s'est faite en avril 2008, et l'un de ses points marquants a
été la suppression du verrou qui empêchait à un
président en fonction au Cameroun de se représenter plus d'une
fois à une élection présidentielle. L'article 6 ayant
été modifié, le Président sortant pouvait de
nouveau candidater pour briguer un nouveau mandat.
En outre, l'élection présidentielle allait se
dérouler avec un nouvel acteur majeur, ELECTIONS CAMEROON qui avait
été créé en 2006, et qui avait l'étiquette
hautement revendiquée d'organisme indépendant de gestion des
élections au Cameroun.
On ne saurait ignorer les débats houleux qui ont eu
lieu autour non seulement du vote de la loi qui permettait au Président
de se représenter, puis de la légalité de sa candidature
quant à la non-rétroactivité de la loi, mais aussi ceux
autour de l'indépendance et de la neutralité annoncée
d'ELECAM, du fait de sa composition politique vilipendée par les partis
d'opposition et la société civile. La pilule est assez mal
passée pour les opposants. Dans la foulée, le pays tout entier a
été secoué en février 2008, par un
soulèvement populaire de jeunes non coordonné. Le Cameroun avait
vécu un mauvais moment qui allait parcourir plusieurs pays d'Afrique
subsaharienne; un mouvement continental que les medias avaient vite fait de
baptiser « les émeutes de la faim ».
Comme inspiré des secousses en Afrique subsaharienne,
2011 est une année assez particulière à travers le monde,
surtout pour ce qui est de l'expression démocratique. Nous avons
assisté successivement à la chute de plusieurs vieux chefs d'Etat
africains, en Tunisie, en Egypte, en en Lybie, et de nombreux paramètres
relatifs à la typicité de ces régimes déchus
faisaient croire que ce serait au tour du Cameroun de voir un changement
à la tête de l'Etat surtout grâce à l'élection
présidentielle. De par les spéculations qui sont allées
galopantes à travers la république et en dehors, tant de la part
des nationaux que de tous les pays qui s'intéressent directement ou
indirectement au Cameroun, de nombreux foyers d'incertitudes sont nés,
et ont fortement contribué à créer une psychose sans nulle
autre pareille autour de cette élection présidentielle.
D'abord, de nombreux acteurs non étatiques ont
commencé par se prononcer en faveur d'un changement à la
tête de l'Etat camerounais, ensuite de nombreux médias nationaux
et
384 D'après le rapport du 3e Recensement
Général de la population.
158
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
internationaux ont véhiculé le spectre d'un
effondrement de l'Etat en 2011. Pour consolider leurs positions politiques, des
leaders du parti au pouvoir, des élites traditionnelles et responsables
administratifs, ont organisé de nombreuses manifestations publiques
autour du thème de la paix, pour appeler les populations à plus
de responsabilité, de sérénité. Le paradoxe est que
cette série de manifestations n'a contribué qu'à augmenter
le sentiment d'insécurité dans l'imaginaire populaire, et les
mesures de sécurité nombreuses et successives, avec leur
caractère spectaculaire en termes de déploiement des forces
armées et police, ont contribué à inquiéter le bas
peuple.
En outre, les populations éprouvent le besoin de vivre
un management étatique plus efficace, face à la corruption, la
dépravation des moeurs, les détournements de deniers publics, et
injustices diverses crées par des micros entités
systémiques qui se servent de leurs positions dominantes pour piller
l'Etat et asphyxier les populations à tous les niveaux d'existence, tant
le clientélisme s'est installé comme pré condition
à certains niveaux pour rentrer dans ses droits.
L'autre enjeu, et non des moindres était de savoir si
il existe au Cameroun une opposition puissante, structurée et capable de
mener à bien un projet socioéconomique alternatif au point
d'obtenir une forte adhésion des populations. Un besoin de changement,
en somme tant dans l'expression de la démocratie à la
camerounaise, que dans les rhétoriques et les pratiques diverses
relatives à la gestion de l'Etat du Cameroun. Enfin cette
élection était l'occasion de voir si l'on peut avoir alors des
élections réellement démocratiques au Cameroun avec la
nouvelle administration électorale.
I. METHODOLOGIE UTILISEE
L'observation électorale de l'ONG Un Monde Avenir et
ses Partenaires est une observation nationale. Conscient du fait qu'un
processus électoral ne se limite pas au
jour du scrutin, mais s'intègre dans un cycle
électoral incluant des questions à long terme portant sur le
cadre juridique, l'inscription des électeurs, l'enregistrement des
partis et des candidats, la campagne électorale, le vote, le
dépouillement, la compilation des résultats et le contentieux,
conscient également que le processus électoral est aussi plus
largement relié aux questions de démocratie, d'État de
droit et de droits de l'homme. En conséquence, une observation
détaillée d'un processus électoral implique une
présence à long terme d'observateurs (OLT), et d'un
déploiement accrue le jour du scrutin d'observateurs court-terme
(OCT).
1.1 Cohérence
Afin d'assurer une approche cohérente de l'observation
électorale, Un Monde Avenir applique la même méthodologie
dans l'ensemble du territoire national. La mission a déployé des
observateurs disposant d'expériences professionnelles très
diverses et leur a assuré une formation portant sur les
différents aspects du cadre juridique et légal, des techniques
d'observation électorale et de la citoyenneté.
Tous les observateurs sont tenus de respecter le code de
conduite pour les observateurs électoraux du Ministère de
l'Administration Territoriale et de la Décentralisation ainsi que le
Guide de l'observateur de Un Monde Avenir.
La méthodologie de l'observation électorale de
l'ONG Un Monde Avenir permet de s'assurer que l'information sur la conduite
d'une élection et sur d'autres indicateurs de l'environnement
démocratique en général est recueillie de manière
systématique par la Mission d'observation électorale. Des outils
conçus à cet effet ont constitués des garde-fous pour
éviter au mieux des évaluations subjectives ou partisanes des
processus électoraux.
1.2 Observation approfondie et à long
terme
La méthodologie de l'observation électorale de
Un Monde Avenir se concentre de manière détaillée sur tous
les aspects et les étapes d'un processus électoral.
159
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Le travail d'évaluation de la mission a impliqué
l'observation directe d'événements électoraux par ses
observateurs ainsi que l'analyse de l'information obtenue à partir des
documents pertinents et au travers des rencontres avec un large éventail
de personnes concernées par les élections au niveau national et
régional.
Les observateurs ont été déployés
dans l'ensemble des 10 régions du pays ainsi que dans 50
départements sur le triangle national.
La mission d'observateurs à long terme (OLT)
déployés quatre (4) mois avant le scrutin dans tous les 10
régions du Cameroun, a été présente depuis les
inscriptions des électeurs, pendant la campagne électorale
jusqu'à l'annonce des résultats définitifs et
l'épuisement des recours liés aux élections.
1.3 Couverture accrue le jour du scrutin
Le jour du scrutin, la mission a accru sa capacité de
couverture pour l'observation du vote et du dépouillement dans les
bureaux de vote. Les observateurs de Un Monde Avenir et partenaires ont
été déployés à travers le pays et chacun
d'eux avait pour mission de visiter un certain nombre de bureaux de vote
à l'intérieur du centre de vote qui lui a été
attribuée. Les observateurs ont utilisé une fiche d'observation
conçue à cet effet pour leur rapport de mission. Pour s'assurer
de la fiabilité et de la cohérence de l'observation du scrutin,
chaque observateur visite l'ensemble des bureaux de vote de son centre, puis
choisi parmi eux un bureau témoin où il observe jusqu'au
dépouillement.
1.4 Évaluation impartiale et
indépendante
Les observateurs avaient l'obligation d'être strictement
impartiale et de ne faire preuve d'aucun parti pris en faveur d'un camp lors du
processus électoral. Leurs conclusions ont été
fondées exclusivement sur des informations exactes et
crédibles.
Elle a été indépendante dans ses
constatations et ses conclusions.
1.5 Non-ingérence dans le processus
électoral
Les observateurs ne se sont pas ingérés dans le
processus électoral.Lorsque des problèmes ont été
observés, ils les ont porté à l'attention des
autorités électorales et n'ont pas intervenu pour corriger ou
influencer directement sur le déroulement du processus.
1.6 Transparence des conclusions et visibilité
du travail.
Un Monde Avenir a organisé une conférence de
presse à mi- parcourt le 9 septembre 2011 (10 jours après
la convocation du corps électoral) pour faire une lecture
critique du processus d'inscription des électeurs.
De même, le 12 octobre 2011 (72 heures après le
scrutin), Il a rendu publique lors d'une conférence de presse où
la coordination du projet EDE/ACPE était ouverte aux questions des
journalistes. Au vu des constatations et irrégularités, une
déclaration préliminaire sur la position de Un Monde Avenir a
été faite. Le rapport national d'analyse détaillé
vient sonner l'aboutissement de l'observation du processus électoral. Il
évoque les recommandations pour l'amélioration du processus en
même temps qu'il capitalise les leçons apprises et les
difficultés rencontrées.
Schémas méthodologique
· Formation des observateurs long- terme puis court-terme
;
· Briefing et déploiement des observateurs
long-terme (OLT) ;
· Observation du processus électoral depuis les
inscriptions des électeurs ;
· Point de presse à mi- parcourt sur l'observation
de la période pré-électorale ;
· Préparatifs en vue du déploiement des
observateurs court- terme (OCT) ;
· Briefing régional et déploiement des OCT
;
· Observation du scrutin, du dépouillement à
l'échelle nationale ;
· Rapport d'observation ;
· Débriefing des observateurs ;
· Point de presse : Déclaration préliminaire
de la mission ;
160
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
? Départ des OCT ;
? Observation de l'environnement postélectoral par les
OLT ;
? Départ de la mission ;
? Rapport final d'analyse de la mission, y compris les «
leçons tirées » et les
recommandations en vue d'éventuelles améliorations
du processus électoral.
II. DESCRIPTION DES ACTIVITES DE L'OBSERVATION
ELECTORALE DE UN MONDE AVENIR ET SES PARTENAIRES
L'observation électorale au Cameroun de l'ONG
Un Monde Avenir et ses partenaires, s'est faite avec le Financement du
Fond des Nations Unies pour la Démocratie (FNUD), et
elle s'inscrit dans le cadre du projet-programme « Education au
Droit Electoral et Accompagnement des Citoyens dans les Processus Electoraux au
Cameroun » (EDE/ACPE). Après avoir assuré la
formation de 700 observateurs électoraux sur l'ensemble du territoire
national, à travers les 10 régions du Cameroun, ayant ainsi
formé des ressortissants de tous les 58 départements du Cameroun,
les observateurs ont reçu, en dehors des badges d'accréditation,
un kit d'observation, des questionnaires d'observation
préélectorale, électorale et postélectorale, qui
ont permis d'obtenir des comptes rendu détaillés. Ils se sont
tous servi des consignes à eux adressées durant les formations et
aussi ont utilisé un même « modèle de rapport de
synthèse d'un observateur » suivant le canevas
élaboré à cet effet.
Structure
La mission d'observation électorale de Un Monde Avenir
et ses partenaires (MOE 1MA) était composée d'une équipe
de coordination, des coordonnateurs de pool et d'observateurs.
L'équipe de coordination comprenait le Coordinateur
(Philippe NANGA), le Chef de Projet (Francis Albert KAMGUEM), le Superviseur,
deux secrétaires et un responsable logistique. Elle assurait le suivi,
la coordination et la centralisation des informations des régions.
Les coordonnateurs de pools au nombre de 100 étaient
les chefs d'équipe qui assuraient la supervision des observateurs et
leur approvisionnement le jour du scrutin. Toutefois, ils constituaient
l'équipe des observateurs à long terme (du processus)
déployé quatre (4) mois avant le scrutin.
Les 600 observateurs court-terme (du scrutin) étaient
déployés dans l'ensemble des dix régions du Cameroun et
dans 50 départements sur les 58 que compte le Cameroun.
Chronogramme
Les observateurs du processus ont travaillé du 1er
Juin au 7 octobre et du 10 au 21 octobre; et les observateurs du scrutin quant
à eux ont été déployés le jour du scrutin
à savoir le 9 octobre 2011.
La mission a été clôturée avec la
proclamation des résultats par la Cour Suprême le 21 Octobre
2011.
Activités
Le Coordinateur et le Chef de Projet, ont eu des entretiens
avec les responsables d'antennes d'ELECTIONS CAMEROON, des candidats à
l'élection présidentielle. Ils ont donné des interviews
à la presse nationale et internationale.
Les dix équipes d'observateurs du processus ont
été déployées après une session de formation
de deux jours à Douala les 26 et 27 mars 2011. Cette session a
été suivi par 22 autres sessions d'observateurs du scrutin d'un
jour chacune dans les 10 régions à raison de deux sessions par
régions du 4 avril au 5 juillet 2011.
161
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Les observateurs long-terme ont été accueillis
de manière très positive par la population en
général. Ils ont tenu des entretiens avec les responsables locaux
d'ELECTIONS CAMEROUN, avec les autorités traditionnelles locales, et la
société civile.
La présence d'une mission d'observation long terme (du
processus électoral) sur place a créé des confusions chez
les populations locales lors des premiers entretiens. Il a alors fallu
expliquer en quoi les mandats de cette mission étaient différents
de ceux de l'administration électorale nationale, la MOE 1MA
étant, elle, une mission indépendante pour observer et faire un
rapport publiquement sur le processus électoral.
Déploiement de la mission
La mission a déployé des observateurs
long-terme (100) quatre mois avant le scrutin et des observateurs court-terme
(700) le jour du scrutin. Ce déploiement s'est effectué dans
l'ensemble des dix régions du Cameroun. Pour des contraintes
d'enclavements, logistiques et météorologiques, elle a couvert 50
départements sur les 58 que compte le territoire national.
III. ANALYSE DU PROCESSUS ELECTORAL
L'analyse du processus s'attardera sur la période
pré-électorale, la campagne électorale, le scrutin et la
période postélectorale.
3.1. Analyse multisectorielle de la période
préélectorale
? L'inscription des électeurs
D'après les chiffres du dernier recensement de la
population en 2005 la population totale était de 17 463 836 habitants
avec une projection de 20 397 760 habitants en 2011. La population
électorale découlant des chiffres a été
déclarée être de 9 millions d'électeurs. Finalement,
en 2011, le chiffre de 7 500 000 électeurs a été
annoncé par Elections Cameroon comme le nombre total
d'électeurs.
Commencé depuis le 1er Janvier 2011, le processus
d'inscription des électeurs a été conduit par Elections
Cameroon à travers ses antennes communales. Il s'est conduit sans la
participation des partis politiques d'opposition, ni de la
société civile.
Les commissions d'inscriptions ne comprenaient que les
représentants du parti du candidat sortant. Des commissions mobiles ont
été mises sur pied avec l'objectif déclaré de
résoudre le problème d'éloignement géographique
observé.
En fait l'inefficacité de ces commissions mobiles
s'est rapidement révélée, notamment du fait d'un
calendrier de déploiement inconnu des populations. L'implication des
cadres du pouvoir ayant contribué à certains niveaux à
accentuer l'indifférence des citoyens, trouvant en ELECAM un outil au
service du pouvoir. Des Chefs traditionnels ont eux aussi été
impliqués au plus haut degré au processus d'inscription en
inscrivant eux même les électeurs. La faible accessibilité
des points d'inscription par les personnes handicapées a
contribué à éliminer une bonne frange de la population; en
effet, la mission a relevé de nombreux bureaux d'inscriptions
localisés à l'étage des immeubles. Le cas des bureaux de
l'antenne communale de Douala 2ème, en est une
illustration.
Toutefois, le processus d'inscription comme le prévoit
la loi, devait déboucher sur la publication et l'affichage des listes
électorales provisoires à travers tout le pays. La mission a ici
relevé une volonté insuffisante d'Elections Cameroon à
vulgariser les listes électorales.
En effet, dans près de 80% des cas observés,
les listes n'ont été que partiellement affichées au niveau
des antennes communales dans l'ensemble des 10 régions du Cameroun ; et
à certains endroits comme l'illustre la photo ci-dessus, les listes
trainaient au sol et chacun y allait de sa manière pour rechercher son
nom. En outre le fichier électoral n'a pas été
nettoyé comme annoncé et ceci a inéluctablement conduit
à la non publication des listes définitives et ipso facto
impacté négativement sur le processus de distribution des cartes
électorales.
? La distribution des cartes
électorales
Un autre aspect, peut-être plus important encore,
concerne la distribution des cartes d'électeurs. En effet, prévu
pour débuter 25 jours avant le scrutin, cette distribution n'a
162
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
réellement commencé que huit (8) jours avant le
scrutin dans la quasi-totalité des points observés. Plusieurs
dysfonctionnements ont contribué à décourager les
électeurs, notamment le personnel insuffisant en charge de la
distribution, causant de longues files d'attendes de la part des
électeurs. Plusieurs doublons ont été enregistrés
comme le témoignent les cartes ci-dessous.
Les cartes électorales ont été quelques
jours avant le scrutin, transférées au niveau des chefferies
traditionnelles, la raison déclarée étant de les
rapprocher des électeurs, mais cela a davantage enfoncé le clou
de la confusion des électeurs qui pour bon nombres se sont
retrouvés en train de faire en vain des allers-retours en vue d'entrer
en possession du précieux sésame. En résultats, des
centaines de milliers de cartes d'électeurs sont restés dans
l'attente des propriétaires dans toutes les régions.
? La campagne électorale
La campagne électorale est légalement
prévue pour débuter quinze (15) jours avant le scrutin.
Officiellement ce délai a été respecté mais dans la
réalité, la campagne du candidat sortant a commencé
plusieurs semaines avant le lancement officiel, ceci notamment à travers
des documentaires diffusés sur la chaine de télévision
nationale sur ses réalisations, ainsi que des reportages sur les
activités des leaders de son parti.
La campagne électorale a démarré dans
une certaine inquiétude de la part des candidats d'opposition qui, une
semaine après n'avaient pas encore reçu les financements
prévus par l'Etat. Aussi certains candidats d'opposition ont
été victimes d'intimidation. C'est le cas du candidat du PADDEC,
Jean De Dieu MOMO qui avait choisi le village d'origine du candidat sortant
(Mvokmeka) pour le lancement de sa campagne, mais a été
finalement empêché par les autorités administratives de la
localité.
La mission a constaté la disproportion énorme
entre les moyens mis en oeuvre par le candidat sortant Paul BIYA et ceux des
autres candidats, ainsi que l'utilisation massive par le premier nommé
des ressources publiques à des fins de propagande personnelle. De
nombreux opérateurs économiques ont personnellement
contribué à titre privé à la collecte des fonds
pour sa campagne. N'ayant pas de chiffres publiés à ce sujet,
l'on ne saurait établir une proportionnalité entre les
contributions privées et les ressources étatiques
utilisées.
La campagne s'est déroulée dans une
atmosphère peu enthousiaste; pour certains candidats qui n'avaient pas
assez de ressources, les activités de campagne se limitaient à
quelques déplacements ciblés dans le pays. De toute
manière, l'on a remarqué grâce aux journaux radio et
télévisés des chaines privées et publiques, que de
nombreux candidats de l'opposition ont ciblé des marchés
fortement fréquentés pour passer leurs messages.
Des membres du gouvernement ont été mis
à contribution pour la mobilisation des ressources financières du
candidat sortant comme l'ont attesté plusieurs quotidiens nationaux. Le
Premier Ministre ayant été désigné comme directeur
de campagne du candidat sortant. Dans la plupart des agglomérations les
panneaux publicitaires ont été dominés par les affiches du
candidat sortant.
De leur côté, les partis d'opposition ont
été relativement absents sur le terrain. La majorité des
candidats semble avoir manqué de stratégies et d'organisation
requises pour pouvoir gérer une campagne de soutien à
l'échelle nationale. La totalité des candidats d'opposition s'est
plainte d'une insuffisance de moyens financiers.
Cependant le principal parti d'opposition, le SDF a
retourné le chèque de 15 millions de Frs CFA qui lui avait
été remis en guise d'avance sur la subvention de l'Etat relative
à la campagne électorale, comme le prévoit la loi;
critiquant ainsi le caractère modique de cette enveloppe
évaluée à 30 millions de FCFA par candidat. Il est tout de
même pertinent de noter que la majeure partie des candidats comptait sur
la somme de 30 millions de Frs CFA qui était réservée
à chaque candidat pour battre campagne. Sachant de prime abord que la
mobilisation des fonds est un véritable problème pour la plupart
des partis politiques camerounais, que tous
163
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
les candidats ont déposé une somme de 5
millions pour faire enregistrer leur dossier de candidature, sachant que la
somme de 30 millions de Frs CFA ne suffirait même pas à battre
campagne dans une grande ville comme Douala, il faudrait profondément
questionner le fait que ces candidats aient accepté une somme si
dérisoire. Allaient-ils véritablement battre campagne pour gagner
une élection nationale?
Par ailleurs, le délai légal de quinze (15)
jours de campagne ne permet pas aux différents candidats de battre
efficacement campagne, compte tenu des difficultés liées au
transport le Cameroun comportant 10 régions, il faut au minimum 3 jours
pour partir d'une région du Sud faire campagne dans le Grand Nord, et
retourner au point de départ.
? Ressources publiques
L'équité d'accès aux ressources
publiques pendant le processus électoral n'a pas été
respecté. Comme l'ont relevé les observateurs dans toutes les
régions, les ressources humaines et matérielles de l'Etat ont
été ouvertement et massivement mobilisées dans tout le
pays pour soutenir la campagne du candidat sortant Paul BIYA: usage de
véhicules et de bâtiments publics; recours aux fonctionnaires de
l'Etat, etc. Les fonctionnaires des régions, préfets,
sous-préfets ont été mobilisés lors des meetings du
candidat sortant.
? Suivi des médias
Dès le 26 septembre, la mission a
procédé à un suivi quantitatif et qualitatif de
l'audiovisuel public. Les observateurs média de la mission ont
relevé le temps d'attention consacré aux candidats, aux partis
politiques et à leurs membres. Le temps d'attention est le temps
où un sujet politique est couvert, soit indirectement par le reportage
des journalistes, soit directement par l'accès direct à
l'audiovisuel. La qualité À positive, neutre ou négative -
de la visibilité des acteurs politiques a également
été relevée.
D'une manière générale, la campagne a
principalement été couverte dans le cadre des journaux et de
l'émission « Espace politique », émission produite sur
la télévision nationale d'Etat (CRTV) à l'occasion de
l'élection présidentielle pour la présentation des
programmes des candidats et pour le reportage de leurs activités. La
Mission a constaté un accès équitable à l'antenne
pour ce programme spécialise où tous les candidats qui le
désiraient ont eu la possibilité de présenter leur
programme. Outre ce programme spécial, Il a été en
revanche remarqué une disproportion dans la visibilité des
candidats, à l'avantage manifeste du candidat sortant. La position de
force de ce dernier a aussi été constatée pour ce qui
concerne la quantité et la qualité de la couverture de sa
campagne. Le Président et ses comités de soutien ont
été les sujets principaux de toute l'information de l'audiovisuel
public, la couverture de leurs activités dépassant la
moitié du temps consacré à la politique et à
l'élection.
Dans plusieurs médias audiovisuels privés, des
émissions spéciales ont elles aussi vu le jour pour le traitement
de la campagne électorale. On a relevé « Etoudi 2011 »
sur Equinoxe tv et Radio, « Au coeur des présidentielles
» sur LTM tv, « Sur le chemin du palais » sur canal 2
international. Ces émissions ont reçu les candidats et
représentants des candidats pour communiquer sur leur programme
politique. La mission a plusieurs fois été sollicitée sur
plusieurs de ces plateaux.
Durant la période préélectorale, le
climat politique était marqué par de multiples incertitudes:
incertitude quant au fait que les élections auront effectivement lieu en
2011, incertitudes quant à la candidature de M. Paul Biya à cette
élection, incertitude quant au fait qu'ELECAM soit en mesure d'organiser
une élection nationale, et enfin incertitude quant au fait que le
Cameroun résisterait face au mauvais vent qui faisait tomber depuis le
début de l'année 2011 des chefs d'Etat africains dont
l'ancienneté au pouvoir devenait très importante.
Il faut avouer que l'issue de la crise ivoirienne avait
créé une psychose et une indignation sans
précédente au sein des populations camerounaises, et
malgré les divergences d'opinions sur la question ivoirienne, à
tous les niveaux de la société, la peur d'une guerre
164
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
civile ou d'une guerre pour le pouvoir au Cameroun
s'était installée et avait fini par marquer les formes de
langage, les mises en scène, les représentations, et les
pratiques politiques dans toutes les couches sociales et politiques
camerounaises. On commençait à s'attendre au pire, le tout
était maintenant de savoir comment il viendrait. Et c'est dans ce
contexte que le gouvernement en place a choisi, comme stratégie
communicationnelle autour des élections, le silence, voire la
rétention d'informations stratégiques. Une pratique contraire
à l'émergence démocratique.
Par exemple, il a régné pendant des mois, un
silence assourdissant sur la date exacte à laquelle l'élection
aura effectivement lieu, et ce silence était combiné au bout d'un
moment à l'incertitude de la candidature du président sortant.
Perdue dans cette phase d'incertitude, incapable d'élaborer une
stratégie adaptée à la situation de crise politique
larvée, l'opposition toute entière s'est
démobilisée et s'est caractérisée par une
réelle incapacité à faire front en termes de
stratégies globales et pertinentes pour l'échéance
électorale. Tandis que le RDPC avait démarré des campagnes
d'inscription sur les listes électorales depuis octobre 2010, la mission
a relevé l'immiscions de certains de ses cadres dans le processus des
inscriptions sur les listes, en lieu et place d'ELECAM.
Le principal parti d'opposition, le SDF, qui au départ
a donné le mot d'ordre d'abstention, remettant en cause la composition
politique d'Elections Cameroon et ayant proposé l'organisation
d'élections à deux tours ainsi que l'usage d'un bulletin unique,
a attendu 3 semaines avant la fermeture des listes pour demander aux
populations d'aller s'inscrire. Entre temps aucun consensus n'était
visible entre partis de l'opposition quant à la manière dont il
faudrait battre le RDPC. Au contraire, des déchirements, et des
désistements faisaient la une au sein des grandes organisations telles
que le SDF et l'UPC. Il n'y eu aucun consensus au sein de l'opposition pour
obliger le pouvoir à améliorer de façon satisfaisante les
règles de jeu en matière électorale. Certains leaders
d'opposition ont dans ce sens exigé notamment l'adoption des bulletins
uniques, d'un scrutin à deux tours et aussi décrier la
composition politique d'Elections Cameroon.
ELECAM en tant que responsable de la gestion
matérielle de l'élection sur l'ensemble du territoire national,
s'est surtout lancée dans une vaste bataille pour inscrire les citoyens
dans les listes électorales, en usant au besoin de caravanes mobiles,
sans mesurer la complexité de communication qu'il faudrait mettre sur
pied afin de gérer cette mobilité et les repères que les
votants devraient avoir une fois les inscriptions faites depuis leurs domiciles
respectifs. Et durant toute cette période, aucune révision des
listes n'a été faite. C'est donc dans ce climat d'insuffisances
multiformes que le décret présidentiel précisant la date
de l'élection et convoquant le corps électoral est survenu le 30
Août 2011, dans la surprise totale même des membres d'Elections
Cameroon engagés dans plusieurs missions dans les représentations
diplomatiques à l'étranger en vue de donner des clarifications
sur le processus d'inscriptions des électeurs.
Cinquante-trois (53) candidatures à l'élection
présidentielle ont été enregistrées au
départ, et les études de dossiers par la cours suprême ont
permis d'en retenir tout d'abord 21. La Cour suprême du Cameroun statuant
en qualité de Conseil Constitutionnel, a rendu le mardi 20 Septembre,
ses différents verdicts à la suite des requêtes
déposées par de nombreux candidats déclarés. Ainsi,
deux autres candidats ont été repêchés (Anicet EKANE
du MANIDEM et SOH FONE du PSU), ce qui a porté à 23 le nombre
total de candidats, un record dans l'histoire des élections depuis le
retour du multipartisme au Cameroun. Les raisons déclarées des
rejets ont été principalement : le dépôt hors
délai des dossiers, l'absence de certificat de cautionnement, l'absence
de certificat de domiciliation, la signature non légalisée sur la
déclaration de candidature.
Parmi les 23 candidats retenus, beaucoup d'inconnus et
plusieurs dont la base électorale n'est pas plus grande que leur
famille. Cette pléthore de candidature a contribué à
165
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
effriter les bases d'une compétition serrée
entre les candidats de l'opposition et celui du RDPC.
3.2. Analyse du déroulement du scrutin et de
dépouillement
Les dix régions couvertes par nos observateurs, nous
ont permis d'avoir des informations empiriques assez précises sur le
scrutin en particulier, le jour du 9 Octobre 2011. Dans la Région du
Centre la majeure partie des bureaux de vote ont ouvert à l'heure;
même si certaines irrégularités étaient
répertoriées, à savoir certains bureaux de vote où
les isoloirs n'étaient pas conformes, car ne garantissant pas le secret
du vote, à l'instar de l'école publique de Nkolndongo B, ou le
centre linguistique appliqué d'Obili. Autre problème dans la
gestion du matériel, le constat a été fait dans plusieurs
bureaux de votes quant au caractère délébile de l'encre.
Par ailleurs la mission a observé à Yaoundé des bureaux de
vote dans les commissariats (notamment au commissariat du sixième
arrondissement à Mendong) et gendarmerie (brigade de gendarmerie
d'Emombo). Ajouté à cela, le zèle de certaines
élites du RDPC, députés en occurrence, les a conduit
à intimider à la fois les responsables de bureaux de vote de
ESIEG B (face acropole), et les observateurs présents en les faisant
sortir des bureaux pour « délibérer à leur
manière ».
En outre, au centre de l'Hôtel des Finances de Bafia,
la mission a relevé la passation des consignes de vote en langue locale
par une dame représentant le RDPC tenu près de l'isoloir
D'autres problèmes ont été
rapportés, à savoir, les doublons dans les listes
électorales, le fait que de très nombreuses cartes
électorales soient restées abandonnées à
elles-mêmes sans que les propriétaires viennent les prendre. Dans
l'ensemble les bureaux de vote ont fermé à 18h Les chiffres que
nous avons obtenus dans la Région du Centre pour les 68 bureaux
visités dans 38 centres de vote font état de 29809 inscrits pour
14983 votant, soit un taux de participation de 50,26%.
Dans la Région de l'Extrême-Nord, l'un des
problèmes était la difficulté que de nombreux
électeurs ont eu à trouver leur bureau de vote, d'abord à
cause de l'emplacement peu connu de ceux-ci excepté certains qui
étaient dans des lieux publics. Le démarrage des
opérations de vote a connu quelques problèmes sérieux
d'organisation matérielle du scrutin, tels que l'absence d'isoloir dans
des bureaux tels que celui de Sera Ndoumba Blama, celui de la
Coopérative dans la ville de Kousseri.
Plus étonnant, le fait que certains électeurs
n'aient pas pu voter, car ils ont trouvé que l'on avait voté
à leur place; à Warba Ecole Publique, au Pont vert, et Nassarao.
Il a été aussi noté l'intervention magistrale d'un chef de
quartier qui à Zokok 1A trouvait indiqué d'entrer dans le bureau
de vote avec ses sujets, pour leur indiquer le bulletin à choisir (celui
du RDPC).
La mission a relevé plusieurs cas de vote multiple
dans les bureaux de vote des centres : Pont vert, Bala Ouro Dole, Sera Doumba
Blama, Warba centre, où certains électeurs ont voté
plusieurs fois. Il y'en a d'ailleurs qui sortaient des bureaux de vote avec les
bulletins qu'ils n'ont pas introduit dans l'enveloppe. Dans certains bureaux de
vote les électeurs n'ont pas émargé après avoir
voté.
Dans les bureaux de vote de Palar 1A école publique,
Bawliwol Zouloum ESPL Djaoro, Palar II, Douaye, Datcheka, Sirlawe, certains
responsables du RDPC donnaient pendant le scrutin 500 Frs CFA ou 1000 Frs aux
électeurs; l'opération se faisait dans une case pas loin des
bureaux. Quelques bureaux se retrouvaient avec de sérieux
problèmes d'arithmétiques, car par exemple au bureau de vote
situé dans les services du Gouverneur de la Région, on a obtenu
300 votants pour 183 inscrits, au Mayo-Kani le RDPC a obtenu un score de 275%,
3760 personnes ont effectivement voté alors que 1538 personnes
étaient inscrites, et 3670 ont voté pour le RDPC. Dans le
Diamaré 9223 personnes ont effectivement voté alors qu'il n'y
avait que 6693 votants dans les procès-verbaux; ce qui permis au RDPC
166
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
d'avoir 116,18% de voies. Ces incohérences flagrantes
ont été notées dans quelques bureaux de vote où par
exemple à Sera Doumba Blama, il n'y a pas eu de dépouillement
vrai. L'arbitraire avec lequel il a été établi le nombre
de votant ne respecte aucune règle.
Nombreux sont les représentants de partis politiques
qui ont brillé par leur absence, ce qui fait que la majeure partie des
bureaux, on avait tout au plus le RDPC, l'ADD, le SDF et le CPP. Cependant,
l'ensemble des analyses menées démontrent à
l'échelle nationale que les candidats de l'opposition majoritairement
étaient peu représentés dans les bureaux de vote.
Les chiffres obtenus des 32 bureaux de vote visités
dans 29 centres différents dans l'Extrême Nord présentent
13200 inscrits pour 6693 votants, soit un taux de participation de 50,7%.
Dans la Région du Nord-ouest, 94,6% des bureaux de
vote se trouvaient dans des lieux publics. Les opérations de vote ont
débuté pour la majeure partie des bureaux à l'heure.
Certains bureaux de vote se trouvaient dans des locaux de l'armée ce qui
n'était pas de nature à encourager ceux qui y devaient voter.
Les observateurs ont noté que des bureaux de vote tels
que ceux de C.S Bayell G, H, PMI A, B, D, G.S Ngomgham A, B n'étaient
pas très facile d'accès pour les handicapés et les vielles
personnes; pour cause les escaliers hauts des édifices qui servaient de
bureau de vote étaient des obstacles réels pour les
handicapés moteurs. Il fallait en permanence les porter pour les hisser
au niveau des bureaux.
De nombreux actes de fraude ou d'intimidation ont
été notés, soit venant des membres du RDPC, soit de
président de bureaux de vote, soit des agents de sécurité
de la police, des membres d'ELECAM ou encore de officiers de l'armée :
à CS Bayelle A, B, C, D, E, F, G, H ; Bamenda III, G.B.H.S. (C,F,G,H)
Bamenda II Mezam, certaines personnes du RDPC se sont accordés la
liberté de donner 5000 Frs ou 1000 Frs CFA selon les zones à ceux
qui ressortaient des bureaux de vote avec le bulletin du SDF. Ces actes de
corruption et de fraudes se sont accompagnés donc par endroits d'acte
d'intimidation verbale de certains présidents de bureaux de vote
(à GBHS Bamenda E Chomba), des officiers de police (au Congres hall
(J,C) au CBC Musang dans Bamenda II, G.S Bujong dans Bamenda I), de ceux de
l'armée.
Il est tout de même à constater que la majeure
partie des bureaux de vote visités dans le Nord-ouest, l'on a vu que les
scrutateurs du RDPC et du SDF.
Dans la Région du Sud-ouest, la majeure partie des
bureaux de vote visités ont commencé à recevoir les
électeurs dès 8h00, tout le matériel dans les bureaux de
vote était déjà disponible. De nombreuses cartes
d'électeurs sont restées en attente de leurs propriétaires
jusqu'à la fin du vote. Les partis les plus présents lors de ce
scrutin au Sud-ouest étaient le RDPC, le SDF, et le PAP. En dehors du
fait que de nombreuses personnes aient eu le droit de voter sans cartes
d'électeurs, mais avec les cartes d'identités, du moment
où elles étaient identifiées formellement, il y'a tout de
même eu le fait de nombreuses personnes déjà
décédées avaient leur noms dans les listes. Paradoxalement
nombreux d'autres électeurs bien qu'en possession de cartes de vote,
cherchaient en vain leurs noms sur les listes électorales de bureaux de
votes en bureaux et ont fini par être frustrées et
découragées, donc n'ont pas voté. Les données
obtenus, pour les 37 bureaux de vote visités dans 23 centre de cette
région illustrent, 16055 personnes inscrites 8395 votants, soit une
participation de 52,3%.
Dans la Région du SUD, quelques actes d'intimidation
ont été constatés en zone rurale, surtout dans les zones
indexées traditionnellement comme étant rebelles : à
Biwong Bulu, un camion de 20 gendarmes et policiers y est resté
mobilisé pendant 3 jours. Certains « homme en tenus » ont
trouvé indiqué de venir ordonner le démarrage des
opérations de vote. Tandis que l'Equipe Spéciale d'Intervention
rapide patrouillait dans les quartiers, les autorités administratives
faisaient elle aussi le tour de bureau de vote. Plus objectivement, l'encre
dans plusieurs bureaux de vote était facile à effacer car
délébile. Aussi quelques astuces locales ont été
utilisées pour orienter les votants à choisir le bulletin du
candidat du RDPC: des expressions dont l'interprétation en
français signifie, « ici le mot d'ordre est le feu » pour
167
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
inspirer la flamme qui symbolise le RDPC, ou encore des
logiques plus élaborées du type « je mange cette
chauve-souris parce que l'arachide de ma mère y est allé».
En dehors de ces aspects ingénieux, puisés de notre riche
culture, il ne serait pas correct d'oublier d'une part que les lampes
prévues en plusieurs bureaux, pour le dépouillement le soir,
n'avaient pas de pétrole et d'autre part qu'il n'a été
observé aucun représentant d'un parti d'opposition dans la
quasi-totalité des bureaux visités.
Pour l'échantillon de 48 bureaux de vote
visités dans 38 centres, on note 15502 inscrits pour 9979 votants,
correspondant à un taux de participation de 64,37%.
Dans la Région de l'ADAMAOUA, le contrôle
systématique des cartes Nationales d'identité ne s'est pas fait,
d'ailleurs les électeurs n'y avaient pas besoin de carte
d'électeur pour voter. Dans tous les bureaux de vote visités
l'encre était délébile. La mission a relevé la
localisation de certains bureaux de vote dans des lieux privés (foyers
traditionnels). Les observateurs n'ont pas eu la liberté de travailler
dans l'arrondissement de Ngaoundéré 3e car intimidés par
le sous-préfet.
Par ailleurs, il a aussi été observé des
électeurs disposant plusieurs cartes.
L'exemple de Monsieur Tewa Joseph, électricien de
profession, qui avait deux cartes de vote dans le bureau de Haut-Nkam A (carte
N°AD05 0617110603 et carte N°AD0506175B205111101) en est une
illustration. Excepté le MP, l'ADD, et l'UDC la mission a relevé
la très faible présence des scrutateurs des partis d'opposition.
Des 45 bureaux de vote visités dans 31 centres, on note pour l'Adamaoua
16855 inscrits pour 7657 votants avec un taux de participation de 45,4%.
Dans la Région de l'OUEST, dans le département
de la MIFI, l'encre était délébile dans tous les bureaux
visités, et les bulletins du CPP, de l'AFP et du GC n'étaient pas
en nombre suffisant partout. Mais aucun autre problème
signalé.
Dans le département de Bamboutos, au centre de
l'école CEBEC de Lafi, les observateurs ont relevé que certains
membres de RDPC orientaient les votants dans 6 bureaux de vote, pour qu'ils
votent leur candidat. En outre, dans tous les bureaux de vote de très
nombreuses cartes sont restées sans titulaire jusqu'à la
clôture du scrutin. Dans le département de la Menoua, à
Penka-Michel on a noté un vote massif de personnes n'ayant pas la
majorité électorale.
L'existence des bureaux de vote dans des chefferies, casernes
militaires (Bafou, Fongo-Tongo, Dschang, Baleveng) a eu de fortes
répercutions sur l'engagement des électeurs à se rendre
dans ces bureaux de vote. Des personnes détentrices de plusieurs cartes
électorales ont pu voter dans plusieurs bureaux des centres de
Fontsa-Toula, Bamengwou, Ecole publique Fotomena. Il faut noter que tous nos
observateurs ont parlé dans ce département de l'encre qui
n'était pas indélébile.
Dans le département de KOUNG KHI, au centre de vote du
foyer municipal de Pété, un bureau de vote n'avait pas d'isoloir,
cependant une salle de classe a été réquisitionnée
à côte pour servir en lieu et place de l'isoloir conventionnel.
Dans le bureau n°3 du Foyer socioculturel à Bayangam, les bulletins
du candidat Paul Biya étaient en nombre nettement inférieurs aux
autres. Pour l'ensemble de la Région de l'Ouest, on a relevé pour
l'échantillon de 150 bureaux de vote visités dans 80 centres,
28180 votants sur 48 436 inscrits, soit un taux de participation de 58,17%.
Dans la Région du Littoral, la publication tardive des
listes électorales a fortement contribué à
désorganiser le scrutin, car beaucoup d'électeurs ne savaient pas
comment se retrouver. Dans certains centres de vote, les bulletins
présents dans certains bureaux de vote étaient en nombre
insuffisant pour un ou plusieurs candidats, sauf pour M. BIYA Paul, candidat
sortant. On peut citer entre autre le centre de la Mission Catholique de
Bonabéri où les bulletins du Candidat Albert DZONGANG
étaient absents au bureau « Q », ceux de HAMENI BIELEU absent
au bureau « B » de même qu'au centre de l'Ecole la
Rénovation de
168
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Mabanda dans l'arrondissement de Douala 4e où les
bulletins de la Candidate Esther DANG étaient absents au bureau « A
». L'ignorance et le zèle encore de certains dignitaires du
régime, leur a laissé la liberté de chasser des
électeurs et des observateurs au moment du dépouillement,
notamment dans des centres tels que Collège de la Salle à Douala
1er, Aussi, la mission a relevé des cas de bureaux avec plusieurs urnes
(bureau K Ecole Publique Déido, Douala 1er ).On peut s'interroger sur la
destination de la seconde urne. De plus, certains bureaux de votes ont
été victime d'une absence de pétrole dans les lampes
tempêtes au moment du dépouillement; ce qui a été
par exemple le cas au Lycée de Bonadoumbe à Douala 1er, où
l'obscurité a régné dans les bureaux le soir.
Il y a tout de même un problème récurrent
que l'on a constaté, c'est le fait qu'avant l'élection, le
dispositif mobile d'ELECAM a permis à beaucoup de citoyens de s'inscrire
dans les listes, mais que par la suite, il y'ait eu un désordre
indescriptible pour le retrait des cartes; cette mauvaise organisation a
fortement contribué à ce que de nombreux électeurs ne
rentrent pas en possession de leurs cartes. Dans la Région du Littoral,
218 bureaux de vote ont été visités dans 141 centres. Pour
un nombre de votant de 26 826 sur 79 311 inscrits. Ce qui correspond à
un taux de participation de 33,8%.
Dans la Région du NORD, la présence des forces
de police dans les bureaux de vote notamment à l'Ecole d'aides-soignants
de Garoua 1er, de la gendarmerie et de la police dans plusieurs centres de vote
de l'école publique de Koléré, de l'Ecole publique du
plateau, a été un des faits majeurs observés par la
mission. Aussi il n'y avait pas assez de bulletin pour les candidats de
l'opposition au centre de vote de l'Ecole publique de Boukorana à
Garoua. En fin la dernière irrégularité rapportée
est le refoulement des scrutateurs de l'opposition, pour le peu qui
étaient représentés, au centre de Pakete dans
l'arrondissement de Gashiga. Sur la base des 47 bureaux de vote visités
dans 31 centres, il y'avait 18964 personnes inscrites pour 10462 votants. Ce
qui correspond à un taux de participation de 55,16%.
Dans la Région de l'EST, pour ce qui est du
département du Lom et Djerem, la mission a constaté plusieurs cas
de votes multiples et cela a été favorisé par le fait que
la procédure d'identification des électeurs n'était pas
respectée par certains responsables de bureau de vote. Dans le bureau de
vote EPC Radio C, l'isoloir donnait sur une fenêtre, et à
Nkolbikon I bureau A, il était monté de manière que les
membres de la commission voient l'électeur choisir le bulletin qui met
dans l'enveloppe. Il est tout de même à noter que de nombreux
observateurs, dans au moins trois région ont noté cette
disposition des isoloirs près de fenêtres, même s'ils ne
semblent pas avoir vu en quoi cela pouvait être utilisé dans les
fraudes.
Les 29 bureaux de vote témoins de 28 centres dans la
région de l'Est font état de 11292 inscrits pour 6081 votants,
correspondant à un taux de participation de 53,85%.
3.3 Analyse de la période post-
électorale
Quelques jours après le déroulement du scrutin,
douze recours d'annulation totale ont été introduits par certains
candidats d'opposition à la cour suprême officiant en lieu et
place du Conseil Constitutionnel. Les griefs portés contre Elections
Cameroon et le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ont un
dénominateur commun : la mascarade électorale. La cour
suprême a dû ainsi examiner entre autres la question d'abstention
forcée, la problématique posée par le candidat Albert
DZONGANG qui n'a eu droit de voter alors qu'il était candidat,
l'établissement de plusieurs cartes d'électeurs pour un seul
individu, les cas des personnes ayant voté sans être inscrits,
l'exclusion des scrutateurs de certains bureaux de vote, les
dépouillements en privé et des violences physiques sur des
militants de certains partis politique. Le RDPC, parti du candidat sortant a
lui aussi introduit un recours pour l'annulation du scrutin dans le
Département de la MEZAM, au Nord-ouest, fief du principal parti
d'opposition (SDF) Il dénonçait des fraudes massives dans ce
département.
169
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Par ailleurs, peu avant le début des recensements des
votes, l'Alliance des Forces Progressistes (AFP), parti du candidat Bernard
MUNA a décidé de claquer la porte de la commission nationale de
recensement général des votes en retirant son mandataire.
Une semaine après le scrutin, sept (7) candidats
leader de l'opposition ont lancé un appel dit « déclaration
de Yaoundé » réclamant l'annulation du scrutin et demandant
au peuple d'aller dans la rue. Les signataires de cette déclaration
étaient : Ni John Fru Ndi (SDF), Edith Kahban Walla (CPP), Adamou Ndam
Njoya (UDC), Bernard Muna (AFP), Albert Dzongang (La Dnamique), Jean de Dieu
Momo (PADDEC), Ayah Paul Abine (PAP). A la suite de la déclaration de
Yaoundé, le président de la conférence épiscopale
nationale du Cameroun, Monseigneur Atangana a appelé le peuple à
s'abstenir de descendre dans la rue à l'issue de la proclamation des
résultats des présidentielles. Le vendredi 21 octobre 2011 a eu
lieu la proclamation des résultats des présidentiels par la cour
suprême, officiant en lieu et place du Conseil Constitutionnel. Certains
candidats invités à la cérémonie ont
boycotté.
La prestation du serment est intervenue le jeudi 3 novembre
2011 à l'Assemblée Nationale. En parallèle à cette
cérémonie d'investiture, le candidat du Mouvement Progressiste,
Jean Jacques EKINDI, bravant l'interdiction de toute manifestation
ordonnée par le Préfet du Wouri en vigueur, organisait une marche
à Douala en désapprobation au processus électoral ayant
conduit à la victoire déclarée du candidat Paul Biya.
IV. DIFFICULTES RENCONTREES ET LECONS
APPRISES
4.1 Difficultés rencontrées
La mission d'observation de l'ONG Un Monde Avenir ne s'est
pas faite sans difficultés. On a noté :
? La collaboration faible des membres des commissions
électorales
Certains observateurs bien que accrédités ont
été empêchés d'accès à
l'intérieur des bureaux de vote.
? L'accès à l'information
La mission a rencontré d'énormes
difficultés quant à l'accès à des observateurs long
terme aux informations pendant la période pré-électorale.
Notamment, le taux d'inscription des électeurs, la liste des bureaux de
vote dans chaque arrondissement.
Ceci a entravé profondément le travail de la
cartographie des observateurs dans les bureaux de vote.
? La limite des moyens financiers
L'insuffisance des moyens financiers n'a pas permis d'assurer
la visibilité de tous les observateurs sur le terrain à travers
notamment le port de tee-shirts ou casquettes.
4.2 Leçons apprises
? La société civile a besoin d'une
stratégie cohérente
Bien que certaines organisations de la société
civile camerounaise aient acquis une expérience certaine en
matière d'observation électorale au cours des dernières
années, les approches adoptées ont été diverses et
parfois on a même réinventé la roue. Certains
progrès ont été accomplis, notamment en ce qui concerne
les critères applicables pour l'organisation d'une mission
d'observation, l'élaboration d'un code de conduite pour les observateurs
et les critères de recrutement de ceux-ci. Il reste qu'une
stratégie cohérente doit être mise en place pour
gérer l'observation et l'assistance électorale.
La tenue d'élections n'est pas toujours synonyme de
démocratie. Il arrive que le pouvoir en place soit tenté de
manipuler les élections afin d'acquérir une
légitimité internationale. Il faut faire preuve d'une
extrême prudence et veiller à ce que la décision
d'organiser une mission d'observation nationale ne contribue pas à
cautionner un processus illégitime.
170
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
? Les élections ne se font pas en un
jour
Il importe d'observer toutes les étapes du processus
électoral pour pouvoir procéder à une évaluation
étayée et complète. À titre d'exemple,
l'enregistrement des électeurs, le déroulement de la campagne
électorale ou la résolution des différends après
les élections peuvent être d'une importance cruciale pour pouvoir
évaluer correctement le processus électoral. Ces étapes
peuvent parfois se dérouler sur plusieurs mois en raison de
difficultés logistiques. Les observateurs à long terme devraient
être sur le terrain quelques mois avant les élections et y rester
suffisamment longtemps pour pouvoir commenter la mise en oeuvre finale des
résultats des élections. Une assistance technique visant à
encourager la bonne gestion des affaires publiques et la démocratisation
doit être fournie dès que possible et devrait se poursuivre entre
les élections.
? Les intervenants sur le terrain doivent se coordonner et
parler d'une seule voix pour maximiser leur influence
Une bonne coordination entre les missions d'observations
nationales par la société civile est nécessaire pour
assurer le succès d'une mission électorale. En dépit d'une
coordination étroite, une harmonisation des outils peut contribuer
à des résultats probants en évitant la dispersion des
efforts.
? La collaboration entre tous les acteurs peut améliorer
le processus électoral L'administration électorale, les partis
politiques, la société civile, les médias ont des points
de vue différents sur les élections et la collaboration parmi ces
acteurs peut améliorer le processus électoral.
V. CONCLUSIONS DE LA MISSION
D'OBSERVATION
Il est important de relever que sur l'ensemble du territoire
national, il y'avait environ 25000 bureaux de vote, et que la mission
d'observation d'Un Monde Avenir ne pouvait pas avoir la prétention de
couvrir tous ces bureaux; encore que d'autres se trouvaient dans les diasporas
camerounaises à l'étranger. Cependant, l'échantillon que
nous avons pu couvrir avec les 700 observateurs formés, ainsi que la
méthodologie utilisée nous ont permis d'avoir un regard
suffisamment édifiant sur le déroulement effectif à la
fois, de la période préélectorale, du scrutin et
même de la phase postélectorale.
Les règles électorales souffrent encore de
plusieurs incongruités telles que l'absence de code électoral
unique, l'absence de consensus dans l'espace politique quant aux conditions
idéales dans lesquelles les élections auraient dû se
dérouler, l'absence de lisibilité dans le travail d'ELECAM,
l'absence, d'un organe véritablement indépendant.
Il serait juste de relever que ces
irrégularités et fraudes doivent être prises dans leurs
contextes. D'abord, il est absolument évident pour tous les observateurs
qu'ELECAM n'a pas suffisamment préparé cette élection,
tant au niveau de la gestion des inscriptions, des listes, des cartes
électorales, ou de tout ce qu'il fallait comme matériel sur le
terrain. Il est urgent que des corrections se fassent dans ce domaine y compris
dans les outils et les méthodes de communication sur les cartes et les
listes électorales.
Par contre, il nous semble évident que les fraudes
constatées représentent un faible pourcentage comparativement aux
lieux où aucun incident ou dysfonctionnement n'a été
rapporté.
Mais aussi, il est connu des croyances sociopolitiques au
Cameroun, que de nombreuses élites du RDPC en mal d'émergence, ou
en quête d'une positionnement administratif ou politique, ont toujours
pensé, à tort ou à raison, que le système de
récompenses avec le président du parti était plus
favorable à ceux qui faisaient d'excellents scores lors des
élections, et qu'ainsi avoir des chiffres records à tout prix,
étaient l'une des
171
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
meilleures manières de marquer des points aux yeux de
la hiérarchie du parti. Or cette façon de faire a ceci de
profondément dangereux qu'elle révèle une profonde
incompétence des certaines bases du RDPC à construire un
militantisme vrai, fondé sur des convictions saines et non sur des
calculs peu citoyens. Ce type de situation est d'autant plus redoutable qu'elle
fausse totalement les données tant pour le parti RDPC en termes
d'appréciation des dimensions motivationnelles et convictionnelles de
ses militants, mais donne raison à ceux qui en face, sans
compétence politique avérée, peuvent arguer qu'il y'a eu
fraude pour légitimer leurs échecs qui pourtant sont souvent
consubstantiels à leur incapacité à faire un travail de
fond au niveau de l'espace politique.
La mission a relevée l'impressionnante absence des
scrutateurs de la majeure partie des candidats de l'opposition à
l'élection présidentielle 2011 au Cameroun.
Autrement dit, l'impréparation de l'opposition
à cette échéance électorale nous amène
à dire que les irrégularités, les fraudes
constatées auraient eu plus de poids que si la compétition avait
eu véritablement lieu entre les diverses candidatures.
En outre aucun parti politique au Cameroun n'a
démontré durant cette élection, avoir compris les vrais
enjeux d'une élection, le sens du vote ou encore l'urgence à
mobiliser les électeurs autour de vrais programmes structurants et
structurés, clairs, réalistes et opérationnels. Il est
inquiétant de constater que les raisons pour lesquelles les militants
votent un candidat ne sont pas les plus représentatives de
l'idéal que l'on se ferait du sens du vote. Très difficilement
vous en verrai voter un homme pour un programme. Enfin aucun de ces partis n'a
donné l'impression de vouloir s'attaquer à un problème de
fond qui mine le champ social au Cameroun et qui affecte les bases depuis
lesquelles se construit l'espace politique, c'est l'extrême
fragilité de la citoyenneté et de l'action citoyenne.
Sur la base des critères prioritaires qui permettent
de valider une élection démocratique, nous pouvons nous prononcer
comme suit :
L'élection présidentielle du 09 octobre 2011 au
Cameroun respecte les critères de périodicité
établis par la loi, au vu de ce que ce soit en principe tous les sept
ans qu'il faille en organiser; et ce délai légal a
été respecté.
Quant à l'honnêteté de cette
élection, elle n'a pas été honnête, car le
défaut d'informations autour de l'élection, autour des
inscriptions, autour du retrait des cartes, a fortement contribué
à pérenniser l'apathie électorale et faire perdre à
l'électeur camerounais, la confiance nécessaire en ce
système électoral. En outre, jusqu'à preuve du contraire,
il n'existe pas de compétition politique crédible au Cameroun; il
n'existe pas de perspective crédible et réelle pour les
électeurs, de pouvoir, par leur vote, démettre leurs dirigeants
de leurs fonctions. De nombreuses insuffisances ont été
relevées, d'abord au niveau informationnel, par rapport au calendrier
électoral, ce qui a contribué à fausser les
stratégies des opposants en occurrence, car il n'aurait pas fallu qu'ils
se mettent à spéculer sur la date de la tenue effective des
élections, mais plutôt que la date soit publiée au moins un
an avant de manière claire et précise.
Sur l'ensemble du territoire national, l'élection n'a
pas été libre partout, En effet, des consignes de vote sur le
choix d'un candidat ont été relevés dans plusieurs bureaux
de vote, aussi, certains individus et même un candidat (Albert DZONGANG)
se sont vus incapables de voter, tandis que d'autres dans certains bureaux de
votes se faisaient refoulés en tant qu'observateurs.
La liberté des observateurs n'était pas
établie et plusieurs d'entre eux ont été repoussés
des bureaux de vote.
Cette élection ne saurait être qualifiée
de juste, à cause d'une part de la disproportion flagrante entre les
moyens et ressources dont disposait le candidat Paul Biya, en comparaison aux
moyens des candidats de l'opposition et d'autre part de
l'inéquitabilité d'accès aux médias.
172
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
L'exigence d'un respect des règles de suffrage universel
a été suivie dans le sens où
l'ensemble des citoyens remplissant les conditions ont le
droit de voter. Cependant l'accès au vote des personnes appartenant
à des minorités (personnes handicapées) ou d'autres
groupes particuliers de citoyens a été entravé. Des
dispositions nécessaires devraient être prises pour rendre
possible le vote des handicapés.
Pour cette élection présidentielle, le suffrage
égalitaire a été respecté, en raison de ce que le
vote de tous les citoyens à la même valeur.
Quant au concept de secret de vote, il est correct de dire
l'absence d'isoloir ou la présence des chefs traditionnels dans certains
bureaux de vote ait entravé le secret du vote. VI.
RECOMMANDATIONS
Au regard de l'ensemble du processus électoral
observé pour le compte de l'élection présidentielle 2011
au Cameroun, les recommandations que nous faisons sont les suivantes :
· Il est impératif de créer au Cameroun
une véritable commission électorale indépendante qui soit
composée prioritairement de personnes venant de la société
civile et sans aucune attache avec les partis politiques. Qu'elle ne soit pas
le fruit de nominations, mais de concertations ouvertes de manière
transparentes et claires entre les partis politiques, l'Etat et la
société civile. Cette commission devra jouir de toutes les
ressources nécessaires pour son bon fonctionnement ;
· La conception et l'utilisation d'un bulletin unique
est une avancée par laquelle les élections au Cameroun doivent
passer pour réduire considérablement le risque de fraude ;
· En outre il urge d'avoir un code électoral
unique, et il faudrait ramener l'âge minimum de vote à 18 ans,
pour l'harmoniser avec les pratiques qui pénalement rendent responsable
à cet âge-là ;
· Quel que soit le type d'élections,
l'administration électorale devrait veiller à ce que des
informations claires et précises soient publiées sur le
calendrier électoral au moins Un an avant toute élection à
caractère national et ce calendrier devra être respecté
scrupuleusement ;
· La mission recommande la refonte totale des listes
électorales au Cameroun et de la manière la plus transparente qui
soit, pour éviter des doublons, les décédés dans
les listes, les déplacé, ou les personnes frappées
d'incapacité électorale. Ceci aura pour effet de
crédibiliser un peu plus le résultat du scrutin ;
· Les partis politiques, la société
civile, l'Administration électorale doivent tous s'engager
désormais et profondément, dans l'éducation civique des
électeurs afin que ces derniers puissent avoir suffisamment
d'informations à la fois sur le déroulement du scrutin et sur les
principaux candidats. Sans ce travail de fond, l'absentéisme restera
toujours un problème profond dans les élections au Cameroun, car
beaucoup de nationaux ne comprennent pas le pouvoir du vote, son sens et ses
enjeux ;
· ELECAM devrait former véritablement ses
représentants bien avant l'élection, pour que leur
présence sur le terrain ne soit pas des fois un facteur de
discrédit de l'élection dans un bureau de vote. De nombreux
représentants d'ELECAM ont démontré sur le terrain qu'ils
ne maitrisaient ni les procédures de vote, ni la loi ;
· ELECAM devrait non seulement publier les listes
électorales provisoires au moins Un mois avant chaque scrutin, mais
aussi distribuer les cartes dans les délais que prévoit la loi.
Mais surtout s'assurer bien à l'avance (au moins 8 semaines avant le
scrutin) que tout le matériel qui sera utilisé est conforme et en
quantité suffisante. Nous proposons d'explorer la possibilité de
remettre la carte au moment de l'inscription ;
· Les partis politiques camerounais gagneraient à
construire leurs bases de depuis les éléments convictionnels et
motivationnels qui les constituent. Ils gagneraient surtout à structurer
un autre leadership fondé sur des valeurs républicaines et
citoyennes et non
173
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
sur des calculs erronées et subjectives. Ils
gagneraient même à sanctionner à la fois les pratiques qui
tendent à duper la hiérarchie du partie quant à la vraie
base électorale laquelle il faut compter dans chaque localité
;
? Nous recommandons l'adoption d'un scrutin à deux
tours ; il serait de nature à favoriser une compétition plus
structurée et équitable entre les divers candidats et partis
politiques, et aussi il légitimerait le vainqueur ;
? Nous recommandons fortement que la durée de la
campagne électorale soit allongée à 21 jours. La
durée légale de 15 jours est courte et il s'avère
difficile pour les candidats d'opérer efficacement dans l'ensemble des
10 régions dans cette limite de temps ;
? Des mesures spéciales doivent être prises pour
favoriser la participation des personnes handicapées. Ainsi, nous
recommandons la mise en place des points d'inscriptions et bureaux de vote
spécifiquement accessibles aux personnes handicapées,
l'utilisation des bulletins de vote spécifiques aux aveugles et
malvoyants.
174
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
Table des matières
AVERTISSEMENT II
DEDICACE III
REMERCIEMENT IV
SOMMAIRE V
LISTE DES ANNEXES VI
SIGLES ET ABREVIATIONS VII
RESUME XI
INTRODUCTION GENERALE : 1
PENSER LE MONITORING COMME UN PHENOMENE POLITIQUE
1
I. Eléments de problématisation du sujet
2
A. Contexte et justification 2
B. Revue critique de la littérature 4
A. Problématique 10
II. Cadre théorique et opérationnel
11
A. Cadre théorique 11
B. Techniques de collecte des données
13
C. Hypothèses et axe de recherche 14
PREMIERE PARTIE : 16
LA CONSTRUCTION SOCIOPOLITIQUE DU MONITORING DES
ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 16
CHAPITRE I :
REGLES ET ENJEUX DU MONITORING DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 17
SECTION I : LE
MONITORING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES : UNE
PRATIQUE ENCADREE PAR DES REGLES NORMATIVES ET
PRAGMATIQUES 17
Paragraphe 1 : Les normes d'encadrement du monitoring
des élections présidentielles 17
A. Le monitoring des élections
présidentielles : une pratique encadrée par le droit
international 17
B. Le monitoring des élections
présidentielles : une pratique encadrée par le droit national
19
Paragraphe 2 : Le monitoring des élections :
une pratique encadrée par des règles pragmatiques
21
A. Les règles pragmatiques internationales :
la Déclaration de Bamako et la déclaration de principes
pour
l'observation internationale d'élection et le code de conduite
des observateurs électoraux internationaux : cas
des élections présidentielles de 2004
et 2011 21
B. Les règles pragmatiques internes : les
concertations entre les acteurs du processus électoral
et
l'adoption du code de bonne conduite au processus
électoral de 2011 23
SECTION 2 : LE MONITORING DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES : UNE
PRATIQUE STRUCTUREE PAR DES ENJEUX MULTIPLES
25
Paragraphe 1 : Le monitoring des élections :
une pratique structurée par les enjeux
politiques et stratégiques économiques
cas de l'élection présidentielle de 1992 25
A. Les enjeux politiques du monitoring des
élections : Cas de l'élection présidentielle de 1992
25
B. Les enjeux stratégiques des acteurs : Cas
de l'élection présidentielle de 1992 27
Paragraphe 2
: Les enjeux économiques et culturels du monitoring des élections
: cas des
élections présidentielles de 1992 et de
1997 28
A. Les enjeux économiques des acteurs du
monitoring des élections 28
B. Les enjeux culturels du monitoring des
élections 29
CONCLUSION PARTIELLE 30
CHAPITRE II : LES
RESSOURCES ET LOGIQUES DU MONITORING DES ELECTIONS
PRESIDENTIELLES AU CAMEROUN 31
SECTION 1 : LES TYPES
RESSOURCES ET LES INSUFFISANCES DES ACTEURS
DU MONITORING DES ELECTIONS 31
Paragraphe 1 : Les types de ressources des acteurs du
monitoring des élections 31
A. Les ressources financières
31
175
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
B. Les ressources humaines
33
C. Les ressources matérielles
34
Paragraphe 2 : Les insuffisances structurelles et
conjoncturelles des ressources 34
A. Les insuffisances structurelles
34
B. Les insuffisances conjoncturelles
35
SECTION 2 : LES LOGIQUES CONTRASTEES DU
MONITORING DES ELECTIONS : LA DYNAMIQUE DE MISE EN OEUVRE DU MONITORING
DES
ELECTIONS 36
Paragraphe 1 : Le déroulement de la mission
de monitoring des élections 36
A. Les activités
préélectorales 37
B. Les activités électorales
proprement dites 41
C. Les activités post-électorales
43
Paragraphe 2 : La fin de la mission de monitoring
des élections présidentielles 44
A. La préparation et la
présentation du communiqué final 44
B. La préparation et la
présentation du rapport final 46
CONCLUSION PARTIELLE 49
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 50
DEUXIEME PARTIE : 51
USAGE ET EFFET DE REALITE DU MONITORING DES
ELECTIONS
PRESIDENTIELLES AU CAMEROUN
51
CHAPITRE 3 : LES USAGES PLURIVOQUES DU MONITORING DES
ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 52
SECTION 1 : LES USAGES INTERNES
DU MONITORING DES ELECTIONS : CAS
DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 1992 52
Paragraphe 1 : Le monitoring des élections
comme instrument de préservation d'une autonomie d'action
dans la mise en oeuvre du processus de
démocratisation 52
A. Le monitoring des élections comme moyen
de disqualification des modèles véhiculés
par
l'environnement international : cas de
l'élection présidentielle de 1992 53
B. Le monitoring des élections comme
volonté relativement contestée de pilotage exclusif de la
dynamique
politico-électoral interne
56
Paragraphe 2 : Les usages politiques du principe de
transparence dans la dynamique
interne du monitoring des élections
présidentielles 59
A. L'argument de transparence comme vecteur de
stabilité sociopolitique : cas de des élections
présidentielles de 1992
59
B. Accords et désaccords sur la
transparence électorale dans le contexte de monitoring des
élections
présidentielles comme maintien du dialogue
politique 60
SECTION 2 : LES USAGES EXTERNES DU MONITORING DES
ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 61
Paragraphe 1 : Le monitoring des élections
comme astuce de promotion de la démocratie par la communauté
internationale 61
A. Une incompatibilité dans les faits :
cas de l'élection présidentielle de 1992
61
B. Le recours au monitoring des élections
comme mesures non-coercitives pour l'établissement de
la
démocratie : cas de l'élection
présidentielle de 1992 63
Paragraphe 2 : La souveraineté
étatique et le principe de légitimité démocratique
64
A. La souveraineté étatique,
qualité de l'Etat 64
B. L'émergence d'un principe de
légitimité démocratique 67
CONCLUSION PARTIELLE 69
CHAPITRE 4 : LES EFFETS DE REALITE DU MONITORING DES
ELECTIONS
PRESIDENTIELLES 70
SECTION 1 : LES
MERITES DES MISSIONS DE MONITORING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES : ENTRE
AMELIORATION DU PROCESSUS ELECTORAL
ET STABILITE SOCIOPOLITIQUE 70
Paragraphe 1 : Les mérites de fond des
missions de monitoring des élections présidentielles
71
176
Le monitoring des élections
présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011
A. La consécration du principe de
l'indissociabilité de la démocratie par les instruments
internationaux et
nationaux et l'évaluation des organes de
gestion de l'organisation et de la conduite des élections
71
B. La mise en place d'institutions de plus en
plus fiables, la construction d'une culture des principes
démocratiques et le monitoring des
instruments juridiques électoraux 73
Paragraphe 2 : Les mérites de forme du
monitoring des élections présidentielles
75
A. L'Observatoire National des Elections (ONEL)
75
B. Elections Cameroon (ELECAM)
79
SECTION 2: LES LIMITES DU DEPLOIEMENT DES
MISSIONS DE
MONITORING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
80
Paragraphe 1: Les limites de fond des missions de
monitoring des élections présidentielles 81
A. L'inconfort conceptuel des missions de
monitoring des élections présidentielles 81
B. L'inconfort épistémologique des
missions de monitoring des élections 82
Paragraphe 2 : Les limites formelles des missions
de monitoring des élections présidentielles 84
A. L'ambiguïté des pratiques des
missions de monitoring des élections présidentielles
84
B. L'inefficience relative des missions de
monitoring des élections 85
CONCLUSION PARTIELLE 87
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 88
CONCLUSION GENERALE 89
BIBLIOGRAPHIE 94
I. OUVRAGES GENERAUX 95
II. OUVRAGES DE METHODOLOGIE 95
III. OUVRAGES SPECIALISEES 96
IV. THESES ET MEMOIRES 97
A. THESES 97
B. MEMOIRES 98
V. ARTICLES ET REVUES 99
VI. DOCUMENTS OFFICIELS ET RAPPORTS DE FIN DE
MISSIONS
D'OBSERVATION DES ELECTIONS DES ELECTIONS
104
A. RAPPORTS DE FIN DE MISSIONS, DES
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES 104
B. RAPPORTS ET COMMUNIQUE DE FIN DE MISSIONS DE
LA
FRANCOPHONIE 104
C. RAPPORT DES ACTEURS NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX
ETATIQUES ET NON ETATIQUES 104
VII. REVUES ET JOURNAUX DIVERS 105
VIII. SITES INTERNET 106
LISTE DES ANNEXES 106
TABLE DES MATIERES 174



