B- L'entretien
L'entretien permet aux chercheurs de retirer des informations et
des éléments de réflexion au travers une interaction avec
une population préalablement sélectionnée.
L'échange qui découle de l'entretien permet
d'exprimer les perceptions d'une situation au travers des questions ouvertes,
et d'interpréter les réactions. Le chercheur facilite alors
l'expression, en proposant un cadre de réflexion autour des objectifs de
recherche fixés.
Les questions posées permettent de guider l'entretien
de façon à ce que le sujet ne s'éloigne pas des objectifs
de recherche. Aussi, le chercheur se doit de garder en éveil son esprit
théorique, de façon à ce que ses interventions
amènent des éléments d'analyse susceptibles d'apporter des
pistes de travail en ce sens.
L'entretien permet de concentrer l'échange autour de ses
hypothèses de travail sans exclure les développements
parallèles susceptibles de les nuancer ou de les corriger.
L'entretien semi-directif :
L'entretien est dit semi-directif car il n'est ni
entièrement ouvert, ni canalisé par un grand nombre de questions
précises.
La préparation de l'entretien demi-directif se fait au
travers une grille d'entretien, avec des questions-guide, souvent
thématiques, permettant de recevoir des informations ciblées de
la part de l'interviewé.
Il faut garder à l'esprit que ces questions sont, en
quelque sorte, des bornes permettant de guider l'entretien vers des objectifs
précis, et que le déroulement de l'entretien fera évoluer
l'utilisation de ces bornes, en fonction des interactions entre le chercheur et
son interlocuteur.
C'est donc bien l'interviewé qui, en fonction de ses
réponses, mène l'entretien. Le chercheur s'efforcera de recentrer
celui-ci lorsqu'il s'écarte des objectifs de recherche, en posant les
questions auxquelles l'interviewé ne répond pas par
lui-même.
L'entretien semi directif permet de compléter les
résultats obtenus par sondage quantitatif de type questionnaire, et
apporte de plus grandes précisions des informations recueillies au
travers les relances et les interactions entre l'intervieweur et
l'interviewé.
Enfin, l'entretien permet de repérer les
représentations au travers du discours des personnes
interrogées
L'analyse de contenu de l'entretien :
L'entretien permet de faire surgir un maximum d'informations et
de réflexions qui serviront de matériaux à une analyse de
contenu systématique.

L'analyse de contenu offre la possibilité de traiter de
manière méthodique des informations et des témoignages qui
présentent un certain degré de profondeur et de
complexité.
L'analyse thématique tente de mettre en évidence
les représentations sociales ou les jugements des locuteurs à
partir d'un examen de certains éléments du discours. L'analyse de
l'évaluation porte sur les jugements formulés par
l'interlocuteur, leur direction et leur intensité.
L'analyse de contenu permet alors d'être
utilisée pour l'analyse de stratégies, des enjeux, d'une
situation problématique ou encore de l'impact d'une mesure sur
l'interlocuteur et ses pratiques. Elle oblige le chercheur à prendre
beaucoup de recul par rapport aux interprétations spontanées, en
l'examinant à partir de critères qui portent sur l'organisation
interne du discours.
Dans cette partie du travail de recherche, il est important
de garder une méthodologie qui permette des repères précis
dans le travail d'analyse, en mettant en lumière les variables
impliquées par les hypothèses, en relevant les informations
correspondantes à ces variables, en vérifiant que celles-ci soit
conformes ou non aux hypothèses et en exprimant leurs
caractéristiques principales pour mieux les mettre en évidence
La méthode utilisée pour l'analyse des
données provenant des entretiens semi-directifs a donc été
élaborée selon trois thématiques principales :

Le partenariat, qui englobe les relations avec les instances
locales, et qui éclaircit les rôles de chacune d'entre elles
L'élaboration du parcours d'insertion professionnelle qui
reprend les étapes importantes, mais aussi les difficultés
éprouvées par les personnes interrogées
Les pratiques et décisions institutionnelles qui influent
sur le déroulement du parcours professionnel.
Ces trois thématiques permettront de mettre en avant
l'importance du maillage territorial, mais aussi de comprendre comment
l'institution, par des critères de mise en application du dispositif
RMI, contribue à freiner le travail d'élaboration des parcours
d'insertion professionnelle des allocataires RMI.
D'autre part, nous verrons les difficultés
éprouvées par les acteurs face à des outils manquant de
souplesse, qualifié parfois d'inadaptés voire de
défaillants vis-à-vis des problématiques
rencontrées par les allocataires. Nous croiserons en outre ces
données avec les attentes exprimées des allocataires
vis-à-vis du dispositif.
C - Le public interrogé :
|
Les allocataires du RMI
Les chargés de Mission PLIE Les référents
RMI
|
|
Les allocataires du RMI :
Les entretiens semi directifs effectués auprès des
allocataires du RMI se sont déroulés principalement chez eux.
L'évolution du parcours d'insertion professionnelle
des personnes a été choisie à divers moments « T
» afin de mieux comprendre l'évolution de leurs
représentations et de leurs attentes à cette période du
parcours d'insertion.
Par conséquent, j'ai rencontré des personnes
ayant signé un contrat aidé, des personnes qui sont en cours de
parcours et d'autres personnes qui ont signé un contrat mais qui n'ont
pas d'objectifs clairement définis.
Les entretiens semi directifs ont pour objectifs de
connaître l'état des savoirs des allocataires en termes de
procédures, de rôles et de règles institutionnelles. La
question principale étant de savoir si le dispositif leur permet de
repérer facilement qui
interpeller.et quelles sont les
attentes des allocataires vis-à-vis du référent et du
contrat d'insertion.
Ces entretiens se sont déroulés avec :

2 personnes en contrat aidé ou ayant effectué un
contrat il y a moins de 6 mois 2 personnes en cours de parcours insertion
1 personne ayant signé un contrat d'insertion sans
objectifs professionnels précis
La particularité de ces publics est qu'il y a une
majorité de femmes.
D'autre part, les personnes interrogées ne proviennent
pas du panel de personnes géré par le PLIE de Tourcoing. Elles
ont été sélectionnées sur la base du volontariat et
ne résident pas sur le même territoire, mais dans la région
du Nord.
La sélection de ce panel a été basée
sur deux critères principaux :

Etre allocataire du RMI
Avoir signé un contrat d'insertion
Puis, les panels ont été à nouveau
divisés en trois autres critères :
|
Les personnes ayant connu un contrat aidé depuis moins de
6 mois
Les personnes qui ont signé un contrat d'insertion,
incluant un projet professionnel et qui tentent de le mettre en oeuvre
Les personnes qui ont signé un contrat d'insertion sans
objectifs professionnels précis à atteindre
|
|
La durée des entretiens fut aléatoire : de 30mn
à 90 mn.
Le lecteur doit en outre être informé des
difficultés particulières que nous avons rencontré pour
approcher ce public, qui s'explique par une méfiance et qui exprimait
une crainte de représailles institutionnelles. D'autre part, le contact
direct avec le public était relativement rare, limitant drastiquement
les opportunités.
Pourtant, quelques personnes proches ont accepté de
participer à cet entretien, avec parfois, un coté revendicatif
qui a permis de récolter des données riches et
éclairantes. Certaines personnes ont eu plus de mal à s'exprimer
que d'autres. Deux personnes ayant eu des imprévus, cela explique que
les entretiens ne soient pas tous de même qualité, en termes de
questionnements et réponses.
Les chargés de mission :
A la frontière entre le public, les partenaires locaux
et les instances politiques, les chargés de mission ont pour objectifs
principaux de veiller à l'équilibre et à l'application des
mesures en faveur de l'insertion professionnelle des personnes très
éloignées de l'emploi, et d'animer ces dispositifs en diffusant
l'information des dispositifs disponibles, validant les actions menées
par les opérateurs conventionnés par le PLIE et en faisant le
lien entre les référents instructeurs et les actions
menées.
Les entretiens effectués avec les chargés de
mission ont pour objectif de repérer le partenariat et les
difficultés qu'ils impliquent, mais aussi comprendre leur point de vue
sur l'organisation et l'utilisation des outils par les référents
et les bénéficiaires.
Les quatre chargés de mission qui ont accepté
de s'entretenir dans le cadre de ce travail de recherche, sont assignés
à un pole particulier de l'insertion professionnelle : les clauses
d'insertion, la médiation à l'emploi, la formation et
l'insertion.
Les rencontres se sont déroulées sur le lieu de
travail des intéressés et ont duré en moyenne 120 mn.
Elles ont été obtenues sur la base du
volontariat. Je n'ai pas rencontré de freins particuliers pour
m'entretenir avec les professionnels du PLIE, les entretiens n'ont pas
été exploitables de façon similaire. Ceci peut s'expliquer
par les différences qui existent dans les domaines d'intervention, et
l'éloignement plus ou moins prononcé avec le public, en
particulier le public RMI.
Les référents généralistes
de parcours :
Les référents sont en lien direct avec le
public. Ils signent les contrats d'insertion, accompagnent les personnes, et
jouent un rôle d'intermédiaire entre les instances et le public.
Les questionnaires préalablement adressés aux
référents ont eu un rôle de compréhension globale de
leurs pratiques, en termes de moyens, de résultats. Ils ont permis
d'esquisser les difficultés ressenties pour l'élaboration du
parcours d'insertion.
Les entretiens qui ont suivis cherchent à comprendre
la relation que les référents entretiennent avec les partenaires
institutionnels et les marges de manoeuvre qui leur sont possibles face aux
freins institutionnels.
Le seul critère de sélection des
référents était qu'ils travaillent le suivi de publics
percevant le RMI.
Les questionnaires16 ont été
envoyés à tous les référents de parcours connus du
territoire de Tourcoing, soit 32 référents. J'ai pu en
récupérer une vingtaine, après maintes relances. La
principale difficulté qui a été exprimée face au
remplissage du questionnaire était le manque de temps. En effet, l'outil
proposé était composé de 66 questions ouvertes et
fermées. En outre, les référents avec qui j'ai pu
m'entretenir ont préféré la relation d'interaction de la
rencontre plutôt qu'une transmission abstraite et impersonnelle au
travers d'un questionnaire.
Trois entretiens ont eu lieu. Nous tenons à
préciser à notre lecteur que ces professionnels ont des
spécificités assez différentes, de part leur lieu de
travail et les publics qu'ils reçoivent.
|
Le premier référent, Charles, travaille seul dans
une structure associative de la ville de T. Le public qu'il reçoit est
assez homogène.
Le deuxième référent Alex, travaille
pour une structure qui accueille un public RMI ayant une problématique
de santé. Le lecteur sera attentif à cette précision qui
est un critère d'éligibilité pour accéder à
certains dispositifs.
Le troisième référent, Judith, travaille
dans le domaine des contrats aidés et
intervient
spécifiquement auprès des personnes
concernées pour qu'elles accèdent à une
|
|
16 Voir annexes
formation et à sortir de ce dispositif particulier. Le
public que Judith reçoit concerne tous les publics positionnés
sur ce type de dispositif, mais notre entretien concernera en priorité
les difficultés rencontrées pour le positionnement sur la
formation et sur la sortie du dispositif du public RMI.
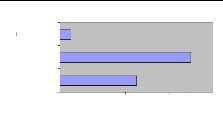
Nlveaux
Bac + 4 et plus
Bac + 3
Bac + 2
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Niveau scolaire des référents
RMI
Pourcentages
Chapitre III - Analyse, interprétation et
conclusion I- Analyse des données
| 


