|



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE MBUJIMAYI (UOM) Av. Kalonji,
n° 27, Q/Kansele, C/Muya, Mbujimayi, Kasaï-Oriental Courriel :
uomrecteur@gmail.com
Téléphone/WhatsApp : +243 853 886 663 www.uom.cd
République Démocratique du Congo


FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du diplôme de graduat en sciences économiques et de
gestion.
Par :
WEMAKOYE ELANGA Elvis Encadré par
:
TSHILENGE ILUNGA Marcel Professeur


ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE MBUJIMAYI (UOM) Av. Kalonji,
n° 27, Q/Kansele, C/Muya, Mbujimayi, Kasaï-Oriental Courriel :
uomrecteur@gmail.com
Téléphone/WhatsApp : +243 853 886 663 www.uom.cd
République Démocratique du Congo
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du diplôme de graduat en sciences économiques et de
gestion
Par :
WEMAKOYE ELANGA Elvis Encadré par
:
TSHILENGE ILUNGA Marcel Professeur
Rapporteur :
KANGODIA KANGODIA Glory Assistant
EPIGRAPHE
"Le succès est la somme de
petits efforts, répétés jour après jour."
Leo Robert Collier
"Entreprendre, c'est se jeter dans le vide et apprendre
à voler en chemin."
Reid Hoffman

DÉDICACE
À mes précieux parents dont l'amour et les
sacrifices sont sans mesure ;
À mes chers frères et soeurs ;
À mes amis ;
Et
Àux jeunes de la commune de Kanshi.
II
WEMAKOYE ELANGA ELVIS
REMERCIEMENTS
Nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont contribué à la réalisation de ce
travail.
En premier lieu, nous remercions le Seigneur notre Dieu,
Maî tre des temps et des circonstances, qui a rendu cette oeuvre
possible.
Ensuite, nous remercions notre directeur de travail, le
professeur Marcel TSHILENGE, et notre codirecteur, l'assistant Glory
KÀNGODIÀ. Nous leur sommes reconnaissants pour leurs conseils,
leur soutien et leurs remarques pertinentes et constructives.
Par ailleurs, nous témoignons notre appréciation
aux professeurs Raphae l MUSÀMPÀ, doyen de la faculté des
sciences économiques et de gestion, José KÀPINGÀ,
vice-doyenne chargée des enseignements, Marcel TSHILENGE,
secrétaire général facultaire, et Jean-Christophe
NTINTÀ, pour leurs connaissances et leurs compétences mises
à notre disposition.
De plus, nous adressons nos remerciements sincères aux
responsables et aux jeunes de la commune de Kanshi, qui nous ont
facilité l'accès au terrain et nous ont fourni des informations
très utiles.
De même, nous exprimons notre affection et notre
reconnaissance à nos chers parents : Jean-Louis ELÀNGÀ et
Marie-Christine KÀKOTSHÀ, qui nous ont soutenus tant moralement
que matériellement pendant tout notre parcours.
En outre, nous manifestons notre amitié et notre
gratitude à nos amis qui nous ont encouragés, appuyés et
accompagnés tout au long de cette période.
Enfin, nous disons notre merci à toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont rendu possible cette oeuvre.
III
WEMAKOYE ELANGA ELVIS
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
BAD Banque Africaine de
Développement
BM Banque Mondiale
CNUCED Conférence des Nations-Unies
sur le Commerce et le Développement.
FMI Fonds Monétaire International
MIBA Société Minière de
Bakwanga
OCDE Organisation de Coopération et de
Développement Économiques
OIT Organisation Internationale du Travail
ONG Organisation Non Gouvernementale
PIB Produit Intérieur Brut
PME Petites et Moyennes Entreprises
PNUD Programme des Nations-Unies pour le
Développement
RDC République Démocratique du
Congo
UA Union Africaine
UE Union Européenne
IV
LISTE DES TABLEAUX
Tableau N°01 Quelques définitions du concept
jeune entrepreneur selon les écoles de
pensée 20
Tableau N°02 Présentation de la
population juvénile de la commune de Kanshi par tranches
d'âge selon les quartiers 36
Tableau N°03 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par
genre 38
Tableau N°04 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par
genre et tranches d'âge 39
Tableau N°05 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par
tranches d'âge 39
Tableau N°06 Présentation du profil des
répondants 42
Tableau N°07 Statistiques descriptives des variables
liées aux facteurs personnels... 43
Tableau N°08 Tests statistiques des variables liées
aux facteurs personnels 44
Tableau N°09 Profils des jeunes entrepreneurs selon leurs
caractéristiques personnelles 45
Tableau N°10 Statistiques descriptives des variables
liées aux facteurs socioculturels 46
Tableau N°11 Tests statistiques des variables liées
aux facteurs socioculturels ....................47
Tableau N°12 Perspectives des jeunes entrepreneurs selon
leurs aspirations et leurs projets..48 Tableau N°13 Principaux
obstacles/défis à l'entrepreneuriat dans la commune de
Kanshi.......49 Tableau N°14 Proposition des solutions aux obstacles de la
commune.........................................49
LISTE DES FIGURES
Figure N°01 Présentation des quatre paradigmes de
l'entrepreneuriat et de leurs
relations ..........15
Figure N°02 Population juvénile par tranches
d'âge selon les quartiers... 38
Figure N°03 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par
genre 39
Figure N°04 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par
genre et tranches d'âge 39
Figure N°05 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par
tranches d'âge 40
Figure N°06 Profil des répondants 42
V
VI
SOMMAIRE
EPIGRAPHE I
DÉDICACE II
REMERCIEMENTS III
SIGLES ET ABRÉVIATIONS IV
LISTE DES TABLEAUX V
SOMMAIRE VI
0. INTODUCTION 1
0.1. Etat de la question 1
0.2. Choix et intérêt du sujet 2
0.3. Problématique 2
0.4. Hypothèses du travail 4
0.5. Objectifs de l'étude 4
0.6. Méthodes et techniques de recherche 5
0.6.1. Méthodes 5
0.6.2. Technique 5
0.8. Canevas du travail 5
CHAPITRE PREMIER : REVUE DE LA LITTERATURE
6
Section 1. Approche théorique de l'entrepreneuriat
6
1.1. Théories sur l'entrepreneuriat 6
1.1.1. Les conceptions dominantes de l'entrepreneuriat.
7
1.1.3. Entreprenariat des jeunes 19
1.1.4. Typologies entrepreneuriales 21
1.1.5. Formes de l'entrepreneuriat 26
1.1.6. Motivations et freins à l'entrepreneuriat
27
CHAPITRE DEUXIEME : METHODOLOGIE ET PRESENTATION DU
CADRE D'ETUDE 33
Section 1. Méthodologie 33
1.1. Collecte des données 33
Section 2. Présentation du cadre d'étude
35
2.1. Contexte économique et social de la commune de la
Kanshi 35
2.2. Quelques statistiques 36
2.3. Entrepreneuriat des jeunes de la commune de Kanshi
40
CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE DES DONNEES ET
INTERPRETATION DES RESULTATS 42
Section 1. Analyse des données 42
1.1. Profil des répondants 42
Section 2. Présentation des résultats
43
2.1. Facteurs personnels influençant l'entrepreneuriat
des jeunes 43
2.2. Facteurs socioculturels influençant
l'entrepreneuriat des jeunes 46
2.3. Perspectives des jeunes entrepreneurs 48
2.4. Obstacles et solutions à l'entrepreneuriat des
jeunes 49
Section 3. Discussion 50
3.1. Les facteurs personnels 50
3.2. Les facteurs socioculturels 51
3.3. Les facteurs liés à l'environnement
52
Section 4. Perspectives 52
4.1. Implications 52
4.2. Pistes de recherches futures 53
4.3. Recommandations 53
CONCLUSION 56
BIBLIOGRAPHIE 57
ANNEXES 61
VII
1
0. INTODUCTION
0.1. Etat de la question
Il est primordial de signaler que l'entrepreneuriat est un
sujet riche et diversifié, qui suscite l'intérêt de
nombreux chercheurs dans différents domaines. Il s'agit donc d'un champ
de recherche en pleine évolution, qui offre de nombreuses perspectives
d'analyse et d'action.
Bien avant la présente étude, nombreux
chercheurs se sont exprimés autour de ce sujet. De ce fait, voici
ci-après quelques-uns d'entre eux :
Tout d'abord, Jaeger et Helfer, qui ont organisé une
journée ressource sur l'entrepreneuriat et la jeunesse, concluent que ce
sujet est en quête de sens et qu'il faut favoriser les échanges
entre enseignants, chercheurs et praticiens. (Toutain & Verzat, 2017)
Ensuite, l'OCDE, qui a réalisé une
synthèse sur l'entrepreneuriat des jeunes, conclut que ce
phénomène est influencé par des facteurs personnels,
sociaux, économiques et institutionnels, et qu'il faut soutenir les
jeunes entrepreneurs par des politiques adaptées. (OCDE/U. E., 2012)
De même, Beye (2012), qui a étudié
l'entrepreneuriat et le développement, conclut que l'entrepreneuriat est
un facteur clé du développement économique et social, mais
qu'il nécessite des conditions favorables et des politiques publiques
appropriées.
Par ailleurs, Sy, Massing et Liboudou (2014), qui ont
étudié les déterminants de l'entrepreneuriat des jeunes en
Afrique de l'Ouest, concluent que ce processus est motivé par des
opportunités et des contraintes, et qu'il faut renforcer les
capacités des jeunes entrepreneurs par des formations et des
accompagnements.
Par la suite, Chabaud, Sammut et Degeorge (2020), qui ont
rédigé un manuel sur l'entrepreneuriat, concluent que
l'entrepreneuriat est un processus complexe et dynamique, qui implique des
acteurs multiples et des compétences variées, et qui peut prendre
des formes diverses selon les contextes.
De plus, Marchesnay (2020), qui a analysé
l'entrepreneuriat en action, conclut que l'entrepreneuriat est une
démarche créative et innovante, qui repose sur la capacité
des entrepreneurs à identifier et exploiter des opportunités,
à mobiliser des ressources et à gérer des incertitudes.
Enfin, Capron, qui a coordonné un ouvrage sur
l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, conclut que
l'entrepreneuriat est un phénomène en pleine expansion, qui
traduit une transition vers une économie entrepreneuriale.
Pour Capron, une économie entrepreneuriale est
caractérisée par une plus grande autonomie, flexibilité et
responsabilité des agents économiques. (Capron, 2009)
Quant à ce travail, il s'attèlera sur la
détermination des obstacles entrepreneuriaux qui concernent seuls les
jeunes et plus spécifiquement ceux du champ d'étude.
2
0.2. Choix et intérêt du sujet
Le choix de ce sujet a été motivé par la
passion de découvrir les défis et les potentialités de
l'entrepreneuriat des jeunes, qui représente une source
d'épanouissement pour ceux-ci et de progrès pour le
développement local.
Ce travail peut donc contribuer à apporter un
complément scientifique et servir d'outil d'aide social. Et ce,
notamment :
y' En enrichissant la connaissance et la compréhension
de l'entrepreneuriat des jeunes dans un contexte spécifique ;
y' En identifiant les besoins et les attentes des jeunes
entrepreneurs, en analysant les forces et les faiblesses de leur environnement
;
y' Et en proposant des recommandations judicieuses pour les
soutenir.
0.3. Problématique
La question de l'emploi occupe une place
prépondérante dans les débats politiques de
développement de toutes les nations du monde entier. Elle retient
l'attention des gouvernements qui cherchent les voies et moyens les plus
appropriés pour pallier les problèmes de chômage afin de
sortir leurs populations de la fragilité.
Le souci principal des gouvernements est de permettre à
leurs populations non seulement de subvenir à leurs besoins, mais aussi
de contribuer au développement socio-économique.
Constat fait, malgré les efforts des gouvernements dans
la recherche des moyens pour la réduction du chômage, il continue
de prendre de l'ampleur dans le monde. (O.I.T, 2019).
Cette situation de chômage en particulier chez les
jeunes, a plusieurs causes. Elle est due aux crises économiques,
politiques et sanitaires, à l'accroissement démographique,
à l'incapacité du marché de l'emploi à
ingérer les vagues successives de diplômés et à
l'inadaptation de la formation aux exigences de ce marché.
Par conséquent, la solution entrepreneuriale semble une
option crédible que proposent plusieurs gouvernements et organismes
internationaux, tels que la B.M., le F.M.I., l'OCDE et la CNUCED.
De ce fait, l'entrepreneuriat est considéré
comme étant l'un des mécanismes de développement
économique et social les plus importants. Il permet en effet la
création d'emplois, l'innovation, la richesse et le bien-être.
(Acs & Audretsch, 1988)
Comme moteur de la croissance économique,
l'entrepreneuriat a attiré énormément d'attention ces
dernières décennies partout dans le monde. Il est souvent mis de
l'avant comme facteur d'accroissement du dynamisme et de la
prospérité d'une nation.
3
Cela est perceptible dans les discours politique et
scientifique. Il permet de renforcer la capacité d'adaptation d'un
territoire en renouvelant ses acteurs économiques.
Les nouvelles entreprises « injectent » du dynamisme
puisque lorsqu'elles entrent pour la première fois dans un marché
; elles fournissent des produits et des services qui n'existent pas encore
localement, et donc élargissent le choix des consommateurs.
À cet égard, l'entrepreneuriat joue un
rôle important dans la réduction de la pauvreté,
l'égalité des sexes et la viabilité environnementale.
Certains auteurs affirment que la société
influence l'entrepreneur potentiel, façonnant ses actions et
conditionnant sa détermination à créer une entreprise. Ils
considèrent l'entrepreneuriat comme un phénomène qui peut
être influencé par le contexte social, culturel, économique
et politique (Fayolle, 2003 ; Boisson & al., 2009).
Ainsi, le rôle des facteurs individuels, sociaux,
économiques et technologiques est déterminant sur la perception
de l'entrepreneuriat et sur l'intention de créer une nouvelle
entreprise.
À l'ère de l'Internet, le champ de
l'entrepreneuriat innove, incitant les jeunes à repenser les concepts,
créant de nouvelles formes de services. De nouveaux secteurs
d'activité voient le jour tandis que d'anciens disparaissent.
En ce sens, la société agit sur le comportement
entrepreneurial, influence la motivation entrepreneuriale et agit
également sur les facteurs qui restreignent ou stimulent l'action
entrepreneuriale.
L'entrepreneuriat demeure un facteur important dans la
société et bénéficie d'un intérêt tout
particulier de la part des économistes, des sociologues et des
décideurs politiques.
Cet intérêt est, sans conteste, dû à
la place de la création d'entreprises dans le développement
économique et social, l'augmentation de la production et du revenu, la
résorption du chômage, la diversification de l'industrie ainsi que
la promotion de l'innovation (Rasmussen & Sorheim, 2006 ; Minniti &
Lévesque, 2008).
En effet, diverses de forces poussent un nombre croissant
d'hommes et de femmes à considérer la création ou la
reprise d'une entreprise comme une alternative crédible à un
emploi salarié.
Parmi ces forces l'on peut citer :
l'accélération incessante des mutations technologiques,
l'évolution des équilibres sociaux, la versatilité
croissante des emplois salariés dans les grandes organisations, la
volonté d'avoir un travail conforme à ses propres valeurs, ainsi
que la perspective d'être son propre patron.
Sur le continent africain, généralement, les
jeunes et les femmes constituent les catégories sociales ayant
d'immenses difficultés à trouver un emploi et à gagner un
revenu décent (Kouty & Douzounet, 2020).
4
Selon des statistiques de la Banque Africaine de
Développement, la majeure partie des jeunes n'a ni emploi stable, ni
perspectives économique (B.A.D, 2018). Les chiffres à ce niveau
sont évocateurs d'un mal profond à l'insertion professionnelle de
la classe jeune de la population ; ce qui occasionnerait des coûts
économiques, pour le moins sérieux.
D'une part, le chômage des jeunes, en freinant la
croissance économique, tend, selon Coward & al. (2014), à
démoraliser les concernés qui, finalement, n'ont plus ni l'envie
ni la capacité de mener une vie. (Kouty & Douzounet, 2020).
D'autre part, on n'en est à penser que c'est, dans une
certaine mesure, l'absence d'opportunité qui alimente conflit et
instabilité politique, voire la tendance à l'émigration
à risque. Pourtant, la solution face aux difficultés
d'accès à l'emploi repose davantage sur l'entrepreneuriat.
Pour ce qui concerne cette étude, un angle de
réflexion particulier est ouvert en interrogation sur les obstacles ou
barrières que rencontrent les jeunes de la commune de KANSHI à se
lancer dans l'entrepreneuriat. Concrètement, il s'agit de
répondre à la question essentielle ci-après :
y' Quels sont les facteurs qui entravent
l'émergence de l'entrepreneuriat des jeunes de la commune de KANSHI,
dans la ville de Mbujimayi ?
0.4. Hypothèses du travail
Eu égard à l'interrogation soulevée ci-haut,
il est proposé l'hypothèse selon laquelle :
y' L'entrepreneuriat des jeunes de la commune de Kanshi
serait entravé par des facteurs personnels liés au profil
même des jeunes entrepreneurs ; des facteurs socioculturels ; ainsi que
des facteurs liés à l'environnement (les règlements, la
fiscalité, l'accès au financement externe, l'accès aux
marchés et le manque de services de soutien).
0.5. Objectifs de l'étude
Ce travail vise à étudier essentiellement
l'entrepreneuriat des jeunes de la commune de Kanshi à Mbujimayi, les
défis qu'il présente et les perspectives y afférentes.
En termes de spécificité, les objectifs qu'il
poursuit sont entre autres ceux de :
y' Identifier et analyser les facteurs personnels qui
influencent la motivation, les compétences, les attitudes et les
comportements des jeunes entrepreneurs dans le contexte du champ d'étude
;
y' Examiner et évaluer les facteurs socioculturels qui
facilitent ou entravent l'entrepreneuriat des jeunes, tels que les normes
sociales, les valeurs culturelles, le rôle de la famille et des
réseaux sociaux ;
y' Explorer et mesurer les facteurs liés à
l'environnement qui affectent l'entrepreneuriat des jeunes, tels que le cadre
réglementaire, le système fiscal, l'accès au financement
externe, l'accès aux marchés et le manque de services de soutien
;
y' Proposer des recommandations pour améliorer les
conditions favorables à l'entrepreneuriat des jeunes et renforcer leur
potentiel entrepreneurial.
5
0.6. Méthodes et techniques de
recherche
En vue de mener une recherche intelligible et avoir des
aboutissements fiables, il est indispensable que la rigueur et la pertinence de
la démarche scientifique reposent sur une adoption rationnelle et
cohérente des méthodes d'analyse et des techniques de collecte
des données.
0.6.1. Méthodes
Pour l'élaboration de notre travail, nous avons
estimé que l'usage des méthodes ci-après permettra la
réalisation de nos objectifs :
V' Méthodes statistiques :
méthodes scientifiques consistant à décrire,
quantifier et synthétiser les données récoltées par
le calcul de certains paramètres et procéder à leur
représentation sous forme de tableaux, graphiques, elles servent
à décrire les caractéristiques des enquêtés,
interpréter et représenter les données recueillies.
0.6.2. Technique
Pour la production des données, nous avons recouru
à :
V' La technique de questionnaire :
elle consiste à interroger un ensemble des répondants,
représentant d'une population, et permet d'assembler des informations
auprès des enquêtés sur leurs situations sociales,
professionnelles ou familiales, leurs impressions, etc. par le biais d'un
questionnement opérationnel et orienté.
0.7. Délimitation du sujet
0.7.1. Dans l'espace : sur le plan
spatial, nous menons notre étude au sein de la commune de la Kanshi,
dans la ville de Mbujimayi, en R.D.C. Le choix de cet espace est dû au
fait qu'il s'agit du milieu où nous vivons et auquel nous
désirons apporter notre contribution pour un changement positif.
0.7.2. Dans le temps : sur le plan
temporel, notre étude s'étend sur l'intervalle d'un mois,
période de nos enquêtes. Ce choix a été
motivé par la disponibilité des données authentiques.
0.8. Canevas du travail
Outre l'introduction et la conclusion, le présent travail
comprend trois chapitres dont :
V' Le premier chapitre qui se centre sur la revue de la
littérature ;
V' Le deuxième chapitre qui traite quant
à lui, de la méthodologie et présentation du cadre
d'étude ;
V' Enfin, le troisième chapitre qui se
focalise sur l'analyse des données et l'interprétation des
résultats.
6
CHAPITRE PREMIER : REVUE DE LA LITTERATURE Section 1.
Approche théorique de l'entrepreneuriat
1.1. Théories sur l'entrepreneuriat
L'entrepreneuriat est un phénomène complexe et
multidimensionnel qui a suscité de nombreuses théories et
approches explicatives.
À la suite de Marchesnay et Verstraete (1999), on peut
considérer l'entrepreneuriat comme un phénomène qui
combine deux niveaux d'analyses indissociables. Ces derniers ont une relation
dynamique et dialectique : l'entrepreneur et son organisation qui se
définissent mutuellement.
Trois dimensions ont été émises dans ce
cadre : la dimension cognitive, praxéologique et
structurale.
1) La dimension cognitive : elle
renvoie à la façon dont l'entrepreneur perçoit et
interprète son environnement, ses opportunités et ses ressources.
Cette dimension comprend trois composantes entre autres :
y' La pensée stratégique : c'est une
réflexion globale sur l'organisation et une vision
considérée comme étant un futur souhaité et
réalisable par l'entreprise.
y' La réflexibilité : c'est la
capacité de l'individu à interpréter, comprendre et
apprendre dans son action. D'où l'action doit guider la pensée et
cette dernière la sert également. Elle est fortement liée
à l'apprentissage et à la pensée stratégique qui
est enrichie en permanence par le vécu quotidien de l'entrepreneur.
y' L'apprentissage : il provient de l'accumulation
des connaissances et des expériences, du vécu, des motivations
ainsi que des capacités intrinsèques de chacun.
Ces trois composantes apparaissent intimement liées et
leur combinaison renvoie à la représentation que l'entrepreneur
fait de l'organisation qu'il impulse.
2) La dimension praxéologique
: elle concerne le processus de création et de
développement de l'entreprise, ainsi que les actions et les
décisions de l'entrepreneur. Elle représente l'essentiel de la
matérialisation et de la concrétisation du
phénomène entrepreneurial à travers deux catégories
d'actions :
y' Les positionnements de l'entrepreneur au sein de ses
différents environnements. Ils renvoient aux activités de
marketing, mais aussi aux éléments de stratégie et aux
politiques fonctionnelles.
7
y' La mise en place d'une configuration organisationnelle.
Elle est indispensable pour produire ce qui est attendu par les espaces
sociaux dans lesquels l'entrepreneur s'insère.
Elle peut s'agir d'une contrainte dans le cas d'une crise de
leadership quand l'entrepreneur fait ce qu'il peut seul, ce qui ne lui permet
pas de relever les défis de croissance. Elle peut soit
représenter une opportunité lorsque l'entrepreneur conduit son
organisation vers sa réussite qui est supposée être sa
croissance.
3) La dimension structurale : elle
se réfère au contexte institutionnel, social et culturel dans
lequel évolue l'entrepreneur. Elle a, d'après les travaux de
Berger et Luckman (1989) et ceux de Bourdieu (1987), deux types de structures
:
y' La structure objective : Bourdieu considère
l'existence de l'agent social comme étant fonction de sa position dans
l'espace social, ce qui produit ainsi des différences de vue entre les
hommes.
La position occupée par une personne dans un espace
social déterminé est une grande opportunité
d'appréhension de ses convictions et d'intronisation de ses
représentations sociales.
y' La structure subjective : elle est une
résultante de la subjectivité individuelle ou collective dans le
sens où les individus érigent des frontières artificielles
autour de leurs environnements afin de leur donner une certaine
intelligibilité.
Ces deux composantes sont fortement liées entre elles
et entretiennent une relation dialectique.
1.1.1. Les conceptions dominantes de l'entrepreneuriat
1.1.1.1. Quelques modèles théoriques
Les conceptions dominantes sur l'entrepreneuriat sont des
modèles théoriques qui tentent d'expliquer les facteurs qui
influencent le comportement entrepreneurial, c'est-à-dire la
création ou la reprise d'une entreprise, ou tout autre projet
innovant.
Il existe plusieurs approches qui se basent sur des
disciplines différentes, comme l'économie, la psychologie, la
sociologie ou le management. Voici quelques exemples de ces conceptions :
1) Le modèle de l'action raisonnée
(Ajzen & Fishbein, 1975)
Ce modèle postule que le comportement entrepreneurial
est le résultat d'une intention qui dépend des attitudes, des
normes sociales et du contrôle perçu sur le comportement.
8
Les attitudes sont les évaluations positives ou
négatives du comportement, les normes sociales sont les pressions
exercées par l'entourage pour adopter ou non le comportement, et le
contrôle perçu est le degré de facilité ou de
difficulté à réaliser le comportement.
Ce modèle se base sur le postulat que les individus
agissent de manière rationnelle et consistante avec leurs croyances et
leurs valeurs. Il s'agit donc d'un modèle cognitif qui met l'accent sur
le processus de décision qui précède le comportement. Le
modèle peut être représenté par le schéma
suivant :
Ic = f31Ac+ f32
Ns + f33 Cp
Où :
I Ic est l'intention
comportementale, c'est-à-dire la probabilité subjective qu'un
individu adopte un comportement donné.
I Ac est l'attitude
comportementale, c'est-à-dire l'évaluation globale du
comportement par l'individu, basée sur ses croyances sur les
conséquences du comportement et sur ses évaluations de ces
conséquences.
I Ns est la norme
subjective, c'est-à-dire la perception par l'individu que les personnes
importantes pour lui approuvent ou désapprouvent le comportement,
basée sur ses croyances normatives et sur sa motivation à se
conformer à ces normes.
I Cp est le contrôle
perçu, c'est-à-dire la perception par l'individu de sa
capacité à réaliser le comportement, basée sur ses
croyances de contrôle et sur la présence ou l'absence de facteurs
facilitants ou inhibants.
I f31, f32 et f33
sont des coefficients qui expriment l'importance relative de chaque
facteur dans la prédiction de l'intention.
Enfin, ce modèle permet donc d'expliquer comment les
attitudes, les normes sociales et le contrôle perçu influencent
l'intention comportementale, qui est elle-même un prédicteur du
comportement réel.
Il a été appliqué à de nombreux
domaines, dont l'entrepreneuriat, pour comprendre les motivations et les
obstacles des entrepreneurs potentiels.
2) La théorie du comportement planifié
(Ajzen, 1991)
Ce modèle est une extension du modèle de
l'action raisonnée qui ajoute un élément
supplémentaire : la perception de la faisabilité du comportement.
Cette perception est influencée par la disponibilité des
ressources et des opportunités nécessaires pour entreprendre.
Il se base sur le postulat que les individus agissent de
manière planifiée et intentionnelle, en tenant compte des
informations dont ils disposent et des conséquences possibles de leur
action.

Il s'agit donc d'un modèle cognitif qui met l'accent
sur le processus de décision qui précède le comportement.
Le modèle peut être représenté par le schéma
suivant :
Ic = â1 Ac+ â2 Ns
+ â3 Cp Où :
I Ic est l'intention
comportementale, c'est-à-dire la probabilité subjective qu'un
individu adopte un comportement donné.
I Ac est l'attitude comportementale,
c'est-à-dire l'évaluation globale du comportement par l'individu,
basée sur ses croyances sur les conséquences du comportement et
sur ses évaluations de ces conséquences.
I Ns est la norme subjective,
c'est-à-dire la perception par l'individu que les personnes importantes
pour lui approuvent ou désapprouvent le comportement, basée sur
ses croyances normatives et sur sa motivation à se conformer à
ces normes.
I Cp est le contrôle
perçu, c'est-à-dire la perception par l'individu de sa
capacité à réaliser le comportement, basée sur ses
croyances de contrôle et sur la présence ou l'absence de facteurs
facilitants ou inhibants.
I f31, f32 et f33
sont des coefficients qui expriment l'importance relative de chaque
facteur dans la prédiction de l'intention.
En plus de ces trois facteurs, le modèle introduit une
variable supplémentaire : la perception de la faisabilité du
comportement.
Cette variable correspond au degré auquel l'individu
croit que le comportement est réalisable, en fonction des ressources et
des opportunités dont il dispose ou auxquelles il peut accéder.
Elle influence à la fois l'intention et le comportement réel,
comme le montre le schéma suivant :
Ic = â1 Ac + â2 Ns
+ â3 Cp
Cf = á1 Cp + á2 Ro Br =
ã1 Ic + ã2 Cf
Où :
I Cf est la perception de la
faisabilité du comportement, c'est-à-dire le degré auquel
l'individu croit que le comportement est réalisable, basée sur
ses croyances de faisabilité et sur les ressources et les
opportunités disponibles ou accessibles.
I Ro est un ensemble de variables
externes qui représentent les ressources et les opportunités
nécessaires pour réaliser le comportement, telles que le temps,
l'argent, le matériel, le soutien social, etc.
I Br est le comportement
réel, c'est-à-dire l'action effective réalisée par
l'individu. I cr1, cr2, y1 et y2 sont des
coefficients qui expriment l'importance relative de chaque variable dans la
prédiction du comportement.
10
Ce modèle permet donc d'expliquer comment les
attitudes, les normes sociales, le contrôle perçu et la perception
de la faisabilité influencent l'intention et le comportement
réel. Appliqué à de nombreux domaines, dont
l'entrepreneuriat, il a aidé à comprendre les motivations et les
obstacles des entrepreneurs potentiels.
3) Le modèle de la formation de
l'événement entrepreneurial (Shapero & Sokol,
1982)
Le modèle de la formation de l'événement
entrepreneurial suggère que le comportement entrepreneurial est
déclenché par un événement qui perturbe le statu
quo (l'état où les choses se trouvaient auparavant) et
crée un déséquilibre dans la situation actuelle.
Cet événement peut être positif (une
opportunité de marché) ou négatif (un licenciement). Par
conséquent, le comportement entrepreneurial dépend alors de trois
facteurs : la perception de la désirabilité du comportement, la
perception de la faisabilité du comportement et la propension à
agir.
Ce modèle se base sur le postulat que les individus ont
tendance à maintenir un certain équilibre entre leurs rôles
sociaux et leurs activités habituelles, sauf si un
événement vient les déplacer de leur trajectoire.
Il s'agit donc d'un modèle situationnel qui met
l'accent sur le rôle des circonstances qui précèdent le
comportement. Le modèle peut être représenté par le
schéma suivant :
E D x F x P I B
Où :
I E est l'événement
déclencheur, c'est-à-dire la situation qui vient perturber
l'équilibre existant et qui crée une opportunité ou une
nécessité d'entreprendre.
I D est la perception de la
désirabilité du comportement, c'est-à-dire le degré
auquel l'individu considère que le comportement entrepreneurial est
attrayant, basée sur ses valeurs personnelles et sociales.
I F est la perception de la
faisabilité du comportement, c'est-à-dire le degré auquel
l'individu croit que le comportement entrepreneurial est réalisable,
basée sur ses compétences personnelles et les ressources
disponibles.
I P est la propension à agir,
c'est-à-dire la tendance de l'individu à passer à l'action
en fonction de ses intentions, basée sur sa personnalité et son
environnement.
I J est l'intention comportementale,
c'est-à-dire la probabilité subjective qu'un individu adopte un
comportement donné.
I B est le comportement réel,
c'est-à-dire l'action effective réalisée par
l'individu.
Le modèle de la formation de l'événement
entrepreneurial permet donc d'expliquer
comment un événement
déclencheur influence la perception de la désirabilité, de
la
11
faisabilité et de la propension à agir, qui
à leur tour influencent l'intention et le comportement
entrepreneurial.
Il a été appliqué dans divers domaines,
dont l'entrepreneuriat social, collectif ou coopératif.
4) Le modèle de l'événement
entrepreneurial (Krueger, 1993)
Le modèle de l'événement entrepreneurial
reprend les éléments du modèle de Shapero et Sokol en les
intégrant dans le cadre de la théorie du comportement
planifié. Il met en évidence le rôle des croyances
personnelles et des influences environnementales sur l'intention
entrepreneuriale.
En effet, ce modèle se base sur le postulat que les
individus agissent de manière planifiée et intentionnelle, en
tenant compte des informations dont ils disposent et des conséquences
possibles de leur action.
Il s'agit donc d'un modèle cognitif qui met l'accent
sur le processus de décision qui précède le comportement.
Le modèle peut être représenté par le schéma
suivant :
E D x F x P Ic = â1 Ac + â2 Ns + â3
Cp
Cf = á1 Cp + á2 Ro Br = y1 Ic + y2
Cf
Où :
I E est
l'événement déclencheur, c'est-à-dire la situation
qui vient perturber l'équilibre existant et qui crée une
opportunité ou une nécessité d'entreprendre.
I D est la perception de la
désirabilité du comportement, c'est-à-dire le degré
auquel l'individu considère que le comportement entrepreneurial est
attrayant, basée sur ses valeurs personnelles et sociales.
I F est la perception de la
faisabilité du comportement, c'est-à-dire le degré auquel
l'individu croit que le comportement entrepreneurial est réalisable,
basée sur ses compétences personnelles et les ressources
disponibles.
I P est la propension
à agir, c'est-à-dire la tendance de l'individu à passer
à l'action en fonction de ses intentions, basée sur sa
personnalité et son environnement.
I Ic est l'intention
comportementale, c'est-à-dire la probabilité subjective qu'un
individu adopte un comportement donné.
I Ac est l'attitude
comportementale, c'est-à-dire l'évaluation globale du
comportement par l'individu, basée sur ses croyances sur les
conséquences du comportement et sur ses évaluations de ces
conséquences.
I Ns est la norme
subjective, c'est-à-dire la perception par l'individu que les personnes
importantes pour lui approuvent ou désapprouvent le comportement,
basée sur ses croyances normatives et sur sa motivation à se
conformer à ces normes.
I Cp est le contrôle
perçu, c'est-à-dire la perception par l'individu de sa
capacité à réaliser le comportement, basée sur ses
croyances de contrôle et sur la présence ou l'absence de facteurs
facilitants ou inhibants.
12
I Cf est la perception de
la faisabilité du comportement, c'est-à-dire le degré
auquel l'individu croit que le comportement est réalisable, basée
sur ses croyances de faisabilité et sur les ressources et les
opportunités disponibles ou accessibles.
I Ro est un ensemble de
variables externes qui représentent les ressources et les
opportunités nécessaires pour réaliser le comportement,
telles que le temps, l'argent, le matériel, le soutien social, etc.
I Br est le comportement
réel, c'est-à-dire l'action effective réalisée par
l'individu.
I /31, /32, /33, á1,
á2, y1 et y2 sont des coefficients qui expriment
l'importance relative de chaque variable dans la prédiction du
comportement.
Le modèle de Krueger permet donc d'expliquer comment un
événement déclencheur influence la perception de la
désirabilité, de la faisabilité et de la propension
à agir, qui à leur tour influencent l'intention et le
comportement entrepreneurial.
Il intègre aussi les éléments du
modèle de la théorie du comportement planifié, en montrant
comment les attitudes, les normes sociales et le contrôle perçu
affectent l'intention. Il a été appliqué dans divers
domaines, dont l'entrepreneuriat social, collectif ou coopératif.
Ces différents modèles ne sont ni exhaustifs ni
exclusifs, mais ils permettent de mieux comprendre la complexité du
comportement entrepreneurial et ses déterminants. Ils peuvent aussi
aider les entrepreneurs potentiels à identifier leurs motivations, leurs
freins et leurs leviers pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale.
1.1.1.2. Paradigmes sur l'entrepreneuriat
Fayolle et Verstraete (2005) identifient quatre paradigmes qui
permettent de cerner le domaine de la recherche en entrepreneuriat : la
détection, construction, exploitation d'une occasion d'affaire
(opportunité), la création d'une organisation,
la création de valeur et
l'innovation.
1) Paradigme de l'opportunité
d'affaires
Ce paradigme repose sur l'idée selon laquelle
l'entrepreneuriat est un processus de découverte, d'évaluation et
d'exploitation des opportunités. La construction de ce paradigme
s'inspire largement des travaux de Schumpeter (1935) et de Kizner (1973).
Schumpeter souligne l'importance de l'innovation qui constitue
l'entrepreneuriat, tandis que Kizner met en évidence l'importance de la
découverte d'opportunité dans les marches. L'ensemble de ces
travaux ont en commun la mise en évidence de l'entrepreneur comme
étant un acteur à la recherche d'opportunité et de
profit.
Pour Fayolle, l'opportunité entrepreneuriale se
construit au cours du processus de création de l'activité et non
pas qu'elle est le point de départ qu'il faut découvrir de ce
processus.
2) 13
Paradigme de la création d'une
organisation
Selon Gartner (1995), l'entrepreneuriat est un
phénomène qui consiste à créer une nouvelle
entité organisationnelle. Il s'intéresse surtout au concept
d'émergence organisationnelle.
L'auteur différencie le phénomène de
création d'une organisation des autres phénomènes
organisationnels. Il cite Collins et Moore (1964), qui attribuent aux
entrepreneurs la capacité de transformer leurs rêves en action par
la création d'une affaire.
Dans cette perspective, l'étude de l'entrepreneuriat
revient à étudier la naissance de nouvelles organisations,
c'est-à-dire les activités par lesquelles le créateur
mobilise et combine des ressources pour réaliser l'opportunité en
un projet.
Cependant, pour Verstreate (1999), l'entrepreneuriat est vu
comme un système complexe et un type spécifique d'organisation
qui est inspiré par un entrepreneur. Cet entrepreneur agit pour
concrétiser sa vision de cette organisation au sein de la structure.
Il est donc nécessaire d'étudier les
activités permettant à un individu de créer une nouvelle
entité.
3) Paradigme de la création de valeur
La création de valeur consiste, d'une part, à
accroître la productivité de l'entreprise et, d'autre part,
à rechercher une croissance durable et rentable. Elle peut
s'apprécier à travers la capacité de l'entreprise à
effectuer des investissements, plus ou moins risqués, avec une
rentabilité qui est supérieure au coût moyen
pondéré du capital.
En effet, la création de valeur est un thème
central de l'entrepreneuriat. Selon Bruyat, inspiré par les travaux de
Gartner (1993), l'objet d'étude dans le domaine de l'entrepreneuriat est
la relation entre l'individu et la valeur qu'il crée.
L'entrepreneur est un acteur indispensable pour la production
du résultat, et réciproquement, le résultat est une
condition indispensable pour que l'entrepreneur existe.
La création de valeur peut se mesurer à
différents niveaux : économique, social, environnemental,
culturel, etc. Elle implique une transformation des ressources disponibles en
biens ou services plus utiles ou plus désirables pour les parties
prenantes.
Cette création est donc un processus dynamique et
contextuel qui dépend des perceptions et des attentes des acteurs
impliqués.
4)
14
Paradigme de l'innovation
L'innovation constitue le fondement de l'entrepreneuriat,
puisque celui-ci suppose des idées nouvelles pour offrir ou produire de
nouveaux biens ou services, ou encore, pour réorganiser l'entreprise.
Innover, c'est créer une entreprise différente
de ce qu'on connaissait auparavant, c'est découvrir ou transformer un
produit, c'est proposer une nouvelle façon de faire, de distribuer ou de
vendre. (Marchesnay M. , 2008)
L'innovation a été longtemps
négligée par la théorie économique. Parmi les
pionniers qui ont étudié le concept, Schumpeter estime que la
firme innovatrice crée une rupture dans la concurrence car elle dispose
d'un avantage compétitif.
L'entrepreneuriat et l'innovation sont liés depuis que
l'économiste autrichien J. A. Schumpeter a évoqué la force
du processus de destruction créatrice qui caractérise
l'innovation.
La fonction d'innovation est donc essentielle et fait de
l'entrepreneur un acteur du développement économique.
1.1.1.2.1. Relations entre les paradigmes
Les quatre paradigmes sur l'entrepreneuriat sont liés
entre eux par des relations de complémentarité, de
causalité ou de circularité. On peut résumer ces liens de
la façon suivante :
1) L'opportunité d'affaires est le point de
départ de l'entrepreneuriat. Elle consiste à identifier ou
à construire une possibilité de créer de la valeur pour
soi-même et pour les autres en exploitant une innovation ou en
répondant à un besoin non satisfait sur le marché.
2) La création d'une organisation est le processus par
lequel l'entrepreneur mobilise et combine des ressources pour réaliser
l'opportunité d'affaires.
Elle implique la mise en place d'une structure, d'une
stratégie, d'un modèle d'affaires et d'une culture
organisationnelle adaptés à l'environnement et aux objectifs de
l'entrepreneur.
3) La création de valeur est le résultat de
l'entrepreneuriat. Elle correspond à la différence entre les
bénéfices et les coûts générés par
l'exploitation de l'opportunité d'affaires.
Elle se mesure à différents niveaux :
économique, social, environnemental, culturel, etc. Elle dépend
des perceptions et des attentes des parties prenantes : clients, fournisseurs,
employés, actionnaires, etc.
15
4) L'innovation est à la fois une source et une
conséquence de l'entrepreneuriat. Elle consiste à introduire une
nouveauté dans un domaine donné : technique, organisationnel,
commercial, etc.
Elle peut être radicale ou incrémentale, disruptive
ou adaptative, produit ou processus. Elle permet à l'entrepreneur de se
différencier de la concurrence et de créer un avantage
compétitif.
Figure n°1 : Présentation des quatre paradigmes de
l'entrepreneuriat et de leurs relations
|
Paradigme de
l'opportunité
|
1
|
Paradigme de la création d'une organisation
|
|
4
3
6 5
|
Paradigme de
l'innovation
|
|
|
Paradigme de la création de la valeur
|
|
|
|
|
|
Les six relations peuvent être résumées de la
façon suivante :
Première relation
Pour exploiter une opportunité d'affaires, il faut
s'organiser en mobilisant et en combinant des ressources diverses qui donnent
naissance à une organisation (processus et/ou son résultat). Par
exemple, pour créer une entreprise de livraison à domicile, il
faut disposer de véhicules, de personnel, de clients, etc.
Deuxième relation
L'organisation ne peut survivre (et l'entrepreneur garder son
statut par rapport à cette organisation) sans apporter à ses
parties prenantes la valeur qu'elles attendent et dont elle tire les ressources
nécessaires à son fonctionnement. Par exemple, pour
fidéliser ses clients, il faut leur offrir un service de qualité,
rapide et fiable.
Troisième relation
Lorsque la valeur apportée est importante, une
innovation en est souvent à l'origine, qu'elle soit organisationnelle,
technique ou commerciale.
16
Moins radicalement, si l'on adopte une approche relative de
l'innovation et de la nouveauté, l'organisation née du
phénomène entrepreneurial est nouvelle (même si elle
s'appuie sur une entité préexistante).
La valeur apportée est donc nouvelle (nouvelle parce
que venant d'une nouvelle organisation, ou plus radicalement cette fois-ci
parce que résultant d'une offre originale). Par exemple, Uber a
innové en proposant une nouvelle façon de se déplacer en
utilisant une plateforme numérique.
Quatrième relation
Une innovation peut correspondre à la construction
d'une opportunité mise sur le marché (on peut voir l'innovation
aussi comme un processus de socialisation d'une nouvelle technique,
organisation ou façon de commercer), à la fourniture d'un nouveau
produit ou service (nouveauté radicale ou nouveauté pour la
population localement desservie).
Aussi, elle peut correspondre à l'apparition d'une
organisation nouvelle au sein du marché ou du secteur. Par exemple,
Airbnb a innové en créant une opportunité de partager son
logement avec des voyageurs.
Cinquième relation
Toute exploitation d'une innovation, à l'instar d'une
opportunité, appelle une organisation et l'existence de celle-ci
favorise les interactions créatives nécessaires à
l'innovation. Par exemple, Google a innové en développant un
moteur de recherche performant et en créant une organisation qui
encourage la créativité de ses employés.
Sixième relation
Une opportunité n'est exploitée que si elle est
perçue comme susceptible de dégager de la valeur au moins pour
celui qui l'identifie. L'identification peut renvoyer à la
détection, à la construction ou à la combinaison des deux.
Par exemple, Steve Jobs a identifié une opportunité en voyant le
potentiel du Macintosh.
1.1.2. Quelques repères théoriques
Parmi les principales théories sur l'entrepreneuriat, on
peut citer :
1) La théorie de Cantillon
(1755)
Cette théorie est une théorie économique
qui attribue à l'entrepreneur le rôle de preneur de risque et de
gestionnaire de l'incertitude. Selon l'auteur, l'entrepreneur est celui qui
achète des biens à un prix certain pour les revendre à un
prix incertain.
L'entrepreneur est donc exposé aux fluctuations du
marché et doit anticiper la demande des consommateurs. Il est aussi
celui qui crée de la valeur en combinant les
17
facteurs de production (terre, travail et capital) de
manière efficace et innovante. Enfin, il est celui qui contribue
à l'équilibre économique en ajustant l'offre à la
demande.
En effet, cette théorie s'inscrit dans la tradition de
l'école classique d'économie, qui considère que le
marché est régi par un ordre naturel et que la monnaie est
neutre. Cantillon reconnaît que tous les secteurs d'activité
peuvent être productifs, à condition qu'ils soient dirigés
par des entrepreneurs compétents et dynamiques.
De plus, cette théorie a été reprise et
développée par d'autres économistes, notamment Say et
Schumpeter.
Pour sa part, Say a généralisé le terme
d'entrepreneur dans la plupart des langues. Schumpeter de son
côté, a souligné le rôle de l'entrepreneur comme
agent de destruction créatrice, c'est-à-dire comme celui qui
bouleverse l'ordre économique existant en introduisant des innovations
radicales.
2) La théorie de Say
(1803)
La théorie entrepreneuriale de Say est une
théorie économique qui met en avant le rôle de
l'entrepreneur comme agent de production, d'innovation et de coordination. Elle
s'inscrit également dans la tradition de l'école classique
d'économie, qui considère que l'offre crée sa propre
demande (loi de Say) et que la monnaie est neutre.
Selon l'auteur, l'entrepreneur est, d'une part, celui qui
combine les facteurs de production (terre, travail et capital) pour
créer des biens et des services qui répondent aux besoins des
consommateurs. D'autre part, L'entrepreneur est aussi celui qui prend des
risques et assume les incertitudes liées à son
activité.
Enfin, l'entrepreneur est celui qui contribue au
progrès technique et à la croissance économique en
introduisant des innovations dans les produits, les procédés ou
les marchés.
Comme Cantillon, Say reconnaît que tous les secteurs
d'activité peuvent être productifs, à condition qu'ils
soient dirigés par des entrepreneurs compétents et dynamiques.
Aussi, cette théorie a été reprise et
développée par d'autres économistes, notamment Schumpeter.
Elle a aussi inspiré des courants plus récents, comme
l'école autrichienne d'économie, qui met l'accent sur le
processus de découverte entrepreneuriale dans un contexte d'incertitude
et de concurrence imparfaite.
3) La théorie de Schumpeter
(1911)
Cette théorie est une analyse classique de la
société capitaliste qui met en évidence le rôle de
l'innovation et de l'entrepreneur dans le changement et le développement
économiques.
18
En effet, Schumpeter affirme que l'économie est un
mécanisme naturel d'autorégulation qui n'est perturbé que
par les interventions sociales et autres. Il soutient que, malgré leurs
faiblesses, les théories économiques sont fondées sur la
logique et fournissent une structure pour comprendre les faits.
Avançant dans ses analyses, l'auteur montre qu'il
existe des principes sous-jacents dans les phénomènes de la
monnaie, du crédit et du profit entrepreneurial qui complètent
ses théories antérieures sur l'intérêt et le cycle
économique.
Schumpeter, un des premiers à défendre
l'idée du profit entrepreneurial comme source de progrès
technique et de croissance, est celui qui a introduit le concept de «
destruction créatrice » pour désigner le processus par
lequel une innovation entraîne la disparition des anciennes entreprises
et la création de nouvelles.
Enfin, pour l'auteur, les phases de prospérité
et de récession sont inévitables dans une économie en
développement et ne peuvent être supprimées ou
corrigées sans entraver la création de nouvelles richesses par
l'innovation.
4) La théorie de Knight
(1921)
La théorie entrepreneuriale de Knight est une approche
originale de l'entrepreneuriat qui met l'accent sur la notion d'incertitude.
Selon lui, il existe deux types de risques dans l'économie : le risque
assurable, qui peut être mesuré et anticipé, et le risque
d'entreprise, qui est imprévisible et non quantifiable.
Dans cette théorie, l'entrepreneur est celui qui
accepte de faire face au risque d'entreprise, en prenant des décisions
sans connaître les conséquences possibles. Il assume ainsi la
responsabilité de l'innovation et du changement, et reçoit en
échange le profit, qui est la récompense de son audace et de sa
créativité.
Knight considère que l'entrepreneur est un agent
essentiel du progrès économique et social, car il introduit de la
nouveauté et de la diversité dans le système.
5) La théorie de Kirzner
(1973)
Cette théorie entrepreneuriale est une contribution
majeure à la tradition économique autrichienne, qui met en
évidence le rôle de l'entrepreneur comme découvreur
d'opportunités de marché.
Selon Kirzner, l'entrepreneur est celui qui perçoit les
déséquilibres entre l'offre et la demande, et qui agit pour les
corriger en créant de la valeur. L'entrepreneur n'est pas un innovateur
radical comme chez J. A. Schumpeter, mais un arbitre qui exploite les
écarts de prix entre les marchés.
L'entrepreneur, affirme-t-il, n'assume pas de risque, mais
profite de son alertness, c'est-à-dire de sa capacité à
saisir les opportunités que les autres agents ignorent ou
19
négligent. L'entrepreneur est donc le moteur du processus
de marché, qui tend vers l'équilibre grâce à son
action.
6) La théorie de Gartner
(1988)
La théorie entrepreneuriale Gartner est une perspective
qui considère l'entrepreneuriat comme un processus d'émergence
organisationnelle, plutôt que comme une caractéristique
individuelle ou une opportunité de marché.
Selon l'auteur, l'entrepreneur n'est pas un type particulier
de personne, mais un rôle qui peut être joué par
différents acteurs dans différentes situations. L'entrepreneur
est celui qui initie, organise et gère une nouvelle entreprise, en
mobilisant des ressources et en interagissant avec divers environnements.
Ainsi, l'entrepreneuriat est, dans cette théorie, le
résultat d'un ensemble d'activités qui visent à
créer et à maintenir une organisation viable.
Gartner propose quatre dimensions pour analyser le processus
entrepreneurial : les caractéristiques de l'individu, le contexte
environnemental, l'organisation créée et le processus
lui-même.
Il est une évidence que ces théories ne sont pas
exclusives mais complémentaires, car elles éclairent
différentes facettes du phénomène entrepreneurial.
1.1.3. Entrepreneuriat des jeunes
Le rôle capital que joue l'entrepreneuriat des jeunes en
tant que levier du développement économique et de la
création de l'emploi est de plus en plus saisi.
Dans les pays en voie de développement comme la R.D.C,
l'importance de la création d'entreprise et de l'auto-emploi est
fondamentale pour toute la dynamique de développement. Elle est une
source essentielle de la production de la richesse et de la lutte contre le
chômage et le sous-emploi.
A l'ère actuelle où l'entrepreneuriat des jeunes
est valorisé par une majorité, les jeunes veulent de plus en plus
être maîtres de leur propre destin. Par conséquent, seul un
faible pourcentage d'entre eux s'aventure à créer une entreprise,
le goût du risque et d'aventure entrepreneurial devenant
limité.
La littérature sur les jeunes entrepreneurs est
généralement cadrée sur les obstacles qu'ils rencontrent.
Il existe peu d'études qui permettent de comprendre la situation
entrepreneuriale de cette catégorie et de faciliter les actions visant
à la promouvoir.
Cependant, le rôle crucial que joue l'entrepreneuriat
des jeunes comme moteur du développement économique et de la
création d'emplois reste méconnu.
20
Dans les pays en développement, la création
d'entreprise et l'auto-emploi sont vitaux pour la dynamique de
développement. Ils sont une source essentielle de production de richesse
et de lutte contre le chômage et le sous-emploi.
De ce qui précède, certains chercheurs ont
suggéré qu'il faut encourager les jeunes à se lancer dans
les affaires, en considérant cette carrière comme un choix
professionnel.
Cependant, il faut reconnaître qu'il y a un manque
d'information et de compréhension sur les prédispositions
entrepreneuriales des jeunes, sur leur processus d'entreprendre, ainsi que sur
les problèmes qu'ils rencontrent.
1.1.3.1. Définition du jeune
entrepreneur
Tableau n° 01 : Quelques définitions du concept
jeune entrepreneur selon les écoles de pensée.
|
Appellations des écoles
|
Courants de
recherche
|
Définitions du jeune
entrepreneur
|
Auteurs de
référence
|
|
École économique
|
Approche
comportementale
|
Un jeune entrepreneur est spécialisé dans la prise
intuitive de décisions réfléchies relatives à la
coordination de ressources.
|
Casson (1991)
|
|
École
comportementale
|
Approche
comportementale
|
Le jeune entrepreneur se définit par l'ensemble des
activités qu'il met en organisation.
|
Gartner (1988)
|
|
École
psychologique avec les courants
personnalistes et
cognitifs
|
Approche déterministe
|
Le jeune entrepreneur se définit par un certain nombre
d'attributs psychologiques que l'on décrit autant par la
personnalité que par les processus cognitifs activés pour la
circonstance.
|
Shaver & Scott (1991)
|
|
École des
processus
|
Approche
comportementale
|
Le jeune entrepreneur est celui qui développe des
opportunités et crée une organisation pour les exploiter.
|
Bygrave & Hofer (1991)
|
Source : Noël & Madoui, (2011)
21
1.1.4. Typologies entrepreneuriales
Les typologies entrepreneuriales sont des classifications des
entrepreneurs selon différents critères, tels que leurs
motivations, leurs caractéristiques personnelles et leurs
stratégies ou leurs modes de gestion.
Ces typologies permettent de mieux comprendre les profils, les
comportements et les performances des entrepreneurs, ainsi que leur
diversité et leur évolution.
Il existe de nombreuses typologies entrepreneuriales dans la
littérature, parmi lesquelles on peut mentionner :
1.1.4.1. La typologie de Carland, Hoy, Boulton, &
Carland (1984)
Ils distinguent quatre types d'entrepreneurs selon leur
orientation vers la croissance et l'innovation : le petit entrepreneur
d'affaires, le gestionnaire d'entreprise, le propriétaire-gestionnaire
et l'entrepreneur.
1) Le petit entrepreneur d'affaires :
c'est celui qui crée ou reprend une petite entreprise,
sans chercher à la faire croître ni à innover. Il se
contente de maintenir son activité et de générer un revenu
suffisant pour sa subsistance. Il n'a pas de vision stratégique ni de
projet ambitieux.
Il est souvent motivé par la nécessité
ou l'indépendance. Il est considéré comme un artisan ou un
commerçant.
2) Le gestionnaire d'entreprise :
il dirige une entreprise de taille moyenne ou grande, en
cherchant à la faire croître mais sans innover. Il se concentre
sur l'optimisation des ressources et la maximisation du profit.
Il a une vision managériale et un projet réaliste.
Il est souvent motivé par le pouvoir
ou le prestige. Il est considéré comme un
administrateur ou un dirigeant.
3) Le propriétaire-gestionnaire
: c'est celui qui possède et gère une
entreprise de petite ou moyenne taille, en cherchant à la faire
croître et à innover. Il se distingue par sa capacité
à combiner les fonctions de propriétaire et de gestionnaire, en
prenant des décisions stratégiques et opérationnelles.
Il a une vision entrepreneuriale et un projet dynamique. Il
est souvent motivé par le défi ou la satisfaction. Il est
considéré comme un créateur ou un développeur.
4) L'entrepreneur : c'est celui qui
crée ou reprend une entreprise, en cherchant à la faire
croître et à innover de façon radicale. Il se distingue par
sa capacité à créer de la valeur, à saisir des
opportunités et à transformer le marché.
Il a une vision innovatrice et un projet
révolutionnaire. Il est souvent motivé par la passion ou la
vision. Il est considéré comme un pionnier ou un leader.
22
1.1.4.2. La typologie de Filion (1990)
Filion propose six types d'entrepreneurs selon leur vision
stratégique : le créateur d'un nouveau concept, le
développeur d'un concept existant, le franchiseur, le franchisé,
le repreneur d'une entreprise existante et le successeur familial.
1) Le créateur d'un nouveau concept
: c'est celui qui invente une nouvelle idée de
produit ou de service, qui répond à un besoin non satisfait ou
qui crée un nouveau marché. Il se distingue par sa
créativité, son originalité et sa capacité à
innover.
Il a une vision claire et ambitieuse de son projet, qu'il
cherche à réaliser avec passion et détermination. Il est
prêt à prendre des risques et à relever des défis.
Il
est souvent considéré comme un pionnier ou un
leader dans son domaine.
2) Le développeur d'un concept existant
: c'est celui qui reprend une idée de produit ou
de service déjà existante, mais qui l'améliore, la modifie
ou la diversifie. Il se distingue par sa capacité à analyser le
marché, à identifier les opportunités et à adapter
son offre aux besoins des clients.
Il a une vision pragmatique et réaliste de son projet,
qu'il cherche à réaliser avec efficacité et
compétitivité. Il est prêt à investir et à se
former pour se différencier de la concurrence. Il est souvent
considéré comme un suiveur ou un imitateur dans son domaine.
3) Le franchiseur : c'est
celui qui crée un concept de produit ou de service original et qui le
propose à d'autres entrepreneurs moyennant une redevance. Il se
distingue par sa capacité à standardiser, à
systématiser et à contrôler son offre.
Il a une vision globale et stratégique de son projet,
qu'il cherche à réaliser avec expansion et rentabilité. Il
est prêt à partager son savoir-faire et à accompagner ses
franchisés. Il est souvent considéré comme un organisateur
ou un formateur dans son domaine.
4) Le franchisé :
c'est celui qui adopte un concept de produit ou de service
créé par un franchiseur moyennant une redevance. Il se distingue
par sa capacité à respecter, à reproduire et à
appliquer le concept du franchiseur.
Il a une vision locale et opérationnelle de son projet,
qu'il cherche à réaliser avec conformité et
qualité. Il est prêt à suivre les directives et les
conseils du franchiseur. Il est souvent considéré comme un
exécutant ou un collaborateur dans son domaine.
5) Le repreneur d'une entreprise existante
: c'est celui qui rachète une entreprise
déjà en activité, soit parce qu'elle est en
difficulté, soit parce que son propriétaire souhaite la
céder. Il se distingue par sa capacité à évaluer,
à négocier et à restructurer l'entreprise.
23
Il a une vision transitoire et évolutive de son projet,
qu'il cherche à réaliser avec redressement ou croissance. Il est
prêt à changer les pratiques et les processus de l'entreprise. Il
est souvent considéré comme un sauveur ou un transformateur dans
son domaine.
6) Le successeur familial :
c'est celui qui hérite ou qui reçoit une entreprise
familiale, soit parce qu'il en est le descendant, soit parce qu'il en est le
conjoint. Il se distingue par sa capacité à s'intégrer,
à perpétuer et à renouveler l'entreprise.
Il a une vision durable et affective de son projet, qu'il
cherche à réaliser avec continuité ou innovation. Il est
prêt à respecter les valeurs et les traditions de l'entreprise. Il
est souvent considéré comme un héritier ou un continuateur
dans son domaine.
1.1.4.3. La typologie de Hisrich & Peters (1998)
Ils identifient cinq types d'entrepreneurs selon leur
motivation principale : le survivant-nécessiteux, le
style-de-vie, le chasseur d'opportunités, le créateur
d'innovations et le constructeur d'empire.
1) Le survivant-nécessiteux :
c'est celui qui crée ou reprend une entreprise par
nécessité, faute d'autres alternatives d'emploi ou de revenu. Il
se contente de survivre et de satisfaire ses besoins de base. Il n'a pas de
motivation particulière ni de projet ambitieux.
Il est souvent confronté à des
difficultés financières, sociales ou environnementales. Il est
considéré comme un entrepreneur par défaut ou par
contrainte.
2) Le style-de-vie : c'est
celui qui crée ou reprend une entreprise par choix, pour avoir plus de
liberté, de flexibilité et de satisfaction personnelle. Il
cherche à concilier son activité professionnelle avec ses
intérêts, ses valeurs et son mode de vie. Il n'a pas de motivation
financière ni de projet de croissance.
Il est souvent attiré par des secteurs
créatifs, artistiques ou récréatifs. Il est
considéré comme un entrepreneur par passion ou par plaisir.
3) Le chasseur d'opportunités :
c'est celui qui crée ou reprend une entreprise par
opportunité, en exploitant un avantage concurrentiel, un créneau
de marché ou une demande insatisfaite. Il cherche à maximiser son
profit et sa performance. Il a une motivation économique et un projet
réaliste.
Il est souvent doté d'un sens des affaires, d'une
capacité d'adaptation et d'un réseau relationnel. Il est
considéré comme un entrepreneur par calcul ou par
stratégie.
4)
24
Le créateur d'innovations :
c'est celui qui crée ou reprend une entreprise par
innovation, en développant un nouveau produit, un nouveau service ou un
nouveau procédé. Il cherche à créer de la valeur et
à se différencier. Il a une motivation créative et un
projet novateur.
Il est souvent doté d'une vision, d'une
capacité d'invention et d'un esprit pionnier. Il est
considéré comme un entrepreneur par vision ou par rupture.
5) Le constructeur d'empire : c'est
celui qui crée ou reprend une entreprise par ambition, en visant
à dominer le marché, à étendre son activité
ou à créer un groupe. Il cherche à accroître sa
puissance et son influence. Il a une motivation politique et un projet
expansionniste.
Il est souvent doté d'un leadership, d'une
capacité de négociation et d'un esprit conquérant. Il est
considéré comme un entrepreneur par pouvoir ou par domination.
1.1.4.4. La typologie de Meyer (2005)
Meyer classe les entrepreneurs en trois catégories
selon leur rapport au territoire : l'entrepreneur local,
l'entrepreneur régional et l'entrepreneur global.
1) L'entrepreneur local :
c'est celui qui crée ou reprend une entreprise dans un territoire
donné, en s'appuyant sur les ressources et les acteurs locaux. Il
cherche à s'intégrer dans le tissu économique et social du
territoire, à répondre aux besoins locaux et à contribuer
au développement local.
Il a une vision territoriale et un projet ancré. Il
est souvent motivé par l'attachement au territoire, la proximité
avec les clients et les partenaires, ou la
qualité de vie. Il est considéré comme un
acteur local ou un citoyen engagé.
2) L'entrepreneur régional
: c'est celui qui crée ou reprend une entreprise
dans un territoire donné, mais qui cherche à se développer
au-delà des frontières locales, en s'ouvrant à d'autres
marchés et à d'autres réseaux. Il cherche à se
diversifier, à se spécialiser et à se
différencier.
Il a une vision régionale et un projet
évolutif. Il est souvent motivé par la recherche de nouvelles
opportunités, la compétitivité, ou la croissance. Il est
considéré comme un acteur régional ou un entrepreneur
dynamique.
3) L'entrepreneur global :
il crée ou reprend une entreprise dans un territoire donné,
mais qui cherche à se positionner sur le marché mondial, en
s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication, les
réseaux internationaux et les stratégies d'alliance. Il cherche
à innover, à conquérir et à dominer.
25
Il a une vision globale et un projet ambitieux. Il est souvent
motivé par la vision, la passion, ou le pouvoir. Il est
considéré comme un acteur global ou un leader mondial.
1.1.4.5. La typologie de Leclair (2014)
Leclair élabore une typologie des entrepreneures selon
le genre (typologie féminine), en distinguant quatre types :
l'entrepreneure innovante, l'entrepreneure opportuniste, l'entrepreneure
traditionnelle et l'entrepreneure sociale.
1) L'entrepreneure innovante :
c'est celle qui crée une entreprise par innovation, en
développant un nouveau produit, un nouveau service ou un nouveau
procédé. Elle se distingue par sa créativité, sa
vision et sa capacité à innover.
Elle cherche à créer de la valeur et à
se différencier. Elle a une motivation créative et un projet
novateur. Elle est souvent attirée par les secteurs de pointe,
technologiques ou scientifiques et est considérée comme une
pionnière ou une leader dans son domaine.
2) L'entrepreneure opportuniste
: c'est celle qui crée une entreprise par
opportunité, en exploitant un avantage concurrentiel, un créneau
de marché ou une demande insatisfaite. Elle se distingue par son sens
des affaires, son analyse et sa capacité à saisir les
opportunités.
Elle cherche à maximiser son profit et sa performance.
Elle a une motivation économique et un projet réaliste. Elle est
souvent attirée par les secteurs porteurs, dynamiques ou rentables et
est considérée comme une calculatrice ou une stratège dans
son domaine.
3) L'entrepreneur traditionnelle
: c'est celle qui crée une entreprise par choix,
pour avoir plus de liberté, de flexibilité et de satisfaction
personnelle. Elle se distingue par son style de vie, ses valeurs et sa
capacité à concilier son activité professionnelle avec ses
intérêts personnels.
Elle cherche à maintenir son activité et
à générer un revenu suffisant pour sa subsistance. Elle a
une motivation affective et un projet ancré. Elle est souvent
attirée par les secteurs traditionnels, artisanaux ou familiaux. Elle
est considérée comme une passionnée ou une épanouie
dans son domaine.
4) L'entrepreneur social :
c'est celle qui crée une entreprise par conviction, pour
répondre à un besoin social, environnemental ou solidaire. Elle
se distingue par son altruisme, son engagement et sa capacité à
créer du lien social.
Elle cherche à avoir un impact positif sur la
société et à contribuer au
développement
durable. Elle a une motivation éthique et un projet altruiste. Elle
26
est souvent attirée par les secteurs sociaux,
écologiques ou humanitaires. Elle est considérée comme une
militante ou une citoyenne engagée dans son domaine.
Cette approche typologique renvoie à des critères
et à des dimensions qui constituent, d'une certaine façon, des
facteurs essentiels de compréhension des entrepreneurs.
Ces typologies, rappelons-le, ne sont ni exhaustives ni
définitives, car elles peuvent varier selon les contextes et les
époques. Elles offrent néanmoins des outils d'analyse utiles pour
appréhender la complexité et la richesse de l'entrepreneuriat.
1.1.5. Formes de l'entrepreneuriat
L'entrepreneuriat peut prendre différentes formes, selon
le type d'activité, le mode de création et le statut juridique de
l'entreprise.
Parmi ces formes nous pouvons mentionner :
1) Création d'une nouvelle entreprise
: il s'agit de créer une entreprise à partir d'une
idée originale ou d'un besoin non satisfait. L'entreprise peut
être :
V' Traditionnelle : elle propose
une activité connue et répétitive, comme un commerce, un
artisanat ou un service.
V' Technologique et innovante :
elle développe une nouvelle technologie ou un nouveau produit, comme une
entreprise technologique (technopreneuriat), une entreprise d'internet et de
e-commerce (cyber entrepreneuriat) ou une entreprise verte (ecopreneuriat).
La création d'une nouvelle entreprise peut concerner
des structures de différentes tailles, comme les petites et
microentreprises, le travail indépendant, les PME ou les grandes
entreprises.
2) Création d'une entreprise par franchise
: il s'agit de créer une entreprise en
bénéficiant du savoir-faire, de la marque et du réseau
d'une entreprise déjà existante, appelée franchiseur. Le
créateur, appelé franchisé, doit respecter le contrat de
franchise et verser des redevances au franchiseur.
3) Reprise, cession et transmission d'entreprises
: il s'agit de reprendre une activité ou une entreprise
déjà existante. Le créateur, appelé repreneur,
peut-être une personne physique ou morale. Il peut reprendre une PME, une
start-up ou même une grande entreprise.
Cependant, le repreneur doit évaluer la valeur de
l'entreprise, négocier les conditions de la reprise et financer
l'opération. Il peut choisir de reprendre la société en
cours ou de créer une nouvelle société.
4)
27
Entrepreneuriat organisationnel ou intrapreneuriat
: il concerne le développement des pratiques et des
comportements entrepreneuriaux à l'intérieur d'une grande
entreprise.
Le salarié qui initie et réalise un projet
innovant au sein de son entreprise est appelé intrapreneur. Il
bénéficie du soutien et des ressources de son employeur.
5) Entrepreneuriat coopératif ou collectif
: il s'agit de créer ou de gérer une entreprise
basée sur les principes de la coopération, de la participation et
de la solidarité. Les salariés sont associés aux
décisions et aux résultats de l'entreprise.
Les exemples d'entreprises coopératives et collectives
sont les sociétés
coopératives (SCOP, SCIC), les associations, les
mutuelles ou les fondations.
6) Entrepreneuriat solidaire et social : il
est centré sur la création ou le développement d'une
organisation à but non lucratif qui vise à répondre
à un besoin social ou environnemental. L'objectif n'est pas le profit
mais l'intérêt général ou la défense d'une
cause.
Les exemples d'entreprises solidaires et sociales sont les
entreprises d'insertion, les entreprises adaptées, les associations
caritatives ou les ONG.
1.1.6. Motivations et freins à
l'entrepreneuriat
Les motivations et les freins sont les facteurs qui incitent
ou découragent les individus à se lancer dans l'entrepreneuriat.
Ils peuvent être de nature personnelle, professionnelle, sociale ou
environnementale.
1.1.6.1. Motivations
La littérature met en exergue deux grandes approches
regroupant les principales théories sur les motivations
entrepreneuriales :
1) Le premier courant concerne le traitement des traits et
attributs poussant les individus à se lancer dans l'entrepreneuriat. On
y trouve des motivations comme le désir d'accomplissement, le
comportement de prise de risque, les ambitions, le désir
d'indépendance ainsi que la prise de responsabilité.
2) Le second est axé sur les facteurs liés
à l'environnement.
Carsrud & Brännback
(2009), ressortissent deux théories sur la motivation
entrepreneuriale : la drive theory et l'incentive theory.
ü La drive theory :
cette théorie suppose qu'un individu est motivé à
démarrer une nouvelle affaire par suite d'un besoin interne tel que
celui de la réalisation (de soi).
28
V' L'incentive theory : cette
dernière suggère que les gens sont motivés à
entreprendre en raison de certaines récompenses externes comme le revenu
ou le prestige.
De leur côté, Buttner &
Moore (1997), parlent plutôt des Pull and Push
factors.
V' Les Pull factors : ces facteurs
supposent que les personnes qui lancent leurs propres affaires peuvent
être inspirées par des raisons souhaitables, notamment l'aptitude
à saisir une opportunité et à travailler de manière
indépendante et/ou disposer d'un meilleur contrôle du travail
(Robichaud et al., 2010).
V' Les Push factors : il s'agit des
facteurs qui sont souvent liés à une situation contraignante
ou imposante due aux difficultés que l'individu rencontre sur le
marché du travail (Amit & Muller, 1995), voire les pressions
familiales subies (Verheul & al., 2010).
1.1.6.2. Freins ou obstacles
Il existe une littérature abondante qui cherche
à identifier les principales barrières à l'entrepreneuriat
des jeunes.
En effet, cette littérature mentionne plusieurs
obstacles qui empêchent les jeunes de passer de l'étape de
l'intention entrepreneuriale à la concrétisation de leur projet.
Certains d'entre eux concernent l'entrepreneuriat de façon
générale, tandis que d'autres sont propres à
l'entrepreneuriat des jeunes.
Parmi les principaux freins à l'entrepreneuriat, on peut
mentionner :
V' Le manque de temps : il empêche les
individus de se consacrer pleinement à leur projet entrepreneurial,
surtout s'ils ont déjà un emploi ou des responsabilités
familiales ;
V' Le manque de financement : il limite les
capacités des individus à investir dans leur entreprise et
à faire face aux dépenses liées au démarrage et au
développement de l'activité ;
V' Les lourdeurs administratives : ceux-ci
découragent les individus par la complexité et la longueur des
démarches nécessaires pour créer et gérer une
entreprise ;
V' Le risque d'échec : il qui effraie les
individus qui craignent de perdre leur investissement, leur
sécurité financière ou leur réputation en cas de
faillite ou de difficultés ;
V' Le manque de compétences ou de confiance en soi
: il freine les individus qui se sentent insuffisamment
préparés ou qualifiés pour entreprendre.
29
En ce qui touche particulièrement les jeunes, nous
retrouvons les pensées des auteurs tels que :
Schoof (2006), qui identifie cinq groupes de
variables clés qui influent sur l'entrepreneuriat des jeunes et qui
peuvent, en considération de leur importance, constituer des
barrières à la création d'entreprises.
Il s'agit :
1) Des attitudes sociales et culturelles
vis-à-vis de l'entrepreneuriat des jeunes.
L'entrepreneuriat des jeunes est influencé par les
attitudes sociales et culturelles. Les valeurs culturelles peuvent encourager
ou décourager l'entrepreneuriat des jeunes. Comme certaines
sociétés détestent le risque et les situations
incertaines, dans celles-ci (sociétés), la faillite d'une
entreprise étant mal perçue.
Par conséquent on n'ose pas entreprendre une
activité qui pourrait mettre à risque d'échouer, alors que
dans d'autres sociétés, l'échec est
considéré comme normal, car il constitue l'un des
résultats du processus d'apprentissage. Les sociétés
individualistes seraient également plus entreprenantes que d'autres.
De plus, l'entrepreneuriat des jeunes est aussi
influencé par la perception qu'on en a et par sa légitimation
sociale. Dans certaines communautés, l'entrepreneuriat a mauvaise
réputation et n'est pas facilement accepté, car les entrepreneurs
sont vus comme malhonnêtes, cupides et prêts à tout pour
réussir.
L'entourage du jeune entrepreneur joue également un
rôle important. Le fait d'avoir un parent entrepreneur ou qui travaille
à son propre compte constitue souvent un facteur de motivation à
l'entrepreneuriat (Blanchflower & Oswald, 2007).
2) De l'éducation entrepreneuriale.
Les facteurs sociaux sont souvent renforcés par un
système éducatif dont le modèle consiste parfois à
privilégier l'emploi salarié au détriment du travail
autonome ou de la création d'entreprise.
Ainsi, dans beaucoup de pays, les jeunes ne reçoivent
aucune formation entrepreneuriale durant leurs études. Dans ces
conditions, ils n'ont pas la bonne attitude envers l'entrepreneuriat et ils
manquent de compétences dans ce domaine.
L'éducation entrepreneuriale permet aux jeunes
d'acquérir des compétences entrepreneuriales, de comprendre ce
qu'est l'entrepreneuriat et de l'envisager comme un choix de carrière.
Elle permet donc d'améliorer la propension des jeunes à
créer leur propre entreprise (Brixiová, Ncube, & Bicaba,
2014).
30
Il est communément admis que les programmes
d'éducation et de formation ne promeuvent pas suffisamment le
développement d'attitudes et de compétences entrepreneuriales,
mais se contentent de préparer les étudiants à un emploi
salarié, bien que des progrès aient été
réalisés récemment dans ce domaine (Potter, 2008).
3) Des problèmes d'accès aux
sources de financement. Les jeunes ne disposent pas de ressources
financières suffisantes pour se lancer en affaires. D'une part, ils
n'ont pas assez d'épargne et manquent de capital physique. D'autre part,
ils ont beaucoup de mal à obtenir du financement, notamment
auprès des banques.
Par rapport aux banques, pour accorder des crédits,
celles-ci se fondent notamment sur l'historique de crédit du demandeur
et sur les hypothèques. Or, les jeunes n'ont aucune expérience de
crédit et ne disposent pas souvent des garanties que l'on doit offrir
à la banque.
4) Du cadre administratif et
réglementaire. Les jeunes entrepreneurs font face à
la complexité et au coût très élevé des
procédures administratives et de la réglementation.
Dans beaucoup des pays, surtout en phase de
développement, les procédures d'enregistrement sont longues, le
cadre administratif et réglementaire manque de transparence et le
système fiscal n'est pas très encourageant.
Ces barrières administratives et réglementaires
découragent souvent les jeunes à entreprendre ou les contraints
à évoluer dans le secteur informel de l'économie.
5) Du manque d'aide et d'appui en affaires.
De ce qui précède, on constate que les jeunes
entrepreneurs ont besoin d'appui et d'accompagnement pour faire face aux
obstacles qui se dressent sur leur route.
Pour sa part, Halabisky (2012), met l'accent
dans son étude sur trois autres facteurs, à savoir :
1) Le manque d'expérience.
L'expérience est un déterminant important dans la
création et la gestion d'une entreprise. Or, très souvent, les
jeunes manquent d'expérience sur le plan entrepreneurial et n'ont jamais
travaillé. Nombreux n'ont connu que le chômage.
Dans ces conditions, les jeunes n'ont pas les
compétences techniques et managériales nécessaires pour
réussir la création d'une entreprise et en assurer la gestion.
Pourtant, l'expérience professionnelle et entrepreneuriale
antérieure est l'un des principaux facteurs qui déterminent le
succès d'une entreprise.
2) Le manque de réseaux. Les
jeunes ont un accès limité aux réseaux d'affaires et
disposent de peu de capital social, ce qui rend difficiles les relations avec
les autres acteurs et ne favorise pas leurs activités
entrepreneuriales.
31
Un manque de relations peut compliquer la création et
la gestion d'une entreprise et empêcher les entrepreneurs d'asseoir leur
légitimité auprès des principales parties prenantes
(organismes financiers, clients, fournisseurs).
3) Les obstacles liés aux marchés.
Les jeunes font aussi face à divers obstacles, ils ont du
mal à obtenir du financement et sont parfois victimes de discrimination
sur le marché des biens et services.
Certains clients doutent parfois de la qualité des
produits de jeunes entrepreneurs. Et comme les ressources de ceux-ci sont
limitées, ils se lancent souvent dans des marchés où les
barrières à l'entrée sont faibles et où la
concurrence est très vive.
Par ailleurs, la littérature distingue, de tout ce qui
précède, trois principaux groupes de barrières à
l'entrepreneuriat des jeunes (Dzaka-Kikouta, et al., 2020) :
Primo : des facteurs personnels
liés au profil même des jeunes entrepreneurs :
la peur du risque, le manque d'expérience et le manque de
compétences entrepreneuriales, ainsi que le faible capital financier et
social.
Secundo, des facteurs socioculturels,
notamment l'attitude négative que peut présenter la
société envers l'entrepreneuriat des jeunes et le manque de
soutien familial ou communautaire. Les jeunes sont influencés par leur
famille, leurs professeurs et la société dans son ensemble.
Les parents et les enseignants, qui représentent des
modèles importants, sont souvent peu informés des exigences et
des perspectives de l'entrepreneuriat.
De ce fait, les activités entrepreneuriales sont
rarement encouragées et sont même parfois perçues de
manière négative par la société, ce qui constitue
un obstacle à l'entrepreneuriat des jeunes.
Tertio, des facteurs liés à
l'environnement, tels que les règlements, la fiscalité,
l'accès au financement externe, l'accès aux marchés et le
manque de services de soutien. Certains de ces facteurs, comme l'accès
au financement, sont transversaux, c'est-à-dire qu'ils appartiennent
à plus d'un groupe de facteurs cités ci-dessus.
De même, beaucoup de ces facteurs sont
interdépendants et se renforcent mutuellement. Enfin, la nature et
l'ampleur de ces barrières varient selon le contexte environnemental
local (Schoof, 2006 ; Jakubczak, 2015).
À partir de la liste d'obstacles à
l'entrepreneuriat des jeunes susmentionnée, notamment celle de Schoof
(2006), Jakubczak (2015) a mené une étude pilote auprès de
67 étudiants âgés de 18 à 24 ans pour analyser les
barrières à l'entrepreneuriat des jeunes en Pologne.
Les résultats obtenus ont montré que les trois
quarts des jeunes avaient eu l'intention de créer une entreprise dans un
avenir proche ou lointain, mais que seulement 3 % d'entre eux avaient
effectivement réussi à le faire. Cela tend à
démontrer que l'ampleur des obstacles à l'entrepreneuriat des
jeunes est très élevée dans ce pays.
Par ailleurs, l'enquête a révélé
que les principaux freins à l'entrepreneuriat des jeunes en Pologne sont
les difficultés d'accès au financement ainsi que la
complexité et les coûts élevés des procédures
administratives. À cela s'ajoutent la peur de faire faillite qui
dénote un faible goût pour le risque et une fiscalité peu
motivante.
32
33
CHAPITRE DEUXIEME : METHODOLOGIE ET PRESENTATION DU CADRE
D'ETUDE
Section 1. Méthodologie 1.1.
Collecte des données 1.1.1. Population
cible
La population cible de cette étude est
constituée des jeunes de la commune de la Kanshi, c'est-à-dire
des personnes âgées de 15 à 35 ans. Cependant, la
préférence a été d'aller jusqu'à 34 ans pour
une bonne transparence vis-à-vis des recensements dont dispose le bureau
des statistiques et recouvrement de cette commune.
Il s'agit d'une population hétérogène qui
regroupe des jeunes de différents niveaux d'éducation, genres,
statuts socio-économiques, secteurs d'activité ou de modes de
gestion. La population cible est estimée à 105909 jeunes, sur la
base des données du précité bureau communal.
1.1.2. Enquête
L'enquête est l'outil principal de collecte des
données. Il s'agit d'un ensemble de questions posées aux
individus sélectionnés dans l'échantillon, afin de
recueillir des informations sur leur profil, leur entreprise, leurs
motivations, leurs difficultés, leurs besoins ou leurs attentes.
L'enquête peut être réalisée par
différents moyens, tels que l'interview face-à-face, le
questionnaire, le téléphone, le courrier ou Internet...
1.1.2.1. Méthodes
Nous avons fait usage des méthodes statistiques
descriptives et inférentielles, qui ont permis de traiter, d'analyser et
d'interpréter les données collectées à partir du
questionnaire.
En effet, ces méthodes consistent à
décrire, quantifier et synthétiser les données
récoltées par le calcul de certains paramètres, à
procéder à leur représentation sous forme de graphique,
des tableaux... à leur traitement ainsi qu'à leur
interprétation et à observer le comportement d'un sujet, d'une
personne sans l'influencer d'aucune façon.
Les méthodes statistiques descriptives ont
consisté à calculer les fréquences, les pourcentages, les
moyennes, les écarts-types, etc., des variables et des indicateurs de
notre étude, afin de décrire les caractéristiques, les
tendances, les distributions, etc., des données.
Les méthodes statistiques inférentielles ont
consisté à réaliser des tests du chi-carré, des
tests t, des tests ANOVA, des corrélations, des analyses de cluster,
etc., des variables et des indicateurs de notre étude, afin de tester
les relations, les différences, les regroupements, etc., des
données, et de vérifier notre hypothèse de travail.
34
Nous avons utilisé les logiciels SPSS et Excel pour
effectuer les analyses statistiques et la mise en lumière de certaines
données.
1.1.2.2. Technique
Pour atteindre les objectifs de cette étude, une
technique de recherche quantitative, basée sur un questionnaire
auto-administré auprès d'un échantillon de 381
enquêtés (majoritairement à ceux qui ont déjà
créé ou repris une entreprise), représentant les jeunes de
la commune de Kanshi, a été utilisée.
Cette technique, rappelons-le, consiste à questionner
un ensemble des répondants, le plus souvent représentant d'une
population, par rapport à leurs situations sociales, professionnelles ou
familiales, leurs impressions, leurs attitudes, à l'égard
d'opinions, d'enjeux humains ou sociaux, ou encore sur tout point de vue
intéressant le chercheur.
Elle nous a permis d'assembler des informations auprès
de nos enquêtés par le biais d'un questionnement
opérationnel et orienté.
Le questionnaire a été élaboré
à partir du cadre conceptuel et de l'hypothèse de travail que
nous avons construits grâce à de la revue de
littérature.
Il comportait des questions fermées, à choix
multiples ou à échelle de Likert, qui permettaient de mesurer les
variables et les indicateurs de notre étude. Il a été
administré en face-à-face, en français.
Ce questionnaire était réparti en trois principales
parties dont :
V' Les caractéristiques sociodémographiques du
répondant ; V' L'entrepreneuriat ;
V' Enfin, les obstacles et perspectives.
1.1.3. Échantillonnage
L'échantillonnage est un processus qui consiste
à prélever un certain nombre d'unités statistiques dans la
population de référence afin de mesurer un certain nombre des
critères sur chacune d'elles. Il permet de réduire les
coûts et le temps de l'enquête, tout en garantissant la
représentativité et la fiabilité des résultats.
Il existe deux types d'échantillonnage : probabiliste et
non probabiliste.
L'échantillonnage probabiliste repose sur le principe
du tirage aléatoire, qui donne à chaque individu de la population
cible une chance égale d'être sélectionné.
L'échantillonnage non probabiliste pour sa part, repose sur le choix
délibéré des individus selon des critères
définis par le chercheur.
S'agissant d'une population finie, un échantillonnage
probabiliste a été sélectionné, du fait qu'il
permet de faire une inférence statistique. Il s'agit bien-entendu dans
ce cas, d'un échantillon aléatoire simple.
De ce fait, par contrainte de temps, aussi des moyens
matériels et financiers, un échantillon représentatif a
été tiré en recourant à la formule de Monkey
(2000), qui fait intervenir la taille de la population mère
Z2.
??2 oc.??. q. N
?? ??2 oc.??. q + (N - 1).d2
Où :
Z2 oc = 1,96 est la valeur de standardisation de la
loi normale lorsque la marge d'erreur
oc est de 5% ;
?? = 0, 5 : est la probabilité de réalisation ;
q : 1 - p = 1 - 0,5 = 0,5 : est la probabilité de
non-réalisation ;
d : la marge d'erreur qui est égale à la valeur de
oc ;
N : la taille de la population.
En application de cette formule avec 105909 comme taille de la
population, la taille de l'échantillon se présente comme suit
:
(1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 105909
?? (1,96)2 x 0,5 x 0,5 + (105909 - 1) x (0,05)2
382,7751871821967
Par conséquent, comme la taille de l'échantillon
est calculée sur base de la taille de la population connue N , elle
devra être corrigée par la formule de VAN CERT qui se
présente de la manière suivante :
??
Enfin, la taille de l'échantillon corrigé donnera
:
??a] 1 + (382,7751871821967 - 1)/105909
= 381,40033533379 ? 381
382,7751871821967
35
De cette correction, la taille de l'échantillon n
est de 381 jeunes de la commune de Kanshi, et ce même nombre est
utilisé pour les questionnaires.
Section 2. Présentation du cadre
d'étude
2.1. Contexte économique et social de la
commune de la Kanshi
La commune de la Kanshi est l'une des cinq communes (Bipemba,
Diulu, Muya, Dibindi et Kanshi) qui composent la ville de Mbujimayi, chef-lieu
de la province du Kasaï -Oriental, en République
Démocratique du Congo.
Elle a été créée en 1967 et doit son
nom au ruisseau Kanshi qui la traverse. Elle a une superficie de 28,79km2
et une population estimée à 350131 habitants en fin
2022.
Elle a été au départ divisé en trois
collectivités (secteurs) : Kinkole, Sukisa et N'Sele. Celles-ci sont
passées à quatre en 1973 : Ntalaja, Tshikisha, N'Sele et Dinanga.
Ensuite,
36
l'organisation a changé et la commune de la Kanshi
compte plutôt des quartiers (actuellement 34) repris dans le tableau un
peu plus bas, et plus de 2500 rues.
La commune de la Kanshi est située au sud de la ville
de Mbujimayi, à proximité de la Société
minière de Bakwanga (MIBA), qui exploite le diamant industriel et gemme
dans la région.
La MIBA était le principal employeur et contribuable de
la ville, mais elle traverse une crise financière et sociale depuis
plusieurs années, ce qui affecte l'économie locale et le niveau
de vie des habitants. Cette commune abrite aussi le club MIBA, un espace de
loisirs et de détente, ainsi qu'une pépinière qui produit
des plants d'arbres fruitiers et forestiers.
En effet, cette commune fait face à plusieurs
défis socio-économiques, tels que le chômage, la
pauvreté, l'insécurité, l'insalubrité, le manque
d'infrastructures et de services publics de base.
Selon une étude réalisée en 2015 par le
Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), le taux de
pauvreté dans la commune était de 76,4 %, le taux
d'analphabétisme de 28,9 % et le taux d'accès à l'eau
potable de 19,6 %.
Aussi, la commune souffrait des conséquences des
conflits armés qui ont secoué le pays depuis les années
1990, notamment les violences intercommunautaires, les déplacements
forcés et les violations des droits humains.
2.2. Quelques statistiques
Tableau N° 02 Présentation de la population
juvénile de la commune de Kanshi par tranches d'âge selon les
quartiers
|
Age 15-17 ans
|
18-24 ans
|
25-29 ans
|
|
30-34 ans
|
|
|
QUARTIERS
BANZA TSHILOBO BEL'AIR
BIMPE
BUZALA DUBAÏ
DU PONT EDIMEKOMBA
GOLF
HAUTE TENSION KABEYA MULONZA KANANGA KASAÏ
KASAMAYI
KASHALA BONZOLA
|
G
|
F
|
H
|
F
|
H
|
F
|
H
|
F
|
|
265
|
261
|
243
|
240
|
245
|
204
|
160
|
220
|
|
343
|
349
|
265
|
275
|
231
|
235
|
203
|
217
|
|
1784
|
1602
|
669
|
690
|
786
|
749
|
517
|
515
|
|
406
|
444
|
416
|
445
|
214
|
136
|
12
|
17
|
|
423
|
441
|
410
|
455
|
401
|
411
|
307
|
343
|
|
449
|
507
|
353
|
368
|
256
|
339
|
246
|
313
|
|
143
|
147
|
383
|
386
|
322
|
399
|
346
|
379
|
|
103
|
131
|
326
|
330
|
440
|
411
|
424
|
349
|
|
272
|
321
|
285
|
355
|
258
|
319
|
251
|
288
|
|
232
|
237
|
279
|
295
|
244
|
221
|
239
|
195
|
|
430
|
505
|
440
|
460
|
268
|
282
|
142
|
150
|
|
78
|
62
|
254
|
228
|
64
|
71
|
64
|
68
|
|
448
|
479
|
339
|
361
|
525
|
447
|
403
|
417
|
|
234
|
229
|
251
|
280
|
304
|
288
|
202
|
225
|
|
LUBILANJI LUFALANGA LAMANU LUZUMU META MUDIAYI MUDIBA
MUKUMADI MUTANDA KABUYA MOTONJ MAYAND NJEKA
NSELE
NTUMBA TSHIAPOTA NYONGOLO POLYGONE TSHIATSHIATSHIA TSHIKISHA
TSHIZUBU MM TUBONDO VOLAILLE 1 VOLAILLE 2 TOTAUX
|
450
|
453
|
241
|
261
|
214
|
237
|
241
|
311
|
|
396
|
416
|
760
|
1216
|
318
|
419
|
335
|
404
|
|
158
|
173
|
307
|
453
|
286
|
357
|
372
|
379
|
|
590
|
793
|
502
|
710
|
464
|
507
|
444
|
742
|
|
18
|
28
|
27
|
28
|
30
|
34
|
32
|
43
|
|
1291
|
1135
|
1590
|
1443
|
1098
|
1069
|
750
|
590
|
|
238
|
268
|
398
|
480
|
439
|
391
|
479
|
764
|
|
100
|
112
|
247
|
256
|
260
|
270
|
242
|
251
|
|
404
|
468
|
238
|
299
|
360
|
217
|
371
|
466
|
|
459
|
516
|
951
|
1024
|
970
|
142
|
717
|
744
|
|
191
|
193
|
200
|
220
|
221
|
272
|
87
|
209
|
|
235
|
285
|
260
|
295
|
247
|
266
|
188
|
217
|
|
655
|
537
|
513
|
514
|
415
|
522
|
471
|
420
|
|
78
|
226
|
343
|
369
|
235
|
237
|
275
|
276
|
|
755
|
856
|
266
|
374
|
354
|
274
|
240
|
160
|
|
296
|
348
|
1002
|
1053
|
519
|
595
|
472
|
538
|
|
557
|
566
|
760
|
728
|
377
|
422
|
440
|
400
|
|
238
|
259
|
961
|
978
|
1000
|
999
|
869
|
874
|
|
422
|
265
|
243
|
240
|
245
|
204
|
160
|
220
|
|
175
|
175
|
189
|
133
|
285
|
114
|
185
|
108
|
|
13316
|
13787
|
14911
|
16242
|
12895
|
12060
|
10886
|
11812
|
Source : rapport trimestriel fin 2022, du bureau des statistiques
et recensements de la commune de Kanshi.
37
38
Figure N° 02 Population juvénile par tranches
d'âge selon les quartiers
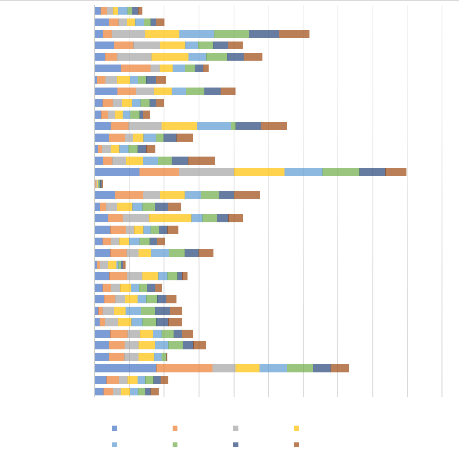
NTUMBA TSHIAPOTA
KASHALA BONZOLA
MUTANDA KABUYA
KABEYA MULONZA
TSHIATSHIATSHIA
MOTONJ MAYAND
BANZA TSHILOBO
HAUTE TENSION
META MUDIAYI
TSHIZUBU MM
EDIMEKOMBA
LUFALANGA
VOLAILLE 2
VOLAILLE 1
MUKUMADI
NYONGOLO
TSHIKISHA
POLYGONE
KASAMAYI
LUBILANJI
TUBONDO
DU PONT
LAMANU
LUZUMU
KANAGA
MUDIBA
BUZALA
BEL'AIR
BIMPE
NSELE
DUBAÏ
NJEKA
KASAÏ
GOLF
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
25-29 ans H 25-29 ans F 30-34 ans H 30-34 ans F
15 à 17 ans G 15 à 17 ans F 18-24 ans H 18-24 ans
F
Tableau N° 03 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi
par genre
|
GENRE
|
|
M
|
52008
|
|
F
|
53901
|
|
TOTAL
|
105909
|
Source : élaboré à partir
du logiciel Excel.
39
Figure N° 03 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par
genre
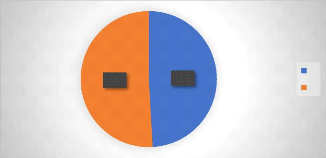
51%
49%
M F
Tableau N° 04 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi
par genre et tranches d'âge
|
Tranche d'âge
|
15-17 ans
|
18-24 ans
|
25-29 ans
|
30-34 ans
|
|
Genre
|
M
|
F
|
M
|
F
|
M
|
F
|
M
|
F
|
|
Total
|
13316
|
13787
|
14911
|
16242
|
12895
|
12060
|
10886
|
11812
|
Source : élaboré à partir
du logiciel Excel.
Figure N° 04 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par
genre et tranches d'âge
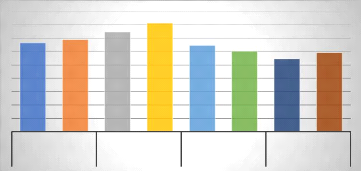
13787
13316
M F
15 À 17 ANS
14911
M F
18-24 ANS
16242
12895
M F
25-29 ANS
12060
10886
M F
30-34 ANS
11812
Tableau N° 05 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi
par tranches d'âge
|
Tranches d'âge
|
Population totale
|
|
15-17 ans
|
27103
|
|
18-24 ans
|
31153
|
|
25-29 ans
|
24955
|
|
30-34 ans
|
22698
|
Source : élaboré à partir
du logiciel Excel.
40
Figure N° 05 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par
tranches d'âge

24%
21%
29%
26%
15 à 17 ans 18-24 ans 25-29 ans 30-34
ans
2.3. Entrepreneuriat des jeunes de la commune de Kanshi
Comme susmentionné, l'entrepreneuriat des jeunes est
une activité qui consiste à créer ou à reprendre
une entreprise par des personnes âgées de 15 à 35 ans. Il
s'agit d'une forme d'insertion socio-économique qui peut contribuer au
développement local, à la création d'emplois, à
l'innovation et à la lutte contre la pauvreté.
Le secteur informel est devenu une source de régulation
pour les opportunités d'emplois tant pour les nouveaux chercheurs
d'emploi que pour les travailleurs recyclés ou reconvertis en
Afrique.
Par suite de la prédominance du secteur informel dans
l'économie congolaise et au manque des structures d'encadrement dans ce
secteur, la situation entrepreneuriale demeurera complexe.
Il sied de noter que l'entrepreneuriat en RDC est
qualifié comme un entrepreneuriat de survie où
l'entrepreneur crée son entreprise par contrainte sociale, par
nécessité et non pour exploiter une opportunité.
Plusieurs lancent d'une manière créative de
petites entreprises ou activités commerciales ou de production,
généralement dans l'économie informelle, pour sortir de la
pauvreté par leurs propres moyens. Cependant, ils le font sans
maîtrise des techniques entrepreneuriales de base ou sans conseils.
En dépit du contexte socio-économique
particulièrement difficile, l'initiative privée autochtone,
à travers les PME et parfois les micros entreprises et l'informel, ont
fait preuve d'un fort esprit d'imagination et de créativité pour
maintenir l'activité économique.
Dans la commune de la Kanshi, l'entrepreneuriat des jeunes est
une réalité qui se manifeste à travers divers secteurs
d'activité, tels que le commerce, l'artisanat, l'agriculture, etc.
Ces jeunes entrepreneurs sont motivés par des facteurs
tels que le besoin de sortir du chômage, le besoin d'indépendance
financière, la passion pour une activité ou l'opportunité
du marché. Un bon nombre fait preuve de créativité,
d'adaptabilité et de résilience face aux difficultés qu'il
rencontre.
Toutefois, l'entrepreneuriat des jeunes dans cette commune est
confronté à plusieurs obstacles qui limitent son potentiel et sa
durabilité. Parmi ces obstacles, on peut citer : le manque de
financement, le manque de formation, le risque d'échec, le manque de
compétences, le faible accès aux marchés ou aux
réseaux professionnels, etc.
Ces obstacles nécessitent des solutions adaptées
qui impliquent les acteurs publics, privés et associatifs, ainsi que les
jeunes eux-mêmes.
41
42
CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE DES DONNEES ET
INTERPRETATION DES RESULTATS
Section 1. Analyse des données 1.1.
Profil des répondants
Le profil des répondants est une description
statistique des caractéristiques sociodémographiques des
individus qui ont participé à l'enquête. Il permet de
connaître la composition et la représentativité de
l'échantillon, ainsi que de vérifier le respect des quotas
fixés lors de l'échantillonnage.
Tableau N° 06 Présentation du profil des
répondants selon leur genre et leurs catégories.
|
Enquêtés
|
Pas entrepreneurs
|
Entrepreneurs
|
Total
|
|
Féminin
|
30
|
166
|
196
|
|
Masculin
|
11
|
174
|
185
|
|
Total
|
41
|
340
|
381
|
Source : élaboré à partir
des données d'enquête Figure N° 06 Profil des
répondants
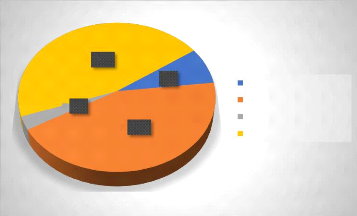
3%
46%
43%
8%
Féminin Pas entrepreneurs Féminin Entrepreneurs
Masculin Pas entrepreneurs Masculin Entrepreneurs
Interprétation :
Le graphique 6 montre que les enquêtés sont
constitués à 11% des jeunes n'ayant pas entrepris et de 89% des
entrepreneurs, cela en vue de comprendre de manière globale les
défis des entrepreneurs ainsi que les motifs pour lesquels certains
jeunes ne se lancent pas dans cette aventure.
Il indique d'une part que parmi les jeunes n'ayant pas
entrepris 8% sont du genre féminin et 3% du genre masculin. D'autre
part, parmi les entrepreneurs, 43% sont des jeunes femmes et 46% des jeunes
hommes.
43
Section 2. Présentation des résultats
Dans cette phase se trouve la présentation des
résultats de l'analyse des données collectées
auprès des 381 jeunes de la commune de la Kanshi.
2.1. Facteurs personnels influençant
l'entrepreneuriat des jeunes
Tableau N° 07 : Statistiques descriptives des variables
liées aux facteurs personnels
|
Variable
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Moyenne
|
Ecart-type
|
|
Genre
|
|
|
|
|
|
Féminin
|
196
|
51.44
|
|
Masculin
|
185
|
48.56
|
|
Entrepreneuriat
|
|
|
|
Pas entrepreneur
|
41
|
10.76
|
|
Entrepreneur
|
340
|
89.24
|
|
Secteur d'activité
|
|
|
|
Agriculture
|
121
|
35.59
|
|
Artisanat
|
55
|
16.18
|
|
Commerce
|
164
|
48.24
|
|
Motivation
|
|
|
2.53
|
0.88
|
|
Indépendance financière
|
137
|
40.29
|
|
|
|
Opportunité de marché
|
79
|
23.24
|
|
Passion pour le domaine
|
81
|
23.82
|
|
Sortir du chômage
|
43
|
12.65
|
|
Influence environnementale
|
|
|
|
Non
|
122
|
35.88
|
|
Oui
|
218
|
64.12
|
|
Education formelle
|
|
|
|
Non
|
43
|
12.65
|
|
Oui
|
297
|
87.35
|
|
Niveau de satisfaction
|
|
|
3.41
|
0.83
|
|
Faible (1-2)
|
69
|
20.29
|
|
|
|
Moyenne (3-4)
|
222
|
65.29
|
|
Forte (5)
|
49
|
14.41
|
44
Source : élaboré à partir
du logiciel Excel. Interprétation :
Le septième tableau présente les statistiques
descriptives des variables liées aux facteurs personnels, qui sont le
genre, l'entrepreneuriat, le secteur d'activité, la motivation,
l'influence environnementale, l'éducation formelle et le niveau de
satisfaction.
Il permet de décrire les caractéristiques de
base des enquêtés et des entrepreneurs, ainsi que leur
distribution selon les différentes variables.
Ainsi, on peut voir que la majorité des
enquêtés sont des entrepreneurs (89.24%), que le secteur du
commerce est le plus représenté parmi les entrepreneurs (48.24%),
que la motivation la plus fréquente est l'indépendance
financière (40.29%).
Enfin, on peut aussi voir que la plupart des entrepreneurs ont
été influencés par leur environnement (64.12%), que la
majorité des entrepreneurs ont suivi une éducation formelle
(87.35%) et que le niveau moyen de satisfaction des entrepreneurs est de 3.41
sur 5.
Tableau N° 08 : Tests statistiques des variables
liées aux facteurs personnels
|
Variable
|
Test
|
Degré de liberté
|
Valeur du test
|
Valeur p
|
|
Entrepreneuriat et genre
|
Chi-carré
|
1
|
6.28
|
0.012
|
|
Niveau de satisfaction et motivation
|
ANOVA
|
3
|
4.12
|
0.007
|
|
Education formelle et motivation
|
Corrélation
|
|
0.21
|
0
|
Source : élaboré à partir
du logiciel SPSS. Interprétation :
Ce tableau présente les tests statistiques des
variables liées aux facteurs personnels, qui sont l'entrepreneuriat et
le genre, le niveau de satisfaction et la motivation, ainsi que
l'éducation formelle et la motivation.
Il permet de comparer les différences entre les groupes
d'entrepreneurs selon ces variables, ainsi que de mesurer les relations entre
ces variables.
On observe qu'il y a une différence significative entre
les jeunes hommes et les jeunes femmes dans la proportion d'entrepreneurs, les
hommes étant plus nombreux à se lancer dans l'entrepreneuriat que
les femmes (p < 0.05).
Aussi, on observe qu'il y a une différence
significative entre les types de motivation dans le niveau de satisfaction des
entrepreneurs, ceux motivés par la passion pour le domaine étant
plus satisfaits que les autres (p < 0.01).
45
Enfin, il y a une relation positive et significative entre
l'éducation formelle et la motivation des entrepreneurs, les
entrepreneurs ayant suivi une éducation formelle étant plus
motivés que les autres (p < 0.01).
Tableau N° 09 : Profils des jeunes entrepreneurs selon leurs
caractéristiques personnelles
|
Variable
|
Cluster 1
|
Cluster 2
|
Cluster 3
|
Cluster 4
|
|
Motivation
|
Indépendance financière
|
Opportunité de marché
|
Passion pour le domaine
|
Sortir du chômage
|
|
Education formelle
|
Haut
|
Moyen
|
Bas
|
Très bas
|
|
Niveau de satisfaction
|
Faible
|
Moyen
|
Fort
|
Très faible
|
|
Propension à prendre des risques
|
Forte
|
Moyenne
|
Faible
|
Très forte
|
Source : élaboré à
partir du logiciel SPSS. Interprétation :
Ce neuvième tableau présente les profils des
jeunes entrepreneurs selon leurs caractéristiques personnelles, qui sont
la motivation, l'éducation formelle, le niveau de satisfaction et la
propension à prendre des risques.
Il permet d'identifier et de caractériser les
différents types de jeunes entrepreneurs, ainsi que de les regrouper en
fonction de leurs similarités et de leurs différences.
On peut percevoir qu'il y a quatre profils distincts de jeunes
entrepreneurs, que nous avons nommés le profil ambitieux, le profil
opportuniste, le profil passionné et le profil
désespéré.
Le profil ambitieux regroupe les entrepreneurs motivés
par l'indépendance financière, ayant un haut niveau
d'éducation formelle, un faible niveau de satisfaction et une forte
propension à prendre des risques.
Le profil opportuniste regroupe les entrepreneurs
motivés par l'opportunité de marché, ayant un niveau moyen
d'éducation formelle, un niveau moyen de satisfaction et une propension
moyenne à prendre des risques.
Le profil passionné regroupe les entrepreneurs
motivés par la passion pour le domaine, ayant un bas niveau
d'éducation formelle, un fort niveau de satisfaction et une faible
propension à prendre des risques.
Le profil désespéré regroupe les
entrepreneurs motivés par le besoin de sortir du chômage, ayant un
niveau très bas d'éducation formelle, un niveau très
faible de satisfaction et une très forte propension à prendre des
risques.
46
2.2. Facteurs socioculturels influençant
l'entrepreneuriat des jeunes
Tableau N° 10 : Statistiques descriptives des variables
liées aux facteurs socioculturels
|
VARIABLE
|
FREQUENCE
|
POURCENTAGE
|
MOYENNE
|
ECART-TYPE
|
|
Défis des jeunes entrepreneurs
|
|
|
2.59
|
0.98
|
|
Le manque d'aide et d'appui en affaires.
|
168
|
49.41
|
|
|
|
Le manque d'éducation entrepreneuriale
|
74
|
21.76
|
|
Le manque d'expérience
|
348
|
102.35
|
|
Les attitudes sociales et culturelles négatives (peur
de l'échec...)
|
226
|
66.47
|
|
Les problèmes d'accès aux sources de financement
|
158
|
46.47
|
|
Autres
|
9
|
2.65
|
|
Perspectives
|
|
|
|
Diversification
|
137
|
40.29
|
|
Expansion de l'entreprise
|
101
|
29.71
|
|
Stabilité
|
121
|
35.59
|
|
Education entrepreneuriale
|
|
|
|
Non
|
43
|
12.65
|
|
Oui
|
297
|
87.35
|
Source : élaboré à partir
du logiciel Excel. Interprétation :
Ce tableau présente les statistiques descriptives des
variables liées aux facteurs socioculturels, qui sont les défis
des jeunes entrepreneurs, les perspectives, l'éducation entrepreneuriale
et le secteur d'activité.
Il permet de décrire les caractéristiques des
jeunes entrepreneurs en termes de leurs difficultés, de leurs
aspirations, de leur formation et de leur domaine d'activité, ainsi que
leur distribution selon les différentes variables.
On peut voir d'une part que les principaux défis des
jeunes entrepreneurs sont le manque d'expérience, les attitudes sociales
et culturelles négatives, le manque d'aide et d'appui en affaires, les
problèmes d'accès aux sources de financement, le manque
d'éducation entrepreneuriale et d'autres défis.
47
D'autre part, on observe que les perspectives les plus
fréquentes sont la diversification, l'expansion de l'entreprise et la
stabilité ; que la majorité des entrepreneurs ont suivi une
éducation entrepreneuriale et que le secteur du commerce est le plus
représenté parmi les jeunes entrepreneurs.
Tableau N° 11 : Tests statistiques des variables
liées aux facteurs socioculturels
|
Variable
|
Test
|
Degré de liberté
|
Valeur du test
|
Valeur p
|
|
Entrepreneuriat et secteur d'activité
|
Chi-carré
|
2
|
18.76
|
0
|
|
Niveau de satisfaction et influence environnementale
|
T
|
338
|
2.34
|
0.02
|
|
Education entrepreneuriale et défis des jeunes
entrepreneurs
|
Corrélation
|
|
-0.27
|
0
|
Source : élaboré à partir
du logiciel SPSS. Interprétation :
Ce onzième tableau présente les tests
statistiques des variables liées aux facteurs socioculturels, qui sont
l'entrepreneuriat et le secteur d'activité, le niveau de satisfaction et
l'influence environnementale, et l'éducation entrepreneuriale et les
défis des jeunes entrepreneurs.
Il permet de comparer les différences entre les groupes
d'entrepreneurs selon ces variables, ainsi que de mesurer les relations entre
ces variables.
En effet, on peut voir qu'il y a une différence
significative entre les secteurs d'activité dans la proportion
d'entrepreneurs, le commerce étant le secteur le plus
représenté parmi les entrepreneurs, suivi par l'agriculture et
l'artisanat (p < 0.001).
Ensuite, on constate qu'il y a une différence
significative entre les entrepreneurs qui ont été
influencés par leur environnement et ceux qui ne l'ont pas
été dans le niveau de satisfaction, les entrepreneurs qui ont
été influencés par leur environnement étant plus
satisfaits que les autres (p < 0.05).
Enfin, on peut voir qu'il y a une relation négative et
significative entre l'éducation entrepreneuriale et les défis des
jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs ayant suivi une éducation
entrepreneuriale faisant face à moins de défis que les autres (p
< 0.01).
48
2.3. Perspectives des jeunes entrepreneurs
Tableau N° 12 : Perspectives des jeunes entrepreneurs selon
leurs aspirations et leurs projets
|
Variable
|
Cluster 1
|
Cluster 2
|
Cluster 3
|
|
Perspectives
|
Diversification
|
Expansion de l'entreprise
|
Stabilité
|
|
Secteur d'activité
|
Commerce
|
Agriculture
|
Artisanat
|
|
Influence environnementale
|
Oui
|
Non
|
Oui
|
|
Défis des jeunes entrepreneurs
|
Faible
|
Moyen
|
Fort
|
|
Education entrepreneuriale
|
Oui
|
Non
|
Oui
|
Source : élaboré à partir
du logiciel Excel. Interprétation :
Le tableau n° 12 présente les perspectives des
jeunes entrepreneurs selon leurs aspirations et leurs projets, qui sont la
diversification, l'expansion de l'entreprise et la stabilité.
Il permet d'identifier et de caractériser les
différents types de jeunes entrepreneurs, ainsi que de les regrouper en
fonction de leurs similarités et de leurs différences.
De ce fait, on peut par exemple voir qu'il y a trois
perspectives principales des jeunes entrepreneurs, que nous avons
nommées la perspective innovante, la perspective croissante et la
perspective conservatrice.
La perspective innovante regroupe les entrepreneurs qui visent
à se lancer dans de nouvelles activités ou à offrir de
nouveaux produits ou services, qui sont dans le secteur du commerce, qui ont
été influencés par leur environnement, qui font face
à peu de défis et qui ont suivi une éducation
entrepreneuriale.
La perspective croissante regroupe ceux qui visent à
augmenter le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le nombre
d'employés ou la taille du marché, qui sont dans le secteur de
l'agriculture, n'ont pas été influencés par leur
environnement, font face à un niveau moyen de défis et n'ont pas
suivi une éducation entrepreneuriale.
La perspective conservatrice regroupe les entrepreneurs qui
visent à maintenir le niveau actuel de performance et de
rentabilité de l'entreprise, qui sont dans le secteur de l'artisanat,
qui ont été influencés par leur environnement, qui font
face à un niveau élevé de défis et qui ont suivi
une éducation entrepreneuriale.
49
2.4. Obstacles et solutions à l'entrepreneuriat des
jeunes
Tableau N° 13 Principaux obstacles/défis à
l'entrepreneuriat dans la commune de Kanshi
|
Principaux obstacles à
l'entrepreneuriat
|
Fréquence
|
|
Le manque de formation
|
200
|
|
Le manque d'opportunités de marché
|
113
|
|
Le manque de financement
|
126
|
|
Total général
|
381
|
Source : élaboré à partir
du logiciel Excel. Interprétation :
Ce tableau présente la synthèse des principaux
obstacles à l'entrepreneuriat dans la commune de Kanshi, selon la
fréquence de leur mention.
Remarque : le total général de 381 ne
correspond pas à la somme des effectifs du tableau, car certains
obstacles sont mentionnés seuls, sans être mis en relation avec
d'autres, tandis que d'autres ont été mis en relation.
L'obstacle le plus fréquent est le manque de formation,
qui apparaît 200 fois sur 381. Cela signifie que plus de la moitié
des enquêtés (52,49%) ont cité cet obstacle comme un frein
à leur projet entrepreneurial.
Le deuxième obstacle le plus fréquent est le
manque de financement, qui apparaît 126 fois sur 381. Cela signifie que
près d'un tiers des enquêtés (33,1%) ont indiqué cet
obstacle comme une difficulté majeure pour démarrer ou
développer leur entreprise.
Enfin, le troisième obstacle le plus fréquent
est le manque d'opportunités de marché, qui apparaît 113
fois sur 381. Cela signifie que près d'un tiers des
enquêtés (29,7%) ont mentionné cet obstacle comme un
défi important pour trouver ou fidéliser des clients.
Tableau N° 14 Proposition des solutions aux obstacles de la
commune
|
Proposition des solutions
|
Fréquence
|
|
Formation et éducation
|
264
|
|
Amélioration de l'accès au financement
|
109
|
|
Développement du marché
|
57
|
|
Total général
|
381
|
Source : élaboré à partir
du logiciel Excel. Interprétation :
Ce tableau présente la synthèse des principales
solutions proposées par les jeunes pour la commune de Kanshi, selon la
fréquence de leur mention dans les données collectées.
50
Remarque : le total général de 381 ne
correspond pas à la somme des effectifs du tableau, car certaines
solutions sont mentionnées seules, sans être mis en relation avec
d'autres, tandis que d'autres ont été mises en relation.
La solution la plus fréquente est la formation et
l'éducation, qui apparaît 264 fois sur 381. Cela signifie que
près des deux tiers des enquêtés (69,3%) ont
suggéré cette solution comme un moyen d'améliorer les
compétences, les connaissances, la confiance et la
créativité des jeunes entrepreneurs.
La deuxième solution la plus fréquente est
l'amélioration de l'accès au financement, qui apparaît 109
fois sur 381. Cela signifie que plus d'un quart des enquêtés
(28,6%) ont recommandé cette solution comme un moyen de faciliter
l'investissement, la production, la distribution et la promotion des
entrepreneurs.
Enfin, la troisième solution la plus fréquente
est le développement du marché, qui apparaît 57 fois sur
381. Cela signifie que près d'un sixième des
enquêtés (15%) ont plaidé pour cette solution comme un
moyen de stimuler la demande, la concurrence, la rentabilité et la
pérennité des entrepreneurs potentiels.
Section 3. Discussion
3.1. Facteurs personnels
Le premier objectif de l'étude était
d'identifier et d'analyser les facteurs personnels qui influencent la
motivation, les compétences, les attitudes et les comportements des
jeunes entrepreneurs dans le contexte du champ d'étude.
De ce fait, les résultats ont
révélé que les facteurs personnels ont un impact
significatif sur l'entrepreneuriat des jeunes de la commune de Kanshi, en
influençant leur décision de se lancer dans l'entrepreneuriat,
leur performance et leur satisfaction.
D'après ces résultats, les hommes sont plus
entrepreneurs que les femmes, selon le test du chi-carré (p < 0.05).
Les différences de perception des opportunités, de confiance en
soi, de préférence pour le risque, de soutien social et de
contraintes familiales entre les deux sexes peuvent expliquer ce
résultat. (Buttner & Moore, 1997).
Par ailleurs, le secteur du commerce est le plus
représenté parmi les jeunes entrepreneurs, suivi par
l'agriculture et l'artisanat, selon le test du chi-carré (p < 0.001).
Cela s'explique par le fait que ces secteurs sont plus faciles d'accès,
moins coûteux, plus demandés et plus rentables que d'autres
secteurs plus innovants, etc. (Schoof, 2006).
Parlant des motivations, la motivation la plus
fréquente parmi les jeunes entrepreneurs est l'indépendance
financière, suivie par l'opportunité de marché, la passion
pour le domaine et le besoin de sortir du chômage, selon le test ANOVA (p
< 0.01).
Ces motivations peuvent s'expliquer par le désir de
réaliser son potentiel, de saisir les occasions, de s'épanouir
dans son activité et de surmonter la précarité, qui sont
des facteurs de motivation intrinsèque et extrinsèque. (Carsrud
& Bra nnback, 2009).
51
En outre, la plupart des jeunes entrepreneurs (64.12%) ont
été influencés par leur environnement, ce qui peut
s'expliquer par le rôle de l'environnement dans la formation des
intentions, des attitudes et des comportements entrepreneuriaux, selon des
modèles théoriques (Ajzen et Fishbein, 1975 ; Shapero et Sokol,
1982).
Aussi, les jeunes entrepreneurs qui ont été
influencés par leur environnement sont plus satisfaits que les autres,
avec une différence de 2.34 points sur le test t (p < 0.05), ce qui
peut s'expliquer par le fait qu'ils bénéficient d'un soutien,
d'une reconnaissance, d'une inspiration et d'une légitimité de la
part de leur entourage.
Nous avons aussi trouvé que les jeunes entrepreneurs
qui ont suivi une éducation formelle sont plus motivés que les
autres, avec une corrélation positive de 0.21 points (p < 0.01), ce
qui peut s'expliquer par le fait qu'ils ont une meilleure perception de leur
potentiel, de leur efficacité et de leur opportunité
entrepreneuriale. (Krueger, 1993 ; Ajzen, 1991).
Enfin, le niveau moyen de satisfaction des jeunes
entrepreneurs est de 3.41 sur 5. Ce niveau reflète les défis et
les contraintes qui limitent leur performance et leur satisfaction, mais aussi
les perspectives et les aspirations qui les motivent et les encouragent.
Ces résultats montrent qu'il existe une
diversité de profils et de caractéristiques des jeunes
entrepreneurs dans la commune de Kanshi.
3.2. Facteurs socioculturels
Le deuxième objectif était d'examiner et
d'évaluer les facteurs socioculturels qui facilitent ou entravent
l'entrepreneuriat des jeunes, tels que les normes sociales, les valeurs
culturelles, le rôle de la famille et des réseaux sociaux.
Nous avons trouvé que les normes sociales et les
valeurs culturelles ont un impact significatif et exercent une influence
ambivalente sur l'entrepreneuriat des jeunes.
D'une part, elles peuvent encourager l'esprit d'initiative, la
créativité, la solidarité et la responsabilité
sociale des jeunes entrepreneurs. D'autre part, elles peuvent décourager
l'innovation, la prise de risque, l'indépendance et la
compétitivité des jeunes entrepreneurs.
Les résultats montrent que les principaux défis
des jeunes entrepreneurs en rapport avec ces facteurs sont le manque
d'expérience, les attitudes sociales et culturelles négatives, le
manque d'aide et d'appui en affaires, et les problèmes d'accès
aux sources de financement qui limitent le potentiel entrepreneurial des
jeunes. (Halabisky, 2012).
De plus, les jeunes ayant suivi une éducation
entrepreneuriale font face à moins de défis que les autres, avec
une corrélation négative de -0.27 points (p < 0.01), car ils
ont acquis des compétences, des connaissances et des capacités
entrepreneuriales qui leur permettent de surmonter les difficultés et
les obstacles. (Fayolle & Vestraete, 2005).
Ces résultats confirment ainsi le fragment de
l'hypothèse selon laquelle l'émergence de l'entrepreneuriat des
jeunes de la Kanshi serait entravé par des facteurs socioculturels.
52
3.3. Facteurs liés à l'environnement
Le troisième objectif était d'explorer et de
mesurer les facteurs liés à l'environnement qui affectent
l'entrepreneuriat des jeunes, tels que le cadre réglementaire, le
système fiscal, l'accès au financement externe, l'accès
aux marchés et le manque de services de soutien.
En effet, les résultats démontrent que les
jeunes entrepreneurs font face au manque de formation (49.41%), de financement
(46.47%) et d'opportunités de marché (48.24%).
Nous avons aussi trouvé que le cadre
réglementaire et le système fiscal étaient perçus
comme des obstacles majeurs à l'entrepreneuriat formel des jeunes. Cela
dit, nos enquêtés n'évoluent jusque-là que dans
l'informel.
Cependant, ces facteurs sont essentiels pour la
création et le développement d'une entreprise, selon les
théories classiques de l'entrepreneuriat. (Cantillon, 1755 ; Say, 1803 ;
Schumpeter, 1911 ; Knight, 1921 ; Kirzner, 1973).
Par ailleurs, ces jeunes proposent comme solutions la
formation et l'éducation (40.29%), l'amélioration de
l'accès au financement (29.71%) et le développement du
marché (35.59%). Ces solutions correspondent à leurs besoins,
attentes, et aux pratiques réussies d'autres pays ou régions
(Fayolle et Verstraete, 2005 ; Schoof, 2006 ; Halabisky, 2012).
Ces résultats démontrent que les facteurs
environnementaux ont un impact significatif sur l'entrepreneuriat des jeunes de
la commune de Kanshi, en créant des conditions favorables ou
défavorables.
Enfin, ces résultats confirment le fragment de
l'hypothèse selon laquelle les facteurs environnementaux entraveraient
l'entrepreneuriat des jeunes de la Kanshi.
Section 4. Perspectives 4.1.
Implications
Du point de vue implications, cette étude a dans un
premier temps contribué à la science, en apportant des
connaissances nouvelles et pertinentes sur l'entrepreneuriat des jeunes de
Kanshi, en utilisant des méthodes rigoureuses et fiables, en s'appuyant
sur des théories et des modèles reconnus, et en testant
hypothèse.
Cette contribution peut être utile pour les chercheurs
sur l'entrepreneuriat des jeunes, en leur offrant des données, des
analyses, des interprétations et des recommandations, qui peuvent
enrichir la littérature, combler les lacunes, confirmer ou infirmer les
travaux existants, ou susciter de nouvelles recherches.
La deuxième implication est liée à la
contribution pratique. Cette contribution a été de proposer des
solutions adaptées et efficaces pour améliorer l'entrepreneuriat
des jeunes de Kanshi, en tenant compte des besoins et des attentes des jeunes
entrepreneurs, ainsi que des bonnes pratiques et des expériences
réussies d'ailleurs.
Cette contribution peut aider les praticiens de
l'entrepreneuriat des jeunes, en leur offrant des informations, des conseils,
des recommandations et des actions, pour créer un
53
environnement plus propice, lever les obstacles, stimuler la
motivation et les compétences, renforcer le soutien et la
reconnaissance, et favoriser l'innovation et la croissance.
La troisième implication est liée à la
contribution personnelle, qui a consisté à réaliser un
travail de recherche original, rigoureux et pertinent, en respectant les normes
académiques, le sujet, l'hypothèse, les objectifs, la revue de
littérature, etc.
Cette contribution nous est utile en tant que chercheurs. Elle
nous permet de développer nos compétences, connaissances et
capacités en matière de recherche, découvrir un domaine
d'étude intéressant et actuel, acquérir de
l'expérience et de la confiance, et en faisant valoriser notre travail
et nos résultats.
4.2. Pistes de recherches futures
La première piste d'amélioration est d'utiliser
d'autres méthodes de collecte des données plus qualitatives,
subjectives et dynamiques, comme des entretiens, des études de cas, des
observations participantes, etc., qui enrichiraient les données
quantitatives, objectives et statiques de cette étude.
La deuxième piste d'amélioration est d'utiliser
des techniques d'analyse des données plus avancées, comme des
modèles de régression, des analyses factorielles, des analyses de
réseaux, etc., qui permettraient d'explorer des aspects plus complexes
des données, tels que les relations causales, les facteurs latents, les
structures de réseaux, etc.
Enfin, la troisième piste de recherche est
d'élargir la portée de cette étude, en utilisant d'autres
sources (par exemple des données secondaires), perspectives, contextes,
etc., qui permettraient de comparer et de généraliser nos
résultats, qui se limitent à l'entrepreneuriat des jeunes de la
commune de Kanshi.
4.3. Recommandations
Sur la base des résultats obtenus, il est
recommandé aux parties prenantes concernées par l'entrepreneuriat
des jeunes de la commune de Kanshi de mettre en oeuvre les actions suivantes
:
Aux jeunes :
V' Rechercher davantage d'opportunités de formation et
d'éducation pour renforcer leurs compétences et leurs
connaissances dans leur domaine d'activité, ainsi que dans d'autres
domaines. Cela peut les aider à surmonter le manque de formation, et
à accroître leur satisfaction et leur performance.
V' Explorer davantage de sources de financement pour leurs
activités, telles que les institutions de microfinance, les plateformes
de financement participatif, etc. Cela peut les aider à surmonter le
manque de financement, et à leur permettre d'investir et
d'élargir leur entreprise.
V' Diversifier leurs produits et services, et rechercher de
nouveaux marchés pour leurs activités. Cela peut les aider
à surmonter le manque d'opportunités de marché, et
à créer plus de valeur et de revenus.
54
y' Se resauter avec d'autres jeunes entrepreneurs, ainsi
qu'avec des mentors, des experts, des modèles, etc. Cela peut les aider
à apprendre des expériences et des bonnes pratiques des autres,
ainsi qu'à accéder à plus d'informations, de ressources,
et d'opportunités pour leurs activités.
Aux autorités publiques :
y' Simplifier les procédures administratives et
juridiques pour la création et le fonctionnement des entreprises, en
réduisant le nombre de formalités, de documents et de
délais requis, permettant aux jeunes entrepreneurs d'évoluer dans
le secteur formel.
y' Soutenir financièrement l'entrepreneuriat des
jeunes, en créant des fonds d'investissement, des garanties de
crédit, des subventions, des prêts à taux réduit,
etc., qui permettraient aux jeunes entrepreneurs d'accéder à des
sources de financement adaptées à leurs besoins et à leurs
capacités.
y' Promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, en organisant des
campagnes, des concours, des événements, etc., qui permettraient
de valoriser l'entrepreneuriat comme une option de carrière, de
reconnaître les réussites des jeunes entrepreneurs, et de
créer un climat de confiance.
Aux organisations privées :
y' Renforcer l'aide et l'appui en affaires aux jeunes
entrepreneurs, en créant des réseaux, des incubateurs, des
mentors, etc., qui permettraient aux jeunes entrepreneurs de
bénéficier de conseils, de formations, de contacts, etc. Cela les
aiderait à développer leurs compétences et leurs
capacités entrepreneuriales.
y' Stimuler l'innovation et la diversification des
activités des jeunes entrepreneurs, en leur offrant des
opportunités de marché, des informations, des études, des
veilles, des tendances, etc., qui leur permettraient d'identifier,
d'évaluer et d'exploiter des opportunités entrepreneuriales, et
de créer de la valeur ajoutée.
y' Promouvoir la reconnaissance et la valorisation de
l'entrepreneuriat des jeunes, qui visent à augmenter la
visibilité, la crédibilité, l'attractivité et
l'impact social des jeunes entrepreneurs, en organisant des concours, des prix,
des témoignages et des campagnes de sensibilisation.
Aux institutions académiques :
y' Développer l'éducation entrepreneuriale des
jeunes, en intégrant des modules sur l'entrepreneuriat dans les
programmes scolaires et universitaires, qui permettraient aux jeunes
d'acquérir des compétences entrepreneuriales, et de se
préparer à l'entrepreneuriat.
y' Renforcer la recherche sur l'entrepreneuriat des jeunes, en
menant des études et
des publications sur l'entrepreneuriat des jeunes, qui
permettraient de produire
des connaissances et des recommandations sur l'entrepreneuriat
des jeunes.
ü Enfin, créer des liens entre
l'éducation, la recherche et la pratique de l'entrepreneuriat des
jeunes, en établissant des partenariats entre les acteurs de
l'écosystème entrepreneurial des jeunes, qui permettraient de
créer des synergies et des mutualisations.
Ces recommandations visent à renforcer le potentiel
entrepreneurial des jeunes de la commune de Kanshi, et à contribuer
à leur insertion socio-économique.
Il est donc essentiel que les parties prenantes
concernées s'engagent à les mettre en oeuvre, en collaboration
avec les jeunes entrepreneurs, et en tenant compte de leurs besoins, de leurs
attentes et de leurs aspirations.
55
56
CONCLUSION
Nous voici au terme de cette étude sur
l'entrepreneuriat des jeunes de la commune de Kanshi, à Mbujimayi.
L'objectif majeur de ce travail était d'identifier les
facteurs qui entravent l'émergence de l'entrepreneuriat des jeunes de la
Kanshi, les défis qu'il présente, ainsi que les perspectives
qu'il offre.
Pour atteindre cet objectif, la question de recherche suivante
a été formulée : quels sont les facteurs qui entravent
l'émergence de l'entrepreneuriat des jeunes de la commune de KANSHI,
dans la ville de Mbujimayi ?
De ce fait, notre hypothèse postulait que
l'entrepreneuriat des jeunes serait entravé par des facteurs personnels,
socioculturels et environnementaux.
Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons
mené une enquête quantitative auprès de 381 jeunes
entrepreneurs de la commune, en nous appuyant sur un niveau de confiance de 95%
et une marge d'erreur de 5%.
En effet, les résultats obtenus confirment cette
l'hypothèse, car ils exposent que les facteurs susmentionnés ont
un impact significatif sur l'entrepreneuriat des jeunes de la Kanshi, en
influençant leur motivation, leurs compétences, leurs attitudes,
leurs comportements, leurs défis, leurs solutions et leurs
perspectives.
Par ailleurs, cette étude engendre des connaissances
nouvelles et utiles sur l'entrepreneuriat des jeunes, en mettant en
lumière ses défis et ses perspectives. Elle apporte une
contribution scientifique, pratique et personnelle à la connaissance de
cet entrepreneuriat dans le contexte de la commune de Kanshi
Néanmoins, elle présente des limites qui
tiennent à la méthodologie, à l'échantillonnage,
à la mesure et à l'analyse des données. Ces limites
peuvent être surmontées en utilisant d'autres méthodes,
sources, techniques et outils de recherche, qui permettraient de renforcer la
validité, la fiabilité et la
généralisabilité de l'étude.
Cette étude ouvre aussi des pistes de recherches
futures pour approfondir et élargir l'étude, notamment sur
l'impact de l'entrepreneuriat des jeunes sur le développement local.
Elle présente également des implications pour les parties
prenantes concernées par l'entrepreneuriat des jeunes.
De tout ce qui précède, nous pouvons dire que
l'entrepreneuriat des jeunes de la commune de Kanshi à Mbujimayi est un
phénomène complexe, dynamique et diversifié, qui
dépend de multiples facteurs, qui présente des
opportunités et des défis, et qui nécessite des solutions
et des actions adaptées.
En définitive, nous espérons que cette
étude contribuera au débat scientifique, à la promotion et
au développement de l'entrepreneuriat des jeunes (en particulier ceux de
la Kanshi), et à leur insertion socio-économique. Ainsi, nous
invitons nos lecteurs à enrichir ce débat en nous partageant
leurs commentaires et suggestions.
57
BIBLIOGRAPHIE
Acs, Z. J., & Audretsch, D. B. (1988). Innovation dans les
grandes et les petites entreprises : une analyse empirique. The American
Economic Review, 678-690.
Adam, M. (2009). Réinventer l'entrepreneuriat pour
soi, pour nous, pour eux. Paris: L'Harmattan.
Ajzen, I. (1991). La théorie du comportement
planifié. 179-211.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). Une théorie de
l'action raisonnée. Addison-Wesley, 1-22. Amit, R., &
Muller, E. (1995). Entrepreneuriat "push" et "pull". Journal of Small
Business and Entrepreneurship, 64-80.
Bergault, F., & Bergault, N. (2016). De l'idée
à la création d'entreprise, Comment concrétiser votre
projet. Paris: Dunod.
Beye, M. (2012). L'entrepreneuriat féminin au
Sénégal : une analyse à partir de l'enquête 1-2-3 de
2005. Revue d'économie du développement, 5-32.
Blanchflower, D. G., & Oswald, A. J. (2007). Is well-being
U-shaped over the life cycle? . Social Science & Medicine,
1733-1749.
Bourdieu, P. (1987). L'entrepreneuriat : une forme de capital
social. Actes de la recherche en sciences sociales, 2-10.
Brixiová, Z., Ncube, M., & Bicaba, Z. (2014).
Compétences et entrepreneuriat des jeunes en
Afrique : analyse avec des preuves du Swaziland. World
Development, 11-26. Bruin, A., & Welter, F. (2009). A gender-aware
framework for women's . International
Journal of Gender and Entrepreneurship, 8-24.
Buttner, E. H., & Moore, D. P. (1997). L'exode
organisationnel des femmes vers l'entrepreneuriat : motivations et
corrélats avec le succès auto-déclarés. Journal
of Small Business Management, 34-46.
Bygrave, W. D., & Hofer, C. W. (1991). Théoriser
sur l'entrepreneuriat. Entrepreneurship, Theory and Practice,
13-22.
Cantillon, R. (1755). Essai sur la nature du commerce en
général. Londres: Fletcher Gyles. Capron, H. (2009).
L'entrepreneuriat. Rosny-sous-Bois: Bréal.
Carland, J. W., Hoy, F., Boulton, W. R., & Carland, J. A.
(1984). Differentiating entrepreneurs from small business owners: A
conceptualization. Academy of Management Review, 354-359.
Carsrud, A., & Bra nnback, M. (2009). Comprendre
l'esprit entrepreneurial : ouvrir la boîte noire. New York:
Springer.
Casson, M. (1991). L'entrepreneur : une théorie
économique. Aldershot: Edward Elgar. Centre d'actualités de
l'ONU. (s.d.). RDC : à Kinshasa, des jeunes se lancent dans la
création
d'entreprises. Récupéré sur
un.org:
https://www.un.org/africarenewal/fr/derni%C3%A8re-heure/rdc-%C3%A0-kinshasa-des-jeunes-se-lancent-dans-la-cr%C3%A9ation-d%E2%80%99entreprises-avec-lappui-de
Chabaud, D., Sammut, S., & Degeorge, J. M. (2020).
Entrepreneuriat : théories et pratiques. Paris: Dunod.
Collins, O. F., & Moore, D. G. (1964). L'homme
entreprenant. East Lansing: Michigan State University Press.
Deconde, G. (2018, Novembre 23). Comprendre les
échelles de mesure. Récupéré sur UX Metric:
https://www.uxmetric.com/en/methods/echelles-de-mesure
Dess, C. G., & Robinson Jr, R. B. (1984). Measuring
organizational performance in the absence of objective measures : The case of
the privately-held firm and conglomerate . Strategic Management
Journal, 265-273.
58
Dzaka-Kikouta, T., Kamavuako-Diwavova,, J., Bitemo Ndiwulu,
X., Makiese Ndoma, F., Manika Manzongani, J. P., & Masamba Lulendo, V.
(2020, Mai). L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES AFRICAINS FRANCOPHONES DANS LA
RÉPUBLIQUE .... Récupéré sur Observatoire de
la Francophonie économique de
l'Université de Montréal:
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no3.pdf
Échantillonnage : tout ce que vous devez savoir
pour vos recherches. (s.d.). Récupéré sur Scribbr:
https://www.scribbr.com/methodology/sampling-methods/
Epopi Mbandi, M. (2021, Août 20). LA
PROBLÉMATIQUE DE L'ENTREPRENEURIAT DES
JEUNES EN RDC. Récupéré sur
congomemoire.net:
https://congomemoire.net/content/la-problEmatique-de-l-entrepreneuriat-des-jeunes-en-rdc-entrepreneuriat-economie-du-lendemain-1056
Études quantitatives : intégrer des
échelles de mesure. (s.d.). Récupéré sur
IntoTheMinds:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-35666-8_5
Fayolle, A. (2003). Entrepreneuriat : apprendre à
entreprendre. Paris: Dunod.
Fayolle, A., & Vestraete, T. (2005). Entrepreneuriat :
modèles et pratiques. Bruxelles: De Boeck.
Filion, L. J. (1990). L'entrepreneurship : Etat d'une
recherche. Revue internationale P.M.E, 7-29.
Filion, L. J. (1990). L'entrepreneuriat : créateur
d'emplois et de richesses. Montréal: Gaëtan Morin.
Frank Knight -- Wikipédia. (s.d.).
Récupéré sur
fr.wikipedia.org:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Knight
Gartner, W. B. (1988). « Who is an entrepreneur ? »
is the wrong question. American Journal of Small Business, 11-32.
Gartner, W. B. (1988). Aspects de l'émergence
organisationnelle. Pergamon, 67-86. Gartner, W. B. (1993). Les mots
conduisent aux actes : vers un vocabulaire de l'émergence
organisationnelle. Journal of Business Venturing, 231-239.
Gnyawali, D. R., & Fogel, D. S. (1994). Environments for
entrepreneurship development : key dimensions and research implications.
Entrepreneurship Theory and Practice, 43-62.
Halabisky, D. (2012). Activités entrepreneuriales
en Europe : l'entrepreneuriat des jeunes. Paris: Éditions OCDE.
Hisrich, R. D., & Petters, M. P. (1998). Entrepreneuriat.
Boston: McGraw-Hill.
Hoy , F., Carland, J. W., Boulton, W. R., & Carland, J. A.
(1984). Différencier les entrepreneurs des petits propriétaires
d'entreprise : une conceptualisation. Academy of Management Review ,
354-359.
Initiative présidentielle pour l'entrepreneuriat
des jeunes en RDC. (2021, Septembre 1). Récupéré sur
actualite.cd:
https://actualite.cd/index.php/2021/09/01/rdc-sama-lukonde-annonce-la-mise-en-place-dun-fonds-special-pour-soutenir
Jakubczak, A. (2015). L'entrepreneuriat féminin en
Afrique subsaharienne : une revue de la littérature. Revue
internationale des études du développement, 615-642.
Joseph A. Schumpeter and Innovation. (s.d.).
Récupéré sur
link.springer.com:
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4614-3858-8_476
Julien, P. A. (2005). L'entrepreneuriat re gional et local :
une perspective internationale et comparative. Presses de l'Universite du
Quebec.
Kirzner, I. M. (1973). Concurrence et entrepreneuriat.
Chicago: University of Chicago Press. Knight , F. (1921). Risque,
incertitude et profit. Boston: Houghton Mifflin.
59
Krueger Jr, N. F. (1993). L'impact de l'exposition
antérieure à l'entrepreneuriat sur les perceptions de la
faisabilité et de la désirabilité d'une nouvelle
entreprise. Entrepreneurship Theory and Practice, 5-21.
Krueger Jr, N. F., & Brazeal, D. V. (1994).
Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. Entrepreneurship
Theory and Practice, 91-104.
La théorie de l'entrepreneur, son évolution
et sa contextualisation. (2022, Février 21).
Récupéré sur cairn.info:
https://www.cairn.info/revue-vie-et-sciences-de-l-entreprise-2022-1-page-55.htm
Leclair, A. (2014). L'entrepreneuriat : une voie
d'insertion professionnelle pour les jeunes. Paris: L'Harmattan.
Leclair, A. (2014). Typologie des entrepreneures selon le
genre : une e tude exploratoire. Revue internationale P.M.E, 9-36.
LEGER-JARNIOU, C. (2013). Le grand livre de
l'entrepreneuriat. Paris: Dunod.
Luckman, T. (1989). L'entrepreneuriat : une approche
sociologique. Revue française de sociologie, 5-24.
Marchesnay, J., & Verstraete, T. (1999). L'entrepreneuriat
: une perspective historique. Revue française de gestion,
10-21.
Marchesnay, M. (2008). L'innovation, moteur de la dynamique
entrepreneuriale. Revue internationale PME, 9-28.
Marchesnay, M. (2020). L'entrepreneuriat en action : ou
comment de jeunes ingénieurs créent des entreprises innovantes.
Paris: Presses des Mines.
Méthode d'échantillonnage : définition
et liste. (s.d.). Récupéré sur Qualtrics:
https://www.qualtrics.com/uk/experience-management/research/sampling-methods/
Meyer, J. (2005). L'entrepreneuriat : un état
d'esprit. Paris: L'Harmattan.
Minniti, M., & Lévesque, M. (2008).
Développements récents dans l'économie de
l'entrepreneuriat. Journal of Business Venturing, 603-612.
Monkey, S. (2000). L'entrepreneuriat : un jeu d'enfant.
Paris: Éditions du Singe.
Mustar, P. (2020). L'entrepreneuriat : de l'idée
à la start-up. Paris: Presses des Mines. Ngijol, J. (2015).
Israel M. Kirzner : les opportunités au coeur de la dynamique.
Récupéré sur
cairn.info:
https://www.cairn.info/revue-de-l-entrepreneuriat-2015-4-page-
99.htm
NISHIMATA, O., & NISHIMATA, A. (2016). Être
entrepreneur aujourd'hui, Comprendre les principales tendances de
l'entrepreneuriat. Paris: EYROLLES.
Noël, D. P., & Madoui, M. (2011).
L'entrepreneuriat : une dynamique collective. Paris: L'Harmattan.
O.I.T. (2019). L'avenir du travail en Afrique : tirer
parti du potentiel de l'intégration régionale.
Genève: Bureau international du travail.
OCDE/U. E. (2012). L'entrepreneuriat chez les seniors :
une mesure du potentiel entrepreneurial. Paris: Éditions OCDE.
Pierre, A. (2010). Agir pour réussir, Comment
arrêter de remettre les choses au lendemain. Paris: Maxima.
Potter, J. (2008). Entrepreneuriat et enseignement
supérieur. Paris: Éditions OCDE.
Rasmussen, E., & Sorheim, R. (2006). Éducation
à l'entrepreneuriat basée sur l'action. Technovation,
185-194.
Say, J. B. (1803). Traité d'économie
politique ou simple exposition de la manière dont se forment, se
consomment et se distribuent les richesses qui ont pour origine la terre, le
travail et les capitaux. Paris: Crapelet.
Schoof, R. (2006). Counting points on varieties using
universal torsors. Arithmetic of
higher-dimensional algebraic varieties, 195-208.
Schumpeter, J. A. (1911). Théorie de la mutation
économique. Leipzig: Duncker & Humblot. Schumpeter, J. A.
(1935). Théorie de l'évolution économique : recherches
sur le profit, le crédit, l'intérêt et le cycle de la
conjoncture. Paris: Dalloz.
Schumpeter, J. A., & Opie, R. (s.d.). The
Theory of Economic Development -- Joseph A.
Schumpeter. Récupéré sur
hup.harvard.edu:
https://www.hup.harvard.edu/authors/7256-schumpeter-joseph-a
Sélection d'un échantillon. (s.d.).
Récupéré sur Statistique Canada:
https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch13/sample-echantillon/5214900-eng.htm
Shapero, A., & Sokol, L. (1982). Les
dimensions sociales de l'entrepreneuriat. Encyclopédie de
l'entrepreneuriat, 72-90.
Shaver, K. G., & Scott, L. R. (1991). Personne,
processus, choix : la psychologie de la création de nouvelles
entreprises. Entrepreneurship Theory and Practice, 23-45.
SHOMBA KINYAMBA, S., & OLELA NONGA, D. (2015).
Monographie de la ville de Mbujimayi. Kinshasa: M.E.S.
Sy, A., Massing, A., & Liboudou, C. (2014).
L'entrepreneuriat des jeunes en Afrique : une opportunité pour
le développement durable. Revue internationale des
études du développement, 11-36.
Toutain, O., & Verzat, C. (2017). L'entrepreneuriat.
Paris: La Découverte.
Van Cert, J. (2021). L'entrepreneuriat : un art
de vivre. Bruxelles: Éditions du Cert. Verheul, L.,
Thurik, R., Hessels, J., & van der Zwan, P. (2010).
Facteurs influençant
l'engagement entrepreneurial des entrepreneurs
d'opportunité et de nécessité.
Zoetermeer: EIM Research Reports .
Vestraete, T. (1999). L'entrepreneuriat : une nouvelle
approche. Revue internationale PME, 7-20.
Vestraete, T. (1999). L'entrepreneuriat : une perspective
cognitive. Revue internationale P.M.E, 9-36.
Wikipédia, C. d. (s.d.). Échelle (mesure).
Récupéré sur Wikipédia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Scale
Wikipédia, C. d. (s.d.). Théorie du risque
-- Wikipédia. Récupéré sur
fr.wikipedia.org:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_risque-profit
60
61
ANNEXES
62
QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
Bonjour Mademoiselle/Monsieur, c'est dans le cadre d'un
travail de recherche marquant la fin du cycle de graduat en sciences
économiques portant sur « L'entrepreneuriat des jeunes de la
commune de Kanshi, à Mbujimayi : défis et perspectives »,
que nous voulons nous entretenir avec vous.
Nous vous remercions de prendre le temps de participer
à cette enquête. Vos réponses seront traitées de
manière confidentielle et anonyme. Elles seront utilisées pour
mieux comprendre l'entrepreneuriat des jeunes dans la commune de Kanshi
à Mbujimayi, ses défis et perspectives.
1. Caractéristiques sociodémographiques
· Age
15 - 17 ans 18 - 24 ans
· Genre
Masculin
· Niveau d'éducation Primaire
|
Secondaire
|
25 - 29 ans 30 - 34 ans
Féminin
Universitaire
|
Autre
|
|
· Etes-vous actuellement employé ? Si oui, dans quel
secteur ?
Public (fonctionnaire) Auto-employé
Privé Sans emploi
2. Entrepreneuriat
· Avez-vous déjà lancé ou repris une
entreprise ?
· Si oui, dans quel secteur ? Commerce
|
Artisanat
|
Agriculture
|
ü Motivation
· Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir
entrepreneur ?
Indépendance financière Opportunité de
marché
Passion pour le domaine Sortir du chômage
Autres
ü Environnement entrepreneurial
· Avez-vous des membres de la famille ou des amis qui sont
entrepreneurs ?
63
Oui
· Avez-vous été influencé par votre
famille, vos amis ou vos collègues pour devenir entrepreneur ?
· Avez-vous reçu une éducation
entrepreneuriale formelle (cours, ateliers, etc.) ?
V' Satisfaction
· Sur une échelle de 1 à 5, comment
évalueriez-vous votre niveau de satisfaction en tant qu'entrepreneur
?
Faible (1-2)
|
Moyenne (3-4)
|
Forte (5)
|
|
3. Défis et perspectives V'
Défis
· Quels ont été les principaux défis
que vous avez rencontrés lors du lancement de votre entreprise ?
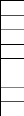
Les attitudes sociales et culturelles négatives (peur de
l'échec...)
Le manque d'éducation entrepreneuriale
Le manque d'expérience
Les problèmes d'accès aux sources de
financement
Le cadre administratif et réglementaire (coût
très élevé des
procédures administratives et de la
réglementation)
Le manque d'aide et d'appui en affaires.
Autres
· Comment avez-vous surmonté ces défis ?
Formation et éducation Réseautage et mentorat
|
Recherche de financement Autres
|
|
V' Perspectives
· Quelles sont vos aspirations en matière
d'entrepreneuriat pour l'avenir ?
Expansion de l'entreprise Stabilité
|
Diversification Autres
|
|
· Quels types de soutien ou de ressources pensez-vous qu'il
serait utile d'avoir pour atteindre ces objectifs ?
Financement
|
Formation
|
Mentorat
|
Autres
|
|
64
V' Défis dans la commune
· Quels sont les principaux obstacles à
l'entrepreneuriat dans la commune de Kanshi ?
Le manque de financement Le manque d'opportunités de
marché
Le manque de formation Autres
· Quelles solutions proposez-vous pour surmonter ces
défis ?
Amélioration de l'accès au financement
Développement du marché
Formation et éducation Autres
V' Ressources et soutien
· Quels types de ressources ou de soutien sont
actuellement disponibles pour les jeunes entrepreneurs dans la commune de
Kanshi ?
Financement Formation
|
Mentorat Autres
|
|
· Comment ces ressources ou ce soutien pourraient-ils
être améliorés ?
|
Augmentation du financement Amélioration de la
formation
|
Expansion du mentorat Autres
|
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce
questionnaire. Vos réponses nous sont précieuses et nous
apprécions votre contribution à cette recherche importante
.
Merci encore pour votre temps et votre participation.
| 


