|

|
Université d'Abomey Calavi (UAC)
|
Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique
et du Sport
|
(INJEPS)
MEMOIRE POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE
EN
SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES (STASE)
SPECIALITE : RECREALOGIE

DANSE ET DEVELOPPEMENT : LE « AGBEHOUN
»
COMME OUTIL D'INTEGRATION DANS LA VILLE
DE PORTO-NOVO
Présenté et soutenu par :
Kossi
KPONGBOSSOU
Sous la direction de :
Dr. Antoine HOUNGA
Maitre
de Conférences des Universités du CAMES
Docteur en
Géographie option Hôtellerie et Tourisme, Enseignant chercheur
à l'INJEPS
Année académique 2017-2018
DEDICACE
A mes parents
Koffi E. F. KPONGBOSU, Barthélémy G. HONFOGA
et
Akou A. ABOTSI
I
REMERCIEMENTS
Avec toute ma considération et tous mes
respects, je remercie mon directeur de mémoire, Professeur Antoine
HOUNGA, pour avoir accepté encadrer ce travail. Je lui suis
également reconnaissant pour sa disponibilité et sa confiance
;
J'adresse un remerciement particulier aux Professeur
Kossivi ATTIKLEME et au Dr Folly MESSAN, respectivement Directeur et Directeur
Adjoint de l'Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du
Sport (INJEPS) pour leur patience et leur compréhension de mes
difficultés ;
Ainsi en est-il du Professeur Albert TITO, pour ses
conseils sans cesse renouvelés et le reste du corps professoral pour
notre formation tout au long du cycle ;
Je tiens à remercier l'ensemble des membres du
jury qui ont accepté évaluer ce travail ;
Je n'oublie pas non plus le soutien et l'aide de mon
responsable de filière, Romuald FATCHESSI, pour ses précieux
conseils, sans oublier sa disponibilité et son implication tout au long
de cette recherche. Je n'oublie pas mes autres camarades de
promotion.
Enfin, je remercie les diverses structures (la mairie,
ACAL-Porto-Novo, SESAME...) qui m'ont accueilli au cours de ma
recherche.
II
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX
Figure 1 : Liens entre culture, loisirs, arts, danse,
intégration et développement.
Figure 2 : Modèle d'évaluation
adopté pour la présente étude
Tableau 1 : Taille de l'échantillon
Tableau 2 : Représentation des données
relatives à l'hypothèse H1
Tableau 3 : Représentation des données
relatives à l'hypothèse H2
Tableau 4 : Représentation des données
relatives à l'hypothèse H3
III
SOMMAIRE
Dédicace i
Remerciements ii
Liste des figures et tableaux iii
Introduction 1
Chapitre 1: Contextualisation de l'étude
3
Chapitre 2: Problématisation de la recherche
7
Chapitre 3: Démarche méthodologique
24
Chapitre 4: Présentation, analyse et discussion
des résultats 28
Suggestions et Conclusion 34
Références bibliographiques
i
Table des matières iii
Annexes v
Résumé / Abstract viii
IV
INTRODUCTION
Le Bénin est un pays situé en Afrique de
l'Ouest et renferme en son sein une grande diversité de danses
traditionnelles. La danse est une suite de pas et de mouvements cadencés
exécutés sur de la musique. Son côté traditionnel
répond aux transmissions de doctrines religieuses ou morales, de
légendes, de coutumes par la parole ou par l'exemple (Larousse, 2008).
Le Bénin est l'un des pays africains où les rythmes et danses
traditionnelles jouent un rôle prépondérant dans la vie
quotidienne. Cette diversité musicale et de rythmes sont nés du
temps des différents règnes des rois du Dahomey (Ahounou, 2016).
Elles sont issues en grande majorité des danses de cultes vodou et des
problèmes de l'époque (Ahounou, 2016). Il s'agit des danses
Zinli, d'Akinta et Akohoun, Tchinkoumè, Toba, Agbotchébou,
Kpanouhoun, etc. Notre recherche ici présentée sera
principalement axée autour d'Agbéhoun, une danse royale
pratiquée dans le sud du Bénin précisément à
Porto-Novo1. Cette danse sacrée est composée de
plusieurs rythmes et pas et est pratiquée pour rendre hommage aux kuvito
(revenants). Cette étude vise à en faire la
promotion.
Le Bénin est un réservoir de danses
traditionnelles inexploitées. Bien que ces artistes ne disposent pas de
cadres d'expressions ou de carrefours qui les mènent ou les
amènent à l'universel, ils réalisent des exploits
surprenants qui font du Bénin un pays unique dans cette catégorie
de danse au monde. « Ces danses traditionnelles du Bénin sont en
voie de disparition dans certains départements du pays. Ainsi, à
travers le Festival national des danses traditionnelles du Bénin
dénommé "Ségan", visant fondamentalement à
rechercher, à promouvoir et à valoriser les danses
traditionnelles béninoises et humours, quasi abandonnées par la
jeunesse, nous allons à la découverte, à l'apprentissage,
à l'appréciation esthétique et à
l'accessibilité des rythmes des danses traditionnelles du Bénin,
en vue de faire leur promotion, avait expliqué Prosper Bohoun, promoteur
du festival en 2013.
Les danses traditionnelles béninoises sont
autant nombreuses et variées qu'il y a de régions et d'ethnies
sur l'étendue du territoire béninois. Chacune d'elles a sa
spécificité caractérisée par une gestuelle et une
rythmique propre. Elles sont avant tout l'expression des émotions, de la
liberté et de la joie de vivre. Elles sont exécutées afin
de transmettre une tradition, d'effectuer
1
https://www.musicinafrica.net/node/15630
1
un rituel, d'honorer une divinité ou de
célébrer un événement, avait-t-il ajouté
(Bohoun, 2013) ». Au Bénin, nous assistons
à une négligence relative du secteur loisir par les
autorités politiques et administratives et une concentration des moyens
de l'Etat sur les secteurs jugés prioritaires. Plus préoccupante
encore est la situation des loisirs traditionnels à l'endroit desquels
il y a un manque de volonté politique et d'effort de
revalorisation.
Pour sauver ce patrimoine immatériel à
cause de son impact dans le développement socio-économique,
plusieurs institutions nationales et internationales apportent des
contributions multiformes. Et c'est pour cette raison que beaucoup de
chercheurs et de scientifiques travaillent pour sauver ces chants et danses en
voie de disparation. C'est le cas du Conservatoire de Danses
Cérémonielles et Royales d'Abomey (CDCRA) créé en
1996 par un groupe d'intellectuels béninois, qui ambitionne de
sauvegarder et de redynamiser ce précieux patrimoine. Le Centre a
bénéficié du soutien des institutions internationales
comme l'UNESCO et le Programme Société Civile et Culture
(PSCC).
2
CHAPITRE 1

CONTEXTUALISATION DE L'ETUDE
3
1.1. Cadre de l'étude
Porto-Novo est la capitale du Bénin,
située dans le sud du pays, à 13 kilomètres de
l'océan Atlantique, dont elle est séparée par une lagune.
Elle se trouve à 30 kilomètres de Cotonou à l'ouest, la
capitale économique, et 12 kilomètres de la frontière
nigériane à l'est. Les communes limitrophes sont
Akpro-Missérété, Avrankou et Adjarra au Nord,
Sèmè-Kpodji au Sud, Adjarra à l'Est et
Aguégués à l'Ouest. Elle est la ville par excellence des
ethnies Goun et Yoruba et de la minorité ethnique Tori. En langue
Goun-gbe, Porto-Novo est appelé généralement Xogbonou et
Adjatchey par les Yoruba.
Un mythe rapporté par la tradition orale veut
que la ville ait été fondée par trois chasseurs yoruba
venus du Nigeria. Cette tradition est difficile à relier à des
faits historiques établis. Les historiens s'accordent à dire que
la ville de Porto-Novo a été fondée dans le courant du
xviie siècle par des princes Aja d'Allada dans une zone peuplée
de pêcheurs tofinnu sur les rives du lac Nokoué. Après la
prise d'Allada par le royaume d'Abomey en 1724, un nouveau royaume se
reconstitue autour de Porto-Novo sous le nom « d'Hogbonu » ou «
Xogbonu » (x?gbonu en ayizo-gbe).
Le Bénin est un pays très riche en
danses africaines : du nord au sud on retrouve différentes
manières de danser. Quoique la danse africaine se pratique
différemment du nord au sud du Bénin, quelle que soit la
région du pays, nous pouvons classer les danses africaines du
Bénin en trois catégories à savoir2
:
- Les danses de réjouissances sont
exécutées lors de cérémonies ou de rituels
très divers comme les mariages, les naissances ainsi que dans la plupart
des évènements qui rythment la vie quotidienne au Bénin.
Nous trouvons suivant les régions du pays : le Massé gohoun,
l'Adjogbo, l'Agbadja, le Kaka, le Kunya, le Tipinti, le Fabenfé,
l'Atchanoun, le Sinssinnou, etc.
- Les danses royales relatent des divinités et
parlent d'elles. Nous avons Klulima, Idjombi, Houngan, Sato,
Blékété, Chasseur, Adjogan, Linsouhoué,
Agbéhoun, Kpodjiguêguê, Guêlêdê, Abikou,
Têkê, Egoungoun, Tchinkoumè, Zinlin, Zangbéto,
Bourian
2
http://www.benin-voyage.com/2014/04/
4
Les danses vodou, danses sacrées, très
endiablées, multicolores, émouvantes qui évoquent les
diverses divinités responsables du ciel, de la terre, de l'air, du
bonheur etc. Ces danses africaines vodou s'intitulent : Sakpata,
Hêviosso, Tchango, Dan, Kokou, Ganbada. Aujourd'hui le secret de ce culte
vodou est encore intact et jalousement entretenu par les gardiens de la
tradition (les maîtres des couvents et les initiés).
La présente étude se situe dans le cadre
de notre mémoire de fin d'études de licence en Sciences et
Techniques des Activités Socio-éducatives (STASE). Elle porte sur
la danse «Agbéhoun», une danse populaire du Sud-Bénin.
Cette danse est une importante ressource culturelle des populations de cette
région du Bénin. Il nous paraît important de la documenter
et de la décrire dans la perspective de son inscription au patrimoine
culturel du Bénin et dans le programme du développement des arts
et loisirs du pays.
La danse est communément perçue comme un
élément du patrimoine culturel et artistique des peuples
d'Afrique en général. Il s'agit des danses traditionnelles et des
danses importées, dites modernes lorsqu'elles viennent de l'Occident
(Europe, Amérique). Au Bénin en particulier, les danses
traditionnelles sont associées à divers religions et cultes,
notamment le culte « Vodou ». Certaines musiques béninoises
actuelles s'inspirent explicitement des cultes Vodou. Elles traduisent les
formes d'appropriation ou de réappropriation de la tradition par les
jeunes générations, qui revendiquent cependant une
créativité ouverte aux influences extérieures. Elles sont
donc susceptibles de donner des indications sur la réalité
sociale et culturelle béninoise et sur les représentations que
les musiciens et leur public se font de leur place dans le monde qui les
entoure. Les textes des chansons montrent comment, à partir
d'évènements ordinaires tels que les rituels festifs 3
célébrés dans les familles ou des collectivités ou,
à l'inverse, lors des rencontres nationales et internationales au
Bénin et à l'étranger, les musiciens décrivent les
bienfaits des cultes Vodou, décodent les interactions entre le Vodou et
les groupes sociaux, évoquent les endroits où les cultes sont
pratiqués.
Il s'agit de préciser l'intérêt de
l'étude pour la culture, la science et le développement. Comme
signalé ci-dessus, si l'on peut réunir suffisamment
d'informations sur cette danse, il sera possible d'indiquer sa place dans le
développement culturel et artistique du Bénin. «
La
3 Poda M. B., 2009.
"Appropriation territoriale dans les rituels festifs à Ouidah
(Bénin)", Colloque international "Musique, territoire et
développement local", 19 et 20 novembre, Grenoble, CNRS PACTE, UMR 5194,
à paraître.
5
musique nourrit bien son homme », disait Gnonas
Pedro, artiste béninois de la chanson moderne, malgré le piratage
croissant des oeuvres d'art musical. Or musique et danse sont quasiment
inséparables. En général, la musique incite à
danser. On danse soit pour le simple plaisir de le faire pour se
réjouir, soit pour la détente afin de vaincre le stress, soit
pour un exercice physique afin d'améliorer sa santé, soit lors
d'un office religieux. Ainsi, la danse aussi pourrait nourrir son homme. Mais
alors quel genre de danse, par qui et comment ? Si les danses de spectacles
pratiquées par les chorégraphes et les acrobates dans le cadre de
divers ballets et divers autres arts scéniques peuvent nourrir son
homme, qu'en est-il alors des danses traditionnelles ? C'est ce que la
présente étude cherche à savoir, après un bref
aperçu général des cultures associées aux danses
diverses au Sud-Bénin. L'étude voudrait établir la place
du Agbéhoun dans le tissu culturel et artistique de cette région.
Elle se situe à la fois dans une perspective de revalorisation des
cultures et danses du Bénin et celle de l'insertion des jeunes dans les
emplois artistiques.
1.2. Objectifs de la recherche
1.3.1. Objectif
général
L'étude vise à comprendre comment la
danse « Agbéhoun » est un outil d'intégration et de
développement au Bénin. Il s'agit d'identifier le champ culturel
de cette danse, d'établir son importance dans l'ensemble des cultures
des populations qui la pratiquent et les valeurs positives d'intégration
et de développement qu'elle véhicule.
1.3.2. Objectifs spécifiques
(OS)
OS1 : Faire une historique de la danse Agbéhoun
afin d'identifier son champ culturel et son espace géographique (terroir
culturel et limites géographiques)
OS2 : Etablir la relation entre le Agbéhoun et
l'ensemble des cultures des populations du terroir culturel concerné au
Sud-Bénin
OS3 : Identifier les valeurs d'intégration et
de développement que véhicule la danse
Agbéhoun
OS4 : Analyser l'usage de ces valeurs par les
populations de son terroir culturel et d'ailleurs au Bénin, en Afrique
et dans le monde.
6
CHAPITRE 2

PROBLÉMATISATION DE LA RECHERCHE
7
2.1. Revue de Littérature
La danse Agbéhoun (AGBE-HOUN4) est
originaire d'Oyo (Nigéria) et est identitaire des peuples yorubas. Cette
danse est apparue à Ouidah, avant d'apparaitre à Porto-Novo. Les
précurseurs de cette danse sont les groupes Egbewolé et Egbeyemi
entre autres. Elle est maintenant dans les villes comme Allada, Ouidah, Abomey,
Savalou, Cotonou et bien évidemment Porto-Novo.
Elle renferme quatre grands rythmes à savoir le
Agbé, le Kosso, le Oguèdè et le Adjaba. Le Agbé,
est un rythme subdivisé en deux (le Agbé rapide et le Agbé
lent « le Idjètcha »). Le Idjètcha est similaire au
rythme « Tshango » (pour le culte du dieu Hêviosso). Les
percussions qui accompagnent le Agbé rapide sont le Gbon, le Dougba, le
Klékpa, le Kléklé et les Agogo ou Ahwanlingan tandis que
le Agbé lent ou Idjètcha est accompagné par le Dougba, le
Klékpa, le Kléklé, les Agogo et le
Agbéka.
Le Ogbon est un instrument de musique appelé
encore « Yalo ». Il est réalisé avec des branches
d'iroko, du cerceau de fer, du Hounssikan5 et soit avec de la peau
de chat, de la peau de serpent, de la peau de jeune biche ou de la peau du
bélier. Il est utilisé dans les cultes Egoungoun, dans le culte
du Hêviosso et dans le rythme Agbéhoun. Ogbon est une percussion
provocatrice de transe chez les adeptes de vodou HEVIOSSO6. Ogbon
fait danser l'âme des défunts. Il est le symbole de la joie, il
occupe la première place dans le rythme Ogbon même
(egunhoun7) (Eric Ahouansou, 2015)8. On le retrouve dans
les aires culturelles d'Adja-tado, yoruba-nago.
Le côté mythique du Agbéhoun
réside dans le fait que toute personne ne peut danser à son
rythme, puisque les instruments ou percussions qui l'orchestrent en particulier
le Ogbon (Yalo) est un instrument sacré que seuls les initiés qui
maitrisent le Odjê (yoruba) ou AWO (goun) qui signifie « secret du
couvent ». Ces percussions du Agbéhoun, avant une
quelconque
4 Rythme OGBON (EGOUN-HOUN)
auquel on ajoute le son résonnant de l'instrument AGBE. On distingue en
ce moment trois AGBE : deux grands et un petit.
5 Fil souvent utilisé dans la fabrication des
Tam-tams africains
6 dieu de la foudre et du tonnerre. Dieu Guerrier,
assimilé au dieu THOR chez les Scandinaves.
7 Rythme traditionnel destiné aux masques
EGOUN-GOUN
8 Eric Ahouansou, «
rôle et symbole de chaque instrument sur les plans physique et
métaphysique », 2015
8
sortie, doivent être rassemblées au sol,
suivi d'une prière que dont les mots sont seulement connus des
initiés. Pour honorer leur fidélité aux instruments et
pour rendre hommage aux anciens, ils font des rituels en offrant des boissons
sucrées, de l'eau, du sodabi (vin de palme), des beignets et des colas
en sacrifice puis lancent du « adji » pour savoir ce que l'avenir
leur réservera.
Agbéhoun a beaucoup évolué
à travers les époques puisqu'elle est identitaire des peuples
yoruba-nago (Nigéria) qui étaient les premiers occupants de
« Adjatchê » (Porto-Novo), chassés lors d'une razzia par
Tê-Agbalin qui devint fondateur de la ville de Hogbonou aujourd'hui
Porto-Novo. Ces derniers déportés à Ouidah comme des
esclaves, où ils siègeront avec leurs coutumes et traditions. Et
pour se rappeler de leurs ancêtres, ils jouaient en hommage à
« Orisha » (la vie) d'où la danse Agbéhoun.
La présente étude n'est pas la
première à aborder les questions liées aux traditions
béninoises, en particulier les danses traditionnelles. Après nos
investigations, nous avons constaté que bien d'autres auteurs (PODA,
M.B, Doussou Soumani, etc.) et même l'Etat béninois se sont
penchés sur la question des danses traditionnelles à travers
mémoires, conférences, et festivals.
Travaux réalisés au Bénin et
dans le Golfe de Guinée (Afrique de l'Ouest) sur les danses
traditionnelles
L'Afrique n'est ni un campement, ni un village, ni une
ville, ni un pays, mais un continent. Par ailleurs, l'Afrique d'hier n'est pas
l'Afrique d'aujourd'hui et ne sera pas l'Afrique de demain.
La danse et la création africaines doivent,
dans une certaine mesure, être le miroir de ces
réalités.9
Les artistes de la troupe béninoise « Les
Supers-anges Hwendo-na-bu-a » du chorégraphe Alladé Coffi
Adolphe font la promotion et valorisent les danses traditionnelles du
Bénin à l'international et par ricochet, toute la culture
béninoise.
Ceci à travers plusieurs représentations
de spectacles de danses traditionnelles du Bénin entre autres le Zinli
d'Abomey dans le département du Zou, le Tipenti de l'Atacora, la danse
sacrée de Sakpata, le dieu de la terre au Bénin, la danse des
calebasses pratiquée dans le département
9Alphonse Tierou, « Ce
que je crois », 2000
9
de l'Alibori ainsi que le Guêlêdê
reconnu patrimoine immatériel de l'Unesco. Dans le cadre de cette
tournée des « Supers-anges Hwendo-na-bu-a », le
président Alladé Coffi Adolphe a délégué ses
pouvoirs à l'artiste Ayi Kuevi Aubin qui est le chef de la
délégation. En effet, « Les Supers-anges Hwendo-na-bu-a
» feront la fierté du Bénin en présentant des
tableaux de danses du Sud et du Nord Bénin, dans les villes telles que
Dijon et Bordeaux respectivement les 18 et 21 juin 2016 et dans bien d'autres
villes de l'Europe. Cette belle opportunité d'exportation des danses
traditionnelles du Bénin pourra également conquérir
plusieurs touristes vers la destination Bénin car au-delà de cet
art qui est promu et valorisé à l'international, c'est toute la
culture du Bénin qui est à l'honneur. Les festivaliers venus des
quatre coins du monde, découvriront l'expression de la culture
béninoise à travers les prestations des artistes de la troupe
« Les Supers-anges Hwendo-na-bu-a », leurs accoutrements, les
chansons exécutées dans les langues du Bénin ainsi que les
instruments de percussion. Il est à noter que cette tournée des
Supers-Anges a reçu le soutien du ministère béninois de la
culture à travers le Fonds d'aide à la Culture qui oeuvre pour
une gestion plus transparente, plus crédible avec plus d'impact sur le
développement culturel du Bénin. Créée en 1986, la
troupe les « Supers-anges Hwendo-na-bu-a » qui signifie « le
patrimoine culturel ne disparaîtra jamais » honore le Bénin
chaque année sur les festivals internationaux.10
2.2. Clarification conceptuelle
2.2.1. La culture et les loisirs
La plupart des danses sont portées par une
culture ou en sont l'expression, et constituent une forme de loisirs. Qu'est-ce
donc la culture ?
Nous faisons nôtre la définition qu'en
donne Marie-Claire Gousseau lorsqu'elle écrit : « La culture est
faite de savoir, somme des connaissances humaines, transmise par
l'enseignement, assimilée par l'Education ; elle anime les
communautés naturelles, en particulier les métiers par le canal
des techniques ; elle suscite l'harmonie sociale, nécessite un
véritable humanisme, ne vit qu'ordonnée aux notions d'Etre, de
Vrai, de Bien, de Beau ; elle s'incarne dans les peuples, les nations, les
patries et y crée un art de vivre en société aux visages
multiples qui
10
http://jaimelaculture.over-blog.com/2016/06/promotion-et-valorisation-des-danses-traditionnelles-du-benin-a-l-international-les-supers-anges-hwendo-na-bu-a-sur-plusieurs-festiv,
Henri MORGAN
10
forme cependant par son unité profonde le
patrimoine universel qui est la civilisation » (M. C. Gousseau - Qu'est-ce
que la culture ?, Paris 1969). Nous retiendrons de cette définition que
le caractère universel de la culture, diverse cependant en ses
incarnations dans le temps et dans l'espace, en fait le patrimoine de tous les
hommes donc des peuples d'Afrique.
C'est une notion complexe, dans la mesure où ce
mot a des résonances extrêmement différentes. Nous sommes
dans une période de crise de civilisation qui est le résultat
d'une crise de cultures (Ibrahima Baba KAKE, 1985). La culture africaine fut
longtemps niée dans la mesure où l'on parlait de peuple sauvage
au lieu de cultures. Pourtant, bien que différente de la culture
occidentale, la culture africaine est plus ancienne qu'elle. Les historiens
nous enseignent que le Noir est au centre même d'un miracle qu'il faut
avoir la loyauté de mettre à sa place, c'est le miracle
égyptien. Nous dirons le « miracle nègre ». Le miracle
grec, ce mot gonflé de suffisance que l'Europe doit à Renan
(1883), recouvre un ensemble de réalités historiques qui ne sont
pas seulement postérieures au fait égyptien mais en sont issues.
Pendant toute la période égéenne, l'influence culturelle
nègre a été prédominante à un moment
où les Blancs étaient des plus frustes et il faudra attendre des
millénaires pour que les Indo-Européens puissent valablement
profiter des leçons de l'Egypte nègre. La technique y avait
atteint un degré élevé de perfection. Les corps de
métiers y étaient variés : céramistes,
orfèvres, tapissiers, etc. On y fabriquait des tissus par des
procédés qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique Noire. C'est dans
la Vallée du Nil que naquirent presque toutes les conceptions
théogoniques purement africaines (Ibrahima Baba KAKE, 1985).
Une question qui revient constamment c'est de savoir
si l'Afrique a une culture propre et à quoi peut servir celle-ci. Comme
dans tout autre domaine aujourd'hui, en Occident la plus grande confusion
règne à ce sujet. Il en est de même en Afrique où
les nouvelles générations qui sont sous l'influence de l'occident
(depuis leurs pensées jusqu'à leurs manières d'agir), en
raison de l'instruction classique, formelle, reçues dans les
écoles.
La culture négro-africaine, ce n'est point ce
syncrétisme qu'affectionnent et encouragent les médias des pays
occidentaux voire des nouveaux Etats africains. Le rôle primordial de la
culture africaine, faut-il le rappeler a toujours été d'enseigner
une certaine idée de l'homme et de la nature et de contribuer à
l'harmonie de leurs relations. Si nous examinons le domaine religieux, force
est de constater que l'Afrique est la terre de prédilection de
l'animisme. Il
11
n'est pas indifférent de préciser la
structure sociale actuelle de l'Afrique et de voir si elle renferme les
éléments d'une résurgence culturelle valable.
Le problème des cultures d'avenir est
lié à celui de l'identité culturelle, propédeutique
du véritable développement d'un peuple (Ibrahima Baba
KAKÉ, 1985).L'identité
culturelle d'un peuple, c'est le droit qu'il a de rester lui-même envers
et contre toutes les formes d'assimilation et de cultures du monde
contemporain. Ces forces jouent le plus souvent en faveur des pays
développés.
Qu'est-ce que les loisirs ?
Le loisir est l'activité que l'on effectue
durant le temps libre dont on peut disposer11. Ce temps libre
s'oppose au temps prescrit, c'est-à-dire contraint par les occupations
habituelles (emploi, activités domestiques, éducation des
enfants...) ou les servitudes qu'elles imposent (transports, par exemple).Le
mot, dérivé du verbe latin licere (être permis),
renvoie, au début du XIIe siècle, aux notions
positives de liberté, et d'oisiveté. Puis, à partir du
XVIIIe siècle, il évolue vers le sens de
divertissement.
On qualifie également le loisir de « temps
libre », soit un temps usuellement consacré à des
activités essentiellement non productives d'un point de vue
macroéconomique, activités souvent ludiques ou culturelles :
bricolage, jardinage, sports, divertissements... Cela a entraîné
par la suite un glissement sémantique du terme « loisir »
(temps libre) vers celui de « loisirs » (divertissements et
sports).Le mot a commencé à accuser ce glissement de sens dans
les années 1960-70, sans doute à la suite de son usage
répété dans l'expression « civilisation des loisirs
» (expression que l'on doit à Joffre Dumazedier dans un de ses
ouvrages, publié en 1962, Vers une civilisation du loisir ?) .
Beaucoup usent du terme comme synonyme de « divertissement », ce qui
constitue une déviation importante de signification.
2.2.2. L'émancipation
culturelle
Certains types de danse peuvent être
perçus comme une expression d'émancipation culturelle. On a
l'habitude de réduire l'émancipation aux dimensions massives,
spectaculaires et historiques des peuples en marche mettant à bas les
rois ou les tyrans. On oublie ainsi que les
11 Laurent Turcot, Sports
et Loisirs. Une histoire des origines à nos jours, Paris, Gallimard,
2016, p. 1314.
12
grandes émancipations, dont
l'évènement révolutionnaire reste le modèle de
référence, sont souvent la convergence et l'agrégation de
petites émancipations individuelles ou groupales.
Nous faisons le choix d'une définition modeste
de l'émancipation. S'émanciper, c'est sortir, aussi limité
que cela puisse paraitre (une première prise de parole pour celui qui
n'a encore jamais osé, une première signature de
pétition...), de la place qui nous a été assignée
par les rapports sociaux, le genre, l'âge, le handicap, la maladie, les
accidents de la vie, quelques fois
notre culture d'origine (Christian Maurel, 2010)
...
S'émanciper ne relève pas uniquement
d'un choix libre et délibéré qui nous permettrait de
sortir définitivement d'une situation de dépendance,
d'assujettissement, d'aliénation ou d'asservissement. Autant de choses
qui nous conduisent à penser qu'on ne s'émancipe jamais seul. Ce
processus émancipatoire, comme tous ceux que nous venons de citer et qui
y sont associés, est de nature culturelle. Sans pour autant nier
l'importance de la culture au sens des manières de vivre, ce que
Jean-Claude Passeron appelle « les styles de vie » extrêmement
divers dans nos sociétés complexes, ni la culture au sens des
« oeuvres valorisées », notamment l'art et le savoir
scientifique, il apparait que c'est la culture en tant que paroles porteuses de
sens et toutes le sont à leur manière qui est principalement au
travail dans les processus concourant à
l'émancipation.
Deux questions se posent. La première est de
savoir comment on passe de l'émancipation individuelle à
l'émancipation collective dans laquelle les femmes et les hommes
construisent de nouveaux droits et deviennent « auteurs-acteurs » de
l'Histoire. Nous pensons y avoir, en partie, répondu en montrant que,
dès le partage de la parole, la confrontation des points de vue et la
co-construction des savoirs, chacun fait un pas vers le collectif et vers une
communauté d'action. A cela, il faut ajouter que
l'évènement (le renvoi de Necker en 1789, la prise des canons de
Montmartre, le 18 mars 1871...) qui fait sens, joue un rôle de
déclencheur d'un plus large mouvement d'ensemble. Mais,
précisément, l'évènement ne peut faire sens que
grâce à un processus culturel préalable
d'émancipation comme les Cahiers de doléances de 1788-89 qui sont
un grand moment d'expression et d'éducation populaire, ou encore par
cette « dimension culturelle du mouvement ouvrier » (Luc Carton) qui
tout au long du 19ème siècle a ouvert de nouvelles perspectives
sociales et politiques. Ainsi la culture y trouve toute sa
13
fonction historique d'attribution de sens,
c'est-à-dire d'analyse critique des situations et de direction dans un
processus de transformation.
La deuxième question concerne les acteurs
sociaux, culturels et politiques de l'émancipation. Nous pensons aux
militants chevronnés, aux « professionnels de la révolution
», aux éducateurs populaires, à certains intellectuels et
artistes engagés... On ne peut ni ne doit attendre d'eux qu'ils
apportent, en quelque sorte « clé en main »,
l'émancipation sous la forme d'une lumière extérieure
venant d'en haut qui conduirait les « masses » vers un avenir
radieux. Ils doivent accompagner, faciliter et non guider, se tenir
derrière ou sur les côtés mais jamais devant ceux qui
s'engagent dans un processus d'émancipation. A la différence du
maitre affranchissant son esclave, la véritable émancipation ne
saurait être octroyée mais conquise. Souvenons-nous des premiers
mots des statuts de l'Association Internationale de Travailleurs (1864) :
« L'émancipation de la classe ouvrière doit être
l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes
»12.
L'histoire s'est chargée de réduire la
portée de cette ambition, institutionnalisée à travers
l'action et les politiques culturelles, et d'en montrer les
ambiguïtés. Comme l'écrit Robert Jaulin (1970 ?) : les
« hommes » n'existent qu'en terme de culture, et la planète
terre héberge diverses cultures humaines irréductibles entre
elles ; ces cultures s'assument, s'inventent, ne sont jamais figées,
elles ne peuvent dialoguer que si elles existent, que si l'humanité
demeure plurielle.
L'annexion politique prépare l'annexion
culturelle. La décolonisation, disait Senghor au Congrès sur la
Civilisation mandingue de Londres (1972), ne se fait pas toujours dans le
dialogue des civilisations. Ou elle se fait mal. Les businessmen se
réunissent plus souvent que les hommes de culture ; entre gouvernements
on parle plus volontiers économie et finances, enseignement et formation
dans les meilleurs cas, qu'art et littérature ou simplement
éducation, la pollution des esprits est pire que celle des plages, voire
celle des villes ; la
12 Christian Maurel, Les processus culturels
de l'émancipation, L'Harmattan, 2010.
14
solution du problème culturel est la condition
sine qua non du développement, et même de toute
croissance.13
2.2.3. La danse : élément d'une
culture, d'un loisir ou d'un art
L'époque est au retour. On ne compte plus les
grands artistes africains, qui après avoir obtenu un succès
occidental, cherchent à s'investir à nouveau sur leur terre
natale. Ce mouvement est particulièrement sensible chez les
chorégraphes. La Sénégalaise Germaine Acogny, les
Burkinabés Salia Sanou et Seydou Boro, en ouvrant des centres
chorégraphiques dans leurs pays respectifs, en sont trois exemples
éclatants. Koffi Koko, danseur-chorégraphe béninois de
renommée internationale14, pionnier d'une danse africaine
renouvelée dans le sillage d'Elsa Wolliaston, a lui aussi amorcé
ce retour avec la première édition du festival « Atout
Africain » qui s'était déroulé du 3 au 21 janvier
2002 dans l'historique cité négrière de Ouidah, sur le
littoral béninois.
Entre vodou et modernité ; une dizaine de
compagnies de danses traditionnelle et contemporaine africaines était
programmée, pour la plupart béninoises, les autres venant de cinq
pays de la sous-région : Mali, Tchad, Burkina Faso,
Sénégal et Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre du festival
était « revendiquer non une rupture mais une continuité dans
la création chorégraphique africaine contemporaine ». «
Rendre hommage à la tradition avant de s'ancrer résolument dans
le présent et la création contemporaine » résume
cette position qui anime bon nombre de pionniers de la nouvelle danse africaine
tels Germaine Acogny, Souleymane Koly ou Alphonse Tierou. Pour Koffi Koko comme
pour eux, la création contemporaine doit se fonder « sur la
richesse immense de la tradition séculaire ». Pas question de
renier, de délaisser ce vocabulaire premier sous prétexte de
modernité. Cette génération aînée prône
en général un enracinement de la danse dans sa culture d'origine
et met souvent en garde les jeunes qui s'orientent davantage vers une
rupture.
« La danse n'est rien d'autre qu'un moyen par
lequel je peux envoyer des messages. Il est important à travers elle
d'installer un réseau de signes à la fois universels, mais
aussi
13
http://espacerda.over-blog.com/article-culture-africaine-identite-culturelle-developpement-dialogue-des-cultures-80323218.html,
Ibrahima Baba KAKÉ
14 On a pu le voir
récemment dans la magnifique adaptation chorégraphique des Bonnes
de Jean Genêt par le Japonais Yoshi Oida
15
spécifiques à ma culture d'origine
», souligne Koffi Koko. Son art est « l'expression d'une
liberté intégrale, mais qui part de ses souches. Sa danse, comme
celle contemporaine en général, se rapproche du sacré et
du secret », ajoute Florent Eustache Hessou.
Le débat autour du sempiternel dilemme de la
création africaine prise entre tradition et modernité a
été au coeur du colloque organisé en marge du festival. Y
ont pris part de nombreux intellectuels et personnalités culturelles
béninoises notamment le sociologue Emile Désiré Ologoudou,
le linguiste Toussaint Tchitchi, l'historien Emmanuel Karl ou encore le jeune
dramaturge et directeur adjoint du Ballet national Eustache Florent Hessou.
L'objectif principal de ce colloque était de jeter les bases «
d'une réflexion scientifique sur la création » qui puisse
éclairer la conduite et la philosophie d'un futur centre
chorégraphique. Son caractère transdisciplinaire n'a pas
manqué d'intérêt.
D'autres manifestations ont eu lieu en marge des
spectacles et du colloque : concerts, stages de formation, exposition-vente
d'arts plastiques. Le programme de cette première édition d'Atout
Africain a peut-être voulu voir trop grand. Quelques problèmes
d'organisation ont été soulevés. Mais la grande
réussite du festival était indéniable. Lorsqu'on sait la
difficulté qu'ont les jeunes compagnies de danse contemporaine
africaines à se produire devant un public populaire, se heurtant souvent
à une forte incompréhension lorsque ce n'est pas une franche
hostilité, on ne peut qu'encourager toute entreprise de sensibilisation.
N'est-ce pas la condition sine qua none pour que la danse continue de se
développer sur le Continent ? Les chorégraphes peuvent-ils
perpétuellement se couper de leur public local ? (AYOKO MENSAH,
2002)
2.2.4. L'intégration
La culture est un domaine qui englobe aussi bien les
croyances, les valeurs, la religion que les loisirs et les habitudes
alimentaires. Chaque société produit ses normes en fonction de
son historicité15. Dans les sociétés
traditionnelles la culture est sacralisée. Elle résulte
d'épreuves passées et de la manière dont elles ont
été surmontées. Les rites et les croyances persistent
alors même que les causes qui sont à leur origine ont disparu.
Cette dimension est mal perçue par l'Occidental qui, vu sa
rationalité, réduit la dimension des choses au fonctionnel. En
Occident se trouvent des sous-groupes culturels qui reflètent tant le
passé que le présent. Les
15 a et b Manuel Boucher, Les
théories de l'intégration, L'Harmattan, 2000, p.
262
16
cultures d'un chef d'entreprise catholique
intégriste, d'un ouvrier communiste athée ou d'un petit paysan
d'un village qui se meurt sont profondément
dissemblables16.
Intégration est un terme qui a deux sens. En
politique publique il est employé comme résultat recherché
ou réclamé. Pour les sociologues, l'intégration est un
processus social susceptible, comme tout processus, d'avancées, de
retournements et d'invention de modalités
nouvelles17.
L'intégration culturelle est une partie de
l'intégration structurelle. Cette dernière comprend en outre
l'intégration dans les structures sociales de la société
(travail, habitat, etc.) et une participation efficace à la vie
collective (associations, élections, etc.). Dans l'intégration
culturelle l'immigré doit renoncer à une partie de sa culture
d'origine. L'acquiescement à ce renoncement est très variable
d'un individu à l'autre. La société d'accueil y joue un
rôle. Le processus est interactif.
L'intégration culturelle s'oppose à
l'assimilation culturelle où la personne ne se reconnaît plus dans
son ancien système. Dans l'intégration culturelle elle ne
conserve de ses anciennes références, si elle le désire,
que celles qui sont compatibles avec les exigences de la vie commune et les
valeurs collectives de la société d'accueil. Cet abandon
s'effectue à des degrés divers selon les individus.
2.2.5. Le développement
Le terme de développement, utilisé dans
les sciences humaines, désigne l'amélioration des conditions et
de la qualité de vie d'une population, et renvoie à
l'organisation sociale servant de cadre à la production du
bien-être. Définir le développement implique de le
distinguer de la croissance. Cette dernière mesure la richesse produite
sur un territoire en une année et son évolution d'une
année à l'autre, telle qu'elle est prise en compte par le Produit
Intérieur Brut (PIB). Elle ne dit rien, en revanche, sur ses effets
sociaux. Elle n'informe donc que peu sur le niveau de vie et encore moins sur
la qualité de vie. La croissance peut contribuer au
développement, mais tel n'est pas toujours le cas et on parle de
croissance sans développement
16 Carmel Camilleri-Margalit Cohen-Emerique (Sous la
direction de), Chocs de cultures : Concepts et enjeux pratiques de
l'interculturel, L'Harmattan, 1989, p. 51 et 53
17 Dominique Schnapper, Qu'est-ce que
l'intégration ? Gallimard, 2007, p. 24 et 21
17
quand la production de richesse ne s'accompagne pas de
l'amélioration des conditions de vie. Inversement, même en
l'absence de croissance, la priorité donnée aux productions les
plus utiles et une plus grande équité dans la distribution des
biens produits améliore les conditions de vie des populations et
crée du développement.
Amélioration du bien-être, le
développement relève donc davantage du qualitatif que du
quantitatif. Néanmoins, l'économiste indien Amartya Sen a mis au
point un Indicateur de Développement Humain
(IDH)18
Parce que la qualité de la vie ne se
réduit pas au bien-être matériel et comprend aussi des
valeurs telles que la justice sociale, l'estime de soi et la qualité du
lien social, le développement a à voir avec ce que les
anglophones disent par le mot de « empowerment », terme construit sur
power et qui désigne la capacité d'un individu ou d'un groupe
à décider pour lui de ce qui le concerne et à participer
au débat citoyen. En effet, le développement ne peut pas se
réaliser sans la participation des personnes, c'est-à-dire
finalement sans la démocratie. Ainsi, Amartya Sen insiste-t-il sur la
possibilité effective que les personnes ont ou n'ont pas de
définir leur projet de vie et de conduire ce dernier en fonction des
conditions réelles qui leur sont faites. Ces conditions
dépendent, certes, des ressources matérielles, mais aussi de
données propres à chaque individu, par exemple la santé,
et de données relatives à l'organisation sociale et politique,
par exemple la place dévolue à chacun et la reconnaissance de son
rôle. Le développement a donc des aspects économiques,
sociaux et politiques. Désignant par capabilités les
possibilités qui s'offrent aux personnes et la liberté qu'ont ces
dernières de choisir, Amartya Sen (2000) affirme que la liberté
apparaît comme la fin ultime du développement, mais aussi comme
son principal moyen pour considérer en conséquence que le
développement peut être appréhendé ... comme un
processus d'expansion des libertés réelles dont jouissent les
individus.
Le sous-développement résulte selon de
nombreux économistes (André Gunder Frank, Celso Furtado), de la
dépendance à l'égard de l'extérieur, des auteurs
ont préféré parler de pays dominés ou de pays
exploités, plutôt que de pays sous-développés. Cette
interprétation a
18Amartya Sen, Un nouveau
modèle économique, Développement, Justice, Liberté.
Paris, O. Jacob, 2000, 356 p.
18
conduit à voir les pays
développés comme un centre exerçant une domination sur une
« périphérie » constituée par les pays
sous-développés (Samir Amin).
Cette réflexion a montré l'insuffisance
de la terminologie. En effet, les inégalités ne résultent
ni d'un retard pris par certains territoires, ni de dysfonctionnements dans le
processus du développement. Elles sont internes au développement
lui-même, lequel bouscule les hiérarchies existantes, en
crée d'autres, produit des dépendances et des
inégalités de nature sociale et spatiale.
N'est-ce pas parce que le développement
lui-même est une utopie : le développement est un processus de
progrès de la qualité de la vie à qui il serait arbitraire
de fixer un terme, mais auquel il est nécessaire de fixer un
cap.19Placer la culture au coeur du développement est un
investissement capital dans l'avenir du monde, la condition du succès
d'une mondialisation bien comprise qui prenne en compte les principes de la
diversité culturelle : l'UNESCO a la mission de rappeler cet enjeu
capital aux nations.
Le défi à relever est de convaincre
décideurs politiques et acteurs sociaux locaux, nationaux et
internationaux, d'intégrer les principes de la diversité
culturelle et les valeurs du pluralisme culturel dans l'ensemble des
politiques, mécanismes et pratiques publiques, via notamment des
partenariats public/privé. Il s'agit d'ancrer la culture dans toutes les
politiques de développement, qu'elles concernent l'éducation, les
sciences, la communication, la santé, l'environnement, le tourisme et de
soutenir le développement du secteur culturel par le biais des
industries créatives : ainsi, en contribuant à
l'atténuation de la pauvreté, la culture est-elle un atout pour
la cohésion sociale.
2.3. Cadre théorique / modèle
d'analyse
Il s'agit ici d'indiquer les relations qui existent
théoriquement entre les concepts qui découlent de la revue de
littérature, et de décrire le modèle qui va servir de base
à l'analyse du sujet de l'étude. Ce modèle est une
série de relations de cause à effet entre quelques variables
empiriques qui sont des indicateurs observables de ces concepts.
Ainsi, le cadre théorique de l'étude est
traduit dans la figure N°1 : Il s'agit des liens entre culture, loisirs,
arts, danse, intégration et développement.
19
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article511,
Bernard Bret
19

INTEGRATION
DEVELOPPEMENT
ARTS
CULTURE
LOISIRS
.
DANSE
Figure 1 : liens entre culture, loisirs, arts,
danse, intégration et développement.
Le modèle empirique d'analyse est
dérivé du précédent, comme découlant du
cadre théorique et des données qu'il nous est possible de
collecter par observation directe ou à travers la documentation
factuelle dans les musées officiels/matériels et les
musées informels matériels ou immatériels (couvents). Il
est illustré dans la figure N°2:
20
|
EXPERIENCE
Proposition d'un projet
évènementiel
basé sur la danse
Agbéhoun
|
|
|
|
|
CONSTATS
- Objectifs poursuivis -
Résultats effectifs
|
ACTIONS CORRECTIVES
- Information
- Sensibilisation
- Contrôle et régulation
|
|
|
REFERENTIELS
- Objectifs prescrits - Résultats
attendus
- Stratégies et moyens prévus
|
|
COMPARATEUR
- Identifier le champ culturel et les valeurs
positives d'intégration et de développement
- Établir son importance dans
l'ensemble des
cultures
|
|
REGULATEUR
- Objectifs
- Informations
- Pertinence des actions
|
Figure 2 : Modèle d'évaluation
adopté pour la présente étude
21
2.4. Problématique
Le colonisateur avait caractérisé
l'Afrique comme le continent d'une « mosaïque de peuples, de races,
de langues et de cultures20 » (Cheikh Anta Diop, 1979), ce qui
selon lui n'était pas favorable au développement. Cette
perception l'avait amené à imposer sa langue aux peuples
colonisés et à installer son centre « culturel » dans
les principales capitales du continent. Mais l'on sait bien que cela
participait d'une stratégie d'inféodation forcée de ces
peuples à la culture étrangère, afin de recruter des
commis dans l'administration coloniale dont l'activité principale
était le commerce des ressources des territoires occupés vers la
métropole.
Pourtant, malgré l'éducation formelle
dans la langue étrangère, les peuples africains ont gardé
leurs cultures et leurs us et coutumes mais sans véritablement les
développer pour conquérir le monde. Pour inciter les pays
africains à revaloriser les cultures de leurs peuples, les
déclarations suivantes ont été faites par
d'éminents penseurs africains : « un peuple sans histoire est un
peuple sans âme21 » (Joseph Ki-Zerbo, 1978) ; « un
peuple sans culture est un peuple perdu22 » (Anthony Biakolo,
1980). La danse fait partie du patrimoine culturel des peuples d'Afrique, en
particulier ceux du Golfe de Guinée dont le Bénin.
Aujourd'hui, au regard du faible niveau de
développement des pays d'Afrique au Sud du Sahara dont le Bénin,
l'on se demande si la culture en général ou la danse en
particulier est véritablement un outil d'intégration des peuples
(races, ethnies) africains et du développement du continent. En
particulier, on veut bien savoir si les danses traditionnelles peuvent
être un tel outil. A cet effet, quelques questions qui taraudent notre
esprit dans le cadre de la présente recherche sont : La danse
Agbéhoun, une danse traditionnelle du Sud Bénin, est-elle un
facteur de promotion d'une culture spécifique, laquelle ? Est-elle un
facteur de mélange des cultures, lesquelles ? Peut-elle être un
facteur d'émancipation culturelle et d'intégration des peuples du
Sud Bénin ? Quelle est ou quelle peut être sa contribution
à l'emploi des jeunes ?
En d'autres termes, au regard de la tendance des
jeunes africains à renier leurs cultures et du taux de chômage
élevé parmi eux, comment cette danse pourrait-elle permettre
d'inverser ces
20 Cheikh Anta Diop, 1979, Nations nègres et
culture, Paris, Ed. Présence Africaine, p. 15
21 Joseph Ki zerbo : « Histoire de l'afrique Noire
d'hier à demain », Hatier. Paris 1978
22 Anthony Biakolo : «
L'étonnante enfance d'Inotan », L'Harmattan éditeur, Paris,
1980, 182 pages. p.
49
22
tendances ? Pourrait-elle faire l'objet de programmes ou
projets de développement artistique ou touristique pour l'insertion des
jeunes dans le monde de l'emploi ?
Principale question de recherche
La question principale de la présente recherche
est donc : La danse Agbéhoun est-elle un outil d'intégration et
de développement du Bénin ? Sinon, quel est son potentiel
à l'être ?
2.5. Hypothèses
Hypothèse 1 : « la danse Agbéhoun
appartient à une seule culture et son champ culturel est limité
au Sud Bénin »
Hypothèse 2 : « la danse Agbéhoun est
porteuse de valeurs positives pour l'intégration et le
développement »
Hypothèse 3 : « l'importance des valeurs
d'Agbéhoun est méconnue »
23
CHAPITRE 3

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
24
La démarche méthodologique a
consisté en ce qui suit :
- Recherche documentaire dans les ouvrages,
productions et publications scientifiques faites sur la danse traditionnelle au
Bénin et en Afrique en général. Cette recherche nous a
mené naturellement à visiter les bibliothèques mais
également les structures en charge des questions relatives à
notre thème de réflexion.
- Enquête exploratoire et visite
préalable des sites et acteurs de la danse Agbéhoun dans les
communes de Porto-Novo et d'Adjarra
- Elaboration d'un guide d'entretien couvrant les
questions de la recherche et enquête approfondie par interviews avec des
personnes ressources et autres acteurs de la danse Agbéhoun dans
quelques quartiers de ces communes
- Analyse des données conformément aux
objectifs ci-dessus mentionnés.
3.1. Méthodes et techniques d'analyse des
données
Sur la base d'un guide d'entretien portant sur les
danses traditionnelles, leurs valeurs, les problèmes et solutions
préconisées pour relancer ces activités, nous avons
recueilli les informations par le biais d'un guide d'entretien, un dictaphone
et une caméra. C'est ce qui nous a permis de transcrire les idées
et d'enregistrer des paroles de notre sujet. Nous avons jugé utile de
faire un entretien direct en effectuant des observations qui seront utiles dans
le report de l'information. Outre cela, nous avons aussi essayé de
capturer quelques images utiles.
3.2. Échantillonnage
Pour mener à bien cette recherche et compte
tenu de sa spécificité, le choix des enquêtés est
aléatoire. Chaque type de cible a été interviewé en
face à face : entretien d'environ vingt minutes.
3.2.1. Taille de
l'échantillon
L'enquête est effectuée dans les
différentes groupes et ballets de danse traditionnelle, auprès de
trente-cinq (35) acteurs (acrobates, chorégraphes de groupe,
percussionnistes et chanteurs), quinze (15) promoteurs culturels et
organisateurs de festivals et (5) observateurs. Le total s'élève
à 55 personnes.
Le tableau suivant résume la taille de
l'échantillon.
25
Tableau 1 : Taille de
l'échantillon
|
Population de l'étude
|
Effectif
|
|
Promoteurs culturels et organisateurs de
festivals
|
15
|
|
Percussionnistes et chanteurs
|
20
|
|
Chorégraphes de groupes
|
10
|
|
Acrobates (danseurs sur bois de bambou)
|
5
|
|
Observateurs
|
5
|
|
Total
|
55
|
3.2.2. Collecte des données et Méthode
de dépouillement
Par le biais de personnes ressources au sein du ballet
national du Bénin, nous avons pu collecter quelques données
auprès de groupes de danse traditionnelle dans la ville de Porto-Novo et
ses environs. Ceci a été possible lors de rendez-vous pris
à l'avance pour s'assurer de la disponibilité des personnes
ciblées.
D'une façon générale, les
réponses ouvertes et qualitatives ont fait l'objet d'un tri
croisé. Par contre, les données quantitatives sont saisies,
traitées et analysées à l'aide du logiciel MS-Excel pour
en déduire des tableaux. Les informations recueillies sont traduites
ensuite en pourcentage en vue d'une interprétation. Cette étape
de la recherche consiste à mettre sous forme exploitable les
données recueillies sur l'échantillon afin d'effectuer une
synthèse générale et de tirer les conclusions qui
ressortent de la vérification des hypothèses.
3.2.3. Difficultés
rencontrées
Au cours de la réalisation de notre
étude, des difficultés ont été observées et
par conséquent, un léger retard dans la finalisation de ladite
étude. Il s'agit entre autres de :
- Des mystères entretenus par les divers acteurs -
L'indisponibilité de certains acteurs
- La réticence des cibles face à
certaines questions - Contraintes liées au temps
3.3. Méthode de vérification des
hypothèses
A une fréquence élevée de la
modalité « bon » ou « positif » d'une variable
explicative, correspond une fréquence élevée de la
modalité « bonne » de la variable expliquée. Une
fréquence est jugée élevée lorsqu'elle est de 30%
ou plus pour une variable à 3 modalités et de
26
50% ou plus pour une variable à deux
modalités. Concrètement, une hypothèse est validée
lorsqu'une perception positive de chaque variable explicative correspond aussi
à une même perception de la variable expliquée.
L'hypothèse est aussi validée lorsqu'une fréquence faible
des variables explicatives correspond à une fréquence faible de
la variable expliquée. Dans tous les autres cas, l'hypothèse est
rejetée.
27
CHAPITRE 4

PRESENTATION, ANALYSE ET DISCUSSION DES
RÉSULTATS
28
4.1. Présentation des résultats et
vérification des hypothèses
Les tableaux ci-après présentent les
résultats de notre enquête, suivis de leur interprétation.
Dans ces tableaux, les effectifs représentent le nombre de personnes
ayant répondu aux différentes questions, de telle sorte que
l'effectif total par question peut être inférieur à 55 qui
est la taille de l'échantillon des personnes
enquêtées
Tableau 2 : Représentation des
données relatives à l'hypothèse H1
|
Modalités
|
Réponses
|
Effectifs
|
Fréquences (%)
|
|
La danse Agbéhoun appartient une seule
culture
|
Oui
|
30
|
75
|
|
Non
|
10
|
25
|
|
Total
|
40
|
100
|
|
La danse Agbéhoun est limitée au sud
Bénin
|
Oui
|
25
|
62.5
|
|
Non
|
15
|
37.5
|
|
Total
|
40
|
100
|
Source : travaux de terrains, décembre
2018
Dans le tableau 2, il apparaît que 30
enquêtés sur 40, soit 75%, jugent que la danse Agbéhoun
appartient à une seule culture tandis que 25 soit 62.5% évoquent
le manque de communication et d'actions récréatives pour faire la
promotion de cette danse. Cela est dû à l'inexistence de lignes
budgétaires pour financer les initiatives et les activités afin
de mettre en place un plan de communication efficace répondant aux
attentes des cibles.
Vérification de l'hypothèse
H1
Enoncé de l'hypothèse : « la
danse Agbéhoun appartient à une seule culture et son champ
culturel est limité au Sud Bénin »
La fréquence de la modalité « oui
» de la variable « La danse Agbéhoun appartient une seule
culture » est de (75%), pendant que 62,5% pensent qu'elle est
limitée au sud Bénin. Cette observation rencontre bien
l'hypothèse avancée, car selon une déduction par analogie,
si les acteurs se voient dotés de moyens et/ou outils nécessaires
à la promotion de la danse Agbéhoun et de son identité, sa
communication serait adéquate et adaptée aux attentes des cibles
visées. On peut conclure que l'hypothèse H1 est
vérifiée.
29
Tableau 3 : Représentation des
données relatives à l'hypothèse H2
|
Modalités
|
Réponses
|
Effectifs
|
Fréquences (%)
|
|
La danse Agbéhoun est porteuse de valeurs
positives
|
Positif
|
35
|
77,78
|
|
Négatif
|
10
|
22,22
|
|
Total
|
45
|
100
|
|
La danse Agbéhoun est porteuse de valeurs
d'intégration et de développement
|
Oui
|
20
|
57,14
|
|
Non
|
15
|
42,86
|
|
Total
|
35
|
100
|
Source : travaux de terrains, décembre
2018
Le tableau 3 montre que 35 personnes
interrogées sur 45, soit 78%, jugent positives les valeurs que transmet
la danse Agbéhoun du point de vue de l'impact des activités,
alors que 20 autres sur 35, soit 57,14 pense que l'implication de la danse
Agbéhoun dans la promotion des valeurs d'intégration et de
développement est forte.
Vérification de l'hypothèse
H2
Enoncé de l'hypothèse : « la
danse Agbéhoun est porteuse de valeurs positives pour
l'intégration et le développement »
La même approche de vérification sera
adoptée, tel que déjà indiquée dans le chapitre
méthodologique. Les résultats ont montré que 77,78% des
enquêté ont jugé positives les valeurs que véhicule
la danse Agbéhoun, pendant que 62,5% disent qu'elle est un important
vecteur d'intégration et de développement. Dans la même
logique de vérification que pour l'hypothèse 1, on note ici que
la concordance est aussi établie selon la déduction par analogie.
L'hypothèse H2 est donc vérifiée.
30
Tableau 4 : Représentation des
données relatives à l'hypothèse H3
|
Modalités
|
Réponses
|
Effectifs
|
Fréquences (%)
|
|
Cohérence des actions de communication
|
Oui
|
15
|
37,5
|
|
Non
|
25
|
62,5
|
|
Total
|
40
|
100
|
|
Efficacité du plan de communication
|
Bonne
|
10
|
22,22
|
|
Moyenne
|
10
|
22,22
|
|
Médiocre
|
25
|
55,56
|
|
Total
|
45
|
100
|
|
Efficacité des moyens mis en oeuvre
|
Efficace
|
10
|
25
|
|
Pas efficace
|
30
|
75
|
|
Total
|
40
|
100
|
Source : Notre étude.
Dans le tableau 4, on note que seulement 10
enquêtés sur 45, soit 22,22%, considèrent efficace le plan
de communication à l'endroit des cibles tandis que 25 autres (55,56%) la
jugent
médiocre, donc inadaptée aux attentes des
cibles. 25 enquêtés sur 40, (62,5%), affirment que c'est dû
à l'incohérence des actions de communication avec les objectifs
prédéfinis.
Vérification de l'hypothèse
H3
Enoncé de l'hypothèse : «
l'importance des valeurs positives d'Agbéhoun n'est pas vraiment
reconnue »
Les résultats ont montré que seulement
22,22% des enquêtés considèrent efficace les actions de
communication à l'endroit des cibles tandis que 55,56% la juge
médiocre donc inadaptée aux attentes des cibles. 25
enquêtés (62,5%) affirment que cela est dû à
l'incohérence des actions de communication avec les objectifs
prédéfinis. L'hypothèse H3 est donc elle aussi
vérifiée.
4.2. Analyse et discussion des
résultats
La danse Agbéhoun véhicule tant bien que
mal des valeurs d'intégration et de développement. Au nombre de
ces valeurs, nous pouvons citer entre autres :
Les valeurs personnelles ou
individuelles
- Connaissance de soi et de son origine
- Amour du prochain, altruisme, Sagesse (maturité
de jugement, clairvoyance) - Dignité, tolérance et
ouverture
- Hospitalité, respectabilité, courage,
dignité
31
- Fidélité aux engagements et à la
parole donnée
- Tempérance, persévérance et
goût de l'effort
- Endurance, générosité,
Reconnaissance, honnêteté
- Maîtrise de soi, Franchise, Circonspection et
altruisme
Valeurs collectives
- Amour du prochain, respect de l'ancien - Relation
parentale et respect de la tradition - Solidarité et patriotisme,
respect du bien commun - Respect du savoir et du savoir-faire
ancien
Il s'agira en l'occurrence d'examiner les moyens
pédagogiques susceptibles de permettre une intégration dans nos
systèmes d'éducation des valeurs considérées comme
positives, en se gardant de perdre de vue les résolutions des Etats
généraux de l'Education. Dans cette optique, un nouvel esprit
pédagogique doit animer l'éducateur. En effet, dans les
activités scolaires et éducatives, les commissions de promotion
de la danse traditionnelle plus précisément de la danse
Agbéhoun doivent insister sur la nécessité de s'inspirer
le plus largement possible de la culture négro-africaine en
général, de la culture béninoise en particulier en vue de
la reconquête de notre identité culturelle.
Perspectives de promotion de la danse
Agbéhoun dans le cadre du développement des arts et loisirs au
Bénin
L'Afrique, et singulièrement l'Afrique noire,
est le continent par excellence des danses ancestrales. Lorsqu'on observe, en
particulier, le paysage culturel béninois aujourd'hui, on
s'aperçoit qu'il y a une effervescence et un déploiement
extraordinaires des festivals de danse patrimoniale en son sein. Ainsi, chaque
chefferie ou tout autre groupement traditionnel coutumièrement bien
structuré, organise son festival de danse ou pense à se lancer
aussi dans cette voie. Intellectuels, hommes politiques, opérateurs
économiques, et même de modestes personnes, s'y attellent avec
engouement, et contribuent promptement à leur organisation.
Le bureau départemental de la
Confédération béninoise de danse (Cobed) de
l'Ouémé a été installé le vendredi 03
juillet 2018 à Porto-Novo par le président du bureau national,
Aladé Coffi Adolphe et son secrétaire, Marcel Zounon, directeur
du ballet national. Hermas Gbaguidi, conseiller et superviseur à la
Cobed et quelques membres du bureau national ont pris part à cette
cérémonie d'installation. Désormais, il a pour mission
d'intervenir dans les arènes de tout ce qui a rapport avec la danse dans
son champ d'actions. La Confédération
32
béninoise de danse (Cobed) a pour objectif
principal de : valoriser et de promouvoir les danses patrimoniales du Benin; de
promouvoir la culture du Bénin; faciliter la mise en place des creusets
d'échanges et de brassage entre les artistes d'ici et d'ailleurs;
organiser des ateliers de renforcement de capacités des acteurs
culturels en général et de ceux des danseurs en particulier;
professionnaliser le secteur de la danse et du ballet bref favoriser
l'émergence de la danse dans l'Ouémé. « Porto-Novo a
une difficulté, pour nos créations par rapport à la danse,
nous avons souvent de retenu, parce qu'il y a certaines danses que nous
exécutons et qui nous créent de problèmes après
»23. A titre d'exemple, le nouveau président a
évoqué l'organisation d'un festival de danse
dénommé «ASSAN OGAN», au cours duquel les organisateurs
ont connu assez de difficultés.24
23Georges Boladji Djidonou,
président du Cobed de l'Ouémé, 2018
24
https://linvestigateurdujour.info/2018/08/06/culture-departement-de-loueme-le-nouveau-president-de-la-cobed-sinstalle-le-bureau-departemental-de-la-confederation-beninoise-de-danse-cobed-de-loueme-a-ete-installe/
33
SUGGESTIONS ET CONCLUSION
Il nous semble très important de conscientiser
cette nouvelle génération béninoise qui se laisse trop
emporter les influences des cultures étrangères (musique moderne,
mode vestimentaire, religion...). Si notre culture nous différencie des
autres, donc il serait préférable de filtrer dans les autres
cultures pour s'enrichir davantage. L'enjeu est la redéfinition de
l'identité africaine dont « la tradition ne doit pas être
ni un élément d'oppression, une espèce de refuge de
refoulement, une espèce de corset dont les dominants seraient heureux de
se servir, ni un alibi à l'usage de certaines bonnes volontés
néanmoins paternalistes ; comme dans le cas de
l'apartheid25 » (MBUMUA W.E., 1970), mais comme atout de
réalisation de la nature humaine mis au service de
l'humanité.
La danse est devenue une discipline enseignée
à l'école par exemple. Les danses à caractère
naturel, les danses traditionnelles ethniques peuvent aussi être
transformées en objet d'enseignement.
Pour ne pas être victime d'un total
déracinement, nous suggérons aussi l'insertion des chants et
danses traditionnelles dans les institutions scolaires primaires et même
secondaires. Nous constatons qu'à l'école, les enfants et
même ceux les plus âgés, se sentent à l'aise en
chantant leurs chansons traditionnelles et dansant sur leurs rythmes. Il
suffira juste de les aider et de leur faire comprendre les valeurs culturelles.
Cela permettrait de conserver nos valeurs culturelles tout en prenant exemple
sur les autres traditions pour une mondialisation de la culture.
La relance des activités traditionnelles peut
bien se faire par le biais des médias à travers une politique de
promotion des valeurs traditionnelles et socioculturelles. La culture africaine
ne peut échapper à cet enlisement que par la révolution.
Malgré la multitude de ses valeurs capables d'assurer son avenir, elle a
encore besoin de l'apport extérieur pour s'enrichir davantage. Ce
progrès ne peut se réaliser que par le changement de
mentalité et de l'éducation. L'autocritique et le dynamisme
constituent les critères de développement de la culture
africaine. La crise des valeurs suite à la dégradation de la
culture africaine constitue le fond de
25 MBUMUA W.E., Un certain humanisme, Yaoundé,
Clé, 1970, p. 23
34
notre travail de recherche. Face à ce
problème, William E. MBUMUA propose un retour aux sources pour recenser
les valeurs nécessaires à la réalisation de l'homme
aboutissant à l'avènement d'un homme synthétique dont
l'Afrique a besoin aujourd'hui. C'est pour nous, Africains, un impératif
catégorique d'intégrer dans notre propre culture sans nous renier
la rationalisation de nos modes de vie et de nos styles avec un esprit critique
et aussi de notre dynamisme culturel aux contacts avec les autres. Pour cela,
il y a lieu de revenir sur notre passé afin de mieux nous projeter dans
l'avenir. Ce retour est une prise de base d'envol et non une exhibition de nos
pseudo-valeurs culturelles toutes faites. C'est un retour en vue d'un saut de
qualité qui soit capable de redorer l'image de celui que l'histoire a
terni.
Seule une révolution culturelle en profondeur
nous permettra de réaliser l'homme total dont a besoin l'Afrique et en
particulier la ville de Porto-Novo. Et cette révolution culturelle sera
l'incarnation d'une Afrique digne d'elle-même, la réinvention
d'hommes nouveaux libres, fiers d'appartenir à leur peuple, prêts
à oeuvrer pour la réalisation du genre humain. Ainsi, on
assistera à l'avènement d'une nouvelle élite qui jouira de
son identité et non plus à celle d'aujourd'hui falsifiée,
dépersonnalisée, déracinée et aliénée
par une mentalité abrutie et colonisée. Tâche difficile car
si rien n'est fait, « l'âme africaine achèvera de se
dissoudre si les élites du continent persistent à refuser leur
propre passé, à craindre l'immersion dans la masse et à
prêcher l'exode culturel.26». Il s'avère
alors nécessaire d'apprendre nos langues à l'école et
d'orienter autrement notre politique culturelle.
Et pour un accès à un très grand
nombre à cette culture africaine, il faut procéder à sa
promotion, à sa diffusion et à la volonté d'offrir aux
autres univers sociaux ce que nous avons de plus précieux et de
particulier. Et nous l'avions remarqué que l'Internet s'est
proposé aujourd'hui pour la diffusion de cette culture. Mais dont
l'usage doit dépendre de notre bon sens. Il est important à tout
Africain de promouvoir sa culture, d'entamer une révolution culturelle
pour se libérer des contraintes des pseudo-valeurs et ne pas se laisser
occire par la nostalgie du passé ou par la mondialisation. Il est donc
nécessaire de procéder à une décolonisation de nos
mentalités arrêtées sur notre propre culture et
d'être ce que nous sommes.
26 KI-ZERBO J.,
cité par MUDIMBE V., L'Odeur du Père, Essai sur des limites de la
science et de la vie en Afrique Noire, Présence africaine, Paris, 1982,
p. 102.
35
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
o a et b Manuel Boucher, Les théories de
l'intégration, L'Harmattan, 2000, p. 262
o Alphonse Tierou, « Ce que je crois »,
2000
o Amartya Sen, Un nouveau modèle
économique, Développement, Justice, Liberté. Paris, O.
Jacob, 2000, 356 p.
o Anthony Biakolo : « L'étonnante enfance
d'Inotan », L'Harmattan éditeur, Paris, 1980, 182 pages. p.
49
o Carmel Camilleri-Margalit Cohen-Emerique (Sous la
direction de), Chocs de cultures : Concepts et enjeux pratiques de
l'interculturel, L'Harmattan, 1989, p. 51 et 53
o Cheikh Anta Diop, 1979, Nations nègres et
culture, Paris, Ed. Présence Africaine, p. 15
o Christian Maurel, Les processus culturels de
l'émancipation, L'Harmattan, 2010
o Dominique Schnapper, Qu'est-ce que
l'intégration ? Gallimard, 2007, p. 24 et 21
o Doussou Soumani, « la danse africaine en quelques
mots »,
https://doussou-soumani.jimdo.com/association/les-danses-africaines/
o Eric Ahouansou, « rôle et symbole de chaque
instrument sur les plans physique et métaphysique »,
2015
o Georges Boladji Djidonou, président du Cobed de
l'Ouémé, 2018
o Joseph Ki zerbo : « Histoire de l'Afrique Noire
d'hier à demain », Hatier. Paris 1978
o KI-ZERBO J., cité par MUDIMBE V., L'Odeur du
Père, Essai sur des limites de la science et de la vie en Afrique Noire,
Présence africaine, Paris, 1982, p. 102.
o L'art contemporain africain : enjeux et perspectives
face à l'émergence du marché de l'art globalisé,
Reine Bassene
o MBUMUA W.E., Un certain humanisme, Yaoundé,
Clé, 1970, p. 23
o Mélaine Bertrand Poda, « Musiques
actuelles et religion Vodoun au Bénin », consulté le 14
décembre 2018. URL :
http://journals.openedition.org/gc/1073
o Poda M. B., 2009. "Appropriation territoriale dans les
rituels festifs à Ouidah (Bénin)", Colloque international
"Musique, territoire et développement local", 19 et 20 novembre,
Grenoble, CNRS PACTE, UMR 5194, à paraître.
o
http://espacerda.over-blog.com/article-culture-africaine-identite-culturelle-developpement-dialogue-des-cultures-80323218.html,
Ibrahima Baba KAKÉ

o
http://jaimelaculture.over-blog.com/2016/06/promotion-et-valorisation-des-danses-traditionnelles-du-benin-a-l-international-les-supers-anges-hwendo-na-bu-a-sur-plusieurs-festiv,
Henri MORGAN
o
http://www.benin-voyage.com/2014/04/
o
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article511,
Bernard Bret
o
https://linvestigateurdujour.info/2018/08/06/culture-departement-de-loueme-le-nouveau-president-de-la-cobed-sinstalle-le-bureau-departemental-de-la-confederation-beninoise-de-danse-cobed-de-loueme-a-ete-installe/
o
https://www.musicinafrica.net/node/15630
II
TABLE DES MATIÈRES
DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX III
SOMMAIRE IV
INTRODUCTION 1
1.1. Cadre de l'étude 4
1.2. Objectifs de la recherche 6
1.3.1. Objectif général
6
1.3.2. Objectifs spécifiques (OS)
6
2.1. Revue de Littérature 8
· Travaux réalisés au
Bénin et dans le Golfe de Guinée (Afrique de l'Ouest) sur les
danses 9
2.2. Clarification conceptuelle 10
2.2.1. La culture et les loisirs
10
2.2.2. L'émancipation culturelle
12
2.2.3. La danse : élément d'une
culture, d'un loisir ou d'un art 15
2.2.4. L'intégration 16
2.2.5. Le développement
17
2.3. Cadre théorique / modèle d'analyse
19
2.4. Problématique 22
2.5. Hypothèses 23
3.1. Méthodes et techniques d'analyse des
données 25
3.2. Échantillonnage 25
3.2.1. Taille de l'échantillon
25
3.2.2. Collecte des données et Méthode
de dépouillement 26
3.2.3. Difficultés rencontrées
26
3.3. Méthode de vérification des
hypothèses 26
4.1. Présentation des résultats et
vérification des hypothèses 29
4.2. Analyse et discussion des résultats
31
III
Perspectives de promotion de la danse
Agbéhoun dans le cadre du développement des arts
et
loisirs au Bénin 32
SUGGESTIONS ET CONCLUSION 34
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
i
TABLE DES MATIÈRES iii
ANNEXES v
RESUME / ABSTRACT viii
iv
ANNEXES
Annexe 1 : Illustrations de la danse Agbéhoun et
instruments utilisés
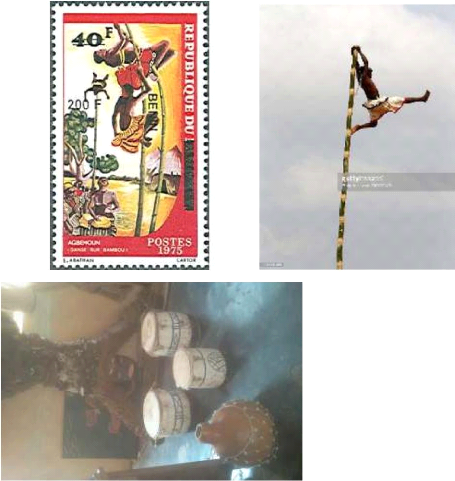
V
Annexe 2 : Questionnaires
Dans le cadre de nos recherches en vue de la
rédaction de notre mémoire pour l'obtention de la licence
professionnelle en sciences et techniques des activités
socio-éducatives (STASE), option récréologie à
l'Institut National de la Jeunesse, de l'Education Physique et du Sport
(INJEPS), nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions
ci-dessous et vous remercions pour le temps que vous voudrez bien nous
consacrer.
Q1 : Connaissez-vous la danse Agbéhoun
?
Q2 : La danse Agbéhoun appartient elle à
une seule culture ?
Q3 : Pensez-vous que son champ culturel est limité
au sud Bénin ?
Q4 : Quel est l'impact de la danse Agbéhoun
dans l'ensemble des cultures des populations du terroir culturel
concerné au Sud-Bénin ?
Q3 : Qu'attendez-vous des dirigeants en charge de la
culture au Bénin ?
............................................................................................................................
Q4 : Avez-vous facilement accès aux
informations relatives aux différents spectacles de danse traditionnelle
?
vi
Q5 : Quelle est l'appréciation des populations
par rapports aux valeurs véhiculées par la danse Agbéhoun
?
|
TRES SATISFAIT
|
|
SATISFAIT
|
PEU SATISFAIT
|
PAS DU TOUT SATISFAIT
|
Q6 : Quel est le taux d'implication des instances
dirigeantes et acteurs pour mettre en évidence l'usage effectif de ces
valeurs par les populations de son terroir culturel et d'ailleurs au
Bénin, en Afrique et dans le monde ?
Q7 : Les instances dirigeantes à travers leurs
différentes activités ont-t-ils développé une bonne
notoriété et une image valorisée de la danse
Agbéhoun auprès du public ?
Q8 : Les instances dirigeantes organisent-t-elles
souvent des rencontres avec les professionnels et pratiquants de la danse
traditionnelle ?
|
TRES SOUVENT
|
RAREMENT
|
PAS DU TOUT
|
VII
RESUME / ABSTRACT
La présente étude est une analyse de la
danse comme un outil d'intégration et de développement. A cet
effet, notre recherche est de comprendre comment la danse «
Agbéhoun » peut jouer ce rôle. Il s'agit d'identifier le
champ culturel de cette danse, d'établir son importance dans l'ensemble
des cultures, de mettre en évidence les valeurs positives
d'intégration et de développement qu'elle véhicule et de
proposer des actions adaptées aux attentes des publics.
Nous avons donc constitué un échantillon
auquel nous avons administré un questionnaire en vue de tester nos
différentes hypothèses. Les résultats de notre
enquête montrent que la danse Agbéhoun représente un
vecteur important de transmission de valeurs positives d'intégration. Il
est donc souhaitable que les instances en charge de la culture
établissent une structure pour gérer stratégiquement les
évènements culturels et servir de relais d'informations pour
contribuer au succès des actions de la promotion de cette
danse.
MOTS CLES: Agbéhoun, danse, intégration,
développement, culture
The present study is an analysis of dance as a tool
for integration and development. To this end, our research is to understand how
the dance "Agbéhoun" can play this role. This is to identify the
cultural field of the dance, to establish its importance in all cultures, to
highlight the positive values of integration and development that vehicle and
propose appropriate actions to audience expectations.
We therefore created a sample to which we administered
a questionnaire in order to test our different hypotheses. The results of our
investigation show that the Agbéhoun dance represents an important
vector of transmission of positive values of integration. It is therefore
desirable that the bodies in charge of culture establish a structure to
strategically manage cultural events and serve as relay information to
contribute to the success of the actions of promotion of this
dance.
KEY WORDS: Agbéhoun, dance, integration,
development, culture
VIII
| 


