|

MÉMOIRE
Présenté par
Fresneau Redha

Effets d'un protocole de musculation du pied
sur
l'explosivité des joueurs de
football
Effects of a foot training protocol on the
explosiveness of soccer players
En vue de l'obtention du Master 2 Ingénierie
& Ergonomie de l'Activité
Physique
Spécialité Système
Musculo-Squelettique, Pathologie, Rééducation &
Réathlétisation
Année universitaire 2020/2021
Encadré par
Ph.D Philippe Germain

Remerciements
À toutes les personnes qui ont
contribué à l'aboutissement de mon Master universitaire de
près ou de loin.
À toutes les personnes qui ont
contribué à l'accomplissement de ce mémoire
universitaire.
À l'ensemble du club pour m'avoir
laissé à disposition le matériel et les infrastructures
nécessaires au bon déroulement du stage.
À Monsieur Philippe Germain
(Ph.D), enseignant-chercheur qui a été mon
directeur de mémoire, pour sa méthodologie, son
accompagnement et ses conseils de scientifiques. Nos échanges m'ont
orienté dans mes recherches et dans mon raisonnement.
À Madame Anabelle Cesaro (Ph.D),
enseignant-chercheur et responsable du Master IEAP parcours SMSP2R,
pour sa disponibilité et ses conseils tout au long de mon Master et
malgré mon statut de sportif de haut-niveau.
À Monsieur Valentin Zamo,
préparateur physique au Trélissac FC, qui a
été mon tuteur en structure. Il m'a soutenu et appuyé
auprès du staff afin que je puisse mettre en place des tests, des
mesures et un protocole sur la totalité de la durée du stage
malgré la pression constante que la compétition impose.
À Monsieur Tiger Pierre, podologue
du sport qui m'a accompagné dans ma démarche,
prêté du matériel et partagé son savoir afin de
mettre en place un protocole cohérent.
À Monsieur Pavlé Vostanic,
entraîneur principal de l'équipe première, qui m'a
laissé la liberté d'organiser des mesures, des tests et des
exercices malgré une planification déjà établie par
son staff pour les joueurs.
FRESNEAU REDHA
Page | 1
Table des matières
Table des figures 4
Table des tableaux 5
Résumé 6
1.La structure 10
1.1 Présentation 11
1.2 Description 12
1.3 Analyse 13
2.Introduction 14
3.Etat de l'art 16
4.Anatomie & Fonctions 22
4.1 Anatomie du pied 23
4.2 Types morphologiques 26
4.3 Biomécanique des fonctions du pied 27
4.4 Fonction musculaire dans le rôle d'amortisseur du pied
29
4.5 Fonction musculaire dans le rôle de propulseur 30
5.Performances & Biomécanique 32
5.1 Qu'est-ce que l'explosivité ? 33
5.2 Biomécanique de la vitesse - Implication anatomique
35
5.3 Biomécanique de la détente - Implication
anatomique 38
6.Problématique 40
7.Hypothèses de travail 43
FRESNEAU REDHA
Page | 2
8.Matériels & Méthodes 45
8.1 Participants 46
8.2 Critères d'Inclusion/Exclusion / Non-inclusion
47
8.3 Matériels 47
9.Protocole 49
10.Résultats 53
10.1 Profils 54
10.2 La variation du poids 55
10.3 Les tests 56
11.Discussion 57
1. Biais/Limites de l'étude 61
12.Conclusion 62
13.Références bibliographiques 64
Table des annexes 69
Annexe 1 : Présentation des différents
paramètres mesurés 70
Annexe 2 : Poids correspondant à chaque sujet 71
Annexe 3 : Résultats détaillés des tests
pour le groupe Test 72
Annexe 4 : Résultats détaillés des tests
pour le groupe contrôle 73
Annexe 5 : Mise en place du test de vitesse avec My
Sprint® 74
Annexe 6 : Utilisation des applications My Sprint® et My
Jump® 75
Annexe 7 : Exemples de résultats obtenus via les
applications 76
FRESNEAU REDHA
Page | 3
Table des figures
Figure 1. Anatomie osseuse du pied (droit) vu du dessus 23
Figure 2. Anatomie osseuse du pied (gauche) vu de profil 24
Figure 3. Musculature intrinsèque du pied 25
Figure 4. Musculature extrinsèque de la jambe et du
pied 26
Figure 5. Types de profil en vue arrière 26
Figure 6.Prise arrière en hauteur d'un patient sur un
podoscope 27
Figure 7. Courbe de l'explosivité (Selon Dufour, 2009)
34
FRESNEAU REDHA
Page | 4
Table des tableaux
Tableau 1. Description des différentes phases de la
foulée 36
Tableau 2. Les muscles et leurs principales actions en course
37
Tableau 3. Niveaux et durées d'activité
musculaire 38
Tableau 4. Hauteur des
nav. et des angulations d'arrières
pieds 54
Tableau 5. Poids moyen par groupe 55
Tableau 6. Résultats par groupe de la puissance obtenue
(W/Kg) 56
FRESNEAU REDHA
Page | 5
Résumé
FRESNEAU REDHA
Page | 6
Objectifs
Observer l'effet d'un protocole de musculation du pied sur les
performances d'explosivité chez des joueurs de football de haut-niveau.
Constater les différences morphologiques au niveau des pieds chez ce
même public. Déterminer si les profils morphologiques ont un
impact sur le protocole proposé en regard des résultats
obtenus.
Méthodes
Les profils morphologiques ont été
déterminés grâce à un goniomètre (pour
déterminer le valgus d'arrière-pieds) et une règle (pour
mesurer la hauteur du naviculaire) conformément aux items de l'indice de
posture de pied. Le test de détente (CMJ) a été
réalisé avec l'application My Jump®. Le test de vitesse (5,
10 ,30 m) a été réalisé avec l'application My
Sprint®. Les joueurs ont été répartis en 2 groupes
(test et contrôle). Le protocole était fixé sur 10 semaines
et les joueurs étaient évalués avant et après le
début du protocole pour comparer les données. Les données
et analyses statistiques ont été réalisées avec
Microsoft Excel® et XLSTAT®.
Résultats
L'écart de poids entre les groupes au début et
à la fin du protocole n'est pas significatif (groupe Test :
p=0,136 groupe Contrôle :
p=0,590). La puissance (W/kg) a augmenté de
manière significative pour le groupe Test après la
réalisation du protocole pour la vitesse
(p=0,009) et pour la détente
(p=0,048). On ne constate pas d'amélioration
significative pour le groupe contrôle ni pour la vitesse
(p=0,994) ni pour la détente
(p=0,143). Aucune évolution des profils
morphologiques durant le protocole.
Conclusion
Un protocole de renforcement du pied sur 10 semaines permet
une amélioration significative de la performance en sprint court (5m) et
en saut (CMJ). Les types morphologiques n'ont pas d'influence dans notre
étude.
Mots clés
Musculation des pieds, Football, Détente, Vitesse,
Explosivité, My Jump, My Sprint, Fléchisseurs du pied, Muscles,
Pieds, Performance, Podologie
FRESNEAU REDHA
Page | 7
Abstract
FRESNEAU REDHA
Page | 8
Objective
To observe the effect of a foot training protocol on the
explosiveness performance of high level soccers players. To observe the
morphological differences in the feet in the same public. To determine if the
morphological profiles have an impact on the proposed protocol with regard to
the results obtained.
Methods
The morphological profiles were determined using a
goniometer (to determine the valgus of the hind feet) and a ruler (to measure
the height of the navicular). The CMJ test was performed with the My Jump
® application and the speed test (5, 10, 30 m) was performed with the My
Sprint® application. The players were divided into 2 groups (test group
and control group). The protocol was fixed over 10 weeks. Players were weighed
evaluated before and after the beginning of the protocol to compare the data.
The data and statistical analyses were performed with Microsoft Excel® and
XLSTAT®.
Résults
The difference in weight between the groups at the
beginning and at the end of the protocol is not significant (Test group:
p=0.136 Control group: p=0.590).Power (W/kg)
increased significantly for the Test group after the protocol for speed
(p=0.009) and for relaxation (p=0.048). There
was no significant improvement for the control group for speed
(p=0.994) and jump (p=0.143). Morphological
profiles did not change during the protocol since because nobody started an
orthopedic treatment.
Conclusion
A 10-week foot training protocol resulted in a significant
improvement in sprint (5m) and jump (CMJ) performance. However, morphological
types are not influencein our study.
Key words
Foot exercice, Football, Relaxation, Speed, Explosiveness,
My Jump, My Sprint, Foot flexors, Muscles, Feet, Performance, Podology
FRESNEAU REDHA
Page | 9
1. La structure
FRESNEAU REDHA
Page | 10
1.1 Présentation
Le Trélissac Football Club est un club de football
français, fondé en 1950 et basé à Trélissac
près de Périgueux en Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Il est issu
de a fusion, en 1983, du Football Club des Maurilloux et du Football Club de
Trélissac, ce dernier étant l'émanation du club « Les
Romains ».
Le club évolue au stade Firmin-Daudou (3000 places)
mais dispose également d'installations sportives sur les communes
d'Antonne-et-Trigonant et de Sarliac-sur-l'Isle.
Le président du club est Fabrice Faure, et le coach
principal Pavlé Vostanic.
Le club évolue en National 2 depuis 2012. C'est un club
qui réalise régulièrement des parcours en coupe de France.
Le dernier en date est l'épopée lors de la saison 2019/2020 ou le
club a affronté l'Olympique de Marseille en 32 ème de finale de
Coupe de France. Sur ces 10 dernières années, le club a
affronté l'OM 3 fois lors de phases finales de Coupe de France. Ils ont
également affronté le LOSC (Lille Olympique Sporting Club).
Depuis plusieurs années, le Trélissac Football
Club continue son développement. Pour permettre aux joueurs et autres
membres du club de travailler dans les meilleures conditions possibles, le club
dispose de structures de qualité tant au niveau sportif qu'au niveau
administratif. En effet, le siège sportif et administratif qui a
été construit il y a maintenant 4 ans se rapproche fortement d'un
centre d'entraînement de club professionnel. Ce nouveau siège est
situé dans l'enceinte du complexe sportif du bourg. D'un point de vue
administratif, il est constitué de plusieurs bureaux mis en place pour
le pôle administratif ainsi que pour les éducateurs et
différents entraîneurs du club. D'un point de vue sportif, les
joueurs ont à disposition une salle de musculation climatisée,
des salles de soins, un espace cryothérapie avec bain froid et
vestiaire, un cabinet médical. En dehors de ces éléments
présents au sein même du siège, le club dispose de 2
terrains synthétiques, 2 terrains en herbes et du stade principal pour
les matchs, qui est partagé avec le Trélissac Rugby qui
évolue également au niveau national.
FRESNEAU REDHA
Page | 11
1.2 Description
Au sein du siège, le club accueille une formation
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et
du Sport) Sports collectifs et Activité physique pour tous. De nombreux
joueurs de l'équipe première s'inscrivent dans ce projet sous
l'impulsion du staff. Cela leur permet en plus du football qui reste leur
profession principale, d'anticiper la suite en se formant et préparant
un diplôme qualifiant.
Pour poursuivre dans la structuration du club, le club dispose
d'une section sportive scolaire football en partenariat avec le Lycée St
Joseph de Périgueux. Les jeunes peuvent ainsi bénéficier
des compétences des éducateurs du club en s'entraînant
quotidiennement tout en suivant une scolarité de qualité.
Le club se structure comme un club professionnel. Un
comité directeur, un pôle sénior, un pôle formation,
un pôle pré-formation, un pôle administratif, un pôle
médical et un pôle féminin.
Le comité directeur est dirigé par Fabrice
Faure, le président du club ainsi que Xavier Sanchez
vice-président. Bernard Besson est le secrétaire
général du club. Michel Bonis est en charge des arbitres et
dirigeant sur la N2. Francis Christmann assure les relations avec la mairie.
Eric Narran est le responsable administratif et financier. Sébastien
Vigier est le responsable partenaires, Jean-Paul Lalanne le responsable des
achats et Jean-Michel Lavaud est en charge des relations PCT2.
Le pôle administratif et commercial est composé
de Johan Abertomy, directeur administratif ; Rita Kochel la responsable du
forum, Laetitia Lérin, sécrétaire et responsable de la
communication.
Le pôle sénior s'articule autour de Pavlé
Vostanic, l'entraîneur principal de l'équipe première. Il
est assisté par Sébatien Vézine, son adjoint, Valentin
Zamo, le préparateur physique, Nicolas Dorbec l'entraîneur des
gardiens, Zivko Slijpcevic le directeur sportif et entraîneur de
l'équipe réserve ainsi que plusieurs dirigeants
bénévoles.
Le pôle formation est supervisé par Zivko
Slijpcevic. On retrouve Nicolas Dorbec pour les spécifiques gardiens, et
Frédéric Vénou qui est le référent au niveau
du BPJEPS et responsable
FRESNEAU REDHA
Page | 12
des sections sportives collège et lycée en relation
avec le club. Il est l'entraîneur des U17. Les U19 sont encadrés
quant à eux par Olivier Hazera.
Le pôle préformation est supervisé
également par Zivko Slijpcevic. On retrouve Nicolas Dorbec pour les
spécifiques gardiens de but, Assan Hammouti qui a en charge les U14/U15,
Haringa Biladjeta qui s'occupe des U13 et Mouraid Bennis sur les U12.
Le pôle féminin est supervisé par Paul
Charron, le responsable du pôle féminin. Marie-France Hernandez
est la responsable coordinatrice du pôle féminin. David Lacotte
est l'entraîneur de la R1 Féminine et son adjoint est Lionel
Badila. Jérome Paul est leur préparateur physique.
L'équipe médicale est composée du docteur
Bruno Roumy, de Baptiste Di Genaro qui est Kinésithérapeute et
Hicham Messadia également kinésithérapeute.
1.3 Analyse
Les joueurs de niveau National 2 sont aujourd'hui
considérés comme des joueurs semi-professionnels. La plupart de
l'effectif ne vit que du football. Même si leur statut juridique aux yeux
de la fédération française de football ne leur permet pas
d'avoir le titre de joueur professionnel, aux yeux de l'état, un sportif
qui ne vit que de son activité est considéré comme
professionnel. De la même manière, les joueurs sont sous contrat
et cotisent comme pour n'importe quel autre emploi.
Les joueurs sont à disposition du club et
engagés contractuellement. Ils répondent à des obligations
comme le fait d'être assidus aux séances, de répondre
à une conduite appropriée dans l'enceinte du club et en dehors du
fait qu'ils soient porteurs des valeurs et de l'image du club. Le staff et
l'organisation globale de la structure sont calés sur celui d'un club
professionnel comme nous l'avons dit précédemment. Les joueurs
disposent par exemple de programme individualisé pour le travail en
salle. L'optimisation et la recherche de performances et de résultats
accompagnent l'ensemble des membres participant à une saison sportive.
Les joueurs bénéficient de l'ensemble des infrastructures et des
accompagnements pour être le plus performant possible et être dans
les meilleures conditions.
Le président a fait le choix de pérenniser le
club à ce niveau-là depuis de nombreuses années afin de
construire un projet solide et durable. Les finances du club sont saines
puisque chaque année le club passe l'étape DNCG (le gendarme
financier du club) sans problème.
FRESNEAU REDHA
Page | 13
2. Introduction
FRESNEAU REDHA
Page | 14
De nos jours, la musculation fait partie intégrante de
la préparation physique dans de nombreuses disciplines sportives. Elle
permet l'optimisation des performances et le développement du potentiel
athlétique des sportifs pour exceller au plus haut niveau. L'approche
spécifique est d'avantage priorisé afin de permettre un transfert
plus ou moins direct vers la discipline. Le travail s'effectue ainsi dans la
continuité en tenant compte des besoins et des demandes de chaque
athlète et de chaque sport. La pratique de musculation chez le
footballeur n'a pas pour but de prendre de la masse, mais d'améliorer
ses performances et de prévenir la venue de blessure par le renforcement
de leurs capacités physiques.
Ainsi, les ischio-jambiers, les abdominaux, les dorsaux, les
bras, les adducteurs etc... sont travaillés quotidiennement de
façon plus ou moins spécifique. Toutefois, la musculation du pied
est un grand oublié des programmes conçus par les
différents staffs. En prévention ou en rééducation,
ce sont les seules fois où l'on prend réellement le temps de
travailler le renforcement de ses pieds. Et pourtant, ils sont les seuls liens
entre notre corps et le sol. L'ensemble des forces est transmis par ceux-ci.
Dans ce sens, plusieurs études se sont intéressées aux
effets de différents protocoles sur les muscles des pieds. Bien qu'elles
se soient penchées sur des profils de sportifs assez différents
que ceux qu'on retrouve dans le football, elles en sont arrivées
à la conclusion suivante : le renforcement des muscles du pied, et en
particulier les fléchisseurs, permet de sauter plus haut, être
meilleur en sprint et améliore la qualité des appuis.
Pour cette raison et parce qu'aucune étude portant sur
ce sujet ne s'est intéressée à des joueurs de football,
nous avons mis en place durant ce stage un protocole de musculation du pied. Le
but est de voir si un protocole, mis en place sur un public de sportif dont la
discipline est à dominante explosive, aura un impact sur les
performances d'explosivité à travers un test de sprint court et
un test de détente verticale.
FRESNEAU REDHA
Page | 15
3. Etat de l'art
FRESNEAU REDHA
Page | 16
Dans cette première partie, nous allons nous pencher
sur ce qui a déjà été réalisé
concernant des protocoles de renforcement des muscles du pied et dans quels
buts.
De nombreuses études se sont intéressées
au renforcement du pied et de l'ensemble des muscles qui y sont
associés. Cependant, les objectifs de celles-ci diffèrent et les
publics également. La recherche a montré que le renforcement des
muscles intrinsèques du pied sur une période de 4 semaines est
bénéfique pour améliorer le contrôle postural
dynamique, la fonction et la stabilité du pied dans un souci
préventif (mais pas uniquement) ainsi que sa posture.
On retrouve l'étude de Fourchet qui préconise
l'amélioration du gainage du pied ainsi que l'utilisation de
l'électrostimulation neuromusculaire pour contrôler la pronation
excessive et prévenir un état de désentraînement
chez des coureurs dans le but de minimiser la survenue de blessures. Ils
proposent un protocole à intégrer dans le programme de
prévention des blessures du membre inférieur. On retrouve
également l'étude d'Ebrecht et al. 1 qui a pour
objectif d'étudier l'effet d'un programme d'électrostimulation
neuromusculaire de 8 semaines sur la force musculaire intrinsèques du
pied. Les résultats étaient comparés à ceux d'un
groupe témoin passif et à ceux d'un groupe témoin actif.
74 participants répartis en 3 groupes. Un groupe suivant le programme
mis en place, un groupe ne faisant rien et un groupe réalisant
uniquement de la course (avec chaussures minimales). Les résultats
démontrent qu'il n'y a pas de différence significative en le
groupe électrostimulation et le groupe course. En outre, une
efficacité d'un tel programme sur la force musculaire n'est pas
démontrée même si elle peut s'avérer utile dans un
protocole de rééducation. Dans cette même idée de
prévention / rééducation, Allessandra et al. 2
a réalisé une étude sur 118 coureurs de fond. Le protocole
durait 8 semaines. Il était axé sur les muscles
périphériques de la cheville. Ils ont évalué la
force du pied, la posture du pied (FPI) et la survenue d'une éventuelle
blessure sur les 12 mois qui suivait ce protocole. Le groupe contrôle
s'est vu plus susceptible de subir une blessure au cours de la période
de 12 mois qui suivait par rapport au groupe d'intervention (p=0,035). En
effet, le délai avant la blessure étai significativement
corrélé avec l'indice de posture du pied (p = 0,031 ; r = 0,41)
et le gain de force du pied (p = 0,044). Pour conclure, ce programme de
renforcement a démontré une réduction efficace du risque
de survenue de blessure chez les coureurs après 4 à 8 mois
d'entraînement. On retrouve aussi la revue de R. Tourillon et al.
3 qui présentent les recommandations pour incorporer à
l'entraînement des
FRESNEAU REDHA
Page | 17
programmes de renforcement des muscles du pied pour la
performance mais également la prévention des blessures. Dans une
idée davantage de performance, l'étude de Takariho et al.
4 visait à déterminer les différences
d'épaisseurs au niveau musculaire sur les jambes inférieures
entre des sprinteurs (26) et des non sprinteurs (26) et examiner la relation
entre l'épaisseur musculaire et les performances en sprints. Au total il
y avait donc 52 participants. Ils ont réalisés les mesures pas
ultrasonographie. Les résultats ont démontré que la
plupart des épaisseurs musculaires étaient significativement plus
importantes chez les sprinteurs que chez les non sprinteurs. Au niveau
performance, parmi les muscles du pied, seule l'épaisseur de l'abducteur
de l'hallux était positivement corrélée avec le meilleur
temps personnel de sprint sur 100 m chez les sprinteurs (r = 0,419, p = 0,033).
Pour le reste il n'y avait pas de différence significative. Les
résultats suggèrent que malgré un développement
plus important chez des athlètes très entrainés, la taille
de ces muscles ne contribue pas nécessairement à l'obtention de
performances en sprint supérieurs. Pour poursuivre sur les études
menées en rapport avec la performance à proprement parler,
l'étude de Rebecca. E et al. 5, comporte 28 sujets et
s'intéresse à des équipes de Hockey sur Glace de haut
niveau. Après avoir satisfait à un protocole de renforcement de 4
semaines, des tests ont été réalisés. Les
résultats au test d'agilité S-Cornering ont
démontré une différence significative (p<0,001), tout
comme les résultats au test de stabilité (p<0,001).
Dans l'étude d'Iwona Sulowska et al. 6,
l'objectif est d'évaluer l'influence des exercices de musculation du
pied sur la performance chez des coureurs de fond.47 coureurs ont
participé à l'étude. Ils ont comparé des
résultats en amont de l'étude entre deux groupes (Test et
Contrôle) et à la suite d'un protocole de 6 semaines. Les
principaux résultats ont montré des améliorations
significatives pour le couple, le travail et la puissance des
fléchisseurs et des extenseurs du genou sur le dynamomètre
isocinétique. Des différences également significatives
pour l'évaluation en sprint au niveau de la puissance (qui
apparaissaient plus élevées) au RAST TEST. Dans ce sens, ils ont
pu en conclure que les exercices de renforcement des muscles des pieds peuvent
améliorer le transfert d'énergie à travers les segments du
corps et augmenter par la même occasion la force et la puissance
générée. Ils ont également préconisé
d'intégrer un programme de renforcement dans le plan
d'entraînement. D'autre part, Lynn et al. 7 rappelle que le
bon fonctionnement de la musculature intrinsèque du pied est essentiel
au maintien de l'intégrité de l'arche longitudinale
médian. C'est d'ailleurs cette
FRESNEAU REDHA
Page | 18
structure qui peut entraîner une pronation excessive du
pied (associée à diverses pathologies). L'objectif de son
étude était d'étudier les effets de deux types
d'entrainement différents des muscles intrinsèques sur la hauteur
de l'arche médial mais aussi sur la performance des tâches
d'équilibre statique et dynamique. 24 participants répartis en 3
groupes. Un groupe a effectué 4 semaines d'exercices différents
pour les deux premiers groupes et le dernier groupe était un groupe
témoin. Les principaux résultats ont permis de constater qu'il
n'y avait pas de différences dans la hauteur des naviculaire. Ils ont
également permis de constater une amélioration de
l'équilibre statique et dynamique par rapport au groupe témoin
même si un groupe a mieux réagi que l'autre (dû au programme
d'exercices d'avantage spécifique à la contrainte imposé
par un test d'équilibre). Une étude qui se rapproche de la
nôtre menée durant le stage est celle de Hashimoto et al.
8. Dans son étude, l'objectif est de vérifier les
effets d'un entraînement des muscles fléchisseurs du pied. 12
participants ont suivi un protocole d'entrainement impliquant la flexion de
toutes les articulations inter-phalangiennes et métatarsophalangiennes
des orteils sur une période de 8 semaines. Les principaux
résultats ont montrés que des changements significatifs ont
été observés pour les scores de force intrinsèques
des fléchisseurs du pied, les sauts (verticaux, en longueur, sur une
jambe) et le temps de course sur un sprint de 50 m. En somme, ce protocole a
permis d'améliorer de manière significative les scores de force
musculaire et les performances de mouvement. Enfin, nous avons relevés
l'étude de Gooding et al. 9 qui a pour objectif de
décrire les changements dans l'activation des muscles plantaires
intrinsèques du pied après 4 exercices par l'imagerie par
résonnance magnétique (IRM) chez 8 participants. Les
résultats ont montré que tous les muscles ont une activation
accrue à la suite des exercices. Ils ont conclu que chacun des 4
exercices a été associé à une augmentation de
l'activation de tous les muscles plantaires intrinsèques du pied
évalués.
Concernant les moyens d'évaluation utilisés au
cours de ces études. Sans énumérer de nouveau l'ensemble
des études en les décrivant successivement ; nous retrouvons
l'IRM qui a été utilisée afin d'observer les modifications
à l'échelle musculaire et les dommages induits 9, la
plateforme de force qui est la plus utilisée la plupart du temps pour le
calcul de la hauteur de saut ou la puissance/ force développé
3,5,5,6,8,10,11, les cellules photoélectriques
4,6,8, le dynamomètre à grippée digitale
4,8,10, l'ultrasonographie 4 et l'index de posture du
pied (FPI)
5,12-17.
FRESNEAU REDHA
Page | 19
Enfin, nous allons nous intéresser aux
différentes études qui valident les applications utilisées
dans le cadre de ce mémoire. Les applications My Sprint® et My
Jump® ont été développées afin de proposer aux
hommes de terrain des outils permettant d'évaluer leur public avec
précision et fiabilité. En effet, les dispositifs tels que les
plateformes de force ou les cellules photoélectriques sont des
dispositifs onéreux. Qu'il s'agisse d'associations sportives, de
préparateurs physiques, d'entraîneurs ou bien d'étudiants,
la mise en place de test permettant une excellente reproductibilité et
des résultats précis et exploitables est souvent
compliqué.
Trop souvent, la vitesse est calculée au
chronomètre, la détente avec une simple craie et les
résultats ne sont pas exploitables d'un point de vue scientifique. La
recherche de performance ne concerne pas uniquement le très haut niveau
dont les structures disposent bien souvent d'énormes moyens. Dans ce
sens, des chercheurs (mettre le nom), par le développement et la
validation de ces applications, ont permis à tous de pouvoir obtenir des
résultats de qualités. La mise en place des tests proposés
est simple, mais il faut cependant respecter les consignes du protocole
énumérées avec précision dans les menus des
applications.
Bien évidemment, ces applications ont dû
être validées avant d'être commercialisées et
utilisables.
Il est toutefois indispensable de souligner que la
référence en matière d'évaluation de performance en
saut vertical est la plateforme de force 18.
Balsalobre-Fernandez et al. 18 ont
réalisé une étude sur la validité et la
fiabilité de l'application My Jump® pour mesurer la performance en
saut vertical. Pour cela ils ont comparé les résultats obtenus
sur une plateforme de force à ceux obtenu avec l'application
après avoir testé 20 hommes au CMJ. Ils ont trouvé une
concordance (ICC) quasi parfaite entre la plateforme de force et l'application
My Jump® pour le saut en contre mouvement (CMJ) (r = 0,997 et p <
0,001). Cette étude a démontré que la hauteur du CMJ
était évaluée de manière fiable et reproductible
avec l'application en comparaison avec une plateforme de force.
Une autre étude 19 a comparé
différentes méthodes d'évaluation de la performance en
saut vertical (plateforme de force, tapis, accéléromètre,
caméra infrarouge, caméra à haute vitesse, Vertec). Le
public (40 étudiants Staps) devait réaliser des sauts de type CMJ
une nouvelle fois.
FRESNEAU REDHA
Page | 20
La corrélation (ICC) entre le temps en l'air obtenu via
l'application et la plateforme de force était parfaite r = 1,
p<0,001). La corrélation (ICC) entre l'application et la plateforme
de force utilisant la vitesse verticale au décollage était
également très élevée (r = 0.996, p < 0,001).
En somme, les résultats de ces 2 études ont
montré que l'application My Jump® est une méthode
appropriée, fiable et réutilisable pour évaluer la
performance en saut et notamment le contre mouvement. Toutefois, il a
été rapporté que la hauteur du saut verticale était
très légèrement surestimée par rapport à
celle obtenue avec la plateforme de force.
En ce qui concerne My Sprint®, une étude
20 a été réalisé dans le but
d'évaluer la validité et la fiabilité des résultats
de performance en sprint mesurée avec l'application et les
méthodes déjà existante telle que les cellules
photoélectriques et le pistolet radar. Le public était
composé de 12 sprinters masculins. Les résultats
démontrent une corrélation (ICC) presque parfaite une nouvelle
fois entre les valeurs de temps pour chaque distance intermédiaire du
sprint de 40 m mesuré avec l'application et avec les cellules
photoélectriques (r=1). Il a été également
observé une corrélation très importante entre les valeurs
pour la force horizontale théorique max (F0), la vitesse
théorique (V0) et la puissance maximale (Pmax).
FRESNEAU REDHA
Page | 21
4. Anatomie &
Fonctions
FRESNEAU REDHA
Page | 22
4.1 Anatomie du pied
Le pied est la partie terminale du membre inférieur. Il
est capable de supporter, diriger et propulser le poids du corps souvent
multiplié et parfois jusqu'à un facteur de douze par les
conditions dynamiques. Les temps sont certes très brefs, mais tout de
même répétitifs. Il est situé à
l'extrémité de la jambe. Il s'articule avec cette dernière
grâce à la cheville. C'est le seul point de contact avec le
sol.
Sa structure est maintenue par de multiples interconnections
fibreuses et musculo ligamentaires qui assurent une précontrainte ainsi
que son animation 21. (Il se divise en deux zones. Tout d'abord,
l'avant pied qui est composé des phalanges et du métatarse.
Ensuite l'arrière-pied, représenté par le tarse.
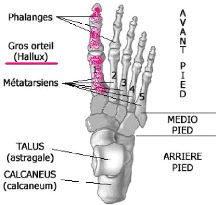
Figure 1. Anatomie osseuse du pied (droit) vu du
dessus
Le pied contient 26 os répartis comme suit : 7 os du
tarse qui forment la moitié postérieure du pied dont les plus
connus sont le talon et le calcanéum, 5 os métatarsiens qui
forment la plante du pied et 14 phalanges qui composent les doigts de pied.
L'ensemble des orteils se décomposent en trois phalanges sauf le gros
orteil qui en comporte seulement 2.
FRESNEAU REDHA
Page | 23
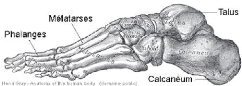
FRESNEAU REDHA
Figure 2. Anatomie osseuse du pied (gauche) vu de
profil
L'ensemble de ces os forment des arches. On retrouve ainsi
deux arches longitudinales médiale et latérale et une arche
transversale. 22 23
Bien évidemment, la présence de ligaments,
tendon et muscles permettent au pied de disposer d'une certaine
élasticité. On retrouve deux catégories de muscles qui
agissent sur/ et au niveau de l'articulation du pied :
- les muscles intrinsèques, situés directement dans
le pied
- les muscles extrinsèques, situés dans la jambe et
dont les tendons sont dans le pied
Au dos du pied, on trouve le court extenseur de l'hallux (sur
le gros orteil) et les courts extenseurs des orteils. Ils peuvent fusionner
(variation musculaire) et ont pour fonction de fléchir les orteils et
l'hallux. Ils renforcent surtout les actions des longs extenseurs de l'hallux
et des orteils qui prennent pour origine l'étage supérieur.
La plante de pied est riche en muscle. Elle se compose d'un
groupe médial de muscles plantaires avec le court fléchisseur de
l'hallux, l'abducteur de l'hallux et l'adducteur de l'hallux. D'un groupe
latéral avec un plan superficiel (muscle abducteur du petit orteil et
court fléchisseur du petit orteil) et un plan profond avec le muscle
opposant du petit orteil. D'un groupe moyen avec 4 plans : au premier plan, le
muscle fléchisseur des orteils, au deuxième plan, le carré
plantaire et les muscles lombricaux du pied, au troisième plan les
muscles interosseux plantaires, au quatrième plan les muscles
interosseux du pied.
Page | 24
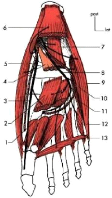
Figure 3. Musculature intrinsèque du pied
1. Muscle adducteur oblique de l'hallux / 2. Muscle court
fléchisseur de l'hallux / 4. Muscle long fléchisseur des orteils
(extrinsèque) / 5. Muscle abducteur de l'hallux / 6. Muscle court
fléchisseur des orteils / 7. Muscle carré plantaire / 8. Muscle
long fléchisseur du 5 ème orteil / 9. Muscle abducteur du 5
ème orteil / 10. Muscle court fléchisseur du 5 ème orteil
/ 11. Muscle opposant du 5 ème orteil / 12. Muscle interosseux du pied /
13. Muscle
adducteur transverse de l'hallux
Enfin, l'aponévrose plantaire est une lame épaisse
de tissues conjonctifs directement sous la peau. Elle a pour rôle de
transmettre une force importante et de redonner une rigidité à la
voûte plantaire. Elle participe à l'absorption des contraintes,
ainsi qu'à la restitution de l'énergie nécessaire à
la propulsion (Fraser, Feger & Hertel 2016).24
Articulations et muscles ont donc pour rôle de permettre
une déformabilité adaptative et une rigidification
quasi-instantanée des bras de levier, ce qui est nécessaire pour
propulser le corps.
FRESNEAU REDHA
Page | 25
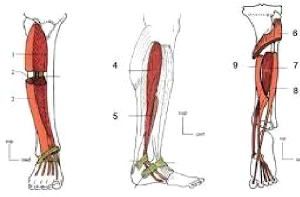
FRESNEAU REDHA
Figure 4. Musculature extrinsèque de la jambe et du
pied
1. Muscle tibial antérieur / 2. Muscle long extenseur
de l'hallux / 3. Muscle long extenseur des orteils / 4. Muscle long fibulaire /
5. Muscle court fibulaire / 6. Muscle soléaire / 7. Muscle tibial
postérieur / 8. Muscle long fléchisseur de l'hallux / 9. Muscle
long fléchisseur des orteils
4.2 Types morphologiques
Les types morphologiques s'évaluent en
général sur un podoscope. Cet outil va permettre d'observer, via
les empreintes des pieds, la répartition des charges sous celui-ci. Il
est également possible, à l'aide d'outils comme nous avons
utilisé dans l'étude (règle, goniomètre) d'avoir un
avis directement par la hauteur du naviculaire et le valgus ou varus
d'arrière-pied. En effet, à plat et dans une position statique,
l'axe du tendon d'Achille par rapport au centre du talon est facilement
observable. On peut ainsi retrouver trois différents types de pieds : le
pied pronateur, le pied supinateur ou le pied neutre (physiologique).
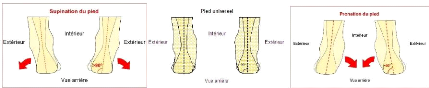
Figure 5. Types de profil en vue arrière
La pronation correspond à un affaissement du pied vers
l'intérieur tandis que la supination
correspond à
l'inclinaison du pied vers l'extérieur. Le pied physiologique correspond
à un
Page | 26
alignement quasi-parfait. Un pied physiologique correspond
à une répartition des pressions équitables sur l'ensemble
du pied alors que le pied pronateur va voir une répartition axée
d'avantage sur l'intérieur (pied plat). Au contraire, le pied supinateur
voit ses pressions réparties plutôt sur l'extérieur du pied
(pied creux).
D'un point de vue statistiques, on considère que 10 %
de la population est supinatrice, 45 % pronatrice et 45 % neutre.
Dans des cas de sur-pronation ou sur-supination, le risque de
blessure est important. Le bilan podologique est important afin de
déterminer le profil et pouvoir répondre à la
problématique. Les semelles orthopédiques sont aujourd'hui le
moyen le plus efficace pour corriger une pronation ou une supination
excessive.

Figure 6.Prise arrière en hauteur d'un patient sur
un podoscope et résultats observables
4.3 Biomécanique des fonctions du pied
Le pied humain se présente comme un tout anatomique
cohérent. Plusieurs fonctions cohabitent dans un volume réduit.
Le pied de l'homme accomplit quatre actions de manière
quasi-simultanée : 25
1. Amortissement des chocs consécutifs à l'attaque
du talon et à la propulsion
Il s'agit là d'une activité évidente
du pied. L'abattement extrêmement raide de l'avant-pied est freiné
par les muscles de la loge antérieure qui dissipent l'énergie
accumulée. Ajouté à cela
FRESNEAU REDHA
Page | 27
au moment de la propulsion, un mécanisme absorbant
du choc qui permet d'appliquer au sol une contrainte importante sans
léser la ligne des têtes métatarsiennes qui s'applique
à la surface portante.
2. Maintien de l'équilibre
Lors de la marche, la projection verticale du centre de
gravité transite à chaque pas par le bord externe pendant le
déport latéral du bassin sur le membre inférieur
porteur.
3. La propulsion du corps du marcheur ou du coureur qui est
réalisée par le bord externe du pied et toute la surface
antérieure
La propulsion est impartie au corps du marcheur ou du
coureur par le bord externe du pied et la partie antérieure, puis le
gros orteil.
4. Les changements soudains de direction, pivotements sur
place
Le changement de direction implique une réduction
maximale de la surface de contact par le sportif afin de tourner plus
librement. Il reste seulement en appui au sol la région sous-jacente
à l'articulation métarso-phalangienne.
FRESNEAU REDHA
Page | 28
4.4 Fonction musculaire dans le rôle
d'amortisseur du pied
Soutenir le poids du corps est la fonction principale du pied.
La locomotion, la course, les sauts sont des fonctions secondaires. Afin de
pouvoir exercer ces actions, le pied doit être en mesure d'amortir les
contraintes qui s'exercent sur lui au cours de chaque activité. Au
moment de l'impact au sol, le pied d'appui reçoit en effet deux et demi
à trois fois le poids d corps.
Lors de la position debout, n'entre en action que les
structures passives et en premier lieu les squelettes osseux et fibreux,
à savoir les ligaments et l'aponévrose plantaire qui vont
absorber les contraintes grâce à leur architecture en arche. La
peau et les tissus mous interviennent également dans le support de ces
contraintes. L'ensemble des muscles décrits comme «
intrinsèques » présentent une activité nulle, mais
agissent de façon passive en accompagnant les structures ligamentaires
26 par deux mécanismes : leur tonus de repos qui va permettre
le maintien d'une tension et le maintien supplémentaire de la
voûte 27. Lors de la marche, les systèmes musculaires
intrinsèques et extrinsèques vont permettre un contrôle
dynamique. Kapandji & Judet (2009) 23 décrivent l'action
de la manière suivante : « lors de la prise de contact avec le sol,
la cheville sera en légère flexion, le talon est le point d'appui
du pied sur lequel vient s'appliquer la poussée de la jambe, suivie par
le reste du pied qui se déroule sur le sol. Les tissus de peau et de
graisse absorbent les premières contraintes, suivi par le calcaneum qui
agit comme un pivot et répartit les pressions sur le pied lors de son
déroulement. Les structures passives entre alors en jeu : la membrane
interosseuse de la jambe, les ligaments et le mouvement de divergence du talus
et du calcanéum limitent ces contraintes. Le muscle tibial
antérieur intervient par la suite afin de freiner la chute de
l'avant-pied sur le sol. Lorsque l'avant-pied touche le sol et que le poids du
corps est déporté vers l'avant, la voûte plantaire
s'écrase. Pour éviter cet écrasement ; un premier
phénomène d'amortissement intervient : les muscles plantaires, en
concordance avec le soutien des structures passives se contractent en
réponse à l'affaissement provoqué. Enfin, les muscles
extrinsèques et notamment le triceps sural se contractent pour
déclencher une impulsion motrice. Dans cette phase, la voûte
planaire est un levier inter-résistant, puisqu'elle est entre le point
d'appui au sol en avant, la force musculaire des extenseurs en arrière,
et le poids du corps au milieu. Afin de faire face à ces contraintes et
éviter qu'elle ne s'écrase à nouveau, il
FRESNEAU REDHA
Page | 29
existe un deuxième effet d'amortissent au cours duquel
les muscles plantaires se contractent. Ils emmagasinent au cours de cette phase
une partie de la force du triceps qu'ils restituent à la fin de
l'impulsion ». Pour une situation de course, il s'agit du même
mécanisme en plus rapide. L'ensemble du système permet un «
amortissement ressort » grâce aux propriétés
viscoélastiques du tendon achilléen et de l'aponévrose
plantaire, combinés à la contraction du triceps sural et de la
musculature intrinsèque et extrinsèque du pied 28. Le
rôle d'amortisseur intervient également lors de saut. Il s'agit du
mouvement inverse du saut. Un saut se traduit par une triple extension des
membres inférieurs. Son amortissement réside dans une flexion,
étape par étape des articulations des membres inférieurs
29. Au moment où l'ensemble du corps redescend, les membres
inférieurs vont reprendre contact avec le sol de façon
liée à partir des extrémités des deux gros orteils,
le dessous des autres orteils, la tête des métatarsiens et enfin
l'isthme et les talons. En parallèle, de façon
synchronisée, Germain. C & Lamotte. A (1990) 30
décrivent la flexion simultanée des chevilles, des genoux et des
hanches pour arriver vers la stabilisation sur les deux jambes. Les muscles du
pied, qu'ils soient extrinsèques ou intrinsèques agissent comme
amortisseur, comme réceptionneur et stabilisateur dans ces
différentes phases.
4.5 Fonction musculaire dans le rôle de
propulseur
En utilisant les arches du pied comme tremplin, le pied
propulse le corps en avant durant la marche, la course et les sauts grâce
à un complexe : le complexe suro-achilléo-calcanéo
plantaire. Ce complexe est propulseur en position debout, il comprend plusieurs
articulations depuis les condyles fémoraux jusqu'aux orteils. Il est
composé d'un moteur puissant à savoir le triceps sural et d'un
système de transmission sophistiqué : le tendon calcanéen,
la partie postérieure du calcanéum et l'aponévrose
plantaire.
Le triceps sural composé :
- Des gastrocnémiens, est un groupe musculaire à
profil explosif donc la fonction dépend de la flexion du genou.
- Du soléaire qui est un muscle lent de la statique
- Du plantaire qui est un long tendon au bord
antéro-médial du tendon calcanéen
FRESNEAU REDHA
Page | 30
Le calcanéen composé :
- de deux lames tendineuses accolées dont une provient
de la partie antérieure des gastrocnémiens et l'autre provient de
la parte postérieure du soléaire
- d'un tendon court - d'un tendon long
Aponévrose plantaire composé :
- os sésamoïde
- fibres de collagènes et élastiques
- organe de propulsion et de statique
La description biomécanique de l'action de propulsion
tient compte principalement des forces de traction du triceps sural. Ces forces
prennent appui sur les condyles fémoraux, elles verticalisent le
calcanéus qui agit comme un véritable bras de levier, elles
tendent l'aponévrose plantaire et s'appliquent jusqu'aux orteils. C'est
un complexe longitudinal ou les différents composants sont en
interaction. 31
FRESNEAU REDHA
Page | 31
5. Performances &
Biomécanique
FRESNEAU REDHA
Page | 32
5.1 Qu'est-ce que l'explosivité ?
L'explosivité est la capacité à produire
la plus grande accélération sur soi-même ou sur un engin.
C'est une utilisation de la puissance musculaire, résultant de la force
par la vitesse. Il s'agit de la capacité à enclencher, en un
temps court, une forte contraction musculaire. Aujourd'hui, la musculation et
notamment en complément lors de phases de préparations
spécifiques par exemple, va permettre de d'entretenir et de
développer cette qualité physique même si la
génétique occupe une part importante sur les
prédispositions physiques d'un athlète. Considérée
comme une qualité physique mêlant force et vitesse, elle permet
dans de nombreux sports d'avoir un réel avantage athlétique en
fonction de la logique interne de l'activité. Dans les sports
collectifs, et plus particulièrement en football, l'explosivité
va permettre de prendre le dessus sur ses adversaires directs dans les
situations suivantes :
- départ arrêté
- sprint
- sauts
- en sortie de dribble
L'explosivité est une qualité qui relève
du domaine qualitatif 32. Tout comme la vitesse, elle ne
nécessite pas un travail de volume trop important mais c'est
réellement l'exécution et l'implication maximale qui induisent
des bénéfices. Certains auteurs conseillent le
développement de l'explosivité avec le développement du
VO2 max. En effet, le secteur qui répond au domaine d'explosivité
est bref. Le substrat de cette qualité est la phosphorylcréatine.
Les mitochondries sont capables de les re-synthétiser. D'où
l'importance d'insister sur le développement de VO2 max.
Le travail en explosivité nécessite l'activation
de fibres rapides « spécialisées » 33. Les
adaptations de l'entraînement énuméré par Dufour
33 sont les suivantes : tout d'abord, la réorganisation des
patterns de recrutement musculaire ; L'amélioration de
l'excitabilité du motoneurone ; Le recrutement sélectif des
fibres et enfin l'élargissement de la fibre motrice.
FRESNEAU REDHA
Page | 33
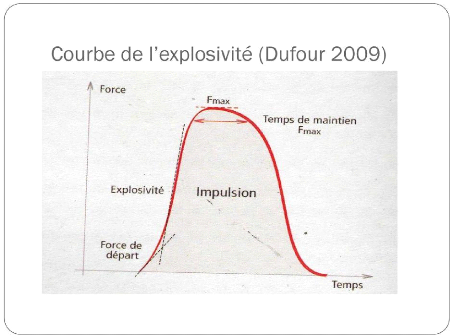
Figure 7. Courbe de l'explosivité (Selon Dufour,
2009)
FRESNEAU REDHA
Page | 34
5.2 Biomécanique de la vitesse - Implication
anatomique
La vitesse est basée sur des processus du
système neuromusculaire et la faculté inhérente à
la musculature de développer de la force, d'accomplir des actions
motrices dans un segment de temps situé en dessous des conditions
minimales données. Elle représente la faculté d'effectuer
des actions motrices dans un espace de temps minimal 34.
À l'arrêt, le centre de gravité du corps
se trouve à la verticale du polygone de sustentation, forme qui est
décrite par la forme que nos pieds dessinent. La marche de l'homme est
une activité motrice fondamentale. Elle peut être définie
comme la combinaison dans le temps et l'espace de mouvements plus ou moins
complexes des différents segments du corps qui aboutissent au
déplacement de l'individu sur un plan horizontal. Les différentes
phases de la foulée s'organisent de la façon suivante :
- flexion plantaire et dorsale de la cheville - flexion et
extension du genou
- flexion et extension de la hanche
Il faut être en mesure de maintenir un équilibre
dynamique lors des différents types d'appuis et de coordonner les
conditions de la propulsion en s'adaptant à chaque instant aux
contraintes de l'environnement extérieur. La course va se
différencier de la marche par la disparition de la phase de double
appuie lors du déplacement rapide. La course, avec l'absence du double
appui, est une succession de foulées bondissantes. La course peut
être caractérisée par une succession de
déséquilibres maîtrisés et rattrapés qui
permettent d'éviter la chute. Plus l'homme ira vite, plus l'action de
forces s'exerçant sur lui sera importante. Pour ajuster en permanence la
posture et maintenir cet équilibre lors de phase de propulsion,
différents muscles interviennent. Les ischio-jambiers par exemple sont
essentiel pour le blocage du genou, les extenseurs de la hanche, de la jambe et
le grand fessier sont les groupes musculaires principalement sollicités
dans la phase d'accélération initiale. En ce qui concerne
l'atteinte de la vitesse de course maximale, les muscles les plus
impliqués sont les ischio-jambiers, les adducteurs et le grand fessier.
Rappelant que le seul point de contact avec la surface terrestre est le pied,
ce dernier doit assurer le transfert d'énergie tout en permettant un
appui stable et fort.
FRESNEAU REDHA
Page | 35
Tableau 1. Description des différentes phases de la
foulée (INSEP. Archives ouvertes)
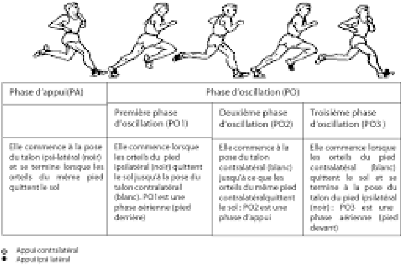
FRESNEAU REDHA
Page | 36
Tableau 2. Association des muscles et de leurs principales
actions lors de la course (issue de La
nouvelle Bible de la
préparation physique, D. Reiss, P.Prévot. 2020).
|
Muscles
|
Principales actions
|
|
|
|
Grand droit de l'abdomen
couplé aux obliques
internes
et externes
|
Maintien du bassin, éviter qu'il ne parte trop en
antéversion. Éviter une
hyperlordose lombaire. Un manque de
gainage de mouvement limite
logiquement la puissance de tout le membre
inférieur.
|
|
Ilio-psoas
|
Principaux releveurs de la cuisse
|
|
Ischio-jambiers
|
Permettent de bloquer le genou lorsque celui-ci est vers
l'avant et
l'entraînement vers l'arrière. Capables de
l'extension du genou en synergie
avec le quadriceps surtout au-dessus de
145°, ils travaillent le plus longtemps
durant le sprint. Atteignant
200 % de la force volontaire, il ne faut pas
s'étonner des nombreux
accidents qu'ils rencontrent.
|
|
Grand fessier
|
Principal extenseur de la cuisse lorsque celle-ci est vers
l'avant ; de par son
action d'exorotation, à la pose du pied, il
stabilisera le bassin en évitant la
rotation de ce dernier vers
l'intérieur. Action diminuée de ce dernier lorsque
le pied
passe à la verticale du centre de gravité. En l'air, il a
tendance à
entraîner la cuisse en abduction, les adducteurs
devront contrecarrer cette
action.
|
|
Quadriceps
|
Ils évitent la chute du corps sur le sol : plus ils sont
puissants, plus l'athlète
est stable, ce qui permet aux autres
muscles de s'exprimer et raccourcit le
temps de contact au sol. Extenseur du
genou, ils propulsent durant
l'accélération, mais s'amenuisent
durant la phase de vitesse maximale.
|
|
Petits et moyens fessiers
|
L'appui monopodal demande de stabiliser le bassin avec le
sprint, la tension
est multipliée par 7. Moins les abducteurs sont
forts, plus l'expression des
muscles moteurs est limitée.
|
|
TFL
|
Apporte une stabilité surtout si le grand fessier est
trop puissant.
|
|
Adducteurs
|
Permettent au membre inférieur de rester en ligne pour
compenser la mise en tension importante du grand fessier. À la fois le
fléchisseur du genou lorsqu'il est derrière et extenseur de ce
dernier lorsqu'il est vers l'avant, ils sont très sollicités et
se blessent souvent si l'on manque de préparation.
|
|
Gastrocnémiens
|
Derniers muscles à travailler avant que le pied ne
quitte le sol, ils ont un rôle
important dans la performance.
Fléchisseurs plantaires, ils ont une
sollicitation excentrique
permettant la restitution.
|
FRESNEAU REDHA
Page | 37
Les données ci-dessous obtenues sur les archives
ouvertes de l'INSEP. Le tableau présente les données de la
littérature relatant les niveaux et durées d'activité. Le
niveau d'activité est présenté à deux vitesses : 15
km/h et 21 km/h.
Tableau 3. Evolution des niveaux et durées
d'activité avec la vitesse
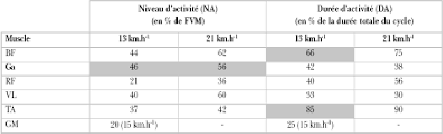
FVM = Force Volontaire Maximale, il s'agit du niveau
d'activation maximal recueilli en mode
isométrique. Ga = gastrocnémiens / TA =
Tibial antérieur / BF = Biceps Fémoral / RF = Droit
fémoral / VL = Vaste interne / GM = Grand fessier
Ce tableau permet de remarquer trois profils différents
:
Tout d'abord les muscles fortement activés (en % du
niveau d'activité enregistré à FVM) tel que Ga notamment ;
les muscles longuement activés (en % du cycle de la foulée) tel
que TA ; les muscles à la fois fortement et longuement sollicités
tel que BF. Les muscles les plus longuement activés, à savoir TA
et BF sont les muscles les plus riches en fibres de type I.
5.3 Biomécanique de la détente -
Implication anatomique
La détente musculaire correspond à la
capacité de s'élever dans les airs lors d'un saut. La
détente est une qualité fondamentale pour des activités
nombreuses et variées. Elle se définit comme la capacité
qu'a le système neuromusculaire de surmonter les résistances avec
la plus grande vitesse de contraction possible 35. Plus la force
appliquée est importante en un minimum de temps et plus le saut est
élevé. D'un point de vue physique, la hauteur qui est atteinte
lors d'un saut est influencée par deux éléments : d'une
part, le travail musculaire fourni lorsque les pieds sont en contact avec le
sol et d'autre part la hauteur du centre de
FRESNEAU REDHA
Page | 38
masse du corps au moment de l'envol. Sans entrer dans des
calculs mathématiques complexes, Chapman (2008) 36
décrit celle-ci de la façon suivante :
s = (
??
) · ? ?? · ??s
m · g
Où s est la distance verticale
parcourue par le centre de masse du corps depuis son point le plus bas lors de
la prise d'élan jusqu'à son point le plus haut lors de la phase
de vol, m est la masse corporelle et g
l'accélération terrestre. L'intégrale
de F*ds est la quantité de travail musculaire produite
durant la phase de contact avec le sol, où F est la
force musculaire et ds le déplacement du centre
de masse du corps durant la phase de contact avec le sol.
Enfin, il existe un autre phénomène
biomécanique qui joue un rôle majeur dans la performance de saut.
Il s'agit du « Strectch-Shortening Cylce » (SSC). Grâce
à ses propriétés mécaniques, un muscle est capable
d'emmagasiner de l'énergie lorsqu'il est allonge pour la restituer de
façon immédiate après et produire plus de force. La
pré-activation, lorsque le muscle s'allonge, permet de débuter sa
phase de contraction avec une plus grande force initiale pour
développement une force maximale plus élevée 36,37
. La détente peut être assimilée à la
qualité de puissance 38. D'un point de vue physiologique,
elle dépendrait à la fois du nombre de fibres sollicitées
simultanément dans un muscle et de leur qualité de
contraction.
FRESNEAU REDHA
Page | 39
6. Problématique
FRESNEAU REDHA
Page | 40
De nos jours, l'ensemble des athlètes a recours
à la musculation en complément de leur activité
principale. L'utilisation de la musculation peut aller de simples exercices de
prévention à des exercices de perfectionnement ou l'on cherche
à améliorer ses qualités physiques, de manières
spécifiques ou non. Les groupes musculaires travaillés qui
ressortent le plus sont les ischio-jambiers, les quadriceps, les fessiers, les
mollets et pour le haut du corps les bras (biceps / triceps), les pectoraux et
les épaules.
La musculation est une activité sportive qui vise
à développer la force musculaire en augmentant la masse des
muscles (ou non) par un effort physique répété ainsi que
l'endurance 39. Depuis de nombreuses années désormais,
la littérature a prouvé l'intérêt du travail de
musculation en complément d'une pratique sportive. A chaque
activité sportive ses spécificités. Quelle qu'elle soit,
elle nécessite un travail spécifique de renforcement, de
développement de puissance, d'équilibre, de souplesse musculaire
et de force. Ces paramètres peuvent être soutenus dans la
recherche de performance par l'utilisation de la musculation. Cette pratique
doit être au service de l'activité principale. Bien
évidemment, la musculation intégrée en planification d'une
préparation physique d'un boxeur sera différente de celle d'un
joueur de football ou de rugby. Les demandes musculaires, les contraintes
physiques et les fondamentaux même de la discipline diffèrent
à travers les disciplines. Cependant, le travail de fond, d'endurance et
de répétition est retrouvé à travers la
musculation. Ce sont les exercices proposés, au regard de ce qu'on
attend de l'athlète et des spécificités imposées
qui guident l'évolution de cette pratique au sein même de
différents sports. L'utilisation d'exercices spécifiques
présente en effet l'avantage de permettre un transfert rapide des gains
qu'on a pu obtenir à l'entraînement vers une habileté
motrice particulière.
Au sein du football de haut-niveau, après l'avoir
vécu en tant que joueurs et également en tant que stagiaire
durant les différentes expériences que j'ai pu avoir en
structures professionnelles, je me suis aperçu que les pieds sont les
parties du corps où les joueurs accordent le moins d'importance. Bien
évidemment, les podologues sont régulièrement
présents pour réaliser des pédicures. Ils réalisent
également un bilan podologique (à la demande des joueurs en
général) en début de saison. Néanmoins, il n'y a
que très peu de travail axé sur le pied. On retrouve des
exercices classiques de prévention sur coussin d'équilibre, sur
plateau de proprioception et parfois sur mousse. Ce type d'exercices est
FRESNEAU REDHA
Page | 41
redondant et très souvent appuyé par les
différents staffs dans le cadre de retour à la suite de blessures
(entorses chevilles, genoux..). Bien que ce type d'exercice sollicite la
musculature extrinsèque du pied (et intrinsèque en fonction la
posture et du chaussage), ils ne sont pas suffisants pour supporter l'ensemble
des contraintes que subissent leurs principaux outils de travail : leurs
pieds.
Comme dit précédemment, nos pieds sont le seul
lien entre notre corps et le sol. Toute la force est transmise par celui-ci ;
un bassin gainé, des cuisses puissantes, une course d'élan et
c'est une masse avoisinant les 700 kg que la cheville et le pied vont devoir
supporter. La chaîne postérieure, complète comprend les
fessiers, les ischio-jambiers et le complexe
suro-achilléo-calcanéo-plantaire (incluant les
fléchisseurs du pied) .40
Plusieurs études, comme nous avons pu le voir dans la
partie Etat de l'art, sont arrivées à la même conclusion,
le renforcement musculaire du pied et notamment, les fléchisseurs
permettent une amélioration de la détente, des temps au sprint et
de la qualité des appuis tout en ayant un rôle dans la
prévention des blessures et la stabilité qu'elle soit statique ou
dynamique. Cela irait donc de soi : si un pied manque de force, il va exprimer
moins que ce que les muscles des étages supérieurs veulent
transmettre. Surtout en football, les muscles des membres inférieurs,
sont très souvent très puissants. Avant d'être des joueurs
de foot, ce sont des athlètes qui doivent courir. Quand on sait que 80 %
du travail effectué par ces mêmes footballeurs en salle de
musculation est concentré sur les membres inférieurs, on comprend
que leurs pieds exprimeront moins que ce qui est disponible au-dessus. Pour
poursuivre, en rendant son pied plus fort, on le rend plus stable. Un pied
stable sera moins sujet aux blessures et il va de même pour le reste du
corps : plus un corps est fort à tous les étages et moins on
risque de le voir se blesser. 40
L'objectif de ce travail est dans un premier temps de
définir le type morphologique de chaque joueur de l'effectif
concerné par l'étude. Dans un second temps, nous voulons savoir
si renforcer les muscles du pied, avec un protocole sur 10 semaines, chez des
joueurs de football semi-professionnels a un impact sur les performances en
saut (CMJ) et au sprint court (5, 10 et 30 mètres). Enfin, nous
chercherons à savoir si le type morphologique du joueur a impacté
les résultats du protocole.
FRESNEAU REDHA
Page | 42
7. Hypothèses de
travail
FRESNEAU REDHA
Page | 43
Dans certaines études, le renforcement des muscles du
pied a mis en évidence des améliorations d'un point de vue
performance, de qualités des appuis et de prophylaxie. Toutefois, les
publics qui participaient avaient des profils différents de ceux de
footballeurs de haut-niveau. On retrouvait des cyclistes, des marathoniens, des
nageurs... Des profils de sportifs qui diffèrent de sports collectifs et
où on ne retrouve pas les sauts par exemple ou les sprints à
proprement parler. L'idée est tout d'abord de déterminer le
profil morphologique des joueurs en déterminant s'ils ont plutôt
un pied pronateur, supinateur ou physiologique (neutre). Ces mesures,
s'appuyant sur l'IPP (Index de posture de pieds) et grâce à des
outils comme une règle ou un goniomètre, doivent avoir une vue
d'ensemble sur le groupe et sur quel profil de pied est majoritaire. Pierre
Tiger, podologue du sport m'avait indiqué bien en amont qu'en
théorie les footballeurs ont un pied dit « dynamique » et donc
ont une tendance à être supinateur.
À la suite de ces mesures, les joueurs seront soumis
à une batterie de tests (avec une pesée e amont), à savoir
un test de détente verticale et un test de vitesse. Ce sont une fois ces
mesures réalisées que le public effectuera un protocole de
renforcement des muscles du pied.
À la fin de ce protocole, les joueurs
réaliseront de nouveau les mêmes tests réalisés en
début de stage, dans les mêmes conditions, afin de
vérifier si le protocole mis en place et les exercices ont
permis une amélioration de la performance sur les tests
réalisés. Il sera également question de
vérifier si des profils de pieds ont réagi de manière plus
significative que d'autre au protocole à travers les résultats
des tests.
Dans le cas où nous obtiendrions des résultats
significatifs allant dans le sens du protocole mis en place, il pourrait
être intéressant d'intégrer un protocole tel que celui-ci
aux programmes d'entraînements individuels des joueurs pour la saison
à venir. Dans le cas inverse, ce travail ne serait pas cause perdu
puisqu'il s'agit d'un travail de renforcement qui peut être
utilisé dans un cadre prophylactique.
FRESNEAU REDHA
Page | 44
8. Matériels &
Méthodes
FRESNEAU REDHA
Page | 45
8.1 Participants
Au total, 22 joueurs de football semi-professionnels ont
participé à cette étude. Ils étaient
âgés en moyenne de 25,57 ans (+ ou - 3,97 ; le plus
âgé de 33 ans et le plus jeune de 20 ans), mesuraient en moyenne
181,48 cm (+ ou - 5,35 ; le plus grand 190 cm et le plus petit 170 cm) et
pesaient en moyenne 73, 91 kg (+ ou - 5,5 ; le plus lourd pesait 84 kg et le
plus léger 63 kg). Ils étaient tous volontaire pour participer
à l'étude. L'ensemble des joueurs s'entraînent 5 fois par
semaine minimum (les séances en salle de musculation sont
réduites à cause de la crise sanitaire - Covid19). Ils
s'entraînent en moyenne 1 h 30 par jour. Aucun joueur de l'effectif ne
dispose de semelles orthopédiques. Ils n'ont jamais
réalisé de protocole de musculation de pied jusqu'à la
mise en place de celui-ci. Les profils morphologiques ont été
définis avec l'aide d'un Podologue du sport (Pierre Tiger).
Les joueurs ayant une activité professionnelle, au
nombre de 8 (âgés de 29 ans en moyenne (+ ou - 3,67) ; mesurent
179,77 cm en moyenne (+ ou - 3,7 cm) ; pèsent 74,87 kg en moyenne (+ ou
- 5, 01 kg)) ; ont une hauteur du naviculaire D moyenne de 4,24 cm, du
naviculaire G moyenne de 4,16 cm ; une tendance supinateur (+2,77 à
droite et +3,11 à gauche en moyenne). En parallèle du football
n'ont pas été soumis au protocole de musculation puisqu'aucun
contrôle n'aurait été possible, et il fallait un groupe
contrôle. Toutefois, leur type morphologique a été
défini et ils ont réalisé l'ensemble des tests.
Le groupe test était composé de 14 joueurs
(âgés de 23,36 ans en moyenne (+ ou - 2,24) ; mesurent 182,53 cm
en moyenne (+ ou - 5,7 cm) ; pèsent 69,1 kg en moyenne (+ ou - 5,9 kg))
; ont une hauteur du naviculaire D moyenne de 5,72 cm, du naviculaire G moyenne
de 5,56 cm ; une tendance supinateur (+2,5 à droite et + 3,07 à
gauche en moyenne). Ces joueurs n'ont pas d'activité à
côté du football. Ils étaient donc 100 % disponible pour
réaliser le protocole.
FRESNEAU REDHA
Page | 46
8.2 Critères d'Inclusion/Exclusion /
Non-inclusion
Tous les joueurs qui n'ont pas contracté de
lésions musculaires sur les muscles des membres inférieurs durant
les 5 derniers mois ont réalisé le test de détente et le
test de sprint.
N'ont pas été inclus dans l'étude les
jeunes joueurs de l'équipe réserve qui venaient parfois faire le
nombre à l'entraînement puisqu'il n'y avait aucune certitude
concernant leur présence quotidienne sur toute la durée de
l'étude.
Ont été exclus de l'étude 3 joueurs. Le
premier était en cours de reprise à la suite d'une rupture des
ligaments croisés. Le deuxième est arrivé durant la
première semaine de février et n'avait pas eu
d'entraînement depuis le deuxième confinement. Enfin, le
troisième a eu la Covid19 et a été placé à
l'isolement 10 jours durant la période de test. Il n'a pas repris
l'entraînement collectif avant la première semaine de mars.
8.3 Matériels
Afin de déterminer les différents profils
morphologiques de pied de chacun, je me suis appuyé sur le tableau de
l'index de posture de pied en prenant deux paramètres en compte : la
hauteur du naviculaire et la mesure d'arrière-pied avec angle
calcanéen. Pour faire les mesures, j'ai utilisé un
goniomètre de type rapporteur et une règle de 15 cm basique. Les
joueurs ont tous été pesés avec la balance du club au
moment des deux prises de poids.
La détente a été évaluée
grâce à l'application MyJump® développée et
validée par le Docteur Samozino et le Professeur Morin. Cette
application permet de mesurer la hauteur du saut (cm), le temps de vol (ms), la
vitesse (m/s), la force appliquée (N) et la puissance
développée (W).
Cette application a fait l'objet d'une étude dont les
principaux résultats ont montré que l'application est valide et
reproductible pour mesurer la hauteur de saut verticale en comparaison à
la plateforme de force 18. La vitesse a été
évaluée grâce à l'application MySprint®
développée et validée par le Docteur Samozino et le
Professeur Morin. Cette application permet de mesurer le temps de
manière précise sur des distances de 5, 10, 15, 20, 25, et 30
mètres. Elle permet aussi de mesurer la force appliquée (N) et la
puissance maximale (W/kg). La mise en place de test nécessitait des
plots avec des piquets qui devaient être placés
FRESNEAU REDHA
Page | 47
à des intervalles bien précis. Ces intervalles
ont été élaborés avec une roulotte métrique
classique qui est utilisée pour calculer des distances sur le
terrain.
Cette application a également fait l'objet d'une
étude dont les principaux résultats ont montré que
l'application est valide et reproductible pour mesurer la vitesse sur
différentes distances jusqu'à 30 mètres en comparaison
à des tests de vitesse réalisés à l'aide de radar
et de cellules. 20
Pour la partie protocole, nous avons utilisé une balle
de massage (qui peut être également une balle de tennis), une
serviette pour le grippé et un élastique de résistance 10
kg.
Les données ont été traitées et
mise en tableaux avec Excel. Le t-test a été
réalisé via Excel avec un logiciel annexe. Le t-test a
été réalisé via XLSTAT. Les échantillons
étaient appariés puisqu'il était question de comparer un
même groupe avant et après un protocole (2 fois : groupe test et
groupe contrôle) et il s'agit d'un test bilatéral.
FRESNEAU REDHA
Page | 48
9. Protocole
FRESNEAU REDHA
Page | 49
Les participants ont été répartis en 2
groupes : Groupe 1 (n = 14), Groupe 2 (n = 8). Le groupe 1 est le groupe test
et le groupe 2 est le groupe contrôle.
L'ensemble des participants ont fait l'objet de mesures au
niveau des pieds afin de déterminer leur type morphologique. Ainsi, les
joueurs, arrivaient en salle de soin par groupe de 3 (protocole COVID) et
mettent pieds nus. Ils doivent rester debout en ayant un écart entre
leurs pieds de la largeur de leurs épaules. La consigne est de
piétiner puis de se stabiliser en gardant le regard en face. La
première mesure est celle de la hauteur du naviculaire (droit et gauche)
à l'aide d'une règle graduée de 20 cm. La deuxième
mesure est le calcul de l'angle de l'arrière-pied avec angle
calcanéen (axe du tendon Achille par rapport au centre du talon). Cette
mesure est réalisée à l'aide d'un goniomètre de
type rapporteur.
Les joueurs sont tous pesés avant de débuter le
protocole et le poids de chacun est relevé dans un tableur Excel.
L'ensemble des joueurs (Gr 1 et Gr 2) réalisent ensuite
avant le début du protocole un test de vitesse et un test de
détente en salle pour obtenir une première base de données
qui servira de références.
Le test de détente est réalisé à
l'aide de l'application MyJump® comme mentionné plus tôt.
Avant de passer au saut, l'application demande de renseigner les valeurs
suivantes : longueur des jambes (de la crête iliaque jusqu'au bout des
pieds), hauteur sol-hanche en position semi-squat à 90° (de la
crête iliaque jusqu'au sol).
Ensuite les joueurs sont tous soumis à un
échauffement standardisé qui sera réalisé dans les
mêmes conditions lors du deuxième test de détente à
la fin de l'étude.
Cet échauffement s'articule ainsi :
- Vélo 5 min entre 85 et 95 rpm
- Montée de genoux sur place 30 secondes x 2
- 2 x 10 squats
- 4 bonds d'une coupelle à une autre (1,50 d'écart)
en pliométrie
Les joueurs passent à la suite les uns des autres en
salle de musculation lors de la séance du matin (10 h) et pieds nus afin
d'éviter que les chaussures ne puissent tronquer les résultats
via l'application. Ils effectuent un CMJ les mains sur les hanches. Ils n'ont
qu'un essai.
FRESNEAU REDHA
Page | 50
Le test de vitesse est réalisé à l'aide
de l'application MySprint® comme mentionné plus tôt
également. Les joueurs sont tous soumis à un échauffement
standardisé qui sera réalisé dans les mêmes
conditions lors du deuxième test de vitesse à la fin de
l'étude.
Cet échauffement s'articule ainsi :
- 2 min de mobilité articulaire (hanches, genoux,
chevilles, tronc)
- 7 min de gammes athlétiques (montées de genoux,
talons fesses, flexions, extensions, pas chassés, abduction, adduction,
balistique ischio-jambiers) - 2 sprints de 10 et 20 m (80 et 100%)
Ce test est réalisé sur terrain
synthétique pour une meilleure reproductibilité, en crampon pour
l'ensemble des joueurs et lors de la séance du matin (10h). Les joueurs
ont 2 essais chacun. L'application propose un tutoriel afin de positionner le
matériel du mieux possible. Ainsi, les joueurs effectuent une course de
30 mètres avec des intervalles tous les 5 mètres. Les piquets
sont disposés comme tel : 5,57 m pour le premier intervalle à 5
m, 10,28 m pour le deuxième intervalle à 10 m, 15 m pour le
troisième intervalle de 15 m, 19,72 m pour le quatrième
intervalle à 20 m, 24,43 m pour le cinquième intervalle à
25 m et 29,15 m pour le dernier intervalle à 30 m. Bien
évidemment, la disposition des marqueurs verticaux (piquets de
préférences) doit être la plus précise possible afin
d'avoir des données fiables. Les distances sont calculées
à l'aide de la roulotte du club.
Les mesures réalisées et les résultats
des tests sont notés dans un tableur et triées par joueur.
Le protocole débute et s'étend sur 9 semaines
pour les joueurs du groupe 1. Les joueurs sont briefés sur les exercices
à réaliser. Ils participent 2 fois par semaine à la
réalisation de celui-ci durant 20 minutes en salle de musculation le
matin.
Ils ont pour consigne de réaliser les exercices suivants
:
- déroulé de pieds sur 5 mètres (3
allers-retours) - grippé de serviette (20 répétitions de
chaque pied) - balle de massage (45 secondes sous chaque pied) -
élastiques (15 répétitions de chaque pied)
Ce circuit comporte 4 exercices et est réalisé 3
fois pour une durée de 20 minutes.
FRESNEAU REDHA
Page | 51
Chaque exercice est séparé de 15 secondes afin
de changer d'atelier. Les joueurs du groupe 1 sont répartis en
mini-groupe par 4 sur deux exercices et par 3 sur les 2 autres. Les
mini-groupes sont conservés d'une séance à l'autre. Chaque
mini-groupe est affecté à un exercice (qui est toujours le
même) pour débuter et le sens de rotation est toujours le
même sur l'ensemble du circuit pour des questions de
reproductibilité.
À la fin du protocole qui dure 9 semaines, les joueurs
sont soumis à un nouveau test de détente et un nouveau test de
vitesse, réalisés dans les mêmes conditions que la
première fois.
FRESNEAU REDHA
Page | 52
10. Résultats
FRESNEAU REDHA
Page | 53
10.1 Profils
Les mesures réalisées dans un premier temps,
à savoir la mesure de l'angle calcanéen d'arrière-pieds
(varus ou valgus) et la hauteur des naviculaires, ont permis de
déterminer la proportion de chaque type morphologique à travers
les deux groupes qui ont participé à l'étude.
Ainsi, on retrouve dans le groupe contrôle 5 profils
physiologiques et 3 profils supinateurs. Dans le groupe test, on retrouve 6
profils physiologiques, 1 profil pronateur et 7 profils supinateurs. Le tableau
ci-dessous reprend les valeurs moyennes par groupe en fonction des
différentes mesures.
Tableau 4. Hauteur des naviculaires (cm) et des angulations
d'arrières pieds par groupe
|
HAUTEUR DU
|
HAUTEUR DU
|
ANGULATION
|
ANGULATION
|
|
NAVICULAIRE (CM)
|
NAVICULAIRE (CM)
|
ARRIERE PIED (°)
|
ARRIERE PIED (°)
|
|
DROIT +/- SD
|
GAUCHE +/- SD
|
DROIT +/- SD
|
GAUCHE +/- SD
|
|
GROUPE TEST
|
5,73
|
+/- 0,91
|
5,56
|
+/- 0,92
|
+2,5
|
+/-
|
2,29
|
+3,07 +/- 3,14
|
|
GROUPE CONTROLE
|
4,28
|
+/-0,73
|
4,31
|
+/-0,62
|
+2,75
|
+/-
|
2,22
|
+3 +/- 2,59
|
Il est précisé (par le signe +) que les
angulations sont exprimées en valeurs positives. En effet, pour
simplifier les calculs et les représentations, nous avons pris comme
indicateur l'axe 0 du goniomètre de type rapporteur. En prenant comme
point de repères l'axe du tronc et en fonction de si nous sommes en
train de réaliser des mesures sur le pied droit ou sur le pied gauche :
l'ensemble des valeurs allant vers l'extérieur, c'est-à-dire
s'éloignant de l'axe du tronc (vers la droite pour le pied droit et vers
la gauche pour le pied gauche) sont considérées comme positives.
Le profil aura donc tendance à être supinateur (en regard de la
marge d'acceptation), c'est-à-dire d'avoir un appui plutôt sur
l'extérieur du pied. L'ensemble des valeurs allant vers
l'intérieur, c'est-à-dire en se rapprochant de l'axe du tronc
(vers la gauche pour le pied droit et vers la droite pour le pied gauche), sont
considérées comme négatives (en regard de la marge
d'acceptation). Dans ce cas, le profil aura tendance à être
pronateur.
Page | 54
FRESNEAU REDHA
On remarque dans le tableau que le groupe test, en moyenne,
les naviculaires droits et gauches sont plus haut que pour le groupe
contrôle. En fonction de la hauteur du naviculaire, on peut
déjà avoir une idée sur le type de pied que la personne va
avoir. Un naviculaire haut est synonyme d'un pied plutôt supinateur. Cela
se confirme dans les résultats : 7 profils supinateurs dans le groupe
test, soit 50 % ; 3 profils supinateurs dans le groupe contrôle, soit
37,5 %.
Le pied supinateur, ou pied dynamique, est donc davantage
présent dans le groupe test. L'angulation est approximativement
identique, seul l'écart-type pour la mesure d'arrière pied gauche
est plus élevé.
La marge d'acceptation pour dire qu'un pied est physiologique
ou alors pronateur/supinateur lorsqu'on détermine le profil au niveau de
l'angulation d'arrière-pied se situe à +/- 4°.
10.2 La variation du poids
La puissance a été calculée en Watt par
Kilogrammes. Les sujets de l'étude ont été pesés 2
fois : une fois avant la première batterie de test en Janvier 2021 et
une deuxième fois avant la deuxième batterie de test en Mai 2021.
L'objectif étant de ne pas avoir de variation de poids significative
afin d'éviter que cela ne fausse les comparaisons de puissance
exprimé en fonction du poids de chacun. Les résultats sont
présentés dans les tables ci-dessous.
On constate une tendance négative pour les deux
groupes. Cette tendance peut s'expliquer par le manque de compétition et
la très nette diminution de la charge d'entraînement (y compris de
musculation) dû à l'arrêt des championnats en raison de la
Covid-19. De plus, la prise de poids réalisé en Mai
coïncidait avec la fin de la période du Ramadan, ce qui peut
également expliquer la perte de poids de certain qui ont observé
le jeûne durant 4 semaines. Les valeurs individuelles sont disponibles en
annexe (annexe 2).
Tableau 5. Poids moyen par groupe relevé en Janvier
et Mai 2021
Test Group Contrôle Group
p p
values +/- SD values +/- SD
Jan. 2021 May 2021
73,75 +/- 6,03 73,5 +/- 5,52
Weight (Kg)
74,14 +/- 5,88 73,75 +/- 4,71
0,136
0,590
p : p-value
FRESNEAU REDHA
Page | 55
La différence mesurée entre les deux prises de
poids n'est pas significative, qu'il s'agisse du groupe Test
(p=0,136) ou du groupe contrôle
(p=0,590). Ainsi, la probabilité que les
performances, exprimées en puissance, aient évolué
à cause du poids est faible.
10.3 Les tests
Seules les données de puissance, en Watt par Kg ont
été traitées. Les calculs
(moyennes, Sd..) pré et post protocole ont
été réalisé à l'aide de graphiques et
testé statistiquement par le t- test via XLSTAT (groupe apparié,
test bilatéral).
Tableau 6. Résultats par groupe de la puissance
obtenue (W/Kg) pour chaque test réalisé, avant et
après le protocole
|
Measure
|
|
Test Group
values +/- SD
|
p
|
Control Group
values +/- SD
|
p
|
|
Sprint - power (W/Kg)
|
Before protocol
|
17,5035 +/-
|
1,467
|
|
15,6065 +/-
|
2,374
|
|
|
|
|
|
0,009**
|
|
|
0,994
|
|
After protocol
|
18,1256 +/-
|
1,682
|
15,6028 +/-
|
2,672
|
|
|
|
|
CMJ - power (W/Kg)
|
Before protocol
|
59,6091 +/-
|
21,391
|
|
51,5850 +/-
|
14,958
|
|
|
|
|
|
0,048*
|
|
|
0,143
|
|
After protocol
|
61,1169 +/-
|
21,650
|
51,0600 +/-
|
15,368
|
|
|
|
p : p-value * : p = 0,05 ** : p = 0,01
La puissance a augmenté pour le groupe test que ce soit
pour la performance en sprint où en saut. Elle a très
significativement augmenté (p=0,009)
après la réalisation du protocole pour les performances en
sprint. Elle a également significativement augmenté
(p=0,048) après la réalisation du
protocole pour les performances en saut (type CMJ). A l'inverse, la puissance
n'a pas évolué où très peu et de manière non
significative pour le groupe contrôle, qu'il s'agisse des performances en
sprint (p=0,994) ou en saut
(p=0,143).
Page | 56
FRESNEAU REDHA
11. Discussion
FRESNEAU REDHA
Page | 57
Le pied est un système complexe avec de nombreux de
degré liberté (flexion, dorsi-flexion, retro-flexion..). Il joue
un rôle important dans les tâches athlétiques telles que la
course, le sprint ou bien même les sauts. Des études
récentes ont montré que les mécanismes à ressort
qu'on peut qualifier de propulseur au niveau du pied provenaient en partie des
composantes élastiques de l'aponévrose plantaire. Pour
repère, cela représente 8 à 17 % de l'énergie
mécanique nécessaire à une foulée et cela peut
augmenter en fonction du développement de chacun. 27,41
D'autres études ont montré que lorsque la
vitesse augmente, l'énergie et la répartition des forces pour
maintenir une foulée sont modulé par les muscles
intrinsèques des pieds. Ce sont d'ailleurs ces muscles qui font l'objet
en grande partie de programmes de renforcement dans la littérature.
L'action des fléchisseurs des orteils, peu détaillés au
cours de l'étude, serait générée
simultanément par l'action commune des muscles intrinsèques et
extrinsèques du pied.42,43 Une étude11 a
d'ailleurs montré une corrélation significative chez des joueurs
de football américain entre la force maximale de flexion des orteils et
la capacité à changer de direction avec une plus grande
agilité sur un test de 3 cônes.
Concernant notre étude, les résultats de
l'étude ont démontré une amélioration significative
des performances en sprint court (5 m) et en saut (CMJ). Ces données ont
été traitées et comparées en tenant compte de la
puissance musculaire développé par les sujets. Ces données
étaient disponibles via les outils d'évaluation utilisés
à savoir les applications My Sprint et My Jump. Afin d'individualiser au
mieux et d'avoir des données interpersonnelles, nous avons pris la
décision d'exprimer les valeurs de puissance par rapport au poids de
chacun. C'est pour cette raison que nous avons des moyennes en Watt/Kg. Pour 2
sujets dégageant la même puissance sur le même test, ramener
celle-ci au poids permet de déterminer avec plus de
représentativité les profils de chacun dans un souci
d'individualisation des résultats.
Concernant les mesures réalisées au niveau
anatomique sur les différents pieds des joueurs, à savoir la
hauteur des naviculaires et le varus/valgus d'arrière-pied : on ne
retrouve pas de différence entre le début et la fin du protocole
même s'il a été démontré dans certaines
études que certains programmes d'entraînement permettent de
corriger des défauts d'axe concernant la complexe suro-achilléo
calcanéo-plantaire. 2,7,17,44,44-46
FRESNEAU REDHA
Page | 58
Les types morphologiques n'ayant pas bougé et en regard
de la littérature, nous supposons que la durée du protocole
n'était pas assez longue pour venir influer sur ce paramètre
Pour poursuivre, nous pouvons affirmer en observant les
résultats que les différents types morphologiques
retrouvés dans la population de l'étude n'ont pas eus d'influence
sur les résultats. En revanche, ayant constaté une population
majoritairement supinatrice dans le groupe test, nous émettons
l'hypothèse qu'un pied supinateur, également appelé pied
dynamique, paraît plus enclin à réagir avec un protocole
comme celui que nous avons mis en place. Nous pourrions tenter d'argumenter
cela en soulignant la manière de répartir le poids sur le pied
dans un premier temps, puis l'action majoritaire du médio pied dans le
processus de propulsion. En effet, le pied physiologique appuie davantage sur
le médio pied ; aussi, le temps de contact en étant
potentiellement plus élevé diminuerait-il la puissance
dégagée ? Et serait-il plus intéressant d'être
supinateur dans ce cas ?
Toutefois, cette réflexion est à approfondir
puisqu'il est largement démontré qu'une supination excessive est
source de blessure, tout comme une pronation excessive.7
L'hypothèse que nous avions émise, à
savoir qu'un protocole de musculation de pied aurait une influence sur
l'explosivité, est donc vérifiée suite à notre
étude.
En nous intéressant à la littérature et
après avoir exploré les sujets touchant de près ou de loin
la structure du pied dans la partie « Etat de l'art », nous avons pu
retenir X études traitant l'aspect performance.
Tout d'abord l'étude de Iwona Sulowska et al.
6, dont l'objectif était d'évaluer l'influence
d'exercices de musculation du pied sur la performance de coureurs de marathon.
Après avoir rassemblé à un public de 47 sportifs
confirmés dans la discipline, ils ont mis en place un protocole pour un
groupe test en comparaison avec un groupe témoin. Les tests
utilisés ont permis de déterminer le couple, le travail, la
puissance des fléchisseurs et extenseurs du genou sur dynamomètre
isocinétique, et la puissance développé au terme d'un RAST
test qui évalue la puissance anaérobie lactique directement sur
le terrain. Les résultats ont démontré des
améliorations significatives sur l'ensemble des paramètres
énumérés précédemment. C'est ainsi qu'ils en
ont conclus que les exercices de renforcement des muscles des pieds
améliore le transfert d'énergie à travers les segments du
corps, et plus particulièrement du bas du corps ; et que ceux-ci
améliorent par la même occasion la force et la puissance
générée.
FRESNEAU REDHA
Page | 59
La méthodologie est intéressante, mais il
paraît évident que la répartition des profils aux seins de
l'étude est trop homogène, on ne retrouve pas de pronation ou de
supination excessive ce qui ne peut constituer un réel reflet d'une
population de sportif et qui plus est, de course à pied. Il aurait pu
être judicieux de réaliser ce projet avec des podologues du sport
afin d'élargir les profils et les différents types morphologiques
obtenus grâce à l'index de posture de pied.
L'étude d'Hashimoto & al. 8, qui se
rapproche également de ce que nous avons fait en tenant compte de la
performance motrice, présente des résultats intéressants
suite à la réalisation de son programme de renforcement (Toe-Curl
Exercice). Il apparait une augmentation significative de la distance au
1-legged-jump, et de la hauteur au vertical jump. De même il y a une
diminution significative de temps au 50-m dash time. Nous remarquons que les
résultats sont exprimés en valeurs brutes. Les auteurs ne
tiennent pas compte des profils physiologiques des sujets. La notion de
puissance n'est pas énumérée, ce qui laisse
apparaître une trop grande variabilité dans les résultats,
sans individualisation en fonction des sujets de l'étude.
Au vu des tests réalisés et des résultats
globalement significatifs, la démarche aurait été,
à mon sens, plus précise de prendre en compte l'expression de la
puissance en W/Kg, car c'est elle qui prime dans l'étude la
motricité et notamment dans les thèmes de force /
vitesse.47 En conclusion ces résultats laissent penser que le
renforcement de la musculature intrinsèque pourrait avoir des
bénéfices sur les capacités d'absorption des chocs et les
performances motrices.
FRESNEAU REDHA
Page | 60
1. Biais/Limites de l'étude
Les résultats de notre étude peuvent être
biaisés par un non-respect exact du protocole puisqu'une partie a
été réalisée en autonomie en raison du confinement.
Cependant, au vue de la nature des tests et des résultats
affichés, nous pensons qu'il a été effectué avec
sérieux. Les résultats peuvent également avoir
été biaisés par un programme de musculation centrant les
muscles du bas du corps qui peuvent avoir une grande influence dans
l'augmentation des performances d'explosivité.40,48,49
Cependant, les salles de sport étant fermés et le public n'ayant
eu que très peu accès à la salle privée du club,
nous pensons que cette variable est assez négligeable. L'ensemble du
public a continué un programme d'entretien physique contenant course et
prophylaxie sous forme de renforcement. Il n'y avait pas d'aspect de
développement musculaire ou d'augmentation des qualités de force
/ vitesse à travers les exercices proposés.
Les intervalles de distances pour le test de sprint ont
été mesurés via un odomètre. La mise en place des
repères a été faite de la façon la plus
précise possible. Cependant, l'utilisation du terrain
synthétique, pour des questions de reproductibilité, ne
permettait pas de planter chaque piquet précisément à la
distance imposée par l'algorithme de l'application. Il fallait mettre un
support afin de faire tenir le repère de façon droite et fixe.
Cette marge d'erreur, correspondant au rayon du support fixe d'environ + / - 5
cm est considérée comme une limite. Cependant, les
bénéfices de réaliser les évaluations sur cette
surface étaient nettement supérieurs aux limites qu'ils allaient
engendrer. La réalisation sur un gazon naturelle, en regard des
périodes où les joueurs ont effectué leur test (janvier et
mai) aurait induit des conditions de reproductibilité plus que
discutable. Le terrain synthétique nous assurait d'avoir une surface qui
resterait la même et qui n'influerait pas, en fonction de la
météo, sur les résultats.
FRESNEAU REDHA
Page | 61
12. Conclusion
FRESNEAU REDHA
Page | 62
Cette période stage, qui s'étalait sur le
deuxième semestre de cette année universitaire, m'a permis de
mener une étude sur la durée. En effet, l'année
dernière, le stage de Master 1 n'a pas été à son
terme et le projet que j'avais mis en place avec ma structure n'a pas abouti.
Pour preuve, le mémoire était présenté sous la
forme d'une bibliographique. À l'inverse cette année, j'ai pu
aller au bout de mon projet même si le confinement de mars est venu
légèrement bousculer la tenue du protocole. Bien que tous les
paramètres n'aient pu être maîtrisés en raison de la
crise sanitaire, l'ensemble des participants et des personnes qui ont
contribués à la mise en place et à la réalisation
de ce stage ont été impliqué dans ce projet. Ainsi, j'ai
pu obtenir des résultats qualitatifs et exploitables. Les outils mis
à disposition ont été relativement simples d'utilisation
et j'ai su rapidement m'adapter afin de pouvoir les maîtriser du mieux
que je pouvais. Que ce soit My Sprint ou My Jump, on retrouve un tutoriel dans
l'application et une présentation sur le site internet du
développer où on y voit le Professeur Morin décrire et
expliqué le fonctionnement.
Les données ont été traitées et
exploitées via Microsoft Excel et XLSTAT2021. J'ai ainsi pu en
dégager des tableaux pour présenter les résultats et les
analyser de manière scientifique.
L'hypothèse émise lors du début de cette
étude, qui s'appuyait sur des résultats trouvés dans la
littérature a ainsi pu être confirmée. L'étude mise
en place durant ce stage de Master 2 a pu démontrer qu'un protocole de
musculation du pied, et plus particulièrement des muscles
fléchisseurs, permet une amélioration significative de la
performance en saut (CMJ) et en sprint court (5 m). En s'intéressant
à la littérature déjà existante sur cette
thématique, nous pouvons nous apercevoir que le public était
très souvent issu de la course à pied. En globalité des
profils plutôt sportifs qui pratique de la longue distance. Aucune
étude n'a porté sur des profils plutôt explosifs qu'on
retrouve dans les sports collectifs par exemple et où
l'explosivité des membres inférieurs est synonyme de performance.
C'est ce qui distingue le travail réalisé lors de ce stage des
études déjà existantes.
Dans une perspective future, il serait intéressant
d'intégrer un programme de renforcement comme celui que nous avons mis
en place au cours de l'étude sur des joueurs en formation ; d'abord afin
d'améliorer la qualité des appuis, ensuite dans une logique de
prévention et enfin pour améliorer les performances dans des
disciplines nécessitant de l'explosivité au sol pour
performer.
FRESNEAU REDHA
Page | 63
13. Références
bibliographiques
FRESNEAU REDHA
Page | 64
(1) Ebrecht, F.; Sichting, F. Does Neuromuscular
Electrostimulation Have the Potential to Increase Intrinsic Foot Muscle
Strength? The Foot 2018, 35, 56-62.
(2) Taddei, U. T.; Matias, A. B.; Duarte, M.; Sacco, I. C. N.
Foot Core Training to Prevent Running-Related Injuries: A Survival Analysis of
a Single-Blind, Randomized Controlled Trial. Am. J. Sports Med.
2020, 48 (14), 3610-3619.
(3) Tourillon, R.; Gojanovic, B.; Fourchet, F. How to Evaluate
and Improve Foot Strength in Athletes: An Update. Front. Sports Act. Living
2019, 1, 46.
(4) Tanaka, T.; Suga, T.; Imai, Y.; Ueno, H.; Misaki, J.;
Miyake, Y.; Otsuka, M.; Nagano, A.; Isaka, T. Characteristics of Lower Leg and
Foot Muscle Thicknesses in Sprinters: Does Greater Foot Muscles Contribute to
Sprint Performance? Eur. J. Sport Sci. 2019, 19
(4), 442-450.
(5) Veltrie, R. E. The Effects of Intrinsic Foot Muscle
Strengthening on Foot Posture, Balance, and Agility in Ice Hockey Players. MS,
West Virginia University Libraries, 2020.
(6) Sulowska, I.; Mika, A.; Oleksy, £.; Stolarczyk, A. The
Influence of Plantar Short Foot Muscle Exercises on the Lower Extremity Muscle
Strength and Power in Proximal Segments of the Kinematic Chain in Long-Distance
Runners. BioMed Res. Int. 2019, 2019,
1-11.
(7) Lynn, S. K.; Padilla, R. A.; Tsang, K. K. W. Differences in
Static- and Dynamic-Balance Task Performance After 4 Weeks of
Intrinsic-Foot-Muscle Training: The Short-Foot Exercise Versus the Towel-Curl
Exercise. J. Sport Rehabil. 2012, 21 (4),
327-333.
(8) Hashimoto, T.; Sakuraba, K. Strength Training for the
Intrinsic Flexor Muscles of the Foot: Effects on Muscle Strength, the Foot
Arch, and Dynamic Parameters Before and After the Training. J. Phys. Ther.
Sci. 2014, 26 (3), 373-376.
(9) Gooding, T. M.; Feger, M. A.; Hart, J. M.; Hertel, J.
Intrinsic Foot Muscle Activation During Specific Exercises: A T2 Time Magnetic
Resonance Imaging Study. J. Athl. Train. 2016, 51
(8), 644-650.
(10) Soysa, A.; Hiller, C.; Refshauge, K.; Burns, J. Importance
and Challenges of Measuring Intrinsic Foot Muscle Strength. J. Foot Ankle
Res. 2012, 5 (1), 29.
(11) Yuasa, Y.; Kurihara, T.; Isaka, T. Relationship Between Toe
Muscular Strength and the Ability to Change Direction in Athletes. J. Hum.
Kinet. 2018, 64 (1), 47-55.
(12) Angin, S.; Mickle, K. J.; Nester, C. J. Contributions of
Foot Muscles and Plantar Fascia Morphology to Foot Posture. Gait Posture
2018, 61, 238-242.
(13) Gonçalves de Carvalho, B. K.; Penha, P. J.; Ramos,
N. L. J. P.; Andrade, R. M.; Ribeiro, A. P.; João, S. M. A. Age, Sex,
Body Mass Index, and Laterality in the Foot Posture of Adolescents: A Cross
Sectional Study. J. Manipulative Physiol. Ther. 2020,
43 (7), 744-752.
FRESNEAU REDHA
Page | 65
(14) Pérez-Morcillo, A.; Gómez-Bernal, A.;
Gil-Guillen, V. F.; Alfaro-Santafé, J.; Alfaro-Santafé, J.
V.;
Quesada, J. A.; Lopez-Pineda, A.; Orozco-Beltran, D.;
Carratalá-Munuera, C. Association between the Foot Posture Index and
Running Related Injuries: A Case-Control Study. Clin. Biomech.
2019, 61, 217-221.
(15) Redmond, A. C.; Crosbie, J.; Ouvrier, R. A. Development and
Validation of a Novel Rating System for Scoring Standing Foot Posture: The Foot
Posture Index. Clin. Biomech. 2006, 21 (1),
89-98.
(16) Okamura, K.; Kanai, S.; Hasegawa, M.; Otsuka, A.; Oki, S.
The Effect of Additional Activation of the Plantar Intrinsic Foot Muscles on
Foot Dynamics during Gait. The Foot 2018,
34, 1-5.
(17) Sánchez-Rodríguez, R.; Valle-Estévez,
S.; Fraile-García, P. A.; Martínez-Nova, A.;
Gómez-Martín, B.; Escamilla-Martínez, E. Modification of
Pronated Foot Posture after a Program of Therapeutic Exercises. Int. J.
Environ. Res. Public. Health 2020, 17 (22),
8406.
(18) Balsalobre-Fernández, C.; Glaister, M.; Lockey, R.
A. The Validity and Reliability of an IPhone App for Measuring Vertical Jump
Performance. J. Sports Sci. 2015, 33 (15),
1574-1579.
(19) Stanton, R.; Kean, C. O.; Scanlan, A. T. My Jump
for Vertical Jump Assessment. Br. J. Sports Med.
2015, 49 (17), 1157-1158.
(20) Romero-Franco, N.; Jiménez-Reyes, P.;
Castaño-Zambudio, A.; Capelo-Ramírez, F.; Rodríguez-Juan,
J. J.; González-Hernández, J.; Toscano-Bendala, F. J.;
Cuadrado-Peñafiel, V.; Balsalobre-Fernández, C. Sprint
Performance and Mechanical Outputs Computed with an IPhone App: Comparison with
Existing Reference Methods. Eur. J. Sport Sci. 2017,
17 (4), 386-392.
(21) Maestro, M.; Ferre, B. Anatomie fonctionnelle du pied et de
la cheville de l'adulte. Rev. Rhum. Monogr. 2014,
81 (2), 61-70.
(22) Drake, C.; Mallows, A.; Littlewood, C. Psychosocial
Variables and Presence, Severity and Prognosis of Plantar Heel Pain: A
Systematic Review of Cross-Sectional and Prognostic Associations.
Musculoskeletal Care 2018, 16 (3),
329-338.
(23) Kapandji, A. I. Anatomie fonctionnelle: schémas
commentés de mécanique humaine; Maloine: Paris, 2007.
(24) Fraser, J.; Hertel, J. Effects of a 4-Week Intrinsic Foot
Muscle Exercise Program on Motor Function: 1679 Board #354 June 1 9 00 AM - 10
30 AM. Med. Sci. Sports Exerc. 2017, 49
(5S), 481.
(25) Viel, E. R.; Desmarets, J. J. Mechanical Pull of the
Peroneal Tendons on the Fifth Ray of the Foot. 1985, 5.
FRESNEAU REDHA
Page | 66
(26) Klein, P.; Sommerfeld, P. Biomécanique des
membres inférieurs: bases et concepts, bassin, membres
inférieurs; Elsevier Masson: Issy-les-Moulineaux, 2008.
(27) Kowalski, C. Biomécanique du pied. Première
partie. Médecine Chir. Pied 2012, 28
(3), 89-99. .
(28) Danowski, R.-G.; Chanussot, J.-C. Traumatologie du
sport; Masson: Issy-les-Moulineaux, 2005.
(29) Leboeuf, F.; de Leluardière, F. A.; Lacouture, P.;
Duboy, J.; Leplanquais, F.; Junqua, A. Étude biomécanique de la
course à pied. 17.
(30) Germain. C, Lamotte. A. Anatomie pour le mouvement. 02.
02.; Editions ARA: Montréal, 2009.
(31) Julia, M.; Hirt, D. La proprioception; Sauramps
médical: Montpellier, 2012.
(32) Prévost, P. Étirements et performance
sportive : 2004, 9.
(33) Dufour, M. Les diamants neuromusculaires; Ed.
Volodalen: Chavéria, 2009.
(34) Drubigny, A.; Lunzenfichter, A. La musculation pour
tous les sportifs: programmes spécifiques pour 43 sports de
l'athlétisme ... au volley; R. Laffont: Paris, 1992.
(35) Badin, J.-C. Volley-ball: formation du joueur et
entraînement; Amphora: Paris, 1991.
(36) Chapman, D. W.; Newton, M.; Mcguigan, M.; Nosaka, K. Effect
of Lengthening Contraction Velocity on Muscle Damage of the Elbow Flexors.
Med. Sci. Sports Exerc. 2008, 40 (5), 926-933
(37) Bobbert, M. F.; Gerritsen, K. G. M.; Litjens, M. C. A.;
Soest, A. J. V. Why Is Countermovement Jump Height Greater than Squat Jump
Height? Med. Sci. Sports Exerc. 1996, 28
(11), 1402- 1412.
(38) Trainingslehre: Einf. in d. Theorie u. Methodik d.
Sportl. Trainings, 10., überarb. Aufl.; Harre,
D., Ed.; Sportverl: Berlin, 1986.
(39) Duchateau, J.; Hainaut, K. Training Effects of Sub-Maximal
Electrostimulation in a Human Muscle: Med. Sci. Sports Exerc.
1988, 20 (1), 99-104.
(40) Reiss, D.; Prevost, P.; Cazorla, G. La nouvelle bible
de la préparation physique: le guide scientifique et pratique pour
tous; 2020.
(41) Chateau, H.; Robin, D.; Falala, S.; Degueurce, C. ANATOMIE
ET BIOMÉCANIQUE DU. 2007, 11.
(42) Boisnel, M. Effets de la fréquence de la
foulée et du type de pose de pied lors de la course à pied sur la
fracture de fatigue tibiale. 71.
FRESNEAU REDHA
Page | 67
(43) Barthelemy, M.; Rey, O. Le pied sportif, étude
anthropologique d'une évidence silencieuse. Corps
2012, N° 10 (1), 209.
(44) Nielsen, R. O.; Buist, I.; Parner, E. T.; Nohr, E. A.;
Sørensen, H.; Lind, M.; Rasmussen, S. Foot Pronation Is Not Associated
with Increased Injury Risk in Novice Runners Wearing a Neutral Shoe: A 1-Year
Prospective Cohort Study. Br. J. Sports Med. 2014,
48 (6), 440-447.
(45) Pabón-Carrasco, M.; Castro-Méndez, A.;
Vilar-Palomo, S.; Jiménez-Cebrián, A. M.; García-Paya, I.;
Palomo-Toucedo, I. C. Randomized Clinical Trial: The Effect of Exercise of the
Intrinsic Muscle on Foot Pronation. Int. J. Environ. Res. Public. Health
2020, 17 (13), 4882.
(46) Jam, D. B. Evaluation and Retraining of the Intrinsic Foot
Muscles for Pain Syndromes Related to Abnormal Control of Pronation. 8.
(47) Perrine, J. J.; Edgerton, V. R. Muscle Force-Velocity and
Power-Velocity Relationships under Isokinetic Loading. Med. Sci. Sports
1978, 10 (3), 159-166.
(48) Reiss, D.; Prevost, P.; Cazorla, G. La bible de la
préparation physique: le guide scientifique et pratique pour tous.
2013.
(49) Macdougall, D.; Sale, D. THE PHYSIOLOGY OF TRAINING FOR
HIGH PERFORMANCE FREE DOWNLOAD. 3.
FRESNEAU REDHA
Page | 68
Table des annexes
Annexe 1 : Présentation des différents
paramètres mesurés 71
Annexe 2 : Poids correspondant à chaque sujet en
Janvier 2021 et
Mai 2021 72
Annexe 3 : Résultats individuels des tests du groupe
Test 73
1. Résultats individuels du groupe Test : tests de
vitesse (5m) 72
2. Résultats individuels du groupe Test : tests de
détente (CMJ) 72
Annexe 4 : Résultats individuels des tests du groupe
contrôle 74
1. Résultats individuels du groupe Contrôle :
tests de vitesse (5m) 73
2. Résultats individuels du groupe Contrôle :
tests de détente (CMJ) 73
Annexe 5 : Mise en place du test de vitesse avec My
Sprint® 75
Présentation de la mise en place 74
Annexe 6 : Utilisation des applications My Sprint® et My
Jump® 76
1. My jump ® 75
2. My Sprint® 75
Annexe 7 : Exemples de résultats obtenus avec les
applications 77
1. My Sprint® 76
2. My Jump® 76
FRESNEAU REDHA
Page | 69
Annexe 1 : Présentation de la hauteur des
naviculaires
(droit et gauche), des angulations d'arrière pieds
(droit et
gauche) et de la tendance des sujets de chaque groupe
|
Groupe
|
Sujets
|
Hauteur ND
(cm)
|
Hauteur NG
(cm)
|
Angulation
APD (°)
|
Angulation
APG (°)
|
Tendance
|
|
Test
|
Andréa
|
5
|
5
|
6
|
6
|
Supinateur
|
|
Test
|
Aurélien
|
5,5
|
4,9
|
2
|
5
|
Supinateur
|
|
Test
|
Jordan P
|
6,2
|
5,3
|
5
|
5
|
Supinateur
|
|
Test
|
Adel
|
4
|
3,8
|
1
|
-3
|
Pronateur
|
|
Test
|
Abdou
|
5,6
|
6
|
0
|
3
|
Physio
|
|
Test
|
Chris
|
4,5
|
4,8
|
4
|
6
|
Supinateur
|
|
Test
|
Julien
|
6
|
6,2
|
6
|
7
|
Supinateur
|
|
Test
|
Maxime
|
6,2
|
6,5
|
5
|
5
|
Supinateur
|
|
Test
|
Juvrel
|
6,3
|
6,5
|
0
|
-1
|
Physio
|
|
Test
|
Louis
|
7
|
6,8
|
0
|
0
|
Physio
|
|
Test
|
Thomas
|
6
|
6,2
|
3
|
1
|
Physio
|
|
Test
|
Gora
|
4,4
|
3,9
|
3
|
5
|
Supinateur
|
|
Test
|
Abdel
|
6,5
|
6
|
0
|
5
|
Physio
|
|
Test
|
Baptiste
|
7
|
6
|
0
|
-1
|
Physio
|
|
Contrôle
|
Jérome
|
3
|
3
|
0
|
0
|
Physio
|
|
Contrôle
|
Rudy
|
5,2
|
5,1
|
1
|
0
|
Physio
|
|
Contrôle
|
Jimmy
|
4
|
4,3
|
5
|
8
|
Supinateur
|
|
Contrôle
|
Ange
|
4
|
4,5
|
3
|
2
|
Physio
|
|
Contrôle
|
Nicolas
|
5,5
|
5
|
2
|
2
|
Physio
|
|
Contrôle
|
Mehdi
|
4,5
|
4,6
|
6
|
5
|
Supinateur
|
|
Contrôle
|
Papis
|
4
|
4
|
0
|
2
|
Physio
|
|
Contrôle
|
Sébastien
|
4
|
4
|
5
|
5
|
Supinateur
|
ND = naviculaire droit / NG = naviculaire gauche / APD =
arrière pied droit / APG = arrière pied gauche
Page | 70
FRESNEAU REDHA
Annexe 2 : Poids correspondant à chaque
sujet en Janvier 2021 et Mai 2021
|
Groupe
|
Sujets
|
Poids (Kg) (01/2021)
|
Poids (Kg) (05/2021)
|
|
Test
|
Abdel
|
74
|
|
72
|
|
Test
|
Abdoulaye
|
79
|
|
77
|
|
Test
|
Adel
|
65
|
|
64
|
|
Test
|
Aurelien
|
63
|
|
63
|
|
Test
|
Baptiste
|
82
|
|
83
|
|
Test
|
Christopher
|
78
|
|
78
|
|
Test
|
Julien
|
76
|
|
75,5
|
|
Test
|
Louis
|
84
|
|
84
|
|
Test
|
Maxime
|
74
|
|
75
|
|
Test
|
Thomas
|
70
|
|
70
|
|
Test
|
Andrea
|
75
|
|
74
|
|
Test
|
Jordan
|
72
|
|
71
|
|
Test
|
Juvrel
|
78
|
|
78
|
|
Test
|
Gora
|
68
|
|
68
|
|
Contrôle
|
Ange
|
79
|
|
80
|
|
Contrôle
|
Rudy
|
78
|
|
78
|
|
Contrôle
|
Jimmy
|
78
|
|
79,5
|
|
Contrôle
|
Mehdi
|
67
|
|
64,5
|
|
Contrôle
|
Nicolas
|
72
|
|
72
|
|
Contrôle
|
Papis
|
70
|
|
69
|
|
Contrôle
|
Sébastien
|
78
|
|
77
|
|
Contrôle
|
Jérôme
|
68
|
|
68
|
FRESNEAU REDHA
Page | 71
Annexe 3 : Résultats individuels
détaillés des tests pour
chaque membre du groupe
Test
1. Présentation des résultats
individuels du groupe Test pour les tests de vitesse (5 m)
Sujets
|
Vitesse 5 m (s)
01/2021
|
Vitesse 5 m (s)
05/2021
|
P max (W/Kg)
01/2021
|
P max (W/Kg)
05/2021
|
Abdel
|
1,272
|
1,269
|
18,242
|
18,452
|
Abdoulaye
|
1,273
|
1,269
|
18,859
|
19,321
|
Adel
|
1,293
|
1,3
|
18,035
|
17,672
|
Aurelien
|
1,295
|
1,285
|
18,229
|
19,769
|
Baptiste
|
1,312
|
1,302
|
24,042
|
25,012
|
Christopher
|
1,358
|
1,341
|
19,234
|
20,238
|
Julien
|
1,487
|
1,398
|
15,335
|
17,12
|
Louis
|
1,444
|
1,542
|
14,38
|
13,981
|
Maxime
|
1,364
|
1,303
|
17,709
|
19,261
|
Thomas
|
1,436
|
1,387
|
15,341
|
14,897
|
Andrea
|
1,402
|
1,398
|
14,283
|
15,178
|
Jordan
|
1,227
|
1,231
|
19,12
|
18,784
|
Juvrel
|
1,358
|
1,327
|
16,194
|
17,362
|
Gora
|
1,317
|
1,303
|
16,046
|
16,992
|
|
2. Présentation des résultats
individuels du groupe Test pour les tests de détente (CMJ)
|
Sujets
|
Hauteur du saut (cm)
01/2021
|
Hauteur du saut (cm)
05/2021
|
P max (W/Kg)
01/2021
|
P max (W/Kg)
05/2021
|
|
Abdel
|
32,16
|
34,45
|
29,21675676
|
30,251628
|
|
Abdoulaye
|
47,9
|
48,12
|
87,40493671
|
89,78653
|
|
Adel
|
37,6
|
35,81
|
43,52661538
|
41,741987
|
|
Aurelien
|
37,66
|
39,87
|
70,21714286
|
70,328732
|
|
Baptiste
|
34,34
|
36,21
|
47,48914634
|
49,376428
|
|
Christopher
|
42,26
|
45,64
|
45,83641026
|
46,849281
|
|
Julien
|
46,57
|
47,06
|
74,26763158
|
76,987292
|
|
Louis
|
34,83
|
32,17
|
64,66392857
|
63,283729
|
|
Maxime
|
45,38
|
44,76
|
112,2902703
|
112,1290802
|
|
Thomas
|
33,26
|
35,65
|
53,30528571
|
56,298234
|
|
Andrea
|
37,09
|
43,28
|
63,148
|
72,019238
|
|
Jordan
|
42,3
|
43,38
|
53,10319444
|
55,3098202
|
|
Juvrel
|
31,17
|
30,78
|
47,15589744
|
46,898821
|
|
Gora
|
37,2
|
39,61
|
42,90176471
|
44,376572
|
FRESNEAU REDHA
Page | 72
Annexe 4 : Résultats individuels
détaillés des tests pour
chaque membre du groupe
contrôle
1. Présentation des résultats
individuels du groupe Contrôle pour les tests de vitesse (5 m)
Sujets
|
Vitesse 5 m (s)
01/2021
|
Vitesse 5 m (s)
05/2021
|
P max (W/Kg)
01/2021
|
P max (W/Kg)
05/2021
|
Ange
|
1,342
|
1,351
|
15,639
|
14,971
|
Rudy
|
1,509
|
1,496
|
14,519
|
15,217
|
Jimmy
|
1,498
|
1,515
|
16,428
|
14,724
|
Mehdi
|
1,515
|
1,529
|
13,962
|
13,172
|
Nicolas
|
1,507
|
1,492
|
14,236
|
15,974
|
Papis
|
1,479
|
1,463
|
15,115
|
16,386
|
Sébastien
|
1,337
|
1,312
|
18,312
|
19,031
|
Jérôme
|
1,331
|
1,389
|
16,641
|
15,348
|
|
2. Présentation des résultats
individuels du groupe Contrôle pour les tests de détente (CMJ)
|
Sujets
|
Hauteur du saut (cm)
01/2021
|
Hauteur du saut (cm)
05/2021
|
P max (W/Kg)
01/2021
|
P max (W/Kg)
05/2021
|
|
Ange
|
38,74
|
38,21
|
41,55025316
|
40,398494
|
|
Rudy
|
36,3
|
34,43
|
40,82769231
|
38,672819
|
|
Jimmy
|
34,4
|
34,26
|
38,71128205
|
38,65524
|
|
Mehdi
|
38,8
|
39,93
|
61,26761194
|
62,1091209
|
|
Nicolas
|
36,53
|
35,54
|
43,11819444
|
42,123836
|
|
Papis
|
39,9
|
39,18
|
74,564
|
74,34872
|
|
Sébastien
|
41,13
|
40,89
|
71,24910256
|
70,873902
|
|
Jérôme
|
38,23
|
38,19
|
41,3925
|
41,298293
|
FRESNEAU REDHA
Page | 73
Annexe 5 : Mise en place du test de vitesse avec My
Sprint®
Présentation de la mise en
place
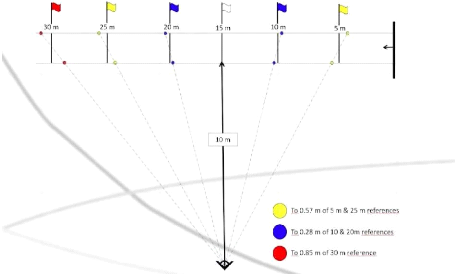
Les écarts entre chaque intervalle sont définis
par l'application. Ils tiennent compte de l'angle de prise de vue. Pour cette
raison, plus les distances seront précises dans la mise en place du test
et plus la fiabilité sera importante.
FRESNEAU REDHA
Page | 74
Annexe 6 : Utilisation des applications My Sprint®
et My
Jump®
1. My jump ®
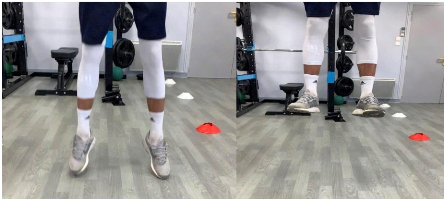
Avec l'application, nous filmons le sujet qui réalise
un saut de type CMJ. Elle permet un séquençage image par image
pour plus de précision. L'idée est de sélectionner en
premier l'image ou le dernier pied décolle du sol. Puis il faut
sélectionner l'image ou le premier pied touche le sol. Une fois la
manipulation réalisée, l'application s'occupe de réaliser
les calculs.
2. My Sprint®

Avec l'application et sur un support stable et fixe, on filme
le sujet qui réalise un 30 m départ arrêté. Elle
permet tout comme My Jump® un séquençage image par image
pour plus de précision. L'idée est de sélectionner chaque
image ou le centre du bassin des sujets se trouve au niveau des jalons. Il faut
être précis puisque le sportif est à vitesse maximale et un
écart d'une image peut entraîner une erreur dans le calcul du
temps de passage. Une fois chaque jalon validé, l'application s'occupe
de réaliser les calculs.
FRESNEAU REDHA
Page | 75
Annexe 7 : Exemples de présentation de
résultats
obtenus avec les applications My Sprint® et My
Jump®
1. My Sprint®

Les résultats obtenus après un test de vitesse
réalisé avec l'application My Sprint® sont
référencés de cette façon (ci-dessus). On y observe
le temps (s) aux différents intervalles (1 - > 5 m, 2 -> 10 m,
ect..) ainsi que des données annexes : la puissance max (w), la
puissance max (W/Kg), la vitesse, la force (N)...
2. My Jump®

Les résultats obtenus après un test de
détente réalisé avec l'application My Jump® sont
référencés de cette façon (ci-dessus). On y observe
la hauteur du saut (cm), le temps de vol (ms), la vitesse (m/s), la force (N)
et la puissance (W). La puissance en W/Kg est obtenue dans notre étude
en divisant la valeur de puissance, indiquée par l'application, par le
poids des sujets.
FRESNEAU REDHA
Page | 76
|
|



