|
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
BURKINA FASO
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
Unité-Progrès-Justice

251658240 DE L'INNOVATION (MERSI)UNIVERSITE JOSEPH
KI-ZERBO
UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
EN SCIENCES HUMAINES (UFR/SH)
DEPARTEMENT D'HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE
MEMOIRE
DE MASTER
OPTION : ECONOMIE, POPULATION ET RELATIONS
INTERNATIONALES
LA COOPERATION ENTRE LE JAPON ET LE BURKINA FASO
DEPUIS LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE TOKYO SUR LE DEVELOPEMENT DE L'AFRIQUE
(TICAD) :1993-2018
251659264
Présenté par Eric ZONGO
SOUS LA DIRECTION DE :
Membre du jury:
Pr Claude Etienne SISSAO
Président: Pr CISSE Issa
Rapporteur : Pr SISSAO Claude Etienne
Membre : Dr COULIBALY Hervé
Landry
Année universitaire 2019-2020
DEDICACE
Je
dédie ce mémoire à mon très cher père Ignace
ZONGO et à ma très chère mère Honorine NANEMA.
REMERCIEMENT
La réalisation d'un travail comme celui-ci
s'accompagne de nombreuses dettes de reconnaissances. Nos remerciements vont
tout particulièrement à :
A notre Directeur de mémoire, le Professeur Claude
Etienne SISSAO, pour sa disponibilité et ses nombreuses observations et
remarques ;
Au corps professoral du Département Histoire et
Archéologie de l'Université Joseph Ki-Zerbo ;
Au Bureau du Département « Asie,
Moyen-Orient et Pacifique » du Ministère des affaires
étrangères et de la coopération régionale du
Burkina Faso ;
Au Gouvernement du Japon ;
A tous nos camarades de promotion ;
A tous nos amis qui nous ont apporté leurs
soutiens ;
A nos parents, frères et soeurs qui nous ont
indéfectiblement encouragés tout au long de ce fascinant
travail.
SIGLES ET ACRONYMES
2IE : Institut international
d'ingénierie de l'eau et de l'environnement.
A.D.D.K.S: Association pour le
développement du département de Karangasso Sambla.
A.G.S: Action for Greening Sahel.
A.I.D : Association internationale de
développement.
A.M.V : African Millenium Village ou Village
africain du millénaire.
A.P.D : Aide publique au
développement.
ABE : African Business Education Initiative
for Youth ou Initiative de l'éducation dans le secteur des affaires en
faveur des jeunes africains.
ADESTO: Association pour le
développement économique et social de Toessin.
ADRAO : Association pour le
développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest.
AEEMB: Association des élèves
et étudiants musulmans du Burkina.
AGOA : Loi sur la croissance et les
possibilités économiques en Afrique.
AJPEE : Association des Jeunes pour la
Protection de l'Environnement et l'Elevage.
AKAFEM : Association Koom pour
l'autopromotion des femmes.
AMELI-EAUR : Projet d'Amélioration des
conditions d'accès durable à l'eau potable et à
l'assainissement en milieu urbain et rural.
ARI : Initiative pour le riz africain.
ASEI: Activity Student Experiment and
Improvisation.
AVI : African Village Initiative ou
Initiative des villages africains.
B.A.S.D : Banque asiatique de
développement.
B.M.D : Banques multilatérales de
développement.
BAD : Banque africaine de
développement.
BEGIN : Education de base pour la
croissance.
BEST : Basic Education Students and Teachers
ou Programme d'appui aux élèves et enseignants de
l'éducation de base.
BIRD : Banque internationale pour la
reconstruction et le développement.
C.E.A : Commission économique pour
l'Afrique.
C.E.B.N.F : Centre d'éducation de base
non formelle.
C.E.G : Collège d'enseignement
général.
C.I.J : Cour internationale de justice.
C.M.A : Coalition mondiale pour l'Afrique.
C.N.A : Centre national des archives.
C.S.L.P : Cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté.
C.S.P.S : Centre de santé et de
promotion sociale.
C.S.U : Couverture sanitaire universelle.
C.U.A : Commission de l'union africaine.
CAD : Comité d'aide au
développement.
CAP : Centre agricole polyvalent.
CARD : Coalition pour le développement
du riz en Afrique.
CEB : Circonscription d'Education de Base.
CENI : Commission électorale nationale
indépendante.
CNUDD: Conférence des Nations-Unies
sur le développement durable.
COGES : Comité de gestion des
établissements scolaires.
CPAF : Centre permanent
d'alphabétisation et de formation.
D.G.R.H : Direction générale
des ressources halieutiques.
D.S : Etude de développement.
DGPER : Direction générale de
la promotion de l'économie rurale.
E.D.D : Education pour un
développement durable.
E.P.A: Economic Planning Agency.
EPSA: Enhanced Private Sector Assistance for
Africa ou Initiative de soutien intégré au développement
du secteur privé en Afrique.
F.D.A : Fonds de développement
africain.
F.M.L.S.T.P: Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme.
FAA : Forum Asie-Afrique.
FAO : Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture.
FASID : Fondation pour les études sur
le développement international.
FNUAP : Fonds des Nations-Unies pour la
population.
FOCAC: Forum sur la coopération
sino-africaine.
G.P : Projet d'aide subventionnée.
GAD : Groupe d'assistance pour le
développement.
GES : Gaz à effet de serre.
GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat.
H.C.R : Haut-commissariat aux
réfugiés.
HFW: Hunger Free World.
I.A.F.S: India Africa Forum Summit ou Sommet
du Forum Inde-Afrique.
I.S.T : Infections sexuellement
transmissibles.
IFNA : Initiative pour la
sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique.
INERA : Institut de l'environnement et de
recherches agricoles.
INHEI: Institut de haute étude
internationale.
J.O.C.V : Japan Overseas Cooperation
Volunteers ou Volontaire japonais pour la coopération outre-mer.
J.S.T: Agence japonaise des sciences et de la
technologie.
JAFTA : Association japonaise de technologie
forestière.
JANIC : Réseau des ONG japonaises.
JBIC : Banque japonaise de coopération
internationale.
JETRO: Japan External Trade Organization.
JGCA: Japan Green Cross Association.
JICA : Agence japonaise de coopération
internationale.
JIRCAS: Japan International Research Center
for Agricultural Sciences.
KOAF: Korea Africa Forum ou Forum
Corée-Afrique.
M.A.A.H : Ministère de l'agriculture
et des aménagements hydrauliques.
M.A.E.C.R : Ministère des affaires
étrangères et de la coopération régionale.
M.A.H.R.H : Ministère de
l'agriculture, de l'hydraulique et des ressources halieutiques.
M.E.S.R.S.I : Ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l'innovation.
MASA : Ministère de l'agriculture et
de la sécurité alimentaire.
MENA : Ministère de l'éducation
nationale et de l'alphabétisation.
MITI : Ministère de l'industrie et du
commerce.
MOF : Ministère des Finances.
MOFA : Ministry of Foreign Affairs.
NEPAD : Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique.
NERICA : Nouveau riz pour l'Afrique.
O.C.D.E : Organisation de coopération
pour le développement économique.
O.D.D : Objectif du développement
durable.
O.I.M : Organisation internationale pour les
migrations.
O.M.C : Organisation mondiale du commerce.
O.M.D : Objectif du millénaire pour le
développement.
O.M.D : Organisation mondiale des douanes.
O.M.P : Opération de maintien de la
paix.
O.M.S: Organisation mondiale de la
santé.
O.N.G : Organisations non gouvernementale.
O.S.B.P: One Stop Border Post.
O.U.A : Organisation de l'unité
africaine.
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en
Afrique du droit des affaires.
ONU : Organisation des Nations-Unies.
ONUDI : Office des Nations-Unies contre la
drogue et le crime.
ONUDI : Organisation des Nations-Unies pour
le développement.
OSAA: Bureau du conseiller spécial
pour l'Afrique des Nations Unies.
OSCAL : Bureau du coordinateur spécial
pour l'Afrique et les pays en développement.
P.C.T : Projet de coopération
technique.
P.D.D.A.A : Programme détaillé
de développement de l'agriculture africaine.
P.D.D.E.B : Programme décennal de
développement d'éducation de base.
P.D.S.E.B : Programme de développement
stratégique de l'éducation de base.
P.D.S.I: Plan Do See and Improve.
P.E-P.N.D : Projet d'étude pour la
formulation d'un programme national de développement des bas-fonds.
P.I.B : Produit intérieur brut.
P.M.A : Pays les moins avancés.
P.M.E : Equipement médical
spécial.
P.M.E: Petite et moyennes entreprise.
P.N.D.E.S: Plan national de
développement économique et social.
P.N.D.S: Programme nationale de
développement sanitaire.
P.N.S.R : Politique nationale de
développement du secteur rural.
P.N-A.E.P.A: Programme national
d'approvisionnement en eau potable.
P.R.P.S-BF : Projet de renforcement de la
production du sésame au Burkina Faso.
PAAGE: Projet d'appui à
l'amélioration de la gestion des écoles.
PACOGES : Projet d'appui aux COGES.
PAPAOM : Promotion d'une agriculture
orientée vers le marché.
PAS : Programmes d'ajustement structurel.
PAU: Plan d'action de Yokohama.
PIDA : Programme pour le développement
des infrastructures en Afrique.
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le
développement.
PPDRADBF : Projet de promotion du
développement rural par l'aquaculture durable au Burkina Faso.
PPTE : Pays pauvres très
endetté.
PROSPECT : Projet de renforcement des
stratégies et des pratiques de l'enseignement dans les centres de
formation des élèves-maîtres.
PSIF : Programme de financement des
investissements du secteur privé.
R.D.C : République Démocratique
du Congo.
R.N.B : Revenu national brut.
S.D.P : Projet d'envoi
spécialisé.
S.N.D.R : Stratégie nationale de
développement de la riziculture.
SATREPS : Projet pour la mise en place d'un
modèle de promotion des cultures par l'utilisation du phosphate
naturel.
SATREPS: Science and Technology Research
Partnership for Sustainable Development.
SCADD: Stratégie de croissance
accélérée et de développement durable.
SHEP : Smallholder Horticulture Empowerment
and Promotion ou promotion de l'autonomisation des petits producteurs
horticoles.
SMASE-WECSA: Strengthening of Mathematics and
Science Education in Western, Eastern, Central and Southern Africa.
SONAGESS: Société nationale de
gestion du stock de sécurité alimentaire.
TIC: Technologie de l'information et de la
communication.
TICAD: Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de l'Afrique (Tokyo International Conference
on African Development).
U.A : Union africaine.
U.E : Union européenne.
UEMOA : Union économique et
monétaire ouest-africaine.
UNICEF : Fonds des Nations-Unies pour
l'enfance.
USAID : Agence américaine pour le
développement international.
WAGRIC: Plan directeur de
l'aménagement des corridors pour l'anneau de Croissance en Afrique de
l'Ouest.
WASABI: Water and Sanitation Broad
Partnership ou Partenariat Étendu de l'Eau et de l'Hygiène.
LISTES DES CARTES, DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUE
Liste des tableaux
Tableau 1: Visites des Hommes d'Etat du Burkina Faso au Japon
depuis 1993.
69
Tableau 2: Visites des Hommes d'Etat du Japon au Burkina Faso
depuis les années 2000
70
Tableau 3: Evolution de l'aide bilatérale japonaise au
Burkina Faso de 1994 à 2018 (valeur en millions de dollars)
74
Tableau 4: Evolution de l'aide multilatérale japonaise
au Burkina Faso de 2008 à 2017 (valeur en millions de dollars)
79
Tableau 5: Les différentes phases de construction des
écoles primaires
82
Tableau 6: L'aide alimentaire japonaise au Burina Faso de 1994
à 2018
91
Liste des graphiques
Figure 1: Histogramme de l'aide bilatérale japonaise au
Burkina Faso
75
SOMMAIRE
DEDICACE
I
REMERCIEMENT
II
SIGLES ET ACRONYMES
III
LISTES DES CARTES, DES TABLEAUX ET DES
GRAPHIQUE
IX
SOMMAIRE
X
Introduction générale
1
PREMIERE PARTIE: LA POLITIQUE D'AIDE
JAPONAISE EN AFRIQUE: LE PROCESSUS DE LA TICAD : 1993-2018
11
Chapitre I: Le Japon et sa politique
d'aide.
13
Chapitre II : Le cadre de la politique
d'aide japonaise en Afrique : le processus de la TICAD : 1993-2018
28
Chapitre III : La TICAD, un forum
à caractère unique?
49
DEUXIEME PARTIE: LA COOPERATION
BURKINA-JAPON APRES LA TICAD I: 1993-2018
63
Chapitre IV: L'orientation de l'assistance
japonaise au Burkina Faso après la TICAD I
65
Chapitre V: Les secteurs clés de la
coopération japonaise au Burkina Faso
80
Chapitre VI: Autres domaines d'intervention
du Japon au Burkina Faso.
100
Conclusion générale
115
Source et bibliographie
118
ANNEXE
A
Introduction générale
1. Enoncé du sujet, intérêt et
bornes chronologiques
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945, le Japon,
pays belliqueux des années 1930, fut vaincu, dévasté,
désarmé et totalement occupé par l'armée
américaine. Pour la première fois de son histoire, le pays est
envahi et occupé par une puissance étrangère. Le choc est
énorme, l'humiliation très profonde même si l'empereur
Hiro-Hito les a invités à « supporter
l'insupportable »1(*). Quelques années plus tard, le Japon devenait
une superpuissance économique. Pour les Japonais, c'est grâce
à leurs propres efforts, bien que ruiné par la défaite de
1945, que le pays est devenu une grande puissance économique au monde.
Cette vision ne nie pas l'importance de l'aide internationale, elle tend
seulement à démontrer que les efforts nationaux sont les premiers
moteurs du développement2(*). Depuis les années 1990, le Japon, pays
potentiellement sympathique, tente d'apparaître sur la scène
internationale comme une puissance globale, développant l'ambition de
jouer un rôle majeur. Ce qui l'a poussé à
s'intéresser au continent africain. En décembre 1991, devant la
tribune de la quarante-sixième Assemblée générale
des Nations-Unies, le Premier ministre japonais Toshiki Kaifu déclinait
l'intention de son pays d'organiser une conférence sur le
développement de l'Afrique. L'objectif était de forger un
consensus au niveau des partenaires internationaux sur la
nécessité d'agir et de mobiliser des ressources pour ce
continent3(*).
L'année 1993 fut ainsi choisie par le Japon pour organiser un forum
mondial devant inciter l'Afrique et ses partenaires à collaborer en vue
d'assurer le développement du continent: c'est la Conférence
internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD (Tokyo
International Conference on African Development). La TICAD est l'un des
éléments les plus importants et les plus visibles des relations
du Japon avec le continent africain. Depuis la TICAD I organisée en
1993, le Burkina Faso est le seul pays qui se fait toujours représenter
par son Chef de l'État. Ce qui signifie que les relations entre les deux
pays sont au beau fixe4(*).
Cependant, la littérature sur la coopération
entre le Japon et le continent africain depuis cette conférence n'est
pas assez abondante. Il est donc intéressant de consacrer une
étude approfondie de la coopération japonaise en Afrique afin de
comprendre son rôle, d'où notre thème de recherche: «
la coopération entre le Japon et le Burkina Faso depuis la
Conférence internationale de Tokyo sur le développement de
l'Afrique(TICAD): 1993-2018 ». La principale
motivation dans le choix de ce sujet est de participer à la recherche
historique au Burkina Faso en axant notre attention sur la coopération
au développement. L'historien français Pierre Renouvin souligne
qu'étudier historiquement les relations internationales revient à
analyser et à expliquer les relations entre les communautés
politiques organisées dans le cadre d'un territoire, c'est-à-dire
entre États5(*). Dans
cette optique, l'État reste au coeur de l'étude des relations
internationales malgré l'émergence des acteurs transnationaux.
Pour l'historien, l'action diplomatique ne peut être comprise sans la
prise en compte de plusieurs facteurs. Il s'agit des forces
géographiques, des conditions démographiques et des forces
économiques6(*). Ces
facteurs constituent le premier ensemble de ses forces profondes. C'est ce
qu'il qualifie de forces matérielles7(*). Ces forces matérielles constituent l'essentiel
des problématiques étudiées dans les relations
internationales. L'une des caractéristiques fondamentales des forces
matérielles est la coopération internationale qui
représente un aspect important de la politique étrangère
des États qu'ils soient petits ou grands, faibles ou puissants,
défaillants ou forts. C'est le cas du Burkina Faso qui, depuis son
indépendance, ne cesse de nouer des relations de coopération avec
des pays amis. C'est l'exemple de sa coopération avec le Japon. Notre
objectif est donc de braquer les projecteurs sur l'état de cette
coopération afin de contribuer à enrichir l'historiographie
burkinabè surtout dans sa dimension internationale.
De plus, de nombreux observateurs à l'intérieur
et à l'extérieur de l'Afrique fustigent les partenariats
internationaux en Afrique comme de simples rhétoriques vides car il y a
peu ou pas de preuves suggérant que ces initiatives ont apporté
une contribution significative au développement de l'Afrique. C'est dans
ce contexte que nous avons cherché à évaluer dans quelle
mesure le processus de la TICAD a favorisé le développement
socio-économique au Burkina Faso. En d'autres termes, l'objectif
principal de notre travail est d'évaluer le processus de la TICAD par
rapport au développement socio-économique du Burkina Faso. Nos
bornes chronologiques sont 1993 et 2018. Ces bornes sont en rapport avec
l'évolution de la TICAD.
1993 : c'est en 1993 que fut
organisée la première TICAD. La TICAD est un forum
multilatéral et international axé sur le développement de
l'Afrique. C'est l'un des plus anciens forums internationaux dans lequel les
problèmes relatifs au développement de l'Afrique font l'objet de
débats entre un grand nombre de parties prenantes8(*). La TICAD a été
organisée tous les cinq ans au Japon de 1993 à 2013. Lors de la
TICAD V en 2013, les organisateurs ont décidé d'adopter un cycle
triennal et une alternance des pays hôtes entre le Japon et un pays
africains. La TICAD VI s'est tenue à Nairobi au Kenya en 2016.
2018 : depuis la TICAD IV, un
mécanisme de suivi a été mis en place pour suivre
l'état d'avancement des agendas prioritaires de la TICAD. Des plans
d'action sont également adoptés. Ces plans d'action incluent des
objectifs quantitatifs à atteindre jusqu'à la prochaine
édition de la TICAD. 2018 permet donc de faire un bilan du Plan de mise
en oeuvre de Nairobi de la TICAD VI.
2. Définition des termes clés
Plusieurs termes clés retiennent ici notre
attention:
La coopération :
Etymologiquement, le terme coopération vient du
latin « cum » avec, et de
« operare », faire quelque chose, agir. De façon
générale, la coopération est l'action de coopérer,
de participer à une oeuvre, un projet commun. La coopération est
la capacité de collaborer à cette action commune ainsi que les
liens qui se tissent pour la réaliser. La coopération
internationale se réfère donc aux activités qui
nécessitent la coordination des efforts par deux ou plusieurs acteurs
afin de réaliser et d'accroître les intérêts communs.
En d'autres termes, la coopération implique une relation construite par
ces acteurs (États dans notre cas), unis par une motivation et une
vision communes, et ayant pour but de planifier et de réaliser ensemble
des objectifs clairement définis et acceptés. Elle suppose un
respect des différences, une confiance réciproque, un engagement
réel des parties, une responsabilité partagée, ainsi
qu'une disposition au dialogue permanent.
La TICAD : la TICAD est l'acronyme de la
Conférence internationale de Tokyo sur le développement de
l'Afrique (Tokyo International Conference on African Development). Elle a
été lancée en 1993 afin de promouvoir un dialogue
politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires
dans le domaine du développement. Les réunions sont
organisées sous la houlette du Japon et co-organisées par les
Nations Unies, le Programme des Nations-Unies pour le Développement
(PNUD), la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine (CUA). Avec la
TICAD, le Japon occupe une place centrale dans la promotion d'un dialogue
international pour le développement de l'Afrique. Les approches de la
TICAD incluent : les concepts d'appropriation africaine et de partenariat
international, la promotion de la participation des organisations
internationales, des pays donateurs, du secteur privé et des
organisations de la société civile, et enfin la mise en place de
mécanismes de suivi pour mesurer l'avancement des programmes et des
projets9(*).
3. La problématique
Le Japon a été le premier donateur d'Aide
publique au développement (APD) au monde durant les années 1990
malgré l'éclatement de la bulle spéculative en 1991 et la
crise économique qui s'en suit. Avec le changement du contexte
stratégique international dû à la chute du bloc communiste,
le Japon repense alors sa politique étrangère et s'interroge sur
le rôle à donner à son APD. Le nouveau contexte
international permet au Japon de définir une ligne directrice pour son
action, c'est-à-dire le développement des pays
bénéficiaires. Le Japon énonce alors les principes qui
doivent guider son APD dans sa charte de 1992. La charte reconnaît
officiellement l'un des concepts majeurs de l'approche japonaise en
matière de développement, le « self-help »
(auto-assistance)10(*). En
conséquence, l'APD japonaise doit être implantée en tant
que soutien aux efforts d'appropriation, ce qui signifie qu'elle doit
être à l'écoute et répondre aux besoins des pays
bénéficiaires qui doivent rester maître de leurs choix de
développement. Tokyo cherchait à faire prévaloir une
nouvelle vision de l'aide, en particulier grâce au concept
d'« appropriation du développement ». Ce concept est
directement hérité de l'expérience du Japon : ayant
lui-même bénéficié des prêts de la Banque
mondiale jusqu'au début des années 1960, le pays a conçu
sur cette base un modèle fondé sur
l'« auto-assistance » qu'il a ensuite adapté
à l'Afrique11(*).
En pratique, Tokyo adopte une démarche inverse de celle habituellement
suivie par les pays donateurs de l'Occident. C'est pourquoi, Howard Lehman
observe dans son étude sur la TICAD : « au lieu
d'arriver dans les pays africains avec de l'argent et des projets
déjà définis, le Japon attend des gouvernements qu'ils
s'approprient leurs besoins, qu'ils déterminent des projets
ciblés, et qu'ils sollicitent ensuite les agences japonaises d'aide au
développement 12(*)». L'appropriation du développement
est l'un des principes de la TICAD. La TICAD est le noyau des efforts du Japon
en Afrique. Elle respecte l'appropriation africaine de son propre chemin de
développement tout en exploitant des partenariats multipartites pour
promouvoir l'ouverture13(*). Au Burkina Faso, le Japon insiste toujours sur
l'importance d'une appropriation de son propre effort de développement.
Autrement dit, le Japon respecte l'initiative du Burkina Faso en matière
de coopération et tient compte de ses propres efforts pour la mise en
oeuvre de ses projets14(*). Ainsi, plusieurs interrogations s'imposent :
Question principale : Comment le Japon a
contribué à promouvoir le développement
socio-économique au Burkina Faso ?
Question secondaire 1 : Qu'est-ce que la
TICAD ? Comment a-t-elle évolué ?
Question secondaire 2 : Quelles sont les
manifestations de la présence japonaise au Burkina Faso ?
Les objectifs
Objectif général
Le présent travail vise à évaluer
l'impact de la coopération japonaise sur le développement
socio-économique du Burkina Faso depuis l'initiative TICAD.
Objectif spécifique 1 : Analyser
le cadre de la politique de coopération du Japon en Afrique à
travers la TICAD.
Objectif spécifique 2 : Analyser
les manifestations de la présence japonaise au Burkina Faso.
Les hypothèses
Hypothèse générale:
La coopération japonaise a un impact sur le
développement socio-économique du Burkina Faso.
Hypothèse 1 : la
coopération japonaise au Burkina Faso est conforme aux principes et aux
objectifs de la TICAD.
Hypothèse 2: la présence
japonaise au Burkina Faso se manifeste par son soutien aux différents
projets de développement.
4. La méthodologie de recherche
Tout travail de recherche scientifique nécessite
l'adoption de méthodes de recherche. Pour la présente
étude, deux méthodes de collectes de données ont
été prises en compte : la recherche documentaire et
l'entretien oral.
La recherche documentaire est l'un des moyens par excellence
de collecte d'informations. Elle a toujours été au centre de tout
travail scientifique et se définit par la consultation de documents
portant sur le même sujet ou ayant le même champ
d'étude15(*). Dans
notre cas, il s'agit essentiellement de la consultation de documents relatifs
aux relations entre le Japon et l'Afrique. Ce qui implique l'exploitation des
journaux de presse, des articles, des ouvrages, des archives et la webographie.
Pour cela, nous avons eu recours aux différentes bibliothèques de
l'Université Joseph Ki-Zerbo, la bibliothèque du Centre national
des archives (CNA), la bibliothèque du Ministère des affaires
étrangères et de la coopération régionale (MAECR)
et la bibliothèque de l'Institut de haute étude internationale
(INHEI). En ce qui concerne la webographie, les sites du Ministère des
affaires étrangères du Japon (www.mofa.go.jp), de
l'Ambassade du Japon au Burkina Faso (www.bf.emb-japan.jp), et du Bureau
de la JICA au Burkina Faso (www.jica.go.jp/bf) ont été
visités.
La recherche documentaire a permis de consulter plusieurs
ouvrages et articles, des rapports, des archives, etc. Ne pouvant pas les
énumérer tous, nous choisissons ceux qui permettent de mieux
comprendre notre sujet. On peut noter:
ü AMBASSADE DU JAPON AU BURKINA FASO, 2015,
orientation de l'assistance pour le Burkina Faso, traduction
provisoire. Ce document de l'Ambassade du Japon au Burkina Faso
résume les raisons qui ont poussé le Japon à assister le
Burkina Faso dans ses politiques de développement. Ces raisons sont
d'ordres politique, géostratégique, diplomatique et
socio-économique. Ce document fait également cas des principes
qui guident l'aide japonaise au Burkina Faso. Ces principes s'articulent autour
de l'accélération de la croissance et le renforcement du capital
humain. Le document mentionne également les objectifs spécifiques
de la coopération japonaise. Ces objectifs sont le développement
du secteur agricole, l'amélioration de la qualité de
l'éducation et la promotion de l'intégration économique
sous-régionale. Les autres points à noter dans le document sont
le soutien à la stabilité sociale et le soutien à
l'investissement du commerce des sociétés japonaises.
ü BLAISE Séverine, 2006, « De l'aide
à la coopération économique : pour un réexamen de
la politique japonaise », Revue Tiers-Monde,
n° 186, Paris, Harmattan, pp. 307-328. L'article examine la politique
d'aide japonaise dans sa globalité sur une longue durée et essaye
de tirer des enseignements de l'aide japonaise en termes d'efficacité.
L'article montre également comment la politique d'aide japonaise
apporte une vision différente de l'aide et du développement qui
est riche d'enseignement.
ü EYINLA Bolade, 2018, « Promoting Japan's national
interest in Africa: a review of TICAD», in Africa Development,
volume XLIII, n°3, CODESRIA, page 107-122. Cet article conteste
l'affirmation japonaise selon laquelle le processus de la TICAD est un
mécanisme permettant d'attirer l'attention du monde et de mobiliser le
soutien international en faveur de l'Afrique. Le processus de la TICAD est
plutôt perçu comme un changement dans la politique du Japon
à l'égard de l'Afrique, défini jusqu'à
présent dans le contexte du Consensus de Washington. Ce faisant, le
Japon élabore une politique africaine visant à servir ses
intérêts nationaux.
ü JICA et Mitsubishi UFJ Reasearch and consulting,
2013, la revue des vingt années de la TICAD, Rapport principal,
Tokyo, 79 pages. Ce rapport est une rétrospective des progrès
accomplis par la TICAD durant ses deux premières décennies
d'existence. Le document analyse l'aide apportée par le gouvernement
japonais et ses partenaires de la TICAD notamment la Banque mondiale et le
Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD). Il analyse
également l'aide par secteur mais insiste davantage sur les engagements
pris par le Japon à la TICAD IV.
ü JICA/Burkina Faso, les grandes lignes des
activités. Ce document de la JICA énumère les
principales activités de l'agence au Burkina Faso. Ces
différentes activités prennent en compte les secteurs de
l'éducation, de la santé, du développement agricole et
rural, de l'environnement, etc. Il énumère aussi l'historique des
différents projets de coopération de la JICA à partir des
secteurs ci-dessus cités. Malgré tout, plusieurs secteurs
importants n'ont pas été pris en compte dans ce document. On peut
noter par exemple le secteur relatif au développement des
infrastructures.
ü KABRE Grégoire, 2012-2013, l'intervention de
la coopération internationale dans le développement de
l'enseignement de base au Burkina Faso: l'exemple de la coopération
japonaise à travers l'Agence japonaise de coopération
internationale (JICA), mémoire de fin de formation, INHEI, 75
pages. L'auteur analyse la contribution de la coopération japonaise dans
le domaine de l'enseignement de base. Cette intervention est analysée en
terme quantitatif et qualitatif. Toutefois, l'auteur analyse l'intervention de
la coopération japonaise dans le domaine de l'éducation. Les
autres secteurs importants comme l'agriculture sont relativement
abordés.
ü KITA Julien, 2008, « L'aide publique au
développement japonaise et l'Afrique : vers un partenariat
fructueux », in Asie Vision, n°10, Paris, Institut
français de relations internationales (IFRI), pp.1-36 pages. Cet article
est une étude historique de l'aide japonaise en Afrique. Il explique,
dans un premier temps, comment l'aide japonaise a été
implantée en Afrique et comment elle a évolué. Ensuite,
l'article nous explique comment l'APD a été le fer de lance des
ambitions japonaises en Afrique. Cependant, on remarque que l'article ne prend
pas en compte la coopération japonaise dans sa globalité. Il ne
montre pas les différents domaines d'interventions du Japon en Afrique.
La TICAD, qui est le cadre de la coopération japonaise depuis le milieu
des années 1990 en Afrique, est peu analysé.
ü LEHMAN Howard, 2005, «Japan's foreign aid policy
to Africa since the Tokyo International Conference on African
Development», Pacific Affairs, volume 78, n° 3, Columbia,
University of British, pp. 423-442. L'article étudie l'évolution
de la politique d'aide japonaise en Afrique depuis le début de la TICAD.
Il analyse les trois premières TICAD. Les trois maîtres mots de
l'article sont « appropriation »,
« partenariat » et la mise en avant du
« modèle de développement asiatique. » Selon
l'auteur, le modèle de développement asiatique peut être
utilisé par les décideurs politiques africains dans leur
politique de développement. D'ailleurs, Howard Lehman affirme que le
modèle de développement asiatique offre une alternative aux pays
africains qui ont des difficultés à sortir de l'ornière
des politiques néolibérales des institutions de Bretton Wood.
Cependant, l'article met l'accent sur le volet diplomatique. Les secteurs de
développement socio-économiques élaborés dans les
Agendas de la TICAD ne sont pas traités.
ü MAECR, 2013, Fiche sur l'état de la
coopération Burkina Faso-Japon, KM126. Ce document du
Ministère des affaires étrangères et de la
coopération régionale est un résumé de la
coopération japonaise au Burkina Faso dans sa globalité avec des
résultats chiffrés. On peut noter les enjeux diplomatiques,
politiques, les secteurs de développement socio-économiques
(éducation de base, agriculture, santé, coopération
technique, environnement, coopération décentralisée,
etc.).
ü OUEDRAOGO Fatoumata, 2015-2016, la contribution de
la coopération japonaise à la gouvernance scolaire au Burkina
Faso, mémoire de fin de formation, INHEI, 72 pages. Elle analyse la
contribution de la coopération japonaise dans la gouvernance scolaire au
Burkina Faso à travers le PACOGES. L'auteur se limite également
au domaine éducatif. Les autres secteurs sont relativement
abordés.
ü SANKARA Salif, 2018, la contribution de la
coopération japonaise au développement économique et
social du Burkina Faso : cas de l'aide alimentaire
« KR1 », mémoire de fin de cycle, INHEI, 90
pages. Ce mémoire analyse la contribution de l'aide japonaise au Burkina
Faso à travers l'aide alimentaire. Selon l'auteur, l'aide alimentaire
japonaise a deux volets : l'assistance aux personnes vulnérables et
sa reconstitution en fonds de contrepartie pour réaliser des projets de
développement. Cependant, l'auteur met l'accent sur l'aide alimentaire
et les projets issus du fonds de contrepartie. II n'insiste pas sur les autres
projets mis en oeuvre par le Japon au Burkina Faso dans le secteur agricole.
Quant à l'enquête orale, elle est une
méthode interactive de recherche qui met en exergue le concept de
communication au sens propre du terme. Nous nous sommes entretenus avec le
personnel de la Direction Asie, Moyen-Orient et Pacifique (DAMOP) qui coordonne
la coopération du Burkina Faso avec l'Extrême-Orient. Nous avons
principalement rencontré le Directeur du DAMOP, Monsieur Ibrahim
Koné. Parmi les bénéficiaires, nous avons eu des
entretiens avec le président de l'Association des parents
d'élèves (APE) de l'Ecole primaire public de Kingria, Monsieur
Boniface Séogo. Cette école a été
bénéficiaire de la phase III des projets de construction des
écoles primaires en 2006. Nous avons eu des discussions avec Monsieur
Moyenga Moise, à l'époque, Directeur de l'école de
Kingria. Ce dernier a piloté les travaux d'exécution du Projet.
Nous avons également rencontré des enseignants qui ont
bénéficié de la formation de l'approche ASEI/PDSI,
à travers le projet SMASE dans le domaine de l'éducation.
5. Difficultés et limites
Comme dans toute recherche, les difficultés n'ont pas
manqué. La première difficulté est la rareté et
l'inaccessibilité d'une certaine documentation. Quant à
l'enquête orale, nous n'avons pas pu rencontrer les personnes ressources
de l'Ambassade du Japon au Burkina Faso. Ils ont toujours avancé le
droit de réserve du personnel de l'Ambassade. De plus, il y a ce
principe qui stipule que toute information demandée (qu'elle soit
écrite ou orale) doit toujours avoir l'aval du Ministère des
Affaires étrangères du Japon avant toute réponse.
En ce qui concerne les limites, on peut mentionner
l'utilisation des valeurs monétaires. En effet, il n'y a pas une
parité fixe entre le Yen ou le Dollar avec le FCFA. Or dans le cadre de
notre travail, les données en FCFA ne sont pas toutes disponibles. Ce
qui nous pousse à utiliser les taux de change annuel moyen pour
convertir les valeurs en Yen ou en Dollar en FCFA. La plupart des chiffres en
FCFA sont donc des valeurs approximatives.
7. Plan
L'étude s'articule autour de deux parties. La
première partie est consacrée à la présentation de
la politique d'aide japonaise en Afrique à travers une analyse de la
TICAD. La deuxième partie analyse la coopération entre le Japon
et le Burkina Faso après la TICAD I.
PREMIERE PARTIE: LA POLITIQUE D'AIDE JAPONAISE EN
AFRIQUE: LE PROCESSUS DE LA TICAD : 1993-2018
Au cours de son histoire, qui débute vraiment
après la Seconde Guerre mondiale, l'Aide publique au
développement (APD) a poursuivi plusieurs types d'objectifs, qui se sont
peu à peu ajoutés les uns aux autres pour constituer un objet
très complexe. L'APD relève d'un souci de réduire les
inégalités à l'échelle internationale16(*). C'est une activité
fondamentale de la coopération économique gouvernementale des
pays à hauts revenus qui a pour but de contribuer au
développement socio-économique, à l'amélioration du
bien-être et à la stabilisation de la vie des peuples des pays en
développement17(*).
Pour le Japon, sa politique d'APD commence véritablement en 1954 suite
à son adhésion au Plan de Colombo18(*). Cette adhésion a permis au Japon de mettre en
place ses premières missions de coopération technique.
Grâce à l'expansion continue de son économie, le Japon va
consentir depuis cette période d'énormes efforts pour l'aide au
développement. Dans les années 1990, l'APD est un pilier
principal de la coopération économique japonaise. En ce qui
concerne l'Afrique, le Japon va lancer la TICAD en tant que structure
institutionnelle de sa relation avec le continent. Qu'est-ce que la
TICAD ? Quelles sont ses particularités ? C'est ce que nous
tentons de répondre dans cette première partie. Avant d'analyser
la politique d'aide japonaise en Afrique à travers la TICAD proprement
dit, nous proposons dans le chapitre 1 de faire une présentation assez
précise et concise du Japon et de sa politique de coopération.
Cette partie se divise donc en trois chapitres. Le premier chapitre
présente le Japon et sa politique d'aide en général. Le
chapitre 2 analyse la TICAD qui est le cadre de la politique d'aide japonaise
en Afrique. Et le chapitre 3 montre l'unicité de la TICAD par rapport
à d'autres forums de développement.
Chapitre I: Le Japon et sa politique d'aide.
Le Japon est un pays contrasté où les
extrêmes se côtoient parfois. Extrême géographique de
ce bout de terre au large de l'Eurasie s'étirant de la froide Hokkaido
près de Sibérie à la subtropicale Okinawa près de
Taiwan, extrême en terme de densité entre les surconcentrations
mégalopolitaines et les espaces ruraux en déprise ;
extrêmes climatiques d'un archipel régulièrement
frappé par des aléas violents. Pays d'Extrême-Orient, le
Japon a joué de sa situation géographique dans la construction et
l'affirmation historique de son indépendance et de sa puissance.
Etymologiquement, « nippon » ou
« ni » (le soleil) et
« pon/hon » (les origines, la racine)
signifie « le pays d'où nait le
soleil »19(*). Le Japon couvre une superficie de 372487 km²
avec une population estimée en 2018 à 126,4 millions
d'habitants20(*).
I. Présentation du
Japon21(*)
Il s'agit de présenter le Japon à travers sa
géographie, son économie et sa place dans le monde.
I.1. La géographie du
Japon
Le Japon se trouve dans la zone d'arcs montagneux de la
façade orientale de l'Asie. Ce pays est le résultat de rencontre
de cinq de ces arcs. Le relief résulte essentiellement d'un quadrillage
de fractures qui fait du pays un ensemble de blocs et de fossés. Le
relief est caractérisé par plusieurs faits : l'abondance
des montagnes dont le symbole est le mont Fuji (3776 mètres), des
forêts sur des pentes plongeant vers la côte et les plaines de plus
en plus urbanisées22(*). Les conditions climatiques, comme la qualité
des terres déterminent les lieux où vit la population. Le climat
des régions qui bordent la mer du Japon est influencée par l'air
glacial de l'Oyashio mais la côte du Pacifique est
réchauffée par le Kuroshio. Dans la zone soumise aux effets
modérateurs de ces courants, les hivers ne sont pas aussi rigoureux que
dans les autres régions d'Asie situées à la même
latitude. L'art et la littérature sont, dans une large mesure,
fondés sur le rythme régulier des saisons, et les fêtes et
coutumes populaires ponctuent les différentes époques de
l'année. Mais la nature n'est pas toujours bienveillante. La nature
japonaise se révèle comme un milieu éminemment
inhospitalier pour l'homme : avec 20% des séismes mondiaux de
magnitude supérieure à 6 se produisant chaque année dans
le monde, 10% des volcans actifs de la planète, les tsunamis, les
typhons, les inondations, les vagues de froid venant de la Sibérie, les
vagues de sécheresses et de chaleurs... le Japon est l'archipel des
risques extrêmes. Quand on parle de risque, tous les esprits pensent
à la triple catastrophe du 11 mars 2011 : le séisme du
Tohoku, le tsunami du Sanriku et l'explosion nucléaire de
Fukushima23(*). Le Japon
est enfin un archipel pauvre en ressources naturelles. On pourrait dresser
toute une liste des matières premières pour lesquelles les usines
japonaises sont dépendantes de l'étranger à 100 %. Il faut
ranger par exemple le coton, la laine brute, le phosphate, le caoutchouc
naturel, le nickel, la bauxite, l'étain. Il est encore dépendant
de l'étranger pour le minerai de fer (82 %), le charbon à coke
lourd (70 %), le sel (80 %). Au chapitre du pétrole le Japon
dépend de l'étranger pour plus de 90 % de ses besoins. Cinq
métaux seulement existent en quantité suffisante au Japon pour la
satisfaction de ses besoins : le cuivre, l'or, l'argent, le magnésium
(extrait de l'eau de mer) et le chromium, nécessaire aux aciers
spéciaux. Un sixième, le zinc, est assez abondant24(*).
Le Japon apparaît donc comme un pays aux rares terres
cultivables, pauvres en ressources naturelles et que des excès de tous
genres frappent en saisons et en régions. La naissance sur ce sol ingrat
d'une brillante civilisation et d'une société
économiquement majeure apparaît comme l'une des grandes victoires
de l'humanité sur la nature. La plus grande ressource japonaise est donc
son peuple.
I.2. L'environnement
économique du Japon
L'économie japonaise après la Seconde Guerre
mondiale a été une longue série de succès.
Malgré les crises qui ont secoué le système
économique international au cours de la deuxième moitié du
XXe siècle (destruction liée à la guerre, fluctuation du
yen, fin du système du Bretton Wood, chocs pétroliers de 1973 et
de 1979), le Japon a toujours su maintenir son économie sur le chemin du
développement et de la croissance25(*). L'industrie japonaise produisait des marchandises de
hautes qualités, en grandes quantités et à des prix
compétitifs26(*).
Les automobiles, les télécopieurs, les appareils photos et les
postes de radio japonais sont les plus vendus au monde. La balance de paiements
courants accumule chaque année des excédents, le Japon
prêtant à l'étranger bien plus que ce qu'il lui emprunte.
De plus, les Japonais ne connaissent pas le chômage ou si peu : de 1960
à 1995, il reste en dessous de 3%. Les vertus du « système
économique nippon » sont vantées dans le monde entier, et
le management « à la japonaise » est étudié dans
toutes les écoles de commerce27(*). The Economist consacre des dossiers admiratifs
à l'envol de l'oiseau fabuleux, aux différentes facettes et
étapes du « miracle » économique28(*). Malgré ces bonnes
performances statistiques générales, le Japon a connu vingt ans
de stagnations économiques et de déflation des prix.
A partir des années 1990, le Japon entre dans une
période de crise économique et bancaire sans
précédent. Cette crise s'est accompagnée de la faillite de
nombreux établissements financiers nationaux, comme le Hokkaido
Takushoku Bank en 1997. La croissance économique est très faible,
voire négative certaine année. La décennie 1990 est
surnommée par les médias de la « décennie
perdue ». En effet, les indicateurs économiques du Japon se
dégradent: augmentation du chômage historiquement très bas,
fin du système de l'emploi à vie, baisse des salaires. Dans son
contexte régional, le Japon s'efface derrière d'autres pays. Les
ports sont dépassés par les ports chinois et sud-coréens.
Les sièges sociaux des entreprises étrangères quittent
Tokyo pour Hong Kong, Singapour ou Shanghai29(*).
Ce n'est qu'au début des années 2000 avec
l'arrivée au pouvoir de Junichiro Koizumi que l'économie
japonaise a commencé à se restructurer. Dans son premier discours
à la 151e session de la Diète (qui réunit les deux
Chambres), Koizumi affirme sa résolution de « faire avancer sans
arrêt les réformes structurelles ». Il raconte à cette
occasion l'histoire fameuse des « cent sacs de riz », qui remonte au
début de l'ère Meiji : alors que la pauvreté et la famine
règnent dans la région de Nagaoka, Torasaburo Kobayashi, le
seigneur de la région, pense qu'il est plus important d'investir dans
l'éducation que de satisfaire les besoins immédiats de son peuple
; il vend donc la récolte de riz et construit une école ; et
c'est ainsi que 100 sacs de riz ont été multipliés par 100
car les diplômés de l'école se sont attelés à
la construction du pays. Le message de Koizumi est que le Japon doit faire le
bon choix : souffrir aujourd'hui, pour être plus fort demain30(*). Au cours des années
2002-2007, le Japon connait alors une croissance économique soutenue.
Cette croissance reposait à 60 % sur les exportations nettes, alors que
la consommation intérieure restait amorphe dans un contexte de
déflation. Cependant, la crise de 2009 et la forte appréciation
du yen ont entraîné un effondrement des exportations vers les
États-Unis et l'Europe, premier et troisième marchés
d'exportation. L'investissement des entreprises s'est donc fortement
contracté, tandis que la montée du chômage et le recul des
salaires étouffaient la consommation des ménages.31(*).
Malgré tout, le Japon reste l'un des pays les plus
riches et les plus développés du monde. Son PIB était de
5266 milliards de dollars en 2016, ce qui en fait la 3e puissance
économique du monde derrière les Etats-Unis (18624 milliards) et
la Chine (11200 milliards), mais devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et la
France. Le Japon est également une puissance commerciale. Selon
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en 2013, l'Archipel se place
4e puissance exportatrice et 4e importatrice au monde,
derrière la Chine, les Etats-Unis et l'Allemagne. Ces exportations
totalisent un volume de 799 milliards de dollars, soit 4,4% des exportations
mondiales contre 886 milliards de dollars pour ses importations, soit 4,8% des
importations mondiales. La balance commerciale est donc redevenue
négative. Ce basculement s'est opéré en 2011, en partie en
raison de la hausse des besoins en pétrole, gaz et charbon à la
suite de l'arrêt des centrales nucléaires du pays32(*). Ces performances permettent
au Japon d'être un acteur étatique majeur dans l'histoire des
relations internationales.
I.3. Le Japon dans les relations
internationales
Le 15 août 1945, le Japon accepta la Déclaration
de Potsdam juste après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de
Nagasaki et l'entrée en guerre de la Russie contre le Japon. Sa
défaite ruina à la fois sa puissance et sa
légitimité. Les Alliés attribuèrent la catastrophe
de la Guerre du Pacifique au militarisme et au centralisme impérialiste
japonais33(*). Le Japon,
agresseur des années 1930, se calma. Il abandonna son régime
autoritaire pour accepter les valeurs occidentales de démocratie et de
justice. Sa constitution de 1947 en fait un acteur pacifique. L'article 9 de la
constitution établit: « Aspirant sincèrement
à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le
peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit
souverain de la nation, ainsi qu'à la menace ou à l'usage de la
force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour
atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera
jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre
potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l'État ne sera
pas reconnu34(*) ».
Sa modernisation a donc été poursuivie en dehors
de tout programme militaire et à l'adhésion aux principales
organisations internationales. Il signa un traité de
sécurité avec les Etats-Unis le 8 septembre 1951, devenant ainsi
l'un de leurs alliés les plus importants du « monde
libre ». C'est le premier ministre Yoshida Shigeru qui a fait entrer
le Japon dans cette nouvelle phase de sa diplomatie. Appelée la «
doctrine Yoshida », cette orientation diplomatique est un modèle de
politique étrangère d'après-guerre. Ce qui
caractérise la doctrine Yoshida, c'est d'abord que le Japon axait sa
politique étrangère sur le bloc de l'Ouest, et surtout sur
l'alliance avec les Etats-Unis, dans le contexte de la guerre froide.
Dépendant de la force militaire américaine pour affronter les
pays communistes hostiles, le Japon a autorisé l'armée
américaine à utiliser des terrains de l'archipel pour ses bases.
En attendant le redressement économique, le gouvernement Yoshida a
décidé de limiter les dépenses pour les forces
d'autodéfense, et de les augmenter à mesure que l'économie
reprendrait35(*). Pour
Yoshida «just as the United States was once a colony of Great Britain
but is now the stronger of the two, if Japan becomes a colony of the United
States it will eventually become the stronger36(*)».
Traduction : « Tout comme les Etats-Unis ont
été autrefois une colonie de la Grande-Bretagne mais sont
désormais le plus fort des deux, si le Japon devient une colonie des
Etats-Unis, il deviendra éventuellement le plus fort ».
Dans les années 1980, la stratégie de l'ancien
premier ministre Yoshida Shigeru de faire du Japon une superpuissance
économique sous la protection militaire des Etats-Unis se
réalise37(*). Le
Japon a su passer d'une position mineure et subordonnée à celle
d'un partenaire majeur, incontournable et privilégié pour
Washington. Il a développé ses capacités
économiques et financières jusqu'au point où elles lui ont
assuré une place dans le club des grands.
Après la fin de la guerre froide, la situation
internationale changea profondément. Avec la disparition de l'URSS en
1991, et la fin du monde bipolaire, la scène internationale s'offrait
enfin une possibilité bien réelle de mettre fin à
l'état de crise. En 1990- 1991, la guerre du Golfe donne une occasion au
Conseil de sécurité, le policier mondial, de fonctionner.
L'occupation puis l'annexion du Koweit par l'Irak de Saddam Hussein entrainent
une escalade de mesures conduisant à la libération de l'Emirat
par une coalition sous mandat de l'ONU38(*). Cette direction collégiale d'une affaire
internationale ouvre la porte au Japon qui pouvait enfin prétendre jouer
un rôle sur la scène internationale.
La fin de la guerre froide n'a cependant pas donné
naissance à un pacifisme effectif à la fois mondial et
cosmopolite. Au contraire, l'état de crise s'est accentué sous
les effets déstabilisateurs de la mondialisation et la multiplication
des sources d'insécurité et de violence. Pendant les
années 1990, les gouvernements et les organisations internationales ont
été confrontés à des défis sans
précédents allant de la prolifération nucléaire au
génocide rwandais, de la dévastatrice guerre civile au Congo au
nombre croissant de réfugiés, du nettoyage ethnique dans les
Balkans à la violation systématique et
généralisée des droits de l'homme s'étirant de la
Birmanie à Haïti et de la Sierra Leone à la Corée du
Nord39(*). Ces
épisodes sont venus confirmer au peuple japonais que la politique de
puissance ne laisse toujours guerre la place à un pacifisme
constitutionnel40(*). Dans
son environnement géographique immédiat, le Japon doit s'adapter
à une Chine plus puissante économiquement, politiquement et
militairement et à une Corée du Nord menaçante avec ses
tests de missiles et son programme nucléaire41(*). Pour jouer un rôle
important sur la scène internationale, le Japon doit s'adapter et
redéfinir son rôle en modifiant les orientations de sa politique
étrangère. Le Japon décida alors de mettre l'accent sur
deux volets de politique étrangère : une participation
accrue aux activités des Nations-Unies et une politique axée sur
l'aide publique au développement.
Toutefois, les contributions japonaises aux Opérations
de maintien de la paix (OMP) sont restées limitées,
qualitativement et quantitativement. La Constitution japonaise n'autorisant pas
l'usage de la force pour résoudre les différends internationaux,
la contribution directe du pays s'est restreinte aux opérations non
militaires, à l'envoi de personnels pour des missions non combattantes,
tels le soutien logistique, les contributions en nature, ou le soutien
technique. En septembre 2010, Tokyo avait contribué à une dizaine
d'opérations de maintien de la paix de l'ONU : Angola (1992), Cambodge
(1992), Mozambique (1993), Salvador (1994), Golan (1996), Timor-Leste (2007 et
2010), Népal (2007), Soudan (2008), Haïti (2010). Le Japon a aussi
contribué à des opérations internationales au Rwanda
(1994), au Timor-Leste (1999), en Afghanistan (2001) et en Irak (2003)42(*). Le second volet de la
politique étrangère du Japon est sa politique d'aide publique au
développement. L'APD constitue la pierre angulaire de la diplomatie
japonaise depuis la fin de la guerre froide.
II. La politique d'aide
japonaise
Ce point analyse la politique d'aide japonaise dans son
ensemble. Il est divisé en trois points. Le premier point analyse les
principes fondamentaux de l'aide japonaise, le second point analyse les axes
prioritaires de l'aide japonaise et le troisième point traite des
différents types d'aide accordés par le Japon.
II.1. Les principes fondamentaux
de l'APD japonaise
Les restrictions imposées par la Constitution japonaise
ont eu pour conséquences de faire de sa politique d'aide un instrument
privilégié de politique étrangère ainsi que le
baromètre de sa présence internationale. Ne pouvant plus fonder
sa puissance sur des facteurs militaires, le Japon a décidé de se
concentrer sur la construction d'une puissance économique et d'utiliser
l'APD pour atteindre cet objectif43(*). L'aide japonaise est encadrée par la Charte
d'aide publique au développement qui définit les grandes
orientations de l'aide. C'est le 30 juin 1992 que le Japon a adopté sa
première charte de l'aide publique au développement en tant que
philosophie de base de l'aide japonaise. La charte
énumère44(*):
ü des considérations humanitaires,
ü la reconnaissance de l'interdépendance des
Nations de la communauté internationale,
ü des considérations environnementales,
ü un soutien aux efforts d'auto-assistance des pays
bénéficiaires.
Ces principes fondamentaux reflètent la position du
Japon dans la communauté des nations, l'expérience du
développement économique qu'il a subie et l'expérience
acquise au cours des dernières décennies dans le domaine de
développement. En tant que tels, ils représentent un produit
unique au Japon, tout en intégrant les tendances internationales en
matière d'aide étrangère45(*). Le Japon a contribué au développement
des pays en développement en tant que l'un des plus grands donateurs au
monde au cours de la période de la charte originelle. Le pays est devenu
le premier donateur en termes de quantité et son APD a commencé
à acquérir une plus grande visibilité dans diverses
régions du monde.
Cependant, en raison de la situation économique et
budgétaire grave qui a continué de persister au Japon et la
vision critique de l'APD par le peuple japonais, le budget d'APD a
été en baisse à partir de l'exercice 1998. En 2001, le
Japon céda sa place aux Etats-Unis en tant que premier donateur au monde
en quantité. L'APD japonaise en 2002 s'est établie à 9,283
milliards de dollars, en baisse de 5,7% par rapport à l'année
précédente46(*).Tenant compte de ces changements dans la situation
nationale et internationale, le gouvernement a révisé la Charte
de l'APD par adoption du Cabinet le 29 août 2003 afin de permettre une
utilisation souple et stratégique de l'APD et d'accroître son
efficacité. L'objectif de l'APD était «de contribuer
à la paix et au développement de la communauté
internationale et d'assurer ainsi la sécurité et la
prospérité du Japon»47(*). De manière générale et selon
Marie-Hélène Pozzar, la nouvelle Charte vise à
améliorer l'efficacité, la flexibilité, la
cohérence et la transparence de l'aide. Il s'agit de mettre l'accent sur
la qualité de l'aide plutôt que sur la quantité48(*). La Charte énonce des
principes de base qui doivent encadrer la mise en oeuvre de l'aide49(*) :
ü l'auto-assistance,
ü la sécurité humaine,
ü l'équité,
ü la prise en compte de l'expérience du Japon dans
la mise en place des programmes d'aide tout en « respectant les politiques
de développement retenues par les pays en développement
».
La charte révisée resta en vigueur jusqu'en
2014. En février 2015, le Japon entra dans une nouvelle époque
dans sa politique d'APD lorsque la nouvelle charte a été une fois
de plus révisée et le cabinet adopta la Charte sur la
coopération économique. Les principes de base de la charte
sont :
ü la contribution à la paix et à la
prospérité par une coopération à des fins non
militaires ;
ü la promotion de la sécurité humaine;
ü la coopération dirigée vers un
développement autonome à travers un soutien apporté aux
efforts d'auto-assistance et un dialogue et une collaboration basés sur
l'expérience et l'expertise du Japon50(*).
II.2. Les axes prioritaires de
l'aide japonaise
Selon la charte révisée de 2003,
les enjeux prioritaires de l'aide Japonaise sont les suivantes: la
réduction de la pauvreté, la croissance durable et les
problèmes d'envergure mondiale51(*).
· La réduction de la
pauvreté
Les principes généraux énoncés dans
les Chartes guident la stratégie du Japon en matière de
réduction de la pauvreté. L'aide du Japon se divise comme
suit:
ü aide à l'éducation (primaire,
supérieure, technique, formation professionnelle, accueil
d'étudiants étrangers) ;
ü aide à la santé: ce volet comprend des
mesures au niveau de la santé de l'enfant et la santé maternelle,
ainsi que la collaboration avec des entités locales.
ü accès à l'eau et aux installations
sanitaires ;
ü aide à l'agriculture, au développement
rural et maritime.
· La croissance durable :
Le Japon apporte son aide en priorité au
développement :
ü des infrastructures économiques et sociales, un
facteur important pour l'activité économique, ainsi qu'à
l'élaboration des politiques, le renforcement des institutions, et le
développement des ressources humaines. Le Japon soutient le
développement des infrastructures et encourage les ressources humaines
à entretenir, gérer et exploiter ces infrastructures
conformément aux politiques de développement des pays en
développement. Des infrastructures spécifiques sont mises en
place sur les routes, les ports, les aéroports, etc.
ü la coopération dans le secteur commercial et des
investissements: le Japon utilise l'APD pour soutenir le développement
des petites et moyennes entreprises (PME) dans les pays en
développement, le transfert de la technologie industrielle japonaise et
la formulation de politiques économiques.
ü la coopération dans le secteur des technologies
de l'information et des communications (TIC). La part de l'aide à ce
secteur reste marginale car le Japon estime que le secteur peut être
développé par le biais d'initiatives privées.
· Les problèmes d'envergure
mondiale.
Les mesures d'aide japonaise concernant les problèmes
d'envergure mondiale se répartissent comme suit:
ü environnement et changement climatique (lutte contre la
pollution, préservation de l'environnement),
ü lutte contre les épidémies (SIDA,
tuberculose, paludisme, poliomyélite, etc.),
ü consolidation de la paix, démocratie et bonne
gouvernance.
II.3. Les catégories
d'aide japonaise
Selon le rapport annuel de la JICA 2015, l'APD japonaise se
répartit en deux catégories: l'aide bilatérale et l'aide
multilatérale.52(*)
· L'aide multilatérale
C'est une aide indirecte aux pays en développement sous
la forme de financements ou de dons aux organisations internationales. Acteur
de premier plan au niveau multilatéral, le Japon apporte des
contributions non négligeables à 57 organisations et fonds
multilatéraux en moyenne chaque année53(*).
Les contributions sont versées aux agences
spécialisées des Nations-Unies, dont le Programme des
Nations-Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations-Unies
pour la population (FNUAP), le Fonds des Nations-Unies pour l'enfance (UNICEF),
et les financements sont alloués aux banques multilatérales de
développement (BMD), dont la Banque mondiale, l'Association
internationale de développement (AID), la Banque asiatique de
développement (BASD), et le Fonds de développement
africain54(*). En 2015,
79,7% de l'APD du Japon ont été dispensés sous forme
d'aide bilatérale. Le Japon a affecté 20,3% de son APD totale aux
contributions au budget central des organisations internationales. Il a aussi
dirigé 13, 9% de son APD bilatérale vers des projets
précis exécutés par des organisations
multilatérales55(*).
· L'aide bilatérale
Elle comprend la coopération technique, les dons et les
prêts:
ü La coopération technique : elle
fait appel à la technologie, au savoir-faire et à
l'expérience du Japon pour former les ressources humaines
appelées à jouer un rôle clé dans l'évolution
socio-économique des pays en développement. De plus, en
planifiant conjointement avec les pays partenaires des programmes d'aide
répondant aux besoins locaux, la coopération technique permet de
développer et de perfectionner des technologies adaptées aux
conditions de chaque pays, tout en rehaussant le niveau technologique
général et en mettant en place de nouveaux cadres institutionnels
et organisationnels. Les pays partenaires peuvent ainsi développer leurs
capacités à résoudre les problèmes et parvenir
à la croissance économique. La coopération technique
comprend la formation des cadres de pays partenaires, l'envoi d'experts, la
fourniture d'équipements et la réalisation d'études
destinée à soutenir l'élaboration de politiques et la
planification de projets de travaux publics (coopération technique pour
la planification du développement).
ü Les dons: ils constituent un apport de fonds
destiné à promouvoir le développement
socio-économique. C'est une aide financière sans obligation de
remboursement. Dans les pays à faible revenu, les dons sont
généralement utilisés pour construire des infrastructures
socio-économiques, comme les hôpitaux et les ponts, ainsi que de
promouvoir l'éducation, la santé et les activités
environnementales, ce qui contribue directement à l'amélioration
du niveau de vie56(*).
ü Les prêts: les prêts soutiennent
les efforts des pays en développent pour parvenir à la croissance
en leur fournissant les capitaux nécessaires à long terme et
à des taux d'intérêts bien inférieur à ceux
du marché. Les formes principales de cette aide sont les prêts
d'APD et le programme de financement des investissements du secteur
privé (PSIF). Comparés à la coopération technique
ou aux dons, les prêts d'APD permettent des financements plus importants
et sont donc surtout utilisés pour la construction d'infrastructures de
base de grande envergure dans les pays en développement. Les prêts
d'APD doivent être intégralement remboursés, ce qui incite
le pays bénéficiaire à se concentrer sur l'importance et
la priorité des projets, et à faire des efforts pour affecter et
utiliser les fonds de manière aussi efficace que possible.
· L'aide des ONG japonaises
Les organisations non gouvernementales sont des institutions
privées mais à but non lucratif. Les ONG japonaises agissent de
manière très visible et sont en contact direct avec les
populations locales des pays en développement en réalisant des
projets de petites tailles (constructions d'écoles de village,
reboisement, animation villageoise...). Elles permettent donc de faire un
travail complémentaire à celui du gouvernement en donnant une
touche humaine aux grands projets d'infrastructures. Elles sont aussi un
vecteur de sensibilisation de l'opinion publique sur les problèmes des
populations des pays en développement57(*). Selon le réseau des ONG japonaises JANIC, il
existe actuellement plus de 400 ONG de coopération internationale au
Japon, qui sont actives dans plus de 100 pays à travers le monde pour
résoudre des problèmes sociaux tels que la pauvreté, la
faim, la destruction de l'environnement, les conflits et les
catastrophes58(*).
III. Les régions
prioritaires de l'aide japonaise
Depuis les années 1980, le Japon a diversifié
son APD en termes de répartitions géographiques.
III.1. L'Asie
Depuis le début de l'aide publique au
développement, l'Asie a toujours été la première
région receveuse d'aide de la part du Japon. Les raisons de cet
état de fait sont aussi bien historiques, géographiques que
politiques mais surtout économiques. Selon la charte
révisée de 2003, l'Asie, une région qui entretient des
relations étroites avec le Japon et qui peut avoir un impact important
sur la stabilité et la sécurité de ce dernier, est une
région prioritaire pour le Japon. Le Japon donnera la priorité de
manière stratégique, prenant pleinement en considération
la diversité des conditions socio-économiques de ces pays. En
particulier, la région de l'Asie de l'Est, qui comprend des pays membres
de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), étend et
approfondit ces derniers temps l'interdépendance économique et
entreprend des efforts visant à mettre en valeur sa
compétitivité régionale en maintenant une croissance
économique et en renforçant l'intégration. L'APD du Japon
sera utilisée pour forger des relations plus étroites avec cette
région et pour remédier aux disparités y existant, prenant
pleinement en considération des facteurs tels que la consolidation des
partenariats économiques avec les pays de l'Asie de l'Est59(*). En 2015, le Japon a
affecté 3,4 milliards de dollars américains à l'Asie du
Sud et l'Asie centrale, et 3,2 milliards de dollars à l'Asie
orientale60(*).
III.2. Moyen-Orient et
autres
Le Moyen-Orient reste le principal fournisseur de
pétrole du Japon, il est donc synonyme d'or noir pour la majorité
des Japonais. Selon la charte de 2003, le Moyen-Orient est une région
importante du point de vue des ressources énergétiques, de la
paix et de la stabilité de la communauté internationale, mais
cette région contient des facteurs déstabilisants, dont notamment
la situation du processus de paix. Le Japon consentira son aide pour favoriser
la stabilité sociale et la consolidation de la paix61(*).
Les relations du Japon avec l'Amérique latine sont
très différentes. En effet, la présence japonaise sur ce
continent est relativement ancienne et importante. Plus d'un million de Sud-
Américains sont de descendance japonaise et résident pour la
plupart d'entre eux au Brésil.
III.3. L'Afrique
Le Japon a peu de liens historiques avec l'Afrique et
l'intérêt qu'il éprouve pour cette région est
relativement récent. En effet, avant les années 1990, le Japon a
été à la traine sur le continent par rapport à de
nombreuses autres puissances industrielles62(*). Des indépendances africaines dans les
années 1960 jusqu'à la fin de la guerre froide en 1991, les liens
entre le continent africain et le Japon sont restés faibles. C'est
à la Conférence de Bandung de 1955 que le Japon commença
timidement à prendre contact avec quelques pays africains à
savoir le Libéria, le Soudan et le Ghana. Son objectif était de
nouer des relations économiques et commerciales63(*). En 1961, le Ministère
des Affaires étrangères du Japon établit, pour la
première fois, en son sein une division africaine64(*). C'est à partir des
années 1970 que le Japon s'est davantage intéressé
à l'Afrique. Les deux chocs pétroliers de 1973 et de 1979
semblent expliquer cet intérêt pour l'Afrique. En 1974, le
Ministre des Affaires étrangères du Japon Toshio Kimura visita
l'Egypte, le Ghana, le Nigéria, le Zaïre et la Tanzanie. En 1979,
ce fut le tour de Naoshi Sonodo qui visite le Nigéria, la Côte
d'Ivoire, le Sénégal, la Tanzanie et le Kenya. C'est le
début de la diplomatie des ressources du Japon en Afrique65(*). Durant les années
1980, l'APD japonaise se développe. L'ONU a constitué une voie
pour le Japon d'approfondir son dialogue avec les pays africains. C'est ainsi
que le Japon a servi de coordinateur lors de l'élaboration de la
Déclaration sur la situation économique de l'Afrique,
adoptée par l'Assemblée générale le 3
décembre 1984. En novembre 1984, Abé Shintaro, ministre des
affaires étrangères du Japon, se rendait en Zambie, en Ethiopie
et en Egypte et promettait cent millions de dollars américains d'aide
alimentaire aux pays d'Afrique frappés par la famine66(*). Cet épisode peut avoir
contribué à l'évolution progressive de la philosophie
d'APD japonaise vers une grande prise en compte des enjeux humains.
Malgré le mécontentement des pays africains
soulevé par les relations entre le Japon et l'Afrique du Sud67(*), les dirigeants africains
perçoivent positivement l'arrivée de l'aide japonaise au cours de
cette période. D'une part, le Japon n'est pas une puissance occidentale,
il n'est pas non plus une puissance coloniale ; d'autre part,
l'expérience japonaise de développement intéresse les
dirigeants africains68(*).
L'aide a été l'aspect le plus visible de la politique japonaise
vis-à-vis de l'Afrique. Alors que seulement 2,2% de l'aide japonaise
était destiné à l'Afrique en 1970, sa part a atteint 15,3%
en 198969(*).
A partir des années 1990, le Japon est devenu le
principal pourvoyeur d'APD au monde. L'aide qu'il accorde à l'Afrique le
range aux côtés de la France, des Etats-Unis et de l'Allemagne qui
sont les principaux bailleurs de fonds du continent. Depuis lors, le Japon joue
un rôle moteur pour le développement de l'Afrique. Lancée
en 1993, la TICAD est une plate-forme clé pour piloter les initiatives
du développement du Japon en Afrique.
Chapitre II : Le cadre de la politique d'aide japonaise
en Afrique : le processus de la TICAD : 1993-2018
Dans ce chapitre, nous tentons d'analyser la politique d'aide
japonaise en Afrique depuis la fin de la guerre froide. L'objectif est de
chercher à comprendre les raisons qui ont poussé le Japon
à s'intéresser activement au continent africain. Le chapitre
explore, explique et analyse donc le processus de la TICAD en se limitant aux
six premières conférences. Il est divisé en deux points.
Le premier point analyse les trois premières réunions qui se sont
tenues entre 1993 et 2003 et couronnées par la déclaration du
dixième anniversaire de la TICAD. Le second point examine les trois
autres conférences allant de 2008 à 2016.
I. De la TICAD I à la
TICAD III
Lorsque la TICAD se tenait en 1993, la situation du Japon et
de l'Afrique était différente. Le Japon demeurait la
deuxième puissance économique mondiale et le plus important
fournisseur d'APD au monde. L'Afrique, en revanche, luttait pour réduire
la pauvreté et cherchait une aide étrangère
rapide70(*).
I.1. La TICAD I (1993).
Selon Shinichi Asazuma, directeur des Affaires africaines au
département du ministère des affaires étrangères
japonais en 2013, la raison pour laquelle le Japon a commencé la TICAD
était de ramener l'attention mondiale sur l'Afrique. En effet, au
début des années 1990, l'intérêt
général sur l'Afrique s'est relativement estompé
après la chute du mur de Berlin en 1989 et la fin de la guerre froide.
Pendant la guerre froide, les pays capitalistes et communistes étaient
mobilisés pour aider les pays africains afin d'étendre leurs
propres blocs et sphères d'influence71(*). Pour Howard Lehman qui cite un autre responsable du
Ministry of Foreign Affairs (MOFA) du Japon, la motivation du Japon dans
l'organisation de cette conférence s'explique par trois raisons72(*):
1) Le Japon a clairement pris conscience des besoins
humanitaires en Afrique et, compte tenu de la richesse économique du
pays, s'est rendu compte qu'il pouvait créer un environnement d'aide
positive.
2) Le Japon souhaitait avoir une place au soleil et voulait
être traité comme une puissance mondiale majeure à la fois
par d'autres grandes puissances et par l'ensemble de la communauté
internationale. C'est pourquoi Bert Edstrôm souligne que la TICAD a
été lancée à la suite et pour contrecarrer ce que
Tokyo considérait comme un simple désastre pour sa politique
étrangère : l'implication du Japon ou plutôt son
absence dans la guerre contre Saddam Hussein. En effet, invoquant des
contraintes constitutionnelles, le Japon, au lieu d'envoyer des soldats
participés à la guerre contre l'Irak dirigée par les
Etats-Unis et autorisée par l'ONU, supportera une importante part du
fardeau financier de l'effort de guerre, affectant 13 milliard de dollars
américains à la campagne militaire contre l'Irak. A la grande
surprise du gouvernement nippon, plutôt que d'avoir des éloges
pour sa générosité financière, le Japon s'est vu
critiquer de toute part. Les autorités japonaises étaient en
colère et en plein désarroi. Le Japon devait donc faire face
à une lutte ardue pour recouvrer non seulement le respect international
mais aussi la confiance en soi73(*). En tant que dernier venu en Afrique, le Japon avait
besoin d'une présence sur le continent pour se présenter comme
l'un des principaux donateurs. De plus, selon Bolade Eyinla, la TICAD est un
instrument diplomatique, consciemment lancée par le Japon en 1993 pour
servir ses intérêts nationaux. Pour lui, en lançant la
TICAD, le Japon avait deux principaux objectifs: exploiter les matières
premières et les ressources minérales africaines et
acquérir à long terme un siège permanent au Conseil de
sécurité de l'ONU74(*).
3) Dans le cadre de son plan stratégique visant
à se positionner comme une puissance asiatique, le Japon a
utilisé la TICAD comme une plateforme pour mettre en avant le
modèle de développement asiatique. Au cours des années
1980, le Japon commença à critiquer l'impact négatif des
Programmes d'ajustement structurel (PAS) en Afrique et les politiques
néolibérales. Le point de vue du Japon sur le modèle de
développement asiatique offre une alternative aux pays africains. Selon
Howard Lehman, le Consensus de Washington a été largement
critiqué au Japon comme étant inefficace et injuste dans son
application aux pays africains. Pour le Japon, les PAS peuvent être plus
efficaces dans des économies à revenu intermédiaire mais
ils sont moins efficaces dans des économies à faible revenu
comme ceux de la plupart des États africains75(*).
Du côté africain, cette période a
été celle pendant laquelle la stagnation économique des
années 1980 s'est poursuivie76(*). Les réformes économiques demeurent
stagnantes. De plus avec la fin de la guerre froide, les pays de l'Union
européenne (UE) se sont mis à apporter leur aide
financière aux anciens pays de l'Est plutôt qu'à l'Afrique,
d'où s'ensuivit une tendance à la diminution de l'aide
financière pour l'Afrique77(*). Les pays africains s'inquiétaient
d'être marginalisés car l'intérêt de la
communauté internationale envers leur développement avait
baissé. La TICAD est organisée dans le but de soutenir les
réformes politiques et économiques en Afrique.
La TICAD I s'est tenue du 5 au 6 octobre 1993 à Tokyo
et coorganisée par le Japon, l'Organisation des Nations-Unies (ONU) et
la Coalition mondiale pour l'Afrique (CMA). Elle a connu la participation de
quarante-huit pays africains, 13 organisations internationales et de nombreux
observateurs78(*). La
conférence a adopté la « Déclaration de Tokyo
sur le développement de l'Afrique : vers le XXIe
siècle », une ligne directrice pour le développement de
l'Afrique qui soulignait l'importance de l'entraide ainsi que la
nécessité d'un soutien international pour l'Afrique. Le Japon
exprima également son appui au développement de l'Afrique et
demanda à l'Afrique de procéder à la mise en place de
leur propre initiative de développement, à la réforme
économique et à la bonne gouvernance. Le modèle de
développement asiatique a été inséré dans le
document. La déclaration de Tokyo stipule qu'à partir
« des exemples réussis d'expérience en matière
de développement en Asie, le succès du développement
repose sur la combinaison d'un engagement fort des dirigeants et des citoyens
à l'égard de la prospérité économique et
d'un développement approprié à long
terme »79(*).
Les grands axes de la déclaration sont:
Ø le nouveau partenariat basé sur les propres
efforts du côté africain et le soutien actif des partenaires de
développement africain ;
Ø la poursuite et le renforcement des réformes
politiques et économiques ;
Ø le développement économique au travers
des activités du secteur privé ;
Ø la coopération et l'intégration
régionale pour encourager le commerce et les investissements
régionaux ;
Ø la pertinence de l'expérience asiatique pour
le développement africain et le renforcement de la coopération
Sud-Sud ;
Ø la prévention, la préparation et la
gestion des désastres humains et naturels et le renforcement de la
sécurité alimentaire.
En termes de résultats, la TICAD I a eu un bilan
mitigé car ses résultats ont été plus
symboliques que substantiels. En effet, des initiatives efficaces axées
sur des résultats n'ont ni été lancées par la
communauté internationale, ni par la communauté
africaine80(*).
Malgré tout, la TICAD I a obtenu quelques résultats surtout sur
le plan diplomatique. La dynamique de développement initiée par
la TICAD a conduit à la promotion du dialogue afro-asiatique. En 1994,
un premier forum Asie-Afrique (FAAI) s'est tenu en Indonésie. L'objectif
de ce forum était de permettre un dialogue direct et des échanges
entre les décideurs africains et asiatiques, mais aussi dans le but
d'identifier les domaines spécifiques où les Africains pourraient
tirer des enseignements de l'expérience asiatique. Il en résulta
l'adoption du « Cadre de Bandung pour la coopération
Asie-Afrique ». Le Japon a organisé en 1997, un FAA II dont
l'objet est d'évaluer les progrès effectués depuis le FAA
I et de préparer les bases de la deuxième TICAD.
I.2. La TICAD II (1998)
En 1993, la déclaration de Tokyo de la TICAD I
stipulait qu'une conférence d'une ampleur et d'une composition similaire
devrait se tenir avant le tournant du siècle81(*). C'est la TICAD II. Une
série de réunions ponctua le lancement de la TICAD II.
Lors de la neuvième session de la Conférence des
Nations-Unies sur le développement durable tenue en Afrique du Sud en
avril 1996, le gouvernement japonais a proposé d'organiser la TICAD II
en 1998 et sa conférence préparatoire en 1997 à Tokyo. En
février 1997, après une série de discussions entre le
gouvernement japonais, les agences du système des Nations-Unies et la
CMA, un accord a été conclu sur un cadre de base et le processus
de la TICAD II a été officiellement lancé82(*). La première
conférence préparatoire de la TICAD II s'est tenue du 10 au 11
novembre 1997 à Tokyo. Les principaux objectifs de la conférence
préparatoire étaient83(*):
ü passer en revue les progrès accomplis depuis la
TICAD I ;
ü identifier les principaux thèmes d'un programme
d'action ;
ü constituer un « Comité
préparatoire » chargé du « Programme
d'action » à soumettre à la TICAD II. Il a
été indiqué que la TICAD II visait à promouvoir
davantage le partenariat émergent pour le développement durable
de l'Afrique.
La conférence a convenu que le Comité
préparatoire se réunirait en principe trois fois en Afrique en
199884(*). La
première réunion du comité préparatoire s'est tenue
à Dakar les 2 et 3 mars 1998. A l'issue de la conférence, un
document synthétique a été préparé pour
servir de base à l'élaboration de l'avant-projet du
« Programme d'action » qui a été
examiné par le comité préparatoire à sa
deuxième réunion tenue à Harare en juin 199885(*). La troisième
réunion du comité préparatoire de la TICAD II s'est tenue
les 7 et 8 septembre 1998. Le comité a parachevé son projet
d'agenda d'action à présenter pour adoption à la TICAD II
prévue du 19 au 21 octobre 1998 à Tokyo. Le programme d'action
identifie les actions que doivent entreprendre les pays africains et leurs
partenaires de développement pour atteindre les objectifs de la TICAD II
en matière de réduction de la pauvreté et
d'intégration accrue des pays africains dans l'économie
mondiale86(*).
La TICAD II s'est tenue du 19 au 21 octobre 1998 à
Tokyo et coorganisée par le Bureau du coordinateur spécial pour
l'Afrique et les pays en développement (OSCAL), le Programme des
Nations-Unies pour le développement (PNUD) et la CMA. Les pays du
continent africain, à l'exception de la Somalie et du Sahara occidental,
10 pays d'Asie, 16 pays donateurs, 6 organisations internationales, plusieurs
observateurs et 22 ONG y participèrent87(*). La TICAD II diffère quelque peu de la TICAD
I du fait que les thèmes fixés sont les « approches »
et les « thèmes transversaux »88(*). Le point le plus remarquable de la TICAD II consista
en l'adoption du « Plan d'action de Tokyo ». Le principal
thème de la conférence était « la
réduction de la pauvreté et l'intégration de l'Afrique
dans l'économie mondiale ». L'objectif de ce programme
d'action est de mettre l'accent sur la réduction de la pauvreté
par une croissance économique accélérée et un
développement durable, ainsi que l'intégration effective des
économies africaines dans l'économie mondiale. Le principal
défi était de réduire d'au moins la moitié de la
population vivant dans l'extrême pauvreté d'ici à 2015, ce
qui souligne l'importance d'une croissance économique équitable,
toutes les couches de la population participant à des activités
économiques et partageant les avantages. Le document souligne
également que « la stabilité politique et sociale ainsi
que la bonne gouvernance sont essentielles au développement durable, de
même sans développement, la paix et la stabilité ne sont
pas durables »89(*). L'appropriation et le partenariat sont
également les principes sous-jacents du Programme d'action. Le document
rappelle que ces principes sont inscrits dans le programme d'action du Caire
pour le développement économique et social de l'Afrique de 1995
ainsi que dans la stratégie du Comité d'aide au
développement de l'OCDE de 1996 intitulée « construire
le XXIe siècle: la contribution de la coopération au
développement»90(*).
En définitive, le programme d'action de la TICAD II
clarifie les actions prioritaires dans le domaine du développement de
l'Afrique : réduire au moins de moitié la proportion des
personnes dans l'extrême pauvreté jusqu'à 2015 ;
assurer l'éducation primaire dans tous les pays jusqu'à
2015 ; réduire la mortalité maternelle de trois quarts et la
mortalité infantile de deux tiers jusqu'à 2015.
Quant au bilan, la TICAD II a permis de mieux comprendre les
problèmes de développement en Afrique et de renforcer la
coopération Asie-Afrique. Le Centre de promotion et de la technologie
Asie-Afrique (Centre Hippalos) a été créé en 1999
et géré par l'Organisation des Nations-Unies pour le
développement industriel (ONUDI). Ce centre, également connu sous
le nom de Centre Afrique-Asie pour la promotion de l'investissement et de la
technologie, vise à encourager les investissements et les transferts de
technologie des pays d'Asie à ceux d'Afrique. A l'époque, le
centre avait choisi la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mozambique, l'Ouganda,
le Sénégal, la Tanzanie et le Zimbabwe pour participer à
des activités de projets. Il fournit des données sur la situation
économique, les systèmes juridiques nationaux, les
possibilités en matière d'investissement et des informations
utiles en matière d'investissement91(*).
La TICAD II a notamment développé un partenariat
avec l'Afrique basé sur sa production de riz. Le Nouveau riz pour
l'Afrique (NERICA) a été présenté comme une
réalisation majeure et concrète du processus de la TICAD. NERICA
a été un vecteur reliant les objectifs du gouvernement japonais
en matière de coopération Asie-Afrique. La TICAD II a
préparé le terrain pour le développement de NERICA en tant
qu'agent important. NERICA constitue un remarquable exemple de
coopération entre l'Asie et l'Afrique qui améliore les
perspectives de sécurité alimentaire. Cette nouvelle
variété de riz associe la hardiesse des espèces de riz
d'Afrique occidentale à la grande productivité du riz asiatique.
Mis au point par l'Association pour le développement de la riziculture
en Afrique de l'Ouest (ADRAO) et ses partenaires en Afrique, en Asie, en
Europe, et en Amérique du Nord et du Sud, il a également
reçu l'appui de nombreux donateurs, y compris le gouvernement du Japon,
le PNUD, la Banque mondiale, la Fondation Rockefeller, l'Agence
américaine pour le développement international (USAID), la Banque
africaine de développement (BAD) et l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). L'Initiative pour le riz africain
(ARI) lancée en mars 2002 visait également à
accélérer la diffusion du Nouveau riz pour l'Afrique dans
l'ensemble de l'Afrique en partant de sept pays pilotes d'Afrique de l'Ouest,
à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la
Guinée, le Mali, le Nigeria et le Togo, pour inclurent des pays
d'Afrique australe et de l'Est: Éthiopie, Madagascar, Malawi,
Mozambique, Ouganda, Tanzanie et Zambie92(*).
Suite à la TICAD II en 1998, deux Forums d'affaires
Asie-Afrique ont été organisés: l'un à Kuala Lumpur
en Malaisie en octobre 1999 qui a débouché sur la signature de 27
protocoles d'accord et l'autre à Durban en Afrique du Sud en juillet
2001 qui a permis la signature de 97 protocoles d'accord. Ces forums visaient
à instaurer des partenariats commerciaux et à attirer un plus
grand flux d'investissements étrangers directs et d'échanges
commerciaux entre l'Asie et l'Afrique. Une série d'ateliers
destinée à renforcer les compétences s'est tenue,
axée sur des sujets clés tels que l'administration et le
fonctionnement des entreprises. Une stratégie visant à effacer
les perceptions négatives que chaque région peut avoir de l'autre
a été élaborée afin d'instaurer la confiance et de
multiplier les possibilités de conclure des affaires93(*).
I.3. La TICAD III (2003)
En 1998, à l'issue de la TICAD II, aucun paragraphe du
Plan d'action de Tokyo ne mentionnait la possibilité d'une TICAD III.
Malgré tout, plusieurs facteurs vont inciter le Japon à envisager
l'organisation de la TICAD III. Dès la seconde moitié des
années 1990, la réduction de la pauvreté est devenue un
thème important sur la scène internationale. En 2000, les
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont
été lancés et incluent la réduction de la
pauvreté dans ses objectifs. De même la question de
l'efficacité de l'aide, thème qui a débuté avec la
Déclaration de Rome, est devenue un enjeu majeur de la communauté
internationale. En avril 2000, l'Union européenne et l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) ont adopté lors du Sommet Afrique-Europe,
le « Plan d'action du Caire », et en mai 2000, les Etats-Unis ont mis
en place la « Loi sur la croissance et les possibilités
économiques en Afrique » (AGOA) qui indique un cadre aux
investissements commerciaux en Afrique subsaharienne. De plus, la Chine a
adopté en octobre 2000 la « Déclaration de Beijing »
lors du Forum sur la coopération sino-africaine et a
rédigé le « Programme de coopération sino-africaine
sur le développement économique et social ». D'autre part,
le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique(NEPAD) a
été adopté au sommet de l'Union africaine (UA) en 2001. Et
lors du sommet du G8 à Gênes en 2001, le « Plan de
Gênes pour l'Afrique » a été
présenté94(*).En décembre 2001 fut organisée une
réunion au niveau ministériel de la TICAD à une
époque où le développement de l'Afrique faisait l'objet de
nombreuses discussions au sein de la communauté internationale. À
cette occasion, la TICAD a exprimé son appui au NEPAD en tant
qu'organisme exprimant l'esprit d'appropriation des pays africains95(*).
La ministre des Affaires étrangères du Japon,
Yoriko Kawaguchi a officiellement présenté les objectifs de la
TICAD III à l'Union africaine le 26 août 2002 à Addis-Abeba
en Ethiopie. Dans son discours, elle rappelle que le Japon a
désigné la période précédant la TICAD III
comme « année de la coopération avec
l'Afrique ». Soulignant que l'appropriation des pays africains a
atteint un nouveau sommet avec le NEPAD, la ministre affirme que la TICAD peut
continuer à jouer un rôle catalyseur unique en tant que cadre
permettant à l'Afrique et à ses partenaires de promouvoir un
dialogue approfondi et une coopération mutuelle. Selon elle, le Japon
accorderait la priorité aux trois domaines suivant du processus de la
TICAD96(*) :
ü la coopération Asie-Afrique ;
ü le développement centré sur l'homme qui
est un principe important de la coopération japonaise en
matière de développement ;
ü les efforts visant à consolider la paix en tant
que condition préalable du développement.
Une réunion préparatoire des hauts
fonctionnaires de la TICAD III a été organisée à
Addis-Abeba les 3 et 4 mars 2003. La réunion a discuté de l'ordre
du jour, du concept et des résultats de la TICAD III. Le but de la
réunion était également de mettre en place un processus
préparatoire avec la communauté internationale, y compris les
pays africains, qui ouvrirait la voie au succès de la TICAD III
prévue du 29 au 1er octobre 200397(*).
À la suite de la réunion préparatoire
d'Addis-Abeba, des réunions régionales se sont tenues à
:
ü Pretoria, Afrique du Sud, pour les pays d'Afrique
australe, 22-23 mai 2003 ;
ü Nairobi, Kenya, pour les pays d'Afrique du Nord et de
l'Est, 5-6 juin 2003;
ü Yaoundé, Cameroun, pour les pays d'Afrique
centrale et de l'Ouest, 23-24 juin 2003.
Les trois réunions régionales ont mis au point
de nouvelles approches en tenant compte des secteurs prioritaires
identifiés lors de la réunion préparatoire, en vue
d'orienter la TICAD III dans ses délibérations.
La TICAD III s'est tenue du 29 septembre au 1er
octobre 2003 à Tokyo avec pour thème « soutenir le
développement de l'Afrique au XXIe siècle ». Elle
rassembla des délégués représentant 89 pays dont 50
pays africains ainsi que 47 organisations internationales et des ONG98(*).
Dans son discours d'ouverture, le premier ministre Junichiro
Koizumi a annoncé les trois piliers qui constituent l'initiative
japonaise d'aide à l'Afrique: le développement centré sur
l'homme, la réduction de la pauvreté par la croissance
économique et la consolidation de la paix99(*).
Le premier pilier met l'accent sur le développement des
ressources humaines, l'eau, la santé et les soins médicaux. Le
deuxième pilier est la réduction de la pauvreté par la
croissance économique. Le Japon cherche à mettre davantage
l'accent sur la coopération, en particulier pour améliorer :
ü la productivité agricole avec le
développement du riz NERICA ;
ü le développement des infrastructures ;
ü la promotion du commerce et de
l'investissement ;
ü la réduction de la dette ;
ü l'assistance de la réforme de la structure
économique ;
ü le soutien par l'intermédiaire des institutions
internationales pour le développement.
Le troisième pilier concerne la consolidation de la
paix. Dans son discours, le premier ministre souligne que « la paix
est la base du développement ». Et ce dernier de rappeler que
le Japon a participé à des opérations de maintien de paix
comme au Mozambique. Il rappelle également que le Japon s'est
récemment engagé dans une coopération en vue de la
consolidation de la paix dans des pays comme la République
Démocratique du Congo (RDC), l'Angola, la Sierra-Leone, le Soudan et le
Libéria100(*).
Pour le premier ministre japonais, le Pays du Soleil Levant
« souhaite approfondir le dialogue avec ses partenaires africains
afin de déterminer comment le peuple africain peut s'affranchir des
diverses menaces comme la pauvreté, les conflits et les maladies
infectieuses ». En d'autres termes, comment le Japon peut
réaliser une société dans laquelle les gens peuvent vivre
avec espoir »101(*).
La conférence a adopté également
« la Déclaration commémorative du dixième
anniversaire de la TICAD ». La déclaration montre l'importance
de la contribution de la TICAD au cours des dix dernières années
et des espoirs ont été exprimés pour que la TICAD devienne
une plate-forme permettant de réunir le soutien de la communauté
internationale au NEPAD. La déclaration met l'accent sur plusieurs
approches102(*):
ü l'appropriation et le partenariat ;
ü le renforcement de la coopération
sud-sud ;
ü la sécurité humaine qui est un vaste
ensemble d'objectifs qui souligne des problèmes comme la
pauvreté, la faim, les maladies infectieuses et le manque
d'éducation.
Un autre fait majeur de la TICAD III a été
l'engagement des coorganisateurs à poursuivre le processus de la TICAD
sous une forme plus institutionnalisée et à développer
davantage ses partenaires. Dans son discours, le premier ministre japonais
déclare : « le Japon s'organisera pour institutionnaliser
la TICAD afin de renforcer ses structures de suivi pour rendre son processus
plus dynamique 103(*)». Il a été également
décidé que ses résultats feraient l'objet d'un suivi
régulier.
Après la TICAD III, fut organisée la
Conférence de la TICAD sur le commerce et l'investissement Asie-Afrique
les 1er et 2 novembre 2004. Cette conférence a eu pour
objectif de promouvoir l'un des trois piliers de la TICAD III qui est
« la réduction de la pauvreté par la croissance
économique », par le biais des investissements commerciaux
dans le cadre de la coopération Asie-Afrique, concept clé du
processus de la TICAD. Cette conférence a eu pour résultat
l'intégration de quatre points au processus de la TICAD : la
formulation d'une politique appropriée pour la promotion de l'industrie,
la promotion du développement de produits basés sur la
supériorité relative, le renforcement de l'autonomie des PME
locales et la promotion d'une contribution sociale par les entreprises
privées.
Une réunion de la TICAD III sur la consolidation de la
paix a aussi été organisée les 16 et 17 février
2006 à Addis-Abeba par le gouvernement du Japon, l'ONU, la CMA, le PNUD
et la Banque mondiale. Elle a connu la participation de 23 pays africains, 50
autres pays, 38 organisations issues de la société civile.
L'objectif de la réunion visait à promouvoir l'un des trois
piliers de la TICAD III, « la consolidation de la paix ».
Cette dernière étant un domaine qui nécessite des
engagements divers et globaux est important du point de vue de la
sécurité humaine. L'objectif est d'examiner les
possibilités d'appui à la consolidation de la paix en Afrique en
partageant l'expérience de la consolidation de la paix au Cambodge et en
Afghanistan. La réunion a reconnu la nécessité de
renforcer les engagements pour la consolidation de la paix, et que celle-ci
nécessitait une approche multiple, intégrée et
cohérente104(*).
Une dernière conférence ministérielle de la TICAD III sur
l'énergie et l'environnement pour un développement durable a
été organisée à Nairobi au Kenya en mars 2007.
C'est à l'issue de cette conférence que les réunions
préparatoires de la TICAD IV ont commencées.
II. De la TICAD IV à
la TICAD VI
A l'occasion de la TICAD III, la nécessité
d'institutionnaliser le processus de la TICAD a été
formulée par les différents participants, surtout de la part des
dirigeants africains. L'objectif était de mettre en place un
mécanisme concret de surveillance du processus. Dans ce point, il est
question de voir l'évolution de la TICAD depuis son
institutionnalisation à travers les trois autres conférences qui
ont suivi, c'est-à-dire la TICAD IV, la TICAD V et la TICAD VI.
II.1. La TICAD IV (2008)
En vue de la préparation de la TICAD IV, des
consultations sur un grand nombre de sujets ont été menées
avec les dirigeants africains, la Commission de l'union africaine (CUA), le
NEPAD, la Commission économique pour l'Afrique (CEA), les
communautés régionales africaines, les coorganisateurs de la
TICAD, d'importantes organisations régionales et internationales, les
pays développés partenaires, des pays d'Asie et autres pays en
développement, ainsi que la société civile, les ONG et le
secteur privé105(*).
En octobre-novembre 2007, des réunions
préparatoires régionales de la TICAD IV se sont tenues à
Lusaka en Zambie pour la région Afrique australe et orientale et
à Tunis en Tunisie pour les régions Afrique du Nord, de l'Ouest
et du Centre. Le but de ces deux réunions était d'expliquer
l'état d'avancement de la préparation de la TICAD IV et
d'écouter les participants régionaux sur des questions
concrètes, ainsi que leurs points de vue et leurs préoccupations
liés aux priorités de la TICAD IV afin de déterminer
l'ordre du jour et de produire les résultats souhaités à
la TICAD IV. Au cours de la réunion, les participants ont
discuté des sujets suivants: accélération de la
croissance, réalisation des OMD, consolidation de la paix et de la
démocratisation et traitement des problèmes liés à
l'environnement et au changement climatique106(*).
La réunion ministérielle de préparation
pour la finalisation du processus préparatoire de la TICAD IV s'est
tenue au Gabon du 19 au 23 mars 2008. Pour atteindre les objectifs de la TICAD
IV, la réunion s'est fixée trois priorités107(*):
ü encourager la croissance économique;
ü assurer la « sécurité humaine
», avec notamment la réalisation des OMD, la consolidation de la
paix et la démocratisation; et
ü traiter des questions de l'environnement et du
changement climatique.
La TICAD IV s'est tenue à Yokohama du 28 au 30 mai 2008
avec pour thème « vers une Afrique qui gagne : un
continent d'espoir et d'opportunités ». Elle a réuni
plus de 3000 participants dont des représentants de 51 pays d'Afrique,
avec 40 chefs d'État et de gouvernement pour créer un plan de
travail visant à réaliser « un siècle de
croissance africaine». Le Sommet de la TICAD IV a adopté la
« Déclaration de Yokohama » qui définit les
principes auxquels les parties prenantes de la TICAD souscrivent pour faire
progresser le développement en Afrique, ainsi que le « Plan
d'action de Yokohama » et le « Mécanisme de suivi de
Yokohama », qui représentent deux feuilles de route pour des
initiatives concrètes aux objectifs chiffrés108(*). Selon la
« Déclaration de Yokohama 109(*)», les domaines
prioritaires de la TICAD IV sont:
ü encourager la croissance économique à
travers le développement des ressources humaines ; le
développement industriel accéléré ; les
infrastructures ; le commerce et investissement ; le
développement agricole et rural, le rôle du secteur privé,
la promotion du tourisme ;
ü assurer la « sécurité
humaine » dans sa dimension économique et sociale
(accomplissement des objectifs du millénaire pour le
développement) ainsi que dans sa dimension politique (consolidation de
la paix et bonne gouvernance) ;
ü traiter les questions de l'environnement et du changement
climatique. Il s'agit ici de s'attaquer à la question du changement
climatique, de l'eau et de l'Education pour un développement durable
(EDD).
Quant au mécanisme de suivi, son objectif est de
contribuer à la stabilité de la mise en oeuvre des initiatives
concernées. L'objectif est également de s'entretenir ouvertement
non seulement avec les Etats africains mais aussi avec les pays et les
organisations internationales sur les concepts et les façons de
pensée qui sont promus par le processus de la TICAD et leurs
résultats concrets. C'est aussi améliorer la transparence et les
responsabilités des activités de la TICAD. Le mécanisme de
suivi se structure à plusieurs niveaux dont les réunions
ministérielles. L'objectif des réunions ministérielles est
de saisir des thèmes spécifiques pour revoir et évaluer
les activités en cours de la TICAD par rapport au rapport d'avancement
annuel, de donner des instructions pour accélérer la mise en
oeuvre.
La première réunion ministérielle de
suivi de la TICAD IV a été organisée les 21 et 22 mars
2009 à Gaborone au Botswana. Son objectif est d'examiner le rapport
annuel 2008 sur l'état d'avancement de la TICAD IV, d'évaluer les
progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Plan d'action
de Yokohama (PAU) et de se pencher sur les incidences de la crise
financière et économique mondiale sur l'Afrique110(*). Selon le communiqué
adopté à Gaborone, le gouvernement japonais a confirmé
qu'il allait honorer pleinement les engagements pris lors de la TICAD IV :
doubler son APD et aider au doublement des investissements privés en
Afrique d'ici 2012. Dans le cadre des efforts visant à
accélérer l'assistance à l'Afrique, compte tenu de la
crise financière et économique mondiale et des difficultés
qu'elle engendre, le Japon s'est engagé à mettre en oeuvre un
programme de subvention et d'assistance technique d'un montant de 2 milliards
de dollars et de mobiliser activement les prêts APD d'un montant de 4
milliards de dollars. De plus, constatant les difficultés
rencontrées par les populations à cause de la crise
économique, le gouvernement japonais s'est engagé à
fournir une aide alimentaire d'un montant d'environ 300 millions de
dollars111(*).
La deuxième réunion ministérielle de la
TICAD IV s'est tenue en mai 2010 à Arusha en Tanzanie. La réunion
a porté sur 4 thèmes: l'état d'avancement de la mise en
oeuvre du plan d'action de Yokohama, les efforts de l'Afrique pour se remettre
de la crise financière et économique mondiale, la
réalisation des OMD et les problèmes de changement climatique.
Une troisième réunion a été
organisée à Dakar au Sénégal les 1er et 2 mai 2011
et a porté sur le développement économique, le changement
climatique, la croissance à faible intensité de carbone et le
développement durable en Afrique. Dans le communiqué
adopté à l'issue de la réunion, les participants ont
reconnu l'importance du processus de la TICAD pour soutenir une croissance
inclusive et équitable en Afrique, tout en approfondissant
l'intégration régionale, le développement des
infrastructures régionales et l'amélioration de la
sécurité alimentaire par le biais d'investissements dans le
développement agricole112(*). La quatrième réunion
ministérielle s'est tenue les 5 et 6 mai 2012 à Marrakech au
Maroc. L'objectif de cette conférence était d'évaluer les
progrès accomplis dans la mise en oeuvre du PAU 2008 adopté
à la TICAD IV et engager des discussions sur la TICAD V113(*).
II.2. LA TICAD V (2013)
Lors de la quatrième réunion
ministérielle de la TICAD IV, les participants ont décidé
de confier au Burkina Faso, l'organisation de la première étape
dans la préparation de la TICAD V114(*). La réunion a eu lieu du 15 au 17 novembre
2012 à Ouagadougou. Au cours de la réunion, de vives discussions
ont été faites autour des sujets tels que « économie
solide et durable », « société inclusive et
résiliente », « paix et stabilité » et «
croissance de qualité ». De nombreuses propositions ont
été formulées pour approfondir la discussion lors de la
TICAD V. A la fin de la réunion, un slogan de la TICAD V a
été approuvé par les participants: « Main dans la
main: avec une Afrique plus dynamique »115(*). La réunion ministérielle de la TICAD
V a été organisée les 16 et 17 mars 2013 à
Addis-Abeba en Ethiopie. A l'issue de cette conférence
ministérielle, un plan quinquennal de la TICAD V a été
élaboré116(*).
La TICAD V s'est tenue à Yokohama du 1er au
3 juin 2013. Sous le concept de base «Main dans la main avec une Afrique
plus dynamique», de vives discussions se sont produites sur l'orientation
du développement de l'Afrique conformément aux thèmes
centraux de la TICAD V, à savoir «une économie solide et
durable», «une société inclusive et
résiliente» et « la paix et la
stabilité »117(*). La TICAD V a rassemblé au moins 4 500
participants dont des représentants de 51 pays africains, de 31 pays
partenaires du développement et de pays asiatiques, dont 39 chefs
d'État et de gouvernement; des représentants de 72 organisations
internationales et régionales; des représentants du secteur
privé et de la société civile tels que des ONG. De plus,
les représentants de tous les coorganisateurs de la TICAD étaient
présents à la TICAD V: Ban Ki-moon, Secrétaire
général des Nations Unies; Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma,
Présidente de la CUA; Jim Yong Kim, Président de la Banque
mondiale; et Helen Clark, Administratrice du PNUD118(*). Deux principaux documents
ont été adoptés à la TICAD V: la Déclaration
de Yokohama 2013 et le Plan d'action de Yokohama 2013-2017. Ces documents
présentent une orientation pour le développement de l'Afrique et
une feuille de route des mesures spécifiques qui seront prises dans le
cadre du processus de la TICAD les cinq années à venir119(*) .
La déclaration de Yokohama 2013 identifie les
principales approches stratégiques à adopter dans le processus de
la TICAD. Ces approches sous-tendent les principes cardinaux qui doivent
être davantage appliqués dans tous les aspects des agendas de
développement de la TICAD V, pour une croissance de
qualité120(*).
Dans le cadre de ces principes, il s'agit:
ü promouvoir la croissance induite par le secteur
privé ;
ü accélérer le développement des
infrastructures ;
ü autonomiser les agriculteurs en tant que principaux
acteurs économiques ;
ü promouvoir une croissance durable et solide ;
ü édifier une société inclusive pour
la croissance ;
ü consolider la paix, la stabilité et la bonne
gouvernance.
La réunion ministérielle de la TICAD V s'est
tenue les 4 et 5 mai 2014 à Yaoundé au Cameroun. Les ministres et
délégations des pays africains et les coorganisateurs de la
TICAD, à savoir le gouvernement du Japon, la CUA, le Bureau du
Conseiller spécial pour l'Afrique des Nations Unies (OSAA), le PNUD et
la Banque mondiale, se sont réunis, avec les représentants
d'autres pays partenaires, d'organisations internationales et
régionales. Les organisations du secteur privé et de la
société civile ont également participé à la
conférence. Les discussions se sont portées sur l'avancée
de la mise en oeuvre du Plan d'action de Yokohama 2013-2017 et sur des
questions relatives à l'agriculture, la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Une séance spéciale a
été consacrée à l'autonomisation des femmes et des
jeunes121(*). Le rapport
d'activité 2013-2015 de la TICAD V a souligné qu'en 2015,
l'état de mise en oeuvre des engagements du PAU 2013-2017 est en bonne
voie. Ce rapport résume son avancement entre janvier 2013 et la fin
décembre 2015122(*).
II.3. La TICAD VI (2016)
La sixième Conférence internationale de Tokyo
sur le développement de l'Afrique (TICAD VI) marque un tournant dans
l'histoire de la TICAD dans le sens où:
1) l'intervalle de tenue des TICAD a été
raccourci de 5 ans à 3 ans.
2) la TICAD VI s'est tenue en Afrique pour la première
fois depuis 1993.
3) En février 2015, le Japon a révisé sa
charte de l'APD. Cette nouvelle charte précise l'aide prodiguée
par le Japon grâce aux « efforts conjoints du secteur public et
du secteur privé à travers le processus de la TICAD, de
façon à ce que la croissance remarquable de l'Afrique au cours
des dernières années, fondée sur l'expansion du commerce,
de l'investissement de la consommation, induise un surcroît de
développement123(*) ».
La réunion des hauts fonctionnaires de la TICAD VI
s'est tenue à Djibouti du 14 au 15 mars 2016. Lors de cette rencontre,
il a été décidé que la réunion
ministérielle préparatoire de la TICAD VI se tiendrait en
République de Gambie du 1er au 2 juin124(*).
Cette réunion ministérielle préparatoire
s'est tenue à Banjul les 16 et 17 juin 2016. L'objectif de cette
conférence était de discuter sur le projet de déclaration
de Nairobi, document final de la TICAD VI. Cette déclaration serait
confirmée lors de la réunion pré-conférence
ministérielle prévue le 26 août juste avant la TICAD VI et
il est prévu de faire adopter la déclaration à
l'unanimité lors de la TICAD VI125(*).
La TICAD VI, elle-même, s'est tenue à Nairobi au
Kenya les 27 et 28 août 2016 avec pour thème « faire
progresser l'agenda du développement durable de l'Afrique: TICAD,
partenariat pour la prospérité ». Cette
conférence a été la première à se tenir en
Afrique. Plus de 11 000 personnes ont participé à la TICAD VI, y
compris des représentants de 53 pays africains, de pays partenaires,
d'organisations internationales et régionales, du secteur privé
et de la société civile telle que les ONG. Par ailleurs, une
mission commerciale a réuni des dirigeants de 77 organisations, dont
des entreprises et des universités japonaises126(*). Lors de la séance de
clôture, la Déclaration de Nairobi a été
adoptée en tant que document final de la TICAD VI127(*). Le Plan de mise en oeuvre
de Nairobi a également été adopté. Ces deux
documents mettent l'accent sur les actions à entreprendre par l'Afrique
et ses partenaires afin d'accélérer les progrès en
direction des Objectifs du développement durable (ODD) et de l'Agenda
2063 de l'Union africaine128(*).
Selon la Déclaration de Nairobi, les domaines
prioritaires de la TICAD VI s'articulent autour de trois piliers129(*):
Pilier 1: Promotion de la transformation
économique structurelle par la diversification économique et
l'industrialisation avec:
ü la diversification économique et
l'industrialisation,
ü le développement des infrastructures de
qualité,
ü le développement du secteur privé,
ü le développement des ressources humaines.
Pilier 2: Promotion de systèmes de santé
résilients pour la qualité de vie. Ce pilier
comprend:
ü le renforcement des systèmes de santé,
ü la réponse face aux crises de santé
publique,
ü la Couverture sanitaire universelle (CSU).
Pilier 3: Promotion de la stabilité sociale
pour une prospérité partagée par :
ü la stabilité sociale et la consolidation de la
paix,
ü la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme
violent,
ü les enjeux planétaires,
ü la sécurité maritime.
La première réunion ministérielle de
suivi de la TICAD VI a été organisée les 24-26 août
2017 à Maputo au Mozambique. L'objectif de cette réunion
était de présenter les progrès du rapport de la TICAD VI
par les coorganisateurs et de porter un regard sur la transformation
économique pour un développement du continent et la promotion de
la sécurité humaine et d'une société
résiliente. A l'issue de la réunion, le « Rapport
d'activités 2017 » et les « Initiatives du Japon
2017 » ont été présentés en tant que
documents finaux de la réunion ministérielle130(*).
Une autre réunion ministérielle de la TICAD
s'est tenue à Tokyo les 6 et 7 octobre 2018 à Yokohama au Japon.
L'objectif était de présenter les progrès
réalisés par le Japon dans les mesures annoncées lors des
réunions précédentes de la TICAD. A l'issue de la
réunion, le «Rapport de la TICAD 2018 - Progrès et
perspectives -» a été officiellement présenté
en tant que contribution à la réunion
ministérielle131(*).
La TICAD est l'élément clé de la
politique africaine du Japon. Les principes généraux de la TICAD
sont « l'appropriation par l'Afrique » et le
« partenariat international ». Lors des sommets de la
TICAD, plusieurs questions sont abordées. Ces questions sont
liées au développement de l'Afrique et prennent en compte les
secteurs comme la santé, l'eau et l'assainissement, l'éducation,
l'agriculture. D'autres secteurs sont également pris en compte. Il
s'agit notamment de la question liée au développement du commerce
et de l'investissement, l'environnement et du développement des
infrastructures, etc. L'assistance du Japon envers l'Afrique est conforme au
processus de la TICAD et ses principes. Le Japon appuie les initiatives propres
des pays africains132(*).
Chapitre III : La TICAD, un forum à
caractère unique ?
Lancée en 1993, la TICAD constitue désormais un
forum ouvert et inclusif qui rassemble les parties prenantes au
développement de l'Afrique de par le monde. Elle s'appuie sur ses
principes fondamentaux de « l'appropriation par les Africains de leur
processus de développement » et du « partenariat
international ».
I. Les coorganisateurs de la
TICAD
Contrairement à la plupart des forums
bilatéraux sur l'Afrique, la TICAD est une conférence qui est
coorganisée par plusieurs parties prenantes.
I.1. Le PNUD
La TICAD joue, depuis sa création en 1993, un
rôle de premier plan dans la promotion et la mobilisation du soutien au
développement de l'Afrique. Le PNUD et le Japon travaillent ensemble
avec les gouvernements des pays africains et avec la Commission de Union
africaine (CUA) pour renforcer le dialogue et la coopération en vue de
réaliser les objectifs de développement du continent et de
traduire les déclarations émanant de la TICAD en un ensemble de
mesures concrètes. Le processus a notamment contribué à
l'intégration des approches de sécurité humaine et de
développement axée sur les personnes en Afrique133(*).
Le PNUD coopère avec le processus de la TICAD en tant
que coorganisateur depuis la TICAD I. Son action est centrée sur
l'humain à travers le renforcement du secteur privé,
l'élargissement de la protection sociale, la création d'emplois
pour les catégories pauvres et le renforcement de la
sécurité alimentaire. Par ailleurs, le PNUD met en oeuvre des
aides pour la prévention des conflits, la consolidation de la paix ainsi
que le rétablissement à long terme afin de construire des pays
forts. De même, il déploie des activités d'appui à
la reconstruction à travers la réduction des dégâts
humains et matériels en contrôlant l'impact des désastres
naturels et ceux liés au changement climatique. Enfin, le PNUD vise un
développement durable par une aide au processus de développement,
en exploitant les ressources naturelles de l'Afrique dans les domaines de
l'économie, de la société et de l'environnement. Les
efforts du PNUD sont basés sur 4 piliers qu'il place au premier plan
:
ü la réduction de la pauvreté,
ü la gouvernance démocratique,
ü l'environnement et énergie et
ü la prévention des conflits.
Le programme se focalise également sur le renforcement
des capacités à travers l'évaluation des progrès
accomplis en Afrique dans la réalisation des Objectifs du
millénaire pour le développement134(*).
Selon Hélène Clark, le PNUD et la TICAD sont
attachés aux principes de leadership et d'appropriation nationaux et de
partenariat international. Les partenaires de la TICAD mobilisent des
connaissances précieuses et un savoir-faire technique pour le
développement. Le programme d'adaptation pour l'Afrique financé
par le Japon et mis en oeuvre par le PNUD à l'échelle du
continent est un exemple de partenariat entre le PNUD et le Japon. Le programme
aide les pays à intégrer l'adaptation du changement climatique
dans les efforts de développement national135(*).
De même, depuis 2016, le PNUD soutient des projets
régionaux de prévention de l'extrémisme violent visant
à lutter contre ses causes profondes, en collaboration avec
l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), le
G5 Sahel et la Commission du bassin du lac Tchad. En partenariat avec le
secrétariat permanent du G5 Sahel, 1 387 agents frontaliers du Mali, du
Burkina Faso, du Tchad, de la Mauritanie et du Niger ont été
formés à la gestion de frontière et à la
sécurité, entre 2016 et 2018136(*).
Le PNUD dispose des moyens nécessaires pour
répondre à toutes les priorités de la TICAD. Au sein des
pays et entre eux, le PNUD constitue des équipes transversales de
spécialistes pour aider les partenaires à toutes les
étapes du processus, depuis la planification et le financement
jusqu'à l'analyse des politiques en passant par la conception des
programmes, les ressources humaines, les achats et autres
opérations137(*).
I.2. La Banque mondiale
La Banque mondiale participe au processus de la TICAD depuis
la réunion au niveau ministérielle de 2001. L'Afrique est
placée par la Banque mondiale comme la zone la plus prioritaire pour le
développement. La Banque mondiale est le plus grand organisme qui
octroie l'aide au développement pour la région d'Afrique. Le
partage des connaissances, la recherche et l'analyse ainsi que le conseil
politique sont les facteurs principaux de l'aide à l'Afrique. Le Plan
d'action de l'Afrique, élaboré en 2005 met l'accent sur « le
partage élargi de la croissance » et précise les 8 secteurs
essentiels et prioritaires à soutenir :
ü le renforcement du secteur privé,
ü l'agrandissement du renforcement de la capacité
économique pour les femmes,
ü la formation de la capacité pour élever
la compétitivité face à l'économie globale,
ü l'amélioration de la productivité
agricole,
ü l'amélioration de la fiabilité de
l'énergie propre,
ü l'élargissement et l'aménagement de
réseaux routiers et de corridors de trafic,
ü l'élargissement de l'accès à
l'assainissement et
ü le renforcement des systèmes de santé
de tous les pays et la prévention du paludisme et du VIH/SIDA138(*).
La stratégie d'assistance à l'Afrique
annoncée en mars 2011 par la Banque mondiale
énumère :
ü la compétitivité et l'emploi,
ü la vulnérabilité et la
résilience,
ü la gouvernance et la capacité du secteur
public, comme secteurs prioritaires pour lancer sa vision et sa
stratégie d'assistance pour les 10 prochaines années139(*).
A la TICAD VI, la Banque mondiale et le Fonds mondial de lutte
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme se sont engagés à
investir 24 milliards de dollars en Afrique au cours des trois prochaines
années pour accélérer les progrès vers la CSU en
Afrique et aider les pays à réformer leurs systèmes de
santé140(*).
La Banque mondiale fait la promotion de la CSU à
travers des projets nationaux et régionaux conjointement menés
avec les gouvernements des pays africains concernés et d'autres
partenaires de développement. Des projets de ce type sont actuellement
en cours au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Ghana,
au Kenya, au Sénégal et en Tanzanie. Ces projets visent à
renforcer les systèmes de santé par des mesures telles que
l'accroissement du financement ou l'amélioration des services de soins
de santé primaires et communautaires et de la gestion du système
de santé. Ces efforts sont également essentiels pour
prévenir et gérer les flambées de maladies
infectieuses141(*).
I.3. Les autres
coorganisateurs
En plus du PNUD et de la Banque mondiale, d'autres acteurs
sont également des coorganisateurs de la TICAD. Il s'agit notamment du
Bureau du Conseiller spécial pour l'Afrique (OSAA) et de la Commission
de l'Union africaine. Jusqu'à la TICAD III, la Coalition mondiale pour
l'Afrique (CMA) a été coorganisatrice de la TICAD.
La Coalition mondiale pour l'Afrique (CMA) est un forum
Nord-Sud qui réunit les dirigeants africains et leurs principaux
partenaires de la communauté internationale pour examiner les
problèmes de développement économique et social les plus
sensibles en Afrique. La CMA cherche à favoriser un consensus sur les
politiques et les programmes d'action et à en suivre les
résultats. Elle part du principe que l'Afrique ne peut se
développer qu'à partir d'elle-même, mais que cet effort a
besoin d'un appui extérieur soutenu et coordonné et une
collaboration étroite avec ses partenaires extérieurs. Le
programme d'action de la CMA s'articule autour des grands thèmes
suivants:
ü la paix et la sécurité, y compris la
gestion des conflits et la réforme dans le secteur de la
sécurité,
ü la gouvernance et la transition vers la
démocratie, comprenant aussi la lutte contre la corruption,
l'éthique de responsabilité publique et l'alternance politique
pacifique,
ü la croissance durable et l'intégration à
l'économie mondiale, y compris l'intégration régionale, le
secteur privé et l'agriculture142(*).
Dans le cadre de son mandat, le Bureau du Conseiller
spécial pour l'Afrique (OSAA) est l'un des cinq organisateurs de la
TICAD. Admis en 2007, le Bureau du Conseiller spécial, concentre plus
particulièrement ses efforts de suivi sur le pilier de la «
Consolidation de la paix, de la stabilité, de la démocratie et de
la bonne gouvernance 143(*)». Depuis 2013, l'OSAA a continué
à mobiliser un soutien global afin de promouvoir la paix en Afrique, la
sécurité et le développement durable, en particulier, dans
le contexte de la mise en oeuvre de l'Agenda pour le développement
durable de 2030 et l'Agenda 2063 de l'UA et son premier plan décennal de
mise en oeuvre. L'OSAA lance également des séries de dialogues en
Afrique, afin de fournir une plate-forme pour explorer et promouvoir des
débats critiques au sujet de la paix, de la sécurité, des
droits de l'homme et des liens entre le développement et l'humanitaire
en Afrique144(*).
En 2018, l'OSAA a organisé deux réunions de
groupes d'experts sur la prévention des conflits, intitulées
« Améliorer l'efficacité de la diplomatie
préventive et de la médiation en Afrique » à
Durban, en Afrique du Sud en juillet et « Renforcer les
capacités de prévention des conflits dans les sous-régions
en Afrique » à Libreville, au Gabon, en novembre. Ces
réunions ont eu pour objectif de promouvoir le programme du
Secrétaire général des Nations-Unies sur la
prévention et de contribuer à la mise en oeuvre complète
de l'Architecture africaine de paix et de sécurité, dont
l'initiative de l'UA pour « Réduire les armes au silence d'ici
2020145(*) ».
La Commission de l'Union africaine (CUA) est devenue
coorganisatrice de la TICAD à partir de la TICAD V de 2013. C'est
à sa demande que la TICAD est devenue une conférence alternative.
Rappelons que la TICAD VI a été organisée au Kenya en
2016. Les activités de la Commission prennent en compte tous les
objectifs prioritaires de la TICAD. Par exemple, dans le cadre des initiatives
du Programme détaillé pour le développement de
l'agriculture africaine (PDDAA),la Commission de l'Union africaine, l'Agence de
planification et de coordination du NEPAD, et les communautés
économiques régionales ont soutenu les pays africains à
augmenter leurs investissements dans l'agriculture dans le but d'atteindre
l'objectif de 10 % des budgets nationaux et celui d'une croissance agricole de
6 %.Trente-cinq pays ont finalisé, inauguré ou mettent en oeuvre
leurs programmes nationaux d'investissement agricole. Ces programmes sont des
plans nationaux complets qui intègrent les interventions prioritaires
pour la mise en oeuvre par un ensemble représentatif d'acteurs au niveau
des pays. Seize des pays disposant d'un programme national d'investissement
agricole ont obtenu un financement du Programme mondial pour l'agriculture et
la sécurité alimentaire allant de 30 à 55 millions de
dollars pour combler les lacunes budgétaires nationales146(*).
II. Les principes
fondamentaux de la TICAD
La TICAD se caractérise ensuite par ses principes
fondamentaux qui en constitue ses philosophies de base.
II.1. L'appropriation
Selon le Petit robert, l'appropriation est l'action de
s'approprier une chose, d'en faire sa propriété. La
Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au
développement de 2005 définit l'appropriation comme un concept
dans lequel « les pays partenaires exercent une réelle
maîtrise sur leurs politiques et stratégies de
développement et assurent la coordination de l'action à l'appui
du développement ». Selon la Déclaration, les pays
partenaires doivent s'engager à:
ü s'investir du premier rôle dans
l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales
de développement, dans le cadre d'un vaste processus de consultation,
ü traduire ces stratégies nationales de
développement en programmes opérationnels axés sur les
résultats intégrant une hiérarchisation des
priorités, tels qu'exprimés dans les cadres de dépenses de
moyen terme et les budgets annuels,
ü assurer la conduite de la coordination de l'aide
à tous les niveaux et des autres ressources affectées au
développement, en consultation avec les donneurs et en encourageant la
participation de la société civile et du secteur privé.
Quant aux pays donateurs, ils doivent respecter le rôle
prédominant des pays partenaires et les aider à renforcer leur
capacité à exercer ce rôle147(*).
Depuis son lancement en 1993, la TICAD n'a cessé de
préconiser que l'appropriation par les pays africains de leur processus
de développement est indispensable au développement de l'Afrique.
La TICAD a contribué à vulgariser les notions d'«
appropriation » et d'«auto-assistance » en tant que facteurs
clés de développement. Ces deux concepts, auxquels la
société japonaise croît profondément en raison de
l'histoire de son propre développement, ont depuis longtemps
marqué les programmes d'aide du Japon148(*). Se penchant sur sa propre expérience en
matière de développement depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, le Japon, pays dépourvu de ressources naturelles, accorde une
grande importance aux ressources humaines. Par exemple, la précision, le
travail d'équipe et l'approche «Kaizen »(le processus de
travail continu des travailleurs sur site pour améliorer la
productivité) ont permis au Japon de créer des produits de haute
qualité149(*). Le
Japon est convaincu depuis longtemps que des ressources hautement
qualifiées sont la clé du développement et de la
diversité économique en Afrique. Pour le Japon, l'assistance
étrangère, sous forme de ressources financières et de
connaissances technologiques, ne sert qu'à stimuler ces forces,
là où c'est nécessaire. Le développement ne peut
donc être que le résultat des efforts des pays
bénéficiaires eux-mêmes. Les pays en développement
doivent gérer leurs économies avec pour principal objectif
d'atteindre l'autonomie le plus tôt possible150(*). C'est ce que souligne
Tsutomu Kimura, représentant de la JICA pour l'Afrique de
l'Ouest: « Nous ne souhaitons pas donner du poisson aux
Africains, nous préférons leur apprendre à
pêcher»151(*).
La TICAD a été un grand soutien au NEPAD.
L'idée même du NEPAD remonte à la TICAD I de 1993. La
Déclaration de Tokyo de la TICAD I recommandait que les pays africains
prennent l'initiative, en élaborant et en mettant en place leurs propres
stratégies de développement, avec le soutien de leurs partenaires
au développement. Le NEPAD a été créé en
2001 au sommet de l'OUA, en tant que vision unique pour l'avenir de l'Afrique.
La TICAD soutient pleinement le NEPAD et offre une tribune sans
précédent pour un dialogue de haut niveau et la recherche d'un
consensus, afin d'appuyer cet effort dirigé par les Africains
eux-mêmes152(*).
La TICAD III par exemple s'est engagé pleinement à créer
une synergie totale entre les travaux de la TICAD et les approches du NEPAD.
Cela a été matérialisé par l'adoption de Cadre
politique conjoint TICAD-NEPAD pour la promotion du commerce et de
l'investissement entre l'Afrique et l'Asie en 2004153(*).
II.2. Le partenariat
international
Le partenariat international promeut le dialogue entre les
pays africains et les partenaires au développement. Et la TICAD a
été convoquée en 1993 dans le but d'atteindre cet
objectif. Ce nouveau partenariat devrait être fondé sur l'objectif
de l'Afrique consistant à devenir autonome, d'une part, et à
apporter un soutien réactif aux partenaires de développement de
l'Afrique, d'autre part154(*). Selon le programme d'action de la TICAD II, le
développement de l'Afrique doit être poursuivi sur le principe du
partenariat mondial qui crée un cadre commun de coopération entre
tous les acteurs du développement y compris les gouvernements africains,
le secteur privé, la société civile et les partenaires de
développement comprenant des pays donateurs et les organisations
régionales et internationales155(*). Dans le cadre du partenariat international,
plusieurs projets sous l'égide de la TICAD, ont été mis en
oeuvre en Afrique.
Dans le domaine de la coopération triangulaire, la
TICAD sert de plate-forme pour promouvoir la coopération et la
collaboration entre les participants à la TICAD, en encourageant leurs
efforts conjoints en faveur du développement en Afrique.
En 2009, le Japon, le Mozambique et le Brésil ont
signé un accord sur le projet de développement agricole du
Couloir de Nakala, une région peu développée avec un fort
potentiel agricole. Le projet vise à contribuer à la
réduction de la pauvreté parmi les petits propriétaires
locaux, au développement de la sécurité alimentaire
nationale et à une croissance économique conduite par le
développement agricole dans cette région156(*).
De plus, le Japon et la France recherchent une
possibilité de coopération dans les domaines suivants :
développement durable, y compris en termes d'infrastructures de
qualité, de santé, de maladies infectieuses et de
sécurité. Il existe un autre effort de coordination entre le
Japon et l'Inde pour améliorer la connectivité en Afrique et dans
la région Asie-Pacifique.
Le processus de la TICAD a également souligné
l'importance de la coopération Sud-Sud, en particulier pour tirer parti
des expériences réussies des pays asiatiques en Afrique. La
conception japonaise de la coopération Asie-Afrique s'est ainsi
développée avec le processus de la TICAD. Désormais, la
coopération japonaise se traduit notamment en Afrique aussi par des
stages en faveur des pays tiers et des envois d'experts de pays tiers.
Singapour, l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines,
l'Inde et le Pakistan sont les principaux pays asiatiques qui accueillent des
stagiaires africains. En dehors de la coopération technique, le Japon a
également créé en 1999 un centre de promotion des
investissements et de la technologie Asie- Afrique (centre Hippalos, en
Malaisie) afin de stimuler des échanges commerciaux et des
investissements entre ces deux régions. Dans ce but, le Japon a
organisé à plusieurs reprises, avec différents
partenaires, des forums économiques Asie-Afrique157(*). En juin 2018, la JICA a
signé un mémorandum de coopération avec l'ONG indienne
Pratham Education Foundation et l'institut de recherche mondial Abdul Latif
Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), un laboratoire d'action contre la
pauvreté, afin d'améliorer les capacités de lecture et
d'écriture des enfants en Afrique, notamment au Niger et à
Madagascar158(*).
Le Japon et la Banque africaine de développement (BAD)
ont conjointement soutenu le développement du secteur privé
africain à travers le programme d'Assistance renforcée pour le
secteur privé en Afrique (EPSA), lancée en 2005. C'est un
programme qui vise à la mobilisation des ressources pour appuyer
l'implantation de la Stratégie du secteur privé de la BAD et son
implication dans des projets d'infrastructures tels que les routes, les chemins
de fer, l'aviation, les technologies de l'information et des communications
(TIC) et le développement urbain. Depuis 2005, le gouvernement du Japon
a versé plus de 3 milliards de dollars US au titre de l'initiative EPSA
pour l'Afrique. La troisième phase de l'initiative EPSA a
été annoncée lors de la TICAD VI avec un engagement
conjoint d'environ 3 milliards de dollars sur 3 ans (2017-2019)159(*).
II.3. Le mécanisme de
suivi de la TICAD.
Le mécanisme de suivi de la TICAD a été
établi en 2008, lors de la TICAD IV. Son objectif est de contribuer
à une mise en oeuvre régulière des initiatives
pertinentes, susciter un débat ouvert au sein des États
africains, des pays et des organisations concernées sur la
manière de promouvoir le concept et les principes du processus de la
TICAD et de ses résultats concrets et améliorer la transparence
et l'imputabilité des activités de la TICAD. Il comprend trois
organes160(*):
Le Secrétariat : il est
établi au sein du bureau des Affaires africaines du ministère des
Affaires étrangères (MOFA). Le Secrétariat collecte,
analyse des informations et conduit des activités de relations
publiques, en collaboration avec les agences gouvernementales concernées
pour ce qui est de l'état d'exécution des domaines prioritaires.
Son action est de transmettre des informations par le biais des sites web
(liens actifs avec le site web du PNUD) et mettre sur pied un service de
consultation de la TICAD qui favorise une interaction avec la
société civile.
Le Comité conjoint de surveillance de la
TICAD : Ces membres sont les États africains (membres du
Comité TICAD), le gouvernement japonais et les organisations
concernées, les coorganisateurs de la TICAD, les pays donateurs, les
organisations internationales. Son action vise à produire un rapport
annuel sur l'état d'avancement et à tenir une réunion en
principe une fois par an.
Les réunions de suivi de la
TICAD : Elles comprennent les participants à la TICAD, y
compris le gouvernement japonais, les coorganisateurs de la TICAD, les
États africains, les Communautés économiques
régionales, les pays donateurs et les organisations internationales etc.
Son action vise à tenir des réunions de suivi au niveau
ministériel en principe une fois par ans, de passer en revue et
d'évaluer les activités en cours de la TICAD en se fondant sur le
rapport annuel et donner des instructions, le cas échéant, pour
une accélération de la mise en oeuvre.
III. La TICAD par rapport
à d'autres forums de développement
Depuis les années 1970, les partenaires de
l'Afrique ont initié plusieurs forums en faveur du développement
africain. On peut citer: le forum France-Afrique lancé en 1973, le
sommet Afrique-Monde arabe (1977), la TICAD (1993), le sommet Chine-Afrique
(2000), le sommet Union européenne-Union africaine (2000), le sommet
Corée-Afrique (2006), le sommet Turquie-Afrique (2008), le forum
Inde-Afrique (2008), le forum Etats-Unis-Afrique (2014), le forum
Allemagne-Afrique (2015), le sommet Russie-Afrique (2019) et le sommet Arabie
Saoudite-Afrique (2019). Ne pouvant pas les énumérer tous, nous
allons mettre l'accent sur les forums organisés par les pays asiatiques,
surtout ceux de l'espace indo-pacifique. La TICAD a été le
précurseur qui a poussé les autres puissances asiatiques de cet
espace géographique à avoir un intérêt croissant en
Afrique. C'est l'exemple de la Chine, de la Corée et de l'Inde.
III.1. La Chine et le Forum sur
la coopération sino-africaine (FOCAC)
Pour renforcer davantage la coopération entre la Chine
et les pays africains, relever ensemble les défis de la mondialisation
économique et oeuvrer au développement commun, sur l'initiative
commune de la Chine et de l'Afrique, le Forum sur la coopération
sino-africaine (FOCAC) a été officiellement lancé suite
à la Conférence ministérielle de l'an 2000 qui s'est tenue
du 10 au 12 octobre 2000 à Beijing. L'objectif du FOCAC est d'engager
des consultations sur un pied d'égalité, approfondir la
connaissance mutuelle, élargir les consensus, renforcer l'amitié
et promouvoir la coopération161(*). Il se tient tous les trois ans. Les huit mesures
prononcées par la Chine lors du sommet de Beijing du Forum sur la
coopération sino-africaine de novembre 2006 s'articulent autour :
ü augmenter l'aide chinoise aux pays africains et la
doubler jusqu'en 2009 par rapport à 2006,
ü accorder des prêts à taux
préférentiel d'un montant de 3 milliards de dollars
américains et des crédits acheteurs à un taux
préférentiel d'un montant de 2 milliards de dollars aux pays
africains au cours des trois prochaines années,
ü créer un fonds de développement
sino-africain dont le capital s'élèvera progressivement à
5 milliards de dollars pour soutenir et encourager les entreprises chinoises
à investir en Afrique,
ü construire, à titre d'aide, le Centre de
conférence de l'Union africaine en signe de soutien aux pays africains
dans leurs efforts visant à accroître leur rôle à
travers une unité accrue et à accélérer le
processus de leur intégration,
ü annuler les dettes gouvernementales liées aux
prêts sans intérêt arrivées à
échéance à la fin 2005 pour les pays africains pauvres
très endettés et les pays les moins avancés ayant
établi des relations diplomatiques avec la Chine,
ü ouvrir davantage le marché chinois aux pays
africains et porter de 190 à plus de 440 le nombre des produits
exemptés de droits de douane en provenance des pays africains les moins
avancés et ayant des relations diplomatiques avec la Chine,
ü créer, au cours des trois prochaines
années, 3 à 5 zones de coopération économique et
commerciale dans des pays africains,
ü former, au cours des trois prochaines années,
15 000 personnes compétentes, toutes catégories confondues, pour
les pays africains ; envoyer en Afrique 100 experts agronomes chinois de haut
rang ; créer en Afrique, 10 centres de démonstration des
techniques agricoles ; y construire 30 hôpitaux et contribuer à la
lutte contre le paludisme à hauteur de 300 millions de yuans, notamment
pour la création de 30 centres de prévention et de traitement du
paludisme ; envoyer en Afrique, 300 jeunes volontaires chinois ; aider les
Africains à construire 100 écoles rurales et porter, avant 2009,
de 2 000 à 4 000 le nombre des bourses accordées chaque
année par le gouvernement chinois aux étudiants
africains162(*).
III.2. Le Forum
Corée-Afrique (KOAF)
En 2006, la Corée lança l'Initiative
coréenne pour le développement de l'Afrique. Le gouvernement
coréen promet alors d'accroître le montant de son aide à
l'Afrique de manière substantielle, de partager son expérience de
développement avec ses partenaires africains et de transférer des
technologies dans des domaines aussi divers que l'agriculture et les
technologies de l'information et de la communication. Dans le sillage de
l'Initiative pour le développement de l'Afrique, la Corée va
mettre en place un mécanisme destiné à encadrer et
institutionnaliser ses relations avec le continent africain. C'est le Forum
Corée-Afrique (KOAF). Le KOAF se tient tous les trois ans sous
l'égide du ministère des Affaires étrangères de la
Corée et vise à renforcer les partenariats et les
expériences de développement. Le premier forum qui s'est tenu
à Séoul en novembre 2006, a réuni 31 pays africains. A
compter du second forum, l'Union africaine est devenue co-organisatrice aux
côtés du ministère des Affaires étrangères de
la Corée. Deux autres forums suivront, à Séoul en 2012
puis en Afrique (Addis-Abeba) en 2016. Le KOAF est officiellement
présenté comme un instrument dans la compétition
avec la Chine et le Japon163(*).
La Corée a également lancé la
Conférence sur la coopération économique entre la
Corée et l'Afrique (KOAFEC) en 2006 en tant que plateforme majeure afin
de mener les initiatives coréennes pour le développement en
Afrique. Selon le Plan d'action du KOAFEC, la conférence vise à
produire des résultats concrets à travers les projets
d'investissement indicatifs dans les six domaines de coopération,
à savoir :
ü l'énergie et les infrastructures,
ü les Technologies de l'information et de la
communication(T.I.C),
ü le développement des ressources humaines,
ü le développement agricole et rural,
ü le changement climatique et
ü le partage des connaissances en matière de
développement en s'inspirant du cas de la Corée164(*).
III.3. L'Inde et le sommet du
Forum Inde-Afrique (I.A.F.S).
A la suite du Japon (1993), de la Chine (2000) et de la
Corée (2006), l'Inde va organiser son premier sommet du Forum
Inde-Afrique en 2008. L'Inde a peu de liens avec l'Afrique. Les liens se
limitent par ailleurs aux États de la façade Est (Kenya et
Tanzanie) et à l'Afrique australe (Afrique du Sud et Madagascar), soient
les territoires accueillant la diaspora indienne. Le Forum se tient tous les
trois ans. Lors du troisième Forum qui s'est tenu en 2015, 41 chefs
d'Etat africains ont participé à la conférence165(*). La conférence a
adopté le Cadre de coopération stratégique Inde-Afrique.
Selon le document, les grands axes de la coopération sont166(*):
ü la coopération dans le commerce et l'industrie,
ü la coopération dans l'agriculture,
ü la coopération en énergie propre,
ü la coopération en économie
bleue/océanique,
ü la coopération en infrastructure,
ü la coopération en éducation et
développement des compétences,
ü la coopération dans le domaine de la
santé,
ü la coopération en matière de paix et de
sécurité,
ü la coopération régionale et d'autres
formes de coopération.
En comparant, le contenu de ces quatre conférences
(TICAD, FOCAC, KOAF et IAFS), les sujets abordés portent largement sur
l'ensemble des sujets de préoccupation de l'Afrique. Mais seule la TICAD
affiche clairement comme objectif central la croissance économique et la
sécurité humaine. C'est également la seule
conférence qui prône les principes d'appropriation du
développement et de partenariat international.
En somme, le Japon est un miracle permanent. Vaincu et
humilié en 1945, le Japon deviendra en quelques années une
puissance économique majeure malgré les contraintes de son
territoire. Son modèle de développement a influencé les
autres pays de l'Asie du Sud-Est. Cependant, malgré sa puissance
économique, le Japon n'est pas devenu une puissance politique et
militaire importante à cause des restrictions de sa constitution. De
plus, depuis 1945, le Japon calque sa diplomatie sur celle des
États-Unis. Du coup, son rôle politique et diplomatique sur la
scène internationale reste très limité, ce qui contraint
le Japon à mettre l'accent sur une diplomatie basée sur
l'Aide publique au développement. L'APD est l'aspect le plus visible de
la politique étrangère du Japon. L'APD a joué un
rôle essentiel pour la diplomatie du Japon de l'après-guerre. Dans
les années 1990, le Japon lança la TICAD afin d'encourager la
communauté internationale à apporter davantage de soutien
à l'Afrique. Au fil des ans, la TICAD est passée d'un simple
soutien à la promotion d'un développement inclusif conforme aux
caractéristiques de chaque pays africain. Dans la partie suivante, il
est question de voir comment la TICAD a eu un impact sur le
développement socio-économique du Burkina Faso.
DEUXIEME PARTIE: LA COOPERATION BURKINA-JAPON APRES LA TICAD
I: 1993-2018
L'assistance du Japon à l'Afrique depuis l'organisation
de la TICAD en 1993 est peu abordée. Nous proposons dans cette partie
d'analyser l'orientation de la politique d'aide japonaise en Afrique
après la TICAD I en prenant l'exemple du Burkina Faso. Il s'agit de
montrer l'impact de la coopération japonaise au Burkina Faso, un pays
très essentiel au vu de sa situation géographique pour le
développement du corridor économique de l'Afrique occidentale.
L'objectif est de mettre en lumière les résultats de l'aide
bilatérale du Japon. Il en est de même des résultats de
l'aide dans les secteurs prioritaires. Le soutien du Japon se fait à
partir des programmes de développement initiés par le Burkina
Faso. Selon les différents programmes d'action de la TICAD, le Japon
apporte une assistance principalement dans les secteurs centrés sur la
personne humaine (l'éducation, la santé, l'eau) ainsi que les
secteurs centrés sur la croissance économique (aménagement
des infrastructures, énergie) à tous les pays de l'Afrique. Au
Burkina Faso, le Japon met davantage l'accent sur les secteurs centrés
sur la personne humaine. Cette partie est divisée en trois chapitres. Le
premier chapitre analyse l'orientation de l'assistance du Japon au Burkina
après la TICAD I. Le deuxième chapitre traite des axes
prioritaires de la coopération japonaise au Burkina Faso. Ces axes sont
l'éducation, l'agriculture et l'intégration régionale. Le
chapitre 3 résume les autres secteurs dans lesquels le Japon apporte une
assistance. Ces secteurs sont la santé, l'eau et l'assainissement et
l'environnement. La question du développement des ressources humaines et
le volet commercial sont également pris en compte.
Chapitre IV: L'orientation de l'assistance japonaise au
Burkina Faso après la TICAD I
Le Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'Ouest situé
à cheval entre les États du Sahel à l'intérieur du
sous-continent et les pays côtiers du golfe de Guinée. C'est un
pays qui occupe une place géostratégique importante du fait de sa
situation géographique. La politique étrangère du Burkina
Faso comporte deux axes principaux : la paix et le développement, afin
de donner une meilleure image du pays à l'extérieur. Comme toute
action internationale, celle du Burkina poursuit trois intérêts
capitaux : la sécurité du territoire, la prospérité
du pays et le rayonnement international de l'État167(*). Le Burkina Faso mène
également une politique étrangère afin de maintenir des
relations étroites avec les pays occidentaux de l'Europe. Il s'efforce
enfin de renforcer ses relations avec les Etats-Unis et les pays asiatiques.
En ce qui concerne les pays asiatiques, le Burkina Faso s'est
vite intéressé au Japon dès son accession à la
souveraineté internationale en 1960 du fait de sa puissance
économique. Il espérait, en établissant des relations
diplomatiques avec le Japon, bénéficier de son expertise et de
son assistance économique. Une représentation diplomatique a
été établie en 1962 à Tokyo. Mais à
l'époque l'assistance japonaise était très peu
considérable, du fait qu'il ne voyait pas encore l'importance d'une
réelle coopération politique et économique avec
l'Afrique168(*). Il faut
attendre les années 1990 pour voir un intérêt croissant du
Japon à l'égard du continent africain matérialisé
par l'organisation de la TICAD en 1993. Depuis cette période, la
coopération entre le Burkina Faso et le Japon s'est
considérablement renforcée et le Japon est l'un des partenaires
privilégiés du Burkina Faso.
I. Les facteurs explicatifs
de la coopération japonaise au Burkina Faso
Depuis l'organisation de la TICAD en 1993, la
coopération entre les deux pays s'est profondément accrue.
Plusieurs raisons expliquent l'importance de cette coopération. Elles
sont d'ordres politiques, diplomatiques et socio-économiques.
I.1. Les facteurs politiques et
sécuritaires.
La démocratie, la liberté, l'état de
droit et la bonne gouvernance sont des valeurs partagées entre les deux
pays. Le Japon soutient la bonne gouvernance politique au Burkina
Faso169(*) en
encourageant le peuple burkinabè dans sa quête de
démocratie et de bonne gouvernance qui sont également des valeurs
auxquelles le Pays du Soleil Levant est attaché170(*).
Contribuer à des élections réussies est
pour le Japon une occasion de renforcer la démocratie et la
légitimité des dirigeants du Pays des hommes intègres. En
2015, le Japon a débloqué près de 500 millions de Francs
CFA pour soutenir la démocratie et le développement au Burkina
Faso. L'objectif du Japon était de contribuer à des
élections libres suite à l'insurrection de 2014. Le Japon a
également mis à la disposition de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI), une somme de cinq cent millions de FCFA
pour le renforcement de ses capacités logistiques. Pour les
autorités japonaises, cette initiative traduit la bonne volonté
du peuple nippon de se tenir aux côtés (en tant qu'ami) du peuple
burkinabè prêt à assumer pleinement son destin et à
écrire une nouvelle page de son histoire après l'insurrection
populaire d'octobre 2014171(*).
Le Japon a également condamné les
différentes attaques terroristes qui se sont perpétrées au
Burkina Faso. Dans une déclaration du 3 mars 2018, le gouvernement
japonais a condamné fermement les attaques terroristes
perpétrées la veille. Selon la déclaration, aucun acte
terroriste n'est justifiable avec aucune raison. Le gouvernement japonais
condamne fermement toutes les formes de terrorisme. De plus, poursuit la
déclaration, le gouvernement japonais est déterminé
à continuer d'appuyer les efforts du gouvernement burkinabè
visant à améliorer la sécurité au Burkina Faso, en
coopérant avec la communauté internationale172(*). Pour le Japon, en tenant
compte des éléments instables de la sous-région, la
stabilité du Burkina est indispensable pour celle de l'ensemble de la
région173(*).
Pour distordre un peu notre borne chronologique, en 2019, le Japon a
accordé au Burkina Faso un don d'équipements sécuritaires
d'une valeur d'environ 3250000000 de FCFA pour l'acquisition de 96
véhicules pick-up, 244 motos et 105 lampes projecteurs portables pour
renforcer le système sécuritaire du Burkina Faso174(*).
I.2. Les enjeux
diplomatiques
La reconnaissance internationale du Burkina Faso par le Japon
date de 1960. En 1962, le Burkina Faso a établi une
représentation diplomatique à Tokyo aussitôt fermée
en 1966 pour des raisons budgétaires. Depuis cette date jusqu'au milieu
des années 1990, malgré la signature de quelques traités
bilatéraux, les relations entre les deux pays ont pris un
caractère beaucoup plus symbolique que pratique. En effet, les deux pays
n'ont pas procédé à des échanges de
représentations résidentes. Les intérêts du Burkina
Faso au Japon ont été gérés par son ambassadeur
résident en Chine175(*). Pour ce qui est du Japon, ses
intérêts au Burkina Faso étaient gérés par
son ambassadeur en Côte d'Ivoire176(*). Ce n'est qu'en 1979 que la Haute-Volta et le Japon
ont décidé d'établir des rapports de coopération
bilatérale à la suite d'un certain nombre d'échanges de
notes qui en situent les domaines d'actions effectives : le domaine
médical et le domaine alimentaire177(*).
A partir des années 1990 avec la TICAD, les relations
entre les deux pays se sont considérablement renforcées avec la
réouverture de l'Ambassade du Burkina Faso au Japon en 1994 et le
début des échanges de visites entre les dirigeants des deux pays.
Par ailleurs, le Burkina Faso soutient la position fondamentale du Japon sur la
scène internationale. Le Burkina Faso soutient la candidature du Japon
à un siège permanent au Conseil de sécurité et au
sein des organisations internationales du Système des
Nations-Unies178(*). En
2018, lors du sommet Japon- Burkina Faso, les dirigeants des deux pays ont
réaffirmé leur position commune et leur coopération en vue
du lancement rapide de négociations sur la réforme du Conseil de
sécurité fondée sur un texte179(*). Le Burkina Faso soutient
également l'approche japonaise des questions de politiques
internationales axées sur la consolidation de la paix et la
sécurité internationale à travers la TICAD. Il soutient
également les diverses initiatives du gouvernement japonais notamment
« l'initiative BEGIN ; l'initiative « Cool Earth
50 » et l'initiative japonaise au sein du G8
« Solidarité entre le Japon et l'Afrique : action
concrètes 180(*)». Le Burkina Faso et le Japon coopèrent
pour la stabilité et la paix dans le monde181(*).
Quant au Japon, il soutient les efforts du Burkina Faso en vue
de la consolidation de la paix en Afrique et ailleurs dans le monde. Pour le
Japon, la stabilité du Burkina Faso est essentielle et indispensable
pour celle de l'ensemble de la région ouest africaine au vue des
phénomènes comme le terrorisme qui menace la région du
Sahel. Stratégiquement bien placé sur le plan
géopolitique, le Burkina Faso constitue également un pont entre
les pays du Sahel à l'intérieur du sous-continent et les pays du
Golfe de Guinée car il joue un rôle essentiel dans
l'intégration économique et douanière
sous-régionale182(*). Comme nous l'avons vu ci-haut, les relations
diplomatiques entre le Burkina Faso et le Japon datent de 1962. Depuis les
années 1990, elles sont excellentes et fructueuses. Malgré tout,
il faut attendre 2007 pour voir la première consultation
bilatérale entre les deux pays. Ces consultations bilatérales se
sont tenues à Tokyo du 11 au 13 juillet 2007183(*). Le Burkina est le premier
pays d'Afrique francophone et le troisième après l'Afrique du Sud
et le Nigeria à tenir des consultations bilatérales avec le
Japon184(*). Cette
rencontre a permis aux deux parties de passer en revue les différents
aspects de la coopération existante et d'entrevoir la possibilité
de son élargissement185(*).
En 2009, le Japon a ouvert une Ambassade résidente au
Burkina. Depuis cette date, la coopération bilatérale entre les
deux pays s'est davantage renforcée par la signature de nombreux
échanges de notes relatifs au financement de projets dans divers
domaines. Il s'agit notamment des secteurs de l'agriculture, de
l'éducation, de la santé, de l'environnement, de la
coopération décentralisée, du développement des
infrastructures, du commerce, de la coopération technique, du secteur de
l'eau et de l'assainissement. En marge de la TICAD, le Burkina Faso et le Japon
tiennent également des réunions bilatérales
Tableau 1: Visites des Hommes
d'Etat du Burkina Faso au Japon depuis 1993.
|
Années
|
Noms
|
|
Octobre 1993
|
Président Blaise Compaoré (TICAD I)
|
|
Décembre 1995
|
Président Blaise Compaoré (visite officielle)
|
|
Octobre 1998
|
Président Blaise Compaoré, (TICAD II)
|
|
Décembre 2000
|
Ministre des Affaires étrangères Youssouf
Ouédraogo
|
|
Septembre 2003
|
Président Blaise Compaoré (TICAD III)
|
|
Juin 2005
|
Ministre des Affaires étrangères Youssouf
Ouédraogo
|
|
Août 2008
|
Président Blaise Compaoré (TICAD IV)
|
|
Août 2012
|
Ministre des Affaires étrangères et de la
coopération régionale, Djibril Bassolé
|
|
Juin 2013
|
Président Blaise Compaoré (TICAD V)
|
|
Février 2014
|
Ministre de l'éducation de base et de
l'alphabétisation, Koumba Barry
|
|
Mars 2015
|
Ministre de l'agriculture, des ressources en eau, de
l'assainissement et de la sécurité alimentaire François
Lompo
Ministre de l'action sociale et de la solidarité
nationale Nicole Angéline Zan Yelemu
|
|
Octobre 2015
|
Ministre de la recherche scientifique et de l'innovation
Jean-Noël Pooda
Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
Hyppolite Dah
|
|
Février 2017
|
Ministre de l'administration territoriale, de la
décentralisation et de la sécurité intérieure Simon
Compaoré
|
|
Novembre 2018
|
Président Roch Marc Christian Kaboré (visite
officielle)
|
Source : Elaboré par nous-mêmes
Dans son intervention à la tribune de la TICAD IV en
2008, le Président Blaise Compaoré s'est réjoui du bon
niveau de la coopération entre le Burkina Faso et le Japon. Il a
souligné que le Burkina Faso a toujours bénéficié
de l'appui multiforme du Japon dans son processus de développement et
s'est félicité de l'ouverture très prochaine à
Ouagadougou d'une Ambassade résidente du Japon qui vient confirmer la
vitalité et l'exemplarité de la coopération entre les deux
pays186(*).
Tableau 2: Visites des Hommes
d'Etat du Japon au Burkina Faso depuis les années 2000
|
Années
|
Noms
|
|
Janvier 2004
|
Vice-ministre des Affaires étrangères Akihito
Tanaka
|
|
Décembre 2007
|
Vice-ministre des Affaires étrangères Osamu
Uno
|
|
Août 2013
|
Vice-ministre parlementaire des affaires
étrangères Toshito Abé
|
|
Juin 2014
|
Vice-ministre parlementaire des affaires
étrangères Hirotaka Ishihara
|
Source : Elaboré par nous-mêmes
Au cours de son séjour au Burkina Faso en 2013, Madame
Abe Toshito a visité l'école des eaux et forêts de
Bobo-Dioulasso et les réalisations agricoles. A cet effet, elle a
reconnu les énormes potentialités du Burkina Faso et s'est
engagée aux côtés des Burkinabè qu'elle a
qualifiés de « sérieux et travailleurs »
à travailler ensemble pour développer le secteur
agricole.187(*)
En octobre 2017, le nombre de ressortissants japonais
résidant au Burkina Faso était de 92. En juin 2018, 68
ressortissants burkinabè vivaient au Japon188(*).
I.3. Les aspects socio-
économiques
Ils sont nombreux :
Sur le plan commercial, le Burkina Faso et le Japon ont de
bonnes relations. En matière d'exportation des biens et services, le
Burkina Faso est un grand exportateur de sésame au Japon189(*). En 2017, par exemple, la
part du sésame dans les exportations totales du Burkina Faso vers le
Japon était de 99, 4 %190(*). En sens inverse, les sociétés
japonaises voient le Burkina Faso comme un marché prometteur pour
l'exportation des produits de marque japonaise comme Toyota, Suzuki, Yamaha,
etc. Les sociétés japonaises manifestent un intérêt
au Burkina en tant que pays fournisseurs de matières premières.
Ces sociétés s'intéressent notamment aux gisements de
manganèse191(*).
Cependant, le Burkina Faso reste l'un des pays les plus
pauvres de la planète. Selon la Banque mondiale, en 2016, le pays se
situait au 144e rang sur 157 dans l'indice du capital humain qu'elle
a établi192(*).
Plus de 40 % de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ces
raisons justifient la nécessité d'accompagner les efforts du
Burkina Faso pour le mieux-être social, la croissance économique,
la stabilité et la paix193(*). Pour le Japon, accordé l'aide au Burkina
Faso est d'une grande utilité pour le soutien de la croissance stable du
Burkina Faso et le renforcement des relations bilatérales avec le Japon.
Comme nous l'avons vu dans la première partie, la réduction de la
pauvreté par la croissance économique est l'un des enjeux
prioritaires de la politique d'aide japonaise en Afrique. C'est pourquoi l'aide
japonaise doit être au service de la réduction de la
pauvreté au Burkina en ciblant des secteurs clés comme le
développement des infrastructures de grande étendue, l'appui
à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, la
promotion du commerce et de l'investissement, le développement des
communautés rurales, l'éducation et la formation des ressources
humaines, la santé et les soins médicaux, l'eau et
l'assainissement. Comme dans les autres pays d'Afrique, le Japon insiste
toujours sur l'importance d'une « appropriation » par le
Burkina Faso de son processus de développement. Autrement dit, le Japon
respecte l'initiative de ses partenaires en matière de
coopération et tient compte de leurs propres efforts pour la mise en
oeuvre de leurs projets. C'est pourquoi, le Japon appuie le Burkina Faso
à travers ses programmes nationaux de développement : Cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui a fait place
en 2011 à la Stratégie de croissance
accélérée et de développement durable (SCADD), qui
elle-même a été remplacée en 2016 par le Programme
national de développement économique et social (PNDES). Les
grandes lignes de la politique d'aide japonaise en Afrique sont basées
également sur les agendas de la TICAD, autrement dit, la
coopération nippo-africaine s'appuie sur les conclusions de la TICAD.
II. L'évolution de
l'aide japonaise au Burkina Faso de 1993 à 2018
Il s'agit de faire une analyse de l'aide bilatérale et
multilatérale du Japon au Burkina Faso.
II.1. Les catégories
d'aides japonaises au Burkina Faso
Dans la première partie, nous avons vu que l'aide
publique japonaise comprend l'aide bilatérale et l'aide
multilatérale (contributions financières à des
organisations internationales). Les dons bilatéraux comprennent la
coopération technique sous forme de transfert de technologies à
des pays en développement et la coopération financière non
remboursable sous forme de subventions. C'est dans le cadre de la
coopération technique qu'intervient la JICA. La JICA exécute les
différentes modalités de la coopération japonaise au
Burkina Faso194(*) :
ü L'envoi de volontaires dans les différents
secteurs de développement des pays hôtes. Le Burkina Faso
accueille depuis 2000 des volontaires japonais travaillant dans les
différentes provinces. On peut également citer le programme des
stages.
ü La mise en oeuvre et le suivi des projets
appuyés par le gouvernement japonais. Les domaines prioritaires
d'intervention de la JICA au Burkina Faso sont l'éducation de base,
l'agriculture, l'environnement, la santé, l'eau potable et
l'assainissement.
L'aide japonaise au Burkina Faso est donc multiforme. Les
projets du gouvernement japonais au Burkina Faso sont classés par types
sous plusieurs étiquettes195(*):
ü Projet de coopération technique (PCT),
ü Projet d'aide subventionnée (GP),
ü Etude de développement (DS),
ü Projet d'envoi spécialisé (SDP),
ü Equipement médical spécial (PME),
ü Aide alimentaire (KR).
La JICA apporte son appui aux ONG japonaises qui interviennent
au Burkina Faso. Les différentes ONG japonaises intervenant par exemple
au Burkina Faso sont Action for Greening Sahel (AGS), Hunger Free World,
l'Association Japan Green Cross, etc. Ces ONG interviennent dans la
coopération décentralisée196(*).
On peut également noter les fonds de
contrepartie. C'est une coopération financière
non-remboursable qui a pour but d'apporter rapidement un soutien aux efforts
pour la réforme structurelle économique des pays en
développement. Cette aide n'est pas liée à un projet
déterminé comme la construction d'une école. Le fonds de
contrepartie est constitué par le pays en développement
bénéficiaire en monnaie locale équivalent à un
certain montant de la valeur de l'équipement fourni dans le cadre de la
coopération financière. Ce fonds doit être utilisé
en accord avec le gouvernement japonais pour le développement
économique et social du pays bénéficiaire197(*).
Le Japon a enfin mis en place « les dons aux
micro-projets locaux contribuant à la sécurité
humaine ». C'est un cadre de financement qui fournit un
soutien aux organisations non-lucratives qui travaillent pour améliorer
les conditions de vie de base dans les pays en développement198(*). Mis en place au Burkina
Faso depuis 1989, cette aide financière est octroyée dans le but
de contribuer à la réalisation des projets élaborés
par des structures communautaires en faveur des populations
défavorisées ou vulnérables. Son objectif principal est
d'améliorer la sécurité humaine des populations cibles.
Les domaines d'intervention de ce Programme d'aide sont l'éducation, la
santé, l'eau et l'assainissement. Les structures éligibles sont
les associations à but non lucratif, les ONG et les collectivités
locales. Le montant maximum pour le financement d'un projet est de 50 millions
de F CFA et couvre seulement les frais liés à l'exécution
du projet soumis199(*).
II.2. L'aide bilatérale
japonaise
L'aide japonaise à l'Afrique a principalement
progressé à travers la promotion du processus de la TICAD. Le
premier indicateur de l'impact de la TICAD, le plus simple et en même
temps très représentatif de ce qu'est ce processus, reste
l'évolution de la part de l'Afrique dans l'APD japonaise200(*). L'aide bilatérale du
Japon au Burkina Faso se fait à travers la coopération
financière non remboursable et la coopération technique.
Tableau 3: Évolution de
l'aide bilatérale japonaise au Burkina Faso de 1994 à 2018
(valeur en millions de dollars)
|
Années
|
Subvention
|
Coopération technique
|
Total
|
|
1994
|
10,36
|
1,46
|
11,82
|
|
1995
|
5,6
|
1,06
|
6,66
|
|
1996
|
13,94
|
0,90
|
14,85
|
|
1997
|
7,17
|
1,07
|
8,24
|
|
1998
|
7,25
|
1,6
|
8,85
|
|
1999
|
24,37
|
3,14
|
28,18
|
|
2000
|
16,75
|
4,50
|
21,25
|
|
2001
|
16,56
|
3,89
|
20,44
|
|
2002
|
4,71
|
5,31
|
10,02
|
|
2003
|
3,90
|
6,69
|
10,58
|
|
2004
|
3,32
|
5,17
|
8,49
|
|
2005
|
12,85
|
6,03
|
18,88
|
|
2006
|
11,62
|
6,85
|
18,47
|
|
2007
|
14,70
|
5,73
|
20,43
|
|
2008
|
11,39
|
9,58
|
20,97
|
|
2009
|
37,84
|
11,93
|
49,77
|
|
2010
|
25,47
|
16,11
|
41,59
|
|
2011
|
24,08
|
16,22
|
40,30
|
|
2012
|
40,61
|
15,75
|
56,36
|
|
2013
|
15,3
|
10,75
|
26,06
|
|
2014
|
12,62
|
10,92
|
23,55
|
|
2015
|
15,05
|
8,51
|
23,56
|
|
2016
|
20,44
|
9,80
|
30,25
|
|
2017
|
8,87
|
10,50
|
19,37
|
|
2018
|
9,48
|
6,34
|
15,82
|
|
TOTAL
|
374,25
|
179,81
|
544,74
|
Source: Elaboré par nous-mêmes à
partir des données des Livres blancs de l'APD Japonaise.
Figure 1: Histogramme de
l'aide bilatérale japonaise au Burkina Faso
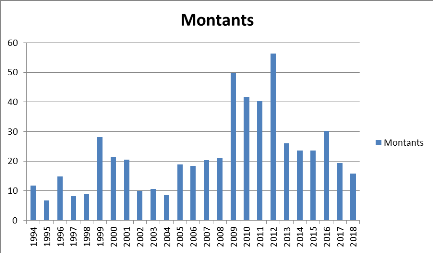
Propre construction à
partir des données du tableau
Dans sa politique de coopération bilatérale avec
le Burkina Faso, le Japon se positionne comme un véritable donateur.
D'ailleurs selon Salif Sankara, depuis 1979, le Japon a décidé
que ses interventions en faveur du Burkina Faso se feront essentiellement sous
forme de dons ; et jusqu'à nos jours, l'essentiel de la
coopération japonaise obéit à cette directive201(*). Le Japon accorde donc des
dons bilatéraux sous forme de coopération technique et des dons
non remboursables. Entre 1994 et 2018, la coopération financière
non remboursable du Japon au Burkina Faso était de 374 250 000
dollars soit environ 217 065 000 000 FCFA202(*). Cette manne
financière a permis le financement de plusieurs projets de
développement au Burkina Faso notamment dans les secteurs de
l'éducation, de la santé, de l'eau et assainissement et d'autres
projets de développement. Quant à la coopération
technique, les subventions du Japon entre 1994 et 2018 étaient de
179 810 000 dollars soit environ 104 289 800 000 FCFA. Elle
a servi à l'envoi d'experts japonais au Burkina Faso, à la
formation des cadres burkinabè au Japon et dans d'autres pays
asiatiques, aux projets de coopération technique et d'études de
développement au Burkina Faso. L'ensemble des subventions du Japon pour
la période 1994-2018 est de 544 740 000 dollars soit environ
321 354 800 000 FCFA. Le graphique nous permet d'identifier
plusieurs phases dans la coopération japonaise au Burkina Faso depuis
1994. Entre 1994 et 1998, c'est-à-dire la période couvrant la
TICAD I, le volume d'aide japonaise est resté très faible. De
11 820 000 dollars en 1994, il a même chuté en 1998 passant
à 8850000 dollars. Durant cette période, les subventions
accordées par le Japon à titre de dons non remboursables sont
relativement conséquentes avec un montant total de 44320000 de dollars.
Mais les montants de la coopération technique sont restés faibles
6090000 dollars ce qui n'a pas permis à l'aide d'évoluer. Pendant
la période qui a couvert la TICAD II, c'est-à-dire entre 1998 et
2003, le volume d'aide japonaise a dans un premier temps augmenté. Entre
1999 et 2001, le volume d'aide a dépassé les 20 millions de
dollars par an. Cette croissance est due à l'augmentation des montants
de la coopération technique. Entre ces trois années, 11530000
dollars ont été décaissés alors qu'ils
n'étaient que de 6090000 dollars. Ensuite entre 2002 et 2003 et
même jusqu'en 2004, l'assistance s'est effondrée de façon
vertigineuse. Les montants de la coopération technique continuent
d'augmenter mais les montants des dons non remboursables ont drastiquement
chuté passant de 16,56 millions de dollars en 2001 à 3,32
millions de dollars en 2004. Cette situation est, sans doute, due à la
diminution du budget de l'aide japonaise dans sa globalité causée
par la situation économique et budgétaire difficile que le pays a
connue pendant les années 1990. Durant la période de la TICAD
III, c'est-à-dire entre 2004 et 2008, on observe une évolution
constante de l'aide japonaise qui est passée de 8,49 millions de dollars
à 20,97 millions de dollars. L'aide japonaise a plus que doublé.
On peut donc conclure que le Burkina Faso a largement
bénéficié des engagements pris par le Japon à
propos de son APD en Afrique lors du sommet du G8 de Gleaneagles en 2005. En
rappel, dans un discours adressé aux Etats africains, le premier
ministre japonais Junichiro Koizumi a souligné que son pays s'engage
à doubler en trois ans l'aide accordée à
l'Afrique203(*). Entre
2008 et 2012, on observe une augmentation vertigineuse de l'aide japonaise qui
est passée de 20,97 millions de dollars en 2008 à 56,36 millions
de dollars en 2012. L'aide japonaise a presque triplé. Cette
période couvre la TICAD IV dans lequel le Japon s'était
engagé à doubler son APD à l'Afrique. Entre 2013 et 2018,
c'est-à-dire la période couvrant la TICAD V et VI, l'aide
japonaise a relativement chuté mais reste toujours dynamique. L'aide
japonaise permet le financement des projets de développement au Burkina
Faso. Ces projets de développements prennent en compte les secteurs de
l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de l'eau, de
l'environnement, etc.
II.3. L'aide japonaise
accordée aux organisations multilatérales
Le Japon soutient les efforts déployés par la
communauté internationale pour aider les populations
défavorisées du Burkina Faso. Le Japon apporte un soutien
financier aux organisations du système des Nations-Unies intervenant au
Burkina Faso.
Le gouvernement du Japon a octroyé en 2008, par
l'intermédiaire de la FAO, une aide financière d'un montant total
de 150 millions de yens, soit environ 841 500 000 FCFA, à
titre d'aide aux agriculteurs défavorisés du Burkina Faso
à travers le « Projet pour l'agriculture et le
développement rural par le biais de systèmes de production de riz
innovants pour la sécurité alimentaire et la réduction de
la pauvreté au Burkina Faso ». En effet, pour
améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des
agriculteurs, la FAO a formulé le projet « Systèmes de
production agricole à base de riz innovants » au Burkina Faso.
L'aide devrait contribuer à la sécurité alimentaire et
à l'augmentation des revenus d'environ 4 000 ménages pauvres dans
les villages ruraux, ainsi qu'à la gestion de la qualité des
semences, du système de production basé sur la riziculture, et
à l'amélioration de la capacité des agriculteurs à
coordonner la pisciculture en utilisant efficacement la riziculture et les
rizières204(*).
De même en 2008, le gouvernement japonais et les
Nations-Unies ont signé le projet d'assistance du Fonds d'affectation
spéciale des Nations-Unies pour la sécurité humaine d'un
montant de 185,92 millions de yens, soit environ 1 043 011 200
FCFA, pour financer le projet « Eliminer le mariage des enfants au
Burkina Faso : un plan pour la protection, l'autonomisation et l'action
communautaire ». Le projet a été mis en oeuvre par le Fonds
des Nations-Unies pour la population (FNUAP) et l'UNICEF. Ce projet vise
à protéger et à responsabiliser les femmes mariées
et les adolescentes risquant de se marier dans 24 localités de 5
provinces du Burkina Faso. L'objectif final était d'améliorer les
conditions de vie des femmes et des adolescentes au Burkina Faso et contribuer
à la réalisation de la sécurité humaine205(*).
A travers le PNUD, le Japon a financé le
« projet d'appui à la consolidation de l'état de droit
et à l'accès de la population pauvre à la
justice » d'un montant de 283 millions de Yens soit environ 1,5
milliards de FCFA en 2012. C'est un don qui est octroyé dans le cadre de
la mise en oeuvre du Programme de renforcement de la gouvernance au Burkina
Faso qui a été conduit par le ministère de la
Justice206(*). Le Japon
a également octroyé des dons au HCR et à l'UNICEF d'un
montant total de près de 4 milliards de FCFA pour exprimer sa
solidarité envers les réfugiés maliens en 2013.Dans le but
de renforcer la résilience des ménages vulnérables
à l'insécurité alimentaire au Burkina Faso, le Japon
octroya un montant de 300 millions de Yens soit environ 1,38 milliards de FCFA
par le biais du PAM en 2017. Le Japon apporte également son appui
financier à l'Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime
(ONUDI). Le Japon contribue à sa manière à la lutte contre
la criminalité transnationale organisée, y compris le terrorisme
et le trafic illicite des armes à feu, à la consolidation de la
paix et la stabilité dans la sous-région. C'est pourquoi, le
Japon accorde des dons pour appuyer l'initiative de l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM) afin de renforcer la
sécurité des frontières dans le Sahel207(*). En 2018, le Japon a
octroyé 1,55 milliards de Francs CFA à l'Union africaine
(Commission de l'UA, coorganisateur de la TICAD) pour le développement
des hôpitaux de niveaux 2 au Nord du Burkina Faso. Une aide de 570
millions de FCFA a été offerte à l'UNICEF dans le projet
d'intervention d'urgence de la résilience des communautés
affectées par les conflits dans la région du Sahel. Il en est de
même du PAM qui a reçu 1,15 milliards de FCFA pour le projet
d'amélioration de la sécurité alimentaire des groupes
vulnérables dans le contexte complexe des crises et des chocs208(*).
Tableau 4: Evolution de l'aide
multilatérale japonaise au Burkina Faso de 2008 à 2017 (valeur
en millions de dollars)
|
Années
|
Montants
|
|
2008
|
3,95
|
|
2009
|
1,00
|
|
2010
|
2,35
|
|
2011
|
0,82
|
|
2012
|
Données indisponibles
|
|
2013
|
10,70
|
|
2014
|
6,00
|
|
2015
|
5,00
|
|
2016
|
2,50
|
|
2017
|
4,20
|
|
2018
|
1,00
|
|
Total
|
37,52
|
Sources : Elaboré par nous-mêmes
à partir des données des Livres blancs de l'APD
Japonaise
Après la TICAD I, la coopération entre le Japon
et le Burkina Faso est restée dynamique. L'assistance japonaise continue
de se renforcer. L'aide japonaise au Burkina Faso se concentre davantage sur le
développement humain avec des secteurs comme l'éducation,
l'agriculture. Dans le prochain chapitre, nous analysons les bases de la
coopération japonaise dans ces secteurs prioritaires.
Chapitre V: Les secteurs clés de la coopération
japonaise au Burkina Faso
Après la TICAD I, la coopération entre le
Burkina Faso et le Japon a pris un tournant beaucoup plus dynamique. Selon le
rapport 2018 de l'Ambassade du Japon au Burkina Faso, le Japon intervient dans
trois domaines prioritaires. Ces domaines sont: l'éducation,
l'agriculture et l'intégration sous-régionale209(*). C'est le 30 mai 2012 que
l'ambassadeur du Japon à Ouagadougou présenta cette nouvelle
politique avec l'orientation vers les secteurs cités ci-haut210(*). L'objectif de ce chapitre
est d'analyser l'efficacité de la coopération japonaise à
travers ces différents secteurs prioritaires. Il examine dans un premier
temps le secteur éducatif, ensuite, le second point analyse le secteur
agricole et le dernier point traite du développement des infrastructures
de haute qualité permettant l'intégration économique
sous-régionale.
I. L'éducation
Il s'agit d'analyser les raisons de la coopération
japonaise dans le domaine de l'éducation, les modalités
d'intervention et quelques acquis de la coopération japonaise dans ce
domaine.
I.1. L'éducation comme
clé de développement
Depuis qu'il s'est engagé sur la voie de l'aide au
développement en Afrique, le Japon a fait du secteur de
l'éducation et de la formation des ressources humaines l'un de ses
principaux vecteurs de coopération avec le continent211(*). Pour le Japon, la
croissance démographique rapide des pays d'Afrique subsaharienne
nécessite une augmentation du nombre de salles de classe, en particulier
pour les écoles primaires. Le Japon estime également que c'est
l'engagement à long terme et les investissements dans l'éducation
et le développement des ressources humaines qui ont contribué
à sa reconstruction d'après-guerre ainsi qu'au
développement des autres pays asiatiques. S'appuyant sur cette
idée, le Japon encourage avec cohérence l'éducation
primaire universelle, une éducation de qualité et
l'égalité des sexes212(*).
Dans le but d'accompagner le Burkina Faso dans son
développement socio-économique, le Japon axe son principe d'aide
sur l'accélération de la croissance et le renforcement du capital
humain. Pour le Japon, la consolidation du capital humain nécessite une
amélioration de la qualité de l'éducation (infrastructures
éducatives, contenus d'enseignement et d''apprentissage,
capacités des enseignants...)213(*). Depuis 1995, le Burkina Faso
bénéficie d'un appui global sous la forme d'une aide
financière non remboursable destiné à la
réalisation d'infrastructures scolaires avec équipement et points
d'eau potable214(*). Le
Japon soutient le Burkina Faso à travers ses programmes de
développement comme le Programme décennal de développement
d'éducation de base (PDDEB 2001-2010) qui a fait place au Programme de
développement stratégique de l'éducation de base (PDSEB
2012-2021)215(*). Dans
le PDSEB 2012-2021, par exemple, un accent particulier a été mis
sur l'amélioration de l'offre et de la qualité de
l'éducation de base à travers plusieurs mesures dont la
réalisation d'infrastructures éducatives, la réforme du
système éducatif, le renforcement des capacités des
acteurs etc.216(*) Les
interventions de la JICA dans le secteur de l'éducation s'appuient sur
le PDSEB et sont mises en oeuvre à travers le Programme d'appui aux
élèves et enseignants de l'éducation de base (Basic
Education Students and Teachers (BEST))217(*).
I.2. Les acquis de la
coopération japonaise dans le domaine de l'éducation
Sur la période de 1995 à 2015, le Japon a
réalisé cinq (05) phases de Projet de construction et
d'équipement de salles de classe dans les écoles primaires au
Burkina Faso. Ce qui a permis la réalisation et l'équipement de
près d'un millier de salles de classes218(*).
Tableau 5: Les
différentes phases de construction des écoles
primaires
|
Phases
|
Années
|
Montants en millions de yens
|
Montants en milliards de FCFA
|
|
Phase I
|
1995
|
625
|
3 331 250 000
|
|
Phase II
|
1997-1998
|
2 180
|
10 573 000 000
|
|
Phase III
|
2005-2006
|
1 732
|
8 660 000 000
|
|
Phase IV
|
2009
|
998
|
4 790 400 000
|
|
Phase V
|
2012
|
1 138
|
7 000 000 000
|
|
Total
|
|
6 673
|
34 354 650 000
|
Source: Elaboré par nous-mêmes à
partir des échanges de note
· Projet de construction d'écoles primaires
phase I (1995)
Après la TICAD I, le Burkina Faso a
considéré l'extension de l'enseignement de base comme la question
la plus importante pour le pays. Pour ce faire, le pays a fait de la
construction de salles de classes primaires, une question urgente pour le
développement de l'enseignement. Le gouvernement japonais en vue de
l'accompagner dans ses efforts a réalisé un projet de
construction d'écoles primaires dans le cadre d'une coopération
financière non remboursable d'un montant de 625 millions de yens soit
environ 3 331 250 000 de FCFA pour soutenir le développement de
l'enseignement de base. Ce projet qui a pris fin en mars 1997 a permis la
construction de 79 salles de classes de 31 écoles219(*) dans 5 provinces du
pays220(*) : Bazega (4
écoles), Ganzourgou (5 écoles), Mouhoun (6 écoles),
Oubritenga (6 écoles) et Sissili (10)221(*).
· Projet phase II (1997-1998)
A la suite du succès du Projet phase I, le gouvernement
burkinabè présenta à la partie japonaise une requête
de fonds nécessaire à la construction de salles de classe, de
logements de maître, de latrines et de forages dans la zone
élargie à 10 provinces ainsi que la fourniture
d'équipements de salles de classe comme les tables bancs dans le cadre
de la coopération financière non remboursable (Projet phase II).
Avec un budget de 2,18 milliards de yens soit environ 10 573 000 000 de
FCFA, la phase II a permis la construction de 259 salles de classe de 77
écoles222(*). Les
provinces bénéficiaires du projet phase II: Bazega
(8écoles) ; Bougouriba (8 écoles);
Boulkiemdé (8 écoles) ;Houet (7
écoles) ; Kossi (4 écoles), Oubritenga (5
écoles), Passoré (8 écoles),
Sanguié (13 écoles),Sourou (8
écoles),Yatenga (8 écoles)223(*).
· Projet phase III (2006)
La phase III a couvert la période 2005-2006. Elle a
été exécutée avec un budget de 1, 732 milliards de
yens soit environ8 660 000 000 de FCFA et a permis la construction de
168 salles de classe, 105 logements de maîtres, 40 blocs de latrines et
34 forages de 53 écoles dans 7 provinces224(*) : Lorum (7 écoles),
Zondoma (11 écoles), Passoré (7 écoles), Bam (9
écoles), Kourweogo (8 écoles), Sanmatenga (7 écoles),
Boulkiemdé (5 écoles)225(*).
· Projet phase IV
La phase IV du projet de construction des écoles
primaires a couvert la période 2009-2011. Exécutée avec un
budget de 997 millions de yens soit environ 4 790 400 000de FCFA,
elle a permis la réalisation de 201 salles de classes, 49 logements de
maîtres, 66 latrines et 17 forages de 67 écoles dans quatre
provinces226(*):
Kouritenga (14 écoles), Boulgou (8 écoles), Boulkiemdé (18
écoles)et Yatenga (27 écoles)227(*). Les travaux qui ont démarré
en juin 2010 ont été achevés dans les délais.
· Projet phase V (2012)
La phase V du projet a été
réalisée au cours de la période 2013-2015. D'un budget de
1,138 milliards de yens soit environ 7 milliards FCFA, elle a permis la
construction de 288 salles de classes de 63écoles dans 9
provinces228(*):
Balés (1 écoles), Houet (13 écoles),
Kénédougou (7 écoles, Tuy (4 écoles), Comoé
(7 écoles), Leraba (5 écoles), Boulgou (15 écoles),
Koulpelogo (4 écoles) et Kouritenga (6 écoles)229(*).
Au total, entre 1995 et 2015, la coopération japonaise
a permis la construction et la réhabilitation de 291 écoles avec
995 salles de classe au Burkina Faso d'un montant de 6,673 milliards de yens
soit environ 35 milliards de FCFA. En dehors du centre, toutes les
régions, à l'exception de celles de l'Est et du Sahel, ont
bénéficié des cinq phases du projet de construction des
salles de classes. L'exclusion de ces deux régions s'explique par le
fait que la mise en oeuvre d'un projet de construction d'une école
primaire de la JICA tient compte de deux éléments. Il s'agit
d'abord de l'élément « effectif ». En effet,
si une école dispose d'un effectif d'élèves assez
réduit, elle n'est pas prise en compte alors qu'on sait que dans ces
deux régions, il y a souvent des classes avec très peu
d'élèves, voire sans élèves230(*). Le deuxième
élément concerne l'« influence des Partenaires
techniques et financiers (PTF). On constate que ces deux régions
connaissent une importante influence des PTF. La coopération japonaise
préfère intervenir dans les zones qui connaissent une moindre
influence, voire une absence d'autres PTF231(*).Le Japon soutient également la construction
des écoles de formation au Burkina Faso. On peut citer :
· Le Projet de construction de l'École
nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Dori.
C'est un don non-remboursable de 830 millions de yens
(environ 4 milliards de FCFA)232(*). L'objectif de la construction de l'ENEP de Dori est
de contribuer à alimenter la région en enseignants
qualifiés et de faire de Dori un pool d'excellence dans la formation des
enseignants du primaire au niveau de la région du Sahel.
En plus de la construction des infrastructures
éducatives, le Japon a également soutenu des projets de
coopération technique dans le domaine de l'éducation. On peut
noter :
· Le Projet d'appui à la formation
continue des enseignants en matière des sciences et des
mathématiques à l'école primaire (SMASE) Phase I et II
(2008-2015).
Le projet a été élaboré par le
Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation
(MENA) avec le soutien technique de la JICA. Le projet a permis la formation de
46900 enseignants et directeurs d'écoles et de 1395 encadreurs
pédagogiques sur l'Approche Activity Student Experiment and
Improvisation/ Plan Do See and Improve ou approche ASEI/PDSI232(*). C'est une approche
d'enseignement/apprentissage centrée sur l'apprenant. Elle met l'accent
sur l'expérimentation pour faciliter la compréhension en faisant
participer activement les apprenants à l'acquisition graduelle des
connaissances. L'enseignement/apprentissage est orienté sur des
activités à travers la pratique, la réflexion, les
échanges et les remarques qui suscitent l'intérêt de
l'apprenant et ses impressions sur les thèmes abordés233(*). Le Japon élabore
également des fiches de leçons de mathématiques et
sciences (863) ainsi que des guides pour enseignants234(*). Le coût global du
projet SMASE est estimé à 317210000 FCFA235(*).
· Le Projet d'appui aux comités de gestion
d'école (PACOGES) phase I et 2 (2009-2017).
Le projet a permis la mise en place d'environ 12 000 COGES
à l'échelle nationale et l'amélioration de la
qualité d'apprentissage à travers les activités
organisées par les COGES (cours supplémentaires...).
· Le Projet de renforcement des stratégies
et des pratiques de l'enseignement dans les centres de formation des
élèves-maîtres (PROSPECT, 2016-2018).
Ce projet contribue à la conception d'outils
destinés à l'amélioration du stage pratique dans les
écoles d'application et de l'enseignement pratique dans les
écoles nationales de formation des enseignants lors de la phase
théorique.
· Le programme de co-création de
connaissances.
Le programme a permis la formation d'environ 200 agents du
Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation
(MENA) au Japon et dans des pays tiers sur des thématiques
diverses236(*).
Plusieurs projets sont également en cours.
I.3. Les projets en cours
Depuis 2015, plusieurs projets ont été soutenus
par la JICA. Les différents projets en cours dans le domaine de
l'éducation sont :
· Le Projet de construction d'infrastructures
éducatives en appui au post primaire phase I (2015-2022).
C'est une subvention de 1 151 000 000 de yens soit plus
de 6 milliards de francs CFA. Les zones bénéficiaires du Projet
Phase I237(*) sont:
Kadiogo (15 CEG), Kourweogo (3 CEG), Oubritenga (2 CEG), Ganzourgou (2 CEG),
Sanmatenga (3 CEG), Bam (1 CEG), Namentenga (3 CEG)238(*).
· Le Projet de construction d'infrastructures en
appui au post-primaire phase II (don non-remboursable) (2017-2021)
:
C'est un don non-remboursable de 1 561 000 000 de yens
soit environ 8 milliards de Francs CFA qui est consacré à la
réalisation de 32 CEG dans les régions du Centre, du Centre-sud
et du Centre-ouest. Les zones bénéficiaires sont239(*) : Kadiogo (10 CEG),
Boulkiemdé (15 CEG) Sanguié (1 CEG), Bazega (5 CEG) et Zoudweogo
(1 CEG)240(*).
· Le Projet de construction de l'ENEP de
Kaya : (2018-2022) :
C'est un don non remboursable de 1 671 000000 yens
soit environ 9 milliards de francs241(*). Cependant, les travaux d'exécution
n'avancent pas normalement. Selon le Président du Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, cela s'explique par les problèmes
sécuritaires que le pays connait. Il s'agit d'assurer le contrôle
de l'exécution des travaux. En effet, ce sont des Japonais qui doivent
les exécuter et ils ont des craintes sur la question
sécuritaire242(*).
Le Japon soutient les initiatives communautaires à
travers les dons aux micro-projets locaux contribuant à la
sécurité humaine. C'est l'exemple de l'école
primaire de Bouro située dans la province du Yatenga qui a
bénéficié de la construction de trois salles de classes,
d'une cuisine, des équipements pour un espace de restauration, d'un
forage et l'acquisition de matériels scolaires au profit de
l'école en 2018. L'objectif est d'augmenter l'offre éducative,
améliorer la vie scolaire par un cadre de qualité propice aux
apprentissages, contribuer à la réduction des classes
sous-paillote et motiver les acteurs de l'éducation243(*).
L'investissement du Japon dans le domaine de
l'éducation est important. Les autorités japonaises parlent de la
construction de 1410 salles de classes dans le domaine de l'enseignement de
base244(*) et de 43 CEG
en 2018245(*). Cet
investissement a également permis la construction des écoles de
formation comme celle de Dori et également celle de Kaya qui est en
cours. L'intervention japonaise a donc un impact au niveau de l'offre
éducative à travers la construction des infrastructures scolaires
et des infrastructures de formations des enseignants. Cela a contribué
à augmenter le nombre d'écoles et de salles de classes, objectifs
majeur du PDDEB et du PDSEB. Dans le PDSEB par exemple, le Burkina Faso s'est
engagé à mettre en oeuvre une politique d'expansion du
système éducatif axée sur la construction des salles de
classes (résorption des classes précaires et construction de
nouvelles salles de classes)246(*). L'intervention japonaise a également un
impact sur la qualité de l'éducation à travers son soutien
au projet de coopération technique comme le projet SMASE qui a permis
d'appliquer le système ASEI/PDSEI au Burkina Faso. Le projet SMASE a
permis de transmettre des connaissances et techniques sur l'approche
centrée sur l'apprenant. L'application de l'approche ASEI/PDSEI a
commencé avec les fiches de leçon et l'outil de
suivi-évaluation. Cependant, selon le MENA, la formation initiale dans
les ENEP reste théorique et ne permet pas suffisamment aux
élèves-maitres d'acquérir les méthodes pratiques
nécessaires à la réalisation des leçons
axées sur l'apprenant. Beaucoup d'élèves-maitres
continuent d'utiliser la méthode classique pendant le stage pratique
dans les écoles d'application, et les maitres-conseillers ne les
encadrent pas efficacement pour maitriser l'approche ASEI-PDSI. Par ailleurs,
les formateurs des ENEP n'ont pas assez d'occasion pour améliorer leurs
compétences professionnelles247(*). Après le secteur de l'éducation,
l'agriculture est un autre secteur prioritaire de la coopération
japonaise au Burkina Faso.
II. L'agriculture
L'agriculture constitue le deuxième secteur prioritaire
de la coopération japonaise au Burkina Faso.
II.1. L'agriculture dans la
politique de coopération du Japon au Burkina Faso.
Le secteur agricole est un domaine prioritaire de l'assistance
du Japon, avec l'objectif de développer le pouvoir potentiel de
l'agriculture en Afrique et y assurer la sécurité alimentaire. Le
Japon a soutenu le Programme détaillé de développement de
l'agriculture africaine (PDDAA) en encourageant la récolte du riz en
Afrique y compris NERICA depuis la TICAD II248(*).
Dans le cadre de la politique d'aide du gouvernement japonais
au Burkina Faso, la JICA vise le développement humain et social à
travers un appui orienté sur divers secteurs prioritaires parmi lesquels
l'agriculture. Elle déploie sa coopération pour répondre
aux problèmes liés au développement agricole et rural au
Burkina Faso249(*). Pour
le Japon, il est impérieux de développer ce secteur afin de
permettre aux populations de bénéficier pleinement des
opportunités dont il regorge. Les initiatives japonaises dans le domaine
agricole se font à travers la Politique nationale de
développement du secteur rural (PNSR), notamment le PNSR II et visent
principalement le développement des filières agricoles porteuses,
le renforcement des capacités des acteurs du monde rural et le
développement des aménagements hydrauliques250(*). Mais le Japon accorde avant
tout de l'aide alimentaire au Burkina Faso.
II.2. L'aide alimentaire
Selon la FAO, l'aide alimentaire s'étend à
l'ensemble des vivres reçus à des fins de développement, y
compris les financements (dons et prêts) destinés à leur
achat. Les composantes essentielles de cette aide sont les vivres contre
travail et ceux vendus pour financer les projets de développement. Au
Burkina Faso, l'aide alimentaire est intégralement accordée sous
forme de dons251(*).
Parmi ses partenaires au développement, le Japon est l'un des principaux
fournisseurs. Pour le Japon, la sécurité alimentaire est un
élément essentiel pour la stabilité sociale d'un pays.
Connue sous le sigle de « KR », l'aide alimentaire
japonaise fait l'objet depuis 1982 de divers échanges de notes252(*). Le Japon accorde deux types
d'aides alimentaires au Burkina Faso : le KR I et le KR II.
· L'aide alimentaire KRI
Le Japon accorde chaque année de l'aide alimentaire KR
I au Burkina Faso. Cette aide est octroyée d'une part sous forme
financières, d'autre part, sous forme de vivres. L'aide alimentaire
japonaise, faite essentiellement de riz et dont la gestion est confiée
à la Société nationale de gestion du stock de
sécurité alimentaire (SONAGESS), est destinée à
réduire les importations du riz, à financer les projets de
développement et à permettre aux populations vulnérables
d'avoir accès à cette denrée. En effet, dans le cadre du
fonds de contrepartie, une grande partie de l'aide alimentaire japonaise est
monétisée et les produits de la monétisation servent
à financer des projets de développement au Burkina Faso. Le reste
est réservé à la distribution gratuite aux personnes
vulnérables et aux associations caritatives oeuvrant dans le social.
En 2018, par exemple, le Japon a octroyé 5242,02 tonnes
de riz au Burkina Faso pour le compte du KR 2016. Selon le ministre de
l'agriculture de l'époque, Jacob Ouédraogo, environ 4200 tonnes
de ce riz sera monétisé afin de financer des projets du Plan
national de développement économique et social (PNDES), le
reliquat, soit environ 1000 tonnes sera réservé aux personnes
vulnérables et aux associations caritatives253(*). La coopération
japonaise admet donc la vente d'une partie de ses dons alimentaires afin de
collecter des fonds destinés exclusivement au financement des projets de
développement social et humanitaire à la base, raison pour
laquelle il n'est pas rare de voir des sacs de riz, marqués
« de la part du peuple
japonais », vendus dans les boutiques au Burkina Faso. Dans
sa politique de coopération, le Japon a fait le choix d'une approche de
coopération qui prend en compte les défis auxquels l'Afrique est
confrontée, capable de ralentir sa marche vers le développement
et la réduction de la pauvreté extrême. Cette
stratégie de coopération permet de soulager les souffrances des
populations par l'amélioration de leurs revenus et la réduction
du déficit alimentaire à travers la relance du secteur agricole
et l'appui à d'autres secteurs prioritaires tels que
l'aménagement des infrastructures, l'assainissement de l'eau dans les
milieux ruraux, la construction des centres de santé et d'écoles.
Par exemple, les fonds de contrepartie issus de l'aide alimentaire
japonaise254(*) ont
permis le financement du projet pour le développement de la production
du maïs hybride Bondofa de campagne sèche 2011-2012 d'un montant de
1100000000 Francs CFA255(*), de la construction du pavillon du Soleil Levant du
Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) d'un montant de 1,7
milliards de FCFA en 2012 et la construction de l'échangeur de l'ouest
à hauteur de 12 273 103 262 de FCFA 256(*).
Tableau 6: L'aide
alimentaire japonaise au Burina Faso de 1994 à 2018
|
ANNEES
|
MONTANTS EN MILLION DE YENS
|
MONTANTS EN FCFA
|
|
1994
|
150
|
802 500 000257(*)
|
|
1995
|
150
|
799 500 000258(*)
|
|
1996
|
150
|
706 500 000259(*)
|
|
1997
|
390
|
1 891 500 000260(*)
|
|
1998
|
Données indisponibles
|
|
|
1999
|
350
|
1 900 000 000261(*)
|
|
2000
|
Données indisponibles
|
|
|
2001
|
250
|
1 510 500 000262(*)
|
|
2002
|
Données indisponibles
|
|
|
2003
|
300
|
1 500 000 000
|
|
2004
|
300
|
1 500 000 000
|
|
2005
|
300
|
1 350 000 000263(*)
|
|
2006
|
340
|
2 748 900 000
|
|
2007
|
490
|
2 000 000 000
|
|
2008
|
800
|
4 760 000 000
|
|
2009
|
800
|
4 000 000 000
|
|
2010
|
940
|
5 273 400 000
|
|
2011
|
760
|
3 800 000 000
|
|
2012
|
480
|
2 400 000 000
|
|
2013
|
510
|
2 550 000 000
|
|
2014
|
440
|
2 200 000 000264(*)
|
|
2015
|
500
|
2 200 000 000
|
|
2016
|
370
|
1 850 000 000
|
|
2017
|
360
|
1 900 000 000
|
|
2018
|
500
|
2 805 000 000
|
|
TOTAL
|
9 570
|
48 247 800 000
|
Source : Elaboré par nous-mêmes à
partir des échanges de note.
Au total, entre 1994 et 2018, le Japon a accordé 9,5
milliards de Yens d'aide alimentaire au Burkina Faso, soit environ
48 247 800 0000 FCFA.
· L'aide alimentaire KR II
C'est un programme similaire au KR I, à la
différence que le produit concerne des intrants et des matériels
agricoles à la place du riz265(*). C'est un don qui s'inscrit toujours dans la
perspective de l'amélioration de la sécurité alimentaire
et de la lutte contre la pauvreté. L'objectif étant d'assurer une
production suffisante et de qualité. Depuis 1994, le Burkina Faso a
bénéficié de plusieurs projets d'aides à la
production alimentaire accrue et aux agriculteurs défavorisés:
1994-1998 (2,1 milliards de Yens, soit 11 781 000 000 FCFA),
2000-2001 (600 millions de Yens, soit environ 3 366 000 000
FCFA), 2007 (330 millions de Yens soit environ 1 851 300 000
FCFA)266(*). Le Japon
soutient également le Burkina Faso à travers les projets de
coopération technique.
II.3. Les projets de
coopération technique.
Les projets de coopération technique soutenus par le
gouvernement japonais au Burkina Faso s'articulent autour :
· Le Projet de promotion du développement
rural par l'aquaculture durable au Burkina Faso : (2010-2013).
C'est un projet de coopération technique mis en oeuvre
par la JICA et le Ministère de l'agriculture, de l'hydraulique et des
ressources halieutiques (MAHRH) à travers la Direction
générale des ressources halieutiques (DGRH). Il consiste à
mettre en place des techniques appropriées de l'aquaculture en milieu
rural focalisées sur les systèmes extensifs et semi-intensifs et
à renforcer le dispositif de vulgarisation à travers le
renforcement des capacités des agents concernés. Le projet est
cofinancé par le Japon à hauteur de 308910000 FCFA et le
gouvernement du Burkina Faso à travers une contrepartie nationale de
46179000 FCFA. Son exécution vise à mettre à la
disposition des agriculteurs et des pêcheurs, des techniques simples,
pratiques et à moindre coût d'aquaculture qui leur permettront de
diversifier leurs sources de revenus. Pour la première année
d'exécution, le projet est intervenu dans 6 provinces à savoir:
Bazèga (Centre Sud), Comoé (Cascade), Houet et
Kénédougou (Hauts Bassins), Gourma (Est) et Sanguié
(Centre Ouest)267(*).
· Le Projet d'appui à l'élaboration
d'un schéma directeur pour la promotion d'une agriculture
orientée vers le marché au Burkina Faso (PAPAOM) 2013 -
2015.
C'est un projet de coopération technique initié
par la Direction générale de la promotion de l'économie
rurale (DGPER) du Ministère de l'agriculture et de la
sécurité alimentaire (MASA) avec l'appui technique et financier
de la JICA qui soutient les entreprises intéressées par les
produits agricoles à haut potentiel notamment le soja et la fraise. Le
PAPAOM a été exécuté pendant 2 ans (avril 2013-mai
2015) avec un budget d'environ 589437000 francs CFA. Ce projet vise à
contribuer au développement agricole et au commerce à travers la
diversification des produits agricoles268(*).
Pour ce qui est de la filière soja, le
Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques
(MAAH) l'a placé au rang des priorités nationales en
matière de développement des filières agricoles. Afin
d'apporter sa contribution, la JICA a mis à la disposition du
ministère, entre octobre 2017 et décembre 2018, un expert soja.
Son objectif est de renforcer les capacités des acteurs de la
filière et de les structurer selon l'acte uniforme de l'Organisation
pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Les
activités ont été essentiellement menées dans les
régions du Centre (Ouagadougou), du Centre-Ouest (Léo), du
Centre-Sud (Po), du Centre-Est (Tenkodogo), et des Hauts-Bassins (Bobo). Ces
régions sont considérées comme des zones de production et
de transformation de soja269(*).
· Le projet de renforcement de la production du
sésame au Burkina Faso (PRPS-BF, 2014-2019).
C'est un projet qui traduit la volonté du Japon
à accompagner le Burkina Faso dans la diversification des
filières agricoles porteuses afin de promouvoir des produits
d'exportation de substitution au coton. Le sésame est l'une des cultures
d'exportation au Burkina Faso et reste porteuse d'espoir car la demande
à l'exportation augmente considérablement. Cependant, la
filière est confrontée à de nombreuses difficultés
notamment les faibles rendements couplés aux problèmes de
qualité. C'est dans ce contexte que le projet de coopération
technique a été élaboré afin de renforcer la
filière sésame. Les objectifs sont d'accroître la
productivité du sésame dans les différentes zones
ciblées que sont les régions de la Boucle du Mouhoun et des
Hauts-Bassins et d'accroître la productivité et les revenus des
producteurs de sésame. Le projet est mis en oeuvre par le MAAH et
bénéficie de la collaboration de l'Institut de l'environnement et
de recherches agricoles (INERA)270(*).
· Le projet d'étude pour la formulation
d'un programme nationale de développement des bas-fonds
(2017-2019).
Le projet couvre tout le territoire du Burkina Faso et est mis
en oeuvre par le MAAH. Il vise à améliorer la production agricole
à travers le programme national de développement de bas-fonds et
à adopter un programme national, opérationnel et
stratégique de développement de bas-fonds à l'horizon
2030271(*).
· Le projet pour la mise en place d'un
modèle de promotion des cultures par l'utilisation du phosphate naturel
(SATREPS, 2017-2022).
Le projet est mis en oeuvre par le Ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l'innovation (MESRSI), dans le cadre d'une recherche conjointe internationale
avec le « Japan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS) », institution de recherche japonaise. Le MAAH joue le rôle
de partenaire de mise en oeuvre de l'expérimentation, l'adoption et
l'utilisation des résultats. Les zones d'interventions du projet
concernent les régions du Centre (Ouagadougou), du Centre-ouest (Saria),
de l'Ouest (Farako-ba) et de l'Est (Kouaré). L'objet d'un tel projet est
de proposer un modèle de promotion de l'application des engrais dans
les systèmes de culture au Burkina Faso car la majorité des
agriculteurs pratique toujours la culture sans engrais272(*).
· Le projet d'amélioration de la
production alimentaire et des revenus des ménages à travers la
création et la promotion des sites de référence
(2014-2019).
Ce projet est mis en oeuvre dans la province du Bam au
Centre-Nord, zone agropastorale par excellence au Burkina Faso. La zone est
caractérisée par des sols qui sont altérés par la
double action de l'érosion éolienne et hydrique. C'est dans le
but de contribuer à l'épanouissement socioéconomique des
populations à travers la protection environnementale et la consolidation
de la sécurité alimentaire que la JICA appuie ce projet. Les
principales activités portent sur l'amélioration des sols
agricoles (application de la technique du zaï, la promotion de la
production et de l'usage du compost, la production et la vente de miel) et
l'embouche ovine. Il bénéficie aux principaux groupes
socioprofessionnels de la zone que sont les agriculteurs et les
éleveurs. Le projet est mis en oeuvre par l'ONG japonaise « Action
for Greening Sahel (AGS-Japan) et l'ONG burkinabè
« Association des jeunes pour la protection de l'environnement et
l'élevage » (AJPEE) avec l'appui de la JICA. Le projet
bénéficie à 135 ménages des 3 villages que sont
Tamponga, Yalka et Foulou à raison de 45 ménages par village.)
Selon la JICA, les résultats sont porteurs car le projet a permis
l'amélioration de la productivité grâce aux diguettes et
au zaï, le rendement passant de 30% (avant le projet) à 50% en
2018273(*). Le Burkina
Faso bénéficie également de plusieurs initiatives
lancées dans le cadre de la TICAD. Il s'agit notamment:
· La Coalition pour le développement de la
riziculture en Afrique (CARD).
Elle a été lancée en 2008 dans le cadre
de la TICAD IV. L'objectif était de doubler la production de riz en
Afrique de 14 millions à 28 millions de tonnes d'ici 2018 afin de
contribuer à combler l'écart entre l'offre et la demande,
à atteindre la sécurité alimentaire et à
réduire la pauvreté sur le continent274(*). L'accompagnement du Burkina
Faso se fait principalement à travers la contribution au
développement, la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de
développement de la riziculture (SNDR), l'appui au développement
des politiques du secteur rizicole, le renforcement des capacités des
acteurs du secteur, et l'accroissement de l'investissement par la
création d'un environnement favorable275(*).
· Le Projet Smallholder Horticulture Empowerment
and Promotion (SHEP) ou Projet de promotion de l'autonomisation des petits
producteurs horticoles.
C'est une initiative qui promeut une agriculture
orientée vers le marché en vue de relever le niveau des revenus
des petits exploitants en Afrique. Le SHEP vise à faire de l'agriculture
un business (« produire stratégiquement pour vendre » et non
de « produire et vendre ») et à mieux connecter le producteur
au marché. Tenant compte des bons résultats du SHEP au Kenya, la
JICA a décidé de l'étendre à plusieurs autres pays
africains et d'en faire un pilier de sa coopération dans le domaine de
l'agriculture. A travers cette initiative, de nombreux agents du
Ministère de l'agriculture du Burkina ont été
formés au Japon et au Kenya276(*).
· L'Initiative pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle en Afrique (IFNA).
Cette initiative, lancée lors de la TICAD VI en 2016,
compte 10 pays membres et a pour objectif d'appuyer les efforts de chaque
gouvernement dans l'accélération de la mise en oeuvre de leurs
politiques en matière de sécurité alimentaire et
nutritionnelle. Les problèmes de priorités nutritionnelles tels
que l'anémie, l'alimentation complémentaire et la croissance ont
été identifiés et les zones d'intervention sont le Nord,
le Sud-Ouest et le Centre-Ouest. Dans ces zones est mise en oeuvre la
Stratégie pays pour le Burkina Faso277(*).
Dans le secteur agricole, l'impact de la coopération
japonaise au Burkina Faso est considérable. L'aide alimentaire, en plus
de financer des projets de développement, permet aux populations
vulnérables d'avoir accès à cette denrée à
travers les dons gratuits accordés aux associations caritatives. Selon
Salif Sankara, près de 45 associations et ONG bénéficient
de l'aide alimentaire japonaise au Burkina Faso. Parmi ces associations, on
peut citer le Centre Delwindé de Tanghin, l'Association action pour la
relance de relève de solidarité sociale de Loumbila,
l'Association Buud Nooma pour le développement, l'Association islamique
des encadreurs des femmes, filles et hommes musulmans, etc.278(*). Les projets de
coopération technique permettent de soutenir les filières
agricoles porteuses comme le sésame, le soja et la fraise. Cela permet
d'accroître la production et les revenus des agriculteurs. Cela permet
également de diversifier les produits d'exportations du Burkina Faso. En
plus de l'éducation de base et de l'agriculture, le développement
des infrastructures constitue un autre secteur prioritaire de la
coopération japonaise au Burkina Faso.
III. La promotion de
l'intégration économique sous- régionale.
La promotion de l'intégration économique sous-
régionale constitue le troisième secteur prioritaire de la
coopération japonaise au Burkina Faso. Ce secteur prioritaire s'articule
autour du développement des infrastructures régionales et
sous-régionales.
III.1. La question des
infrastructures dans la coopération japonaise au Burkina Faso.
Basé sur l'expérience de la reconstruction
d'après-guerre du Japon et du développement des pays asiatiques,
le Japon estime qu'il est impératif de développer les
infrastructures y compris les routes, les ports ainsi que la distribution
d'électricité pour permettre une croissance économique
solide et durable279(*).
Afin d'assurer la croissance stable du Burkina Faso qui dépend des pays
voisins pour la circulation des marchandises et la fourniture de
l'énergie, le Japon s'est récemment engagé à la
promotion de l'intégration économique sous-régionale, en
approfondissant la collaboration avec l'UEMOA par l'amélioration de
l'efficacité des douanes aux frontières et l'aménagement
des infrastructures sous-régionales280(*). Cela concrétise les objectifs de la
Déclaration de Yokohama de la TICAD IV qui souligne le besoin
fondamental de se concentrer sur le développement d'infrastructures de
dimension régionale281(*). Pour le Japon, pour permettre une croissance
économique solide et durable, il est impératif de
développer des infrastructures de hautes qualités comme le
développement des routes, de ponts, etc. Les initiatives du gouvernement
japonais au Burkina Faso s'appuient sur la Stratégie de
développement du secteur des transports au Burkina Faso 2011-2025.
Celle-ci définit les axes stratégiques du sous-secteur routier
interurbain et international comme suit: développer et renforcer le
secteur routier, améliorer les conditions de transit sur les corridors
internationaux, renforcer la gestion du patrimoine routier, renforcer la
compétitivité des services de transport et consolider
l'intégration régionale282(*).
III.2. Les initiatives du Japon
au Burkina Faso
Lors de la TICAD V, le gouvernement japonais a
décidé de mettre en place 10 plans directeurs pour l'Afrique de
2013 à 2018. Pour l'Afrique de l'Ouest, le plan s'articule autour du
concept d'agriculture de haute qualité, à commencer par l'anneau
de croissance de l'Afrique de l'Ouest. L'anneau est lié à la
construction d'autoroutes reliant les pays de l'intérieur aux pays
côtiers. L'objectif est de réduire l'impact négatif de ce
handicap géographique et de stimuler les activités
économiques en faveur du développement283(*).
Le projet de Plan directeur de l'aménagement
des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest
(WAGRIC-CACAO) est le projet phare de la coopération japonaise
au Burkina Faso dans le domaine de la promotion de l'intégration
économique sous-régionale. L'objectif du projet est de
réaliser un développement économique
équilibré entre les zones côtières et
intérieures de quatre pays à savoir le Burkina Faso, la
Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo (ces quatre pays sont
désignés sous l'appellation de pays CACAO ou sous-région
CACAO), en mettant à profit les potentiels de développement
identifiés des secteurs économiques et en supprimant les goulots
identifiés sur les corridors de transport. Il s'agit de permettre le
développement de la région, renforcer la croissance
économique et promouvoir l'investissement étranger en exploitant
le maximum du potentiel de développement et des ressources des pays tout
au long des corridors du projet. Le projet s'est occupé de quatre
corridors internationaux dont trois au Burkina Faso. Il s'agit : du
corridor Abidjan-Ouagadougou, du corridor Lomé-Ouagadougou, du corridor
Tema-Ouagadougou284(*).
L'UEMOA en partenariat avec le Japon a lancé d'autres
projets, comme le projet « One Stop Border Post(OSBP) ou Poste
frontalier à arrêt unique (PFAU) ». L'objectif est
d'accélérer le dédouanement des marchandises
importées d'un pays à l'autre et à faciliter les
échanges commerciaux285(*). Pour faciliter l'intégration
économique sous-régionale, le Japon a réalisé
à travers l'Echange de notes avec l'UEMOA, le projet de
l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers entre le Togo et
le Burkina Faso286(*). L'échange de note a été
signé en 2016 avec une valeur 195 millions de yens soit environ
1 093 950 000 FCFA287(*).
En 2017, dans le cadre de l'initiative EPSA, le Japon accorde
pour la première fois un prêt de 56,59 millions de yens soit
317 469 900 FCFA au Burkina Faso pour le projet
d'amélioration de la route nationale n°4
Gounghin-Fada N'Gourma- Frontière du
Niger288(*). Ce
projet doit être réalisé en collaboration avec la BAD.
Le Japon a également financé le projet
de réhabilitation de la rocade sud-est de Tansoba
dans la ville de Ouagadougou à hauteur de 5,8 milliards de yens
soit 32 543 610 000 FCFA289(*). Les travaux qui ont démarré en
août 2019 doivent prendre fin en décembre 2021.
En dehors de ces trois secteurs prioritaires, le Japon
intervient dans d'autres domaines au Burkina. Il s'agit des secteurs de l'eau,
de la santé, de l'environnement, d'envoi de volontaires et le commerce.
Le prochain chapitre vise à analyser l'état de la
coopération japonaise dans ces secteurs au Burkina Faso.
Chapitre VI: Autres domaines d'intervention du Japon au
Burkina Faso.
Le processus de la TICAD a trois piliers prioritaires à
savoir les secteurs de besoins humains fondamentaux, la croissance
économique et la question de démocratie et de bonne gouvernance.
Toutes ces priorités sont prises en compte au Burkina Faso mais l'accent
est davantage mis sur le secteur des besoins humains fondamentaux notamment
l'agriculture et l'éducation qui sont des secteurs prioritaires de la
coopération japonaise. Il est question dans ce chapitre d'analyser les
autres secteurs dans lesquels la coopération japonaise apporte une aide
au Burkina Faso. Il s'agit des autres secteurs centrés sur les besoins
humains fondamentaux (santé, eau et assainissement et environnement),
les secteurs centrés sur le développement des ressources humaines
(envoi de volontaires, programmes de stages) et les relations commerciales
entre le Burkina Faso et le Japon.
I. Les secteurs
centrés sur les besoins humains fondamentaux de base.
Il s'agit des secteurs de la santé, de l'eau et enfin
de l'environnement.
I.1. Le secteur de la
santé
Lancée en 1993, la TICAD est la plate-forme clé
pour piloter les initiatives de développement du Japon en Afrique. La
conférence est une occasion de faire progresser les engagements pris par
le Japon envers l'Afrique dans des domaines divers : c'est le cas de la
santé. Depuis la TICAD I, le Japon et ses partenaires de
développement se sont toujours engagés à soutenir les
efforts des pays africains en matière de santé. Le Japon
encourage le renforcement des systèmes de santé, le renforcement
de la santé maternelle, néonatale et infantile, la
prévention et le traitement des maladies infectieuses et parasitaires
(paludisme, tuberculose, poliomyélite, SIDA)290(*).
Au Burkina Faso, le paludisme est une cause majeure
représentant 50% du taux de morbidité et de mortalité
parmi les citoyens, ce qui en fait la plus grave des maladies
infectieuses291(*). Pour
s'attaquer à ce problème, la JICA envoie des groupes de
volontaires japonais pour la coopération outre-mer (JOCV) chargés
de distribuer des moustiquaires et de mener des activités de
prévention et de sensibilisation au paludisme292(*). De plus, en vue de
l'amélioration des services sociaux de base (éducation,
santé et alimentation en eau) pour les couches vulnérables, qui
constitue le noyau de la politique de développement du Burkina Faso, des
mesures intensives concernant l'élargissement de l'accès des
habitants aux services de santé de base, l'amélioration de la
qualité, l'augmentation de l'utilisation de ces services ont
été poursuivies dans le domaine de la santé. C'est dans
cette perspective que le gouvernement burkinabè a inscrit parmi les
principales stratégies du Plan national du développement
sanitaire (PNDS 2011-2020), l'amélioration du système de
services, la formation des ressources humaines dans le secteur de la
santé, la prévention des maladies et la promotion de
santé, ainsi que l'amélioration des infrastructures de service.
Les priorités concrètes de ces principales stratégies,
à savoir les services de santé au niveau communautaire, la
santé maternelle et infantile, les activités de sensibilisation
sociale, le programme nutritionnel, les capacités d'approvisionnement en
médicaments et vaccins, correspondent exactement aux activités de
services de santé auxquelles s'engagent les centres de santé, ce
qui signifie que le PNDS ne pourrait pas produire ses effets positifs sans que
l'accès des habitants aux Centres de Santé et de Promotion
Sociale (CSPS) ne soit assuré et que ceux-ci ne confirment un
fonctionnement stable293(*). Le Japon et le Burkina Faso entretiennent depuis
longtemps d'excellentes relations dans le domaine sanitaire. Le Japon est
intervenu dans l'éradication du ver de guinée, de la
poliomyélite et de la lutte contre le paludisme294(*).
ü 1997-2000 : Projet d'approvisionnement en eau potable en
vue de l'éradication du ver de guinée. D'un montant de
1.372.000.000 de yens soit environ 7 milliards de FCFA.
ü 1999 : Projet d'éradication de la
poliomyélite (par l'intermédiaire de l'UNICEF) d'un montant de
106 millions de yens soit environ 530 millions de FCFA.
ü 2007 : Projet de lutte contre le paludisme d'un
montant de 180 millions de yens (720 millions de CFA). C'est un don pour la
distribution de 233200 moustiquaires imprégnées durables dans 5
provinces.
ü Le gouvernement japonais a également
approuvé en 2007, l'utilisation des fonds de contrepartie d'un montant
d'un milliard de franc CFA pour la mise en oeuvre du cadre stratégique
de lutte contre le VIH, le SIDA et les infections sexuellement transmissibles
(IST)295(*).
ü 2012: Projet de construction des centres de
santé et de promotion sociale. D'un montant de
1 401 000 000 de yens (7 858 610 000 FCFA), le
projet vise la construction de 39 CSPS dans les zones296(*)de Banfora (4
CSPS), de Mangodara (8 CSPS), de
Dédougou (6 CSPS), de Tougan (6 CSPS), de
Nouna (2 CSPS), de Solenzo (3 CSPS), de
Sapouy (3 CSPS), de Léo (3 CSPS), de
Batié (1 CSPS), de Diébougou (3
CSPS)297(*).
L'objectif du gouvernement japonais est d'apporter son aide directe aux points
principaux de la politique sanitaire du Burkina Faso, et ainsi constitue une
des conditions importantes de la production d'effets du PNDS 2011-2020 dans les
zones concernées par le Projet298(*). Le projet CSPS est en cours
d'exécution299(*).
Au total, le Japon a construit 48 CSPS depuis
sa présence au Burkina Faso300(*).
En ce qui concerne la construction des
maternités, l'assistance japonaise se fait
généralement à travers les dons aux micro-projets locaux
contribuant à la sécurité humaine. C'est l'exemple de la
construction et l'équipement de la maternité Sakina de Nagrin
à Ouagadougou. D'un montant de 47 855 998 de CFA, ce don a
été octroyé à l'Association des
élèves et étudiants musulmans du Burkina (AEEMB) en 2017.
De même, en 2018, le village de Kounou dans la province de Sissili a
bénéficié de la construction d'une maternité d'un
montant de 49 millions de FCFA. La construction des maternités vise
à soutenir les efforts du gouvernement burkinabè à
améliorer l'accès des populations aux services de santé,
surtout améliorer la prise en charge sanitaire de la femme enceinte, de
la mère et de l'enfant301(*).
I.2. L'eau et
l'assainissement
Les réalisations de l'aide japonaise dans les domaines
de l'eau et de l'hygiène occupent une part importante de l'aide à
l'Afrique. L'approvisionnement en eau est l'un des domaines prioritaires de
l'aide japonaise en Afrique. C'est pourquoi, le Japon met en oeuvre des projets
d'aides non-remboursables et de prêts bilatéraux concernant l'eau
et les installations sanitaires dans plus de 40 pays en Afrique302(*). Le Japon contribue
énormément à faciliter l'accès à une eau
saine dans les différentes régions de l'Afrique. En 2006, le
Japon a lancé le projet « Partenariat étendu de l'eau
et de l'hygiène (Water and Sanitation Broad Partnership Initiative :
WASABI) ». Une aide mettant à profit les connaissances,
l'expérience et les technologies japonaises est ainsi apportée
dans ce secteur. L'appui est donné en gardant à l'esprit les
besoins de chaque pays et leurs efforts autonomes en adaptation avec leur stade
de développement303(*). Au Burkina Faso, la JICA intervient dans le secteur
de l'eau potable et de l'assainissement dans le cadre du Programme national
d'approvisionnement en eau potable (PN-AEPA). Elle contribue à
améliorer l'accès à l'eau potable et participe à la
sensibilisation des populations des zones d'interventions. La JICA accompagne
le Burkina Faso pour l'atteinte des objectifs du PN-AEPA. Bien avant la TICAD,
le Japon a exécuté plusieurs projets de coopération dans
le cadre de sa coopération financière non-remboursable dans le
secteur de l'eau au Burkina Faso. On peut citer :
ü 1982 : Projet d'aménagement des
équipements de la Direction nationale des ressources en eau, de
l'aménagement et de l'équipement rural,
ü 1992 : Projet d'hydraulique villageoise dans les
provinces du Poni et de la Bougouriba.
Depuis l'initiative TICAD, les différentes initiatives
japonaises dans ce domaine s'articulent autour :
· Le projet AMELI-EAUR (Projet
d'amélioration des conditions d'accès durable à l'eau
potable et à l'assainissement en milieu urbain et rural au Burkina
Faso).
C'est un projet qui est né d'une convention de
coopération signée en décembre 2009 entre le Burkina Faso
et le Japon et qui a officiellement démarré en avril 2010 pour
une durée de 5 ans. D'un montant de 2,7 milliards de FCFA, ce projet a
été piloté conjointement par l'Institut international
d'ingénierie de l'eau et de l'environnement (2IE) au Burkina Faso et
l'Université de Hokkaido au Japon. Il est financé et soutenu par
la JICA, l'Agence Japonaise des Sciences et de la Technologie (JST) et le
Ministère burkinabè de l'agriculture et de la
sécurité alimentaire (MASA). C'est une véritable
plateforme de recherche et de collaboration scientifique entre le 2iE et
l'université d'Hokkaido dans le cadre du programme international SATREPS
(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development) de la
JICA et la JST.
· Le Projet d'approvisionnement en eau potable
des régions du Plateau central et du Centre Sud (phase I
2009-2012).
Conformément aux objectifs du PN-AEPA 2015, le
gouvernement du Burkina Faso a entrepris un projet visant l'augmentation du
taux d'accès à l'eau potable en le faisant passer à 76% en
2015. C'est dans ce contexte que le gouvernement burkinabè a
adressé une requête au gouvernement du Japon pour le Projet
d'approvisionnement en eau potable des régions du Plateau central et du
Centre Sud (phase I 2009-2012). Ce Projet portait sur la construction
d'ouvrages d'approvisionnement en eau. C'est un don non remboursable de
1 459 000000 de Yens soit environ 5,8 milliards de FCFA304(*) qui a permis la construction
de 300 forages équipés de pompe à motricité humaine
dans les deux régions. Les travaux qui ont démarré en
octobre 2009 ont pris fin en mars 2012.
· Le Projet d'approvisionnement en eau potable
des régions du Plateau central et du Centre Sud Phase II
(2014-2016).
En 2009, à la suite du Projet phase I, le gouvernement
burkinabè a de nouveau sollicité l'aide du Japon afin d'atteindre
les objectifs en matière de taux d'accès à l'eau potable
dans le Plateau central et le Centre-Sud à l'horizon 2015. Ce projet
phase II est également un don non remboursable de 968 millions de Yens,
soit environ 4 840 000 000 de FCFA305(*) pour la construction de 300
forages équipés de pompes à motricité humaine. Ce
projet a permis d'assurer l'approvisionnement en eau potable à une
population bénéficiaire d'environ 90 000 habitants.
Un autre projet soutenu par le Japon est le Projet de
renforcement de la gestion des infrastructures hydrauliques d'approvisionnement
en eau potable et de promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans
le Plateau Central (PROGEA/PCL: 2009-2013). Les
provinces concernées par ce projet sont le Ganzourgou, le
Kourwéogo et l'Oubritenga.
Dans le cadre des dons aux micro-projets locaux contribuant
à la sécurité humaine, plusieurs projets ont
été signés et réalisés par le Japon dans ce
secteur en 2018. On peut noter306(*) :
ü Le projet de réalisations de forages dans quatre
communes de Samba, province du Passoré dans la région du Nord. Le
projet a été signé avec l'Association pour le
développement économique et social de Toessin (ADESTO). Le
montant total du don est de 20 millions de FCFA et est octroyé dans le
but de contribuer à la réalisation de forages dans quatre
villages de la commune de Samba : Toessin, Mesga, Batono, Zinguedessin. Le
projet a été signé le 6 mars 2018, la
cérémonie d'inauguration du dit projet, le 30 novembre
2018307(*).
ü Le 5 mars 2018, le projet d'approvisionnement en eau
potable de l'orphelinat Sainte Thérèse de Loumbilla. D'un montant
de 41 869 000 FCFA, le château d'eau réalisé est
un projet qui comporte un volet eau, un volet éducation et un volet
humanitaire. C'est le 30 octobre 2018 que le projet a été
inauguré308(*).
ü Le 28 février 2018 a été
signé le projet de réalisation de forages dans trois villages de
la commune de Karangasso Sambla, province de Houet dans la région du
Haut-Bassins. D'un montant de 31709 euros, le don est accordé à
l'Association pour le développement du département de Karangasso
Sambla. Ce don a permis à l'Association de réaliser trois forages
dans trois villages (Badarasambla, Siènné et Kongolikam) de la
commune au bénéfice de plus de 6400 personnes. Le projet a
été inauguré le 28 septembre 2018309(*).
Jusqu'en 2018, le Japon a construit 1131
forages au Burkina Faso310(*).
I.3. L'environnement et le
changement climatique
L'Afrique est très gravement impactée par le
changement climatique et vulnérable à la variabilité
climatique. Lors de la TICAD V, les dirigeants ont reconnu le grave impact du
changement climatique sur le continent et ont appelé à l'action
pour atteindre une croissance durable et résiliente en intégrant
la réduction des risques de catastrophes et l'adaptation au changement
climatique311(*). A la
TICAD IV le Japon a lancé le Partenariat « Cool Earth
50 ». C'est un mécanisme de financement pour le monde dont le
cumul de 5 ans était de dix milliards de dollars, démarré
par les pays en voie de développement visant à contribuer
à la réduction des émissions, la croissance
économique et la stabilisation du climat. (Il existe 36 pays partenaires
« Cool Earth » en Afrique)312(*). Le Japon contribue également dans la
réalisation du « Cadre conjoint Japon-PNUD pour
l'établissement d'un partenariat relatif à l'adaptation au
changement climatique en Afrique »313(*). Dans le cadre de ce programme, le Burkina Faso a
mené des études de vulnérabilité multisectorielles
et de modèle climatique. En outre, pour améliorer le
réseau d'observation du climat au niveau national, 16 stations
automatiques ont été installées. Au moment de la TICAD V,
le Burkina Faso fut le premier pays à adopter le Programme national
d'adaptation sur la base de ces études. Un soutien supplémentaire
a été apporté aux zones rurales en vue de mettre en place
un programme d'assurance contre les aléas météorologiques
en faveur des petits exploitants314(*). L'intervention de la JICA dans le secteur de
l'environnement est axée sur la conservation et la gestion durable des
ressources naturelles. Elle contribue à l'amélioration des
conditions de vie des populations de manière durable à travers la
mise en oeuvre de projets de manière participative. La JICA
intègre aussi la lutte contre les effets néfastes des changements
climatiques et le renforcement des capacités des agents des services
forestiers dans ses programmes de développement315(*). L'objectif est à la
fois de réduire la pauvreté et de préserver
l'environnement. Avec l'appui de la coopération japonaise, de nombreux
projets ont été réalisés.
ü 1999 : Projet régional
d'amélioration de pépinières forestières d'un
montant de 605 millions de yens, soit environ 3 285 150 000 de
FCFA.
ü 2004 Projet de réhabilitation et de renforcement
des capacités du Centre national de semences forestières de
quatre antennes régionales d'un montant de 321 millions de yens, soit
1 800 810 000 FCFA. Les quatre antennes régionales sont
l'antenne régionale de Bobo Dioulasso, l'antenne régionale de
Dori, l'antenne régionale de Fada-Ngourma et l'antenne régionale
de Kaya.
ü 2007 Projet de gestion participative et durable des
forêts de la Comoé (PROGEPAF/Comoé).D'un montant de 114,7
millions de yens (environ 64 346 700 FCFA)316(*), le projet a visé
quatre forêts classées de la province : Bounouna, Toumousseni,
Gouandougou et Kongouko317(*).
ü 2009 : Projet d'amélioration des
capacités de gestion des catastrophes naturelles causées par les
changements climatiques d'un montant de 700 millions de yens, soit environ de
3 927 000 000 FCFA.
ü 2010: Projet de renforcement des capacités
d'enseignement et de formation de l'Ecole nationale des eaux et forêts
d'un montant de 655 millions de yens, soit 3 674 550 000
FCFA.
En 2009, le Japon a fourni au gouvernement burkinabè,
une aide d'urgence d'environ 14 millions de yens (environ 70 millions de FCFA)
pour les inondations causées par les pluies torrentielles du
1er septembre318(*). Cette aide matérielle était
composée de tentes (30), de bâches en plastiques (18), des
couvertures (1000), des épurateurs d'eau (10 en raison de 4 litres par
minute), de jerricans (422, matériel de transport et de conservation
d'eau potable d'une capacité de 10 à 15 litres)319(*).
De plus, le 16 mars 2009, le Japon a octroyé 3,5
milliards de FCFA, pour l'achat au profit du Ministère de l'habitat et
de l'urbanisme, de bulldozers, de pelleteuses, de camion-bennes et d'autres
équipements destinés à la réalisation des travaux
pour réduire les effets des catastrophes naturels320(*). En plus d'intervenir dans
les secteurs des besoins humains fondamentaux de base, le Japon intervient
également dans les secteurs de la croissance économique comme le
commerce et les investissements au Burkina Faso.
II. La promotion du commerce
et de l'investissement au Burkina Faso.
Il est question dans ce point d'examiner l'assistance
japonaise dans le domaine du commerce et de l'investissement, sa promotion au
Burkina Faso et enfin des différents produits d'échanges entre le
Burkina Faso et le Japon.
II.1. L'assistance japonaise
dans le domaine commercial au Burkina Faso
Au Burkina Faso, le Japon encourage activement la
coopération économique afin de contribuer aux activités
des sociétés japonaises, en soutenant le développement des
produits agricoles à fort potentiel d'exportation tel que le
sésame auquel les sociétés japonaises s'intéressent
et en apportant un appui pour l'amélioration de l'efficacité des
douanes aux frontières et l'aménagement des infrastructures
sous-régionales favorisant la promotion de la vente des produits
japonais notamment les motocyclettes et les voitures. Un autre objectif est
d'encourager les firmes japonaises à établir un partenariat dans
le domaine. Les entreprises japonaises présentes au Burkina Faso sont
entre autres la société CFAO Motors, concessionnaire de
véhicules et motocyclettes et la société SYSMEX,
fournisseur d'appareils biomédicaux.
En termes d'échange commercial, le partenariat entre
les deux pays est ancien. Depuis les années 1960, il existe des courants
d'échanges entre le Burkina Faso et le Japon. Le 14 février 1964
par exemple, un accord commercial a été signé entre les
deux gouvernements. Selon l'article I de
l'accord : « les deux gouvernements s'efforceront
d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays et de
le maintenir à un niveau aussi élevé que
possible321(*)». Les échanges se font à
travers les importations et les exportations. Le Japon importe des produits non
transformés en quantités limitées et vend des produits
manufacturés au Burkina Faso322(*).
II.2. Les produits
d'échanges
Parmi les produits japonais, le Burkina Faso importe des
voitures pour le transport des personnes, des bouteurs (buldozers) et des
véhicules pour le transport de marchandises323(*). Quant aux exportations, on
peut noter que le Burkina exporte majoritairement du sésame en direction
du Japon qui a représenté une proportion de l'ordre de 99,4% en
2017. Globalement, les échanges commerciaux entre les deux pays se
caractérisent par un déficit chronique très
défavorable au Burkina Faso. Ce déficit est essentiellement
dû à la faible compétitivité des produits
burkinabè. Le Burkina Faso exporte peu de produits de valeurs vers le
Japon alors que ce dernier exporte des produits de hautes qualités et
souvent très coûteuses vers le Burkina Faso. La balance
commerciale entre les deux pays reste largement déficitaire. Par exemple
en 2017, la valeur des importations burkinabè en provenance du Japon
s'élève à 73 357 900 000 FCFA. Les exportations
en direction du Japon en 2017 se chiffrent 16 659 800 000 FCFA.
Le solde commercial, c'est-à-dire la différence entre les
exportations et les importations est de - 56 701 100 000
FCFA324(*).
On remarque que le Japon est un grand importateur du
sésame burkinabè. Cependant la filière rencontre
d'énormes difficultés en matière d'exportation vers les
pays asiatiques qui sont les plus gros clients. Selon l'Economiste du
Faso, l'image du sésame burkinabè a été
sévèrement ternie au Japon en 2013. En effet par deux fois, des
cargaisons de sésame à destination du Japon ont été
contrôlées positives à des substances toxiques où
l'on a détecté un taux élevé d'imidaclopride. Au
total 581,94 tonnes de sésame étaient
incriminées325(*). Ces situations portent un coup dur aux
échanges commerciaux entre les deux pays et a pour conséquence de
décrédibiliser les produits burkinabè sur le plan
international.
Pour mettre plus de sérieux dans ses échanges
commerciaux, le Burkina Faso doit prendre des résolutions pour
intensifier le contrôle de la qualité de ses produits à
l'exportation. En 2017, les deux plus grands importateurs du sésame sont
Singapour (40,3%) et le Japon (29,1%)326(*). La culture du sésame continue d'augmenter. A
cet effet le Japon doit davantage accompagner le Burkina Faso en vue de
renforcer leur partenariat pour développer le secteur. Le Japon peut
encourager les flux de capitaux privés en incitant les entreprises
japonaises à s'investir davantage dans le secteur. II peut
également aider à la modernisation et à la mise à
disposition de main-d'oeuvre et de formation technologique en faveur des
agriculteurs burkinabè. De plus, le Burkina Faso ne
bénéficie pas d'un Bureau du Japan External Trade Organisation
(JETRO). Ce qui fait que le niveau des échanges commerciaux ne
s'améliore pas et le commerce direct entre les deux pays n'est pas
totalement encouragé. L'ouverture d'un bureau du JETRO au Burkina Faso
permettra donc d'assurer la tangibilité de la coopération
économique entre les deux pays.
III. Le développement
des ressources humaines et les limites de la coopération
nippo-burkinabè.
Le rôle des volontaires japonais, la question du
programme de stages et les imperfections dans la coopération
nippo-burkinabè sont analysés ici.
III.1. Le JOCV au Burkina
Faso
Le Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) ou le
programme du service des volontaires de la coopération japonaise a
été créé en 1965. C'est une action du gouvernement
du Japon pour encourager ses citoyens à participer à
l'émergence des pays en voie de développement. Ce programme
géré par la JICA, ne pourvoit, en principe, ni de financement, ni
de fourniture ou de matériels au profit des bénéficiaires,
sauf de la technicité. Leurs objectifs visent à contribuer au
développement ou à la reconstruction des pays en voie de
développement, à approfondir la compréhension mutuelle et
les liens d'amitié entre le pays hôte et le Japon et à
favoriser un échange d'expériences et le développement
personnel des volontaires.327(*)
Dans le cadre de la coopération bilatérale
Burkina Faso-Japon, l'Echange de note de service des JOCV a été
signé par les deux gouvernements respectifs le 6 octobre 1998. Ce fut la
création du Bureau du JOCV au Burkina Faso. En avril 2000, le Burkina
Faso reçoit ses premiers volontaires japonais qui étaient au
nombre de trois. En avril 2006, le Bureau du JOCV devint le Bureau de la JICA
au Burkina Faso. Chaque année, quatre groupes de jeunes volontaires
japonais sont envoyés et affectés pour deux ans dans des services
publics et des ONG. Ils sont envoyés pour accompagner les populations
à la base dans leurs efforts de développement. Ces jeunes
volontaires travaillent et vivent au sein des populations locales328(*). Affectés dans
plusieurs localités, ils partagent leur savoir-faire dans les domaines
de l'éducation, de l'environnement, de l'eau et du sport avec leurs
homologues sur le terrain. Entre 2000 et 2018, le Burkina Faso a reçu au
total 400 volontaires japonais329(*).
Le JOCV intervient dans les domaines définis comme
prioritaires à savoir l'agriculture et l'éducation, mais aussi la
santé, le développement communautaire et l'encadrement de la
jeunesse330(*).Ces
volontaires interviennent également dans le domaine de l'environnement,
dans l'enseignement supérieur, dans l'administration territoriale, dans
l'action sociale, etc. Ce sont des promoteurs du développement rural;
des agriculteurs de riz, de légumes et de fruits; des éleveurs;
des experts en cultures; des planteurs d'arbres; des éducateurs en
environnement; des enseignants d'école primaire; d'éducation
physique; des instructeurs de judo; des entraîneurs de volleyball et de
baseball, des animateurs de jeunes; des infirmières et soignants; des
thérapeutes physiques; des prothésistes et orthésistes;
des statisticiens de la santé; des entretiens ménagers; des
techniciens en informatique.331(*)
III.2. Le programme de
stages
Dans le cadre du renforcement des capacités des cadres
burkinabè, des stagiaires des différents ministères
prennent part chaque année à des formations organisées au
Japon ou dans le cadre de la coopération sud-sud dans des pays tiers.
Des experts japonais sont également envoyés dans le cadre de
l'exécution des projets de développement332(*). Selon le rapport 2018 de
l'ambassade du Japon au Burkina Faso, 1323 stagiaires
burkinabè ont été envoyés au Japon pour la
formation entre 1978 (date du lancement du programme) et 2018. Egalement,
460 experts japonais ont été envoyés au
Burkina Faso333(*).
En 2013, lors de la TICAD V, le Japon a mis en place l'African
Business Education Initiative for Youth (Initiative de l'éducation dans
le secteur des affaires en faveur des jeunes africains) dite Initiative ABE.
L'objectif est de donner la possibilité à quelque 1000 jeunes
africains de suivre un cursus de maîtrise débouchant sur des
stages en entreprise au Japon. L'initiative vise à contribuer à
la formation des ressources humaines nécessaires au développement
du secteur industriel et du monde des affaires en Afrique. Outre
l'expérience professionnelle qu'elle permet aux stagiaires
d'acquérir, l'Initiative ABE favorise la diffusion des
technologies334(*). Ce
partenariat publique-privé témoigne de l'ouverture et de la
détermination du Japon à équiper la main-d'oeuvre
africaine de demain. Le programme vise à partager le professionnalisme
japonais au travail avec des stagiaires africains. Entre 2014 et 2018,
15 stagiaires burkinabè ont
bénéficié de cette initiative335(*). Même si leur nombre
est relativement faible, le Japon accorde également des bourses
d'études aux étudiants du Burkina Faso. Entre 2010 et 2018,
24 boursiers ont bénéficié d'une bourse
d'étude japonaise336(*). Malgré les bonnes relations entre le Japon
et le Burkina Faso, il existe quelques imperfections à l'état
actuel de la coopération entre les deux pays.
III.3. Les imperfections dans la
coopération entre le Japon et le Burkina Faso.
Dans le domaine de l'éducation, à la TICAD II de
1998, le Japon s'est engagé à assurer l'éducation primaire
dans tous les pays africains jusqu'à 2015. De 1995 à 2015, le
Burkina Faso a bénéficié de cinq phases du Projet de
construction et d'équipement de salles de classes dans les écoles
primaires. Cependant, deux grandes régions ayant des priorités
beaucoup plus élevées que les autres n'ont pas
bénéficié de ces phases. Il s'agit de la région de
l'Est et du Sahel. Il faudrait donc travailler à ce que cette
coopération puisse prendre en compte ces deux régions hautement
prioritaires à l'avenir.
Dans le secteur de l'agriculture, le Japon met l'accent sur
l'aide alimentaire KR I composée de vivres. Au Burkina Faso, il y a un
manque de compétence technique, de capacité et sans doute de
volonté alors que le pays regorge d'énormes potentialités
dans le secteur agricole. L'agriculture burkinabè a donc besoin qu'on
lui apporte de la technicité afin de permettre une augmentation de la
production agricole. La coopération japonaise doit donc mettre l'accent
sur les projets de coopération de technique, la formation des acteurs du
secteur agricole et le programme KR II.
On peut également souligner la faiblesse des relations
économiques entre les deux pays. Du côté du Japon, en
dehors de CFAO Motors racheté en 2012 et de l'entreprise SYSMEX
implantée en 2015, aucune autre entreprise japonaise n'est
présente au Burkina Faso. De plus, l'absence d'un Bureau du JETRO au
Burkina Faso fait que le commerce et l'investissement entre les deux pays n'est
pas totalement encouragée. Du côté du Burkina Faso, le
Japon manifeste un intérêt pour le Burkina Faso en tant que pays
fournisseur de matière première. Les sociétés
japonaises s'intéressent notamment aux gisements de manganèse.
Jusqu'à présent, aucune entreprise japonaise n'a encore obtenu le
droit d'exploitation d'un gisement minier au Burkina Faso. Ce qui est grave
encore, le peu de produit que le Burkina Faso exporte en direction du Japon
n'est pas souvent conforme aux règles de production qui leur permet de
s'insérer totalement dans le marché international en
général et celui du Japon en particulier. Le sésame
burkinabè est souvent victime de déclassement à cause des
pesticides utilisés. Le produit souffre donc de la mauvaise
qualité. Les autorités burkinabè doivent donc sensibiliser
les producteurs à l'utilisation de produits de traitements
homologués.
Enfin, les problèmes sécuritaires que connait le
Sahel a également un impact sur la coopération entre le Japon et
le Burkina Faso. Depuis la prise d'otages de la raffinerie d'In Amenas, en
Algérie, en janvier 2013, qui a coûté la vie à dix
employés japonais, il y a une obsession de Tokyo pour les questions du
terrorisme et de la protection de ses ressortissants en Afrique. C'est pourquoi
l'Ambassade du Japon au Burkina Faso demande toujours à ses
ressortissants de s'éloigner des zones à risques. Actuellement,
plusieurs travaux d'exécution soutenus par le gouvernement japonais
n'avancent pas normalement à cause des questions sécuritaires.
C'est le cas du Projet CSPS, de la construction de l'ENEP de Kaya, etc. En
2013, la phase V du projet de construction des écoles primaires a eu du
mal à prendre fin à cause de la crise malienne de 2012.
En conclusion, de sa coopération avec les pays
asiatiques, celle avec le Japon est l'une des plus dynamiques. L'investissement
du Japon au Burkina Faso est fort considérable et le Japon respecte
l'appropriation par le Burkina Faso de son processus du développement en
soutenant ses programmes de développement. Dans la mise en oeuvre de ces
projets de développement, le Japon tient toujours compte du principe
d'auto-assistance. Le champ d'intervention de cette coopération couvre
non seulement les domaines des besoins humains fondamentaux des populations,
les infrastructures socio-économiques et le développement des
ressources humaines. Les secteurs jugés prioritaires sont
l'éducation de base, l'agriculture et récemment
l'intégration régionale a été
insérée. D'autres secteurs prioritaires mais qui sont hors
programmes sont également pris en compte. Il s'agit des secteurs de la
santé, de l'eau et de l'environnement. La coopération
s'étend également à la paix et à la
stabilité qui sont des conditions préalables au
développement socio-économique. Comme le souligne l'Ambassadeur
FUTAISHI Masato en 2017 « ce mécanisme de
coopération permet de réaliser une coopération globale et
équilibrée en vue de construire une société
pacifique et prospère qui assure à tous une vie
digne »337(*). Il est bien vrai que la coopération
japonaise au Burkina Faso s'appuie en grande partie sur les conclusions de la
TICAD, malgré tout, aucun projet de coopération triangulaire
impliquant une collaboration entre le Japon et un autre pays donateur
participant à la TICAD n'a pas encore été mis en oeuvre
au Burkina Faso338(*).
Il ne fait aucun doute que des engagements bien structurés entre le
Japon, le Burkina Faso et d'autres pays donateurs sous les auspices de la TICAD
auront le potentiel d'offrir des avantages tangibles pour la croissance et le
développement du Burkina Faso.
Conclusion générale
Lancée en 1993, la TICAD est le cadre de la politique
de coopération du Japon en Afrique. Avec ce forum, le Japon a
tissé un nouveau rapport de coopération avec ses partenaires
africains en faisant usage de son expérience de développement sur
le continent sans avoir un pouvoir de colonisateur dans la région. La
TICAD a été le premier soutien important offert par un pays non
occidental à l'Afrique. Elle a grandement contribué à
promouvoir la prise en considération des idéaux de
développement en Afrique. Elle a également évolué
en tant que processus destiné à promouvoir le
développement africain tel que le conçoivent les pays africains
et les peuples africains. Ce qui signifie qu'elle prône une prise de
conscience par les Africains d'être les principaux acteurs du
développement de l'Afrique. C'est l'appropriation du
développement. Suivant cette philosophie, le Burkina Faso a mis en place
ses propres documents de stratégie de réduction de la
pauvreté comme le CSLP, la SCADD et le PNDES. Il a aussi établi
des documents de politique sectorielle de développement comme le PDSEB
(éducation), le PNSR (agriculture), le PNDS (santé) la
Stratégie de développement du secteur des transports ou la
politique nationale en matière d'environnement. Toutes les initiatives
de coopération du Japon au Burkina Faso se basent sur les objectifs de
ces documents référentiels. C'est la politique d'auto-assistance
du Japon dans les pays en développement.
Le partenariat international est aussi un principe fondamental
de la TICAD. C'est un esprit qui vise à renforcer la coopération
réciproque de la communauté internationale et la
solidarité parmi les différents pays dans leur soutien
vis-à-vis de l'Afrique, de sorte à soutenir l'indépendance
et l'autonomie des Africains. Autrement dit, la TICAD sert de plate-forme pour
promouvoir la collaboration et la coopération entre les participants
à la TICAD, en encourageant leurs efforts conjoints en faveur du
développement en Afrique. Au Burkina Faso, le Japon met conjointement en
oeuvre des projets de développement avec des organisations
internationales comme le PNUD (environnement) et le groupe de la Banque
mondiale (au Burkina Faso, la Banque mondiale fait la promotion de la
couverture sanitaire universelle, pilier 2 de la TICAD VI).
La TICAD joue un rôle catalyseur pour traduire les
philosophies et les priorités qu'elle a promues dans les
différents Plans de mise en oeuvre. Comme nous l'avons mentionné
dans le chapitre 1 de la deuxième partie, le premier indicateur de
l'impact de la TICAD reste l'évolution de la part de l'aide japonaise
dans les pays africains. Au Burkina Faso, le Japon a accordé plus de 340
milliards de FCFA d'aide au développement entre 1994 et 2018339(*). Le Japon accorde
généralement des dons au Burkina Faso.
Selon les plans d'actions de la TICAD, les trois piliers
fondamentaux de la coopération japonaise en Afrique sont la
sécurité humaine, la croissance économique et la
consolidation de la paix.
La sécurité humaine englobe les secteurs des
besoins humains fondamentaux : sécurité alimentaire,
éducation, santé, eau et assainissement, etc. C'est ce pilier qui
est davantage mis en oeuvre par le Japon au Burkina Faso. Le Burkina Faso a
bénéficié de nombreux projets de développement dans
ces différents secteurs. Les résultats sont à la fois
quantitatifs et qualitatifs.
Quantitatifs parce que le Japon a contribué à
construire de nombreuses infrastructures socio-économiques au Burkina
Faso. Dans le secteur de l'éducation, on peut citer la construction des
infrastructures éducatives au primaire (1410 salles de classe) et au
secondaire (43 CEG) et la construction des écoles de formation (Dori et
Kaya). Dans le secteur de l'eau, la construction de forages (1131 forages)
notamment dans les deux régions du Plateau Central et du Centre Sud. Au
niveau sanitaire, la construction de maternités et de CSPS (48 CSPS). Le
Japon apporte également chaque année de l'aide alimentaire en
grande quantité (environ 48 milliards de FCFA d'aide alimentaire) au
Burkina Faso.
Qualitatifs parce que le Japon a soutenu divers projets de
coopération technique. Dans le secteur agricole, on peut citer les
initiatives CARD, SHEP et IFNA. Dans le secteur éducatif, les
initiatives ASEI/PDSI, PACOGES et ABE. Dans le domaine de l'environnement,
l'initiative Cool Earth 50, etc.
Le deuxième pilier de la TICAD est la croissance
économique. Le Japon cherche à mettre davantage l'accent sur le
développement des infrastructures régionales comme les routes et
les autoroutes, la promotion du commerce et de l'investissement et l'assistance
de la réforme de la structure économique. Au Burkina Faso, c'est
à partir de 2012 que le développement des infrastructures
régionales a été placé comme un secteur prioritaire
de la coopération japonaise. Le commerce entre les deux pays
s'accroît également surtout avec l'augmentation de la production
du sésame au Burkina Faso depuis 2013.
Le troisième pilier de la TICAD est la consolidation de
la paix qui, selon le Japon, est la base du développement. Le Japon
fournit divers types de soutien notamment une assistance aux
réfugiés et une assistance électorale au processus de
paix, etc. Afin de renforcer la démocratie et la
légitimité des dirigeants du Pays des hommes intègres, le
Japon apporte une assistance électorale au Burkina Faso même si
cette aide est relativement modeste. Le Japon apporte également sa
solidarité aux réfugiés présents au Burkina Faso
notamment ceux du Mali à travers des dons accordés aux
organisations internationales particulièrement le PAM et le HCR.
L'assistance du Japon en Afrique en général et au Burkina Faso en
particulier à travers la TICAD est donc globale.
Cela nous ramène à notre question de
départ. Le Japon a-t-il contribué à promouvoir le
développement socio-économique au Burkina Faso ? Autrement
dit, la TICAD a-t-elle un impact sur le développement
socio-économique au Burkina Faso ? Nous pouvons dire que le Japon
contribue à sa manière à la promotion du
développement socio-économique du Burkina Faso. De plus, il y a
actuellement une réelle volonté politique du Japon pour soutenir
pleinement les efforts du Burkina Faso. Cette volonté est
concrétisée par les diverses consultations bilatérales
entre les deux pays depuis 2007. L'objectif de ces consultations
bilatérales étant de consolider la coopération entre les
deux pays. Malgré tout, on notera quelques imperfections à
l'état actuel de la coopération entre le Japon et le Burkina Faso
comme la faiblesse des relations économiques ou encore l'impact des
questions sécuritaires.
Comme nous l'avons dit plus haut, la TICAD est le miroir de la
coopération japonaise en Afrique. Pour notre part, il faut être
reconnaissant au Japon d'avoir lancé un tel forum durant la
période que l'on a surnommé les décennies perdues pour le
développement de l'Afrique, c'est-à-dire les années 1990,
à cette époque peu glorieuse où le continent africain
était soumis aux pénibles contraintes imposées par les
Programmes d'ajustement structurel (PAS).
Source et bibliographie
I. Les sources
I.1. Les archives
ü CNA, 2005, Ambassade du Burkina Faso au Liban et au
Japon : correspondance, télégrammes, rapports mensuels,
lettres de créances, 1963-1983, 7V347.
ü CNA, 2009, Haute-Volta-Japon : rapport de
coopération bilatérale 1982, 43V264
ü CNA, 2014, Japon : correspondance
générale, 1985-1986, 20V196.
ü MAECR, 2011, Fiche sur l'état de la
coopération Burkina Faso-Japon, KM126.
ü MAECR, 2013, Point sur la coopération
Burkina Faso-Japon, KM194.
I. 2. Les
rapports
ü INSD, 2018, Annuaire du commerce extérieur
2017, Ouagadougou, Imprimerie nationale, 186 pages.
ü MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU
DEVELOPPEMENT, 2018, Coopération pour le développement, les
financements innovants comme alternative pour le financement du
développement au Burkina Faso : réalités et
perspectives, Ouagadougou, Direction générale de la
coopération (DGCOOP), 185 pages.
ü MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE
L'ARTISANAT, 2018, Balance commerciale et commerce extérieur
2018, Imprimerie nationale, 57 pages.
ü MOFA, 1995, Japan's ODA Annual 1994.
ü MOFA, 2004, Japan's ODA White paper 2003.
ü MOFA, 2015, Japan's ODA White paper 2014.
ü MOFA, 2016, White paper on development cooperation
2015.
ü MOFA, 2017, White paper on development cooperation
2016.
ü JICA et Mitsubishi UFJ Reasearch and consulting,
2013, la revue des vingt années de la TICAD, Rapport principal,
Tokyo, 79 pages.
ü JICA et Mitsubishi UFJ Reasearch and consulting, 2013,
la revue des vingt années de la TICAD, Rapport
complémentaire, Tokyo, 313 pages.
ü JICA, 1997, rapport de l'étude du concept de
base pour le projet de construction d'écoles primaires (phase 2) au
Burkina Faso.
ü JICA, 2004, rapport de l'étude du concept de
base pour le projet de construction d'écoles primaires (phase III) au
Burkina Faso, 80 pages.
ü MEBA et JICA, 2009, rapport de l'étude du
concept sommaire pour le 4e projet de construction d'écoles
primaires au Burkina Faso.
ü MEBA et JICA, 2012, rapport de l'étude du
concept sommaire pour le projet de construction d'écoles primaires
(phase V) au Burkina Faso.
ü MEBAM et JICA, 1996, rapport de l'étude du
concept de base pour le projet de construction d'écoles primaires au
Burkina Faso, volume supplémentaire.
ü MENA et JICA, 2015, rapport d'étude
préparatoire pour le projet de construction d'établissements
d'enseignements post-primaire au Burkina Faso, 114 pages.
ü MENA et JICA, 2017, rapport d'étude
préparatoire pour le projet de construction d'établissements
d'enseignements post-primaire phase II au Burkina Faso.
ü MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES, 2015, rapport final du projet TICAD V « adaptations en
vue de l'amélioration de la sécurité alimentaire au
Burkina Faso » (janvier 2014 - juin 2015), 30 pages.
ü MINISTÈRE DE LA SANTE et JICA, 2012, rapport
de l'étude préparatoire pour le projet de construction de Centres
de santé et de promotion sociale (CSPS) au Burkina Faso.
ü MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE et JICA, 2013, Projet de gestion participative et durable des
forêts dans la province de la Comoé, rapport
d'achèvement du projet (juin 2007-décembre 2012), Ouagadougou,
Association japonaise de technologie forestière (JAFTA), 172 pages.
ü MINISTERE DES INFRASTRUCTURES, 2017, Étude
préparatoire du projet d'amélioration de la rocade sud-est du
boulevard de Tansoba au Burkina Faso, rapport final, Ouagadougou, JICA,
134 pages.
ü MOFA et al, 2003, le processus de la TICAD : 10
années de résultats concrets.
ü MOFA et al, 2013, TICAD V- Main dans la main avec
une Afrique plus dynamique, 1er-3 juin, Japon, Yokohama, 9
pages.
ü MOFA, 2003, TICAD III : soutenir le
développement de l'Afrique au XXIe siècle, New-York, Kaori
Ishii, Unité spéciale de la TICAD, 16 pages.
ü MOFA, 2010, TICAD IV, rapport
d'activités annuel 2009, résumé, Tokyo, 28 pages.
ü MOFA, 2016, TICAD V, rapport
d'activités 2013-2015, résumé, 32 pages.
ü MOFA, 2017, TICAD, initiatives japonaises en
2017, 10 pages.
ü MOFA, 2018, TICAD, rapport 2018,
progrès accomplis et voies à suivre, 11 pages.
ü MOFA, 2019, TICAD VI-Rapport 2016-2018, 18
pages.
ü PNUD, 2016, Partenariats pour le
développement en Afrique, le Japon et le PNUD en
action », 7 pages.
I.3. Les documents officiels
ü MOFA, 1992, charte de l'aide publique au
développement, traduction non officiel, 7 pages.
ü MOFA, 1993, Déclaration de Tokyo sur le
développement africain « vers le 21e
siècle ».
ü MOFA, 1998, Développement de l'Afrique au
XXIe siècle, l'agenda de Tokyo pour l'action, 21 octobre.
ü MOFA, 2003, charte de l'aide publique au
développement du Japon, 14 pages.
ü MOFA, 2003, discours de clôture de M. Yoshiro
Mori, président de la TICAD III, traduction provisoire, Tokyo,
1er octobre.
ü MOFA, 2003, remarque luminaires de M. Yoshiro Mori,
président de la TICAD.
ü MOFA, 2003, résumé du
président de la conférence de la TICAD III, traduction
provisoire.
ü MOFA, 2008, TICAD IV Déclaration de Yokohama
Vers une Afrique qui gagne, 8 pages.
ü MOFA, 2008, TICAD IV, Plan d'action de
Yokohama, 18 pages.
ü MOFA, 2015, Charte de la coopération au
développement, traduction provisoire, 17 pages.
ü TICAD VI, Déclaration de Nairobi: Faire
progresser l'agenda du développement durable de l'Afrique -TICAD
partenariat pour la prospérité, Nairobi, 10
pages.
I. La bibliographie
II.1. Les ouvrages
ü BELL, PM and MARK Gilbert, 2017, the world since
1945, an international history, 2nd edition, Bloomsbury academic, 756
pages.
ü KI Doulaye Corentin, 2008, introduction à la
politique étrangère du Burkina Faso: la période
voltaïque, 1960-1983, Ouagadougou, les Presses africaines, 375
pages.
ü KINGSTON Jeff, 2013, Contemporary Japan: history,
politics and social change since 1980, second edition, London,
Wiley-Blackwell, 302 pages.
ü RENOUVIN Pierre et DUROSELLE Jean-Baptiste, 1991,
introduction à l'histoire des relations internationales, Paris,
Armand Colin, 532 pages.
ü SOUYRI Pierre-François 2016, Moderne sans
être occidental. Aux origines du Japon d'aujourd'hui, Paris,
Gallimard, 496 pages.
ü VERNEUIL, Christophe et VERNEUIL, Soraya, 2012,
Japon et Chine, concurrences régionales, ambitions mondiales,
Paris, Ellipse, 156 pages.
II.2. Les mémoires
ü BANDE Delwende Samuel, 2008, Les relations
diplomatiques entre le Burkina Faso et la République de Chine
(Taiwan) : enjeux politiques autour de la reconnaissance internationale du
statut de la République de Chine (Taïwan), mémoire de
maitrise en relations publiques internationales, Université libre du
Burkina.
ü KABRE Grégoire, 2012-2013, l'intervention de
la coopération internationale dans le développement de
l'enseignement de base au Burkina Faso: l'exemple de la coopération
japonaise à travers l'Agence japonaise de coopération
internationale (JICA), Mémoire de fin de formation, Ouagadougou,
INHEI, 75 pages.
ü MBIDA Patrick Roger, 2011, De la TICAD III
à la TICAD IV : enjeux et mutations de la politique africaine de
coopération du Japon, master professionnel en relation
internationale, Université Yaoundé II, 112 pages.
ü OUEDRAOGO Fatoumata, 2015-2016, la contribution de
la coopération japonaise à la gouvernance scolaire au Burkina
Faso, mémoire de fin de formation, Ouagadougou, INHEI, 72 pages.
ü SANKARA Salif, 2018, La contribution de la
coopération japonaise au développement économique et
social du Burkina Faso : cas de l'aide alimentaire « KR1 »,
mémoire de fin de cycle, Ouagadougou, INHEI, 90 pages.
ü ZOA Christian Alima, 2008, Les clés de
l'offensive politico-diplomatique du Japon en direction de l'Afrique et du
Cameroun, rapport de DEA en relation internationale, Université
Yaoundé II, 165 pages.
II.3. Les articles
ü AKAHA Tsuneo, 2011, « Japon : trouver
l'équilibre entre soft power et hard power », in Politique
étrangère, Paris, IFRI, pp.115-127.
ü AMBASSADE DU JAPON EN COTE D'IVOIRE, 2013,
« Réunion préparatoire des experts de la TICAD V
à Ouagadougou », in Lettre du Japon, n°5, 4
pages.
ü AMPIAH Kweku, 2004, « L'Afrique du Sud dans
la TICAD : un rôle pivot », in Afrique
contemporaine, n°212, Paris, De Boeck Supérieur, pp.
91-112.
ü Anonyme, 2010, « Projet d'appui à la mise
en place de comités de gestion dans les écoles primaires »,
in Amitié et Développement, n°23, Ouagadougou,
JICA, 6 pages.
ü ANTIL Alain, 2017, « Japan's Revived African
Policy, in Afrique en questions, n°34, Paris, les Editoriaux de
l'IFRI, 6 pages.
ü AUREGAN Xavier, 2018, « L'Inde en Afrique ou
l'impossible rattrapage vis-à-vis de la Chine », in l'Espace
politique, n°36, Paris, Varia, pp. 1-20.
ü BERT Edström, 2010, « Japan and TICAD
process», in Asia Paper, Stockolm, Institute for security &
Development policy, 36 pages.
ü BLAISE Séverine, 2006, « De l'aide
à la coopération économique : pour un réexamen de
la politique japonaise », Revue Tiers-Monde,
n° 186, Paris, Harmattan, pp. 307-328.
ü BOUISSOU Jean-Marie, 1999, « Déchiffrer
« l'énigme » de la politique extérieure du Japon
», in Etudes internationale, Volume 30, numéro 1,
Québec, Institut québécois des hautes études
internationales, pp.9-30.
ü BOULANGER Eric, 2013,
« l'ambiguïté de l'identité japonaise en relation
internationale et la montée en puissances de la Chine : la fin du
pacifisme constitutionnel ? », Relations
internationales, n°154, Paris, les Presses universitaires de France
(PUF), pp. 125-142.
ü CHAPONNIERE Jean-Raphaël et LAUTIER Marc, 2014,
« le modèle de développement de l'Asie de
l'est » in Recherche internationale, Paris, Association Paul
Langevin, n°98, 121-146.
ü CORNELISSEN Scarlett, 2004, « la politique
japonaise de moyenne puissance et l'Afrique : un cadre d'analyse pour
dépasser l'opposition réactif-proactif », in
Afrique contemporaine, n°212, Paris, De Boeck Supérieur, pp.
33-53.
ü DEFARGES Philippe Moreau, 2004, « De la SDN
à l'ONU », in revue Pouvoirs, n°109, Paris, Le Seuil,
pp. 15-26.
ü DONNELLY Elisabeth, 2008, « Japan-African
engagement and TICAD IV: can Japan lead the way on African development? In
Chatham house, 1-36 pages.
ü EYINLA Bolade, 2018, « Promoting Japan's national
interest in Africa: a review of TICAD», in Africa Development,
volume XLIII, n°3, CODESRIA, page 107-122.
ü FRANK Robert, 2003, « penser historiquement les
relations internationale », in Annuaire Français de Relations
Internationales, Bruxelles, Edition Bruylant, page 42-65.
ü JALLAIS Bérénice, 2004, « Le Japon
et l'Organisation des Nations-Unies : efforts récompensés et
espoirs frustrés », in revue Ebisu, n°33, Paris, la
Maison franco-japonaise, pp. 209-237.
ü KAJI Sahoko et JAQUET Christophe, 2002,
« Japon: la décennie perdue », in Politique
étrangère, n° 67, Paris, IFRI, pp. 67-90.
ü KAMO Shozo, 2004, « de l'engagement
économique à l'engagement politique: les nouvelles orientations
de la politique africaine du japon », in Afrique contemporaine,
n° 212, Paris, De Boeck Supérieur, pp. 55-66.
ü KATSUMATA Makoto, 2009, « La perspective des
relations entre le japon et l'Afrique à l'âge de la mondialisation
», in Revue des deux mondes, Paris, pp. 37-44.
ü KITA Julien, 2008, « L'aide publique au
développement japonaise et l'Afrique : vers un partenariat
fructueux », in Asie Vision, n°10, Paris, Institut
français de relations internationales (IFRI), 1-36 pages.
ü LEHMAN P. Howard, 2005, « Japan's foreign aid
policy to Africa since the Tokyo International Conference on African
Development », Pacific Affairs, volume 78, n° 3, Columbia,
University of British, pp. 423-442.
ü LEHMAN P. Howard, 2007, « Japan's national
economic identity and African development: an analysis of TICAD», in
Research Paper, n° 61, Helsinki, World institute for development
economics research (WIDER), pp. 1-17.
ü MEYER Claude, 2011, « l'économie japonaise
: miroir de notre futur ? », in Politique
étrangère, Paris, IFRI, pp.101-114.
ü NAGATSUJI Takashi, 2016, « Determinants of Japan's
ODA Allocations in Africa », in Asia Vision, n° 84, Paris,
IFRI, 32 pages.
ü NICOLAS Françoise, 2020, « La Corée
en Afrique : Entre soft power et intérêt économique »,
in Centre Asie, Paris, IFRI, 1-43.
ü OBAYASSI Minuro, 2004, « TICAD, un processus
favorable au développement de l'Afrique », in Afrique
Contemporaine, n°212, Paris, De Boeck Supérieur, pp. 77-89.
ü OGASAWARA Minoru, 2004, « la
coopération japonaise à l'égard de l'Afrique : vers un
développement de la coopération Asie-Afrique », in
Afrique contemporaine, n°212, Paris, De Boeck Supérieur, pp.
67-75.
ü PAJON Celine, 2017 « France and Japan in Africa: a
promising partnership», in Lettre du Centre Asie, n° 71,
Paris, IFRI, pp. 1-6.
ü PERRON-DOISE Marianne, 2014, « Japon :
puissance militaire, puissance civile ? », Revue
Outre-Terre, n°6, Paris, Outre-Terre, pp. 57-70.
ü QUEFELEC Stéphane, 1997, « l'aide
publique au développement dans la coopération économique
japonaise », Ebisu, n°16, Paris, pp. 135-161.
ü SARE Salifou, 2013, « Ministère de
l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire (MASA) et l'Agence
Japonaise de Coopération Internationale (JICA) ont lancé
officiellement le mercredi 12 Juin 2013 les activités du Projet d'Appui
à l'élaboration d'un schéma directeur pour la promotion
d'une agriculture Orientée vers le marché (PAPAOM) » in
Amitié et développement, n°31, Ouagadougou, JICA
Burkina, 8 pages.
ü SOUTOU Georges-Henry, 2005, « Introduction
à la problématique des mondialisations », in
Relations internationales, n°123, Paris, Presses universitaires de
France, (PUF), pp.3-9.
ü TAKAHASHI Susumu, 1999, « Le Japon dans l'ordre
mondial. Une position perpétuellement précaire », in
Etudes internationales, Volume 30, numéro 1, Québec,
Institut québécois des hautes études internationales, pp.
31- 43.
ü TRAORE Clément 2013, « Le
Projet d'Appui aux Comités de Gestion d'Ecole (PACOGES) a
organisé le 26 juillet 2013 une cérémonie de
récompense des meilleurs comités de gestion d'école
(COGES) », in Amitié et développement,
n°31, Ouagadougou, JICA, 8 pages.
ü WATANABE Hirotaka, 2001, « La diplomatie
japonaise après la Deuxième Guerre mondiale »,
Annuaire français de relation internationale, volume II,
Bruxelles, Editions Bruylant, pp. 63-77.
ü YASUO Inoue, 2006, « le modèle japonais et
ses relations avec l'Asie orientale », in Recherche
internationale, n°76, Paris, Association Paul Langevin, pp.83-110.
III. La webographie
ü AGENCE D'INFORMATION DU BURKINA (AIB), 2019,
éducation au Burkina : le Japon offre une école de 48,5
millions de FCFA à la population de Perkoa, disponible sur
www.aib.media/2019/10/11/, consulté le 18 novembre 2019.
ü AGENCE D'INFORMATION DU BURKINA, 2019,
coopération japonaise : les associations s'informent sur les
conditions d'intervention, disponible sur
www.aib.media/regions/2019/01/04/, consulté le 4 décembre
2019.
ü AIB, 2013, Burkina : plus de 2 milliards de FCFA
d'aide alimentaire offert par le Japon, disponible sur
www.news.aouaga.com/h/17678.html, consulté 26 novembre 2019.
ü AICARDI DE SAINT-PAUL Marc, 2016, Japon-Afrique :
genèse d'une relation pérenne, disponible sur
www.academiedegeopolitiquedeparis.com/japon-afrique-genese-dune-relation-perenne/
consulté le 11 aout 2019.
ü AMBASSADE DU JAPON AU BURKINA FASO, 2018, projet de
construction d'une maternité dans le village de Kounou, commune de
Biéha, province de Sissili dans la région du centre-ouest,
disponible surwww.bf.emb-japan.go.jp/itpr_ja00_000197.html,
consulté le 2 sept. 19.
ü AMBASSADE DU JAPON AU BURKINA FASO, 2015, Elections
crédibles et apaisées au Burkina Faso : un soutient de 45600000
FCFA de l'AMBASSADE DU JAPON, disponible
surwww.bf.emb-japan.go.jp/itprtop_/00_000033.html, consulté le
1er juin 2019.
ü AMBASSADE DU JAPON AU BURKINA FASO, 2018, projet
d'approvisionnement en eau potable de l'orphelinat Sainte Thérèse
de Loumbilla, disponible
surwww.bf.emb-japan.go.jp/itpr_ja00_000193.html, consulté le 2
Septembre 2019.
ü AMBASSADE DU JAPON AU BURKINA FASO, 2018, projet
de construction des salles de classe dans l'école primaire de Bouro,
commune rurale de Oula, Province du Yatenga dans la région du Nord,
disponible surwww.bf.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000194.html,
consulté le 2 sept. 19.
ü AMBASSADE DU JAPON AU BURKINA FASO, 2018, projet de
réalisations de forages dans quatre communes de Samba, province du
Passoré dans la région du Nord, disponible sur
www.bf.emb-japan.go.jp/itpr_00_000196.html, consulté le 1er juin
2019.
ü ANONYME, 2017, Forum de la TICAD à
Maputo, disponible sur
www.temoignages-re.cdn.ampproject.org/v/s/www.temoignages.re/spip.php?
Consulté le 1er juin 2019.
ü BANQUE MONDIALE, 2018, Burkina Faso, vue
d'ensemble, disponible sur
www.banquemondiale.org/fr/country/burkinafaso/overview, consulté
le 31 juillet 2019.
ü BIRBA Germaine, 2015, Exportation des produits
agricoles : contre-attaque de la filière, disponible sur
www.leconomistedufaso.bf/2015/01/21/exportation-des-produits-agricoles-contre-attaque-de-la-filière-sesame/,
consulté le 13 août 2019.
ü CASLIN Olivier, 2016, Norio Maruyama : le
Japon veut promouvoir ses propres solutions en matière de
développement,
www.jeuneafrique.com/mag/345725/
consulté le 18 Janvier 2019.
ü CASLIN Olivier, 2016, l'économie japonaise
en quête de débouchés en Afrique, disponible
www.jeuneafrique.com/mag/345718/economie-japonaise-quete-de-debouches-afrique/
consulté le 18 janvier 2019.
ü DARBON (D), 1992, la coopération japonaise:
une aide publique au développement méconnue, disponible sur
www.politique-africaine.com/numeros/pdf/049107.pdf, consulté le
30 avril 2019.
ü DCPM/MAERC, 2007, Coopération Burkina
Faso/Japon: bientôt les premières consultations
bilatérales!»,
http://lefaso.net/spip.php?article21727.
ü DOH Kowoma Marc, 2018, Burkina Faso :
coopération japonaise au Burkina Faso- zoom sur quelques axes
prioritaires, disponible sur
www.allfrica.com/stories/201804230736.html, consulté le 4
décembre 2019.
ü GARNIER Régis, 2004, géographie du
Japon, disponible sur
www.garnier.free.fr/nof/japon/géographie.html, consulté le
29 décembre 2018.
ü GOVERNMENT OF JAPAN, 2016, Foresting high-skilled
human resources toward economic diversification, disponible
www.washingtonpost.com/sf/brand-connect/wp/enterprise/japan-in-africa/,
consulté le 4 février 2019.
ü GOVERNMENT OF JAPAN, 2016, Japan in Africa,
building resilient health system, disponible sur
www.washingtonpost.com/sf/brand-connect/wp/enterprise/japan-in-africa-health-systems/
consulté le 4 février 2019.
ü GUYONNET Emilie, 2013, « Le Japon
défend ses positons », in monde diplomatique
disponible sur
www.monde-diplomatique.fr/2013/06/GUYONNET/49202,
consulté le 7 juin 2019.
ü JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS), 2005,
Dons hors projet, disponible sur
www.jics.or.jp/jics_html-e/profile/pdf/nonpro-f.pdf,
consulté le 2 septembre 2019.
ü JICA, 2018, Le projet d'amélioration de la
production alimentaire et des revenus des ménages à travers la
création et la promotion des sites de référence
(2014-2019), disponible
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity04_02.html,
consulté le 3 Septembre 2019.
ü JICA, 2018, Le projet de renforcement de la
production du sésame au Burkina Faso (PRPS-BF, 2014-2019),
disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity04_01.html,
consulté le 3 Septembre 2019.
ü JICA, 2018, projet d'étude pour la
formulation d'un programme nationale de développement des bas-fonds
(PE-PNDBF, 2017-2019), disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity04_03.html,
consulté le 3 Septembre 2019.
ü JICA, 2018, projet pour la mise en place d'un
modèle de promotion des cultures par l'utilisation du phosphate
naturel (SATRES, 2017-2022), disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity04_04.html,
consulté le 3 Septembre 2019.
ü JUN Hongo, 2013, « TICAD to redefine Japan
aid to Africa », in Japan Times, disponible
www.japantimes.co.jp/news/2013/05/09/national/ticad-to-redefine-japan-aid-to-africa/&.XFijqhi2w0M,
consulté le 4 février 2019.
ü LANGUILLON-AUSSEL Raphael et REVEYAZ Nathalie, 2017,
Japon : cadrage et problématiques générales,
disponible sur
www.geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/japon/cadrage-et-problematiques-generales,
consulté le 29 décembre 2018.
ü MASATO Futaishi, 2017, discours à l'occasion
d'une caravane de presse sur l'état de la coopération
Japon-Burkina Faso, disponible sur
www.sidwaya.bf<m.1410.cooperation-japon-Burkina/.
ü MATSUTANI Minoru, 2013, « the Evolution of
TICAD Since Its Inception in 1993 », in Japan Times du
1er Juin, disponible sur
www.japantimes.co.jp/news/2013/06/01/world/the-evolution-of-ticad-since-its-inception-in-1993/&.XFijMRi2w0M,
consulté le 4 février 2019.
ü MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS
HYDRO-AGRICOLES, 2018, coopération Burkina Faso-Japon : plus de 5000
tonnes de riz pour la sécurité alimentaire, disponible sur
www.agriculture.bf/jcms/fra_9379/fr/, consulté le 29 juillet
2019.
ü MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DU JAPON (MOFA),
2003, la coopération japonaise à l'égard de l'Afrique
en chiffres, glossaire pour comprendre l'Afrique, disponible
www.mofa.go.jp/region/africa/pamph0311_f/word/index.html,
consulté le 31 juillet 2018.
ü MOFA, 1995, Japan's ODA Annual 1994,
disponible sur www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1994/1.html&1,
consulté le 27 mars 2019.
v
ü MOFA, 1997, The preparatory conference for the
second Tokyo international conference on African development (TICAD II),
co-chairs' summary report, disponible sur
www.mofa.go.jp/africa/ticad2/ticad24.html, consulté le 23 mars
2019.
ü MOFA, 1997, Lancing of TICAD II Process,
disponible sur www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/ticad23.html,
consulté le 23 mars 2019.
ü MOFA, 1998, Tokyo international conference on
African development: list of participants, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/list/index.html, consulté le
23 août 2019.
ü MOFA, 1998, The Tokyo international conference on
African development: the second preparatory committee meeting, disponible
sur www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/ticad25.html, consulté le
23 mars 2019.
ü MOFA, 1998, African development toward the 21st
century: The Tokyo Agenda Action, disponible
surwww.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/agenda21.html, consulté le
23 mars 2019.
ü MOFA, 1998, The third preparatory committee meeting
for TICAD II (8 September): Press release, 8 septembre, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/ticad210.html, consulté le 23
mars 2019.
ü MOFA, 2002, Policy speech by Ms. Yorika Kawaguchi,
Minister for foreign affairs of Japan at the United Nations conference center
(Addis Ababa, 26 August), disponible
surwww.mofa.go.jp/region/africa/fmv0208/ethiopia.html, consulté
le 23 mars 2019.
ü MOFA, 2003, Aperçu de la TICAD III,
disponible surwww.mofa.go.jp/region/africa/ticad3/outline_f.html,
consulté le 23 août 2019.
ü MOFA, 2003, Déclaration commémorative
du dixième anniversaire de la TICAD, traduction finale, Tokyo, 1er
octobre, disponible sur www.mofa.go.jp/region/africa/ticad3/index.html"
consulté le 23 août 2019.
ü MOFA, 2003, Keynote speech by Prime Minister
Junichiro Koizumi at the Third Tokyo International Conference on African
Development (TICAD III): Provisional translation), traduction provisoire,
Tokyo, 29 Septembre, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad3/pmspeech.html, consulté le 23
mars 2019.
ü MOFA, 2003, TICAD III senior official- level
preparatory meeting, disponible
surwww.mofa.go.jp/announce/event/2003/2/0228.html, consulté le 23
mars 2019.
ü MOFA, 2004, Japan's ODA White paper 2003,
disponible sur
www.mofa.go/policy/oda/white/2003/part1_1.html&chart04
consulté le 27 mars 2019.
ü MOFA, 2005, Japan's policy for African development:
Prime Minister Koizumi's message to Africa in the context of the G8
Summit, disponible sur www.mofa.go.jp/region/africa/policy.pdf,
consulté le 28 mai 2019.
ü MOFA, 2005, japon: 60 ans de lutte pour la paix
(fiche de synthèse), disponible sur
www.mofa.go.jp/policy/postwar/60th.html, consulté le 25 novembre
2019.
ü MOFA, 2007, Japan-Burkina Faso bilateral
consultation (outline), disponible
www.mofa.go.jp/announce/announce/2007/7/1174493_830.html,
consulté le 23 mars 2019.
ü MOFA, 2008, Exchange of notes on Grant aid
(assistance for underprivileged farmers) through the food and agriculture
organization of the United Nations (FAO) to the Republic of Uganda and Burkina
Faso, disponible sur
www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/3/0314.html, consulté le 23
mars 2019.
ü MOFA, 2008, Assistance by United Nations Trust Fund
for Human security to the project «Eliminating child marriage in Burkina
Faso: A plan for protection empowerment and community action'', disponible
sur
www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/4/1179262_1000.html,
consulté le 23 mars 2019.
ü MOFA, 2009, Emergency aid for flood disaster
in Burkina Faso, disponible sur
www.mofa.go.jp/announce/announce/2009/9/11995560_1142.html,
consulté le 23 mars 2019.
ü MOFA, 2009, première réunion
ministérielle de suivi de la TICAD, communiqué, Gaborone,
Botswana, 22 mars, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad4/folluwup/comm0903-f.pdf,
consulté le 26 Août 2019.
ü MOFA, 2007, TICAD IV regional preparatory
meeting, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad4/pre0710.html, consulté
le 7 mai 2019.
ü MOFA, 2013, 20 ans de processus de la TICAD, et
d'Aide publique au développement (APD) du Japon pour l'Afrique,
disponible sur www.mofa.go.jp/region/africa/ticad_20_fr.pdf ,
consulté le 2 juillet 2018.
ü MOFA, 2013, Fifth Tokyo international conference on
African development, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/page6e_000075.html, consulté le 23 mars
2013.
ü MOFA, 2013, Liste des principaux
représentants des pays participants et des organisations
internationales, disponibles sur
www.mofa.go.jp/files/000006934.pdf, consulté le 6 septembre
2019.
ü MOFA, 2014, première réunion
ministérielle de TICAD V (aperçu et évaluation),
disponible sur www.mofa.go.jp/afr/af2/page3e_000175.html,
consulté le 23 mars 2019.
ü MOFA, 2015, Japan's ODA White paper 2014,
disponible sur
www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2014/html/honnbun/b1/s1_1.html,
consulté le 9 avril 2019.
ü MOFA, 2016, TICAD VI ministerial
pre-conference, disponible sur
www.mofa.go.jp/af/af1/page3e_000548.html, consulté le 23 mars
2019.
ü MOFA, 2016, TICAD VI preparatory ministerial
meeting, disponible sur www.mofa.go/jp/af/af1/page3e_000505.html,
consulté le 23 mars 2019.
ü MOFA, 2016, The TICAD VI preparatory senior
officials' meeting, disponible sur
www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001076.html, consulté le 23
mars 2019.
ü MOFA, 2016, Sixth Tokyo international conference
on African development (TICAD VI), disponible sur
www.mofa.go.jp/af/af1/page3e_0005551.html, consulté le 23 mars
2019.
ü MOFA, 2017, Tokyo international conference on
African development (TICAD) ministerial meeting, disponible sur
www.mofa.go.jp/af/af1/page3e_000721.html, consulté le 6 Septembre
2019.
ü MOFA, 2018, Tokyo international conference on
African development (TICAD) ministerial meeting (overview), disponible sur
www.mofa.go.jp/af/af1/page23e_0005335.html, consulté le 6
Septembre 2019.
ü MOFA, 2018, The terrorist attacks in Ouagadougou,
Burkina Faso (Statement by press secretary Norio Maruyama, disponible
surwww.mofa.go.jp/press/release/press4e_001937.html, consulté le
23 mars 2019.
ü MOFA, 2018, Sommet Japon-Burkina Faso,
disponible sur www.mofa.go.jp/af/af1/bf/page4e_000948.html,
consulté le 23 mars 2019.
ü MOFA, 2019, Coopération Japon-Burkina,
www. mofa.go.jp/files/000470872.pdf, consulté le 28 mai 2019.
ü NATIONS-UNIES, 2008, L'espoir et
l'opportunité à l'ordre du jour de la quatrième
conférence internationale de Tokyo sur le développement de
l'Afrique (TICAD IV), communiqué de presse du 27 mai, publié
tel que reçu, disponible sur
www.un.org/press/fr/2008/AFR1707.doc.htm,
consulté le 8 mai 2019.
ü NATIONS-UNIES, 2008, la quatrième
conférence internationale de Tokyo sur le développement de
l'Afrique (TICAD IV) établit un cadre pour « un siècle
de croissance officielle », communiqué de presse du 30
mai, publié tel que reçu, disponible sur
www.un.org/press/fr/2008/AFR1707.doc.htm,
consulté le 7 mai 2019.
ü OUATTARA Fabé Mamadou, 2019,
coopération japonaise : faire profiter l'Afrique de
l'expérience de développement nippon, disponible sur
www.sidwaya.info/blog/2019/11/20/.
ü OUBIDA François, 2016, Improved
infrastructures key to success moving forward, disponible sur
www.japantimes.co.jp/news/2016/08/26/national/improved-infrastructure-key-succes-moving-forward/&.XPJsZOm2w0M,
consulté le 1er juin 2019.
ü POZZAR Marie-Hélène, 2009, Fiche
technique de l'aide au développement: portrait du Japon, disponible
sur www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/Aide_developpement_-_Portrait_Japon.pdf
consulté le 19 mars 2019.
ü PRESIDENCE DU FASO, 2013, la vice-ministre
parlementaire chargée des Affaires étrangères du Japon a
échangé avec le Président du Faso sur le suivi de la TICAD
V, disponible sur www.news.aouaga.com, consulté le 4 octobre
2019.
ü PRESIDENCE DU FASO, 2019, Ouverture de la 7e TICAD
: le Président du Faso précise les attentes du Burkina,
disponible sur
www.presidencedufaso.bf/ouverture-de-la-7e-ticad-le-president-du-faso-precise-les-attentes-du-Burkina/,
consulté le 1er décembre 2019.
ü RUBIAN Renata, 2011, African development
ministerial discusses climate change, low carbon growth, disponible sur
www.sdg.iisd.org/news/african-development-ministerial-discusses-climate-change-low-carbon-growth/
consulté le 19 mai 2019.
ü SAKANDE Ibrahiman, 2008, Politique
étrangère du Burkina Faso: pour des diplomates et non des
ambassadeurs stars, disponible sur www.lefaso.net/spip.php?
article28354, consulté le 30 juillet 2019.
ü SAWADOGO Hannifah 2019,
« Réhabilitation de la rocade sud-est du Boulevard des
Tansoba: Rendez-vous le 31 décembre 2021», in l'Economiste du
Faso, disponible
www.leconomistedufaso.bf/2019/07/29/,
consulté le 13 août 2019.
ü ZABSONRE Issouf, 2008, « Blaise
Compaoré déplore la faiblesse de l'aide publique au
développement à la tribune de la 4ème TICAD au
Japon, in le faso.net, disponible sur
http://lefaso.net/spip.php?article2705,
consulté le 1er juin 2019.
ANNEXE
Annexe 1: L'assistance japonaise à la
région Afrique subsaharienne en 2017 : Livre blanc 2018, page
102
Calendar year: 2017
(Unit: US$ million)
|
Rank
|
Country or region
|
Grant
|
Loan aid
|
Total
(Net
disbursement)
|
Total
(Gross
disbursement)
|
|
|
Grant aid
|
Grants
provided
through
multilateral
institutions
|
Technical
Cooperation
|
Total
|
Amount
disbursed
(A)
|
Amount
recovered
|
A)-(B)
|
|
|
|
|
1
|
Kenya
|
17.39
|
6.28
|
36.75
|
54.14
|
108.55
|
81.95
|
26.60
|
80.73
|
162.69
|
|
2
|
Mozambique
|
22.52
|
|
25.23
|
47.75
|
101.77
|
0.91
|
100.86
|
148.61
|
149.52
|
|
3
|
Sénégal
|
7.43
|
0.09
|
22.47
|
29.90
|
75.16
|
0.27
|
74.89
|
104.79
|
105.06
|
|
4
|
Tanzania
|
20.68
|
|
21.83
|
42.51
|
34.58
|
2.88
|
31.70
|
74.21
|
77.09
|
|
5
|
Uganda
|
21.70
|
15.41
|
18.44
|
40.15
|
24.44
|
0.36
|
24.07
|
64.22
|
64.58
|
|
6
|
Ghana
|
34.57
|
|
16.63
|
51.20
|
|
|
|
51.20
|
51.20
|
|
7
|
Rwanda
|
20.34
|
1.47
|
15.18
|
35.53
|
7.80
|
|
7.80
|
43.32
|
43.32
|
|
8
|
South Sudan
|
35.74
|
20.34
|
6.48
|
42.22
|
|
|
|
42.22
|
42.22
|
|
9
|
Malawi
|
29.44
|
2.79
|
11.67
|
41.10
|
|
|
|
41.10
|
41.10
|
|
10
|
DRC
|
28.74
|
9.20
|
11.90
|
40.63
|
|
|
|
40.63
|
40.63
|
|
11
|
Ethiopia
|
11.25
|
5.39
|
27.66
|
38.90
|
|
|
|
38.90
|
38.90
|
|
12
|
Côte d'Ivoire
|
22.44
|
1.05
|
15.98
|
38.43
|
|
|
|
38.43
|
38.43
|
|
13
|
Guinea
|
26.65
|
7.78
|
3.42
|
30.08
|
|
|
|
30.08
|
30.08
|
|
14
|
Cameroun
|
7.80
|
7.69
|
8.64
|
16.43
|
12.76
|
|
12.76
|
29.19
|
29.19
|
|
15
|
Liberia
|
22.95
|
3.66
|
2.52
|
25.47
|
|
|
|
25.47
|
25.47
|
|
16
|
Zambia
|
5.77
|
1.29
|
18.36
|
24.13
|
1.22
|
|
1.22
|
25.35
|
25.35
|
|
17
|
Sudan
|
11.34
|
4.59
|
12.34
|
23.68
|
|
|
|
23.68
|
23.68
|
|
18
|
Nigeria
|
13.38
|
4.84
|
9.67
|
23.06
|
|
0.11
|
-0.11
|
22.94
|
22.94
|
|
19
|
Somalia
|
21.17
|
21.08
|
0.32
|
21.49
|
|
|
|
21.49
|
21.49
|
|
20
|
Benin
|
15.86
|
|
4.49
|
20.35
|
|
|
|
20.35
|
20.35
|
|
21
|
Mali
|
16.17
|
4.58
|
3.83
|
19.99
|
|
|
|
19.99
|
19.99
|
|
22
|
Burkina Faso
|
8.87
|
4.20
|
10.50
|
19.37
|
|
|
|
19.37
|
19.37
|
|
23
|
Djibouti
|
13.24
|
1.10
|
3.68
|
16.92
|
|
|
|
16.92
|
16.92
|
|
24
|
Togo
|
16.27
|
|
0.39
|
16.66
|
|
|
|
16.66
|
16.66
|
|
25
|
Zimbabwe
|
9.83
|
2.46
|
5.00
|
14.84
|
|
|
|
14.84
|
14.84
|
|
26
|
Niger
|
12.63
|
9.61
|
1.92
|
14.55
|
|
|
|
14.55
|
14.55
|
|
27
|
Madagascar
|
5.43
|
4.46
|
8.45
|
13.88
|
|
|
|
13.88
|
13.88
|
|
28
|
Mauritania
|
10.95
|
6.04
|
1.78
|
12.73
|
|
|
|
12.73
|
12.73
|
|
29
|
South Africa
|
0.92
|
|
11.02
|
11.94
|
|
0.84
|
- 0.84
|
11.10
|
11.10
|
|
30
|
Botswana
|
0.31
|
|
4.20
|
4.51
|
7.24
|
4.02
|
3.22
|
7.74
|
11.76
|
|
31
|
Chad
|
10.99
|
5.19
|
0.23
|
11.21
|
|
|
|
11.21
|
11.21
|
|
32
|
Central Africa
|
10.86
|
10.86
|
0.03
|
10.90
|
|
|
|
10.90
|
10.90
|
|
33
|
Sierra Leone
|
5.07
|
4.90
|
5.58
|
10.65
|
|
|
|
10.65
|
10.65
|
|
34
|
Cabo Verde
|
1.94
|
|
0.54
|
2.48
|
5.64
|
|
5.64
|
8.12
|
8.12
|
|
35
|
Seychelles
|
5.35
|
|
0.13
|
5.49
|
|
|
|
5.49
|
5.49
|
|
36
|
Namibia
|
0.68
|
|
3.09
|
3.77
|
|
8.37
|
- 8.37
|
-4.60
|
3.77
|
|
37
|
Eswatini
|
2.94
|
2.94
|
0.80
|
3.74
|
|
1.80
|
- 1.80
|
1.94
|
1.94
|
|
40
|
Eritrea
|
2.67
|
|
0.83
|
3.50
|
|
|
|
3.50
|
3.50
|
|
41
|
Republic of the Congo
|
2.72
|
0.93
|
0.46
|
3.17
|
|
|
|
3.17
|
3.17
|
|
42
|
Guinea-Bissau
|
2.41
|
2.41
|
0.41
|
2.82
|
|
|
|
2.82
|
2.82
|
|
43
|
Burundi
|
1.73
|
1.47
|
0.86
|
2.58
|
|
|
|
2.58
|
2.58
|
|
44
|
Mauritius
|
1.92
|
|
0.59
|
2.50
|
0.06
|
2.82
|
-2.75
|
-0.25
|
2.57
|
|
45
|
Sao Tome and Principe
|
2.31
|
0.23
|
2.54
|
|
|
|
|
2.54
|
2.54
|
|
46
|
Comoros
|
1.78
|
|
0.33
|
2.12
|
|
|
|
2.12
|
2.12
|
|
47
|
Lesotho
|
1.32
|
1.17
|
0.32
|
1.64
|
|
|
|
1.64
|
1.64
|
|
48
|
Gambia
|
|
|
0.41
|
0.41
|
|
|
|
0.41
|
0.41
|
|
49
|
Equatorial Guinea
|
|
|
0.15
|
0.15
|
|
|
|
0.15
|
0.15
|
|
Multiple countries in
Sub-Saharan Africa
|
|
89.82
|
89.82
|
18.10
|
107.92
|
306.64
|
3.36
|
303.28
|
411.20
|
414.56
|
|
Sub-Saharan Africa region
total
|
|
637.51
|
265.11
|
379.92
|
1,017.43
|
685.86
|
108.58
|
577.28
|
1,594.70
|
1,703.29
|
Annexe 2 : Zones bénéficiaires du
projet de construction d'écoles primaires phase I (1995)
|
Provinces
|
Site et nombre de salles de classes
|
|
Bazega
|
Lilbouré (2 salles de classes), Napagabtenga
Gougen(3), Nakombogo(1), Doulougou(3)
|
|
Ganzourgou
|
Komséogo(1), Sapaga(2), Zorgo(3), Bollé (2),
Rapadama-T(3)
|
|
Mouhoun
|
Bolomakoté(3), Dora(3), Sécaco(3),
Ségou (3), Soukoui(3), Hankuy-B(3)
|
|
Oubritenga
|
Goabga(3), Bilgo(3), Nedogo (3), Village V3(2), Boulala
(2), Loumbila(3)
|
|
Sissili
|
Péhiri(3), Kayero(3), Baouiga (2), Nebourou(2),
Sapouy(3), Nanano(2), Karaboulé(3), Sadouin (2), Kalian (2), Combiogora
(3
|
Annexe 3 : Zones bénéficiaires du
projet de construction d'écoles primaires Projet phase II
(1997-1998)
|
Provinces
|
Sites et nombre de salles de classes
|
|
Bazega
|
Goanghin (3 salles de classes), Kombissiri E(2),
Kounioudou (3), Nagouma(4), Monomtenga (6), Babdo(2), Nambé (2),
Saponé Marché (2)
|
|
Bougouriba
|
Nisseo(3), Orpoune(3), Diébougou C(6), Balembar
(6), Sangolo(3), Tinguera (3), Bapla(3), Lotto(3)
|
|
Boulkiemdé
|
Yoro-Yarce (3), Sigle(3), Doulou (6), Savily(3), Tampelga
(3), Yorgo (2), Zerkoum (3), Niankado (3)
|
|
Houet
|
Bare (3), Samatoukoro (3), Peni (6), Bodialedaga (6),
Matourkou (6), Tougancoura (3), Lafiabougou D (3))
|
|
Kossi
|
Cissé (3), Kombara (3), Kasso (3), Toni (3),
|
|
Oubritenga
|
Sao (3), Wavousse (3), Boussé A (3), Annexe ENEP
(6), Nomgana (6))
|
|
Passore
|
Yalgatenga (3), Gnangla (2), Dakore (3), Kabo (4), Batono
(3), Zougo (3), Song-Naba (3), Pelgatenga (3);
|
|
Sanguié
|
Bounga (3), Tita B (3), Nemelaye (3), Youloupo (3),
Sandié (3), Reo secteur 8 (3), Reo secteur 9 (3), Baporo (3), Nedialpoun
(3), Reo secteur 1A (6), B (6), Zoula (3), Goundi B (3)
|
|
Sourou
|
Guimou (3), Yeguere (3), Kamina (3), Bagnontenga (3),
Kouayo (3), Gouran (3), Bo (3), Bouaré (3)
|
|
Yatenga
|
Saye (3), Merayawa (3), Soumianga
(3), Yabonsogo (3), Son-Hon (3), Gourcy C (3),
Koudoumbo (3), Boursouma (3)
|
Annexe 4: Zones bénéficiaires du projet de
construction d'écoles primaires Projet phase III (2006)
|
Provinces
|
Site et nombre de salles de classes
|
|
Lorum
|
Rimasse (3 salles de classes), Kandarfo (3), Hitté
(3), Dougouri Ouidi (3), Golanga (3), Kelembali (3), Nassingré
(3)
|
|
Zondoma
|
Kibilo (3), Bougounam A (3), Rassogoma (3), Gourcy secteur
3 (3), Gourcy secteur 2 (3), Lago (3), Kindibo (3), Rassomdé (3),
Bangassomba (3), Garou (3), Guiro-Guiro (3)
|
|
Passoré
|
Samba (3), Kingria (3), Bouré (3), Yaké
(3), Bokin B (3), Kaba (3)
|
|
Bam
|
Lourgou (3), Nakindougou (3), Boussouma (3), Tora (3),
Déméon (3), Ibi (3), Namsiguia (3), Yilou (3), Vato (3)
|
|
Kourweogo
|
Laye (3), Gantin (3), Sourgoubila (3), Méko (3),
Boussé secteur 3 (3), Niou (3), Boussé A (3), Tangsèghin
(3)
|
|
Sanmatenga
|
Wemtenga A (9), Gaoua (3), Bangassé (3), Communale
A (6), Sera (3), Soubeira (3), Sirgui (3)
|
|
Boulkiemdé
|
Seguedin (3), Kanyalé (3), Tanguin (3),
Zoétgomdé (3), Tio (3)
|
Annexe 5: Zones bénéficiaires du projet de
construction d'écoles primaires Projet phase IV
|
Provinces
|
Sites et nombre de salles de classes
|
|
Kouritenga:
|
Balkiou B (3salles de classes), Bassénéré
(3), Silenga (3), Kaokouka (3), Tempéla (3), Yargo C (3), Zimkorom (3),
Kouendé (3), Rakaw (3), Banghrin (3), Lelkom (3), Bicko (3),
Védega (3), Somdabesma (3)
|
|
Boulgou
|
Gassougou (3), Sousoula (3), Wangala (3), Zabré A (3),
Dango (3), Sangou (3), Kipoura (3), Sago (3)),
|
|
Boulkiemdé
|
Ipendo (3), Koanga (3), Niandiala B (3), Guirgo (3), Yagba
(3), Ralo (3), Villa (3), Gode B (3), Salbisgo mixte (3), Banko (3), Tampouy
(3), Rogho (3), Nazoanga C (3), Kaligri (3), Wend-Yam (3), Gogin (3), Villy
Rana (3), Yikiemdin (3)
|
|
Yatenga
|
Sodin (3), Thiou B (3), Kalo (3), Barga bilingue (3), Kao (3),
Binbilin D (3), Koumna-Yargo (3), Ninigui (3), Youba C (3), Lougouri (3), Soubo
(3), Wembatenga (3), Gourga (3), Namissiguma B (3), Sissamb-Koudgo (3), Somiaga
B (3), Talle B (3), Tougou C (3), Samni (3), Nango-Foulcé A (3),
Boulzoma (3),Nodin B (3), Saye (3), Yansa (3), Toumini (3), Gonna (3),
Poédogo (3)
|
Annexe 6: Zones bénéficiaires du projet de
construction d'écoles primaires Projet phase V (2012)
|
Provinces
|
Sites
|
|
Balés
|
Pahin
|
|
Houet
|
Bana, Quezzin Ville D, Secteur 18 B, Kua F, Accard-Ville
Ouest C, Dogona E, Wolokoto, Pala B, Camp militaire D, Kouentou B, Fo B,
Dabokry, Dandé D
|
|
Kénédougou
|
Banzon C, Banzon E, Dougnouna-Gnizanso, Samorogoua C, Sikoria
Dienkandougou, Lanviera, Djiguera B
|
|
Comoé
|
École Sud B de Banfora, École communale
Beregadougou, Bounouna B de Ouo, Korona B, Tatana B ; Bondorola,
Sikanadjo
|
|
Leraba
|
Malon, Monsona, Golona B, Peligna, Sindou B
|
|
Boulgou
|
Kerma, Watinoma, Bissiga, Bangagou B, Wayalghin, Koknoghin,
Zinegodin, Keogo, Ningare, Zano. Bissaya B, Bongo, Bourma de Zoaga, Zoaga B,
Ponga de Zonse
|
|
Koulpelogo
|
Cognitenga, Ganzaga, Ouargaye C, Yourga C
|
|
Kouritenga
|
Finoungo, Boto, Baskouré B, Wedogo-Bokin, Goughin C,
Silminabin
|
|
Tuy
|
Bouety, Kovio, Tiomboni, Bonsé),
Comoé (École Sud B de Banfora, École
communale Beregadougou, Bounouna B de Ouo, Korona B, Tatana B ; Bondorola,
Sikanadjo
|
Annexe 7: Zones bénéficiaires de projet
de construction d'infrastructures éducatives en appui au post primaire
phase I
|
Provinces
|
Sites
|
|
Kadiogo
|
Bloc Kossyam A et B (Arrondissement 7 de Ouagadougou),
Somgandé B et D (arrondissement 4), Widi A et B (Arrondissement 2),
Tampouy E et F (Arrondissement 3), Bassinko B (Arrondissement 8), Kalgondin A,
B, C, D (Arrondissement 5), Balkui A (Arrondissement 11), Yagemkoudogo
(Arrondissement 9), Kiedpalogo/Kouba (Koubri), Yaoghin ( Komki-Ipala), Bloc
Tanzougou A, B et C (Arrondissement 1), Yimdi (Tanghin-Dassouri), Dayoubsi
(Komsilga), Konkaga (Saaba), Nioko II A, B et C (Arrondissement 10
|
|
Kourweogo
|
Koui A (Boussé), Tampelga (Laye), Toeghin A (Toeghin
|
|
Oubritenga
|
Tanzougou (Loumbila), Watinoma (Nagrengo)
|
|
Ganzourgou
|
Wagen (Zam) Meguet A (Meguet
|
|
Sanmatenga
|
Malou (Mané), Gabou ( Barsalogo) Imiougou Natenga
(Korsimoro)
|
|
Namentenga
|
Zambaga (Boulsa), Tougouri (Tougouri), Boko (Dargo)
|
Annexe 8: Zones bénéficiaires du projet de
construction d'infrastructures en appui au post-primaire phase
II
|
Provinces
|
Sites
|
|
Kadiogo
|
Kamsaoghin (Arrondissement 1), Baoghin
(Arrondissement 2), Toudoumwéogo (Arrondissement 4),
Wayalghin (Arrondissement 5), Malgabzanga (Arrondissement 6),
Sandogo (Arrondissement 7), Bissighin (Arrondissement 8),
Kamboince (Arrondissement 9), Bendogo (Arrondissement 10),
Dagnongo (Arrondissement 11)
|
|
Boulkiemde
|
Bingo et Villa (Bingo),Kindi Centre (Kindi), Paas-Ba
et Ménéga (Kokologho), Nandiala centre (Nandiala),
Godo (Pella), Ralo A (Poa), Ramonkodogo et Kamsi
(Ramongo), Kouria, Makoula et Siglé (Siglé),
Guirgo (Sourgou), Thyou (Thyou)
|
|
Sanguie
|
Ekoulkoala (Reo)
|
|
Bazega
|
Goanghin (Doulougou), Kombissiri secteur 5 et
Nagnimi (Kombissiri), Balonghin et Saponé B
(Saponé)
|
|
Zoudweogo
|
Basgana (Manga)
|
Annexe 9 : Zones bénéficiaires du
projet de construction des centres de santé et de promotion
sociale
|
Zones
|
Sites
|
|
Banfora
|
Boko, Boulo, Djontoro, Diamon
|
|
Mangodara
|
Gandougou, Dandougou de Mangodara, Doutié,
Kassandé, Dandougou de Kele, Poïkoro, Sampobien, Touroukoro
|
|
Dédougou
|
Syn, Toroba de Douroula, Toroba de Kari, Kari de Tikan,
Fakouna, Tiokuy
|
|
Tougan
|
Gorom, Bombara, Yéguéré, Doussola, Gani,
Douban
|
|
Nouna
|
Koroni, Kiemè
|
|
Solenzo
|
Denkénè, Orowé, Kosso
|
|
Sapouy
|
Tiaben Kasso, Poun, Bazilakou
|
|
Léo
|
Vara, Kélié, Kabora
|
|
Batié
|
Banaba
|
|
Diébougou
|
Orkounou, Tingera, Pokro
|
Annexe 10 : Carte du Japon

TABLES DES MATIERES
DEDICACE
I
REMERCIEMENT
II
SIGLES ET ACRONYMES
III
LISTES DES CARTES, DES TABLEAUX ET DES
GRAPHIQUE
IX
SOMMAIRE
IX
Introduction générale
1
PREMIERE PARTIE: LA POLITIQUE D'AIDE
JAPONAISE EN AFRIQUE: LE PROCESSUS DE LA TICAD : 1993-2018
11
Chapitre I: Le Japon et sa politique
d'aide.
13
I. Présentation du Japon
13
I.1 La géographie du Japon
13
I.2 L'environnement économique du
Japon
14
I.3 Le Japon dans les relations
internationales
16
II La politique d'aide japonaise
19
II.1 Les principes fondamentaux de l'APD
japonaise
19
II.2 Les axes prioritaires de l'aide
japonaise
21
II.3 Les catégories d'aide
japonaise
23
III Les régions prioritaires de l'aide
japonaise
25
III.1 L'Asie
25
III.2 Moyen-Orient et autres
26
III.3 L'Afrique
26
Chapitre II : Le cadre de la politique
d'aide japonaise en Afrique : le processus de la TICAD : 1993-2018
28
I. De la TICAD I à la TICAD III
28
I.1 La TICAD I (1993).
28
I.2 La TICAD II (1998)
32
I.3 La TICAD III (2003)
35
II De la TICAD IV à la TICAD VI
40
II.1 La TICAD IV (2008)
40
II.2 LA TICAD V (2013)
43
II.3 La TICAD VI (2016)
45
Chapitre III : La TICAD, un forum
à caractère unique ?
48
I. Les coorganisateurs de la TICAD
49
I.1 Le PNUD
49
I.2 La Banque mondiale
50
I.3 Les autres coorganisateurs
52
II Les principes fondamentaux de la TICAD
54
II.1 L'appropriation
54
II.2 Le partenariat international
56
II.3 Le mécanisme de suivi de la
TICAD.
57
III La TICAD par rapport à d'autres
forums de développement
58
III.1 La Chine et le Forum sur la
coopération sino-africaine (FOCAC)
59
III.2 Le Forum Corée-Afrique
(KOAF)
60
III.3 L'Inde et le sommet du Forum
Inde-Afrique (I.A.F.S).
61
DEUXIEME PARTIE: LA COOPERATION
BURKINA-JAPON APRES LA TICAD I: 1993-2018
63
Chapitre IV: L'orientation de l'assistance
japonaise au Burkina Faso après la TICAD I
65
I Les facteurs explicatifs de la
coopération japonaise au Burkina Faso
65
I.1 Les facteurs politiques et
sécuritaires.
65
I.2 Les enjeux diplomatiques
67
I.3 Les aspects socio- économiques
70
II L'évolution de l'aide japonaise au
Burkina Faso de 1993 à 2018
71
II.1 Les catégories d'aides japonaises
au Burkina Faso
71
II.2 L'aide bilatérale japonaise
73
II.3 L'aide japonaise accordée aux
organisations multilatérales
76
Chapitre V: Les secteurs clés de la
coopération japonaise au Burkina Faso
79
I L'éducation
80
I.1 L'éducation comme clé de
développement
80
I.2 Les acquis de la coopération
japonaise dans le domaine de l'éducation
81
I.3 Les projets en cours
86
II L'agriculture
88
II.1 L'agriculture dans la politique de
coopération du Japon au Burkina Faso.
88
II.2 L'aide alimentaire
89
II.3 Les projets de coopération
technique.
92
III La promotion de l'intégration
économique sous- régionale.
97
III.1 La question des infrastructures dans la
coopération japonaise au Burkina Faso.
97
III.2 Les initiatives du Japon au Burkina
Faso
98
Chapitre VI: Autres domaines d'intervention
du Japon au Burkina Faso.
99
I Les secteurs centrés sur les besoins
humains fondamentaux de base.
100
I.1 Le secteur de la santé
100
I.2 L'eau et l'assainissement
102
I.3 L'environnement et le changement
climatique
106
II La promotion du commerce et de
l'investissement au Burkina Faso.
108
II.1 L'assistance japonaise dans le domaine
commercial au Burkina Faso
108
II.2 Les produits d'échanges
109
III Le développement des ressources
humaines et les limites de la coopération nippo-burkinabè.
110
III.1 Le JOCV au Burkina Faso
110
III.2 Le programme de stages
111
III.3 Les imperfections dans la
coopération entre le Japon et le Burkina Faso.
112
Conclusion générale
114
Source et bibliographie
117
ANNEXE A
* 1 Verneuil Christophe et
Verneuil Soraya, 2012, Japon et Chine, concurrences régionales,
ambitions globales, Paris, Ellipse, page 74.
* 2 Kita Julien, 2008,
« l'aide publique au développement japonaise et
l'Afrique : vers un partenariat fructueux ? », in Asie
Vision, Paris, IFRI (centre Asie), page 7.
* 3 Zoa Christian Alima,
2008, les clés de l'offensive politico-diplomatique du Japon en
direction de l'Afrique et du Cameroun, rapport de DEA, Université
Yaoundé II, consulté sur le site www.memoireonline.com,
consulté le 18 Janvier 2019.
* 4 Ministère des
affaires étrangères et de la coopération régionale,
2012, fiche sur l'état de la coopération Burkina-Japon,
KM126.
* 5Pierre Renouvin et
Jean-Baptiste Duroselle, 1991, introduction à l'histoire des
relations internationales, Paris, Armand Colin, page 1.
* 6Pierre Renouvin et
Jean-Baptiste Duroselle, 1991, op.cit, page 2.
* 7Robert Frank, 2003,
« penser historiquement les relations internationale »,
in Annuaire Français de Relations Internationales, page 43.
* 8 En plus du gouvernement
japonais, la TICAD est coorganisée par le programme des Nations-Unies
pour le développement (PNUD), la Coalition mondiale pour l'Afrique
(CMA), la Banque mondiale, la commission de l'Union africaine.
*
9www.japan.go.jp/pc/ticad/_userdata/ticad6/fr_whatsticad.html,
consulté le 25 Novembre 2019.
* 10 MOFA, 1992, charte
de l'aide publique au développement, traduction non officiel, 7
pages.
* 11 GUYONNET Emilie, 2013,
Le Japon défend ses positions, disponible sur
www.monde-diplomatique.fr/2013/06/GUYONNET/49202,
consulté le 7 Juin 2019.
* 12Idem.
* 13GOVERNMENT OF JAPAN,
2016, Japan in Africa, building resilient health system, disponible
sur
www.washingtonpost.com/sf/brand-connect/wp/enterprise/japan-in-africa-health-systems/
consulté le 4 février 2019.
* 14 S.E.M Masato Futaishi,
2017, discours à l'occasion d'une caravane de presse sur
l'état de la coopération Japon-Burkina Faso, disponible sur
www.sidwaya.bf<m.14910-cooperation-japon-burkinafaso, consulté
le 16 juin 2018.
* 15 Cité par BANDE
Delwende Samuel, 2008, Les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et
la République de Chine (Taiwan) : enjeux politiques autour de la
reconnaissance internationale du statut de la République de Chine
(Taîwan), mémoire de maitrise en relations publiques
internationales, Université libre du Burkina, disponible sur
www.memoireonline.com/03/12/5434/m_Les-relations-diplomatiques-entre-le-Burkina-Faso-et-la-Republique-de-chine-tawan-enjeux-polit0.html,
consulté le 30 juil. 19.
* 16 Pierre Jacquet, 2006,
« les enjeux de l'aide publique au développement »,
in Politique étrangère, Paris, IFRI, pp. 941-942.
* 17 MOFA, 2003, la
coopération japonaise à l'égard de l'Afrique en chiffres:
glossaire pour comprendre l'Afrique, disponible sur
www.Mofa.go.jp/region/africa/pamph0311_f/word/index.html,
accédé le 30 Juillet 2019.
* 18Le Plan de Colombo pour
le développement de l'Asie du Sud et du Sud-Est a été
lancé en 1950 par la conférence des ministres des Affaires
étrangères du Commonwealth. D'autres pays non affiliés au
Commonwealth y participent.
* 19 LANGUILLON-AUSSEL Raphael
et REVEYAZ Nathalie, 2017, Japon : cadrage et problématiques
générales, page 3.
* 20www.stat.go.jp.
* 21Carte du Japon en
annexe.
* 22 GARNIER Régis,
2004, géographie du Japon, page 6.
* 23 LANGUILLON-AUSSEL Raphael
et REVEYAZ Nathalie, 2017, op.cit, page 13.
* 24 Voir
www.monde-diplomatique.fr/1962/01/A/24580, consulté le23 mars
2019.
* 25SAHOKO Kaji et JAQUET
Christophe, 2002, « Japon, la décennie perdue », in
Politique étrangère, Paris, IFRI, page 68.
* 26 P.H.M. Bell and Mark
Gilbert, 2017, The World since 1945, an international history, second
edition, London, Bloomsbury academic, page 418.
* 27 SAHOKO Kaji et JACQUET
Christophe, 2002, op.cit., page 68.
* 28JORLAND Patrice,
2006 « La trajectoire du Japon, présentation »,
in Recherche internationale, n° 76, Paris, Association Paul
Langevin, page 39.
* 29 Languillon-Aussel
Raphael et Reveyaz Nathalie, 2017, op.cit,.
* 30SAHOKO Kaji et JAQUET
Christophe, 2002, op.cit, pp. 74-75.
* 31 MEYER Claude, 2011,
« l'économie japonaise: miroir de notre
futur ? », in Politique étrangère, Paris,
IFRI, page 102.
* 32 LANGUILLON-AUSSEL Raphael
et REVEYAZ Nathalie, 2017, op.cit., page 14.
* 33 WATANABE Hirota, 2001,
« La diplomatie japonaise après la Deuxième guerre
mondiale, in Annuaire français de Relations internationales, Bruxelles,
Editions Bruylant, page 63.
* 34 D'après la
constitution du Japon du 3 novembre 1946, disponible sur
www.mjp.univ-perp.fr/constit/jp1946.htm, consulté le 25 septembre
2019.
* 35WATANABE Hirota, 2001,
op.cit., , pp. 64-65.
* 36 P.H.M. Bell and Mark
Gilbert, 2017, op.cit, page 254.
* 37BOULANGER, Eric 2013,
« L'ambiguïté de l'identité japonaise en relations
internationales et la montée en puissance de la Chine: la fin du
pacifisme constitutionnel », in Relations internationales,
n°154, Paris, Presses universitaire de France(PUF), page 138.
* 38DEFARGES Philippe
Moreau, 2004, « De la SDN à l'ONU », in
revue Pouvoirs, n°109, Paris, Le Seuil, p. 22.
* 39 KINGSTON Jeff, 2013,
contemporary Japan: history, politics and social change since 1980s,
second edition, Wiley-Blackwell, page 115.
* 40.BOULANGER, Eric 2013,
op.cit, page 139.
* 41PAJON Céline,
2014, « Le Japon d'Abe face à la Chine de XI: de la paix
froide à la guerre chaude?, in Politique
étrangère, Paris, IFRI, page 24.
* 42AKAHA Tsuneo, 2011,
« Japon: trouver l'équilibre entre soft power et hard
power », in Politique étrangère, Paris, IFRI,
page 118.
* 43POZZAR
Marie-Hélène, 2009, Fiche technique de l'aide au
développement : portrait du Japon, page 2, disponible sur
www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/Aide_developpement_-_Portrait_Japon.pdf
consulté le 19 mars 2019.
* 44. DARBON (D), 1992,
la coopération japonaise: une aide publique au développement
méconnue, disponible sur
www.politique-africaine.com/numeros/pdf/049107.pdf,
consulté le 30 avril 2019.
* 45 MOFA, 1995, Japan's
ODA Annuel 1994, disponible sur
www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1994/1.html&1.
* 46 MOFA, 2004, Japan's
ODA White paper 2003, disponible sur
www.mofa.go/policy/oda/white/2003/part1_1.html&chart04
consulté le 27 mars 2019.
* 47 MOFA, 2004,
Idem.
*
48Marie-Hélène Pozzar, 2009, op.cit. p. 5.
* 49 D'après la
charte révisée de l'aide publique au développement du
Japon 2003, pp. 4-6.
* 50 D'après la
charte de la coopération économique, disponible
www.mofa.go.jp/policy/oda/page_000138.html,
consulté le 9 aout 2019.
* 51Charte de l'aide publique
au développement du Japon de 2003, pp 6-8.
* 52 D'après le
rapport annuel de la JICA 2015, disponible sur
https://www.jica.go.jp/french/publications/annual/2015/c8h0vm00009wukdf-att/2015_0-1.pdf,
consulté le 12 aout 2019.
* 53 Examen par les pairs
2014, op.cit., page 7.
* 54 Rapport annuel de la
JICA 2015, op.cit.
https://www.jica.go.jp/french/publications/annual/2015/c8h0vm00009wukdf-att/2015_0-1.pdf,
consulté le 12 aout 2019.
* 55 D'après le
rapport sur la coopération au développement 2017/Japon de l'OCDE,
page 251.
* 56 Rapport annuel de la JICA
2015, op.cit.
https://www.jica.go.jp/french/publications/annual/2015/c8h0vm00009wukdf-att/2015_0-1.pdf,
consulté le 12 aout 2019.
* 57QUÉFÉLEC
Stéphane, 1997, « L'aide publique au développement dans
La coopération économique japonaise », in
Ebisu, Paris, Maison franco-japonaise, pp. 141-142.
* 58 D'après le site
web de JANIC, disponible sur
www.janic.org/janic/
consulté le 21 août 2019.
* 59 Charte de l'aide publique
au développement du Japon de 2003,op.cit., page 8.
* 60 D'après le rapport
sur la coopération au développement 2017/Japon de l'OCDE, page
252.
* 61 Charte de l'aide publique
au développement du Japon de 2003,op.cit., page 9.
* 62ANTIL Alain, 2017,
« Japan's revived african policy », in l'Afrique en questions,
n°34, Paris, les Editoriaux de l'IFRI, disponible
surwww.ifri.org/en/publications/editoriaux-de-lifri/lafrique-questions/japans-revived-african-policy,
consulté le 13 août 2019.
* 63AMPIAH Kweku, 2004,
« L'Afrique du Sud dans la TICAD: un rôle pivot »,
in revue Afrique contemporaine, n°212, Paris, De Boeck
Supérieur, page 92.
* 64 ANTIL Alain, 2017,
op.cit.
www.ifri.org/en/publications/editoriaux-de-lifri/lafrique-questions/japans-revived-african-policy,
consulté le 13 août 2019.
* 65AICARDI DE
SAINT-PAULMarc, 2016, op.cit.,
www.academiedegeopolitiquedeparis.com/japon-afrique-genese-dune-relation-perenne/
consulté le 11 aout 2019.
* 66 JALLAIS
Bérénice, 2004, « Le Japon et l'Organisation des
Nations-Unies : efforts récompensés et espoirs
frustrés », in revue Ebisu, n°33, Paris, la
Maison franco-japonaise, page 226.
* 67 Le Japon a maintenu des
relations privilégiées avec l'Afrique du Sud malgré le
régime d'apartheid en vigueur dans le pays.
* 68KITA Julien, 2008,
op.cit., page 16.
* 69ANTIL, Alain, 2017,
op.cit.
www.ifri.org/en/publications/editoriaux-de-lifri/lafrique-questions/japans-revived-african-policy,
consulté le 13 août 2019.
* 70JUN Hongo, 2013,
«TICAD to redefine Japan aid to Africa» in Japan Times
disponible sur
www.japantimes.co.jp/news/2013/05/09/national/ticad-to-redefine-japan-aid-to-africa/&.XFijqhi2w0M
consulté le 4 février 2019.
* 71 Cité par
MINORU, Matsutani 2013, «The evolution of TICAD since its inception in
1993», in Japan
Times,www.japantimes.co.jp/news/2013/06/01/world/the-evolution-of-ticad-since-its-inception-in-1993/&.XFijMRi2w0M,
consulté le 4 février 2019.
* 72LEHMAN Howard,
2005,«Japan's foreign aid policy to Africa since the Tokyo International
Conference on African Development», PacificAffairs, volume 78,
n° 3, Columbia, University of British, page 427.
* 73 EDSTROM Bert, 2010,
«Japan and the TICAD process », in Asia Paper,
Stockholm, Institute for Security & Development Policy, pp. 12-13.
* 74 EYINLA Bolade, 2018,
« Promoting Japan's national interest in Africa : a review of
TICAD», in Africa Development, volume XLIII, n°3, CODESRIA,
page 108-109.
* 75 LEHMAN P. Howard, 2007,
« Japan's national economic identity and African development: an analysis
of TICAD», in Research Paper, n° 61, Helsinki, World
institute for development economics research (WIDER), page 3.
* 76 JICA and Mitsubishi
UFJ Reasearch and consuling, 2013, op.cit., page21.
* 77JICA and Mitsubishi UFJ
Reasearch and consuling, 2013, Idem page 22.
* 78 Site web du
ministère des Affaires étrangères du Japon:
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/outline.htlm;
consulté le 23 mars 2019.
* 79 Déclaration de
Tokyo sur le développement de l'Afrique : vers le XXIe
siècle, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/ticad22.htlm,
consulté le 23 mars 2019.
* 80 LEHMAN Howard, 2005,
op.cit. p. 429.
* 81 Déclaration de
Tokyo sur le développement de l'Afrique : vers le XXIe
siècle, op.cit.
http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/ticad22.htlm.
* 82 MOFA, 1997, Lancing
of TICAD II Process, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/ticad23.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 83 MOFA, 1997,The
preparatory conference for the second Tokyo international conference on African
development (TICAD II), co-chairs'summary report, disponible sur
www.mofa.go.jp/africa/ticad2/ticad24.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 84 MOFA, 1997,
idem,
www.mofa.go.jp/africa/ticad2/ticad24.html
.
* 85 MOFA, 1998,The
Tokyo international conference on African development: the second preparatory
committee meeting, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/ticad25.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 86MOFA, 1998, The
third preparatory committee meeting for TICAD II (8 September): Press
release, disponible sur www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/ticad210.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 87 MOFA, 1998,
Conférence internationale de Tokyo sur le développement de
l'Afrique, Tokyo, 19-21 octobre 1998, liste des participants, disponible
sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/list/index.html,
consulté le 23 août 2019.
* 88 Les thèmes relevant
de l'« approche» sont le renforcement de la coordination, la
coopération et l'intégration régionales, la
coopération sud-sud. Quant aux
thèmes « transversaux », on peut noter le
renforcement des capacités, l'intégration de la dimension genre,
la gestion de l'environnement.
* 89 MOFA, 1998, African
development toward the 21st century: the Tokyo Agenda Action, § 4,
disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/agenda21.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 90 MOFA, 1998,
Développement de l'Afrique au XXIe siècle: l'Agenda de Tokyo pour
l'action, idem, §8.
* 91 MOFA et al, 2003, TICAD
III: soutenir le développement de l'Afrique au XXIe siècle, page
12.
* 92 MOFA et al, 2003,
idem, page 7.
* 93 MOFA et al, 2003,
ibidem. page 10.
* 94 Agence japonaise de
coopération internationale (JICA) et Mitsubishi UFJ Research and
Consulting, 2013, la revue des vingt années de la TICAD,
Rapport complémentaire, page 2-4.
* 95Idem.
* 96 MOFA, 2002, Policy
speech by Ms. Yorika Kawaguchi, Minister for foreign affairs of Japan at the
United Nations conference center (Addis Ababa, 26 August),disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/fmv0208/ethiopia.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 97 MOFA, 2003, TICAD
III senior official- level preparatory meeting, disponible sur
www.mofa.go.jp/announce/event/2003/2/0228.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 98 MOFA, 2003,
Aperçu de la TICAD III, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad3/outline_f.html,
consulté le 23 août 2019.
* 99 MOFA, 2003,Keynote
speech by Prime minister Junichiro Koizumi at the Third Tokyo international
conference on African development (TICAD III): Provisional translation) ,
Tokyo, 29 Septembre, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad3/pmspeech.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 100 MOFA, 2003,
Keynote speech by Prime Minister Junichiro Koizumi, idem,
§15.
* 101 MOFA, 2003,
Keynote speech by Prime Minister Junichiro Koizumi,Ibidem, §16.
* 102 MOFA, 2003,
Déclaration commémorative du dixième anniversaire de
la TICAD, traduction finale, Tokyo, 1er octobre, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad3/index.html"
consulté le 23 août 2019.
* 103 MOFA, 2003,
Keynote speech by Prime Minister Junichiro Koizumi,op.cit.
§18.
* 104Agence japonaise de
coopération internationale (JICA) et Mitsubishi UFJ Research and
Consulting, 2013, Idem, page 2-7.
* 105 Nations-Unies,
2008, l'espoir et l'opportunité sont à l'ordre du Jour de
quatrième conférence internationale de Tokyo sur le
développement de l'Afrique (TICAD IV), communiqué de presse
du 27 mai, §14, disponible sur
www.un.org/press/fr/2008/AFR1705.doc.htm,
consulté le 8 mai 2019.
* 106 MOFA, 2009, TICAD
IV regional preparatory meeting, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad4/pre0710.html,
consulté le 7 mai 2019.
* 107 Nations-Unies,
2008, la quatrième conférence de Tokyo sur le
développement de l'Afrique (TICAD IV) établit un cadre pour
« un siècle de croissance africaine, communiqué de
presse du 30 mai, disponible sur
www.un.org/press/fr/2008/AFR1707.doc.htm,
consulté le 7 mai 2019.
* 108Nations-Unies,
2008,Idem.
* 109 La
« Déclaration de Yokohama » de la TICAD IV est
disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad4/doc/declaration_f.pdf.
* 110 MOFA, 2009,
première réunion ministérielle de suivi de la TICAD,
communiqué, Gaborone, Botswana, 22 mars, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad4/folluwup/comm0903-f.pdf,
consulté le 26 Août 2019.
* 111MOFA,
2009,Idem.
* 112RUBIAN Renata, 2011,
African development ministerial discusses climate change, low carbon
growth, disponible sur
www.sdg.iisd.org/news/african-development-ministerial-discusses-climate-change-low-carbon-growth/
consulté le 19 mai 2019.
* 113 Communiqué de
la Quatrième réunion ministérielle de suivi de la TICAD,
Marrakech, Maroc, 5 et 6 mai 2012, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/mini1205/pdfs/communique_f120.pdf,
consulté le 19 mai 2019.
* 114 Ambassade du Burkina
Faso au Japon, 2012, Coopération Japon-Burkina et coopération
multilatérale, disponible sur
www.sites.google.com/site/ambassadeburkinafasoaujapon/coopération-japon-burkina-faso/ticad,
consulté le 7 mai 2019.
* 115 Ambassade du Japon en
Côte d'Ivoire, 2013, « Réunion préparatoire des
experts de la TICAD V à Ouagadougou », in Lettre du
Japon, n°5, Abidjan, page 2.
* 116 MATSUTANI Minoru,
2013, « The evolution of TICAD since its inception in 1993»,
in Japan Times, disponible sur
www.japantimes.co.jp/news/2013/06/01/world/the-evolution-of-ticad-since-its-inception-in-1993/&XFijMRi2w0M,
consulté le 4 février 2018.
* 117 MOFA, 2013,, Fifth
Tokyo international conference on African development, §1, disponible
sur
www.mofa.go.jp/region/page6e_000075.html,
consulté le 23 mars 2013.
* 118 MOFA, 2013, Liste
des principaux représentants des pays participants et des organisations
internationales, disponibles sur
www.mofa.go.jp/files/000006934.pdf,
consulté le 6 septembre 2019.
* 119 MOFA, 2013, op.cit,
www.mofa.go.jp/region/page6e_000075.html".
* 120 D'après la
Déclaration de Yokohama 2013, page 2.
* 121 MOFA, 2014,
première réunion ministérielle de TICAD V
(aperçu et évaluation), disponible sur
www.mofa.go.jp/afr/af2/page3e_000175.html,
consulté le 23 mars 2019
* 122 D'après le
rapport d'activités 2013-2015 de la TICAD V, Résumé, page
4.
* 123 D'après la
Charte sur la coopération économique du Japon, page 9.
* 124 MOFA, 2016, The
TICAD VI preparatory senior officials' meeting, disponible sur
www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001076.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 125 MOFA, 2016,TICAD
VI preparatory ministerial meeting, disponible sur
www.mofa.go/jp/af/af1/page3e_000505.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 126 MOFA, 2016, Sixth
Tokyo international conference on African development (TICAD VI),
disponible sur
www.mofa.go.jp/af/af1/page3e_0005551.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 127 MOFA, 2016, op.cit.,
http://www.mofa.go.jp/af/af1/page3e_0005551.html".
* 128 Anonyme, 2017,
« Forum de la TICAD à Maputo », in
Témoignages du 23 août, disponible sur
www.temoignages-re.cdn.ampproject.org/v/s/www.temoignages.re/spip.php?
Consulté le 1er juin 2019.
* 129 MOFA, 2016, La
Déclaration de Nairobi, disponible sur
www.mofa.go.jp/af/af1/page3e_000543.html,
consulté le 6 septembre 2019.
* 130 MOFA, 2017, Tokyo
international conference on African development (TICAD) ministerial
meeting, disponible sur
www.mofa.go.jp/af/af1/page3e_000721.html,
consulté le 6 Septembre 2019.
* 131 MOFA, 2018, Tokyo
international conference on African development (TICAD) ministerial meeting
(overview), disponible sur
www.mofa.go.jp/af/af1/page23e_0005335.html,
consulté le 6 Septembre 2019.
* 132 MOFA, 2013, 20 ans
de processus de la TICAD, et d'Aide publique au développement (APD) du
Japon pour l'Afrique, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad_20_fr.pdf
, consulté le 2 juillet 2018.
* 133 PNUD, 2016,
Partenariat pour le développement en Afrique, disponible sur
www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/poverty-reduction/partnerships-for-development-in-africa--japan-and-undp-at-work.html
consulté le 29 mai 2019.
* 134 JICA and Mitsubishi
Research and Consulting, 2013, op.cit., rapport principal, page
4-7.
* 135 CLARK Helen, 2013,
La TICAD reste aussi importante que jamais, disponible sur
www.japantimes.co.jp/news/2013/06/01/world/ticad-remains-as-important-as-ever/&.XFii8i2w0M
consulté le 4 février 2019.
* 136Rapport 2019 de la
TICAD, page 17.
* 137 PNUD, 2018,
Partenariat pour l'avenir de l'Afrique: Japon-PNUD, page 9.
* 138 JICA and Mitsubishi
Research and Consulting, 2013, op.cit, page 48.
* 139Idem.
* 140 BANQUE MONDIALE,
2016, lancement par des partenaires du cadre pour
l'accélération de la couverture sanitaire universelle en Afrique
: la Banque mondiale et le Fonds mondial engagent 24 milliards de dollars,
disponible sur www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2016/08/26,
consulté le 19 mai 2019.
* 141 TICAD, 2016, Rapport
2018--Progrès accomplis et voies à suivre, page 10.
* 142 TICAD III, 2003,
la Coalition mondiale pour l'Afrique, disponible sur
www.ahibo.com./ticad/LP2_8GlobalCoalition_FR.pdf, consulté le 18
Janvier 2019.
* 143 OSAA, 2016, La
Conférence internationale de Tokyo sur le développement de
l'Afrique (TICAD, disponible sur
www.un.org/fr/africa/parterships/ticad/shtml, consulté le 22
avril 2020.
* 144 Rapport 2019 de la
TICAD, page 17.
* 145 Rapport 2019 de la
TICAD, Idem, page 18.
* 146 D'après le
rapport d'activités 2013-2015 de la TICAD V,
Résumé, page 16.
* 147 D'après la
Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au
développement de 2005, page 5
* 148Scarlett Cornelissen,
2004, « la politique japonaise de moyenne puissance et l'Afrique un
cadre d'analyse pour dépasser l'opposition
réactif-proactif » in revue Afrique contemporaine,
n°212, Paris, De Boeck supérieur, page 44.
* 149GOVERNMENT OF JAPAN,
2016, Foresting high-skilled human resources toward economic
diversification, disponible sur
www.washingtonpost.com/sf/brand-connect/wp/enterprise/japan-in-africa/
consulté le 4 février 2019.
* 150CORNELISSEN Scarlett,
2004, op.cit, page 44.
* 151 Cité par
CASLIN Olivier, 2016, « Afrique-Japon: quand coopération rime
avec concentration», in Jeune Afrique, disponible sur
www.jeuneafrique.com/mag/345773/politique/afrique-japon-cooperation-rime-concentration/,
consulté le 18 Janvier 2019.
* 152 TICAD, 2003, TICAD
et NEPAD, disponible sur www.ahibo.com/ticad/ticad-nepad.htm.,
consulté le 23 avril 2020
* 153 MOFA, 2004, Cadre
politique conjoint TICAD-NEPAD pour la promotion du commerce et de
l'investissement entre l'Afrique et l'Asie, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/aatic/joint0411.pdf, consulté le 23
avril 2012
* 154Déclaration de
Tokyo sur le développement de l'Afrique : vers le XXIe
siècle, disponible sur
http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/ticad22.htlm.
* 155 MOFA, 1998,
Développement de l'Afrique au XXIe siècle: l'Agenda de Tokyo pour
l'action, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad2/agenda21.html.
* 156 MOFA, 2013,
op.cit, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad_20_fr.pdf
* 157OGASAWARA Minoru, 2004,
«la coopération japonaise à l'égard de
l'Afrique : Vers un développement de la coopération
Asie-Afrique », in Afrique contemporaine, n°212, Paris, De Boeck
Supérieur, page 69.
* 158 Rapport 2018 de la
TICAD, page 18.
* 159 TICAD VI, 2018,
Rapport 2018- progrès accomplis et voies à suivre-, page
15.
* 160 MOFA, 2008,
Mécanisme de suivi de la TICAD, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/ticad4/report2008_a1f.pdf,
consulté le 22 avril 2020.
* 161 FOCAC, 2020,
Mécanisme du FOCAC, disponible sur
www.focac.org/fra/ltjj_4/ltz/, consulté le 22 avr. 20.
* 162 Site web du
ministère chinois des Affaires étrangères,
www.fmprc.gov.cn, consulté le 22 avril 2020.
* 163 NICOLAS
Françoise, 2020, « La Corée en Afrique: Entre soft
power et intérêt économique », in Centre
Asie, Paris, IFRI, page 12.
* 164Site web de la
conférence, www.koafec-conference.org/fra/conference/about.html,
consulté le 22 avril 2020.
* 165 AUREGAN Xavier, 2018,
« L'Inde en Afrique ou l'impossible rattrapage vis-à-vis de la
Chine », in l'Espace politique, n°36, Paris, Varia,
page 8.
* 166 D'après la
déclaration de New-Delhi de l'IAFS de 2015, un partenariat, une
vision partagée, 13 pages.
* 167 Cité par SAKANDE
Ibrahiman, 2008, Politique étrangère du Burkina Faso: pour
des diplomates et non des ambassadeurs stars, disponible sur
www.lefaso.net/spip.php? article28354, consulté le 30 juillet 2019.
* 168Ki Doulaye Corentin,
2008, introduction à la politique étrangère du Burkina
Faso: la période voltaïque, 1960-1983, Ouagadougou, les
Presses africaines, page 185.
* 169 FUTAISHI Masato,
2017, op.cit.,
www.sidwaya.bf<m.14910-cooperation-japon-burkinafaso/.
* 170 Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2015, Elections crédibles et apaisées au
Burkina Faso : un soutient de 45600000 FCFA de l'AMBASSADE DU JAPON,
disponible sur
www.bf.emb-japan.go.jp/itprtop_/00_000033.html,
consulté le 1er juin 2019.
* 171 Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2015, op.cit.,
www.bf.emb-japan.go.jp/itprtop_/00_000033.html.
* 172 MOFA, 2018,The
terrorist attacks in Ouagadougou, Burkina Faso (Statement by press secretary
Norio Maruyama, disponible sur
www.mofa.go.jp/press/release/press4e_001937.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 173 Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2015, orientation de l'assistance pour le Burkina Faso,
disponible sur
www.bf.emb-japan.jp/itrtopp_fr/orientation2015.html,
consulté le 1er juin 2019.
* 174 Interview accordé
par l'Ambassade du Japon, Tamotsu Ikezaki, disponible sur
www.lefaso.net/spip.php? article92357, consulté le 4 décembre
2019.
* 175 CNA, 2014,
Japon : correspondance générale 1985-1986,
20V196.
* 176 CNA, 2014,
Idem.
* 177 CNA, 2009, rapport
de coopération bilatérale entre la Haute-Volta et le Japon,
43V264.
* 178 MAECR, 2013,
op.cit., KM126.
* 179 MOFA,
2018,Japan-Burkina Faso summit meeting, disponible sur
www.mofa.go.jp/af/af1/bf/page4e_000948.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 180 MAECR, 2013,
op.cit., KM126.
* 181 FUTAISHI Masato,
2017, op.cit.,
www.sidwaya.bf<m.14910-cooperation-japon-burkinafaso
* 182 Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2015, op.cit.,
www.bf.emb-japan.jp/itrtopp_fr/orientation2015.html.
* 183 MOFA, 2007,
Japan- Burkina Faso bilateral consultation (outline), disponible
www.mofa.go.jp/announce/announce/2007/7/1174493_830.html,
consulté le 23 mars 2019
* 184 MAECR, 2013,
op.cit., KM126.
* 185 DCPM/MAECR, 2007,
Coopération Burkina Faso/Japon: bientôt les premières
consultations bilatérales!, disponible sur
www.lefaso.net/spip.phpp?article21727,
consulté le 1er juin 2019.
* 186 Cité par Issouf
Zabsonré, 2008, « Blaise Compaoré déplore la
faiblesse de l'aide publique au développement à la tribune de la
4ème TICAD au Japon », in le faso.net, disponible sur
www.lefaso.net/spip.php? article27075, consulté le 1er
juin 2019.
* 187 Présidence du
Faso, 2013, la vice-ministre parlementaire chargée des Affaires
étrangères du Japon a échangé avec le
Président du Faso sur le suivi de la TICAD V, disponible sur
www.news.aouaga.com, consulté le 4 octobre 2019.
* 188MOFA, 2019,
Japan-Burkina Faso relations (basic data), disponible sur
www.mofa.go.jp/region/Africa/Burkina_f/data.html, consulté le 15
février 2020.
* 189 FUTAISHI Masato,
2017, op.cit.,
www.sidwaya.bf<m.14910-cooperation-japon-burkinafaso.
* 190 Ministère du
commerce de l'industrie et de l'artisanat, 2018, Balance commerciale et
commerce extérieur 2018, Ouagadougou, Imprimerie nationale, page
33.
* 191 Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2015, op.cit.,
www.bf.emb-japan.jp/itrtopp_fr/orientation2015.html.
* 192 Banque mondiale,
2018, Burkina Faso, vue d'ensemble, disponible sur
www.banquemondiale.org/fr/country/burkinafaso/overview,
consulté le 31 juillet 2019.
* 193 FUTAISHI Masato,
2017, op.cit.,
www.sidwaya.bf<m.14910-cooperation-japon-burkinafaso/.
* 194 JICA, sd, Bureau de
la JICA au Burkina Faso, disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/office/index.html,
consulté le 18 Janvier 2019.
* 195 JICA, sd, Les
activités au Burkina Faso, disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/english/activities/activity01.html,
consulté le 18 janvier 2019.
* 196 MAECR, 2012,
point de la coopération Burkina/Japon, KM194.
* 197 Japan International
cooperation System (JICS), 2005, Dons hors projet, disponible sur
www.jics.or.jp/jics_html-e/profile/pdf/nonpro-f.pdf,
consulté le 2 septembre 2019.
* 198 Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2018, dons aux micro-projets locaux contribuant à la
sécurité humaine, disponible sur
www.bf.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000172.html, consulté le 21 novembre
2019.
* 199 Agence d'information
du Burkina, 2019, coopération japonaise : les associations
s'informent sur les conditions d'intervention, disponible sur
www.aib.media/regions/2019/01/04/, consulté le 4 décembre
2019.
* 200 OBAYASHI Minoru,
2004, « TICAD, un processus favorable au développement de
l'Afrique ? », in Afriquecontemporaine, n°212, Paris,
De Boeck supérieur, page81.
* 201SANKARA Salif, 2018,
la contribution de la coopération japonaise au développement
économie et social du Burkina Faso : cas de l'aide alimentaire
« KR 1 », mémoire de fin de cycle, INHEI, page
37.
* 202Taux de change au 31
décembre 2018 (1 Dollar égal à 580 FCFA).
* 203 MOFA, 2005,
Japan's policy for African development: Prime Minister Koizumi's message to
Africa in the context of the G8 Summit, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/policy.pdf, consulté le 28 mai
2019.
* 204 MOFA,
2008,Exchange of notes on Grant aid (assistance for underprivileged
farmers) through the food and agriculture organization of the United Nations
(FAO) to the Republic of Uganda and Burkina Faso, disponible sur
www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/3/0314.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 205 MOFA, 2008,
Assistance by United Nations Trust Fund for Human security to the project
«Eliminating child marriage in Burkina Faso: A plan for protection
empowerment and community action'', disponible sur
www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/4/1179262_1000.html,
consulté le 23 mars 2019.
* 206 BAZIE B.
Grégoire, 2013, consolidation de l'état de droit au
Burkina : une convention tripartite pour rendre la justice plus accessible
aux pauvres, disponible www.lefaso.net/spip.php ?article55033,
consulté le 28 mars 2020
* 207 FUTAISHI Masato,
2017, op.cit.,
www.sidwaya.bf<m.14910-cooperation-japon-burkinafaso.
* 208 MOFA, 2019,
Coopération Japon-Burkina Faso, disponible sur www.
mofa.go.jp/files/000470872.pdf, consulté le 28 mai 2019.
* 209 MOFA, 2019,
Idem, www. mofa.go.jp/files/000470872.pdf.
* 210 MAECR, 2013,
op.cit., KM 126.
* 211 CASLIN Olivier, 2016,
« L'éducation, axe majeur de la coopération japonaise
en Afrique », in Jeune Afrique du 10 août, disponible
sur
www.jeuneafrique.com/mag/345730/economie/leducation-axe-majeur-de-cooperation-japonaise-afrique/
consulté le 18 janvier 2019.
* 212 MOFA, 2013,
op.cit, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad_20_fr.pdf
, consulté le 2 juillet 2018.
* 213 JICA, sd, Les
grandes lignes des activités: l'éducation, disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity01.htlm,
consulté le 18 Janvier 2019 .
* 214 MAECR, 2011,
op.cit., KM194.
* 215 Ministère de
l'éducation nationale et de l'alphabétisation et JICA, 2013,
l'enseignement des mathématiques et des sciences selon l''approche
ASEI-PDSEI, Ouagadougou, Projet SMASE-Burkina, page 8.
* 216 JICA, sd,
op.cit,
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity01.htlm.
* 217Idem.
* 218 JICA, sd,
op.cit,
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity01.htlm.
* 219 JICA, 1997,
Rapport de concept de base pour le projet de construction d'écoles
primaires (phase 2) au Burkina Faso, pp. I-II.
* 220Rapport de
l'étude du concept de base pour le projet de construction
d'écoles primaires au Burkina Faso.
* 221Pour les
différents sites bénéficiaires, voir annexe 2.
* 222 JICA, 1997, Idem,
page 8.
* 223Pour les noms des
différents sites bénéficiaires, voir annexe 3.
* 224Rapport de
l'étude du concept de base pour le projet de construction
d'écoles primaires (phase III) au Burkina Faso, page 16.
* 225Pour les noms des
différents sites bénéficiaires, voir annexe 4.
* 226Rapport de
l'étude du concept sommaire pour le 4e projet de construction
d'écoles primaires au Burkina Faso.
* 227 Pour les noms des
différents sites bénéficiaires, voir annexe 5.
* 228Rapport de
l'étude du concept sommaire pour le projet de construction
d'écoles primaires (phase V) au Burkina Faso.
* 229Pour les noms des
différents sites bénéficiaires, voir annexe 6.
* 230 KABRE
Grégoire, 2012-2013, Idem, page 59.
* 231 KABRE
Grégoire, 2012-2013, Ibidem, pager 59.
* 232 JICA, sd,
op.cit,
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity01.htlm.
* 233 Ministère de
l'éducation nationale et de l'alphabétisation et JICA, 2013,
op.cit, page 10.
* 234 JICA, sd,
op.cit,
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity01.htlm.
* 235 OUEDRAOGO Fatoumata,
2015-2016, la contribution de la coopération japonaise à la
gouvernance scolaire au Burkina Faso, mémoire de fin de formation,
Ouagadougou, INHEI, page 45.
* 236 JICA, sd,
op.cit,
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity01.htlm.
* 237Pour les noms des
différents sites bénéficiaires, voir annexe 7
* 238Rapport
d'étude préparatoire pour le projet de construction
d'établissements d'enseignements post-primaire au Burkina Faso,
* 239Rapport
d'étude préparatoire pour le projet de construction
d'établissements d'enseignements post-primaire (phase 2) au Burkina
Faso,
* 240Pour les noms des
différents sites bénéficiaires, voir annexe 8
* 241 JICA, sd,
op.cit,
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity01.htlm;
* 242 PRESIDENCE DU FASO,
2019, Ouverture de la 7e TICAD : le Président du
Faso précise les attentes du Burkina, disponible sur
www.presidencedufaso.bf/ouverture-de-la-7e-ticad-le-president-du-faso-precise-les-attentes-du-Burkina/,
consulté le 1er décembre 2019.
* 243Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2018, projet de construction des salles de classe dans
l'école primaire de Bouro, commune rurale de Oula, Province du Yatenga
dans la région du Nord, disponible sur
www.bf.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000194.html,
consulté le 2 sept. 19.
* 244 Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2019, op.cit.
* 245 Agence d'information
du Burkina (AIB), 2019, éducation au Burkina : le Japon offre
une école de 48,5 millions de FCFA à la population de Perkoa,
disponible sur www.aib.media/2019/10/11/, consulté le 18
novembre 2019.
* 246 PDSEB 2012-2021, page
40.
* 247Page Facebook du MENA:
m.facebook.com/ministereduc.burkina/posts/868624323291176.
* 248 MOFA, 2013,
op.cit, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad_20_fr.pdf.
* 249 JICA, sd, Les
grandes lignes des activités: l'agriculture, disponible
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity04.html,
consulté le 18 janvier 2018.
* 250Idem.
* 251 Cité par
Ministère de l'économie, des finances et du développement,
2018, coopération pour le développement, Ouagadougou,
page 70.
* 252 MAECR, 2013, op.cit.,
KM126.
* 253 Ministère de
l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles, 2018,
coopération Burkina Faso-Japon : plus de 5000 tonnes de riz
pour la sécurité alimentaire, disponible sur
www.agriculture.bf/jcms/fra_9379/fr/, consulté le 29 juillet
2019.
* 254Pour un aperçu
plus global des projets du Fonds de contrepartie, confère SANKARA Salif,
2018, la contribution de la coopération japonaise au
développement économie et social du Burkina Faso : cas de l'aide
alimentaire « KR 1 », mémoire de fin de cycle, INHEI,90
pages.
* 255MAERC, 2013,
op.cit., KM126.
* 256 AIB, 2013,
Burkina : plus de 2 milliards de FCFA d'aide alimentaire offert par le
Japon, disponible sur www.news.aouaga.com/h/17678.html, consulté
26 novembre 2019.
* 257 Taux de change annuel
entre le FCFA et le Yen en 1994 : 1 Yen= 5,38 FCFA (repéré
sur www.stat-niger.org/annuaire/monaie/monaie1.htm, consulté le 20 avr.
20).
* 258 Taux de change annuel
entre le FCFA et le Yen en 1995 : 1 Yen= 5,33 FCFA.
* 259 Taux de change annuel
entre le FCFA et le Yen en 1996 : 1 Yen= 4,71FCFA.
* 260 Taux de change annuel
entre le FCFA et le Yen en 1997 : 1 Yen= 4,85FCFA.
* 261 Taux de change annuel
entre le FCFA et le Yen en 1999 : 1 Yen= 5,43FCFA.
* 262 Taux de change annuel
entre le FCFA et le Yen en 2001 : 1 Yen= 6,04FCFA.
* 263 Taux de change annuel
entre le FCFA et le Yen en 2005 : 1 Yen=4,80FCFA
* 264 Les autres valeurs
ont été repérées dans les médias.
* 265SANKARA Salif, 2018,
op.cit, page 73.
* 266MOFA, Exchange of
notes in fiscal year by region, disponible sur
www.mofa.go.jp/policy/oda/page.html&Africa.
* 267 D'après le
Bulletin d'information de la JICA, Amitié et développement,
n°23 de 2010, page 5.
* 268 Salifou SARE, 2013,
« Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité
Alimentaire (MASA) et l'Agence Japonaise de Coopération Internationale
(JICA) ont lancé officiellement le mercredi 12 Juin 2013 les
activités du Projet d'Appui à l'élaboration d'un
schéma directeur pour la promotion d'une agriculture Orientée
vers le marché (PAPAOM) » in Amitié et
développement, n°31, Ouagadougou, JICA Burkina, page 5.
* 269 JICA, sd, Les
grandes lignes des activités: autres approches d'appui, disponible
sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity/04_02.html,
consulté le 18 janvier 2018.
* 270 JICA, 2018, Le
projet de renforcement de la production du sésame au Burkina Faso
(PRPS-BF, 2014-2019, disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity04_01.html,
consulté le 3 Septembre 2019.
* 271 JICA, 2018,
projet d'étude pour la formulation d'un programme nationale de
développement des bas-fonds (PE-PNDBF, 2017-2019), disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity04_03.html,
consulté le 3 Septembre 2019.
* 272 JICA, 2018,
projet pour la mise en place d'un modèle de promotion des cultures
par l'utilisation du phosphate naturel (SATRES, 2017-2022), disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity04_04.html,
consulté le 3 Septembre 2019.
* 273 JICA, 2018, Le
projet d'amélioration de la production alimentaire et des revenus des
ménages à travers la création et la promotion des sites de
référence (2014-2019), disponible
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity04_02.html,
consulté le 3 Septembre 2019.
* 274 Gouvernement du
Japon, 2016, op.cit,
www.washingtonpost.com/sf/brand-connect/wp/enterprise/Japan-in-africa-health-system.
* 275 JICA, sd, Les
grandes lignes des activités : les initiatives, disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity04_03.html,
consulté le 18 Janvier 2019.
* 276 JICA, sd, Les
grandes lignes des activités : les initiatives, disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity04_03.html,
consulté le 18 Janvier 2019.
* 277JICA, sd,
idem.
* 278 SANKARA Salif, 2018,
op.cit, annexe 6.
* 279MOFA, 2013,
op.cit, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad_20_fr.pdf.
* 280 Ambassade du Japon au
Burkina, 2015, op.cit.,
www.bf.emb-japan.jp/itrtopp_fr/orientation2015.html.
* 281 D'après la
Déclaration de Yokohama de la TICAD: vers une Afrique qui
gagne, page 3.
* 282Ministère des
infrastructures, 2017, Étude préparatoire du projet
d'amélioration de la rocade sud-est du boulevard de Tansoba au Burkina
Faso, rapport final, Ouagadougou, JICA, p. 1-9.
* 283 OUBIDA
François, 2016, l'amélioration de l'infrastructure est la
clé du succès pour aller de l'avant, disponible sur
www.japantimes.co.jp/news/2016/08/26/national/improved-infrastructure-key-succes-moving-forward/&.XPJsZOm2w0M,
consulté le 1er juin 2019.
* 284 DOH Kowoma Marc,
2018, Burkina Faso : coopération japonaise au Burkina Faso-
zoom sur quelques axes prioritaires, disponible sur
www.allfrica.com/stories/201804230736.html, consulté le 4
décembre 2019.
* 285 OUBIDA
François, 2016, op.cit., disponible sur
www.japantimes.co.jp/news/2016/08/26/national/improved-infrastructure-key-succes-moving-forward/&.XPJsZOm2w0M,
consulté le 1er juin 2019.
* 286 FUTAISHI Masato,
2017, op.cit,
www.sidwaya.bf<m.14910-cooperation-japon-burkinafaso.
* 287 MOFA, 2017,
Echange de notes concernant les subventions pour l'exercice 2016 par
région, disponible sur
www.mofa.go.jp/policy/oda/page25_000020.html&africa/,
consulté le 13 août 2019.
* 288 D'après le
rapport 2018 de la TICAD, page 15.
* 289 MOFA, 2018,
Echange de notes concernant les subventions pour l'exercice 2017 par
région, disponible sur
www.mofa.go.jp/policy/oda/page22e_000804.html&africa,
consulté le 13 août 2019.
* 290MOFA, 2013,
op.cit, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad_20_fr.pdf.
* 291Ministère de la
santé et JICA, 2012, Rapport de l'étude préparatoire
pour le projet de construction de Centre de santé et de promotion
sociale au Burkina Faso (CSPS), page 1-2.
* 292 JICA, sd,
Activités au Burkina Faso : santé, disponible
www.jica.go.jp/burkinafaso/english/activities/activity01.html,
consulté le 18 Janvier 2019.
* 293 Ministère de
la santé et JICA, 2012, op.cit, p 2-2.
* 294 MAECR, 2013,
op.cit., KM126.
* 295 MAECR, 2011,
Point de la coopération Burkina/Japon, KM 194.
* 296Pour les noms des
différents sites bénéficiaires, voir annexe 9.
* 297Ministère de la
santé et JICA, 2012, Rapport de l'étude préparatoire
pour le projet de construction de Centre de santé et de promotion
sociale au Burkina Faso (CSPS), page 1-9.
* 298Ministère de la
santé et JICA, 2012, op.cit, p. 2-2.
* 299 JICA, sd, les
grandes lignes des activités, disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activités/activity02.html,
consulté le 19 avril 2020.
* 300 MOFA, 2019,
op.cit , www. mofa.go.jp/files/000470872.pdf.
* 301 Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2018, projet de construction d'une maternité dans le
village de Kounou, commune de Biéha, province de Sissili dans la
région du centre-ouest, disponible sur
www.bf.emb-japan.go.jp/itpr_ja00_000197.html,
consulté le 2 sept. 19.
* 302 MOFA, 2013,
op.cit, disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad_20_fr.pdf.
* 303 JICA et Mitsubishi
Research and Consulting, 2013, op.cit., Rapport principal, page
4-6.
* 304 Repéré
sur
www.icafrica.org/en/news-events/infrastructure-news/article/le-japon...,
consulté le30 mai 2020
* 305 Repéré
sur www.sig.bf/2013/11/hydraulique-4-840-000-000-de-fcfa-pour...,
consulté le 30 mai 2020
* 306 Ces projets sont
disponibles sur le site de l'Ambassade du Japon au Burkina Faso:
www.bf.emb-japan.go.jp/itprtop_fr/index.html.
* 307 Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2018, projet de réalisations de forages dans quatre
communes de Samba, province du Passoré dans la région du
Nord, disponible sur
www.bf.emb-japan.go.jp/itpr_00_000196.html,
consulté le 1er juin 2019.
* 308 Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2018,projet d'approvisionnement en eau potable de
l'orphelinat Sainte Thérèse de Loumbilla, disponible sur
www.bf.emb-japan.go.jp/itpr_ja00_000193.html,
consulté le Septembre 2019.
* 309 Ambassade du Japon au
Burkina Faso, 2018, le projet de réalisation de forages dans trois
villages de la commune de Karangasso Sambla, disponible sur
www.bf.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000192.html,
consulté le 1er juin 2019.
* 310 MOFA, 2019,
op.cit, www. mofa.go.jp/files/000470872.pdf.
* 311 Déclaration de
Yokohama 2013, page 3.
* 312 JICA et Mitsubishi
Research and Consulting, 2013, op.cit., Rapport principal, page 4-6.
* 313 MOFA, 2013, op.cit,
disponible sur
www.mofa.go.jp/region/africa/ticad_20_fr.pdf.
* 314 PNUD, 2016,
Partenariat pour le développement en Afrique: le Japon et le PNUD en
action, page 6.
* 315 JICA, sd, Les
grandes lignes des activités: l'environnement, disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/activity05.html,
consulté le 18 janvier 2019.
* 316 Ministère de
l'environnement et du développement durable et JICA, 2013, Projet de
geste participative et durable des forêts dans la province de la
Comoé, rapport d'achèvement du projet (juin
2007-décembre 2012), Ouagadougou, Association japonaise de technologie
forestière (JAFTA), page 133.
* 317 Ministère de
l'environnement et du développement durable et JICA, 2013,
Idem, page 3.
* 318MOFA, 2009, Emergency
aid for flood disaster in Burkina Faso, disponible sur
www.mofa.go.jp/announce/announce/2009/9/11995560_1142.html, consulté le
23 mars 2019.
* 319 .MAECR, 2011,
op.cit., KM194.
* 320 MAECR, 2011,
Idem, KM194.
* 321 CNA, 2005,
op.cit., 7V347.
* 322 CNA, 2005,
op.cit., 7V347.
* 323 Ministère du
commerce de l'industrie et de l'artisanat, 2018, op.cit., page 39.
* 324 INSD, 2018, Annuaire
du commerce extérieur 2017, page 149.
* 325 Birba Germaine,
2015, « Exportation des produits agricoles : contre-attaque
de la filière sésame », in l'Economiste du Faso du
21 janvier, disponiblesur
www.leconomistedufaso.bf/2015/01/21/exportation-des-produits-agricoles-contre-attaque-de-la-filière-sesame/,
consulté le 13 août 2019.
* 326 Ministère du
commerce, de l'industrie et de l'artisanat, 2018, op.cit., page
41-42.
* 327 JICA, sd, Les
grands lignes des activités au Burkina Faso, disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/activities/volunteer.html,
consulté le 18 janvier 2018.
* 328 JICA, sd, Bureau de
la JICA au Burkina Faso, disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/office/index.html,
consulté le 18 janvier 2018.
* 329 MOFA 2019,
op.cit, www. mofa.go.jp/files/000470872.pdf.
* 330 JICA, sd,
Idem.
* 331 JICA, sd,
Activités au Burkina Faso: programme de
bénévolat, disponible sur
www.jica.go.jp/burkinafaso/english/activities/activity02.html,
consulté le 18 Janvier 2018.
* 332 JICA, sd,
op.cit.,
www.jica.go.jp/burkinafaso/french/office/index.html.
* 333 MOFA 2019,
op.cit,www. mofa.go.jp/files/000470872.pdf.
* 334 TICAD VI, 2018,
op.cit., page 11.
* 335 MOFA, 2019,
op.cit, www. mofa.go.jp/files/000470872.pdf.
* 336Idem.
* 337 FUTAISHI Masato,
2017, op.cit,www.sidwaya.bf<m.14910-cooperation-japon-burkina
faso/
* 338. Par exemple la
France et le Japon coordonnent des projets de développement dans les
secteurs des infrastructures et de l'eau en Côte d'Ivoire et au Kenya. Il
en est de même de la collaboration entre le Japon et le Brésil au
Mozambique dans le secteur agricole.
* 339 Aide bilatérale
et multilatérale cumulées.
|
|



