|

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES
ET
SOCIALES SOUISSI RABAT
Master Finance et Management des Organisations Economiques et
Sociales et
Développement Humain
La jeunesse Marocaine de la participation à
l'implication dans le développement humain et social : Cas de la
dynamique du Programme Concerté Maroc
Mémoire préparé et soutenu
publiquement par : ABDEDINE Hicham
Sous la direction de : BOUTARKHA Naaima
Professeur à la Faculté des Sciences Economiques
Souissi Rabat.
Suffragants :
NADIF Mohammed, Professeur et président du Master
AITHADDOUT Ahmed, Président du Réseau Marocain de
l'Economie Sociale et Solidaire (REMESS)
Année universitaire 2011/2012
« La question des jeunes est d'ordre structurel et ne
doit être abordée que dans le cadre d'une approche de
développement humain participatif, concerté (multi-acteurs)
impliquant nécessairement les jeunes. »
AIT HADDOUT Ahmed
Expert en économie sociale
et solidaire
Les opinions exprimées dans ce mémoire sont celles
de l'auteur et ne sauraient en aucun cas engager l'Université ou le
Programme Concerté Maroc.
Remerciements
Je dédie ce modeste travail à mes parents qui
m'ont soutenu durant tout mon cursus scolaire. Et par l'occasion je tiens
à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin
à la réalisation de cette recherche, par leurs idées, ou
leurs suggestions.
Mes remerciements à l'encadrement de la Faculté
au nom de madame BOUTARKHA Naaima pour avoir accepté
d'encadrer ce thème de mémoire et pour tous les aspects
techniques et méthodologiques, aux membres de la coordination nationale
du Programme Concerté Maroc qui m'ont accueillis parmi eux, et m'ont
consacrés leur temps précieux, et aux porteurs des projets qui
ont fait sujet de ce mémoire, pour leur accueil et leur amabilité
durant les entretiens réalisés sur le terrain.
Mes remerciements s'adressent aux membres du jury pour avoir
accepter de juger ce travail :
NADIF Mohammed, professeur et
président du Master option Finance et Management des Organisations
Economiques et Sociales et Développement humain ;
AITHADDOUT Ahmed, Président du
Réseau Marocain de l'Economie Sociale et Solidaire (REMESS).
Résumé
Ce travail se veut une contribution à la question de la
jeunesse marocaine : C'est une jeunesse qui connait plusieurs problèmes
liés au chômage et à la précarité, etc. Dans
cette recherche, nous mettons l'accent sur le rôle et les initiatives
prises par l'Etat censées répondre et corriger les
dysfonctionnements qui touchent les jeunes. Il s'avère que l'Etat ne
peut pas seul remédier à cette situation. Dans cette même
optique se dessine le rôle indispensable des organisations de la
société civile à travers un ancrage de la
coopération internationale. Il devient donc primordial d'adopter une
approche pluri-acteurs : une approche concertée en vue de
répondre à des problèmes communs. Dans cet objectif, le
choix a été mis sur la dynamique du Programme Concerté
Maroc (PCM), qui opte pour une action fondée sur l'implication des
organisations de la société civile franco-marocaines, aux
cotés des pouvoirs publics, dans le but de réfléchir
ensemble, et réhabiliter la situation de la jeunesse.
Cette recherche a été focalisée sur les
projets du PCM dans sa deuxième phase (2006-2010), pour montrer dans
quelle mesure l'approche concertée a bénéficié aux
jeunes marocains, et les a rendu des acteurs à part entière dans
le développement socioéconomique et humain de leur
société. Sur la base de l'analyse de quelques projets, il y'a eu
certes des résultats appréciables en matière d'implication
des jeunes dans le développement humain et social. Néanmoins le
PCM en est encore à son début entrain de s'élargir et
d'apprendre de ses expériences passées. De ce fait plusieurs
recommandations ont été dégagées pour le futur PCM
3, en vue de surmonter les obstacles et garantir la pérennité du
programme.
C'est au travers de trois chapitres que nous tenterons
d'amener des éléments d'analyse de notre problématique :
La jeunesse marocaine de la participation à l'implication dans le
développement humain et social. Le premier chapitre portera sur un
état des lieux de la situation socio-économique des jeunes, ainsi
que leur rôle dans l'histoire du pays. Ensuite dans le second chapitre,
nous allons aborder les réformes initiées par l'Etat en
matière de jeunesse. Enfin, un troisième et dernier chapitre
mettra l'accent sur l'analyse de l'impact des projets du PCM sur les jeunes.
Mots clés : jeunesse, Maroc, concertation,
cofinancement, emploi, chômage, Programme Concerté Maroc.
Table des matières :
Remerciements 3
Résumé 4
Liste des sigles et abréviations 7
Méthodologie de travail 8
Introduction générale 10
Chapitre 1. Histoire et état des lieux de la
jeunesse Marocaine 13
I. Le rôle de la jeunesse dans l'histoire du pays 13
II. Une population majoritairement jeune 15
III. Les jeunes dans l'économie 16
1. Le Chômage des jeunes 16
2. L'emploi des jeunes 19
IV. Analyse Sociologique 21
1. En matière d'éducation 21
2. La pauvreté et l'immigration clandestine 23
3. Les jeunes et la politique 25
Chapitre 2. Le rôle et les réformes de
l'Etat au niveau Social (1999 - 2011) 28
I. Lancement de l'Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH) 28
II. La Promotion de l'emploi 30
1. L'adoption de la Charte de la petite et moyenne entreprise
30
2. La réforme du code de travail 30
3. Insertion directe des diplômés chômeurs
31
III. La mise en oeuvre de la charte de l'Education Formation
31
1. Axes Stratégiques 31
2. Quelques Chiffres 32
IV. La promotion de l'activité du Microcrédit 34
V. Le système d'accompagnement et de création
d'entreprises pour les jeunes 35
1. Démarrage officiel du premier incubateur féminin
au Maroc 35
2. Association Maroc Telecom pour la création
d'entreprises et la promotion de
l'emploi 36
3. Les Centres Régionaux d'Investissement 36
4. Le programme Moukawalati 37
VI. Le lancement de la stratégie intégrée de
la jeunesse 38
1. Le diagnostic 38
2. Les forums régionaux de jeunes 39
3. Les critères de sélection 39
VII. Origine et fondement du Programme Concerté Maroc
41
Chapitre 3. Cas du Programme Concerté Maroc : la
recherche action réalisée sur les
projets de développement 45
Section 1 : PCM 2 et constats des entretiens effectués
sur terrain 45
I. Qu'est ce que la Capitalisation 45
II. Quelques constats préliminaires 46
1. La concertation pluri-acteurs 46
2. L'implication de la jeunesse 47
Section 2 : Analyse des Projets de Développement du
PCM 2 49
I. Agir sur la jeunesse par une approche concertée 49
II. Impliquer les jeunes dans le processus du
développement humain 52
III. Cofinancement des projets du Programme Concerté
Maroc 55
Conclusion 62
Annexes 65
Bibliographie 75
Liste des sigles et abréviations
BIT : Bureau International du Travail
CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement CNLRQ : Comité National de Liaison des
Régies de Quartiers
CR : Commune Rurale
CRED : Centre des Recherches et des Etudes Démographiques
CRI : Centre Régional d'Investissement
CU : Commune Urbaine
Copil : Comité de Pilotage
FAIR : Fond d'Appui aux Initiatives Régionales FAP : Fond
d'Appui à Projet
FMI : Fond Monétaire International
FNUAP : Fond des Nations Unies pour la Population
HCP : Haut Commissariat au Plan
IDH : Indice de Développement Humain
INDH : Initiatives Nationale pour le Développement
Humain
JTC : Jeunesse Territoire Citoyenneté ONU : Organisation
des Nations Unies OSC : Organisations de la Société Civile PAS :
Programme d'Ajustement Structurel PCM : Programme Concerté Maroc
PCP : Programme Concerté Provincial PCPA : Programme
Concerté Pluri-Acteurs
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
UNICEF : Fond des Nations Unies pour les Enfants
UNIFEM : Fond des Nations Unies pour la Femme
Méthodologie de travail
1. Le choix du thème de la jeunesse :
Le choix de la problématique de la jeunesse marocaine
est lié au fait que l'auteur même de ce mémoire fait partie
de cette catégorie de la population. Une jeunesse souvent
marginalisée et loin d'être impliquée dans la prise de
décision, parce qu'on ne la considère pas comme une force de
proposition, et de contribution au développement du pays. De plus la
jeunesse connait beaucoup de problèmes, tel que le chômage, la
marginalisation, la sous-représentation dans les instances politiques.
Nous cherchons dans ce mémoire à relever les problèmes
vécus par ces jeunes, comment les initiatives de l'Etat ont
répondu à ces problèmes, et quel rôle du
système de coopération international à travers le cas du
PCM.
2. Méthodes spécifiques : La
mission consistait à faire :
o Une Collecte documentaire ;
o Des Entretiens individuels et collectifs ; o Une
rédaction de fiches de synthèse ;
Une première rencontre a été
organisée avec l'équipe du Bureau du Programme Concerté
Maroc pour faire un peu connaissance avec l'équipe du Bureau
opérationnel, et aussi avoir une idée sur le planing de la
mission.
Une formation accélérée sur la
Capitalisation des expériences a été faite par le
consultant de Capitalisation du programme en France : le but était de
comprendre la tache assignée, pour bien mener les entretiens.
Après une analyse documentaire, et une
présentation de fiches synthétisées sur les documents
analysés, un planing a été mis en place pour les
entretiens sur terrain, des visites ont été organisées en
coordination avec les acteurs à interviewer.
La Capitalisation a été basée sur trois
axes : la gouvernance internationale du PCM, l'accompagnement de la jeunesse
marocaine et la qualification des acteurs, notre recherche mettra le point sur
le deuxième axe dans un cadre de concertation pluriacteurs, puisqu'il
s'agit de la philosophie du PCM pour agir au profit des jeunes
marocains. De ce fait des entretiens ont été
effectués auprès des acteurs membres du PCM, avec des questions
spécifiques et déclinées pour chacun d'eux, dans ce
même cadre, nous avons effectué des entretiens avec les porteurs
des trois projets qui font l'objet de ce mémoire :
o Un entretien collectif effectué à Khénifra
avec les porteurs du projet Cré'Acteurs ;
o Des entretiens individuels ont concernés : le
délégué de l'Entraide Nationale
de Jerada et le référent jeune du Programme
Concerté Provincial de Jerada ;
o Des entretiens avec le
trésorier et le responsable administratif et financier de
l'Espace Associatif, dans le cadre du projet JTC.
Ces entretiens ont pour objectif de répondre aux questions
suivantes :
- Comment la Concertation de plusieurs acteurs peut dynamiser la
situation des jeunes ?
- Dans quelle mesure les jeunes ont été
impliqués, en tant que bénéficiaires et acteurs dans leurs
projets ?
- Quelles sont les retombées de la logique du
Cofinancement sur les projets destinés aux jeunes ?
3. Difficultés rencontrées :
Parmi les difficultés rencontrées durant
l'élaboration de ce mémoire, nous avons retenu les suivantes :
o La rareté des enquêtes portant sur la jeunesse,
souvent les informations sur les jeunes sont à rechercher dans des
enquêtes nationales portant sur des questions impliquant la population en
général (emploi, mariage...), la population active urbaine ou
rurale etc.
o Dans le cadre des entretiens menés sur le terrain,
nous avons été confrontés à certains associatifs
qui font parti des projets du PCM, et qui ne le connaissent pas bien, et donc
leurs réponses aux questions n'ont pas été prises en
compte.
Introduction générale
Le rapport mondial de l'ONU de l'année 2007 sur la
jeunesse comporte de nombreux avertissements concernant les menaces qui
pèsent sur le développement de la jeunesse.
Ce rapport stipule que 1,2 milliard de personnes en 2007 sont
âgées de 15 à 29 ans, et que cette jeunesse est la mieux
éduquée de l'histoire. Il relate aussi que les
réalités vécues par celles-ci sont pourtant alarmantes, et
il expose de nombreuses données significatives, par exemple :
- 200 millions de jeunes vivent avec moins d'un dollar US (8
dirhams) par jour ; - 130 millions de jeunes sont analphabètes ;
- 10 millions de jeunes sont atteints du VIH (SIDA) ;
- 88 millions de jeunes sont au chômage ;
Les jeunes constituent, selon l'ONU, 18% de la population
mondiale et sont une ressource importante pour le développement des
nations. D'où l'enjeu capital pour toutes les politiques publiques
d'être en harmonie avec les besoins, les exigences et la
réalité de cette couche de la société.
Les questions liées à l'éducation, la
santé, l'emploi, la lutte contre la pauvreté, les droits de
l'homme (...) constituent des enjeux prioritaires pour la jeunesse. C'est ce
qui fait du domaine de la jeunesse un espace favorable aux « politiques
intégrées », tout en sachant que cette approche est la plus
répandue dans de nombreux pays. Ces politiques sont gérées
par des agences nationales (indépendantes ou collectives) qui englobent
les diverses parties actives de la société, y compris la
société civile.
Notre étude porte sur le cas de la jeunesse Marocaine,
une jeunesse qui a évolué à travers le temps de
façon fluctuante et constitue à la fois un atout important pour
le pays, et sa chance pour l'avenir. Selon le rapport du cinquantenaire de
2006, les jeunes de moins de 30 ans représentent 60% de la population.
Cette population jeune souffre d'un chômage massif et d'une
précarité de l'offre d'emploi. En matière
d'éducation, les jeunes souffrent encore de l'analphabétisme, et
d'une insuffisance en termes d'accès à une éducation de
qualité (etc.).
Bien qu'aucune politique ou stratégie nationale
multisectorielle de jeunesse n'ait
encore été
développée, il semble qu'il y'a actuellement un environnement
politique
favorable et une volonté de différents secteurs
gouvernementaux pour prêter une
attention soutenue aux problèmes des adolescents et des
jeunes adultes. L'analyse des différentes politiques menées en
faveur des jeunes montre que ceux-ci sont au centre des préoccupations
des décideurs marocains.
Toutefois, l'approche adoptée pour apporter une
réponse aux besoins des jeunes reste sectorielle et ne prend pas en
considération l'interaction des problèmes entre eux et leur
incidence sur le devenir de la société. Il faut noter aussi que
« depuis les années 1970 les crises économiques et
l'augmentation des déficits publics, l'ouverture des marchés et
l'incidence de la mondialisation, etc., ont favorisé un profond
réexamen du rôle de l'Etat dans la plupart des pays du monde
»1. En effet, l'Etat semble, aujourd'hui, de plus en plus
incapable de faire face seul aux défis étroitement liés
à la persistance du chômage, aux nouvelles formes de
pauvreté, aux exigences en matière de droit de l'homme, et la
dégradation de l'environnement.
Constat majeur, est celui du rôle de plus en plus
important que peuvent jouer les programmes de coopération internationale
au Maroc. Ces derniers travaillent sur des questions liées à ce
qui est déjà cité plus haut. Leur objectif est de
rassembler les différents acteurs de la société
(associations, coopératives, élus locaux, ONG, pouvoirs
publics.etc.), en vue de résoudre ensemble des problèmes communs.
Dans notre étude, nous allons nous focaliser sur le cas du Programme
Concerté Maroc.
Rappelons que le plan du Mémoire s'articulera autour de
trois chapitres, un chapitre premier qui portera sur l'état des lieux de
la jeunesse marocaine. Un deuxième chapitre se focalisera sur les
réformes de l'Etat qui ont été lancées pour
remédier aux déséquilibres humains et sociaux, et qui ont
inclus la jeunesse marocaine. Enfin, le troisième chapitre portera sur
la partie pratique du mémoire, il s'agira de la recherche action qui a
été faite dans le cadre du chantier de la capitalisation des
projets de développement, qui sont destinés aux jeunes
ciblés par le programme. De plus, nous allons effectuer une analyser de
trois projets de développement. Cette analyse a été
basée sur plusieurs entretiens avec les présidents et les chefs
de projets des associations membres, également avec les responsables de
la coordination nationale, ainsi que les jeunes référents (etc.).
L'objectif étant de déterminer l'impact de la philosophie du PCM
sur les jeunes.
1 Rapport de l'Institut National de Statistique et
d'Economie Appliquée (INSEA), Economie sociale au Maroc :
état des lieux et perspectives d'avenir, 2007, 105 p.
Chapitre 1. Histoire et état des lieux de la
jeunesse
Marocaine
La jeunesse constitue un atout incontestable pour le pays.
Selon le rapport du cinquantenaire, les jeunes de moins de 30 ans
représentent 60%2 de la population. Au delà de leur
catégorisation statistique, les jeunes représentent un potentiel
humain considérable, dont la valorisation constitue un défi
crucial pour le pays. Paradoxalement, cet important potentiel d'avenir est mal
connu en termes sociologiques et culturels. Le déficit de connaissance
que le Maroc a accumulé sur sa jeunesse est patent et doit être
comblé si l'on veut être à la hauteur des attentes.
I. Le rôle de la jeunesse dans l'histoire du pays
A travers le passé la jeunesse marocaine s'est
rassemblée autour d'une question incontournable, celle de la
libération du pays.
Le nationalisme a lutté contre le protectorat, en
tissant tout un réseau de résistances dont l'objectif principal
était l'indépendance autour de laquelle il y'avait un consensus
total du peuple et du Roi (Ikken, 1999). La volonté de la
libération était portée sur les épaules des jeunes
marocains (étudiants, militants, ouvriers, ou encore de simples
citoyens). Les animateurs du nationalisme étaient jeunes pour la
plupart. Leur âge ne dépassait guère 20 ans. On pourrait
citer quelques noms de ces jeunes résistants qui devaient marquer, plus
tard, l'histoire marocaine (Omar Ben Abdeljalil, Abdelaziz Ben Driss, Ahmed
Cherkaoui, Mehdi Benbaraka, Abderrahim Bouabid...), (Ikken, 1999).
Sur la base de la présentation du manifeste de
l'indépendance du 11 janvier 1944, ce dernier a été
marqué par une forte présence de jeunes, entre résistants
nationalistes, cadres, et intellectuels, « 70% des jeunes signataires
avaient un âge compris entre 15 et 35 ans »3
(...).
2 Rapport du Cinquantenaire, Le Maroc
Possible, « Les jeunes et la dynamique du changement », 2006,
282 p.
3 Les âges des signataires à la
signature du Manifeste, ont été calculés sur la base du
nombre des signataires et la différence entre leurs dates de naissance
et la date de la présentation du Manifeste de l'Indépendance.
Les jeunes par contre se sont rassemblés sous
l'initiative du nationalisme, la formation se faisait dans des petits groupes,
sous forme d'associations théâtrales, et sportives, dont les buts
étaient apparemment éducatifs, mais dans la
réalité, ces petits groupes étaient de véritables
foyers nationalistes, qui facilitaient la circulation des idées, et
également constituaient un réservoir de formation et de
recrutement des jeunes militants (Ikken, 1999).
En 1932, une Association dénommée « Union
sportive de Rabat-Salé » (Mernissi, 2008), a été
créée. Elle constitue le véritable lancement d'un
mouvement associatif de la jeunesse marocaine.
La véritable structuration de la jeunesse marocaine
s'est réalisée après la libération du pays, en
1956. Deux des plus grands mouvements de la jeunesse ont vu le jour à
savoir l'Association Marocaine d'Education de la Jeunesse (AMEJ), et Toffola
Chaâbia (Mernissi, 2008).
A cette époque, les jeunes étaient plus
conscients du rôle qu'ils devaient jouer au sein de leur pays
libéré, leur rôle s'était concrétisé
dans plusieurs projets économiques et sociaux : reboisement,
opération école, lutte contre l'analphabétisme... Des
exemples de responsabilité, et d'implication des jeunes dans la
construction et la réalisation de l'essor du pays, telle que la
participation en 1957 de 12 000 jeunes à la construction de la route de
l'Unité (Al-Wahda). La plus grande mobilisation de la jeunesse
que le Maroc a connue en 1975 était la Marche Verte qui avait
mobilisé toute la jeunesse Marocaine : 75 % (Ikken, 1999) des marcheurs
avaient moins de 25 ans.
Depuis les années 80 et le début des
années 90, le Maroc est entré dans une phase de déficit
public dû à l'application du Programme d' Ajustement Structurel
(PAS), et qui de plus a entrainé des conséquences néfastes
au niveau social qui ont touché la jeunesse, tel que l'augmentation du
chômage, et de la pauvreté, etc.
Ci-après, nous allons voir les facteurs
démographiques qui ont favorisé l'importance de la
catégorie des jeunes.
II. Une population majoritairement jeune
La démographie marocaine précoloniale suivait un
régime démographique quasinaturel, elle connaissait des
fluctuations causées par la fréquence des crises
démographiques, ces dernières liées à un
phénomène naturel (sécheresse, épidémies,
etc.), et aussi à un facteur politique comme les invasions
étrangères.
Au début du 20ème siècle la
pyramide des âges au Maroc se caractérise par une base large,
notons ainsi l'importance de la tranche d'âges située entre 10 et
24 ans.

Source :
http://www.exportnetwork.ma
Plusieurs facteurs peuvent justifier cette tendance :
l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène,
l'accroissement très sensible des connaissances médicales ainsi
que le développement des mesures préventives et
curatives4.
Il faut noter que l'espérance de vie à la
naissance est passée de 67,9% à 72,9%5
4 Rapport du CRED et HCP : Tendances
passées et perspectives d'avenir, 2006, 96 p.
5 Ministère de la Santé et Haut-commissariat au
Plan, 2009-2010.
entre 1994 et 2009. Et dans une autre optique le taux
d'alphabétisation de la population âgée de 10 ans et plus a
évolué de 45% à 60,3%6 sur la même
période, marquant ainsi le passage à une population mieux
instruite et consciente quant aux préventions contre les maladies
infantiles, et aux exigences nutritionnelles pour préserver
l'état sanitaire des descendants.
Ceci s'est accompagné par le progrès en termes
d'équipement médical et d'infrastructures hospitalières.
Ajoutons à cela que le nombre d'habitants par médecin a
baissé de façon importante entre 1994 et 2008 passant de 2933
à 1611 habitants par médecin. Donc ces résultats
confirment la baisse du taux de mortalité infantile de 57%o à
32,2%o7 entre 1991 et 2009.
L'ensemble de ces éléments combinés les
uns aux autres, ont favorisé un environnement propice à
l'augmentation de la masse des jeunes, cette dernière qui
nécessite une attention particulière, vu qu'elle soufre de
plusieurs problèmes, tel que ceux liés à l'emploi,
à la pauvreté et à la persistance du chômage,
etc.
Dans la partie qui va suivre, nous allons mettre la
lumière sur les problèmes rencontrés par les jeunes en
termes de chômage et d'emploi.
III. Les jeunes dans l'économie 1. Le
Chômage des jeunes
La question du chômage ne peut être abordée
sans se référer à plusieurs critères, qui sont :
l'évolution de la structure du marché de travail,
l'évolution du progrès technique, la qualification de la main
d'oeuvre, et également la structure de la pyramide des âges du
pays.
En effet le marché du travail est un lieu abstrait
où se confronte l'offre et la demande d'emploi. Lorsque la demande sur
ce marché diminue le chômage augmente. Les crises
économiques constituent une cause majeure du chômage, car les
entreprises qui sont touchées par la crise cherchent à
réduire leurs coûts de production en procédant à des
licenciements. Une autre cause est la substitution du capital au travail : en
raison de l'évolution du progrès technique qui pousse les
entreprises à remplacer l'Homme par la machine, et ce pour des soucis de
productivité.
6 Opcité.
7 Opcité.
D'autre part même en présence d'importants
investissements la question de la qualification est incontournable, les
entreprises cherchent des profils qualifiés et bien formés pour
assurer la pérennité de leurs organisations. Cet objectif est
parfois difficile en raison des problèmes que le pays connait en
matière d'éducation, tel que la présence d'un taux
élevé des non diplômés. Près de
65,2%8 de la population active ne dispose d'aucun diplôme.
En outre, la structure des âges de la population est
cruciale, car la présence d'une population majoritairement jeune, exige
des investissements important de la part de l'Etat, et lorsque ce dernier
n'arrive pas à créer ces investissements, les jeunes et plus
particulièrement les diplômés sont en situation de
chômage.
En effet, le chômage au Maroc touche surtout les
diplômés, plus spécifiquement les femmes avec
70,7%9. Cela peut être justifié par le fait que les
femmes ne s'intègrent pas facilement dans la majorité des
fonctions comme les hommes, ces derniers en tendance à accepté
des fonctions quelque soit leur nature et leur degré de
difficulté ainsi que la situation géographique. Il faut noter
aussi que les femmes constituent la tranche la plus diplômée avec
14,4% par rapport aux hommes 10,3%10. On assiste donc à une
nouvelle catégorie de femmes carriéristes dont le cycle
d'étude augmente de plus en plus. Il faut savoir également que
les jeunes diplômés sont les plus touchés par le
chômage surtout la tranche de 15 à 24 ans (57,9%)11,
suivi de la tranche d'âge de 25 à 34 ans (32,6%) puisqu'il s'agit
de la population la plus nombreuse, et celle dont les attentes sont beaucoup
plus exigeantes quant aux postes à occuper.
De façon générale et en observant
l'évolution du taux de chômage de l'année 2005, 2008 et
2010, et selon le graphique ci-après nous remarquons une tendance
globale à la baisse, le taux de chômage national est passé
entre 2005 et 2010 de deux chiffres (11%) à un seul chiffre
(9,1%)12. Cette tendance est justifiée par les initiatives
prises par l'Etat tel que l'encouragement de l'investissement, le lancement de
l'INDH en 2005 et également la mise en oeuvre de la nouvelle charte de
l'emploi (cf.chapitre 2).
8 Haut Commissariat au Plan, Enquête sur les
niveaux de vie des ménages, 2008.
9 Rapport de l'Agence Internationale du
Développement Economique et Social, 2008.
10 Opcité.
11 Opcité.
12 Haut Commissariat au Plan, Enquête nationale
sur l'emploi, 2010.

Graphique 1 : Taux de chômage national selon le milieu
(2005,2008 et 2010)
2. L'emploi des jeunes
La question de l'emploi est liée à plusieurs
facteurs. Tout d'abord elle est fonction du niveau d'éducation et de
qualification de la population du pays, elle est liée également
à la politique d'ouverture en termes d'investissements étrangers,
et d'autre part, à la répartition géographique de
l'emploi.
De façon générale les créations
d'emploi se font essentiellement en milieu urbain. En effet, la dernière
décennie a été marquée par la création de
1,56 millions d'emlpois dont 69% ont été créés dans
les villes, alors que 31% ont concerné les campagnes. Ce qui est tout
à fait normal puisque ce sont les villes qui offrent le plus
d'opportunités d'emplois en présence d'une forte
industrialisation, des entreprises, et des administrations, etc.
Il est à signaler que dans le grand Casablanca, 28 000
emplois sont créés chaque année, 17 000 nouveaux emplois
annuels dans la région de Marrakech -Tensift-Al Haouz, tandis que la
région de Tadla-Azilal perd chaque année 1000 postes par an en
moyenne. En se basant sur les tranches d'âge, du fait que les jeunes sont
exigeants en matière de postes à pourvoir, les emploi
créés durant la dernière décennie ont
profité plus aux adultes âgés de 30 à 59 ans avec
158 000 emplois en moyenne annullement depuis l'année 2 000. Par contre
chez les jeunes de 15 à 29 ans 9 000 emlpois ont été
pérdus chaque année13.
La délocalisation des unités de production de
bien et de services ont beacoup contribué à la création
d'emplois au Maroc, notamment la dynamique de l'offshoring. Un exemple est
celui des centres d'appel qui emploient plus de 30 00014
salariés au niveau national, mais il reste pour les jeunes un tremplin,
et source pour financer leur quotidien.
13 La Vie Economique, mai 2011.
14 Enquête de l'émission
Eclairage, 2010.
« J'ai intégré le métier des
centres d'appel, seulement pour assurer le financement de mes études
supérieures, et non pas pour construire une carrière, à
mon avis c'est un travail très stressant même s'il est bien
rémunéré, et dés que j'aurais mon diplôme je
vais chercher un poste qui correspond bien à mon profil universitaire
». Khaled, 24 ans, Rabat.
Mais certains jeunes l'ont pris comme une carrière, et
ne souhaitent pas le changer même contre un emploi dans le public,
justifiant cette préférence par le fait que les centres d'appel
offrent par exemple au titulaire d'un bac+2 un salaire 2 fois celui de la
fonction publique.
« C'est vrai que je suis titulaire d'une licence en
droit, et je sais que beaucoup de jeunes manifestent devant le parlement chaque
jour, pour intégrer la fonction publique, mais moi je souhaite
travailler dans le centre d'appel, car j'ai deux enfants, un loyer et j'ai
acheté une voiture à crédit, seul un salaire comme celui
que je reçois me permet de faire face aux charges très lourdes de
la vie ». Nadia, 26 ans, Temara.
Nous constatons qu'au niveau de l'emploi, il s'agit
plutôt des préferences des jeunes quant au secteur dans lequel ils
souhaitent travailler. En 1992, selon le Haut Commissariat au Plan 87 % des
jeunes diplômés en chômage préféraient
travailler dans le secteur public dont 30 % au Ministère de
l'intérieur. Seuls 2 % optaient pour le secteur privé, car
communément les jeunes pensent que le secteur privé est fragile
et peu sûr. Mais avec la persistance du chômage, les exigences de
la vie et l'évolution des besoins de consommation, les jeunes commencent
à changer leurs attitudes en optant de plus en plus pour des initiatives
privées (Chattou, 2003).
Dans une autre optique, on assiste à une
dépréciation des diplômes, comme exemple la licence n'a
plus la valeur qu'elle avait il y'a longtemps, et cette dépreciation est
proportionnelle à la dégradation du niveau de l'enseignement et
également aux exigences des entreprises en matière de
qualification et de compétence. Donc, les jeunes étudiants
commencent à sentir cette frustration, ils sont donc contraints par le
fait qu'ils doivent prolonger leur cycle d'études et avoir de hauts
diplômes s'ils veulent intégrer un poste intéressant et
bien rémunéré.
Un autre problème qui bloque l'emploi des jeunes, c'est
celui du réseau famillial et de la corruption, les diplômes
même s'ils sont souvent de niveau supérieur, s'avèrent
insufisants. Beaucoup de jeunes étudiants affirment l'importance de
l'intermédiaire ou encore le terme le plus utlisé dans la
société (le Piston), pour accèder à un
emploi. C'est ce qui crée plus de frustration chez les jeunes
diplômés en supérieur, c'est le fait d'emploi basé
sur les connaissances et les réseaux familliaux, et qui mènent
à des dysfonctionnements au sein de l'entreprise du fait de
l'inadéquation du profil avec le poste à pourvoir, ou de
l'incompétence de la personne recrutée. Et même nous
assistons à des recrutements par des entreprises privées, non
justifiés par le mérite ou la compétence, seulement sur
des critères physiques, plus particulièrement liés aux
jeunes femmes. Certaines entreprises privées exigent lors des entretiens
d'embauche que les jeunes femmes voilées par exemple, enlèvent
leurs voiles, si jamais elles veulent être admises au sein de
l'entreprise. Parfois les recruteurs abusent de leur pouvoir de recrutement
envue d'exploiter le besoin des jeunes femmes d'un travail, ce qui conduit
souvent à des harcèlements sexuels.
En plus de la problématique du chômage et de
l'emploi des jeunes, il y'a d'autres problèmes d'ordre sociologique
vécus par les jeunes, tels que les problèmes liés à
l'éducation, la pauvreté et l'émigration, et que nous
allons voir ci-après.
IV. Analyse Sociologique 1. En matière
d'éducation
L'éducation est censée être un
critère de développement des nations, dans la mesure où
elle est le précurseur de l'amélioration des conditions de vie de
la population. Cette dernière en étant bien formée, peut
accéder facilement à un emploi, d'autant plus l'éducation
figure parmi les trois critères de l'IDH qui permettent de classer les
pays selon l'ordre de développement humain. Le Maroc a été
classé en 2008, au 130ème rang sur 182 pays au niveau du
développement humain, et c'est le secteur de l'éducation qui l'a
entre autres pénalisé. De ce fait, le pays compte parmi les
nations à faible IDH, et ce, malgré les efforts consentis depuis
l'année 2004 (cf. chapitre 2) qui ont contribué à
améliorer le développement humain au Maroc.
Le système éducatif a rencontré ses
limites en matière de résolution du problème du
chômage. Le Maroc est l'un des rares pays qui n'ont pas instauré
un système d'évaluation des apprentissages15. Et la
Banque Mondiale a classé le Maroc dans les derniers rangs à
coté du Djibouti, du Yémen et de l'Iraq.
En se focalisant sur les chiffres, la proportion des
diplômés est passée de 30,4% à 36,6% entre 1999 et
2009. Le taux d'alphabétisation de la catégorie des jeunes
à âges de 15 à 24 ans est passé de 62,5% à
79,5% sur la même période, ceci est dû à l'attention
particulière accordée par la haute autorité au domaine de
l'alphabétisation, notons qu'il y'a eu création de deux
directions, à savoir la Direction de l'Education non Formelle, et la
Direction de la Lutte Contre l'Analphabétisme. Du coté de la
scolarisation, le Maroc a enregistré une importante évolution
concernant l'enseignement primaire de la population de 6 à 12 ans, ainsi
le taux de scolarisation de cette catégorie a atteint 90,5%. Pour
l'enseignement scolaire collégial, le Maroc a atteint un taux de 44%. Si
l'on observe ces deux derniers taux, on peut dire que l'effectif qui
accède à l'enseignement collégial ne représente que
la moitié de l'effectif scolarisé dans le primaire. Plusieurs
facteurs peuvent être avancés : les jeunes quittent le cycle
primaire en cours de route, ou bien ils réussissent le cycle primaire,
mais n'ont pas la possibilité d'intégrer le cycle
collégial, pour des soucis financiers. Plusieurs d'entre eux quittent
l'école pour travailler et aider leurs familles, les garçons
travaillent en tant qu'apprentis par exemple dans la menuiserie, la
mécanique, etc. Concernant les filles, elles sont beaucoup plus
orientées vers le travail domestique, en tant qu'aides
ménagères. Ceci à plusieurs conséquences
négatives sur cette catégorie de la population, car ils sont
exposés à la manipulation dans des travaux forcés contre
une somme d'argent minime, et également à l'exploitation
sexuelle.
En matière de formation professionnelle, les
résultats sont importants, il faut noter que l'effectif a presque
doublé en nombre de stagiaires, entre 1999 et 2009, passant ainsi de 130
000 à 252 000 stagiaires. Il est force de constater que l'on
évoque tout le temps l'évolution en termes de quantité,
mais on ne met jamais l'accent sur l'amélioration de la qualité
de l'éducation au Maroc, ce qui a contribué au faible classement
du Maroc en matière d'éducation à l'international.
15 Le Matin, du 4 février 2008, Art : La Banque
mondiale cloue au pilori l'enseignement et appelle à des
réformes.
Les problèmes liés à l'éducation et
à la difficulté d'accès à l'emploi renforcent la
pauvreté et l'immigration des jeunes.
Ci-après nous allons mettre la lumière sur les
problèmes liés à la pauvreté et à
l'immigration clandestine.
2. La pauvreté et l'immigration
clandestine
La pauvreté est une composante structurelle de la
situation économique et sociale du Maroc. Liée à
l'état de sous développement dans le quel le pays se trouvait au
moment de l'indépendance, elle perdure au-delà de la
période de mise en application du Programme d'Ajustement Structurel.
Confronté à un endettement lourd, le pays est contraint d'adopter
de 1983 à 1993 un PAS imposé par le FMI. Ces dix années
ont été marquées par la réduction massive des
dépenses publiques, le développement des exportations, les
politiques de privatisation et parallèlement par la montée de la
pauvreté et du chômage.
o La Pauvreté au Maroc :
Depuis le début des années 90, le Maroc s'est
trouvé confronté à une situation sociale en
perpétuelle dégradation, caractérisée par une
pauvreté grandissante et par un creusement des inégalités.
La proportion de la population vivant en dessous du seuil national de
pauvreté atteint 19% en 2003, contre 13% en 1997. En outre, les
inégalités sont importantes. Selon un rapport de l'O.C.D.E sur
les perspectives économiques en Afrique 2002, 10% des plus pauvres
détiennent 2,6% de la richesse nationale, tandis que 10% des plus riches
en possèdent 30,9 %.
En termes d'impact, l'amélioration globale des niveaux
de vie, conjuguée à la stagnation des inégalités
sociales, a sensiblement réduit la pauvreté de 2001 à
2008, « le taux de pauvreté absolue a diminué de 6,7%
à 3,6% au niveau national, de 2,3% à 1,3% en milieu urbain, et de
12,3% à 6,7% en milieu rural. »16.
En termes d'effectif, si le nombre de personnes vivant en
dessous du seuil de la pauvreté s'élève en 2007 à
2,8 millions17 personnes, il y a lieu de noter que, depuis 2001, 1,7
million de marocains sont sortis de la pauvreté. Dans ces
progrès, il est certain que l'impact de l'Initiative Nationale pour le
Développement Humain a été
16 HCP, rapport national sur les Objectifs du
Millénaire pour le Développement, 2009.
17 HCP, rapport national sur les Objectifs du
Millénaire pour le Développement, 2007.
d'une portée significative malgré le
caractère récent de sa mise en oeuvre, la pauvreté a
baissé plus rapidement dans les communes rurales ciblées par
cette initiative. Entre 2004 et 2007, la pauvreté a baissé dans
ces communes de 36% à 21%18.
Malgré ces réalisations la pauvreté
persiste encore au Maroc et touche les jeunes en particulier puisqu'ils
constituent une partie importante de la population du pays, entrainant ainsi
d'autres conséquences : par exemple l'émigration non
conventionnelle ou conventionnelle à l'étranger en est une. La
principale cause, c'est que les jeunes, cherchent à sortir de la
précarité, et comme solution ils choisissent d'émigrer
à l'étranger. Parmi ces jeunes, on trouve les titulaires de
diplômes dans des spécialités qui ne sont pas beaucoup
demandées au Maroc, et qui émigrent par exemple au Canda ou en
Allemagne... là où leurs compétences sont
valorisées.
Un autre fléau est celui de la prostitution des jeunes
femmes qui se trouvent dans une situation de pauvreté et de
chômage. Il faut signaler que les chiffres des Maladies Sexuellement
Transmissibles sont importants, 77%19 des femmes atteintes ont un
âge situé entre 15 à 25 ans, alors que les jeunes hommes
représentent 23% seulement.
o De la pauvreté à l'émigration
clandestine
Prés de 2 millions de marocains vivent et travaillent
actuellement en Europe. Les marocains se prennent comme destination principale
l'Europe, non seulement pour des raisons économiques, mais
également pour des raisons psychologiques.
Il faut noter que le Maroc compte parmi les pays africains
à forte affluence d'émigrés clandestins, et constitue
également un canal de passage pour les émigrés
subsahariens.
Chaque jour, de nombreux jeunes marocains entreprennent des
voyages dangereux vers les côtés d'Espagne ou les Îles
Canaries. Mais, plus souvent qu'on ne le pense ces immigrations n'aboutissent
pas à la destination souhaitée, entrainant ainsi des
dégâts humains importants en raison des moyens utilisés, et
qui ne répondent pas aux normes en vigueur.
18 HCP, Enquête nationale sur les niveaux de
vie des ménages, 2007.
19 Reportage sur les Maladies Sexuellement
Transmissibles, 2M, 2010.
En 2002, 90% des jeunes marocains veulent émigrer et
vivre à l'étranger et 89% des jeunes entre 20 et 29 ans
souhaitent migrer. 60% des femmes déclarent qu'elles n'hésiteront
pas à quitter le Maroc pour rejoindre l'Europe20. Constat
majeur à faire, c'est la frustration des jeunes face à la
précarité, ils ont perdu confiance vis-à-vis des
politiques publiques et aussi dans les instances représentatives, qui
utilisent seulement les voix des jeunes pour accéder aux postes de
pouvoir. Mais en contrepartie, ils ne prêtent pas une attention
particulière aux attentes des jeunes.
3. Les jeunes et la politique
Au Maroc, la relation des jeunes à la politique reste
à appréhender. Malgré les signes de libéralisation
politique, les enquêtes menées jusqu'à présent,
mettent en évidence la montée de l'abstention et la baisse des
adhésions des jeunes aux organisations politiques traditionnelles.
Il est force d'affirmer l'indifférence croissante des
jeunes à la politique, en plus de cette indifférence,
affirmée d'autres types de rapports positifs à la politique
peuvent êtres distingués : celui où les jeunes sont
encadrés dans des organisations politiques ou à caractère
politique et celui où le rapport à la politique se fait en dehors
de toute agence politique. On peut aussi ajouter les nouvelles formes d'actions
collectives qui s'inscrivent dans le cadre de la société civile
et qui sont souvent présentées comme un palliatif à
l'action politique (Rachik, 2006).
Au niveau de l'adhésion des jeunes aux partis
politiques, malheureusement il n'ya pas de données précises quant
au nombre des jeunes adhérents aux partis politiques, faute de
présence d'enquêtes nationales à ce sujet. En 1992, le taux
des adhérents parmi les étudiants ne dépassait pas 7 %.
D'après une autre enquête menée à l'échelle
nationale 32,1 % des jeunes enquêtés savent ce qu'est une
association (48 % en urbain et 10 % en rural), 4 % adhèrent à une
association (0,7 % en rural) dont 80 % à des associations sportives,
culturelles et éducatives et 18 % à des associations à
caractère politique (Bourqia, 1992).
20 Le journal indépendant, 2002.
En matière du rapport entre la politique et la
religion, les jeunes ne veulent pas que la religion se mêle des partis
politiques, c'est ce qui a été tiré dans l'enquête
récente menée par l'Economiste et Sunergia sur les jeunes
d'aujourd'hui.
D'après cette enquête effectuée sur un
échantillon de 1020 jeunes issus de différentes villes du
royaume, 37% sont contre le fait que la religion guide les partis politiques,
29% sont pour, et 35%21 des jeunes ont déclaré qu'ils
ne savent rien. Ces chiffres nous poussent à émettre quelques
suppositions : les jeunes tendent de plus en plus vers la modernisation du fait
que les Etats s'inspirent des modèles occidentaux en matière de
démocratie, du droit de la femme et du droit de l'enfant (...), ce qui a
généré chez les jeunes une culture de modernité de
l'Islam, en faisant de lui seulement une pratique secondaire qui doit
s'éloigner du champs politique.
D'autre part, il y'a une part de jeunes qui ont copié
le modèle parental conservateur, et qui fait que les décisions
politiques doivent prendre comme base de départ les valeurs de
l'Islam.
De l'autre coté on trouve une part importante des
jeunes qui n'ont pas d'opinion. Cela est dû au manque de culture
politique et religieuse, qui est lié aux insuffisances éducatives
en matière d'éducation à la citoyenneté, avec des
programmes fondamentaux souvent superficiels. Ces derniers ne prennent pas en
compte le rôle que les jeunes peuvent jouer dans la gestion de la chose
publique, à travers le vote, la participation dans la prise de
décision, etc.
De plus, il est force d'affirmer que les jeunes peuvent jouer
un rôle important dans la prise de la relève au niveau des
instances politiques, chose qui ne doit pas rester monopolisée par
l'ancienne génération. En effet la plus haute autorité du
pays a mis le point sur cette question en ramenant l'âge du vote à
18 ans, cela pour confirmer le rôle des jeunes dans l'avenir du pays, et
non pas pour faire des jeunes uniquement un effectif qui permet de rassembler
un maximum de voix pour les candidats aux élections.
21 Enquête Economiste-Sunergia, les jeunes
d'aujourd'hui 2011, 80p.
Pour conclure, tout au long de ce chapitre nous avons
analysé les principaux problèmes vécus par les jeunes, des
problèmes qui engagent l'avenir de toute la nation, puisque l'essor de
cette dernière table sur sa jeunesse. Ajoutons à cela le
mouvement des jeunes du 20 février 2011 qui a soulevé la
faiblesse des politiques publiques au niveau de la jeunesse. D'où
l'importance d'une prise en compte urgente des attentes de cette
catégorie de la population. L'Etat a déjà initié
plusieurs réformes au niveau économique et social et qui tentent
de répondre aux attentes de la jeunesse du Maroc.
Dans le second chapitre nous allons voir les principales
réformes qui ont été lancées par l'Etat, pour
apporter des solutions aux problèmes économiques et sociaux de la
population marocaine, Les réformes ont été
destinées notamment aux jeunes, et parmi lesquelles figure la
stratégie intégrée de la jeunesse, lancée au cours
de l'année 2010.
Chapitre 2. Le rôle et les réformes de
l'Etat au niveau
Social (1999 - 2011)
Depuis l'intronisation de Sa Majesté Mohammed VI en
1999, les actions des pouvoirs publics en matière de
développement social, d'élargissement de l'accès des
populations défavorisées aux infrastructures et aux services
sociaux de base et de lutte contre la pauvreté, ont connu une
intensification particulière, qui s'est traduite par
l'amélioration de la plupart des indicateurs sociaux.
Dans ce cadre, nous allons traiter ci-après les
principales réformes.
I. Lancement de l'Initiative Nationale pour le
Développement Humain (INDH)
L'Initiative Nationale pour le Développement Humain
(INDH), a été lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed
VI, le 18 mai 2005. Elle vise la réduction des déficits sociaux
en particulier dans les quartiers urbains pauvres et les communes rurales les
plus démunies (équipements et services sociaux de base, tels que
la santé, l'éducation, l'alphabétisation, l'eau,
l'électricité, l'habitat salubre, l'assainissement, le
réseau routier), la promotion des activités
génératrices de revenus stables et d'emplois22, tout
en adoptant une action plus imaginative et plus résolue en direction du
secteur informel et l'aide aux personnes en grande vulnérabilité
ou à besoins spécifiques.
Cette initiative nationale constitue le défi majeur
à relever pour la concrétisation du projet de
société et de développement du Maroc23. Il
s'agit d'un chantier qui repose sur le ciblage des zones et des
catégories les plus démunies ainsi que la participation des
populations pour une meilleure appropriation et viabilité des projets et
des interventions. Elle privilégie l'approche contractuelle et le
partenariat avec le tissu associatif et les acteurs du développement
local et de proximité.
22 Centre d'études internationales, Une
décennie de réformes au Maroc, KARTHALA, 2010, 426 p.
23 Opcité.
Depuis son lancement, presque 4 millions de citoyens ont
bénéficié de 16.000 projets qui touchent aussi bien les
activités génératrices de revenu (AGR), les projets
d'appui aux infrastructures de base, les actions de soutien à
l'animation culturelle et sportive ainsi que les actions de formation et de
renforcement des capacités.
L'enveloppe budgétaire globale allouée à
la réalisation des projets inscrits durant les 4 premières
années, s'est levée à 9,4 milliards de dirhams au niveau
national dont 5,5 milliards de dirhams au titre de la contribution de
l'INDH.
Les jeunes ont constitué une partie incontournable de
la mission de l'INDH, ils étaient plus particulièrement
ciblés en matière d'activités génératrices
de revenus, d'animation culturelle et sportive, d'alphabétisation, et
également d'ancrage des valeurs de citoyenneté chez les jeunes
des quartiers pour les rendre des acteurs dans leurs entourage. On peut prendre
des exemples tel que celui des jeunes femmes qui ont
bénéficié des formations en tissage, et couture, et dans
la même optique elles ont bénéficié d'un financement
pour acquérir des machines à coudre. On peut donner un autre
exemple concernant les jeunes des quartiers de Hay Moulay Ismail, et Kariat
Ouled moussa. Les jeunes de ces quartiers sont issus de familles
défavorisées, et n'ont pas de qualification. Ils ont
bénéficié dans le cadre des projets de l'INDH d'un
financement pour acquérir des grandes motocyclettes, destinées
pour transporter les marchandises. Ces moyens de transports sont souvent
utilisés de façon informelle pour déplacer les individus
entre Hay Moulay Ismail et Kariat Ouled moussa vu que les
moyens de transport formel n'accèdent pas au milieu de Hay Moulay
Ismail. Et ceci permet à ces jeunes de réaliser une entrée
régulière d'argent24.
Ci-après nous allons voir les principales modifications
qui ont été appliquées au secteur de l'emploi en vue
d'améliorer l'intégration des jeunes au marché du
travail.
24 Entretien avec un bénéficiaire de
l'INDH.
II. La Promotion de l'emploi
La promotion de l'emploi a été placée au
coeur de la stratégie de développement économique et
social à travers la mise en place des dispositifs et instruments
suivants :
L'insertion directe, la formation-insertion, l'insertion par la
promotion de l'entreprise et la réforme de l'intermédiation au
niveau du marché du travail25.
Parallèlement à ces dispositifs, d'autres mesures
stratégiques importantes ont été prises et que nous allons
voir ci-après.
1. L'adoption de la Charte de la petite et moyenne
entreprise
Cette Charte est destinée à soutenir les
entreprises dans leurs efforts de restructuration et de développement.
Il faut rappeler que la dite Charte institue de nouveaux mécanismes
visant la redynamisation de la création de petites et moyennes
entreprises à travers notamment le renforcement du processus de garantie
des prêts.
2. La réforme du code de travail
Entrée en vigueur en juin 2004, cette réforme
constitue une avancée majeure dans la construction de l'Etat de droit et
dans l'amélioration de l'environnement de l'entreprise et partant dans
la promotion de l'attractivité de l'économie nationale.
En complément à ces mesures, et dans le cadre de
la mise en oeuvre des recommandations des assises de l'emploi tenues en
septembre 2005, un dispositif ciblé de promotion de l'emploi des jeunes
diplômes chômeurs a été arrêté. Ce
dispositif a visé plus particulièrement l'amélioration de
l'organisation et de la gestion du marché de travail, en particulier
l'adoption du nouveau code du travail. Outre «Moukawalati» et le
microcrédit, destinés à la création d'entreprises,
plusieurs programmes ont été mis en place, à savoir
«Taahil »26 ciblant les diplômés
chômeurs, et «Idmaj»27 en tant que mécanisme
d'incitation au premier emploi en faveur de l'entreprise.
25 Ministère de l'économie et des
finances, Rapport de loi de finance, 2010.
26 Ministère de l'économie et des
finances, Projet de loi de finance pour l'année
2011.
27 Opcité.
3. Insertion directe des diplômés
chômeurs
Il s'agit du nouveau décret ministériel qui est
entré en vigueur juste après la révolution du 20
février 2011, et qui opte pour l'intégration des
diplômés chômeurs. Rappelons dans ce sens que ce
décret ministériel autorise les administrations publiques et les
collectivités locales à recruter, sans concours, les titulaires
de diplômes supérieurs dans les cadres et grades correspondant
à l'indice de l'échelle 11 conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur durant les deux années 2011 et 2012.
Dans cette même dynamique quelques 430028
diplômés chômeurs ont été recrutés
depuis le démarrage de cette initiative. Il faut préciser que les
jeunes qui vont constituer des groupes de diplômés chômeurs
ou qui participeront à des groupes déjà existants, sont
ceux qui vont bénéficier de cette initiative exceptionnelle, et
cela afin de faciliter le dialogue avec les autorités
compétentes.
Dans ce qui suit nous allons aborder les rénovations
apportées par la nouvelle Charte de l'éducation formation.
III. La mise en oeuvre de la charte de l'Education
Formation
La charte nationale d'éducation et de formation,
entrée en vigueur en l'an 2000, se fonde sur une mobilisation nationale
pour la rénovation de l'école. La décennie 2000-2009 a
été déclarée décennie nationale de
l'éducation et de la formation, ainsi le secteur de l'éducation
et de la formation a figuré parmi les priorités nationales
après l'intégrité territoriale.
La mise en oeuvre de la réforme du système
d'éducation et de formation s'articule autour des principaux axes
stratégiques ci après.
1. Axes Stratégiques
a- La généralisation de l'enseignement à
travers notamment :
- la poursuite des efforts visant la généralisation
de l'enseignement fondamental et du préscolaire ;
- l'intensification de l'enseignement secondaire, l'objectif a
été la généralisation du
28 Disponible sur
http://www.marpresse.com.
cycle collégial en 2008, et la fixation d'un objectif de
60%29, pour le cycle qualifiant du baccalauréat, pour la fin
de l'année 2010.
b- L'amélioration de la qualité des
enseignements :
Ceci à travers notamment la refonte et
l'amélioration des programmes au niveau du contenu et de la
méthodologie avec le renforcement des branches scientifiques et
techniques et l'introduction et la diffusion des nouvelles technologies de
l'information et de la communication ;
c- L'amélioration de la gouvernance du système
d'éducation et de formation à travers notamment :
- l'instauration de la décentralisation et la
déconcentration dans le secteur
d'éducation à travers la création des
Académies Régionales d'Education et de Formation ;
- la consolidation de l'autonomie de l'université
consacrée par la loi 01-00 portant organisation de l'enseignement
supérieur promulguée par le dahir n°1.00.199 du 19 mai
2000.
d- L'amélioration du financement de la
réforme :
A travers la mobilisation des fonds extrabudgétaires
notamment dans le cadre de la coopération internationale ainsi qu'une
plus grande implication du secteur privé et de la société
civile à travers le partenariat, et la mise à contribution des
différents partenaires socio-économiques, des ménages
ainsi que des Collectivités Locales dans le financement de
l'éducation.
2. Quelques Chiffres
Huit ans après le lancement de la décennie de
l'éducation, le système d'éducation et de formation a
enregistré des avancées réelles sur divers plans.
L'enseignement scolaire a été marqué par l'accroissement
de ses effectifs dans tous les cycles, la résorption des écarts
de scolarisation entre genres et milieux ainsi que diverses avancées
pédagogiques. Toutefois, les acquis restent fragiles à cause de
nombreux dysfonctionnements persistants.
29 Rapport de la Direction des Etudes et des
Prévisions Financières, Juillet 2009.
L'augmentation des effectifs au secondaire collégial et
qualifiant de plus de 40%30 sur les huit dernières
années et l'augmentation des taux de scolarisation de 15 points de
pourcentage pour toutes les tranches d'âge indiquent que la marche vers
l'obligation de scolarité jusqu'à 15 ans est bien prise en compte
.
Le taux net de scolarisation des enfants âgés de
4-5 ans dans le préscolaire a atteint 58,9%31 sur le plan
national dont 51,2%32 pour les filles, et le taux net de
scolarisation dans le premier cycle fondamental est passé de 84,6%
à 94,6% entre 2000-200133 et 2007-2008. Cette hausse a
été plus importante pour les filles, dont le taux net de
scolarisation est passé, au cours de la même période, de
80,6% pour se situer à 92,5%. En milieu rural, ce taux est passé
de 76,7% à 93,5% pour les deux sexes. Ces évolutions ont
nécessité la mise en oeuvre d'importants projets physiques
puisque le nombre total des établissements de l'enseignement primaire
public a atteint en 2007-2008 près de 7.003 écoles et 13.451
écoles satellites34. Le réseau des
établissements s'est élargi par la création de 790
établissements dans le primaire (671 dans le milieu rural et 119 dans le
milieu urbain) durant la période 2000-2008.
Pour ce qui est de l'enseignement collégial, le taux
spécifique de scolarisation des enfants âgés de 12-14 ans a
atteint globalement 77,1% et 70,6% pour les filles en 2007-2008 contre 60,3% et
52,7% respectivement en 2000-2001. En milieu rural ce taux a atteint 57%
globalement et 46,7% pour les filles contre 37,5% et 27,9 respectivement en
2000-2001.
Quant au taux spécifique de scolarisation des enfants
âgés de 15-17 ans il a enregistré une nette
amélioration passant globalement de 37,2% en 2000-2001 à 49,7% en
2007-2008 et de 32,2% à 45,2% pour les filles35. Le nombre
total des établissements de l'enseignement secondaire qualifiant public
a atteint en 2007-2008 près de 743 établissements (590 en milieu
urbain et 153 en milieu rural). Le volet
30 Rapport de la Direction des Etudes et des
Prévisions Financières, Juillet 2009.
31 Disponible sur
http://www.men.gov.ma/.
32 Opcité.
33 Rapport national, Alphabétisation des
adultes au Maroc, Direction de la lutte contre l'analphabétisme
1997-2003.
34 Disponible sur
http://www.men.gov.ma/.
35 Rapport national, Alphabétisation des
adultes au Maroc, Direction de la lutte contre l'analphabétisme
1997-2003.
afférent à l'enseignement universitaire,
mérite une attention particulière, tant qu'il est vrai que seule
une politique de réinvention36 de l'université
marocaine, et d'incitation à la recherche scientifique, permettra de
donner à la recherche et au développement leur pleine
signification.
Pour remédier aux insuffisances enregistrées en
termes d'emploi des jeunes, l'Etat a procédé à la
promotion de la dynamique du microcrédit comme alternative, dans le but
de doter les jeunes de moyens financiers pour se créer leurs propres
activités, dans un cadre de génération de revenus.
IV. La promotion de l'activité du
Microcrédit
Dans le but d'encourager la création d'emploi et la
promotion d'activités génératrices de revenus pour les
populations défavorisées, les pouvoirs publics ont
procédé, depuis l'année 2000, à la mise en oeuvre
d'actions visant le renforcement des capacités institutionnelles et
financières des associations de microcrédit autorisées
à exercer conformément aux dispositions de la loi n° 18-97
relative au microcrédit promulguée par le dahir n° 1-99-16
du 5 février 1999 (BO n° 4678 du 1er avril 1999).
Le nombre total des bénéficiaires de
microcrédits a atteint 1.353.074 en 2007, dont près de
64%37 de femmes avec une valeur totale des prêts de 5.598 MDH.
Les bénéficiaires en milieu urbain représentent
55,3%38 du total des bénéficiaires, contre 2% pour le
milieu périurbain et 42,6% pour le milieu rural. Le secteur de
microcrédit mobilise 5150 agents de terrain et 1550 cadres et
employés hors terrain.
Le nombre total des prêts distribués depuis la
création jusqu'à l'année 2007 a atteint 113 millions
environ avec un montant de 19 milliards de dirhams39. En termes de
qualité de portefeuille, le taux de remboursement s'est situé
à 98%40.
La dynamique du microcrédit a permis aux jeunes
d'améliorer leurs revenus, et le
niveau de vie de leurs familles.
L'objectif de cette dynamique est de soutenir l'auto-
emploi des jeunes, et
les aidants à créer des activités
génératrices de revenu.
36 Centre d'études internationales, Une
décennie de réformes au Maroc, KARTHALA, 2010, 426 p.
37 Ministère de l'économie et des
finances, Projet de Loi de Finances, 2011.
38 Opcité.
39 Rapport de la Direction des études et des
prévisions, 2009.
40 Opcité.
D'après une enquête que nous avons mené
nous même dans le bidonville Sehb Lkayed, près de Hay
Salam à Salé, et qui a concerné un échantillon
de 100 personnes, dans le cadre de l'impact du microcrédit sur la
pauvreté. Les jeunes entre 20 et 34 ans ont constitué 75% de cet
échantillon, ces derniers ont affirmé qu'ils sont
intéressés par le microcrédit, et sont près
à demander un prêt auprès des institutions de
microcrédit pour créer leurs propres activités.
Dans la partie suivante nous allons identifier les acteurs
d'accompagnement et d'aide à la création des entreprises, qui
sont mis à la disposition de la jeunesse marocaine.
V. Le système d'accompagnement et de
création d'entreprises pour les jeunes
Il faut noter, que plusieurs acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux opèrent au Maroc dans le domaine d'accompagnement et
d'aide à la création d'entreprises au profit des jeunes.
1. Démarrage officiel du premier incubateur
féminin au Maroc
C'est une initiative de l'association des femmes chefs
d'entreprises du Maroc (Afem)41 qui vise à encourager la
création d'entreprises par des femmes porteuses de projets innovants. Ce
projet, baptisé "Casa Pionnières", est le premier en son genre
dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient (Mena). Son objectif est de
contribuer à créer un environnement favorable pour la
création d'entreprises au Maroc en intégrant l'approche genre.
"Casa Pionnières" s'adresse à toute jeune femme, ayant un projet
de création d'entreprise prioritairement dans le secteur des
services.
Les candidates sélectionnées
bénéficient d'un espace d'accueil et d'aide à la
création d'entreprise, incluant des services à des coûts
réduits, une logistique matérielle adaptée, un programme
d'accompagnement dans l'élaboration et la finalisation technique des
projets d'entreprise, une formation en fonction des besoins identifiés,
le suivi par des conseillers et l'accès à des réseaux de
chefs d'entreprises nationaux et internationaux.
41 Initiative lancée en 2007.
Ce projet est soutenu par plusieurs partenaires
gouvernementaux et organisations internationales, dont notamment le
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, l'UNIFEM, le PNUD,
l'Agence Espagnole de Coopération Internationale, le Centre
Régional d'Investissement (CRI) de Casablanca, le réseau Maroc
entreprendre, la Fondation BCP pour la création d'entreprises et
certains groupes privés. L'Afem est une association indépendante
créée en 2000 en vue d'offrir aux femmes chefs d'entreprises un
cadre leur permettant de contribuer à l'essor de l'économie
nationale, d'encourager l'action entrepreneuriale féminine, d'orienter,
d'encadrer et d'assister la femme entrepreneur dans sa recherche de la
compétitivité requise pour toute entreprise.
2. Association Maroc Telecom pour la création
d'entreprises et la promotion de l'emploi
Sa mission est d'aider les jeunes talents à
concrétiser leurs projets de création d'entreprises
génératrices d'emplois et de revenus. Il s'agit d'un prêt
plafonné à 100.000 dirhams sans intérêts, avec un
apport personnel de 10 %. Les bénéficiaires sont les jeunes
âgés de 20 à 39 ans, diplômés d'études
supérieures ou disposant d'un diplôme de formation ou d'une
expérience professionnelle.
o Secteur d'activités : tous les secteurs
d'activité présentant un potentiel de
création d'emplois (commercial, artisanal, industriel,
agricole, services) ;
o Types de projets : technologies de l'information, cyber,
mécanique automobile,
broderie, métiers du bâtiment, production agricole,
élevage...
o Nature du projet : création uniquement.
3. Les Centres Régionaux d'Investissement
(CRI)
La création des CRI a été mise sous la
responsabilité des Walis des Régions42. Les CRI sont
parmi les mécanismes que les pouvoirs publics ont veillé à
mettre en place pour le développement de l'investissement tant à
l'échelon national que régional. Ils ont été mis en
place pour orienter et accompagner les jeunes porteurs de projets qu'ils soient
nationaux ou bien des jeunes résidents à l'étranger.
42 Lettre adressée par Sa Majesté
Mohammed VI au Premier Ministre au sujet de la gestion
déconcentrée de l'investissement, le 09 janvier 2002.
Le rôle des CRI ne se limite pas à la mission
traditionnelle du guichet unique, mais englobe des missions plus larges telle
que la mise à la disposition des opérateurs économiques de
données et informations à caractère économique qui
puissent aider à valoriser les potentialités des régions
où ils opèrent.
4. Le programme Moukawalati
La mission du programme est de contribuer à la
réduction progressive du taux de chômage moyennant l'appui
à la création d'entreprises génératrices de
richesses et d'emplois en adéquation avec les exigences et les
spécificités au niveau régional. Egalement assurer la
pérennité progressive du tissu économique régional
par un dispositif de suivi des entreprises créées au cours de la
période de démarrage.
Le réseau de guichets du programme Moukawalati a
été élargi à 183 guichets. Le nombre de conseillers
a été également revu à la hausse, avec 112 nouveaux
conseillers. Il s'agit de redonner confiance aux jeunes, dont bon nombre ont
été dissuadés par la bureaucratie et d'autres obstacles.
Le plus important dans ce plan de relance c'est qu'il est ouvert aussi aux
non-diplômés, il est ouvert à tous les porteurs de projets.
Le programme vise une tranche de population âgée entre 20 et 45
ans, ajoutons à cela que deux personnes peuvent s'associer et ramener le
projet à un montant inférieur ou égal à 500.000 DH.
Il faut signaler que les jeunes porteurs de projets bénéficient
d'un accompagnement avant et après la création de leurs
projets.
En plus de l'ensemble de ces initiatives, les pouvoirs publics
ont tablé sur le partenariat avec des ONG et des programmes de
coopération internationale, en vue de répondre aux attentes des
jeunes marocains. C'est dans cette optique que la stratégie
intégrée de la jeunesse à été
lancée.
VI. Le lancement de la stratégie
intégrée de la jeunesse
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a
lancé le processus d'élaboration de la stratégie nationale
intégrée de jeunesse avec l'appui technique de trois
organisations du système des Nations Unies, l'UNICEF, Le FNUAP et le
PNUD qui ont octroyé 1 million de dollars à cette
opération (pour sa mise en oeuvre effective par les collectivités
locales).
Prenant en considération que les jeunes sont au coeur
des enjeux stratégiques en termes de participation à l'essor
économique, à la promotion de la citoyenneté et d'un
projet de société moderne, démocratique piloté par
les droits, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre
d'une action gouvernementale concertée, a lancé les travaux
d'élaboration de la stratégie nationale intégrée de
jeunesse. Ce processus est mené avec l'appui d'un comité
multisectoriel où sont représentés les différents
départements concernés, 10 ministères, des
collectivités locales, 15 associations nationales, et plusieurs
associations de jeunes, avec l'appui technique de trois organisations du
système des nations unies.
Après un travail de recherche et d'analyse qui a permis
de fixer les objectifs de cette stratégie, ses acteurs et ses champs
d'intervention, le Ministère de la Jeunesse et des Sports avec
l'ensemble des partenaires concernés a arrêté les
étapes clés de conception de cette stratégie à
savoir : le diagnostic, l'organisation des fora régionaux de jeunes, la
tenue des assises nationales de jeunesse et l'élaboration d'une charte
nationale de jeunesse.
Plus précisément, ces étapes se
présentent comme suit :
1. Le diagnostic
Il va permettre l'analyse de la situation actuelle des jeunes
au Maroc à travers une revue documentaire et des entretiens avec
l'ensemble des parties prenantes concernées. Il sera
complété à travers la réalisation d'un benchmark
international avec les expériences de l'Espagne, de la Finlande, de la
France et de la Tunisie.
2. Les fora régionaux de jeunes
16 fora régionaux ont eu lieu sur le territoire
national. Leur objectif a été d'ouvrir un débat franc et
constructif avec 4000 jeunes issus des différentes catégories
sociales et démographiques. Ces jeunes ont soumis leurs propositions et
attentes de façon à alimenter la plateforme de travail des
assises nationales de la jeunesse.
Certes les jeunes montrent leur insatisfaction des
institutions de l'Etat43, mais le ministère souhaite inverser
la tendance, en ouvrant un espace de débat et de réflexion
intégrant les jeunes dans le processus de mise en oeuvre d'une
stratégie nationale.
3. Les critères de sélection
Les 4000 jeunes choisis pour participer aux fora
régionaux n'ont pas été sélectionnés de
manière aléatoire, ces jeunes ont pour mission de
représenter les quelques 16 millions de jeunes que compte notre pays.
Afin de transcrire toute la complexité de cette population, quatre
facteurs ont été adoptés comme critères de
sélection sur la base des études préalablement conduites
:
o Urbains/ruraux : ce critère permet de distinguer les
attentes et les besoins des jeunes selon leur mode de vie, et de retranscrire
les disparités sociales entre zones urbaines et zones rurales.
o Scolarisés/non-scolarisés : les aspirations
peuvent varier grandement selon les niveaux d'instruction des jeunes.
o Hommes/femmes : des différences importantes subsistent
entre les hommes et les femmes, dans différents domaines.
o Tranche d'âge : l'âge des participants compris
entre 7 et 30 ans présente des profils très variés, et
permet de couvrir une cible assez importante.
Jusqu'à nos jours, et en interrogeant des responsables
du ministère de la jeunesse, rien n'a encore été
publié, le diagnostic, et le rapport de restitution des résultats
des forums a été confié à un bureau d'étude,
qui n'a pas encore rendu le travail final.
43 L'Economiste, Numéros 3216, du 19
février 2010, Art : Lancement des Fora Régionaux des jeunes.
Dans cette même dynamique il est force de constater que
le fait de se passer des mythes visant à placer les pouvoirs publics et
la société civile dans une relation frontale, est l'un des axes
forts et particulièrement innovant des programmes de coopération
internationale44.
Chacun s'accordant à penser que l'obstacle au dialogue
se situe autant dans la difficulté des OSC à comprendre la
mécanique administrative, la logique du circuit de décision
politique et les enjeux qu'elle suppose au niveau local, national ou
international, que dans la propension des pouvoirs publics à identifier
les OSC sous l'angle idéologique en négligeant souvent leurs
savoir-faire et acquis en termes de pratiques.
Les programmes de coopération dans leur forme
concertée et pluri-actrice (PCPA), proposent à chaque groupe
d'acteurs de chercher (et de trouver) les axes sur lesquels ils peuvent avancer
ensemble. Chose que nous allons voir dans le troisième chapitre, en
prenant comme cas pratique le Programme Concerté Maroc, et son action
sur la question de la Jeunesse.
Il est nécessaire dans un premier temps de
présenter le PCM et son cadre général, pour pouvoir
comprendre son action.
44 Lucien COUSIN, Mieux faire société ensemble
(la contribution des Programmes Concertés PluriActeurs à une
rénovation du dialogue entre société civiles et pouvoirs
publics), 2008, 96 p.
VII. Origine et fondement du Programme Concerté
Maroc
Le Programme Concerté Maroc (PCM), tire son origine du
« temps du Maroc en France » organisé en 1999 et qui a vu
s'animer partout dans le pays des milliers de manifestations qui ont
montré la richesse de la coopération franco-marocaine. A cette
occasion, la nécessité de mettre en place un « partenariat
global » entre les deux pays a été entérinée
par les deux gouvernements et au sein de ce partenariat, l'importance
soulignée de développer et de consolider les coopérations
entre les acteurs de la société civile des deux Etats.
Le cadre général du PCM, rentre dans la
dynamique des PCPA, dans lesquels se trouve une double ambition de construire
une coopération entre des organisations de la société
civile, qu'elles soient au Sud ou au Nord, et un dialogue politique entre ces
organisations et les pouvoirs publics dans la finalité de coproduire des
politiques publiques inclusives.
Le PCPA entend établir un lien entre les initiatives et
décisions mondiales45 et l'accès effectif des
populations les plus pauvres aux services de base fondamentaux, notamment par
le truchement d'une utilisation plus judicieuse de l'aide publique au
développement. C'est l'établissement de ce lien qui renforce les
opportunités de collaboration entre les pouvoirs publics
français, « distributeurs » d'une aide au développement
et les organisations de la société civile française,
actives dans plusieurs régions du monde. Le postulat qui oriente cette
collaboration est que la concertation entre les Etats et les
sociétés civiles est indispensable pour mettre en oeuvre des
politiques efficaces de lutte pour la réduction de la pauvreté et
les inégalités et pour un Etat de droit plus marqué.
Néanmoins il est force de constater que les Etats
développés à travers la coopération internationale,
plus particulièrement l'aide au développement, ont des enjeux
politiques et économiques. En raison de la mondialisation et l'expansion
des marchés étrangers, les pays développés
cherchent de plus en plus à délocaliser leurs productions dans
les pays en voie de développement. Ces derniers
45 Sommet du Millénaire, conférence de
Monterrey, déclaration de Paris, rencontre d'Accra,
etc.
représentent pour les pays développés une
richesse en ressources naturelles abondantes et en ressources humaines
qualifiées. D'autant plus les pays développés connaissent
une pyramide des âges vieillissante, et donc comptent en grande partie
sur l'affluence des jeunes émigrés issus des pays en voie de
développement (exemple du Canada...). Dans une autre optique, certaines
ONG internationales ont plutôt des enjeux religieux dans un souci de
diffusion des valeurs religieuses dans les pays où elles oeuvrent, et ce
sous prétexte des actions caritatives.
En revenant à notre étude, il faut noter que la
recherche d'une meilleure articulation entre les programmes bilatéraux
et les nombreuses initiatives multilatérales a constitué une
préoccupation forte des acteurs institutionnels et non gouvernementaux
intervenant au Maroc dans le cadre des réformes engagées par le
Royaume. C'est l'ensemble de ces préoccupations qui a donné
naissance au projet d'un Programme Concerté multi-acteurs
franco-marocain s'inscrivant dans le cadre d'une nouvelle contractualisation
entre les pouvoirs publics français et les acteurs non gouvernementaux.
Ainsi a été lancé le Programme Concerté Maroc
(PCM), programme qui a réuni en son sein 19 organisations
françaises, 36 organisations marocaines et le ministère des
affaires étrangères français de 2002 à 2005.
1. Intérêts et enjeux de la deuxième
phase du PCM (2006-2010)
Le PCM a choisi la dynamique de la jeunesse, parce que les
jeunes constituent la tranche la plus importante de la population, 50% de la
population à moins de 25 ans. En outre, la jeunesse représente
l'avenir du pays et elle connaît des problèmes spécifiques
compromettant cet avenir, au Maroc, comme dans d'autres pays en voie de
développement. En effet, malgré les récents progrès
de la scolarisation, une forte proportion de jeunes reste encore
analphabète ou privée d'une formation professionnelle
appropriée à des emplois satisfaisants.
Comme nous l'avons déjà précisé
ci-dessus, les jeunes diplômés du supérieur en
chômage sont nombreux et ils s'intègrent peu dans
l'économie. Par ailleurs, le sous emploi et la faible
rémunération touchent les jeunes non formés, dans les
secteurs traditionnels de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat.
On comprend, dans ces conditions, les difficultés
qu'éprouvent les jeunes
générations à se
préparer aux mutations sociales, économiques, et
professionnelles.
On imagine les problèmes qu'elles rencontrent pour
s'installer dans une vie familiale et à s'insérer dans un cadre
de participation citoyenne. Cet enjeu d'inclusion est pointé dans
différents rapports, réalisés par les autorités
marocaines avec l'appui du PNUD et de la Banque Mondiale, tels que : «
les jeunes, un atout sous estimé », ou, « ensemble,
pour un développement humain » et encore le rapport du
cinquantenaire de l'indépendance « pour un développement
humain élevé ». C'est dire la pertinence du
thème commun aux membres et aux partenaires publics et non
gouvernementaux du PCM.
Cette dynamique accompagne la montée en puissance du
tissu associatif marocain marquée par l'existence de plus de 46 000
associations dont plus de 2 00046 sont des associations de jeunes
pour une population majoritairement composée de jeunes.
Pour aller de l'avant dans sa deuxième phase le PCM a
mis en place un ensemble de mesures stratégiques et techniques : comme
objectif général il s'est fixé l'accompagnement de la
jeunesse marocaine à être actrice d'un développement humain
et solidaire, dans un cadre de concertation entre associations
françaises et marocaines, avec leurs pouvoirs publics dans l'ambition
d'assurer une grande implication des jeunes dans la société
marocaine.
Le PCM a mis en oeuvre des moyens et des outils pour
concrétiser son action, tel que :
- Les projets : leur intérêt réside dans
le principe qu'ils seraient conçus et conduit conjointement par des
partenaires français et marocains. Ils devraient contribuer à
l'atteinte d'un ou plusieurs résultats escomptés par le programme
tout en respectant ses principes et valeurs. Les projets
sélectionnés par une commission élue seront
financés par un Fonds d'Appui à Projets (FAP).
- Les activités régionales : consistent à
renforcer l'élaboration de stratégies d'action collectives
régionales et la création de passerelles avec les dispositifs
existants d'appui à la décentralisation. Ces actions seront
financées par un fonds d'Appui aux Initiatives Régionales
(FAIR).
46 Rapport d'évaluation du PCM, 2006.
- Les activités transversales : sont en pleine
articulation et complémentarité avec les autres types
d'activités et se devront de répondre aux besoins réels et
concrets des acteurs du programme (formation, échange
d'expérience, séminaires, plaidoyer...). Le PCM a mis
également en place quatre pôles thématiques, à
savoir le pôle Insertion professionnelle, Education Animation, Economie
Sociale et Solidaire, Citoyenneté et Accès aux Droits. L'objectif
de ces thématiques est d'approfondir la connaissance mutuelle autour des
projets et des acteurs, et de tirer les bonnes pratiques des expériences
des uns et des autres.
Le PCM dans sa seconde phase, a compté 96 organisations
membres dont 63 organisations marocaines et 33 organisations françaises.
Ceci a permis un début d'appropriation du programme par les associations
marocaines, et un poids de plus en plus soutenu, vu qu'au début les
organisations étrangères assuraient le financement et aussi le
pilotage. Actuellement le rapport de force a changé, puisque les
associations marocaines sont devenues plus nombreuses dans les consortiums des
projets du PCM.
Chapitre 3. Cas du Programme Concerté Maroc :
la
recherche action réalisée sur les projets
de
développement
Section 1 : PCM 2 et constats des entretiens
effectués sur
terrain
I. Qu'est ce que la Capitalisation
Avant tout nous devons tout d'abord définir la
Capitalisation. C'est un thème récurrent dans le milieu des
organisations de solidarité internationale. On ne cesse de le
répéter : « il faut capitaliser ! ». Pourquoi ? Comment
? Ce n'est pas toujours bien clair.
Paradoxalement, il n'existe pas beaucoup de documents de
référence sur la capitalisation, et ceux qui existent proposent
des réflexions particulièrement intéressantes sur l'enjeu
de valoriser les expériences, mais manquent peut-être des
repères méthodologiques pratiques47.
Selon Pierre de Zutter (1994) : « la Capitalisation,
c'est le passage de l'expérience à la connaissance partageable
».
Dans ce qui suit nous allons présenter quelques
caractéristiques de la capitalisation :
· Capitaliser, c'est prendre du recul par rapport à
une expérience ;
· Se poser la question, comment dans une expérience,
on est passé d'un niveau à un autre ?
· Questionner une expérience, la discuter, voir la
remettre en cause ;
· C'est tirer des enseignements de l'expérience qui
pourraient servir de modèles de réussite pour une utilisation
ultérieure ;
47 Philippe Villeval (Handicap International) et
Philippe Lavigne Delville (Groupe de Recherche et d'Échanges
Technologiques), Capitalisation d'expériences... expériences
de capitalisations Comment passer de la volonté à l'action,
Traverses n° 15, 2004, 49 p.
II. Quelques constats préliminaires
Un constat majeur, c'est que le PCM a changé sa
philosophie, tout d'abord la focalisation sur les jeunes contrairement à
la première phase qui était large et portait sur la question de
la pauvreté. Ensuite la métamorphose de sa gouvernance, en
instaurant un organe unique qui représente les deux pays dans les
principales décisions stratégiques à savoir le
comité de pilotage. Dans ce dernier siègent les associations des
deux pays, et également les pouvoirs publics afférents
(Ministère des Affaires Etrangères Français,
Ministère Marocain de Développement Social et de la famille...),
et les jeunes, élément incontournable dans la prise de
décision.
D'autre part, les visites sur le terrain pour interroger les
acteurs du PCM situés un peu partout sur le territoire marocain, ont
révélé des constats probants quant à
l'efficacité de ce programme d'aide au développent. Dans ce qui
suit nous allons dégagés quelques constats selon les trois axes
de Capitalisation.
1. La concertation pluri-acteurs
Une identité pour les associations : D'après les
questions posées à certains acteurs dans les projets du PCM, les
associations ont trouvé dans le PCM une vraie identité,
vis-à-vis des acteurs publics et des bailleurs de fonds internationaux,
ce qui leur a donné un plus et une force de conviction48.
Dans sa conception des projets, le PCM exige une véritable
démarche de concertation, non seulement entre associations du Nord et
associations du Sud, mais également, une implication des pouvoirs
publics, que ce soit dans les projets, ou dans le pilotage et la gouvernance du
programme lui-même.
Rappelons que le Ministère du Développement
Social, siège au comité de pilotage, ainsi que l'Entraide
Nationale. Ce dernier est un partenaire stratégique, qui a mis en place
ses locaux et ses délégations à la disposition des
activités du PCM à destination des jeunes. Un autre point plus
important, c'est que dans les projets concertés provinciaux (PCP), pour
réunir les acteurs d'une même province, le PCM a mis en place une
étape préalable à la concertation, qu'il finance et
organise, l'objectif étant de faire connaissance entre les acteurs de la
société civile et les pouvoirs publics, ainsi que les
collectivités locales. Dans l'élaboration du PCP, il y'a des
48 Entretien avec Zoubir Chatou, coordinateur du
projet Cré'Acteurs.
conditions à remplir, premièrement il faut une
présence obligatoire des jeunes, deuxièmement une présence
d'au moins une collectivité locale, et quelques associations locales.
2. L'implication de la jeunesse
Il faut rappeler que le but ultime du PCM est d'enclencher une
dynamique qui permet à la jeunesse de s'ouvrir sur son environnement et
la situe au sein de partenariats multiples. Cette approche est importante car,
en favorisant le développement du tissu associatif marocain, le PCM
évite l'enfermement étroit des jeunes dans leur propre
association. C'est cela qui fait qu'on peut parler d'une démarche qui
contribue à l'installation de relations entre les jeunes et les adultes,
et donc assurer un transfert de savoir faire de génération en
génération, ainsi entre les associations de jeunes et les autres
partenaires actifs dans le développement communautaire.
Le PCM compte environ 20 000 jeunes, entre jeunes
bénéficiaires des activités du programme, et les jeunes
membres des associations du PCM.
Suivant les entretiens avec les acteurs du PCM, ce dernier a
offert :
- Un espace d'expression : les jeunes
associatifs du programme, sont invités à toutes les
manifestations organisées, autour des quatre thématiques, ils ont
l'occasion de rencontrer d'autres acteurs associatifs ou publics... ce qui leur
donnent l'occasion de s'exprimer et d'échanger des idées et des
ambitions...
- Une plateforme de rencontre entre les jeunes et
d'autres acteurs... : dans sa deuxième phase le PCM a choisi
comme volet d'action la dynamique de la jeunesse, avec une double ambition :
faire bénéficier les jeunes du fruit des projets
réalisés sur terrain, et plus particulièrement les rendre
des acteurs, qui réfléchissent, prennent des initiatives et
agissent indépendamment. Sous l'égide du PCM, les jeunes
effectivement sont devenus des acteurs : en premier lieu, l'accès des 4
jeunes au comité de pilotage pour représenter les jeunes de leur
territoire, leur a donné l'opportunité d'être à
égalité avec les autres dans les propositions et les prises de
décision, de se confronter aussi avec les pouvoirs publics. En second
lieu, la participation des jeunes aux rencontres nationales organisées
par le PCM leur a permis de tisser des liens et des connaissances avec des
acteurs de grande importance, tel que les ONG internationales, les ONG et
associations nationales,
d'échanger des idées de projets, l'objectif
étant de « travailler ensemble ». En troisième lieu,
pour les projets du PCM qui sont portés par ses associations membres,
une condition incontournable est à retenir, c'est que pour valider un
projet, il faut qu'il soit fait pour et par les jeunes : des
bénéficiaires jeunes, et des associations de jeunes qui portent
les projets.
- Une base d'encouragement à la participation
des jeunes à la gestion des affaires locales : Au cours de la
deuxième phase du programme, 4 conférences régionales, ont
étés organisées dans quatre régions du pays, et une
conférence nationale, autour de la participation des jeunes à la
gestion de la chose publique : Ces conférences se sont traduites par une
invitation non seulement des acteurs du programme mais, au-delà, des
acteurs hors du programme, qui étaient également
intéressés par ces manifestations.
Sur la base de ces conférences plusieurs jeunes ont
été ciblés, 400 jeunes ont participé aux 4
conférences régionales, et 180 jeunes ont participé
à la conférence nationale. En plus des conférences
régionales, 3 universités de jeunes sont venues dans leur
continuité, et leur complémentarité, le but étant
de former et informer les jeunes sur leur rôle dans la gestion des
affaires locales. Au total 290 jeunes ont participé aux
universités de jeunes. L'ensemble de ces conférences s'est
traduit par l'implication de certains jeunes bénéficiaires dans
les élections de 2009, à titre d'exemple : des jeunes se sont
présentés aux élections dans leurs communes, il faut
signaler également que d'autres se sont inscrits pour la première
fois dans les listes électorales49.
A noter que ce sont des premiers constats d'après les
entretiens effectués avec les membres du Programme. Le volet jeunesse
sera traité et analysé sur la base de quelques
projets50 spécifiques que nous avons choisis.
49 Entretien avec B.Boukhsimi, président de
l'Association Mouvement Twiza, porteuse du Projet Jeunesse Territoires
Citoyenneté.
50 Vu l'importance des projets du PCM, nous avons
choisi de travailler sur trois projets.
Section 2 : Analyse des Projets de Développement
du PCM 2
Les Projets de développement du Programmes
Concerté Maroc, ont été conçus dans un cadre local
et régional, suivant différents champs d'action, répondant
à des besoins spécifiques des populations de plusieurs
régions du pays, et en rassemblant acteurs de la société
civile et pouvoirs publics, pour une cause commune qui est la
réhabilitation de la situation des jeunes marocains. En ce qui suit,
nous allons analyser quelques projets dont le choix a été
établi à l'avance. Les projets qui vont faire l'objet de cette
analyse sont :
- Le Projet Cré'Acteurs du Moyen Atlas, (Fiche en Annexe
4) ;
- Le Projet Jeunesse Territoire et Citoyenneté (JTC),
(Fiche en Annexe 5) ;
- Le Programme Concerté Provincial (PCP) de Jerada, (Fiche
en Annexe 6) ; L'analyse portera sur l'impact des projets sur les jeunes
ciblés, notons de plus que cette analyse se focalisera sur plusieurs
critères. En premier, l'action sur la jeunesse par une approche
concertée, ensuite sur l'implication des jeunes ciblés par les
projet, de façon à déterminer dans quelle mesure les
jeunes ont été bénéficiaires, et dans quelle mesure
ces mêmes jeunes ont été impliqués en tant
qu'acteurs dans le développement de leur localité, et enfin sur
l'impact du cofinancement des projets.
I. Agir sur la jeunesse par une approche
concertée
Dans le cadre des interventions des ONG dans les pays du Sud,
l'aide au développement était perçue par les associations
nationales ou locales comme étant concurrentielle, ou en d'autres
termes, prédominantes, puisque le rôle des ONG du Nord
était limité aux donations financières. Dans le cas du
Maroc, les associations réclamaient donc un réel partenariat avec
un réel partage des responsabilités. L'avènement de la
notion du Programme Concerté Pluri Acteurs (PCPA) a donné un
autre sens au paysage associatif avec plus de rééquilibrage. Le
Programme Concerté Maroc dans sa forme pluri-actrice défend le
rééquilibrage Nord-Sud. Cela réside dans le passage en
premier lieu d'un PCM fondé sur la coopération entre une
association française et marocaine, avec une prédominance des
associations du Nord dans le pilotage et la prise de décision, à
un PCM fondé sur le pluri acteurs. En d'autres termes, la
nécessité de travailler en consortiums, ce dernier exige un
réel partage des actions, et une mise en commun des expériences,
d'où la mise en place
de la charte des valeurs, qui incite les signataires ou
partenaires de projets, à s'engager dans le respect des valeurs en
vigueur à savoir (la coresponsabilité, réciprocité,
démocratie, transparence, parité, exemplarité et
autonomie). En second lieu, l'instance de prise de décision du PCM est
un comité de pilotage transnational, qui réunit à la fois
des associations françaises, et marocaines, des pouvoirs publics
français et marocains, ainsi que les représentants des jeunes, et
le plus important dans cette instance c'est que les parties prenantes
travaillent en concertation, et ont des voix égales et participent
ensemble à l'élaboration des stratégies par consensus.
D'autre part, force est de constater l'ébauche
d'appropriation du terrain par les associations marocaines membres du PCM,
à tous les niveaux. Au comité de pilotage, les 2/3 des
représentations sont marocaines, et le 1/3 concerne la
représentation française. Sur les projets FAP, les associations
marocaines bénéficiaires commencent à prendre place, les
2/3 sont des associations marocaines, et le 1/3 est composé par des
associations françaises. Egalement, les visites croisées se sont
faites dans les deux sens, non seulement les associations marocaines ont
bénéficié de leur visites au Nord, mais aussi celles du
Nord sont venues pour voir et tirer profit des évolutions associatives
marocaines.
Cette logique a été projetée sur les
projets du programme. Pour servir la jeunesse marocaine, les porteurs des
projets ont entamé la même philosophie. Ils se sont
constitués en consortium rassemblant les associations marocaines et les
associations françaises. Tel est le cas du projet Cré'Acteurs qui
a réuni en son sein 4 associations marocaines (l'association Yannor de
Khénifra, l'association Ait Bourzouine d'El Hajeb, l'association Tazouta
de Séfrou et l'association Ain Bechar de Taza), et seulement 2
associations françaises à savoir ESF et CEFIR. La majorité
a été donnée aux associations marocaines parce qu'elles
sont des associations locales qui connaissent les spécificités de
leurs territoires, le tissu institutionnel local, et plus
particulièrement les projets et les aspirations des jeunes de la
région. En outre, l'implication des ONG françaises, est due
à l'apport du savoir faire, du fait que le projet opte pour le tourisme
rural, et que les deux ONG travaillaient déjà sur la même
dynamique avec les acteurs locaux du Moyen Atlas. De même pour le projet
JTC, il a été conçu de façon concertée entre
le CCFD, le CNLRQ et le Carrefour Associatif avec cinq de ses associations
membres.
Le PCP de Jerada s'est lancé dans une optique
provinciale, vu que c'est la décomposition du territoire la plus
pertinente pour nouer une concertation efficace, en raison du rapprochement des
acteurs locaux et associatifs, ce qui facilite leur rassemblement autour de la
question des jeunes. Le PCP, contrairement aux deux autres projets a
réuni seulement des acteurs marocains (associations, conseil provincial,
communes, délégation de l'éducation nationale, l'entraide
nationale ...).
Les réunions des consortiums ont constitué un
réel échange d'expérience et de mutualisation des efforts.
Il faut noter que la démarche de concertation était
présente dans toutes les étapes de la construction des projets et
leur mise en oeuvre. Ceci a permis aux jeunes associatifs et aux jeunes
ciblés par les projets, d'acquérir un esprit de concertation,
dans la mesure où ils ont commencé à chercher des
partenaires pour leurs projets d'avenir, et également élaborer
des plans d'action concertés pour chercher des opportunités de
financement complémentaire.
De même les ateliers de réflexion et les visites
entre membres des consortiums ont permis aux jeunes de faire connaissance avec
d'autres jeunes du territoire national, pour partager et transmettre les bonnes
pratiques. Dans une autre optique, les visites croisées Nord-Sud, et
Sud-Nord qui ont été réalisées dans le cadre des
projets, ont constitué pour les jeunes une opportunité
d'échanger et d'apprendre des expériences de leurs homologues
français. Tel que l'exemple du projet Cré'Acteurs dans le quel
une visite a été effectuée entre les jeunes de
l'association Ait Bourzouine et les jeunes de l'ONG Belge (Landes de
Gascogne).
Dans ce qui va suivre, nous allons voir quel a été
l'impact des projets sur l'implication des jeunes en tant qu'acteurs dans le
développement de leur entourage.
II. Impliquer les jeunes dans le processus du
développement humain
L'objectif spécifique du PCM a été non
pas de faire des jeunes une population bénéficiaire d'actions
ponctuelles, mais de vrais acteurs impliqués dans le
développement de leur localité. De ce fait, il a instauré
la même démarche au sein de ses projets.
La notion de jeunes acteurs et développeurs consiste en
la construction de leurs capacités et compétences pour prendre
part dans le développement local. Il est donc important de s'engager
dans l'action collective au sein du territoire, contribuer à la gestion
durable du partenariat et participer à la construction de la
démocratie locale. Dans le tableau ci-après nous allons donner un
aperçu sur les jeunes bénéficiaires des trois projets
objet de ce mémoire.
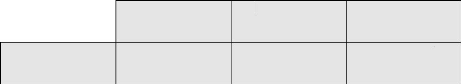
Nombre de jeunes bénéficiaires
Projet
Cré'Acteurs
131 jeunes51
164 jeunes52
PCP Jerada
80 jeunes53
Projet JTC
On se basant sur la dynamique des quatre projets on remarque
qu'ils ont un résultat attendu commun, qui est celui de l'implication
des jeunes dans les actions des projets et faire d'eux des acteurs autonomes.
Ceci a été concrétisé sur deux volets, par le
renforcement des capacités et par l'accompagnement et la mise à
disposition des jeunes d'outils et de méthodologies de travail.
Sur le projet Cré'Acteurs, il était question de
focaliser l'action sur les leviers qui caractérisent la région et
qui peuvent donner un champ porteur en matière d'emploi aux jeunes. On
peut citer des exemples tel que le tourisme rural, l'Apiculture, la
Cuniculture... D'après les entretiens effectués avec les membres
du projet, il est certain que les jeunes ont constitué la partie majeure
des bénéficiaires. En outre, la dynamique instaurée par le
PCM dans ses projets a fait que les jeunes après avoir
51 Entretien avec S. Boulomor, président de
l'association Aitbourzouine, El hajeb.
52 Entretien avec M.Hamzaoui, Référent
jeune du PCM et membre de l'association Gafait, Jerada.
53 Entretien avec A. Amziane, Trésorier du
Carrefour Associatif, Rabat.
suivi des formations diverses devaient pendre l'initiative et
s'impliquer dans leurs propres projets d'avenir. On peut évoquer
l'exemple de la coopérative Ourthou d'Apiculture créée par
7 jeunes de l'association Yannor54. Il faut
préciser que ce sont ces mêmes jeunes qui ont suivi une formation
en Apiculture. De même une autre coopérative a été
créée par 10 jeunes femmes de l'association
Tazouta, ces dernières avaient suivi une formation au métier de
tissage.
Dans le cadre du PCP de Jerada, il est question
d'intégrer les attentes et besoins des jeunes de la région dans
les Plans de Développement Communaux (PDC) et chercher à
impliquer les jeunes dans la prise de décision au niveau de la gestion
des affaires locales. Ce constat est tiré de la situation difficile
liée à la marginalisation et au manque d'opportunité
d'emploi. Une partie importante des jeunes travaillent dans des conditions
lamentables dans des « Cendriers »55 en vue d'avoir un
petit revenu journalier. Il faut signaler que plusieurs jeunes lycéens
ont subit la mort dans ces mines.
Le PCP de Jerada se veut un regain de confiance chez les
jeunes en les sensibilisant sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la
gestion des affaires locales. D'un coté par la participation aux listes
électorales et de voter sur les personnes qui vont les
représenter dans les instances législatives, et d'un autre par la
présentation de ces jeunes aux élections en vue de devenir des
acteurs locaux et représenter leurs communes. L'implication des jeunes
réside dans la constitution des conseils de jeunes issus de trois
communes de la province de Jerada. Ces jeunes ont pu créer une charte de
la participation à la gestion des affaires locales (Annexe 4).
Les conseils de jeunes de Jerada ont constitué une
force de conviction vis-à-vis des pouvoirs publics, des élus
locaux et des associations. Grâce à l'implication et la
volonté des jeunes, les présidents de 6 communes, la
municipalité de Jerada à coté de 10 associations et 110
jeunes ont signé la dite charte56. Ceci montre que les
pouvoirs publics sont convaincus du rôle et de la place des jeunes dans
l'élaboration participative des PDC.
54 Entretien avec M. Bobot, président de
l'association Yannor, Khénifra.
55 Des puits d'extraction du charbon qui ont
été abandonné par la société
d'exploitation.
56 Entretien avec M.Hamzaoui, Référent
jeune du PCM et membre de l'association Gafait, Jerada.
Au niveau du projet JTC, l'échelle prise en compte est
le quartier. L'objectif était d'ancrer les valeurs de citoyenneté
dans l'esprit des jeunes et faire d'eux des acteurs à part
entière dans les activités visées par le projet. Comme le
cas du PCP de Jerada, les jeunes du projet JTC ce sont constitué en 4
conseils de jeunes (le conseil de Rabat Yaacoub el Mansour, le conseil de
Khemisset, le conseil de Khénifra et le conseil de la commune de
Tendrara). Ces 4 conseils ont été composé de 20 jeunes
chacun représentant leurs confrères des 4 provinces.
Les jeunes du JTC ont suivi des formations dans plusieurs
domaines à savoir la sensibilisation à la préservation de
l'environnement, les effets de la drogue, l'animation culturelle et sportive.
Les 80 jeunes du projet ont acquis les outils nécessaires en vue
d'être eux même des acteurs dans leurs quartiers et procéder
à la sensibilisation de la population des quartiers à travers des
ateliers de formation et des soirées culturelles. Les résultats
sont appréciables, on peut citer comme exemple les jeunes du conseil de
Khénifra qui ont crée un club de jeunes lycéens pour la
sensibilisation contres les effets dangereux de la drogue. De même pour
les jeunes du conseil de la commune Yaacoub el Mansour de Rabat qui ont
réaménagé 4 jardins au niveau de 4 quartiers. Il faut
signaler que les jeunes de ce conseil ont mobilisé près
80057 personnes entre jeunes et adultes.
Il est force de constater que l'impact et la philosophie du
PCM a été d'une grande portée sur les jeunes. Ces derniers
ont appris à s'organiser en conseils et à approcher les pouvoirs
publics en vue de réfléchir ensemble sur les
préoccupations des jeunes. De même ils ont acquis des outils et
des méthodes pour pouvoir créer leurs propres projets.
Nous allons voir ci-après la question du cofinancement et
son impact sur les projets et les jeunes.
57 Entretien avec M.Azim, Responsable Administratif et
Financier du Carrefour Associatif.
III. Cofinancement des projets du Programme Concerté
Maroc
Le PCM a essayé d'ancrer dans l'esprit des jeunes des
associations membres la notion de concertation, avec d'une part les pouvoirs
publics, et d'autre part les acteurs de la société civile
franco-marocains. Ces jeunes ont appris à chercher eux même des
partenariats et des bailleurs de fonds locaux et internationaux, tout en
sachant que le PCM a joué le rôle de facilitateur et de garant, et
a donné plus de crédibilité aux projets portés par
les jeunes auprès des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds.
Nous allons voir comment le cofinancement a été
réalisé dans chacun des projets du PCM (voir annexe 4).
1. Cofinancement et répartition du budget du PCP
Jerada58
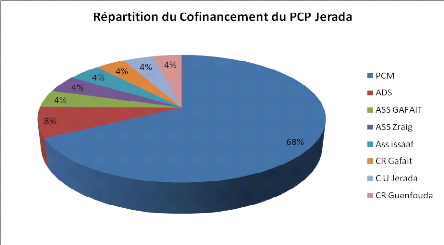
2. Cofinancement et répartition du budget du
projet Cré'Acteurs59

Dans le cas du projet Cré'Acteurs, le PCM a
contribué à hauteur de 49%, mais les porteurs du projet ont
dépassé le budget prévisionnel qui est de 203 300.00
euros, pour atteindre un budget de 206 680.00 euros, ce qui a rendu la
participation du PCM à 45%. Les porteurs du projet ont cherché
à impliqué des organismes dont le poids est très
important. Nous observons la participation de l'INDH et du Ministère du
Développement Social, avec respectivement 15% et 10%. Participation de
l'ANAPEC de 7%, et également les deux membres français CEFIR et
ESF avec respectivement 4% et 2%.
Les valorisations constituent une part importante 17%, par
rapport aux contributions des partenaires.
59 Entretien avec M.BOBOT président de
l'Association Yannor Khénifra, membre du consortium
Cré'Acteurs.
3. Cofinancement et répartition du budget du
Projet JTC60

Le PCM au niveau du projet JTC, a apporté un
cofinancement de 48%, de plus on note une importante participation du CCFD 34%.
Il faut signaler l'apport de l'Entraide Nationale qui figure parmi les
partenaires stratégiques du PCM. Certes son cofinancement est
minoritaire 3%, mais il faut savoir que l'Entraide Nationale cofinance les
projets d'un large tissu associatif, et contribue avec ses moyens logistiques
en faveur des jeunes du PCM.
Dans le cas du projet JTC on observe également une part
importante des valorisations qui est de 15%.
4. Les retombées du Cofinancement sur les projets
et les jeunes ciblés o Sur les Projets :
Le Programme Concerté Maroc, n'était pas
simplement un bailleur de fonds pour les associations porteuses des projets,
mais aussi un accompagnateur, dans la mesure, où il a instauré un
suivi du déroulement des projets, et aussi un financement par tranche,
ce qui exige une implication sincère de la part des porteurs de
projets.
60 Entretien avec M.AZIM, Responsable Administratif et
Financier du Carrefour Associatif.
La logique du PCM dans l'implication des organisations de la
société civile et les acteurs publics est un
élément primordial. Il n'était pas seulement apparent dans
les documents programmes du bureau du PCM, mais il était
concrétisé par l'engagement dans des partenariats signés
auprès de l'Entraide Nationale et le Ministère de la Jeunesse et
des Sports. Cette philosophie du programme a été projetée
dans les projets de développement du PCM, à travers l'incitation
des porteurs à chercher des partenaires et des bailleurs publics, que ce
soit au niveau local, national, ou international auprès des ONG et des
agences de développement internationales.
L'impact de la logique du cofinancement a été
remarquable sur les projets. C'est d'abord le fait que ces projets ont pu lever
des fonds auprès des partenaires publics marocains, ensuite la mise en
ouvre de ces projets leur a donné plus de crédibilité dans
les territoires ou ils opèrent et donc notons comme résultat, le
renforcement de leur reconnaissance en tant qu'acteurs associatifs. Ils sont
aujourd'hui en capacité d'approcher d'autres organismes internationaux
telle que la Fondation de France pour déposer des documents projets pour
cofinancement61.
o Sur les Jeunes :
Les jeunes étaient non seulement une cible mais de vrais
acteurs dans ces dynamiques car ils ont participé dans toutes les phases
de ces actions :
Sur le projet Cré'Acteurs, ils ont crée leur
propre coopérative, ils ont appris dans le cadre du PCM et de leur
projets, le sens du montage des projets, et les techniques de recherche des
bailleurs de fonds publics et privés. Au niveau du projet JTC, ils
élaboraient leur propre plan d'action et sa mise en oeuvre, sur les deux
territoires (Rabat et Tendrara ils se sont constitués en association de
jeunes. Sur le projet Jerada, ils sont aujourd'hui membres de la cellule
jeunesse de leur municipalité et ils ont contribué à
l'élaboration du Plan de Développement Communal. Ces jeunes
seront beaucoup plus renforcés à travers la mise en place des
conseils jeunesse que le PCM est en train de préparer, afin de les
mettre en place dans les territoires où sont localisées les
associations membres (objectif spécifique 1 du PCM3)62.
61 Entretien avec D.AJJOUTI, Directeur du Programme
Concerté Maroc.
62 Document Programme du PCM 3.
Tout au long de cette section nous avons essayé de
montrer comment la dynamique du PCM a permis d'impliquer les jeunes comme
acteurs dans le développement humain et social. Certes les exemples sont
nombreux et nous remarquons que les résultats sont appréciables,
mais il y'a certains dysfonctionnements qu'il faut relever.
Tout d'abord la question de la gestion des fonds du PCM qui
est confiée à une association dénommée Association
de Concertation et de Développement. Les jeunes lors des entretiens ont
montré leur scepticisme quant au fonctionnement de cette association qui
se charge du portage juridique et financier du PCM.
Ensuite, il faut mettre l'accent sur l'inadéquation
entre les budgets alloués aux projets et les actions menées au
profit des jeunes. On remarque l'importance des budgets face à des
actions qui sont minoritaires et qui ciblent un nombre minime des jeunes. De
plus, il est important de soulever la question des expertises
étrangères qui coûtent au PCM des fonds colossaux.
De plus, au niveau de la répartition des budgets des
projets JTC et Cré'Acteurs nous remarquons un taux très important
des valorisations qui est respectivement de 15 à 17%. Ce qui est un peu
exagéré rappelant ainsi la nécessité du
contrôle et du suivi de la part des bailleurs de fonds en vue de
s'assurer de la bonne affectation de ces fonds, et qu'ils servent de
façon concrète la population cible.
Un autre point est celui du nombre total des jeunes du PCM qui
atteint 20 000 jeunes. Selon les entretiens effectués avec certains
jeunes du PCM, ce nombre est un peu exagéré et on trouve souvent
des jeunes du PCM qui sont déjà engagés dans des emplois
et qui bénéficient encore du statut de jeunes du PCM alors qu'il
faut céder la place aux jeunes qui sont dans des situations
difficiles.
Section 3 : Les recommandations
Certes le PCM de façon générale a
prouvé qu'il y'a eu des résultats appréciables, sur la
base des actions qui ont été réalisées dans les
trois projets et dont on a relevé l'impact sur les jeunes. Mais il y'a
plusieurs limites qui ont été soulevées par les acteurs
membres du programmes lors des entretiens et dont nous avons avancé
quelques recommandations.
Il faut également souligner certaines limites
liés au fonctionnement du PCM, d'une part la lourdeur du dispositif
(reporting trimestriel, justificatifs et rigidité des procédures
de suivi financier)63, ce qui surcharge les acteurs associatifs, qui
ont d'autres taches à réaliser sur le terrain. D'autre part, la
vulgarisation du PCM, car il n'est pas beaucoup connu dans le paysage
associatif marocain.
Au niveau stratégique, le manque de connaissance de la
réalité et des évolutions du terrain de la part des
personnes impliquées dans la prise de décision, engendre des
défaillances dans les résultats escomptés. Il faut
partager et coordonner avec les acteurs associatifs et l'équipe
exécutive du PCM, de même baser les décisions sur un
support de connaissances terrain émanant des acteurs associatifs et
locaux, connaissant parfaitement le terrain.
Le PCM est un programme de renforcement des capacités
des jeunes et des associations, c'est également un facilitateur dans la
mesure où il donne plus de crédibilité aux jeunes et aux
porteurs de projets, vis-à-vis des bailleurs de fond internationaux et
des pouvoirs publics. Il doit donc rester sur cette même dynamique, en
focalisant tous les efforts sur les jeunes, et ne pas se dispatcher sur
plusieurs axes. Dans cette optique, le PCM doit concentrer son action sur la
dynamique locale, en prenant comme cadre géographique la province, du
fait que les acteurs se connaissent bien, et qu'il est facile de les
réunir sur des questions qui touchent les problèmes des jeunes de
la dite province, tel que l'exemple du PCP Jerada.
Un autre volet important, celui des visites croisées qui
constituent un levier de
transfert des compétences et des bonnes
pratiques. Les visites réalisées dans le
cadre du PCM, ont
bénéficié plus aux jeunes du Nord, par rapport aux jeunes
du
63 Entretien avec plusieurs acteurs associatifs du
PCM.
PCM. Faute de souplesse des autorités
compétentes en matière d'octroi des visas, en raison bien entendu
des actes déjà commis par certains jeunes, qui profite du visa
pour rester définitivement dans les pays étrangers. Signalons
qu'aucun cas n'a été enregistré dans le cadre des visites
croisées du PCM, de plus quand les visas ne sont pas accordés aux
jeunes, c'est généralement les présidents d'associations
qui partent à la place des jeunes. Il faut que les autorités
cherchent de leur part à instaurer des procédures facilitant ce
genre de visites, qui permettent aux jeunes d'apporter des pratiques et des
techniques innovantes en matière de montage de projet de
développement.
Et enfin, sur la base des projets, le nombre des jeunes
bénéficiaires est minoritaire, face aux budgets importants
alloués aux projets. Le PCM dans ce cas doit chercher à
élargir la population de jeunes à intégrer dans ses
projets de développement. Il faut noter que les jeunes qui font parti du
programme, sont ceux adhérents aux associations membres, et d'autres qui
l'ont côtoyé dans certaines activités déjà
réalisées.
Pour que la parole des jeunes puisse prendre tout son sens
dans le futur, une question d'ordre stratégique devra donc
impérativement être débattue : à quels jeunes le PCM
s'adresse-t-il :
o Aux jeunes les plus en difficultés ?
o A ceux ayant le moins d'opportunités (accès
à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à
la mobilité...) ?
o Aux jeunes ruraux ou aux jeunes urbains ?
o En priorité aux jeunes militants et aux jeunes
souhaitant s'impliquer dans la vie locale, ou à ceux qui en sont le plus
éloignés ?...
La réponse à cette question est essentielle car
elle permettra de déterminer plus précisément :
o Les motivations et les attentes des membres du programme
vis-à-vis des jeunes « porte parole » dans les espaces
politiques ;
o Les modalités d'associations et de
représentations des jeunes dans ces espaces ;
Conclusion
D'après ce que nous avons vu tout au long de ce
mémoire, la jeunesse demeure, un élément incontournable
pour la réalisation de la prospérité du pays, il s'est
avéré qu'il faut prêter une attention particulière
à cette catégorie de la population. Sur la base de toutes les
réformes initiées par l'Etat il y'a eu quelques
améliorations, sur le plan économique et social des jeunes. Mais
il reste encore beaucoup à faire, surtout que l'Etat ne peut pas
remédier seul aux problèmes de la jeunesse, d'où
l'importance d'impliquer la société civile avec toutes ses
composantes, pour travailler ensemble et résoudre en synergie tous les
aspects de marginalisation des jeunes, et sur l'ensemble des domaines (les
doits de l'Homme, l'emploi, la gestion des affaires locales,
l'éducation, la santé, etc.).
A travers la stratégie intégrée de la
jeunesse marocaine, nous avons relevé une prise de conscience de la part
des programmes de coopération internationale, et du gouvernement
marocain, sur l'importance du couplage des efforts des deux pôles, par le
biais de la recherche d'une concertation et d'une complémentarité
entre différents acteurs64, et aussi pour chercher ensemble
des solutions à des problèmes communs.
Ensuite sur le cas du Programme Concerté Maroc, nous
avons vu la vision générale et la philosophie, qui mettent
l'accent sur l'importance de réunir les acteurs publics et ceux de la
société civile, pour opérer dans des projets
destinés aux jeunes. D'après l'analyse des résultats des
projets de développement du PCM, il y'a nécessité de dire
qu'il y'a eu un travail appréciable, et que les résultats sont
remarquables, surtout qu'il s'agit d'un petit programme qui est à son
début65.
Mais il faut mettre l'accent sur le fait que le PCM à
travers sa logique d'action et de cofinancement, a cherché à
influencer les politiques publiques. Cela de façon à pousser les
pouvoirs publics à travailler sur la même dynamique de
concertation pluri-acteurs. L'exemple est celui de l'Entraide Nationale qui est
devenu un partenaire stratégique du PCM, en étant convaincue et
influencé par sa vision considérable en matière
d'implication de la jeunesse dans le développement humain et social.
Cette influence est particulièrement visible auprès des
délégués de l'Entraide Nationale qui ont acquis de
nouveaux réflexes et pratiques dans le travail avec les associations.
Pour l'Entraide Nationale, malgré toute l'expérience acquise
64 Séminaire de Paris, Enjeux
généraux du débat sur le Cofinancement ONG,
décembre 2004.
65 Entretien avec Bérénice POSTIC,
Ex-Chargé des Activités Transversales du PCM.
dans le travail auprès des associations, ce partenariat
renforce le climat de confiance tout particulièrement avec les jeunes et
permet à ces délégués de développer de
nouvelles compétences et savoirs-faires (outils d'accompagnement des
associations, et suivi des projets). Les formes les plus abouties de cette
collaboration sont visibles dans les programmes de concertation provinciaux
grâce au travail mené avec les référents provinciaux
désignés par le programme.
Pour le PCM, ce partenariat permettra d'inscrire les actions
dans une démarche globale de développement, qui respecte les
priorités nationalement définies et d'élargir l'action aux
autres acteurs publics (emploi, santé, éducation, formation
professionnelle, etc.).
Enfin, il est d'une grande nécessité de
converger les efforts de l'Etat, des organisations de la société
civile et des programmes de coopération internationale, en vue de
répondre aux attentes de la jeunesse marocaine. Surtout que les
perspectives d'avenir montrent que la population jeune gardera toujours son
importance.
Pyramide des âges au Maroc : perspectives
2030
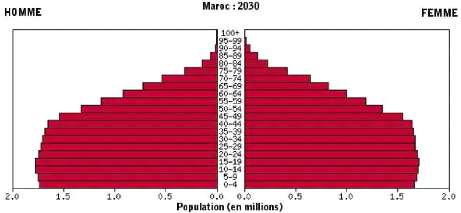
Source :
http://www.exportnetwork.ma
Le Maroc compterait près de 38 millions d'habitants en
2030 dont 21% âgés de moins de 15 ans66.
66 Rencontre d'information du Haut Commissariat au
Plan, 2007.
ANNEXES
Annexe 1 : Fiche représentative du Projet
Cré'Acteurs
N° Dossier P02-2007
Titre du projet Les Cré'Acteurs pour le
développement local rural
Lieu(x) Villages de montagne du Moyen-Atlas
Durée du projet 24 mois
Objectif (s) global (aux) :
- Accompagner la jeunesse marocaine du Moyen Atlas dans ses
projets de développement local rural, notamment dans le domaine du
tourisme rural et de l'artisanat ;
- Consolider et structurer un travail de réseau, outil
de concertation, entre Jeunes des associations dans le territoire du Moyen
Atlas, des jeunes se voulant acteurs du développement de leur territoire
;
- Favoriser et accompagner la création d'AGR et le
développement d'AGR en activité dans le Moyen Atlas, dans un
esprit d'économie sociale et solidaire.
Objectif spécifique :
Contribuer, par une stratégie concertée entre
les associations françaises et marocaines, membres du consortium, et les
pouvoirs publics, à rendre les jeunes acteurs du développement
économique local s'appuyant sur le tourisme rural, dans un esprit
d'économie sociale et solidaire.
Nom des demandeur(s)67 (Organisations
françaises) :
- CEFIR (Centre d'Education et de Formation Interculturel
Rencontre), Chef de file ; - ESF (Electriciens sans Frontières) ;
Nom des demandeurs (Organisations marocaines)
:
-Association Tazouta -Association Yannor -Association Ain
Bechar
67 En précisant d'abord l'organisation «
chef de file » désignée pour recevoir les versements et,
ensuite, tous les autres membres du consortium.
-Association Aït Bourzouine
Partenaire (s)
local (aux) :
- Entraide Nationale de Fès, Meknès ;
- Agence de Développement Social de Fès Boulmane,
Meknès Tafilalet ; - ANAPEC Région Fès Boulmane,
Meknès Tafilalet.
Groupe(s) cible(s)68 :
Jeunes des associations de développement local rural du
Moyen Atlas, jeunes ruraux demandeurs d'emploi et jeunes impliqués dans
les coopératives rurales du Moyen Atlas (artisanat, produits du
terroir), cadres associatifs.
Bénéficiaires finaux69
:
Jeunes des associations de développement rural du Moyen
Atlas, jeunes ruraux demandeurs d'emploi, jeunes impliqués dans les
coopératives rurales, associations et coopératives dans leur
ensemble, prestataires du tourisme rural du Moyen Atlas, population locale
bénéficiant des effets induits du développement par le
tourisme rural et l'artisanat.
Principales activités :
Formations, Animation de réseau, Appui aux projets des
jeunes, Actions de lisibilité du travail des associations, Appui aux
AGR, Appui à la création d'AGR.
68 Les « groupes cibles » sont les
groupes/entités qui bénéficieront directement des effets
positifs du projet.
69 Les « bénéficiaires finaux
» sont ceux qui bénéficieront à long terme du projet
au niveau de la société ou du secteur au sens large.
Annexe 2 : Fiche représentative du Programme
Concerté Provincial
de Jerada
Durée du projet 7 mois
Titre du projet Programme concerté provincial
Lieu(x) Province de Jerada
Objectif (s) global (aux) :
Contribuer à la réussite de la nouvelle
stratégie du PCM axée sur l'animation provinciale (PCP) à
travers la création des comités consultatifs communaux.
Objectifs spécifiques :
- Contribuer à l'implication des jeunes dans la
gouvernance locale respectivement dans les communes de Jerada, Guenfouda et
Gafait ;
- Intégrer les préoccupations des jeunes dans les
plans de développement local dans les communes ciblées.
Porteur du projet
Association Isaaf Jerada solidarité et
développement. Nom des associations partenaires membres du PCM
:
Association Isaaf-Jerada, Association Zraig pour le
développement, et Association Gafait pour la culture et le
développement.
Nombre du jeune référent provincial
:
Deux jeunes : Mlle Khadija BOUTRIG /M. Mohamed HAMZAOUI
(suppliant). Associations non membres du PCM :
Association Aourach, Association AFAQ, Association rencontre des
jeunes, et Association les Enfants de Zellidja.
Partenaire (s) local (aux) :
La Commune urbaine de Jerada-Commune rurale de Gafait -
commune rurale de Guenfouda. Entraide Nationale-Jeunesse et sport-Education
Nationale, Délégation de l'artisanat.
Acteurs cibles du projet :
Les jeunes de la province, les élus (28 personnes
touchées par la formation et une centaine pour le forum).
Résultats escomptés :
- Les grandes thématiques identifiées par le PCM
(ESS, éducation et citoyenneté,....) sont manifestées
comme axe primordial dans les plans de développement communaux des
communes ciblées (Jerada, Guenfouda et Gafait) ;
- Des structures et un programme de concertation provinciale sont
crées et pérennisés.
Annexe 3 : Fiche représentative du Projet
Jeunesse Territoire
Citoyenneté
N° Dossier P05-2006
Durée du projet 36 mois
Titre du projet Jeunesse, Territoire, Citoyenneté
Lieu(x) :
Le projet est mis en oeuvre dans quatre territoires
d'intervention :
1. Le quartier Douar El Kora (commune de Yaacoub El Mansour -
Rabat) ;
2. La municipalité de Khemisset (Province de Khemisset)
;
3. La commune rurale de Tendrara (Province de Figuig) ;
4. Le quartier Amalou Ighreben (commune rurale de Moha Ou Hammou
Zayani - Province de Khénifra).
Objectif global :
Participer à l'effort national pour engager la jeunesse
marocaine à s'impliquer dans une citoyenneté réelle et
agissante propre à la rendre actrice du développement humain
durable de sa société.
Objectif spécifique :
Accompagner 80 jeunes Marocains à exercer une
citoyenneté appliquée aux besoins des communautés et des
territoires dans leurs réalités locales et selon une approche
inter locale.
Nom des demandeurs (Organisations françaises)
:
-Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (chef de file) -Comité National de Liaison des
Régies de Quartiers (CNLRQ).
Nom des demandeurs (Organisations marocaines)
:
- Réseau Carrefour Associatif.
Partenaires locaux :
- Les associations membres du Carrefour Associatif (les
associations AMAPPE, Amal, Oued Srou, Mouvement Twiza, AMSED).
Groupes cibles :
- Quatre groupes de 20 jeunes représentatifs de la
population jeunesse des territoires d'intervention : 80 jeunes (de 18 à
30 ans).
Bénéficiaires finaux :
- L'ensemble des jeunes des quatre territoires d'intervention,
leur famille, leur entourage ;
- Les jeunes, les populations et les autorités publiques
des territoires d'intervention ; - les associations membres du Carrefour
Associatif ;
- Les acteurs de développement au Maroc.
Principales activités :
- Mettre en place la coordination centrale du projet ;
- Initier le projet dans les quatre territoires cibles ;
- Mettre en place les quatre conseils jeunesse du territoire et
leurs travaux ; - Mettre en place le Forum des Conseils Jeunesse
du Territoire ;
- Mettre en oeuvre les quatre plans d'actions jeunesse du
territoire ;
- Capitaliser le projet en vue de l'édition du guide
« le jeune et sa citoyenneté » et du rapport
d'expérience.
Annexe 4 : La charte d'honneur, pour la
participation des jeunes à
la gestion de la chose publique, qui a
été élaborée par les jeunes de
la province de
Jerada
Présentation
Le Pacte d'honneur pour la participation des jeunes, est
l'aboutissement d'une dynamique civile que le Programme concerté Maroc a
enclenché afin de mettre en oeuvre les recommandations issues de l'appel
des jeunes du Programme, lui-même synthèse des 4
conférences régionales et de la conférence nationale sur
« quelle implication des jeunes dans la gestion de la chose publique
locale ? ». L'objectif en était de renforcer l'approche
participationniste de cette tranche importante de la population qu'est la
jeunesse.
L'appel des jeunes se réfère à 3
thèmes :
· Démocratie et état de droit
· Gouvernance économique
· Environnement
Il se réfère également aux
synthèses des 2 universités organisées dans le cadre du
pôle citoyenneté et accès au droit. Universités
conçues comme autant d'espaces de concertation dédiées
à la jeunesse marocaine, et dont l'objectif premier est d'instaurer des
mécanismes d'accompagnement des jeunes marocains à être
acteurs engagés dans le développement humain solidaire.
Le pacte d'honneur, vise - à travers
les jeunes du programme, vis-à-vis de leurs pairs-, à
réfléchir sur les mécanismes et les modalités de
mise en oeuvre de la participation citoyenne des jeunes au niveau de leur
quartier, de leur Douar à l'occasion des élections de juin
2009.
Le changement et les évolutions que connait le Maroc
dans le renforcement de
démocratie et de la modernité
émanant de la volonté royale déclarée et mise
en
place par le gouvernement afin de considérer comme prioritaire,
toute planification
stratégique ou politique publique spécifiques
à la Jeunesse.
L'état aujourd'hui est appelé à revisiter
ses stratégies par rapport aux problématiques de la jeunesse.
Le Maroc connait toujours un déficit dans ce cadre.
Les modifications introduites dans la nouvelle charte
communale font de la collectivité un espace de concertation promouvant
la proximité comme approche et condition sine qua non d'un
développement social équitable.
Les collectivités locales sont appelées
à travailler selon une stratégie globale et
intégrée ayant pour objectif de porter les valeurs, et y faire
adhérer la jeunesse en mettant en exergue l'approche pédagogique,
l'intégration sociale et les activités socioculturelles et
scientifiques afin de prémunir les jeunes des dérives et des
extrémismes. Cela ne peut « ETRE » que grâce à la
promotion de la concertation, du dialogue, de l'information et de la
communication.
Principes généraux :
· Égalité
· Respect mutuel
· Reconnaissance de l'autre, Rejet de l'exclusion.
· Dialogue
· Coresponsabilité
· Entraide (Solidarité ?)
· Démocratie
· Égalité des chances
· Transparence.
Engagements :
Considérant les constats et afin de promouvoir les
principes précités tout en veillant à l'atteinte des
objectifs du 3e millénaire, nous demandons aux élus
:
Concernant le volet DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT
:
· Garantir l'information et la communication continue avec
la population en général et des jeunes en particulier.
· Faire participer les associations de jeunesse dans
l'élaboration du plan
communal du développement
économique et social de la collectivité locale.
· Renforcer le partenariat égalitaire avec les
associations de jeunes. Concernant la GOUVERNANCE ECONOMIQUE
:
1. Instaurer les mécanismes de participation des jeunes
dans l'élaboration des budgets ainsi que dans le suivi et le
contrôle des dépenses publiques.
2. Rendre à la collectivité locale, son
rôle d'espace de concertation et d'encouragement des jeunes, en leur
permettant de bénéficier des opportunités de
développement social et économique vers l'amélioration, de
leurs conditions de vie.
3. Faire de la collectivité locale un acteur
légitime, pour l'instauration auprès de la jeunesse, de la
culture du respect de l'environnement et de la bonne santé Concernant
l'ENVIRONNEMENT :
- Faire de la collectivité locale une institution
publique oeuvrant à instaurer une culture de protection de
l'environnement et de préservation de la santé des jeunes.
En qualité de :
Signature :
Annexe 5 : Répartition du cofinancement des
trois projets du PCM
- PCP Jerada :
|
Partenaires du Projet
|
Budget en dirhams
|
Pourcentage
|
|
PCM
|
85 768.20
|
68%
|
|
ADS
|
9850.00
|
8%
|
|
Association Gafait
|
5500.00
|
4%
|
|
Association Zraig
|
5500.00
|
4%
|
|
Association Isaaf
|
5500.00
|
4%
|
|
CR Gafait
|
5000.00
|
4%
|
|
CU Jerada
|
5000.00
|
4%
|
|
CR Guenfouda
|
5000.00
|
4%
|
|
BUDGET TOTAL
|
127 118.20
|
100%
|
- Projet Cré'Acteurs :
|
Partenaires du Projet
|
Budget en Euros
|
Pourcentage
|
|
PCM
|
93 500.00
|
45%
|
|
INDH
|
30 000.00
|
15%
|
|
Ministère du
Développement Social
|
20 000.00
|
10%
|
|
Valorisations
|
35 000.00
|
17%
|
|
ANAPEC
|
14 490.00
|
7%
|
|
CEFIR
|
08 690.00
|
4%
|
|
Électriciens Sans
Frontières
|
05 000.00
|
2%
|
|
Budget Total prévu
|
203 300.00
|
-
|
|
Budget Total réalisé
|
206 680.0070
|
100%
|
- Projet JTC :
|
Partenaires du projet
|
Budget en Euros
|
Pourcentage
|
|
PCM
|
146 238.00
|
48%
|
|
CCFD
|
102 291.00
|
34%
|
|
Valorisations
|
44 327.00
|
15%
|
|
Entraide Nationale
|
8000.00
|
3%
|
|
Budget Total
|
300 856.00
|
100%
|
70 Budget total augmenté par des fonds
mobilisés à mis parcours par les porteurs du projet
Cré'Acteurs.
Bibliographie
1. Les Ouvrages :
- BOURQIA Rahma, Jeunesse estudiantine marocaine Valeurs
et stratégies, Publications de la Faculté des Lettres et des
sciences Humaines de Rabat, 1995, 127 p.
- Centre d'études internationales, collectif, Une
décennie de réformes au Maroc, KARTHALA, 2010, 426 p.
- COUSIN Lucien, Mieux faire société
ensemble (la contribution des Programmes Concertés Pluri-Acteurs
à une rénovation du dialogue entre société civiles
et pouvoirs publics), 96 p.
- IKKEN Aissa, Les organisations de jeunesse au Maroc,
AL ASAS, 1999, 151 p.
- Le Maroc possible, collectif, « Rapport du
Cinquantenaire » 2006, 288 p.
- MERNISSI Fatima, A quoi rêvent les jeunes,
MARSAM, 2008, 190p.
- VILLEVAL Philippe (Handicap International) et LAVIGNE
Philippe (Groupe de Recherche et d'Echanges Technologiques), Capitalisation des
expériences, Comment passer de la volonté à l'action,
Traverses n°15 , 2004, 49 pages.
2. Les Rapports :
- Rapport de l'Agence Internationale du Développement
Economique et Social, Les besoins des jeunes en formation et en services
financiers, 2008.
- Rapport du Ministère de l'économie et des
finances, l'année budgétaire 2011.
- Rapport national dur le Développement Humain, 2007.
- Rapport national, Alphabétisation des adultes, Direction
de la lutte contre l'Analphabétisme, 1997-2003.
- Rapport de la Direction des études et des
prévisions financière, La décennie des réformes et
du progrès, 2009.
- Rapport du PNUD, Femmes et Dynamiques du Développement,
2005.
- Rapport 50 ans de Développement Humain au Maroc, Hassan
Rachik, Jeunesse et Changement Social, 2006.
- Rapport FNUAP, Approche Communautaire Jeune pour Jeune, mai
2007.
- Séminaire de Paris, Enjeux généraux du
débat sur le Cofinancement ONG, décembre 2004.
- Bulletin Mensuel d'Information de l'Institut National d'Etudes
Démographiques, Populations et Sociétés, n° 359,
juillet-Août 2000.
| 


