INTRODUCTION
L'épidémiologie de la GEU doit distinguer les
GEU survenues alors que la femme n'avait pas de contraception (échec de
reproduction) ou qu'elle en avait un (échec de contraception). Ces deux
types de GEU diffèrent sur presque tous les plans (sauf peut-être
la prise en charge et l'efficacité immédiate du
traitement) : incidence, localisation, facteurs de risque et
fertilité ultérieure
De façon générale,
l'épidémiologie de la GEU concerne l'étude de son
incidence (nombre ou proportion de nouveaux cas par an), de ses facteurs de
risque et de ses conséquences. Les connaissances sur chacun de ces
points sont issues d'enquêtes épidémiologiques1(*).
ETAT DE LA QUESTION
Disons que certaines autres études avaient
déjà été mené avant nous, sur la question de
la prévalence des grossesses ectopiques bien sûr dans d'autres
milieux que chez en République Démocratique du Congo.
Après une forte augmentation entre 1970
et 1990, l'incidence de la GEU a décru pendant une dizaine
d'années. On assiste actuellement à une évolution
différenciée : décroissance des GEU sous
contraception, augmentation des GEU sans contraception. Trois quarts des GEU
sont ampullaires et 4,5 % sont extra-tubaires2(*).
Dans une étude prospective par DIALLO F.B et coll., les
auteurs rapportent 63 cas de grossesse extra-utérine.
Sur le plan épidémiologique la femme
présentant une G.E.U. est une femme jeune en pleine activité
génitale avec une incidence de 6,34 % entre 21 et 30 ans, nulligeste
tout au plus primipare ou paucipare 4,93 %, à antécédents
gynécologiques chargés 16 % d'avortement clandestins 5 %
d'infections génitales.
Sur le plan thérapeutique, la chirurgie a
été radicale dans 80,94 %.
Pour améliorer le pronostic, les auteurs proposent : un
diagnostic précoce de la grossesse et une lutte contre les M. S. T., les
infections gynécologiques, les avortements provoqués clandestins
par une sensibilisation et une éducation sanitaire soutenues3(*).
CHOIX ET INTERET DU SUJET
L'augmentation de la fréquence de la Grossesse Extra
Utérine a été démontrée dans les pays
industrialisés au cours des deux dernières décennies,
constituant un important problème de Santé Publique. La
fréquence a doublé ou triplé4(*).
Vu l'importance de la fréquence des interruptions
volontaire des grossesses clandestine parmi les jeunes dans nos milieux, les
infections génitales hautes et tant d'autres facteurs de risque exposant
la femme à certains risques obstétricaux notamment la grossesse
ectopique, notre choix sur ce sujet a été motivé le souci
de contribuer à la santé de la reproduction de la femme en
général et celle de la ville de Lubumbashi.
L'intérêt de ce sujet s'inscrit de la cadre
d'éduquer la femme Lushoise sur le plan sanitaire de reproduction en vue
de diminuer la fréquence des grossesses ectopique dans nos milieux.
PROBLEMATIQUE
La présente étude repose sur les questions
suivantes :
- Quelle est la prévalence des grossesses
extra-utérines (GEU) à L'hôpital Général
Sendwe ?
- Quelle tranche d'âge est plus touchée ?
- Quel est le facteur de risque principal rencontré
à l'hôpital Sendwe ?
HYPOTHESES
Cette incertitude sur la prévalence de grossesse
extra-utérine nous amène à pousser loin nos investigations
sur la question et avec la progression de cette étude, nous allons
pouvoir donner une précision sur la prévalence. Les jeunes dames
dont l'âge varie autour de 20 ans seraient les plus touchées dans
cette étude et le principal facteur de risque serait les interruptions
volontaires de grossesses dans les antécédents des patientes.
BUT ET OBJECTIF
Cette étude s'inscrit dans le cadre de diminuer la
fréquence de grossesses extra-utérine. C'est ainsi que ce travail
a pour objectifs de :
· Déterminer la fréquence
hospitalière (Prévalence) de la G.E.U. à l'hôpital
général de référence Jason Sendwe,
· Dégager le profil
épidémiologique de la femme présentant une G.E.U.
METHODOLOGIE
Notre étude est rétro-prospective allant du
janvier 2007 à juin 2009. Les facteurs descriptifs sont l'âge, la
parité et les antécédents des patientes. Nous n'avons
retenu pour population, les fiches de patientes qui avaient
nécessité une hospitalisation.
Pour l'étude des facteurs de risques, nous avons retenu
L'étude statistique utilise le test du «chi
carré», les moyennes arithmétiques et autres.
Le dénominateur le plus accessible est le nombre des
accouchements permettant une comparaison entre les différentes autres
études. Dans l'étude prospective, nous avons pu déterminer
le nombre des naissances qui permet d'intégrer les grossesses multiples
et le nombre des naissances vivantes qui diminue la fréquence de GEU
observée.
Une interview libre a été adressée aux
personnels médicaux et infirmier.
Pour la partie théorique, nous avons fait une analyse
documentaire et même une analyse des registres des malades en
gynécologie pour la collecte de données sur terrain.
DELIMITATION DE SUJET
Ce travail concerne toutes les fiches des patientes ayant
conçu une grossesse extra-utérine dans le service de
gynécologie-obstétrique et tous les cas d'accouchement ayant lieu
dans la période allant du mois de janvier 2007 au mois de juin 2009,
à l'hôpital général de référence Jason
Sendwe.
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Ce travail comprend deux grandes parties hormis la partie
introductive et conclusive, dont la première est théorique et
traite sur un bref rappel anatomique et physiologique de l'organe reproducteur
féminin, les généralités sur la grossesse
ectopique ;
La seconde est pratique et présente le cadre de recherche,
les résultats de la récolte de données ainsi que l'analyse
et commentaires.
CONSIDERATIONS
THEORIQUES
CHAPITRE 0 : DEFINITION DE
CONCEPTS DE BASE
1. La prévalence : c'est un terme de
l'épidémiologie qui définit le nombre de personnes
atteintes d'une certaine
maladie
à un moment donné dans une population donnée.
Son but est d'estimer le nombre véritable de cas, au
moment de l'étude, dans la population concernée5(*).
2. La grossesse : La grossesse (ou la gestation) est le
processus physiologique au cours duquel la progéniture vivante d'une
femme, se développe dans son corps depuis la conception jusqu'à
ce qu'elle puisse survivre hors du corps de la mère. Une femme en
état de grossesse est dite enceinte ou gravide6(*).
3. Extra-utérin (ine) : Terme d'anatomie et de
pathologie. Qui existe ou qui se passe hors de la cavité de
l'utérus. Grossesse extra-utérine.
4. La grossesse extra-utérine : La grossesse
extra-utérine est une
grossesse se
développant hors de l'
utérus. La
très grande majorité des grossesses extra-utérines sont
des grossesses dans la
trompe de Fallope
ou grossesses tubaires. La grossesse extra-utérine est une urgence
chirurgicale dans sa forme rompue. Son diagnostic est de plus en plus
précoce permettant d'éviter sa rupture et la mise en jeu du
pronostic vital et permettant un traitement non chirurgical sous certaines
conditions strictes.
CHAPITRE PREMIER : RAPPEL
ANATO-PHYSIOLOGIQUE DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR FEMININ
1.1. VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR FEMININ

1.1.1. Les ovaires :
L'ovaire représente la glande génitale
féminine. Il en existe 2 (un de chaque côté) situés
dans la cavité pelvienne.
Cette glande a 2 fonctions distinctes:
- La formation des cellules reproductrices de la femme, les
ovules (ovogénèse)
- La synthèse des hormones sexuelles
féminines (oestrogène, progestérone et
androgènes)
De la puberté à la ménopause,
l'ovaire est l'objet de modifications cycliques mensuelles (le cycle ovarien)
dont l'objectif est de libérer, chaque mois, un oeuf mature prêt
à être fécondé (l'ovocyte libéré lors
de l'ovulation) et de préparer la paroi de l'utérus
(l'endomètre) à une éventuelle implantation.
1.1.2. Les trompes de Fallope:
La trompe de Fallope est un long conduit d'environ 12 cm qui
relie chaque ovaire à l'utérus (il y en a donc 2, une de chaque
côté).
Elle a pour fonction la captation de l'ovocyte au moment
de l'ovulation grâce au mouvement des cils de son ampoule, d'assurer le
transport des spermatozoïdes de l'utérus vers l'ovaire, et ensuite
des oeufs fécondés en sens inverse, et le liquide qu'elle
contient fournit à l'oeuf des conditions favorables à son
développement.
Cette trompe sera le siège de la fécondation.
1.1.3. L'utérus:
L'utérus, organe situé au milieu de la
cavité pelvienne, comporte 2 parties distinctes:
1. Le corps dans lequel débouchent les
trompes (au niveau de l'isthme tubaire) et qui comporte 2 couches dans son
épaisseur:
- une couche externe de muscles (le
myomètre).
- une couche interne muqueuse
(l'endomètre) qui présente des variations
d'épaisseur et de composition cycliques en réponse aux variations
des taux des hormones sexuelles sécrétées par l'ovaire.
2. Le col qui assure la communication entre
le corps de l'utérus et le vagin. C'est par cette petite porte
d'entrée que passeront les spermatozoïdes déposés
dans le vagin au moment du rapport sexuel, si la période est propice
à la fécondation.
Les fonctions de l'utérus sont multiples:
- il assure le transport des spermatozoïdes du vagin vers
les trompes
- il est le siège de la nidation, l'embryon s'implantant
dans l'épaisseur de son endomètre vers la fin de la
première semaine du développement de l'oeuf
fécondé.
- pendant toute la durée de la grossesse, il
protège l'embryon et lui fournit le matériel nécessaire
à son développement. Son volume s'adaptant au fur et à
mesure à la croissance continue du foetus.
- en fin de grossesse, ses
contractions assurent l'expulsion du foetus et du placenta.
A la fin du cycle ovarien, s'il n'y a pas eu
fécondation et nidation, sa paroi interne (l'endomètre) va
être éliminée sous l'effet de la chute brutale des hormones
sexuelles. Cela occasionne des saignements (les règles).
1.1.4. Le vagin:
Le vagin est l'organe de copulation dans lequel seront
déposés les spermatozoïdes au cours du rapport sexuel.
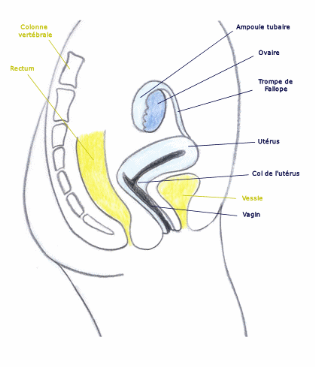
Le vagin représente également la filière
que le bébé devra franchir lors de l'accouchement... il est donc
très extensible!
1.2. PHYSIOLOGIE DE LA GROSSESSE
1.2.1. Physiologie : La
fécondation et la nidation7(*)
1° Le spermatozoïde
Après l'éjaculation, le sperme reste en contact
avec la glaire cervicale, avec laquelle il a pu être plus ou moins
mélangé.
Du fait du pic oestrogénique pré ovulatoire,
cette glaire possède au maximum à ce moment précis ses
qualités de réceptivité (abondance, filance,
limpidité et autres caractères physicochimiques) aux
spermatozoïdes qui fuient l'acidité vaginale.
Les gamètes mâles (spermatozoïdes) sont
capables de vivre plusieurs jours dans une glaire d'excellente qualité
et semblent se regrouper dans les cryptes de l'endocol (improprement
appelées glandes), d'où ils sont progressivement
libérés vers l'utérus et les trompes.
La progression des spermatozoïdes dans le col, la
lumière utérine et les trompes est mal connue; elle n'est pas le
fait de leur seule motilité, car on trouve des spermatozoïdes dans
les trompes quelques minutes après un rapport, laps de temps trop court
pour qu'ils franchissent par eux mêmes cette distance
considérable; aussi, les cinétiques utérine et tubaire ont
elles un rôle certain.
Au cours de ce trajet, les spermatozoïdes
acquièrent leur pouvoir fécondant grâce à un
phénomène de "capacitation" au contact de la glaire et des
muqueuses génitales féminines. Les spermatozoïdes morts sont
résorbés au niveau des muqueuses, principalement de
l'endomètre.
2° L'ovocyte
Après la décharge de l'hormone hypophysaire LH,
au quatorzième jour d'un cycle de vingthuit jours, il apparaît une
ouverture sur le follicule ovarien mûr, à travers laquelle le
liquide folliculaire s'écoule dans le péritoine en
entraînant l'ovocyte.
Le corps jaune qui se forme sur l'ovaire sécrète
très rapidement de la progestérone, qui, entre autres actions
biologiques, va entraîner un décalage thermique et faire perdre
à la glaire cervicale ses propriétés
réceptrices.
A son émission, l'ovocyte est entouré d'une
couronne de cellules de la granulosa (corona radiata) et n'a pas achevé
sa maturation: il est au stade d'ovocyte II avec 23 chromosomes (22 A + X),
après avoir émis son premier globule polaire, et entame sa
dernière mitose de maturation.
Il est entraîné par un courant de liquide
péritonéal vers l'orifice externe de la trompe, qui s'est par
ailleurs rapprochée de l'ovaire jusqu'à en balayer la surface
avec les franges de son pavillon. L'ovocyte migre dans la trompe sous l'action
des cils de l'épithélium tubaire et de mouvements
péristaltiques, et il est débarrassé de sa corona radiata
au cours de ce trajet.
3° La fécondation
La rencontre du spermatozoïde et de l'ovocyte semble se
faire dans le tiers externe de la trompe.
Le spermatozoïde, également porteur de 23
chromosomes (22 A + X, ou 22 A + Y) pénètre l'ovule qui
achève sa dernière mitose de maturation et émet son
deuxième globule polaire. Le spermatozoïde se fixe au niveau de
récepteurs spécifiques sur la zone pellucide de I'ovocyte, puis
la traverse, et fusionne avec la membrane plasmique de l'oeuf; les noyaux
(pronuclei) mâle et femelle s'accolent pour reconstituer un oeuf à
46 chromosomes, dont le sexe est déterminé par le capital
chromosomique du spermatozoïde.
4° La progestation
La progestation est la période de six à sept
jours pendant lesquels l'oeuf ainsi formé mène une vie libre. Il
se divise rapidement et a triplé de dimensions lorsqu'il entre dans la
lumière utérine au stade de morula après les trois
à quatre jours nécessaires pour franchir les 6 à 8
centimètres qui l'en séparent.
Cette morula reste ensuite libre dans la lumière
utérine pendant trois jours supplémentaires au cours desquels
elle passe au stade de blastocyste de trois dixièmes de
millimètre de diamètre.
5° Nidation et début
de gestation
Le blastocyste entre en contact avec l'endomètre
(muqueuse utérine), dans lequel il pénètre le 9e jour
après la fécondation, soit vers le 23e jour d'un cycle de 28
jours, car l'ovule ne reste fécondable que pendant quelques
heures.
Son trophoblaste rudimentaire (précurseur du placenta)
sécrète très vite de l'HCG, dont la détection est
à la base des tests de grossesse, et qui va stimuler le corps jaune:
loin de se tarir, les sécrétions estroprogestatives de ce dernier
vont augmenter régulièrement et maintenir l'endomètre en
place: c'est l'aménorrhée gravidique.
Il faut noter le rôle essentiel du corps jaune et de ses
sécrétions hormonales, tant au cours de la progestation
(contractions des trompes, nutrition de l'oeuf libre par les
sécrétions génitales) que pendant la nidation
(préparation adéquate de l'endomètre) et le début
de la grossesse.
CHAPITRE II : LA GROSSESSE
ECTOPIQUE
2.1. Définition
o Développement de l'oeuf fécondé en
dehors de la cavité utérine, ce développement peut avoir
comme localisation :
v la
trompe utérine (grossesse tubaire); la grossesse peut être
implantée :
Ø soit dans la portion interstitielle de la trompe,
alors elle est appelée (grossesse
interstitielle, ou grossesse angulaire)
;
Ø soit dans la portion isthmique de la trompe, il
s'agit de la grossesse tubaire isthmique
Ø soit dans la portion moyenne de la trompe,
Ø soit dans la portion ampullaire de la trompe
(grossesse tubaire ampullaire),
Ø soit dans la portion distale de trompe, près
du pavillon tubaire,
Ø et enfin, la grossesse tubaire peut se compliquer par
la formation d'un hématosalpinx (hématome de la trompe) d'une
taille variable allant de quelques centimètres jusqu'à
l'extention sur la totalité de la trompe (
gros
hématosalpinx).
v
l'ovaire (grossesse ovarienne) ;
v le col
de l'utérus (grossesse cervicale);
v la paroi musculaire de
l'utérus,
c'est-à-dire le myomètre (grossesse intra-murale);
v la cavité abdominale (grossesse abdominale) ;
v il existe des localisations très rares sur d'autres
organes intra-abdominaux comme le foie...
v l'association de la grossesse intra-utérine avec la
grossesse extra-utérine est appelée la
grossesse hétérotopique ou ditopique,
2.2. Manifestations cliniques
La grossesse extra-utérine est une pathologie grave qui
peut mettre en danger la vie de la femme ; sa gravité vient du fait
qu'elle peut provoquer une hémorragie interne parfois fatale :
par un avortement interne complet ou incomplet,
c'est-à-dire l'expulsion partielle ou totale de la grossesse
extra-utérine de l'organe porteur vers la cavité abdominale (les
cas les plus souvent rencontrés sont les expulsions des grossesses
tubaires ou se qu'on appelle les avortements tubo-abdominaux complets ou
partiels) ; par la rupture et l'éclatement de l'organe porteur de la
grossesse extra-utérine.
1) Dans les formes typiques de la grossesse
extra-utérine tubaire, la patiente présente les
symptômes et les signes suivants :
- retard de règles ;
-
métrorragies ;
- douleurs en bas du ventre (douleurs pelviennes) ; de temps
en temps irradiant vers l'anus et/ou la face interne de la cuisse et le
genou ;
- test de grossesse positif ;
- examen gynécologique douloureux (en particulier le
toucher vaginal profond) ; avec parfois la palpation d'une masse avoisinant
l'utérus qui est lui-même de taille d'un utérus non gravide
(qui ne porte pas de grossesse) ;
-
À l'échographie :
v pas de grossesse intra-utérine identifiable ;
v l'endomètre est habituellement peu épais dans
les grossesses extra-utérines; le plus souvent, il ne mesure que
quelques millimètres, mais un endomètre épaissi (15
à 25 mm, comme c'est le cas dans les grossesses intra-utérines
débutantes), voire très épaissi, n'exclut pas le
diagnostic de grossesse extra-utérine.
v la présence à proximité de
l'utérus d'une masse évoquant, pour l'échographiste, le
diagnostic d'un hématosalpinx (un hématome ou une collection du
sang dans la trompe,) de forme oblongue ou arrondie et de taille variable
allant de
quelques
cm à
plus
de 10 cm,), et de temps en temps on peut identifier de façon claire
le sac de la grossesse (sac gestationnel).
Dans le sac gestationnel
ectopique on peut parfois identifier certains éléments
anatomiques du produit de la grossesse (le
trophoblaste,
la
vésicule
ombilicale, et plus exceptionnellement l'embryon; ou le foetusmort ou
vivant), mais dans certains cas, on peut constater qu'il s'agit d'un
oeuf
clair sans aucune formation embryonnaire et exceptionnellement, une
grossesse
môlaire extra-utérine ;
v enfin, il est possible de mettre en évidence un
épanchement plus ou moins important dans la cavité abdominale et
qui témoigne le plus souvent de la présence d'une
hémorragie interne.
· En combinant l'échographie aux dosages de
hCG
plasmatique, il est admis qu'une grossesse évolutive
intra-utérine est visible :
v par l'échographie par voie abdominale à partir
d'un taux plasmatique de
hCG
égale ou supérieur à 2500 mUI/ml ;
v par l'échographie par voie endovaginale à
partir d'un taux plasmatique de
hCG
égale ou supérieur à 1500 mUI/ml
2) Mais la grossesse extra-utérine peut prendre des
formes cliniques très variables et parfois trompeuses ; pour l'exemple
on peut citer :
- Les formes d'emblée graves (douleur abdominale ou
pelvienne d'apparition brutale comme un coup de poignard et malaises, voire
état de choc avec chute de tension artérielle...) si la prise en
charge est retardée, il existe un risque fatal ;
- Les formes ressemblant à
l'avortement
spontané d'une grossesse intra-utérine (pseudo avortement),
car la patiente, au cours d'une métrorragie et de douleur pelvienne,
peut expulser par la voie génitale naturelle, une quantité
importante de débris qui ressemblent, à l'examen à l'oeil
nu, aux débris d'un avortement spontané, mais en effet, ces
débris ne sont que des débris provenant de
l'endomètre
(appelé dans ce cas : la caduque) après avoir subi des
modifications particulières sous l'effet des hormones
sécrétées par
le
corps jaune.
- Des formes trompeuses parce que, il n'y a pas du retard de
règles ou seulement retard de quelques jours ; dans ces cas
particuliers, les patientes signalent des
règles
inhabituelles par leur durée, leur abondance, leur aspect ou par la
présence d'autres symptômes associés ;
- Des formes qui sont découvertes tardivement par la
présence d'une anémie et d'une masse située
derrière l'utérus (appelée hématocèle,
c'est-à-dire une collection du sang ou un hématome qui s'est
formé lentement par une hémorragie interne continue à
faible débit) ;
- Les formes paucisymptomatiques, c'est-à-dire qui
donnent peu de signes et symptômes ;
- Enfin des formes asymptomatiques et qui sont
découvertes fortuitement lors d'un examen clinique ou
échographique dans le cadre de l'exploration d'une grossesse qui semble
cliniquement normale.
3) Devant cette variété de formes cliniques et
devant la gravité de la maladie dans certains cas, il faut que le
médecin pense à cette pathologie chez toute femme en
période d'activité génitale et se plaignant :
- de douleurs abdominales, même minimes ;
- de troubles inhabituels des règles ;
- devant chaque avortement spontané sans arguments
échographiques clairs prouvant qu'il s'agissait d'une grossesse
intra-utérine ;
- dans ce cadre il est conseillé que toute
I.V.G.
soit précédée par un examen échographique qui
permet de vérifier la localisation de la grossesse en même temps
que la détermination de son âge et de sa viabilité.
Il faut informer les femmes à risque de grossesse
extra-utérine des symptômes et des signes de cette pathologie pour
qu'elle consulte son médecin le plus rapidement possible dès
qu'un symptôme ou un signe apparaît.
2.3. Facteurs de risques
Les femmes à haut-risque de grossesse
extra-utérines sont :
· les femmes ayant dans leurs antécédents
- une grossesse extra-utérine ;
- une
infection
génitale haute ;
- une plastie tubaire ;
- une intervention chirurgicale nécessitant l'ouverture
de la cavité abdominale ;
- une
I.V.G.
(interruption volontaire de grossesse) ;
- un tabagisme.
· chez les femmes utilisant un de ces moyens de
contraception :
- un
stérilet ;
-
une pilule micro progestative ;
- après utilisation de
la
contraception de lendemain.
2.4. Le traitement actuel de la grossesse extra-utérine
2.3.1. Abstention thérapeutique :
Statistiquement 20 % des grossesses extra-utérines
régressent spontanément, mais le traitement qui consiste à
surveiller la patiente sans procéder à un traitement
médical ou chirurgical est réservé aux patientes
asymptomatiques (sans symptômes), chez lesquelles les explorations
cliniques et les dosages sanguins (
hCG
et pour certains centres, le taux de progestérone plasmatique) prouvent
qu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine inactive ou peu active et en
régression spontanée.
Dans ce cas-là, les taux d'
hCG
chez la patiente peuvent être comparés à la courbe de la
régression du taux d'
hCG
plasmatique chez les patientes ayant eu une grossesse extra-utérine
tubaire avec :
-
un traitement radical chirurgical par salpingectomie (ablation de la trompe)
;
-
un traitement chirurgical avec conservation de la trompe.
-
Évolution du taux de hCG au cours d'une grossesse normale
(tableau)
-
Évolution du taux de hCG au cours d'une grossesse normale
(courbe)
2.3.2. Traitement chirurgical :
La voie d'accès :
Soit par laparotomie (chirurgie classique par
ouverture de la paroi abdominale) dans :
Les cas graves avec altération de l'état
général de la patiente ;
En cas de contre-indication à la coelioscopie
(chirurgicale ou anesthésique) ;
échec de la réalisation du traitement
chirurgical par voie coelioscopique en raison du volume important de la
grossesse extra-utérine ou des difficultés d'accès devant
la présence d'adhérences ou des difficultés à
réaliser l'hémostase (le contrôle des saignements) ;
Dans certaines localisations (grossesse abdominale ou
grossesse angulaire volumineuse) ;
Si le chirurgien juge que le matériel coelioscopique
présente des défauts rendant la chirurgie coeliscopique
dangereuse pour la patiente ;
Enfin, si le chirurgien juge que ses compétences en
chirurgie coelioscopique ne lui permettent pas de réaliser l'acte
chirurgical par cette voie.
Soit par chirurgie coelioscopique dans tous les autres cas.
L'acte chirurgical, quand il s'agit d'une grossesse ectopique
tubaire, est variable parce qu'il peut être :
2.3.3. Conservateur : la trompe porteuse de
la grossesse ectopique est conservée ; le chirurgien peut
procéder :
- soit à une expression sur la trompe permettant
l'expulsion en dehors de la trompe la grossesse ectopique ou ses débris
qui sont restés dans la lumière tubaire après une
expulsion spontanée et incomplète ;
- soit à une salpingotomie (césarienne tubaire)
qui consiste à inciser la paroi de la trompe pour extraire la grossesse
ectopique contenue dans sa lumière par expression ou aspiration.
2.3.4. Radical : c'est-à-dire,
l'ablation de la trompe (salpingectomie) ; les indications sont :
- les volumineuses grossesses tubaires de plus de 5 à 6
cm de diamètre ;
- l'altération importante de la trompe (rupture ou
prérupture tubaire) ;
- en cas de récidive de la grossesse tubaire du
même côté ;
- si la grossesse tubaire est à l'origine d'importante
hémorragie interne ;
- si, au cours de la même intervention, le
contrôle de l'hémostase est imparfait après une tentative
d'un traitement chirurgical conservateur ;
- en cas d'échec du traitement conservateur
réalisé lors d'une précédente intervention.
2.3.5. Il existe un
score
thérapeutique chirurgical de la grossesse extra-utérine
permettant au chirurgien de choisir la technique chirurgicale la plus
adaptée pour la patiente en fonction du degré de
l'altération de sa fertilité.
2.3.6. Traitement médical
Par l'administration d'un traitement antimitotique (qui
arrête la division cellulaire au niveau des cellules qui constituent la
grossesse ectopique). Il s'agit du méthotrexate à une dose de 1
à 1,5 mg/kg en intra-musculaire (50 mg/m² de la surface corporelle)
ou en injection locale dans la masse de la grossesse ectopique, soit au cours
d'une coelioscopie ou sous contrôle échographique si cette
grossesse ectopique est identifiable avec ce moyen d'investigation.
Le méthotrexate peut être associé à
l'antiprogestérone appelée (RU 486), ce qui améliore
nettement les résultats en ce qui concerne le taux de succès.
Le traitement médical est réservé aux
patientes porteuses de grossesse ectopique :
- peu symptomatique ;
- peu active (faible taux de bêta-hCG, faible taux de
progestérone plasmatique c'est-à-dire un taux inférieur
à 5 ou 10 nanogrammes/millilitre) ;
- peu volumineuse (moins de 3 ou 4 cm de diamètre
dans son grand axe) ;
- ne contient pas un embryon présentant une
activité cardiaque positive ;
- qui n'est pas associée à une hémorragie
interne importante (hémopéritoine de moins de 100 cc).
- l'absence de contre-indication au méthotrexate est
nécessaire.
Enfin ce traitement ne peut pas être proposé que
chez les patientes qui ne sont pas angoissées et qui ont les moyens de
comprendre l'intérêt de ce type de thérapie et qui sont
capables de consulter rapidement le médecin en cas d'apparition de
nouveaux symptômes ou aggravation des symptômes déjà
présents.
L'efficacité du traitement médical de la
grossesse extra-utérine peut être évaluée par :
- les symptômes que la patiente peut décrire car
une aggravation ou une apparition de nouveaux symptômes témoignent
d'un éventuel échec nécessitant de consulter rapidement un
centre médical ;
- l'examen clinique et l'exploration échographique
réguliers qui permettent de repérer les probables échecs
du traitement ;
- enfin les dosages réguliers des taux de
hCG
plasmatique (hormone sécrétée par les cellules
trophoblastiques qui font partie des constituants de la grossesse).
Les
remarques concernant les dosages des taux de
hCG
sont :
Les taux de hCG doivent être comparés à
la
courbe de la régression normale du taux de hCG après le
traitement médical de la grossesse extra-utérine
Cette courbe montre une élévation initiale du
taux de
hCG
dans les huit premiers jours (environ de + 25 % du taux initiale).
La négativation du dosage de
hCG
plasmatique (qui témoigne de la guérison définitive) est
obtenue en moyenne au bout de 28 jours.
Le traitement médical peut comporter des risques dus
à la toxicité du méthotrexate qui est essentiellement :
- hématologique (thrombopénie : diminution de la
numération des plaquettes dans le sang ; leucopénie ou diminution
de la numération des globules blancs dans le sang) ;
- digestive (diarrhée, somatite ou inflammation des
muqueuses de la cavité buccale)
- hépatique (au niveau du foie).
Le fait d'administrer le méthotrexate en une seule
injection diminue énormément sa toxicité et ses effets
secondaires.
CONSIDERATIONS
PRATIQUES
CHAPITRE I : PRESENTATION DU
CADRE DE RECHERCHE, METHODOLOGIE, DIFFICULTES RENCOTREES
2.2. PRESENTATION DU CADRE DE RECHERCHE
2.2.1. HISTORIQUE DE L'HOPITAL GENERAL PROVINCIAL DE
REFERENCE JASON SENDWE
1. CADRE GEOGRAPHIQUE ET PRESENTATION
Situé dans la zone de santé de
Lubumbashi, l'hôpital Général provincial Jason Sendwe est
situé dans la partie est de la commune de Lubumbashi .Il est
limité au nord par l'avenue Sendwe, au Sud par l'avenue des Ecoles,
à l'Est par le Lycée Wema et à l'Ouest par l'avenue
Likasi.
Cet hôpital d'intérêt public comprend deux
grandes parties à savoir : La partie pavillonnaire et la partie
à Etages dans lesquelles nous trouvons plusieurs services
hospitaliers.
2. APERÇU HISTORIQUE DE L'HOPITAL J.
SENDWE
L'hôpital Général Provincial de
Référence Jason Sendwe, appelée Jadis Hôpital Prince
LEOPOLD fut construit en 1928.
Les mobiles qui avaient poussé les autorités de
l'époque à construire cet Hôpital propre aux
indigènes furent à la fois d'ordre social et humanitaire c'est
-à-dire la lutte contre les maladies endémiques dues à la
poussée démographique, afin d'éviter la contagion dans
l'Hôpital reine ELISABETH (Hôpital pour blanc)
Cet Hôpital dont l'édification n'a pas
été une tâche facile fut construit en deux phases à
savoir :
La première phase : cette phase de construction
consacrée à la parte pavillonnaire fut exécuter en 1928.
Elle comptait à sa construction de l'édifice à l'Etage s
1958. Toute fois, une aile sera construite avant l'accession de notre pays
à l'indépendance. Les travaux seront interrompus suite aux
évènements malheureux qui avaient suivi l'indépendance du
pays.
Il faut signaler que c'est un hôpital de l'Etat, qui
sera géré jusqu'en 1962 par l'Etat lui-même .En 1962, suite
à l'installation du camp de réfugiés de triste
mémoire entre la Rwashi où trouvait l'Hôpital Universitaire
de l'Université Officiel du Congo et le centre ville, les
autorités de l'Université seront incapable d'accomplir la
formation des étudiants
En Médecine et se verront obliger de
déménager pour s'installer à l'Hôpital Sendwe. IL y
à
Partir de cette date une gestion bicéphale avec une
direction de l'Etat à côte de celle de l'Université.
Notons que cette même année sera celle de
l'inauguration du bâtiment à l'étage.
A partie de 1974, la direction de l'Hôpital sera
confiée à la Gécamines pour des raisons d'ordre social,
dont la plus importante fut le souci du président de la
république de permettre à
La population la ville de bénéficier d'une
Médecine et de soins de bonne qualité à un prix moins
cher. Deux ans plus tard l'Université quittera pour aller s'installer
à l'ancienne Clinique reine ELISABETH actuellement Cliniques
Universitaires.
Pendant la gestion de la Gécamines, l'Hôpital
Sendwe comptait :
· 377 agents d'exécution
· 88 agents classe 4
· 65 agents de cadre dont 15 médecins
Compte tenu des difficultés d'ordre économiques
qui ont entraîné la faillite de la Gécamines,
l'autorité politique en concertation avec le gouvernorat de province du
Katanga, l'Université de Lubumbashi, la Gécamines et le consulat
de Belgique, avait jugé bon de répondre la gestion de
l'Hôpital et la confiée à l'Université de Lubumbashi
qui en reprit la direction à partir du 30 Septembre 2005.
L'Hôpital Sendwe avec sa capacité de
1200 lits est classé en deuxième position
après l'Hôpital Général de Kinshasa, il dessert pour
ainsi dire la population de toutes les communes de Lubumbashi, mais aussi celle
venant de tout le reste du Katanga, de deux Kasaï et du Sud Kivu.
Vu son importance bien que disposant de 1200 lits, il
connaissait un pourcentage d'occupation de plus de 100%,
Actuellement il a un taux d'occupation de 66,3 % avec une
tendance de baisse vu certains indicateurs tels que l'accueil de patients, la
qualité de soins qui s'explique par son efficience, accessibilité
aux soins...
A. SUR LE PLAN
ADMINISTRATIF
L'administration de l'Hôpital Sendwe est rendue
complexe et délicate par le fait que son tuteur l'Etat congolais confie
la gestion à qui il veut et cette complexité ne facilitent pas
la solution de multiples problèmes poses.
Pour mieux assurer la gestion, l'hôpital Sendwe
fonctionne avec deux structures à savoir:
§ La structure Administrative et
§ La structure Médicale.
LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE
Elle est dirigée par un comité de gestion
composé d'un Médecin Directeur et d'un Administrateur
Gestionnaire financier. Elle s'occupe de l'administration courante de
l'Hôpital, elle coordonne les différents services, elle engage et
affecte le personnel soignant suivant la formation de chacun. Elle fonctionne
sous la direction du Médecin directeur.
Plusieurs Gestionnaires administrateurs se sont
succédé à la tête du dit Hôpital depuis sa
création.
· MBOMBO MUJANE de 1990-1992
· SONGA SONGA de 1992-1994
· LUPUNGU A YAV de 1994-1996
· KASHIKALA de 1996-1997
· ZINGA de 1997-2000
· LUPUNGU A YAV de 2000-2003
· SHISOLA de 2003-2004
· KYUNGU SHIMBI de 2004-2006
· KASEKI WILLY de 2006-2008
· GEORGETHE MUSONDA de 2008-2009 jusqu'à ce
jour.
B. LA STRUCTURE MEDICALE
Elle est dirigée par un Médecin Directeur qui
coordonne les services médicaux.
C'est un secteur très vaste qui comprend plusieurs
services spécialisés à savoir :
- La chirurgie
- La gynécologie
- La médecine interne
- La pédiatrie
- L'hôpital du jour qui comprend les dispensaires :
Ophtalmologie, ORL, gynécologie, pédiatrie, Médecine
interne
- Les Urgences et les PMI.
2.3. METHODOLOGIE
Notre étude est rétro-prospective allant du
janvier 2006 à juin 2009. Les facteurs descriptifs sont l'âge, la
parité et les antécédents des patientes. Nous n'avons
retenu pour population, les fiches de patientes qui avaient
nécessité une hospitalisation.
Pour l'étude des facteurs de risques, nous avons retenu
L'étude statistique utilise le test du «chi
carré», les moyennes arithmétiques et autres.
Le dénominateur le plus accessible est le nombre des
accouchements permettant une comparaison entre les différentes autres
études. Dans l'étude prospective, nous avons pu déterminer
le nombre des naissances qui permet d'intégrer les grossesses multiples
et le nombre des naissances vivantes qui diminue la fréquence de GEU
observée.
Une interview libre a été adressée aux
personnels médicaux et infirmier.
Pour la partie théorique, nous avons fait une analyse
documentaire et même une analyse des registres des malades en
gynécologie pour la collecte de données sur terrain.
2.4. DIFFICULTES RENCONTREES
- Le manque d'une bonne tenue de registre de malades dans tous
les services ;
- L'accès difficile à certaines informations
auprès des certains infirmiers.
CHAPITRE II : PRESENTATIONS
DES RESULTATS
Cette étude présente les résultats de
1138 patientes vues en consultations gynécologique à
l'hôpital général Jason Sendwe de la période allant
de 2006 à 2009, et de 13 909 accouchements.
Pour tous nos résultats, différentes variables
nous ont été utile pour l'analyse de cette étude
notamment :
- L'âge
- La provenance
- La gestité
- Parité
- Facteurs de risque
- Ainsi l'évolution de la fréquence entre trois
années (2007- 2009)
Tableau 1 : Répartitions des patientes
selon l'âge
|
Ages
|
Effectifs
|
%
|
|
15-18
|
60
|
5,3
|
|
19-23
|
180
|
15,8
|
|
24-28
|
456
|
40,2
|
|
29-33
|
202
|
17,7
|
|
34 - 44
|
240
|
21
|
|
total
|
1138
|
100
|
Constatation :
Ce tableau nous montre à suffisance que la population
GEU est beaucoup plus dans la tranche d'âge 24-28 ans de notre
échantillon et représente 40,2% dont l'âge moyen est de
26#177;5 ans, l'âge minimal était de 15 ans et le maximal de 44
ans. Disons que l'âge modal ou le plus fréquent est 28 ans
Tableau 2 : Distribution de patientes selon leur
adresse
|
Commune
|
Effectifs
|
%
|
|
Lubumbashi
|
198
|
17,3
|
|
Kampemba
|
489
|
43
|
|
Kamalondo
|
81
|
7,1
|
|
Kenya
|
168
|
14,8
|
|
Katuba
|
120
|
10,5
|
|
Annexe
|
53
|
4,6
|
|
Rwashi
|
29
|
2,5
|
|
total
|
1138
|
100
|
Constatation :
Cette distribution nous montre que la majorité de nos
patientes venaient de la commune Kampemba où nous trouvons la proportion
de 43%, suivi de la commune de Lubumbashi qui représente 17,3 % de la
population. Très peu sont celles qui venaient de la commune Annexe,
Rwashi et Kamalondo.
Tableau 3 : Répartition des patientes
selon la gestité
|
Gestité
|
Effectif
|
%
|
|
1-3
|
619
|
54,4
|
|
4-6
|
384
|
37,7
|
|
7-9
|
129
|
11,3
|
|
10-12
|
6
|
0,5
|
|
Total
|
1138
|
100
|
Constatation :
La gestité médiane en comptabilisant le nombre
de la GEU en cours est 3. La majeure partie de nos patientes avait une
gestité entre 1 et 3 ; cette tranche représente 54,2 % de
notre échantillon. Celle qui avait une gestité entre 4 et 6
représentent 37,7% ; 11,3% de celles qui avaient porté 7
à 9 grossesses. Et notre constat est que très peu avaient
déjà conçu entre 10 et 12 grossesses (0,5%).
Tableau 4 : Répartition des patientes
selon la parité
|
Parité
|
Effectif
|
%
|
|
1
|
381
|
33,4
|
|
0
|
329
|
29
|
|
2
|
103
|
9
|
|
=3
|
325
|
28,6
|
|
total
|
1138
|
100
|
Constatation :
Disons qu'au vu de ce tableau, nous constatons qu'il y a eu
beaucoup de primipare qui représentent 33,4 % de notre
échantillon ; 29 % sont celles qui avaient une parité
nulle ; 28,6 % sont les Multipares avec une parité =3 et
nullipare (29%).
Tableau 7 : Antécédent des
patientes opérées de GEU à propos de 1138 GEU entre 2007
et 2009
|
Antécédents
|
Effectifs
|
%
|
|
Avortements
|
521
|
45,7
|
|
Infections génitale
|
293
|
25,7
|
|
GEU antérieure
|
199
|
17,5
|
|
Stérilité
|
2
|
0,2
|
|
Chirurgie pelvienne
|
90
|
8
|
|
Césarienne
|
26
|
2,3
|
|
Contraceptifs oraux et DIU
|
7
|
0,6
|
|
Total
|
1138
|
100
|
L'étude des antécédents des patientes met en
évidence la fréquence des avortements (45,7%), des infections
génitales (25,7 %), des GEU antérieures (17,5 %). La chirurgie
pelvienne représente 8 % pour notre échantillon. Les
contraceptifs oraux et dispositifs intra-utérin (DIU) ne
représentent que 0,6 % de patientes.Tableau 8 :
Fréquence de Grossesse Extra-utérine à l'hôpital
Sendwe de 2007 à 2009
|
Année
|
Nombre de GEU
|
Nombre d'accouchements
|
GEU/100 accouchements
|
|
2007
|
317
|
4 949
|
6,4
|
|
2008
|
625
|
5 860
|
10,6
|
|
2009 (jusqu'en juin)
|
196
|
3 100
|
6,3
|
|
Total
|
1138
|
13 909
|
8,2
|
Cette distribution nous montre à suffisance qu'en 2007 il
y avait eu une ascension de grossesse extra-utérine opérée
avec un pic de fréquence de 10,6 pour 100 accouchements alors qu'en 2006
le taux était de 6,4 % accouchement, et baisse du taux en 2008
(6,3%).
La prévalence pour les 3 périodes d'étude
est 8,2 pour 100 accouchements à l'hôpital Sendwe
Tableau 8 : Antécédent des
patientes opérées de GEU à propos de 1138 GEU reparti par
période annuelle.
|
Antécédents
|
Année
|
Effectifs
|
|
2007
|
2008
|
2009
juin
|
|
Avortements
|
198
(54%)
|
221
(49,5%)
|
102
(31,2%)
|
521
(45,7%)
|
|
Infections génitale
|
104
(28,2%)
|
99
(22,1%)
|
90
(27,6%)
|
293
(25,7%)
|
|
GEU antérieure
|
56
(15,3%)
|
91
(20,4%)
|
52
(15,9%)
|
199
(17,5%)
|
|
Stérilité
|
2
(0,54%)
|
0
|
0
|
2
(0,5%)
|
|
Chirurgie pelvienne
|
6
(1,6%)
|
28
(6,27%)
|
56
(17,1%)
|
90
(8%)
|
|
Césarienne
|
0
|
6
(1,3%)
|
20
(6,1%)
|
26
(2,3%)
|
|
Contraceptifs oraux et DIU
|
0
|
1
(0,2%)
|
6
(1,8%)
|
7
(0,6%)
|
|
Total
|
366
(32,1%)
|
446
(39,1%)
|
326
(28,8%)
|
1138
(100%)
|
Il ressort de ce tableau qu'en rapport aux
antécédents ou facteurs de risque de la grossesse
extra-utérine, de manière spécifique par
antécédent, la fréquence est toujours élevée
2008 surtout les avortements (221 patientes), suivi contrairement des
infections génitale dans une proportion de 104 patientes en 2007
Tableau 9 : Distribution patiente selon le
mode d'admission
|
Mode d'admission
|
Effectifs
|
%
|
|
Référée
|
884
|
77,7
|
|
Venue d'elle-même
|
254
|
22,3
|
|
Total
|
1138
|
100,0
|
La majorité de parturientes ayant fait une grossesse
ectopique étaient référée d'un centre de
santé avec un effectif de 884 patientes qui représentent 77,7% et
peu de patientes se sont amenées d'elle-même de la maison vers
l'hôpital et elles représentent 22,3% de notre échantillon
.
DISCUSSION ET COMMENTAIRES
Au terme de notre étude sur la prévalence de
grossesse extra-utérine, il est important d'attirer notre attention sur
plusieurs points :
L'âge :
La fréquence (la prévalence) de la G.E.U. de 8,2
% dans cette étude est une fréquence élevée.
Cette progression et la fréquence élevée
s'observent aussi bien dans la littérature africaine8(*) que dans la littérature
européenne où l'on relève une fréquence ancienne de
0,3 %, une fréquence actuelle de l à 2 % et une fréquence
prévisible de 2 à 3 %. Cette fréquence
élevée serait en rapport avec la recrudescence des IVG et des
infections génitale haute, essentiellement l'augmentation du nombre des
infections tubaires.
La G.E.U. a concerné tous les âges de la vie
génitale active avec un maximum entre 24 et 28 ans de notre
échantillon (catégorie exposée aux facteurs
incriminés dans la pathogenèse de la G.E.U) et représente
40,2% dont l'âge moyen est de 26#177;5 ans, l'âge minimal
était de 15 ans et le maximal de 44 ans. Disons que l'âge modal ou
le plus fréquent est 28 ans.
Le risque de G.E.U. diminue aux âges extrêmes. La
littérature rapporte une augmentation progressive de l'incidence de
G.E.U. avec l'âge9(*).
En Afrique, l'âge médian se situe vers 25
ans10(*). L'âge
médian des primipares est de 17 ans et 5 mois à Libreville alors
que l'âge médian des nullipares avec GEU est de 23 ans.
La parité n'influence pas la fréquence de
G.E.U., l'étude fait ressortir le risque encouru par les primipares 33,4
%. Il s'agit de primipares âgées, le risque s'explique par
l'âge tardif de la première grossesse permettant l'installation
d'une pathologie tubaire le plus souvent d'origine infectieuse et la
stérilité secondaire.
WESTROM estime que 50 % des cas de G.E.U. surviennent sur des
trompes déjà infectées11(*).
Les antécédents d'avortement (45,7%) ont
été les plus pourvoyeurs de G.E.U, des infections
génitales (25,7 %), des GEU antérieures (17,5 %). La chirurgie
pelvienne représente 8 % pour notre échantillon. Les
contraceptifs oraux et dispositifs intra-utérin (DIU) ne
représentent que 0,6 % de patientes. Il s'agit pour la plupart
d'avortements provoqués clandestins, suivi de des infections
génitales (25,7 %), des GEU antérieures (17,5 %). La chirurgie
pelvienne représente 8 % pour notre échantillon. Les
contraceptifs oraux et dispositifs intra-utérin (DIU) ne
représentent que 0,6 % de patientes.
La majorité de nos patientes provenaient de la commune
Kampemba où nous trouvons la proportion de 43%, suivi de la commune de
Lubumbashi qui représente 17,3 % de la population. Très peu sont
celles qui venaient de la commune Annexe, Rwashi et Kamalondo. Ceci explique
s'explique par la position d'implantation de l'hôpital Sendwe par rapport
aux différentes communes de la ville de Lubumbashi.
Disons nous constatons qu'il y a eu beaucoup de primipare (33,4
%), multipares (28,6 %) et nullipare (29%). Et pour la plupart, ont
été référées d'une structure sanitaire.
CONCLUSION
Ce travail a étudié la prévalence de
grossesse ectopique à Lubumbashi, cas de l'hôpital Jason
Sendwe.
Notre étude était rétro-prospective allant
du janvier 2007 à juin 2009 et a concerné tous les cas des
patientes ayant comme une grossesse extra-utérine dans le service de
gynécologie-obstétrique et tous les cas d'accouchement ayant lieu
dans la période allant du mois de janvier 2007 au mois de juin 2009,
à l'hôpital général de référence Jason
Sendwe.
Après analyse, nous aboutissons à la conclusion
selon laquelle :
La prévalence de la G.E.U. est élevée
dans notre étude (8,2%). Sur le plan épidémiologique, la
femme faisant une G.E.U. est une femme jeune en pleine activité
génitale, à antécédents gynécologiques et
chirurgicaux chargés, nulligeste traitée pour
stérilité tout au plus primipare ou paucipare, à bas
niveau socio-économique.
La G.E.U. a concerné tous les âges de la vie
génitale active avec un maximum entre 24 et 28 ans (40,2%) dont
l'âge moyen est de 26#177;5 ans
La prévention bien que difficile est possible, elle
doit s'appuyer sur la lutte contre les M.S.T., les infections
gynécologiques, les avortements clandestins. Elle devrait être
possible grâce à une éducation sanitaire soutenue.
SUGGESTION ET RECOMMANDATION
Aux autorités politico-administratives
- Mettre sur pied une politique de surveillance des maladies
sexuellement transmissible,
- Mettre des moyens pour décourager la pratique des
interruptions des grossesses clandestines et illégale
Aux personnels médicaux
- Le pronostic doit être amélioré par le
dépistage précoce des grossesses, singulièrement des
G.E.U. en vue d'une chirurgie conservatrice.
BIBLIOGRAPHIE
1. COSTE J. ; BOUYER J. ; JOB-SPIRA N. ;
Epidémiologie de la grossesse extra-utérine : incidence et
facteurs de risque, 1996, vol. 24, no2, pp. 135-139,
FRANCE
2. DIALLO F.B., Grossesse extra-utérine (G.E.U.) aspects
épidémiologique et thérapeutique au service de
gynécologie obstétrique du CHU IGNACE DEEN DE CONAKRY,
Médecine d'Afrique Noire : 1999, 46 (10)
3. DIALLO F.B et coll., Grossesse extra-utérine
(G.E.U.) aspects épidémiologique et thérapeutique au
service de gynécologie obstétrique du CHU IGNACE DEEN de
Conakry, Médecine d'Afrique Noire : 2006, 46
(10).
4. PICAUD A., NLOME-NZE A.R., Evolution de la fréquence
de La grossesse extra-utérine à Libreville (Gabon) de 1977
à 1989
5. L'encyclopédie santé Vulgaris-Médical.
6. EMILE LITTRE, Dictionnaire de
Français « Littré »,
définitions, citations, synonymes, usage...
(1863-1877)
7. EMPERAIRE Jean-Claude, Gynécologie endocrinienne du
Praticien, éd. Masson
8. VANTYGHEN A., M.C. VANTYGHEN HANDIQUET, B.LANCIEUX, MONSIEUR
J.C., D.VINATIER. La G.E.U. : aspects épidémiologiques
diagnostics, thérapeutiques et pronostic (à propos de 117
observations relevées d'avril 1976 à septembre 1983). Journal
Gynécologie Obstétrique et Biologie Reproduction 1985, 14 :
67-75.
9. VANTYGHEN A., M.C. VANTYGHEN HANDIQUET, B.LANCIEUX, MONSIEUR
J.C., D.VINATIER, op cite.
10. CAZENAVE J., C., BIANCHI G., MACKOUMBOU A. BELIER L.,
DESTANNE DE BERNIS, SUPPINI A. Les inflammations tubaires non
spécifiques, causes des trois-quarts des grossesses
extra-utérines en Afrique inter-tropicale. Méd. Afr. Noire,
1987, 34, 817-829.
11. WESTROM L. Infiltration et G.E.U. après salpingite
recherche récente sur épidémiologie de la
fertilité. Société Française, étude de
la fertilité. Masson Ed. Paris, 1986 : 205-212.
TABLE DE MATIERE
EPIGRAPHE................................................................................................
I
DEDICACE................................................................................................II
AVANT-PRO.............................................................................................III
INTRODUCTION
1
ETAT DE LA QUESTION
1
CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
PROBLEMATIQUE
2
HYPOTHESES
2
BUT ET OBJECTIF
3
METHODOLOGIE
3
DELIMITATION DE SUJET
3
SUBDIVISION DU TRAVAIL
3
CONSIDERATIONS THEORIQUES
4
CHAPITRE 0 : DEFINITION DE CONCEPTS DE
BASE
5
CHAPITRE PREMIER : RAPPEL ANATO-PHYSIOLOGIQUE
DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR FEMININ
6
1.1. VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL
REPRODUCTEUR FEMININ
6
1.2. PHYSIOLOGIE DE LA GROSSESSE
8
1.2.1. Physiologie : La
fécondation et la nidation
8
CHAPITRE II : LA GROSSESSE ECTOPIQUE
11
2.1. Définition
11
2.2. Manifestations cliniques
11
2.3. Facteurs de risques
13
2.4. Le traitement actuel de la grossesse
extra-utérine
14
CONSIDERATIONS PRATIQUES
17
CHAPITRE I : PRESENTATION DU CADRE DE
RECHERCHE, METHODOLOGIE, DIFFICULTES RENCOTREES
18
2.2. PRESENTATION DU CADRE DE RECHERCHE
18
2.2.1. HISTORIQUE DE L'HOPITAL GENERAL PROVINCIAL
DE REFERENCE JASON SENDWE
18
2.3. METHODOLOGIE
21
2.4. DIFFICULTES RENCONTREES
21
CHAPITRE II : PRESENTATIONS DES RESULTATS
22
DISCUSSION ET COMMENTAIRES
25
CONCLUSION
25
SUGGESTION ET RECOMMANDATION
25
BIBLIOGRAPHIE
25
TABLE DE MATIERE
25
* 1 COSTE J. ;
BOUYER J. ; JOB-SPIRA N. ; Epidémiologie de la grossesse
extra-utérine : incidence et facteurs de risque,
1996, vol. 24, no2, pp. 135-139, FRANCE
* 2 DIALLO F.B., Grossesse
extra-utérine (G.E.U.) aspects épidémiologique et
thérapeutique au service de gynécologie obstétrique du CHU
IGNACE DEEN DE CONAKRY, Médecine d'Afrique Noire : 1999, 46 (10)
* 3 DIALLO F.B et coll.,
Grossesse extra-utérine (G.E.U.) aspects
épidémiologique et thérapeutique au service de
gynécologie obstétrique du CHU IGNACE DEEN de
Conakry, Médecine d'Afrique Noire : 2006, 46
(10).
* 4 PICAUD A., NLOME-NZE A.R.,
Evolution de la fréquence de La grossesse extra-utérine
à Libreville (Gabon) de 1977 à 1989
* 5 L'encyclopédie
santé Vulgaris-Médical.
* 6 EMILE
LITTRE, Dictionnaire de Français
« Littré », définitions,
citations, synonymes, usage... (1863-1877)
* 7 EMPERAIRE Jean-Claude,
Gynécologie endocrinienne du Praticien, éd. Masson
* 8 VANTYGHEN A., M.C. VANTYGHEN
HANDIQUET, B.LANCIEUX, MONSIEUR J.C., D.VINATIER. La G.E.U. : aspects
épidémiologiques diagnostics, thérapeutiques et
pronostic (à propos de 117 observations relevées d'avril 1976
à septembre 1983). Journal Gynécologie Obstétrique et
Biologie Reproduction 1985, 14 : 67-75.
* 9 VANTYGHEN A., M.C. VANTYGHEN
HANDIQUET, B.LANCIEUX, MONSIEUR J.C., D.VINATIER, op cite.
* 10 CAZENAVE J., C., BIANCHI
G., MACKOUMBOU A. BELIER L., DESTANNE DE BERNIS, SUPPINI A. Les
inflammations tubaires non spécifiques, causes des trois-quarts des
grossesses extra-utérines en Afrique inter-tropicale. Méd.
Afr. Noire, 1987, 34, 817-829.
* 11 WESTROM L. Infiltration
et G.E.U. après salpingite recherche récente sur
épidémiologie de la fertilité. Société
Française, étude de la fertilité. Masson Ed. Paris, 1986 :
205-212.
| 


