|
 
Université d'Orléans - UFR des Lettres, Langues
et Sciences Humaines
Département de Géographie
Une gestion des terres conflictuelle :
du monopole foncier de l'Etat à la
gestion locale des Mongo
(Territoire de Basankusu,
République Démocratique du Congo).
MEMOIRE DE RECHERCHE
Master en Sciences Humaines et Sociales
Mention: Géographie et Aménagement
Spécialité : Territoires et
développement durable dans les pays industrialisés, en
développement ou en émergence.
Présenté par : Sous la direction
de :
Ulysse BOURGEOIS
M. Denis CHARTIER
(Maître de conférences en Géographie)
Membres du Jury :
Pierre-Armand ROULET
(chercheur en Géographie)
Denis CHARTIER
(professeur des université et chercheur à
l'Institut de recherche pour le développement)
28/09/2009
Ce travail est bien évidemment dédié
au lecteur, à mes proches, familiaux ou non, mais je le dédie
particulièrement aux Mongo avec une pensée pour les
paysans.
Une gestion des terres conflictuelle :
du monopole foncier de l'Etat à la
gestion locale des Mongo
(Territoire de Basankusu, RDC).

Photographie 1 :
Une parcelle de manioc et des arbres servant pour les
limites de propriétés
Présenté par : Sous la direction
de :
Ulysse BOURGEOIS
M. Denis CHARTIER
(Maître de
conférences en Géographie)
Mots clefs : Afrique centrale, appropriation, conflit
foncier, droit coutumier, droit foncier,
Etat, forêt tropicale, gestion foncière,
histoire, propriété foncière, Mongo
Résumé :
Le propriété des terres en Afrique est
marquée par des interactions entre deux manières de gérer
les terres. D'après le droit juridique, l'Etat est le seul est le
propriétaire foncier. Cependant, en zone rurale et forestière, il
existe des pratiques foncières anciennes, et les population locales ont
également des droits fonciers, indépendamment de l'Etat.
Située au coeur des forêts du bassin du Congo, la
République Démocratique du Congo est un pays où l'on
observe des modes coutumiers de gestion des terres. De nombreuses populations
dépendent de ces forêts pour leur survie. C'est le cas de la
population Mongo vivant dans les forêts équatoriales au centre du
pays. La gestion des terres de cette population est au coeur des enjeux que
représentent les forêts. Entre un Etat aux multiples
difficultés, et les populations Mongo, la gestion foncière est
marquée par différentes manières de s'approprier la terre.
D'où des tensions voire des conflits entre deux acteurs fonciers
différents.
Keywords : central Africa, appropriation, land
conflict, customary law, land rights, State,
tropical forest, land administration, history, landed
property, Mongo.
Abstract :
The land property in Africa is marked by the interactions
between two ways of land management. According to the legal right, the State is
the only landowner. However, in rural and forestry areas, there are old land
administrations and the local populations also have State-independent land
rights. Located in the center of the Congo bassin forests, the Democratic
Republic of Congo is a country with customary land administrations. Many
populations depend on forest to survive. The way this population administrates
the land is the stake which constitutes the forests. Between a numerous-problem
State, after many years of political troubles, the landed property is marked by
different ways of land appropriation . As a result we can notice tensions and
conflits between two differents land players.
SOMMAIRE
Sommaire p. 04
Remerciements
Introduction p. 07
PARTIE I
Le rôle de l'Etat en matière foncière
depuis la colonisation jusqu'à la République Démocratique
du Congo p. 14
Chapitre 1. La propriété de la terre lors de
la période coloniale:
un autoritarisme foncier p. 15
1. La période pré-coloniale p. 16
2. La colonisation : les relations entre l'administration
coloniale
et les populations locales p. 17
Chapitre 2. Les différentes lois régissant le
foncier en zone rurale p. 30
1. La nouvelle constitution et la gestion des terres
coutumières p. 30
2. La loi de 1973 : une référence p.
33
3. La loi foncière de 1980 p. 36
Chapitre 3. Le code forestier de 2002 p. 39
1. Les grands ensembles forestiers selon le droit forestier p.
39
2. Les droits d'usage selon les différents types de
forêts p. 41
3. L'aménagement des forêts p. 42
Synthèse p. 45
PARTIE II
La population Mongo : l'imbrication entre la
société et le domaine foncier p. 46
Chapitre 1. Une population au coeur du bassin du Congo.
p. 48
1. Localisation au sein de la RDC p. 48
2. L'arrivée de la population Mongo dans la cuvette du
bassin du Congo et
en particulier dans le Territoire de Basankusu p. 49
3. Une culture très liée à la nature p.
53
Chapitre 2. Une société complexe et
hiérarchisée p. 55
1. Les différenciations au sein de l'Ethnie Mongo p.
55
2. L'organisation sociale p. 56
3. L'organisation politique en zone rurale p. 58
Chapitre 3. La répartition des terres chez les
populations Mongo p. 62
1. La propriété des forêts d'après les
enquêtes p. 64
2. Les délimitations spatiales entre les différents
propriétaires des forêts p. 70
3. Comment et pourquoi obtenir une portion de forêt
selon la coutume Mongo ? p. 72
Chapitre 4. Les règles foncières selon les modes
d'utilisations de l'espace :
étude de cas à l'échelle d'un
village p. 75
1. Les espaces anthropisés p. 76
2. Les espaces naturels : forêts et cours d'eau p.
81
3. Les limites entre les propriétaires p. 85
Chapitre 5. L'interdépendance entre les structures
familiales
et la gestion des terres p. 86
1. La généalogie et l'évolution du finage
p. 86
2. La répartition des terres entre les lignées d'un
clan p. 88
3. Un acteur prépondérant en matière
foncière : le chef de lignée p. 93
Synthèse p. 95
PARTIE III : Les relations difficiles entre deux
manières de gérer les terres p. 96
Chapitre 1. Les conflits fonciers p. 97
1. Les conflits à l'échelle du village :
à l'intérieur de la société Mongo p. 98
2. Les conflits entre les chefs de terres et les concessions
privées p. 104
3. Les tensions entre les terres urbaines et les
propriétaires coutumiers p. 112
4. Les différentes manières pour résoudre
juridiquement
les conflits fonciers p. 114
Chapitre 2. Une gestion territoriale conflictuelle entre les
populations et l'Etat p. 117
1. L'exercice de l'Etat en matière de foncier : un
pouvoir à relativiser p. 118
2. Les acteurs fonciers dans le cas d'une cession de terre p.
120
3. La forêt limite-t-elle l'autorité de
l'Etat ? p. 122
Chapitre 3. Les interactions entre la gestion
coutumière et la conservation. p. 125
1. Modifier l'utilisation des forêts: le cas de la chasse
p. 126
2. L'organisation foncière de l'espace: un atout pour la
conservation? p. 129
Synthèse p. 132
Conclusion générale p. 133
Bibliographie p. 137
Liste des documents p. 141
Liste des entretiens p. 143
Annexe 1: Définitions p. 145
Annexe 2 : Entretien avec le Patriarche du clan Bafaka p.
148
Annexe 3 : Entretien avec le chef de la lignée Bokewa
p. 159
Annexe 4 : Un titre foncier coutumier p. 161
Annexe 5 : Tableau récapitulatif sur
l'évolution des principales activitées
économiques et leurs droits d'usage p. 162
Ces recherches furent une expérience marquante. Je
tiens à remercier le professeur Denis Chartier, sans qui ce stage
n'aurait pas eu lieu. Je remercie les membres d'African Wildlife Foundation et
particulièrement ma maître de stage : Florence Mazzocchetti
pour avoir pris le temps de nous aider à faire ces recherches de
terrain. Je remercie aussi Jef Dupain pour ses conseils prudents et pour cette
opportunité de stage en République Démocratique du Congo.
Je salue profondément le professeur Antoine Tabu pour m'avoir
donné de grandes indications et des aides pour mes recherches, et aussi
Théo Way Nana pour son aide et son amitié. Nombreuses sont les
personnes qui ont contribué à ce travail, d'une manière
toujours dévouée. Je pense ainsi aux gardiens de AWF qui nous ont
beaucoup appris sur les coutumes et les usages de mise auprès des
Mongo : Pitchou, Antonio, Anifa, Cobra, Guyguy et les autres. Je pense
également à Maoua et sa précieuse expérience.
Mes recherches avec les habitants du village de
Boondjé, sont dues non pas à AWF, mais au Président Daniel
Likemba Bokoto. Je peux affirmer sans le moindre doute que sans lui, ce travail
de recherche aurait été incomplet et insuffisant. Je suis dans ce
sens reconnaissant auprès de la Prodaelpi et
d'Acebo1(*). Je pense
à Valentin, Secrétaire de la Prodaelpi, et à Pierre
Bokewa, Président d'Acebo. L'accueil qui nous a été
réservé au village grâce à eux, et grâce aux
habitants a été des plus chaleureux. Merci à Jean-Robert
et Pierre de nous avoir offert un toit, et d'avoir pris soin de nous comme un
père pour ses fils. Merci également à mes compagnons de
travail : Luyéyé, l'Agronome, le chef de localité de
Boondjé, et aussi Daniel Likemba Botoko. Ce travail est pour une bonne
partie aussi le leur. Je les remercie pour tout cela.
De la même manière que l'Equateur et les
Mongo furent pour moi une découverte, la géographie en fût
une aussi pour les personnes citées précédemment. Ma
dernière reconnaissance s'adresse à cette science : la
géographie, qui apprécie les voyages.
Introduction
L'homme ne peut vivre sans la terre. Les ressources fournies
par la nature sont indispensables à sa survie, qu'il s'agisse des
activités de chasse, de cueillette ou de l'agriculture. La terre est un
des biens le plus précieux des sociétés humaines. Elle est
source de richesses autant que de rivalités. Chaque
société a besoin de terres pour vivre, et de la même
manière qu'il existe une grande variété de
sociétés, il existe presque autant de type d'occupation de
l'espace.
A l'échelle mondiale, l'histoire montre bien que les
conquêtes militaires sont la plupart du temps liées à la
volonté de s'approprier tel ou tel territoire. Pour des ressources par
exemple, ou pour des stratégies politiques. Les conflits fonciers ont
parfois des répercutions sur la géopolitique de certaines
régions. Les exemples de telles tensions ne manquent pas en Afrique,
entre des populations d'éleveurs et d'agriculteurs. Certains
problèmes locaux peuvent se transformer en conflits régionaux
plus graves comme des affrontements armés. Ces tensions sont très
fréquemment analysées comme des conflits ethniques alors qu'ils
concernent souvent des conflits d'usages sur les terres. Cubrilo M.
et Goislard C. donnent l'exemple de la région
des Grands Lacs : « les affrontements des dernières
années de l'Afrique des grands lacs ne peuvent pas être
analysés sous le seul angle des rivalités inter-ethniques. La
dimension foncière paraît constituer un élément
explicatif important 2(*) ». Les migrations (une des plus
importantes dans l'histoire) qui ont eut lieu suites aux conflits et aux
massacres dans cette région très instable de l'Afrique, entre le
Rwanda, l'Ouganda le Burundi et la République Démocratique du
Congo, posent à n'en pas douter de très graves tensions autour de
l'accès à la terre.
Le continent africain est un exemple particulier des jeux
d'échelles à propos de la question foncière. Au niveau
national, l'Etat est l'acteur foncier principal, mais contrairement à
l'Europe, d'autres types de gestions foncières existent selon les
régions. En Afrique, l'Etat a été mis en place suite
à l'implantation européenne lors de la période coloniale.
Le rôle juridique et l'organisation des pouvoirs politiques sont
hérités du droit européen. Pourtant d'autres
maîtrises foncières existent, principalement en zone rurale.
Anciennement, le foncier africain était marqué par des formes
collectives de propriétés, interdépendantes de
l'organisation sociale. La terre était perçue différemment
par rapport à la conception des Etats coloniaux. Dans la gestion
traditionnelle, la terre n'appartenait pas à l'homme, mais c'est l'homme
qui appartenait à la terre. La maîtrise foncière de l'Etat
sur les populations africaines est passée par la modification de
gestions des terres dites traditionnels ou coutumiers. Au niveau local, le
domaine foncier était régit par les sociétés
présentes sur des terres qu'elles considéraient
légitimement comme leurs propriétés.
Considérée avec mépris par les administrations coloniales,
la gestion coutumière a été volontairement
réorganisée et modifiée pour assurer la mainmise de l'Etat
sur les ressources naturelles et sur les populations locales. Aux yeux de la
majorité des européens, elle semblait
« primitive » dans un contexte où la civilisation
était signe de modernité et de nouveauté.
Il existe encore en Afrique des modes de gestion
hérités de traditions anciennes. On utilise alors le terme
coutumier. Il désigne la manière dont une population gère
localement ses territoires, avec des règles et des traditions anciennes.
Qui plus est, ce sont des règles antérieures à la
création des Etats-nations. La présence de systèmes
fonciers anciens et de la maîtrise foncière de l'Etat rend la
gestion territoriale complexe. Une grande variétée de
systèmes fonciers agissent sur l'espace. Selon les échelles, la
terre va être appropriée de différentes manières
avec des interactions et parfois des divergences sur la façon dont on
considère l'espace. La terre se retrouve donc au coeur de nombreux
conflits liés à différentes conceptions du foncier.
Présentation de la République
Démocratique du Congo.
Située en Afrique centrale, la République
Démocratique du Congo est un pays où la diversité
ethnique se traduit par une grande variétée de systèmes
fonciers, dont certains sont « coutumiers ». Ce pays
d'Afrique centrale dispose d'un territoire national très vaste : la
troisième superficie des pays d'Afrique, soit 2 345 000 km². La
population n'est pas importante, la densité de population est en effet
d'environ 27 hab./km². La majorité de la population vit en zone
rurale (68 % de la population totale3(*)) et dépend du travail de la terre et
des ressources forestières. Le territoire national de la RDC est
composé de nombreuses forêts dont le rôle est primordial
pour la survie des populations. La pauvreté étant très
importante, l'agriculture ainsi que les forêts sont bien souvent les
seules richesses dont disposent les populations vivant en zone rurale. La RDC
est située sur une partie du bassin du Congo que l'on nomme la cuvette
centrale. Celle-ci se situe dans le vaste bassin versant du fleuve Congo. Ce
bassin couvre une surface d'environ 750 000 km², et se trouve sur 9 pays
d'Afrique Centrale (RDC, République du Congo, Angola, Zambie, Tanzanie,
Rwanda, Burundi, République Centrafrique et Cameroun). Le bassin est
localisé entre les parallèles 9°N et 14°S et entre les
méridiens 11°E et 34°E. Le réseau hydrographique est
plus important que la cuvette sédimentaire, et le fleuve Congo est le
second fleuve au monde de part son débit, ainsi que le cinquième
concernant la longueur de son cours (4700 kilomètres). Du fait de ces
caractéristiques, ce bassin sédimentaire est
« l'archétype africain du climat dit
« équatorial », ou
forestier 4(*)».
Cet ensemble forestier dispose d'une biodiversité
d'intérêt mondial. On y trouve des espèces
endémiques comme certaines espèces de primates (le bonobo par
exemple). Le pays dispose dans certaines régions, d'un environnement
naturel encore préservé.
La conservation de la nature par African Wildlife
Foudation.
C'est dans ce contexte que l'ONG African Wildlife Foundation a
décidé d'agir dans la Province de l'Equateur. AWF est une ONG
internationale qui oeuvre dans la conservation d'espaces naturels. De
nationalité kenyane, elle a été créée en
1961 à l'initiative d'un groupe de chasseurs influents. Elle a pour
rôle la protection d'espaces écologiques à haute valeur en
biodiversité afin de rendre écologiquement, économiquement
et socialement viable certaines zones forestières. Le rôle d'AWF
vise à assurer la sauvegarde d'espèces animales
emblématiques telles que les bonobos, les rhinocéros et d'autres.
Cette ONG est présente dans toute la partie sud de l'Afrique (Afrique du
Sud, Botswana, Zambie, Zimbabwe, Mozambique, Tanzanie, Kenya), et depuis 2006,
elle a étendu son action à la RDC. Depuis 2002, la RDC a
établi un agenda prioritaire avec comme volonté du pouvoir
congolais en place, de faire passer la superficie nationale des aires
protégées de 8% à 15%. C'est pour répondre à
ces objectifs chiffrés que l'ONG est en charge de l'aménagement
de la Réserve de Lomako Yokokala. D'une superficie de 3600 km²,
elle s'inscrit dans une région plus vaste appelée
Maringa-Lopori-Wamba. Elle se situe dans la Province de l'Equateur. Cet
ensemble écologique a été délimité par le
Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC) qui regroupe une
trentaine d'OG et d'ONG dont le but premier est de mettre en place des
programmes de conservation et de gestion durable des forêts du bassin du
Congo. AWF est chargée de coordonner les actions dans le paysage M.L.W.,
avec des partenaires tels que USAID avec le programme Central Africa Regional
Programme for Environment (CARPE), ou encore avec l'Agence Française de
Développement (FFEM). Le tout sous contrôle de l'Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). La totalité du
paysage est concernée par les programmes de conservation, avec la
réalisation de mosaïques de conservation, avec des zones de chasses
communautaires, ou encore avec la mise en place de forêts communautaires.
D'une manière générale, il ne s'agit pas de faire de la
conservation strictement in situ. Les besoins en développement
économique sont importants pour les populations, et les acteurs
environnementaux en ont conscience
Comment affirmez vous ça (source de l'info).
. Cela concerne par exemple le rétablissement des
échanges commerciaux. En effet, l'impact des problèmes politiques
des dernières guerres a bouleversé les activités et la
pression sur les milieux forestiers. Ainsi, avec les difficultés de
transport, les filières agricoles ont été stoppées
lors des guerres, et il y a depuis cette période une forte
prédominance de la chasse, qui concerne la totalité de la
région. D'où la volonté de développer des
infrastructures et des mesures économiques pour rétablir et
réactiver les anciennes structures économiques.
De nombreuses populations se trouvent dans la Province de
l'Equateur. La plus importante est la population Mongo. Issue du grand groupe
Bantou, elle représente la grande majorité du peuplement de la
région. En terme de population, c'est la troisième ethnie de la
RDC. La conservation nécessite de prendre en compte la manière
dont les populations locales perçoivent et utilisent leurs territoires.
Le foncier est donc un domaine à intégrer dans la mise en place
de zones protégées et de politiques de développement.
Entre la gestion des terres par l'Etat et les
pratiques foncières locales, comment est géré le domaine
foncier ? Quel est l'intérêt de comprendre le domaine foncier
pour la conservation ? Nous essayerons de répondre
à ces questions dans ce mémoire.
Cette étude s'articule en trois grands axes. Tout
d'abord, l'analyse va concerner les outils juridiques nationaux mis en place
dans la gestion foncière des terres sur une échelle de temps
large, allant de la période pré-coloniale jusqu'à
aujourd'hui. Puis, après une présentation de l'ethnie Mongo, nous
allons voir comment sont gérées les terres à une
échelle locale, et dans quelle mesure ce système foncier est
interdépendant de l'organisation sociale des populations Mongo. Puis,
une troisième partie va décrire les tensions relatives à
la terre, avec des exemples détaillés. Les relations antagonistes
entre les deux systèmes fonciers seront analysées. Nous verrons
également comment la conservation s'intègre dans ce contexte
foncier, et en quoi les pratiques foncières locales sont importantes
à connaître pour mettre en place des politiques de conservation
efficaces ?
Méthodes de recherche.
Ces questions font suites à une demande d'AWF
consistant à comprendre les pratiques foncières des populations
Mongo. C'est par l'intermédiaire d'un stage de terrain que les
recherches présentes dans ce travail ont pu être
réalisées. AWF a demandé que des recherches soient
entreprises en zone forestière pour mieux comprendre les règles
coutumières encadrant la gestion des terres et les droits d'usages des
populations Mongo. C'est suite à cela que ces recherches ont
été entreprises. Les données ont été
obtenues par le biais d'entretiens et d'observations auprès de la
population Mongo. L'analyse des différents outils législatifs
concernant la propriété de la terre a été un
préalable aux recherches de terrain avec la population locale, tout
comme la littérature concernant les Mongo. C'est donc en partant d'une
approche nationale que le champ d'étude s'est ensuite centré sur
une zone précise : le territoire de Basankusu. Cela a permis
d'avoir une vision plus générale de la gestion foncière
pour ensuite la confronter à la réalité vécue par
la population. Les observations ont été obtenues avec la
participation des habitants d'un village, tant pour la réalisation de
cartes participatives que pour la compréhension de l'organisation
sociale. Cela a nécessité la collaboration d'un interprète
originaire du village dans la mesure où il n'est pas évident de
se faire accepter sans avoir le soutien d'une personne qui connaisse la
population locale. C'est par cet interprète (M. Daniel Likemba Botoko)
que le village de Boondjé a été choisi. Des raisons
techniques ont également été prises en compte pour ce
choix, telles que la proximité d'un centre urbain, l'accès par
une route en bonne état, ou de la bonne réputation du village
dans la région.
Lors de ces recherches de terrain, l'approche a
consisté à rencontrer les acteurs en matière
foncière : aussi bien les ayant droit coutumiers que les personnes
en charge du domaine foncier dans les administrations de l'Etat. Cette approche
par le droit a pour but de confronter une réalité
législative à la pratique locale. L'approche juridique a donc
été complétée par une approche sociologique pour
comprendre le niveau local, lié à l'imbrication entre la
société et la propriété de la terre. De nombreuses
autres données ont été obtenues lors des recherches de
terrain, par exemple, celles relevant de l'histoire.
Etat de la littérature.
Le foncier en zone rurale africaine est un domaine où
de nombreux travaux de recherches ont été effectuées. La
littérature est donc abondante. On trouve par exemple les publications
des éditions Karthala : avec Le Roy E., Le
Bris E., ou encore Karsenty A.. Cependant, elles
concernent très souvent l'Afrique de l'ouest (pour la
littérature en langue française). Peu de recherches
récentes concernent la République Démocratique du Congo,
particulièrement, sur le domaine foncier et sur la gestion des terres
coutumières. Cela peut en partie s'expliquer par les différents
conflits armés qui ont concerné la région depuis plus de
dix ans. Une littérature abonde sur la population Mongo, liée
essentiellement aux travaux des pères missionnaires Hustaert
G. et Boelaert E. et à des recherches
effectuées lors de la période coloniale, et après
l'indépendance. Ces recherches sont cependant anciennes et à
l'heure actuelle, le foncier des populations Mongo n'a pas vraiment fait
l'objet de recherches. Il existe une littérature abondante sur les
écosystèmes forestiers, et d'une manière
générale sur la faune et la flore de cette partie du bassin du
Congo, mais concernant les populations, il semble y avoir un déficit.
Définitions des principaux termes
utilisés.
Par définition, la société est une
collectivité régit par des institutions, ce qui renvoie à
des liens de solidarités, des échanges, et à une
organisation spécifique. Pris dans sa généralité,
le foncier peut être défini comme les rapports entre une
société et l'espace. Le foncier est interdépendant de
l'organisation sociale. En effet, il est avant tout un « fait
social » qui traduit comment les populations perçoivent
l'espace. Toute société est installée sur un territoire et
ce sont les interactions entre l'homme et l'environnement qui permettent de
comprendre une organisation foncière. Cette organisation se traduit par
des rapports sociaux, par une structure sociale ou encore par des règles
précises. Le domaine foncier renvoie à la propriété
de la terre. Ce domaine étant très large, il ne se limite pas
à la sociologie. D'autres aspects sont importants tels que les aspects
juridiques, politiques, ou encore économiques. Il est donc
nécessaire d'avoir une approche pluri-disciplinaire pour mettre en
évidence la manière dont les hommes vivent avec leur
environnement, ainsi que la répartition des terres. L'histoire est
également une discipline à intégrer dans une étude
sur le foncier, car la propriété des terres n'est jamais
figée. Elle s'adapte et s'intègre à un contexte
précis. La manière dont chaque société, ou chaque
communauté utilise la terre est appelée l'appropriation. De
racine latine, cette notion traduit l'action de rendre propre à un usage
(cf. Annexe 1, Définitions des termes clefs, p.
145-148). Il va donc exister des règles précises pour
encadrer l'accès à la terre. Ces règles sont juridiques et
elles sont gérées par certaines autorités. La
maîtrise de la terre est très souvent le rôle de l'Etat.
Cependant, il existe différentes échelles d'analyse du foncier. A
l'échelle locale, la gestion des terres peut être pratiquée
de manières différentes.
La compréhension du foncier est toujours difficile car
elle englobe de nombreux domaines. Ces recherches ne sont donc qu'un
aperçu du foncier chez les populations Mongo. Ce travail ne
prétend pas décrire une situation homogène, notamment car
les situations varient d'une région à une autre, et aussi parce
que la diversité ethnique au sein des Mongo est importante. Selon les
groupes sociaux, la gestion foncière peut être différente.
Certains aspects liés au foncier ne sont donc qu'abordés
brièvement, comme le droit juridique coutumier.
PARTIE I:
Le rôle de l'Etat en matière
foncière depuis la colonisation jusqu'à
la République Démocratique du
Congo
Le terme foncier est étymologiquement lié au
domaine juridique. La gestion des terres est en effet toujours mis en relation
avec le droit. Il peut y avoir différents types de droit pour encadrer
le foncier. L'Afrique dans son ensemble a été marquée dans
son histoire par des apports voulu ou non, entre un droit dit traditionnel et
le droit européen (à l'origine) sur la propriété
des terres.
Comment la propriété de la terre a-t-elle
été gérée de l'arrivée des européens
jusqu'à aujourd'hui ?
Quelle est la coexistence du droit écrit et du droit
oral ?
Nous allons donc nous pencher sur la gestion coloniale de la
propriété de la terre, puis nous verrons la législation
contemporaine concernant le foncier en RDC. D'abord avec les lois
foncières et le code forestier ensuite, en analysant les rapports entre
la législation et les terres rurales.
Chapitre 1
La propriété de la terre lors de la
période coloniale :
Un autoritarisme foncier
La colonisation du Congo débute officiellement le
1er août 1885, date où Léopold II de Belgique
devient roi et seul propriétaire de l'Etat Indépendant du Congo
et elle prend fin le 30 juin 1960. Cela marque la création de la
première République du Congo.
Cette période de 75 ans donne naissance à de
nombreuses modifications. Ce sujet étant vaste, l'analyse ne va
concerner que le domaine du foncier, de l'appropriation des terres, et la
manière dont l'administration coloniale va considérer les
« indigènes », que l'on pourrait appeler aujourd'hui
les « autochtones », ou les congolais.
Il est également important de préciser que
l'Etat Indépendant du Congo n'est pas sous l'autorité de l'Etat
belge, mais il est l'entière propriété privée de
Léopold II. Il faudra attendre l'année 1908 pour que l'Etat
Indépendant du Congo soit remplacé par le Congo Belge.
1. La période
pré-coloniale.
L'organisation politique des populations avant la
période coloniale est marquée par une ancestralité forte.
Les pratiques semblent pour le colonisateur exister depuis des temps
très anciens, et elles se reproduisent sur un schéma
hérité de la tradition. Cette vision d'une
« stagnation » n'est pourtant pas exacte dans la mesure
où de nombreuses études postérieures montrent les
évolutions de peuplement pour la seule province de l'Equateur
5(*).
Néanmoins, le rôle des traditions est très fort : il
organise les rapports sociaux, les rapports avec la terre, avec le domaine
religieux, etc. Le village est selon les traditions l'unité politique
très prédominante, « et chaque village est
indépendant » selon C. Ibañez de
Ibero. Il ajoute aussi que l' « on rencontre
parfois une sorte de fédéralisme
« anarchique » assez curieux, quand plusieurs
agglomérations se rattachent entre elles pour des objets divers et par
accords volontaires 6(*)».
L'autorité à l'échelle du village est
représentée par un patriarche, qui est la personne dont
l'autorité est la plus forte. C'est lui le garant du respect de la
coutume. « Il exerce la police et en qualité de
représentant de la communauté est propriétaire du sol non
bâti dont les familles ne sont que les usufruitières. Il a parfois
comme sanction de ses pouvoirs, le droit de vie ou de
mort 7(*)». Néanmoins, l'autorité du
chef, bien que située en haut de la hiérarchie se voit tout de
même « limitée par une assemblée à
laquelle tous les hommes libres [surtout les notables] peuvent prendre
part et qu'on appelle palabre 8(*)».
Concernant l'organisation du foncier par rapport aux coutumes,
la terre appartient à l'autorité la plus forte du village. Les
terres peuvent être allouées ensuite aux familles, ou à
d'autres entités. Mais elles n'en sont pas les propriétaires
exclusives. Ce système doit permettre une gestion conforme aux coutumes,
et donc, conforme également aux pratiques des ancêtres. En effet,
les ancêtres ont une forte importance dans la vie religieuse, et comme le
fait religieux est un élément lui aussi très important
dans les coutumes, et dans la vie de ces populations, cela peut expliquer
certains rapports à l'espace, à la terre, aux fleuves et aux
cours d'eau, aux forêts.
2. La colonisation : les relations entre
l'administration coloniale et les populations locales.
A. Une gestion souple en théorie : 1885-1891.
Les chefs traditionnels sont les représentants directs
des populations de l'Etat Indépendant du Congo. Ils ont
été en contact avec le pouvoir royal belge. Cela explique que
l'Etat colonial ait dû mettre en place des lois, des décrets pour
gérer la question du pouvoir et de la souveraineté. Toujours
selon Ibañez de
Ibero C. : « la plupart des chefs
indigènes ont conservé en grande partie l'autorité dont
ils étaient pourvus avant la création de l'Etat
indépendant ». Il ajoute aussi que
certains chefs ont été officiellement reconnus par le
Roi-souverain, dans ce cas leur autorité a été
préservée.
Les populations indigènes sont autorisées
à disposer librement de leurs terres. Sur leurs propriétés
collectives, elles peuvent donc pratiquer librement l'agriculture, la
cueillette, le commerce des produits naturels du sol, la chasse, etc. Par
ailleurs, elles ne peuvent pas être expropriées par un colon sans
l'autorisation du chef de village. Le chef peut ainsi traiter avec le colon
pour l'achat ou la location de parcelles. Cette politique ne va concerner
qu'une brève période, car le décret qui suit va modifier
ces rapports, en défaveur des populations locales. Lors de cette
période, on constate peu de restrictions. L'Etat participe au bon
maintient des rapports entre les colons et les populations locales. Personne ne
peut empêcher les populations de pratiquer leurs activités
économiques, et les usages locaux sont donc permis. Par exemple,
l'Ordonnance du 1er Juillet 1885 et les décrets des 17
décembre1886 et du 8 juin 1888 autorisent les populations à
exploiter les mines dont elles disposent 9(*).
La réalité des décrets cache une
vérité moins visible au seul regard des textes de lois. En effet,
cette période est marquée par le travail forcé pour
la récolte de ressources précieuses (caoutchouc pour l'essor de
l'industrie automobile, ivoire, produits agricoles, etc.). Les populations
locales ont des quotas sur ces ressources qu'elles doivent remettre aux
administrateurs, sous peine de « sanctions », autrement dit
des pillages, des meurtres, voire même des guerres. Ainsi, un grand chef
coutumier du nom de Wéssé refusa de payer le tribut imposé
par les colons belges, et il entra en guerre dans le Territoire de Basankusu
lors de cette période. Ce fût un des Territoires de l'actuelle
Province de l'Equateur où les postes de commerce fûrent les plus
nombreux, et cela très tôt. Par exemple, en 1895, la ville de
Basankusu disposait de 11 postes commerciaux, soit plus que toute autre ville
de cette vaste région.
Néanmoins, cette politique coloniale concernant la
législation n'a pas perduré car elle n'était pas assez
influencée par des considérations économiques et
budgétaires aux yeux du propriétaire. En effet, le Roi
Léopold II va rapidement changer ces rapports. Il se rend compte que
cette politique est coûteuse et qu'elle ne permet pas à ses
caisses personnelles d'augmenter significativement. D'où
l'émergence d'une nouvelle politique, encore moins tolérante et
plus motivée par le commerce.
A. Le durcissement de la politique
coloniale :1891-1910.
1. Les nouveaux décrets
Le décret du 6 octobre 1891 est le
principal changement d'orientation des rapports avec les populations locales.
Il est annoncé que :
§ Article 1 : « dans les
régions déterminées par le gouvernement
général, les chefferies indigènes seront reconnues comme
telles, si les chefs ont été reconnus par le Gouverneur
général, ou en son nom, dans l'autorité qui leur est
attribuée par les coutumes ».
§ Article 5 : « les chefs
indigènes exerceront leur autorité conformément aux us et
coutumes, pourvu qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public et
conformément aux lois de l'Etat. » Ils sont donc
placés « sous la direction et la surveillance des
commissaires de districts ou de leurs
délégués ».
Ce décret, qui fixe les modalités de
reconnaissance des droits coutumiers au sens large, a été ensuite
complété par un arrêté du Gouverneur
général daté du 2 janvier 1892. Cet arrêté
donne des compétence aux commissaires de districts, à certains
fonctionnaires qui sont désignés par le Gouverneur
général pour que ceux-ci puissent « accorder aux
chefs indigènes reconnus comme tels, et dont ils jugeront
l'autorité suffisamment établie, l'investiture
prévue 10(*)». C'est donc le roi Léopold II
et son administration qui décident eux-mêmes quels acteurs doivent
bénéficier de l'autorité. Selon une stratégie
géopolitique, des personnes plutôt favorables à la
politique coloniale (les chefferies, sous-chefferies) auront la
préférence des autorités. Les deux photographies
ci-dessous rendent compte de deux types d'acteurs politiques : à
gauche, on observe un chef nommé par l'administration coloniale en tenue
européenne entouré de soldats coiffés . Le
cliché traduit un certain asservissement. Sur la photographie de droite,
on peut voir un chef coutumier, avec certains attributs traditionnels et
guerriers ( peau de léopard , lances) : chaque notable en haut de
la hiérarchie sociale a des pouvoirs politiques, guerriers et
religieux.
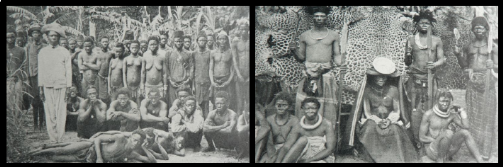
Photographie 2 : Photographie
3 :
Chef nommé par l'administration coloniale.
Chef coutumier avec ses femmes et ses
(Territoire d'Oshwe, 1920, Van Der Kerken)
guerriers. (Territoire d'Inongo, Van Der Kerken)
Un autre décret revêt une importance dans
l'évolution de ces rapports : le décret du 21
septembre 1890. Pourtant ce décret ne fut jamais officiellement
publié. Néanmoins il va influencer la politique envers les
populations locales 11(*).
Par ce décret, les terres du Congo deviendront la
propriété du Roi des belges, exceptées quelques
manufactures de l'actuel Bas-Congo. Ce décret comportait plusieurs
interdictions, dont l'une concernait l'interdiction aux indigènes de
prélever deux ressources : l'ivoire et le caoutchouc. Ce
décret stipule que ces prélèvements sont autorisés
dans les zones cultivées et dans les zones d'habitations. Autrement dit,
l'interdiction est quasi-totale car c'est dans les zones forestières,
les plaines, les savanes ou les marais que se trouvent les hévéas
et les éléphants.
Cette interdiction provoqua une grande polémique chez
les commerçants européens. Voici le discours du président
de la Société du Haut-Congo Brugman M., lors
d'une assemblée générale des actionnaires :
« Défendre aux indigènes de vendre
de l'ivoire et du caoutchouc provenant des forêts et des savanes de leurs
tribus et qui font partie de leur sol héréditaire est une
véritable violation du droit naturel. Défendre aux
commerçants européens d'échanger avec les indigènes
cet ivoire et ce caoutchouc, les oblige à acheter des concessions pour
commercer avec les natifs, est contraire à l'esprit et au texte de
l'acte de Berlin12(*), qui a proclamé la liberté
illimitée pour chacun de commercer et interdit la création de
monopole13(*)».
Brugman M. émit un certain nombre de
plaintes juridiques qui remontèrent en Europe. Suite à cela, un
nouveau décret daté du 30 octobre 1892 fut mis
en place pour répondre au problème de la propriété
de la terre. Ce décret aborde la question difficile de la
domanialité des terres vacantes. L'Etat ayant considéré
que la grande partie des terres « inoccupées » par
les populations était sa propriété.
Pourtant les terres vacantes au sens premier du mot n'existent
pas. La terre ou la forêt qui n'est pas visiblement habitée est
pourtant la propriété d'un groupe, d'un clan, ou d'une personne.
L'ambiguïté vient du type de propriété présent
dans la majorité du bassin du Congo. La propriété est
perçue comme définitive et stable, « les
indigènes la connaissent sous la forme collective, la communauté
étant le village ou la tribu. Cette propriété
s'étend d'ordinaire sur tout le territoire sur lequel le chef exerce sa
juridiction. Les limites sont d'ailleurs nettement
définies 14(*)».
2. La répartition des terres vacantes.
Le décret réparti ces terres en trois
zones :
§ La zone libre : c'est la plus petite
proportion car elle concerne environ 16% du total des terres. On y autorise par
exemple la récolte libre du caoutchouc pour les colons et les
populations locales.
§ Le domaine privé : C'est la plus
grande partie concernée, elle englobe la grande majorité des
terres soit plus de 65 % de la superficie totale du pays. C'est une zone
commerciale, et les sociétés concessionnaires (des
sociétés propriétaires et/ou commerciales pratiquant des
activités soit forestières, soit agricoles) ont
l'exclusivité du droit à exploiter certains produits agricoles.
Dans cette zone, l'exploitation libre par les populations est interdite.
§ La zone provisoirement
réservée : il y a peu d'informations sur cette
dernière catégorie, et il ne m'est pas possible de définir
quel est son but, peut être pour la chasse ? Néanmoins c'est
une petite superficie qui est concernée par rapport aux deux autres
zones.
Plusieurs modifications seront apportées à ce
texte, telles que la création du domaine de la couronne en 1896, aux
dépens du domaine privé et de la zone libre.
Il ressort de ce texte que sur une surface d'environ 85 % du
territoire national, les populations locales n'ont plus le droit de vendre
leurs ressources, sauf l'ivoire et le caoutchouc, qui sont tous deux des
produits à forte valeur ajoutée. L'ivoire pour les bijoux, et le
caoutchouc pour les besoins croissants de l'industrie (par exemple l'industrie
automobile). Ces deux produits ont donc constitué un monopole pour tout
le commerce du pays, malgré le non-respect de l'Acte de Berlin qui
définissait les règles pour le commerce des pays signataires.
Cette période a donc augmenté les restrictions
sur les activités et sur la survie même des populations locales.
Que ce soit au niveau politique avec le contrôle colonial des chefferies,
ou encore avec les interdictions fortes sur le commerce, la
propriété de la terre est au coeur de ces problèmes car
c'est par l'expropriation foncière que peuvent ensuite se mettre en
place les politiques coloniales. On change volontairement les rapports à
la terre pour servir l'intérêt de la puissance coloniale.
B. La politique coloniale de l'Etat Belge.
Le 18 novembre 1908, sous la pression
internationale menée par le Royaume-Unis, la Belgique est contrainte
d'assumer le Congo, alors qu'elle était plutôt réticente
à l'annexion. Le contexte créé par le roi Léopold
II rendit l'Etat belge plus tolérant dans sa manière de
gérer cette nouvelle colonie15(*).
Un décret fut donc promulgué, c'est le
décret du 10 mai 1910. Il marque le changement de
politique par rapport à la période précédente
marquée par le travail forcé, les tortures, etc. On donne
quelques droits aux populations, et on cherche à rendre plus efficace et
plus légitime l'administration coloniale.
Un fait important est également la mort en 1909 de
Léopold II, ce qui amène son neveu Albert 1er
à sa succession. Il hérite ainsi d'une situation difficile et il
entreprend un assouplissement du droit envers les populations locales et envers
le rapport à la terre.
1. La réorganisation des pouvoirs coutumiers.
Celui-ci organise la répartition politique des
autorités coutumières. On répartie les pouvoirs selon deux
niveaux différents : les chefferies et les sous-chefferies. Les
limites territoriales de ces autorités coutumières
« sont déterminées par le commissaire de
district 16(*)».
L'apport de ce décret est important. Tout d'abord, il a
différents buts :
§ Il facilite le prélèvement des
impôts ;
§ Les chefferies deviennent un moyen de contrôle du
colonisateur, en passant par les structures coutumières pour avoir une
autorité plus légitimée ;
§ L'autorité de certains chefs se voit
renforcée.
Ce décret a pour but de fixer les populations sur un
territoire donné. Bien que la notion de territoire soit présente
dans la gestion coutumière pré-coloniale, celle-ci se voit
consolidée de manière volontaire. C'est donc une stratégie
politique qui donne des moyens de contrôle sur les populations
indigènes. Ce contrôle des populations a été
critiqué par certaines personnes comme le Père Hustaert
G. : « Beaucoup de villages ont été
déplacés pour la facilité de la surveillance ou de la
circulation établie sur les domaines d'autres clans
17(*)». Des recensements sont
effectués, et cela permet de fixer les populations sur des espaces
délimités. Ainsi, pour qu'une personne puisse quitter telle ou
telle circonscription, il faut passer par le commissaire de district pour
obtenir son avis. Voici comme un chef de clan parle de la réorganisation
des terres claniques :
« Quand les blancs, les belges sont venus, ils
dirent : « Non, nous ne pouvons pas continuer à
marcher dans des pistes en se communiquant entre nous par
Lokolé18(*). Des ruelles ! » Les
blancs ont vu qu'ils devaient passer par-ici, par-là. Ils
dirent : « ça ne va pas. Faisons une route pour que
les hommes puissent s'aligner ». Lorsqu'on les a alignés, ce
clan [sur la carte], on les a fait sortir ici. Celui-ci se met ici. La
terre ici c'est pour ce clan. La terre ici appartient à ce clan. Le clan
est là, quand on le fait sortir, on trouve un autre clan. On le
superpose. Ils sont seulement là pour habiter, mais les terres sont
propres aux autochtones. Pour qu'ils aient une place pour faire les cultures,
ils doivent demander aux autochtones. C'est ainsi que se déroulaient les
choses 19(*)».
« Les notables de chaque clan : clan de
Bafaka, clan de Bonsombo se réunirent et se demandèrent :
que pouvons nous faire ? Nous avions été là-bas
[dans l'éladji], et nous sommes maintenant venu. Bolongo
boi c'est l'alignement ancien et Bolongo boné c'est cet
alignement. L'alignement où on a tué Elumbu19(*). Quand on fait
l'alignement on fait étondo20(*). Le clan de Bafaka voilà votre
piquet 21(*). Bonsombo voilà votre piquet. Les
gens étaient brutaux. Où se limite le clan Bafaka ?
Venez ! Où se limite le clan Bonsombo ? Venez ! Nous
sommes maintenant dans un nouvel alignement. Toi, ta femme et tes
enfants : mets toi ici ! Toi, ta femme et tes enfants : mets toi
ici !, etc. fin. Mon père était le maître de cette
opération 22(*)».
La référence au terme de
« piquet » traduit bien cette répartition des clans
sur les axes routiers nouvellement créés. Les gens vivaient de
manière plus homogène sur l'espace, alors que la vie le long des
routes pouvait poser des problèmes fonciers pour certains clans.
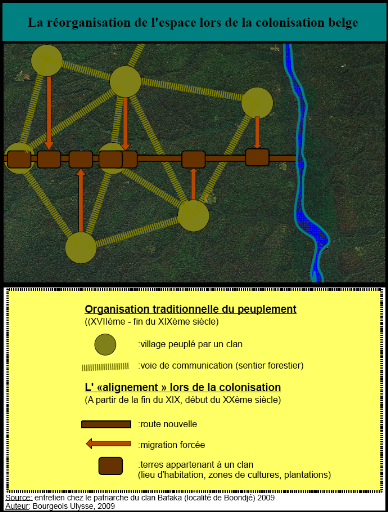
Figure 1.
Comme on peut le voir sur ce document, certains clans n'ont
pas eu besoin de changer de terres. Mais d'autres ont été
obligés de partager l'espace devenu plus restreint :
« C'est là où se posent des
problèmes. Alors on allonge le clan. Et ceux-ci peuvent se mettre ici.
Alors ils ont juste la partie de terres pour leurs habitations et les
installations hygiéniques et consort. Mais ils n'ont pas la partie de
terre pour cultiver. Alors pour cultiver là-bas, ils doivent demander
aux autochtones 23(*)».
Il est fort probable, que des notables ou des chefs qui ont
obtenu certains droits spécifiques de
« délégation de l'autorité », devaient
régner sur des régions vastes et stratégiques
économiquement. En effet, vu la grandeur du pays concerné par le
colonisateur, il est peu plausible que tous les chefs aient
bénéficié de ce décret.
Les attributions des chefferies et des sous-chefferies sont
aussi définies par le colonisateur. Elles doivent par exemple
« débrousser les alentours des villages et (...)
maintenir ceux-ci dans un état constant de propreté :
elles doivent également aménager ou entretenir, moyennant
rémunération des travailleurs par l'Etat, les chemins, ponts,
passages d'eau, gîtes d'étapes, et construire ou entretenir au
chef-lieu du ressort une école et une habitation à l'usage des
agents européens de passage 24(*)». Cette citation
illustre très bien comment le pouvoir colonial conçoit de
rôle des chefferies. Elles sont aussi des lieux par où passe la
modification culturelle des populations, c'est le cas précisément
avec l'école. Et ces modifications passent par l'édification de
routes pour faciliter les déplacements, notamment commerciaux
liés à l'esclavage. Le rôle de la route est
déterminant dans la mesure où elles sont aussi des
éléments de contrôle comme on peut le voir sur le
schéma ci-dessus. L'entretien des routes était souvent à
la charge des villages sous peine de sanctions par l'administration. La
création des routes était sans doute réalisée
grâce au travail forcé. Voici certaines photographies prises par
Van Der kerken probablement dans les années
1920-1930 :

Photographie 4 :
Construction d'une route en zone de forêt
inondée
(Bassin de la Lomela : Territoire de Boende, Van Der
Kerken)

Photographie 5 :
Route traversant le village des
Basengere
(Territoire d'Inongo, Van Der Kerken)
Parmi les autres mesures mises en place par ce décret,
on peut également citer la suppression des impôts de travail ou
encore le droit de disposer des produits du sol.
2. Le droit d'usage sur les ressources.
Concernant ce dernier point, un autre décret vient le
compléter : le décret du 22 mars 1910 qui
traite de la récolte des produits végétaux dans les terres
appartenant à l'Etat. Cela ne restitue pas la propriété
collective de ces terres aux populations locales, mais une avancée est
tout de même à noter. Les populations peuvent à nouveau
disposer librement des produits du sol. L'Etat est donc le propriétaire
mais l'usufruit est en principe laissé aux populations. Pourtant,
ces droits ne sont pas gratuits, et la personne qui désire
récolter certaines ressources doit payer à l'Etat une certaine
somme, par an pour le copal et le caoutchouc. Il est également possible
de payer une personne pour qu'elle récolte les produits voulus. D'autres
cas existent où les populations ne payent pas d'impôts pour leurs
activités (hors exploitation forestière) : lorsque celles-ci
n'exportent pas leurs récoltes.
Cela est très bien résumé dans les termes
de Durpiez M., qui fût un administrateur colonial
à cette période :
« La colonie propriétaire des terres
domaniales croit que le meilleur mode d'usage qu'elle puisse faire actuellement
de son droit de propriété c'est de permettre à tous,
indigènes ou non indigènes, moyennant des conditions diverses, de
récolter les produits végétaux naturels : mais elle
n'entend pas par là restreindre en quoi que ce soit son droit de
propriété. Elle veut pouvoir dans la suite aliéner des
terres domaniales, à titre onéreux ou à titre gratuit au
profit d'individus ou de communautés indigènes ou non
indigènes, donner ces biens domaniaux en location ou concéder des
droits de jouissance exclusive sans grever les futurs propriétaires ou
occupants de l'obligation de respecter le droit de
cueillette 25(*)».
Il est important de préciser que malgré la mise
en place de ces décrets dans le droit et au sein du pouvoir colonial,
ceux-ci mettront parfois du temps à être appliqués
concrètement. Ainsi les décrets sur la création des
chefferies ne se feront pas toujours facilement, et de nombreuses guerres ont
eu lieu. Surtout concernant l'exploitation forcée du caoutchouc, qui
fût une pratique dans les règles de l'esclavage.
On perçoit bien comment l'administration entend
gérer ses propres terres. Après avoir
dépossédée certaines populations de leur territoires
coutumiers, elle donne des droits restreints, mais pas autant que lors de la
période du règne de Léopold II où la situation
était très dure, dictatoriale même. Néanmoins, le
fait de concéder des terres aux populations locales est un changement
juridique qui perpétue la domination coloniale sur les populations. Les
moyens juridiques se révèlent donc des instruments politiques
puissants pour permettre la libre disposition des forêts par l'Etat, et
pour les compagnies privées.
Les quelques avancées énumérées
ici sont tout de même à relativiser dans la mesure où les
droits fonciers sont volontairement bouleversés pour servir les
intérêts géopolitiques de la colonie, et où la
coutume est perçue par l'administration comme une gêne et un
danger. C'est un mode de gestion à moderniser par
l'européanisation, tant pour l'appropriation des terres, que pour le
contrôle politique, ou encore simplement par volonté de changer la
culture des populations avec des jugements de supériorité
liés à la civilisation européenne.
Chapitre 2
Les différentes lois régissant le foncier
en zone rurale
1. La nouvelle constitution et la gestion des terres
coutumières.
La constitution d'un pays est toujours l'élément
fondamental du droit. Celle en vigueur en RDC a été
officialisée le 18 février 2006 après un
référendum. Elle a pour but de définir les bases de
l'organisation de l'Etat mais aussi de répondre aux problèmes de
légitimation du pouvoir suite aux guerres entre 1996 et 2003.
Il ne s'agit pas ici d'analyser en détail son apport
par rapport à la constitution antérieure, ou bien de discuter sur
tous les points précis mentionnés dans cette constitution. Nous
allons nous contenter de porter notre attention sur les articles qui concernent
la coutume. La coutume étant considérée comme un mode de
gestion des terres, avec son droit, ses acteurs, etc. La constitution dans ce
sens tente de reconnaître et d'harmoniser les rapports entre la coutume
et l'Etat.
A. L'autorité coutumière.
Article 207 (Titre III, chapitre 2, section 3) : De
l'autorité coutumière.
« L'autorité coutumière est
reconnue.
Elle est dévolue conformément à la
coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la
Constitution, à la loi, à l'ordre public et aux bonnes
moeurs.
Tout chef coutumier désireux d'exercer un mandat
public électif doit se soumettre à l'élection, sauf
application des dispositions de l'article 197 alinéa 3 de la
présente Constitution.
L'autorité coutumière a le devoir de
promouvoir l'unité et la cohésion nationales.
Une loi fixe le statut des chefs
coutumiers. »
La coutume est perçue selon la constitution comme une
autorité, au même titre que l'Etat, les institutions provinciales
ou encore les autorités locales. Ces dernières peuvent ainsi
être les territoires, les groupements ou les localités (les
villages). La coutume représente donc un pouvoir, et elle a le devoir de
s'intégrer à l'Etat, et par conséquent, elle ne doit pas
s'opposer à la République et à l'exercice du pouvoir.
C'est ce que stipule l'article 63 (Titre II, chapitre
4) :
« Toute autorité nationale, provinciale,
locale et coutumière a le devoir de sauvegarder l'unité de la
République et l'intégrité de son territoire sous prix de
haute trahison. »
B. Le droit coutumier.
Chaque coutume ayant son propre mode de fonctionnement
juridique, il existe des interactions avec l'Etat. La constitution n'oppose
donc pas la justice d'Etat à la justice coutumière. L'Etat
intervient donc dans l'exécution du droit coutumier. A une
échelle provinciale et non nationale, comme le précise
l'article 204 (Titre III, chapitre 2, section 2) :
« Sans préjudices des autres dispositions
de la présente Constitution, les matières suivantes sont la
compétence exclusive des Provinces :
(...)
28 : l'exécution du droit
coutumier. »
C. La propriété.
Le mode coutumier de gestion concerne aussi la
propriété de la terre, et la présente constitution
reconnaît deux modes d'acquisition des terres : l'une se base sur le
droit écrit (la loi) et l'autre se base sur la coutume (le plus souvent
oralement, et très rarement de manière écrite). Voici ce
que précise à ce sujet l'article 34 (Titre III,
chapitre 2, section 3) :
« La propriété privée est
sacrée. L'Etat garanti le droit à la propriété
individuelle ou collective acquise conformément à la loi ou
à la coutume. »
La constitution de la RDC intègre donc le mode coutumier
de gestion des terres. Le foncier est régit administrativement par
différentes lois, certaines sont anciennes comme le code foncier, ou
récente comme le code forestier.
2. La loi de 1973 : une
référence.
La principale loi qui établit le droit foncier à
l'échelle nationale est la loi 73-021 portant sur le
régime général des biens, sur le régime foncier et
immobilier et sur le régime des sûretés. Elle
a été mise en place le 20 juillet 1973. C'est aujourd'hui encore
la loi de référence en matière foncière. Cette loi
englobe de nombreux domaines comme la propriété des biens,
l'immobilier, le droit concernant les concessions, le régime des
sûretés26(*), la question du droit coutumier, etc.
Lors de cette analyse nous allons nous concentrer sur le droit
foncier en milieu rural, forestier, et sur la manière dont la loi aborde
le droit coutumier.
A. Le milieu rural.
1. Définitions de la propriété.
Il est définit par le droit, en rapport avec la
définition de l'urbain. « Les terres urbaines sont celles
qui sont comprises dans les limites des entités administratives
déclarées urbaines par les lois ou les règlements en
vigueur. Toutes les autres terres sont rurales. Selon leur vocation, les terres
sont destinées à un usage résidentiel, commercial,
industriel, agricole ou d'élevage 27(*) ».
Ces terres sont définies comme la
propriété de l'Etat. Il y a deux types de
propriétés sous l'autorité de l'Etat :
§ D'une part, le domaine foncier public, qui concerne
« toutes les terres qui sont affectées à un usage
ou à un service public 28(*)», il peut s'agir
d'une entreprise sous contrôle de l'Etat, ou encore d'un bâtiment
ministériel.
§ D'autre part, le domaine privé de l'Etat
correspond à toutes les autres terres29(*). C'est la même
manière de procéder que pour le milieu rural : le
privé est définit en fonction du domaine public.
2. Les terres agricoles.
Il y a différentes manières d'attribuer la terre
pour les activités de culture ou d'élevage. La première
concerne les superficies importantes (de plus de 10 ha). Elles
nécessitent au préalable un titre d'occupation provisoire pour
ensuite être concédées, c'est-à-dire
possédées légalement. Pour qu'une personne dispose de
terres pour l'agriculture ou l'élevage par exemple, elle doit payer un
loyer progressif pendant 5 années. Ce loyer ne peut être plus
élevé que 5% du prix du terrain concédé pour la
4ème année. Ce droit d'occupation provisoire est
fixé par les articles 155 et 156. Après la
période obligatoire de cinq ans, la personne peut acheter les terres
qu'elle occupe au prix fixé lors du contrat d'occupation provisoire.
Certains types d'occupation du sol ne nécessitent pas
le même processus. Des seuils sont définis dans l'article
157. Ces terres ne doivent pas être couvertes par plus de
10% de constructions, 50% de cultures alimentaires, fourragères ou
autres, 50% de plantations (avec des seuils concernant le nombre de plant par
hectare30(*), et ces terres ne doivent pas être
classées en vue de la conservation du sol. Ces terres « ne
pourront jamais être considérées comme mises en valeur et
occupées 31(*)», et ainsi, les paysans qui travaillent
ces surfaces ne sont pas tenus de payer les impôts et
l'emphytéose. L'emphytéose est un statut juridique de location de
terres32(*), mais le locataire dispose de droits plus
larges et c'est à peu de choses près un propriétaire. Ce
statut concerne avant tout les propriétés rurales, et il permet
au propriétaire de mettre en valeur ses terres sans pour autant avoir
des charges à supporter dans la mise en culture, qui reviennent au
locataire. Comme l'emphytéose est située sur un terrain
appartenant à l'Etat, l'emphytéote (le locataire) se doit de
payer « à l'Etat une redevance en nature ou en
argent 33(*)».
B. Le droit coutumier et le droit foncier.
Il existe peu de références aux droits des
communautés locales. Il n'y a pas non plus de définition du terme
« communauté locale » alors qu'il est employé
à plusieurs reprises. Seulement trois articles de la loi 73-021
concernent le droit coutumier.
L'article 387 explique que
« Les terres occupées par les communautés locales
deviennent (...) des terres domaniales ». L'Etat est
donc le propriétaire de ces terres, qui sont essentiellement rurales et
forestières.
L'article 388 vient ensuite définir
brièvement quelles sont les terres concernées par le droit
coutumier : « Les terres occupées par les
communautés locales sont celles que ces communautés habitent,
cultivent ou exploitent d'une manière quelconque -individuelle ou
collective- conformément aux coutumes et usages locaux. »
Pour qu'une communauté puisse avoir les droits de
jouissance sur ces terres, une ordonnance du Président de la
République doit être obtenue. Le droit de jouissance est par
définition, le droit donné par l'Etat sur une terre mise en
concession. Il est très proche du droit de propriété, avec
quelques obligations supplémentaires telles que le maintien de la terre
en bon état, ou encore la limitation des droits de jouissance dans le
temps à 25 ans, qui peuvent être renouvelables.
Pour obtenir une terre rurale située en terre
coutumière, il n'est pas légal de faire les démarches
auprès des autorités coutumières. Si un contrat est
passé entre une personne privée et un chef de terre, cela n'est
pas reconnu par la loi. Pour acheter une terre, la loi impose de demander et de
faire les démarches auprès des autorités administratives
de l'Etat.
3. La loi foncière de 1980.
Promulguée le 18 janvier 1980,
elle s'intitule la loi portant sur le régime
général des biens, sur le régime foncier et immobilier et
sur le régime de sûreté n°80-008. C'est
une loi qui définit plus précisément certains aspects de
la loi de 1973. On y trouve ainsi des précisions concernant le droit
coutumier, les enquêtes de vacance de terres, ou encore le régime
foncier des terres coutumières. Cette loi aborde donc plus
précisément la question de la coutume.
A. Le régime foncier et les terres
coutumières.
Le régime foncier est par définition, l'ensemble
des règles juridiques et des principes selon lesquels la terre
appartient à l'Etat, et il informe comment une personne privée
peut obtenir des possessions sur les terres.
On définit une nouvelle fois le domaine public de
l'Etat et le domaine privé de l'Etat. La définition du domaine
public est similaire à la loi précédente de 1973.
Concernant le domaine privé, il est stipulé que
« les terres coutumières appartiennent également au
domaine privé de l'Etat ». C'est l'article
388 qui définit cette règle de droit foncier. Cet
article est important car il détermine ensuite comment procéder
à une concession. En effet, seules les terres du domaine privé
peuvent être concédées.
Pour cela, l'Etat accorde divers contrats selon le type
de terre obtenu. Ainsi, le contrat de concession perpétuelle ou de
concession ordinaire donne un droit de jouissance sur la terre. Il existe
d'autres contrats concernant les bâtiments mais étant
donnés qu'ils concernent le domaine urbain, ils ne concernent pas
directement cette étude.
Les acteurs peuvant accorder des concessions sont le
Ministère des Affaires foncières, les représentants locaux
de ce ministère que sont les Conservateurs des titres fonciers (le
cadastre dépend d'eux par exemple). Mais pour obtenir une demande, il
faut en premier lieu se présenter au Conservateur des titres
fonciers : il évolue à l'échelle du District.
Une typologie détermine (en milieu rural) quels sont
les acteurs qui peuvent donner une concession selon la superficie
demandée :
§ Moins de 10 ha : le Conservateur des titres
fonciers (le District)
§ Entre 10 et 200 ha : le Gouverneur de province (
la Province)
§ Entre 200 et 1000 ha : le Ministre des Affaires
foncières (l'Etat : l'exécutif)
§ Entre 1000 et 2000 ha : le Président
§ Plus de 2000 ha : le Parlement à travers
une loi (le pouvoir législatif)
B. Un point important concernant les terres
coutumières : l'enquête de vacance de terres.
Cette enquête est une étape préalable
importante pour obtenir n'importe quelle concession de terres rurales. Le
rôle de cette enquête est de connaître les terres
demandées et ainsi que les droits sur cette même terre.
Il est précisé par l'article
193 que :
« Le droit de propriété que l'Etat
possède sur toutes les terres et même sur les terres
coutumières n'éteint pas les droits de jouissance que les
communautés traditionnelles possèdent encore sur ces terres. Ces
droits de jouissance consistent en droits de culture, de chasse, de
pêche, de ramassage, etc. ».
Cette enquête de vacance de terre est d'une grande
importance pour les communautés coutumières car elle est
créée pour que les droits des communautés soit reconnus et
intégrés dans la demande de concession. De cette
manière : s'« il s'avère que les
communautés coutumières possèdent certains droits sur les
terres demandées, elles devront être dédommagées
intégralement avant que la concession puisse être accordée.
Elle ne le sera pas si ces terres sont jugées nécessaires
à l'entretien et au développement futur des villages
environnants ».
Par cette enquête et par ces règles, on
reconnaît aux communautés coutumières les droits d'usages,
mais on ne leur reconnaît pas vraiment la propriété de
leurs terres, de leurs forêts. Néanmoins cela traduit un
certain pouvoir de la coutume sur les terres rurales.
C. Le cas du droit de pacage et la convention
fermière.
Le droit de pacage est un droit lié à des terres
destinées à faire paître le bétail.
L'étymologie de pacage vient du latin pascuum (pâturage),
et de pascere (paître). Le paysan emmène son
bétail (souvent des chèvres, des moutons) pour que ceux-ci se
nourrissent. Ce type de milieu est ouvert et il correspond à une
propriété de la terre non pas privée mais collective. Il
est très présent en Afrique, et surtout chez les
sociétés dites traditionnelles. Cet espace n'est souvent ni
arboré, ni cultivé. La loi de 1980 définit comment
procéder à une demande de ce type de terre. Il est écrit
que :
« La convention fermière s'en tient au
droit coutumier ;
I. on adresse la demande de terre au chef
coutumier ;
II. le Secteur enregistre le contrat contre le paiement
d'un droit d'enregistrement ;
III. le dossier est transmis au Territoire pour
contrôle par l'Administrateur du Territoire et l'Agronome de
Territoire ;
IV. communication de la convention
fermière 34(*) ».
Cet extrait montre bien qu'il faut consulter les
autorités coutumières pour entreprendre une demande de terres.
Pourtant, la suite de l'extrait ci-dessus précise que
« cette manière de procéder n'est pas conforme en
droit écrit 35(*)».
Les relations entre le droit écrit officiel et le droit
oral coutumier ne sont pas évidentes à comprendre en analysant
les règles de droit. Il est important donc de déterminer quelles
sont les relations entre ces deux types de droit, qui paraissent
antagonistes.
Chapitre 3
Le code forestier de 2002
Le 29 août 2002, la loi n°011/2002
portant sur l'abrogation de l'ancienne législation forestière de
1949 a été promulguée par le Président de la
République après avoir été adoptée par le
pouvoir législatif (l'Assemblée Constituante et
Législative-Parlement de Transition, soit un seul organe). Après
une longue période sans changer la législation forestière,
l'Etat a décidé de faire évoluer et d'apporter des
précisions sur la gestion forestière. Ce nouveau Code
définit les termes importants en matière de gestion tels que les
produits forestiers non-ligneux (une définition à certains
égards encore lacunaire), le plan d'aménagement forestier, la
communauté locale36(*) pour ne citer que ces exemples.
1. Les grands ensembles forestiers selon le
droit.
Un nouveau cadre juridique est donné aux forêts
en apportant une classification des forêts (Les forêts
classées, les forêts protégées et les forêts
de production permanente).
§ Les forêts classées sont ainsi des
forêts soumises « à un régime juridique
restrictif concernant les droits d'usage et
d'exploitation 37(*)». Elle sont propriétée de
l'Etat, et elles ont souvent une importance écologique. Cette partie du
Code mentionne la superficie de forêts classées dans le territoire
national (15% de la superficie totale). On trouve ensuite deux grands types de
forêts classées.
Le premier groupe est défini dans l'article
12 et ces forêts peuvent être des réserves de
biosphère, des jardins botaniques et zoologiques, des forêts
urbaines, etc. Elles sont marquées par leur rôle en matière
de biodiversité, en matière
« récréative » et scientifique.
L'article 13 définit le second groupe,
et il concerne les forêts ayant un rôle à jouer en
matière écologique. On parle de protection et de
conservation : « les forêts nécessaires
pour : la protection des pentes contre l'érosion ; (...)
la conservation des sols ; la salubrité publique et
l'amélioration du cadre de vie ( ...) ».
§ Les forêts protégées sont
celles « qui n'ont pas fait l'objet d'un acte de classement et
sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux
droits d'usage et aux droits d'exploitation 38(*)». Elles sont
aussi sous propriété de l'Etat (article 20).
L'article 21 définit comment ces forêts peuvent
être mises en concession. L'article 22 explique les
modalités d'attribution des concessions aux communautés locales,
selon les coutumes, concernant les forêts de communautés locales,
et c'est une des innovations par rapport à l'ancien code. Cet aspect est
traité plus en profondeur par la suite dans le Code, notamment par les
articles 111 à113.
§ Le dernier grand type de forêts concerne les
forêts de production permanente. Selon le Code, ce sont des
« forêts soustraites des forêts
protégées par une enquête publique en vue de les
concéder ; elles sont soumises aux règles d'exploitation
prévues par la présente loi et ses mesures d'exécution
39(*)».
2. Les droits d'usage selon les différents
types de forêts.
L'Etat, par l'intermédiaire du Code, autorise ou
restreint l'utilisation de la forêt et précisément de ses
ressources. Etant entendu que l'Etat est le propriétaire des espaces
forestiers, il définit les lois concernant les populations en zone
forestière. Selon la classification ci-dessus, ces droits vont
être différents.
§ Les articles 38, 39 et 40
définissent les droits d'usage dans les forêts
classées. Seules les populations riveraines de ces forêts sont
autorisées à utiliser les ressources forestières, mais
avec des clauses précises. Elles sont autorisées à
ramasser le bois mort, à pratiquer la cueillette, le ramassage de
produits forestiers non-ligneux (fruits, plantes alimentaires,
médicinales, mais aussi chenilles, escargots ou grenouilles), et aux
prélèvements de bois mais dans un cadre précis (pour la
construction d'habitations et pour l'artisanat). Il est donc interdit de
pratiquer la coupe d'arbres à des fins commerciales.
§ Concernant les forêts
protégées (articles 41 à 44), les
droits d'usages traditionnels sont libres, malgré la présence de
taxes ou de redevances forestières. Ces droits peuvent être
modifiés et contrôlés par le Ministère de
l'Environnement, de la conservation de la Nature et des Eaux et Forêts,
par l'intermédiaire d'un zonage ou de modalités
spécifiques (par exemple, l'activité agricole, ou encore la
récolte de produits forestiers). Le cadre juridique est donc flexible,
et il peut si besoin être contraignant ou souple.
§ Les droits d'usages ne sont pas abordés pour
les forêts de production permanentes, car le cadre n'est pas
restrictif. Ces droits sont donc maintenu pour les populations riveraines
concernées.
3. L'aménagement des
forêts.
Par aménagement, on entend principalement la mise en
exploitation des ressources forestières ligneuses. L'exploitation
forestière est plus encadrée, notamment en ce qui concerne les
étapes préalables à l'exploitation forestière.
A. Le code distingue trois grands types de
préalables : l'inventaire, la reconnaissance et le plan
d'aménagement.
§ Un inventaire forestier est obligatoire. C'est
la première étape pour l'exploitation. Il est pris en charge par
l'administration, qui peut ensuite l'externaliser40(*). L'inventaire est
soumis à une autorisation par le Gouverneur de la province
concernée, et un délais d'un an doit être
respecté41(*).
§ Ensuite, l'inventaire débouche sur une
reconnaissance forestière. Pour cela, il faut aussi obtenir une
autorisation du Gouverneur de Province, pour que débutent les travaux,
car, ni l'inventaire, ni la reconnaissance ne donnent droit à une
concession forestière.
§ Le plan d'aménagement est
l'élément le plus important pour l'aménagement forestier.
Il peut concerner différents domaines tels que la production durable de
tous les produits forestiers et de produits pour la biotechnologie : les
services environnementaux, le tourisme et la chasse ; les autres objectifs
compatibles avec le maintien du couvert forestier et de la protection de la
faune sauvage 42(*). Le plan d'aménagement est ainsi
« un ensemble de documents, outils de référence et
de gestion, qui fixent un programme d'action à court, moyen et long
terme, pratique et réaliste sur le plan social, écologique et
financier 43(*)». La réalisation d'un plan
d'aménagement se fait par les mêmes acteurs que l'inventaire. Les
populations locales ne sont mentionnées que dans une phrase :
« L'administration s'assure de la consultation des populations
riveraines, des autorités locales compétentes et des particuliers
concernés 44(*) ». Nous reviendrons plus
tard sur cet aspect qui n'est pas clairement défini, malgré
l'importance qu'il requiert.
B. L'exploitation passe par un titre de
propriété.
Ce titre est le contrat de concession forestière, il
donne les droits d'exploitation, mais aussi les devoirs qui incombent à
l'exploitant. Selon la superficie forestière concernée, les
signataires de la concession vont être différents45(*). De nombreuses
règles sont présentes dans le Code sur la concession, et on
trouve aussi mentionnées les relations entre l'exploitant et les
populations présentes dans ces forêts. Ces règles
défendent l'exploitant mais également les populations locales et
leurs activités. L'article 106 va dans ce sens :
« Sans préjudices de l'exercice de tous les droits
reconnus par la loi aux communautés locales, le concessionnaire ou
l'exploitant forestier a l'exclusivité d'utilisation du réseau
d'évacuation qu'il a établi ».
C. Les Forêts de communautés locales et
l'exploitation forestière.
Les forêts de communautés locales étaient
auparavant appelées « forêts
indigènes » dans l'ancien droit forestier. Cela correspond
à une forêt coutumière, c'est-à-dire, une
forêt qui s'inscrit dans un territoire coutumier. Le Code forestier
définit les droits de ces populations par rapport à leur
forêt . « Outre les droits d'usage, les
communautés locales ont le droit d'exploiter leur forêt. Cette
exploitation peut être faite soit par elles-mêmes, soit par
l'intermédiaire d'exploitants privés artisanaux, en vertu d'un
accord écrit 46(*). Les exploitants privés
artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des
communautés locales que moyennant la détention d'un
agrément délivré par le Gouverneur de province, sur
proposition de l'administration forestière locale47(*) ».
Ces forêts ne sont pas encore existantes. Pour disposer
juridiquement de ces forêts, un décret présidentiel doit
être rédigé pour valider la reconnaissance des possessions
coutumières. Actuellement, un texte de loi a été
proposé au gouvernement pour permettre aux communautés locales la
reconnaissance de leurs forêts, mais il fait débat car la
situation n'est pas uniforme en matière de gestion des forêts par
les population à l'échelon national. En effet il existe en
République Démocratique du Congo une grande variété
d'ethnies et donc de nombreux modes d'occupation du sol qui peuvent être
très différentes. Cela nécessite un état des lieux
avec des connaissances sur les populations, des activités humaines
(à l'aide de cartes par exemple), les règles foncières, la
connaissance également des droits d'usage coutumiers, des conflits, etc.
D'où la grande difficulté d'harmoniser le droit juridique et les
procédures pour que les territoires villageois soient reconnus
officiellement.
Synthèse
Depuis l'arrivée des européens, l'Etat a
toujours été conçu comme un acteur
prépondérant sur le domaine foncier. Le question de la
propriété des terres a été cruciale pour la
domination coloniale qui est passée par la réorganisation
administrative de l'espace. L'objectif était de rendre facile
l'appropriation de terres appartenant aux populations locales. Le droit foncier
a donc été mis en place comme un outil politique et
économique de contrôle territorial.
Le cadre juridique contemporain de la RDC est différent
de la période coloniale. On reconnaît les droits fonciers
coutumiers dans les textes de loi comme on peut le voir dans la constitution.
Le récent code forestier aborde la question des populations locales, en
reconnaissant l'existence des droits d'usages coutumiers. Cependant, certains
aspects juridiques restent ambivalents par rapports aux populations locales.
Le cas des cessions de terres est révélateur de ces
différences. Pour acheter une parcelle de terre, il est interdit de
consulter en premier les autorités coutumières. Le lois
précisent bien que c'est l'administration qui peut céder des
terres, et non les propriétaires coutumiers. La création de
forêts communautaires est une avancée, mais dans la
réalité, elles n'existent pas. Les territoires coutumiers ne sont
donc pas officiels.
Il faut admettre que la reconnaissance des terres
coutumières ne rend pas facile le rôle de l'Etat. Celui-ci cherche
à affirmer son monopole foncier, mais la réalité traduit
que le pouvoir de l'Etat est limité. Il faut faire une distinction entre
les terres urbaines et les terres rurales. Le foncier en zone urbaine est
géré par l'Etat, tandis que la gestion coutumière est
influente en ce qui concerne les forêts et les campagnes. Les
compétences de l'Etat en matière foncière sont donc
à relativiser. Bien que le droit donne tous les pouvoirs à
l'Etat, il doit tout de même tenir compte d'autres modes de gestion des
terres.
Après avoir tenté de comprendre le cadre
juridique du domaine foncier de la RDC, nous allons maintenant aborder la
gestion des terres rurales à travers une population
précise : les Mongo. Il s'agit d'analyser comment est
gérée la terre non plus à l'échelle nationale et
juridique, mais localement et dans la pratique.
PARTIE II:
La population Mongo : l'imbrication entre la
société et le domaine foncier
Il y a plusieurs manières de se référer
à la population Mongo. Certains emploient le nom d'ethnie Mongo, de
grand groupe Mongo, de peuple, ou encore de population. Ces deux premiers
termes ont été employé par Van Der Kerken
G. qui a fait de très nombreuses recherches sur cette
population entre les décennies 1920 et 1940, ce qui débouchera en
1941 sur sa publication du premier volume intitulé L'Ethnie Mongo,
suivit par le volume II et III. Cette « terminologie » a
été reprise par la suite et très discutée par les
personnes qui se sont intéressées de près au Mongo.
L'ethnie renvoie le plus souvent à « une
population d'une même origine, possédant une tradition culturelle
commune, spécifié par une conscience d'appartenance au même
groupe dont l'unité s'appuie en général sur une langue, un
territoire et une histoire identique 48(*) ».
Il est nécessaire de préciser que les auteurs (souvent de
nationalité belge) qui parlent d'une certaine unité du peuple
Mongo se sont pas tous des acteurs neutres. Ainsi, Van Der
Kerken fût gouverneur de l'Equateur et il a plaidé en
faveur d'un « rassemblement Mongo » (ou
« regroupement Mongo ») dans une seule province. Quand on
parle de « regroupement » cela signifie qu'il faut
créer un territoire administratif qui tienne compte de la population
présente. On cherche ainsi à rendre plus homogène les
délimitations à l'intérieur du pays.
Ces considérations sont très liées
à deux pères missionnaires : Boelaert E. et
Huslstaert G.. Ces deux pères sont
considérés comme les plus grands connaisseurs des Mongo, et c'est
par leur observations qu'ils en ont déduit une certaine unité des
différentes tribus Mongo 49(*). Les éléments qui leur ont
permis d'observer cette unité viennent de différents aspects
culturels tels que la linguistique, ou encore une histoire que partage les
différents groupes au sein de l'ethnie. Par exemple, il y a une histoire
orale intitulé l'Epopée Nsong'a Lianja. Lianja est
considéré comme l'ancêtre, et le héros des Mongo. Ce
récit explique la création du monde, la naissance du peuple
Mongo, ainsi que l'histoire (mythique) de ses ancêtres.
La notion d'ethnie a aussi des racines coloniales, et elle
peut dans certains cas participer à un découpage arbitraire selon
des critères ethniques. C'est ce qu'exprime Chrétien
J.-P. : « L'ethnicité se
réfère moins à des traditions locales qu'à des
fantasmes plaqués par l'ethnographie occidentale sur le monde dit
coutumier 50(*)». Le terme d'ethnie a
été aussi un moyen pour ne pas accorder un statut plus
élevé aux autochtones. On ne leur donne pas le qualificatif de
nation ou de peuple, pour marquer une hiérarchie avec les
sociétés européennes.
Néanmoins, des doutes subsistent sur l'unité des
Mongo, et tous les historiens ne sont pas d'accord pour affirmer que les Mongo
avaient -avant l'arrivée des européens- cette conscience commune.
Une des raisons les plus plausible est l'enclavement des populations et du
peuplement avant l'arrivée des belges. D'autres raisons sont les guerres
tribales au sein des Mongo, ce qui explique clairement que même si ils
disposaient d'un patrimoine commun, les rapports pouvaient être
conflictuels au plus haut point.
Dans tout les cas, aujourd'hui, les Mongo forment une seule
ethnie comme le souligne Bongango J. :
« La seule chose sûre est que cette conscience
existe à l'heure actuelle: la colonisation l'a rendue possible, par la
mise en contact de groupes qui s'ignoraient. » De plus, il
affirme qu' « on a certainement raison de mettre à
l'avant-plan l'aspect unitaire lorsqu'on aborde l'histoire des Mongo ;
mais cette unité, loin d'être un présupposé, est
plutôt l'aboutissement d'un processus (...)51(*)».
Chapitre 1
Une population au coeur du bassin du Congo
1. Localisation au sein de la RDC.
Les Mongo vivent en grande majorité dans la Province de
l'Equateur, mais on trouve aussi des Mongo dans d'autres Provinces de la
République Démocratique du Congo comme le Kasai Oriental, le
Kasai Occidental, le Bandundu, ainsi qu'au Nord-Kivu. Néamoins, c'est en
Equateur que se trouve la grande majorité de la population Mongo. Leur
répartition générale est limitée à l'est et
à l'ouest par la boucle du fleuve Congo et par le Kasai au sud.
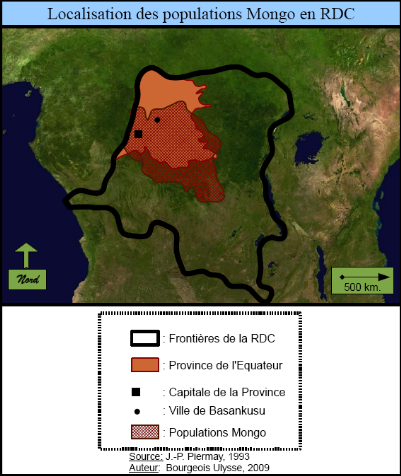
Figure 2.
On constate sur la carte que l'ensemble de la population Mongo
tient une place importante au sein de la RDC et surtout dans la Province de
l'Equateur. Elle est située dans un vaste espace. Cet espace est
forestier et il se trouve intégralement dans la cuvette du Bassin du
Congo.
Il n'est pas évident de connaître le nombre
d'individus au sein de la population Mongo à l'heure actuelle dans la
mesure où les données statistiques sont anciennes et qui
plus est, les sources de ces données ne sont pas toujours
connus.
Il existe des statistiques anciennes concernant les Mongo.
Avant l'arrivée des Européens, la population était
nombreuse. Selon Van Der Kerken, la population Mongo
était estimée entre 3.000.000 à 6.000.000 d'individus,
voire même plus encore selon lui 52(*). Toujours selon cet auteur, la population
serait comprise entre 1.500.000 et 2.000.000 habitants pour la décennie
1940. La diminution de la population est imputable à diverses causes
dont : les croisades de peuples Arabes à partir du XVIème
siècle ; les guerres tribales, et plus récemment
l'esclavage arabe puis européen avec l'exploitation du caoutchouc.
Bongango J. estime avec quelques doutes le
chiffre de la population Mongo pour l'année 1984 53(*) : elle serait de
11.124.031 habitants, soit 37,7% de la population zaïroise
54(*). On
constate donc que la population Mongo est de taille importante dans le
Zaïre de l'époque. La population de l'actuelle RDC, est
évaluée à 62.635.723 habitants selon les données
statistiques de l'Unesco pour l'année 2007. D'autres sources de l'ONU
donnent le chiffre de 66.832.000 habitants en 2009 55(*). Il est très
délicat d'affirmer que l'augmentation générale de la
population se reflète aussi dans la population Mongo. En effet, les
statistiques sont souvent invérifiables, comme le chiffre de la
population actuelle Mongo de 400.000 habitants selon des sources peu fiables
56(*).
Cet exemple précis rend compte de la difficulté d'évaluer
précisément la population Mongo car le dernier recensement
national date de 1984, le reste des statistiques se base sur des estimations en
rapport avec l'accroissement démographique.
2. L'arrivée de la population Mongo dans la
cuvette du bassin du Congo, et en particulier dans le Territoire de
Basankusu.
Le peuplement du bassin du Congo est ancien. Les Mongo
seraient originaires du Nord-Est de la RDC, dans la région du Haut-Nil
(l'actuel Ouganda) vers les Lac Albert, Edouard et Victoria. Cette
hypothèse fut avancée par Van Der Kerken G., et
est corroborée par d'autres historiens plus contemporains comme
Leysbeth A. (1963), Mikanza N. (1966),
Hustaert G. (1972) ou encore Ndaywel è Nziem
I., Obenga T. & Salmon
P. (1998).
Il y aurait eu deux grandes migrations. La première se
situe entre le XIV et XVIème siècle après J.C.. Ces
groupes Mongo sont les Batetela et les Basuku et ils se sont installés
non pas dans l'actuelle province de l'Equateur mais dans la Province de Mamiena
et du Kasai-Oriental57(*).
La seconde migration, celle qui nous intéresse
concerne l'arrivée dans la cuvette du bassin du Congo. Soit un trajet
d'Est en Ouest. Cette migration se situerait entre le XVIème et le
XVIIIème siècle. Malgré ces hypothèses, il reste de
nombreux doutes sur l'histoire de ces migrations, et à ce jour les
nombreuses tentatives d'explications scientifiques n'ont pas été
concluantes. L'histoire de ces migrations (ou conquêtes) est
principalement orale, et les travaux de recherche sur l'histoire des Mongo
avant l'arrivée des européens sont inachevés.
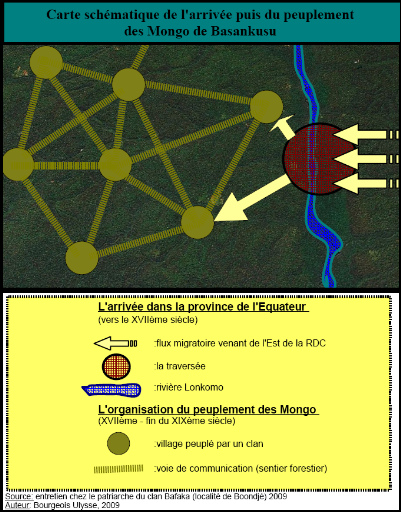
Figure 3.
La guerre des chiens et les Mongo de
Basankusu :
La tradition orale de l'histoire est très bien connue
des Mongo. La grande guerre appelée guerre du chien
selon les recherches de Bongango J., mais appelée
guerre des chiens lors des recherches
concernant ce travail. Du domaine du mythe et de l'histoire orale, cette guerre
débuta ainsi :une jeune fille reçut de son défunt
père un chien de chasse en héritage. Ce chien permettait à
la famille de ne manquer de rien, et principalement de viande de chasse. Vint
un jour où le mari tua le chien en l'absence de l'épouse. Le
soir, le mari servit la viande préparée à son
épouse, et celle-ci mangea le repas. Mais pendant ce repas,
l'époux annonça que la viande était celle du chien de son
père. L'épouse retourna dans sa famille, et c'est ainsi que
commença la guerre qui divisa en deux groupes distincts la population. A
partir de ce moment les Mongo se séparèrent des Ngombé,
les Mongo Baseka Bongwlanga se sont installés dans la région de
Basankusu. Les Ngombé sont actuellement eux aussi répartis dans
la cuvette centrale de cette région de la RDC. Mais ils sont moins
nombreux que les Mongo. Cette scission aurait eu lieu vers Kisangani, dans la
province Orientale 58(*). La migration qui entraîna
l'arrivée du peuple Mongo dans la région de Basankusu aurait
traversé la rivière Lonkomo. Les descendants actuels datent cette
migration au XVI ème siècle. Selon Bongango
J. : « La majorité des Baseka
Bongwalanga prétendent être originaires de la zone de
Befale59(*)».
La guerre des chiens serait à l'origine du peuplement
dans le territoire de Basankusu par les Mongo proprement dit, appelé
aussi Baseka Mundji. Au sein des Baseka Bongwalanga, on distingue deux
groupes : les baseka Bonwgwalanga proprement dit et les Basek'efekele.
Cette distinction est principalement faite par rapport aux chefferies. Ainsi,
la chefferie de Bongilima (qui va nous intéresser par la suite) est dans
le groupe des Basek'efekele.
Figure 4 :
L'organisation des Mongo de Basankusu
source : Bongango J. (2008),
Van Der Kerken G. (1944)
|
Mongo de Basankusu, ou Baseka Mondjé ou Baseka
Mundji, ou Nsongo
(ancêtre commun : Bosungu'Ombala)
|
|
Baseka Bongwalanga
|
Basek' efekele
|
|
Baseka
Bongwalanga
|
Basek'ekulu
|
|
Groupements (ou chefferies)
|
|
Bolima II, Ntomba, Mondjondjo I, Mondjondjo II, Boeke, Ndeke,
Lolungu, Boyela, Wala, Waka, Lifumba, Bokenda, Bolima I, Boende
|
Buya, Euli, Lilangi I et Lilangi II
|
Lisafa, Bongilima, Ekombe, Buya-Bokakata,
Lifumba-Bonamba, Ekoto et Mpombo (ou Bosombe)
|
3. Une culture très liée à la
nature.
La culture des Mongo est très liée à la
nature. Cela s'observe à différents niveaux comme la pratique
religieuse. Auparavant, les cultes concernaient de manière forte des
divinités secondaires (par rapport au Dieu Créateur). Cela
concernait des forces dites telluriques (liées à des forces
physiques comme la foudre, la pluie), des animaux (avec le totémisme),
des mânes, etc. La pratique du totémisme ainsi que le culte des
ancêtres (ancestrisme) semble avoir été les principaux
cultes des Mongo avant la christianisation de la cuvette centrale de la RDC. Le
totémisme peut être définit comme une relation
étroite entre une communauté (le clan par exemple) et certains
espèces vivantes. Un clan va, par exemple, avoir un totem comme le
crocodile. Dans ce cas des interdits existent : on ne chasse pas l'animal,
on lui dédit des cultes, des cérémonies. D'une
manière générale, cela influence beaucoup le groupe, dans
le mesure ou s'instaure une connexion avec le monde naturel. Pour
Lévi-Strauss C., les groupes sociaux pratiquant ces
relations avec le monde dit « naturel » (animaux, plantes,
etc ) ont tissé de tels liens sociaux que la nature devient un
guide : « une méthode de
pensée ». Le totémisme est également une
manière d'organiser la société en étroite relation
avec la nature, comme le rappelle Descola P. quand il affirme
que « dans un tel mode d'identification, les objets naturels ne
constituent donc pas un système de signes autorisant des transpositions
catégorielles, mais bien une collection de sujets avec lesquels les
hommes tissent jour après jour des rapports
sociaux 60(*)».
Ces traits culturels sont autant d'éléments pour
tisser également des liens étroits avec la terre. Cela s'observe
principalement avec le rôle des ancêtres : « Les
terres sont occupées au terme d'une alliance passée par le
premier occupant avec les puissances de la terre et les esprits du lieu.
(...). Le chef ou le maître de la terre est le garant du respect de
l'alliance. Il est généralement le descendant du premier
occupant. Il est chargé des des sacrifices nécessaires à
l'obtention de l'accord et de la protection des possesseurs mythiques des
lieux. C'est de cette médiation qu'il détient son
autorité 61(*)».
Voici un exemple pour illustrer le totémisme
présent chez les Mongo, et en particulier chez les Baenga, qui sont des
Mongo pratiquant essentiellement la pêche, répartis donc le long
des ruisseaux, rivières et fleuves du bassin hydrographique du fleuve
Congo. Certaines cérémonies importantes de la vie sociale de ces
populations sont encore très marquées par le totémisme, et
le culte des ancêtres.
Ces cérémonies religieuses peuvent concerner par
exemple :
§ La résolution d'un problème lié
à la sorcellerie : comme
l'« enlèvement » d'un enfant par un crocodile
§ La résolution d'un problème dit
« climatique » : comme le manque de poisson
§ La mort d'un notable important du groupe, etc.
Le manque de poisson est expliqué comme un
problème avec les puissances naturelles. La cérémonie
(Nkembi) a pour but de résoudre ce problème en se
référant aux puissances totémiques. Dans ce cas, le
notable le plus influent du groupe se rend en pirogue avec un enfant, un chien
et une natte. Le lieu de la cérémonie n'est pas choisi au hasard,
il peut s'agir d'un marécage, d'un cours d'eau précis. Le chien
est offert en sacrifice, puis le notable se rend au port de son village sur
une natte 62(*). Le crocodile est selon les dire,
situé en-dessous de la natte, pour l'empêcher de couler. Dans ce
cas, la cérémonie s'est déroulé comme prévu,
c'est-à-dire qu'il y aura prochainement du poisson dans les nasses, et
dans les filets des pêcheurs. En effet, l'observation de signes permet de
déterminer si le problème va être résolu ou non.
Ainsi, si la natte ne coule pas, on va interpréter qu'il n'y aura pas de
sécheresse (période de capture du poisson), tandis que si elle
coule, le signe est perçu comme négatif : il n'y aura pas de
sécheresse, et donc peu de prises de poissons. Il faut ajouter que le
crocodile est considéré comme l'animal le plus puissant
concernant la pratique de la magie dans cette région.
L'apport du christianisme lié à la
présence de missionnaires dans l'actuelle Province de l'Equateur tend
à réduire voire combattre ces pratiques qualifiées parfois
de sorcellerie, avec tout ce que cela comporte de jugements négatifs.
L'économie illustre également les relations
fortes avec la nature. Les Mongo vivant intégralement de la forêt,
cette dernière intervient dans toutes les activités, y compris
l'agriculture. Ces activités sont, la chasse, la pêche,
l'utilisation des ressources ligneuses, mais aussi non-ligneuses (les plantes
médicinales ou alimentaires). Les relations avec la nature sont
très fortes comme l'illustre les pratiques religieuses anciennes
comme le totémisme, mais ces interactions entre les populations et leur
milieu évoluent pourtant.
Chapitre 2
Une société complexe et
hiérarchisée
Il y a un très grand nombre de tribus, de sous-tribus
au sein de l'Ethnie Mongo. Une hiérarchisation à
l'intérieur de ces populations permet, en plus de d'informer sur la
structure sociale, et également sur l'histoire même des Mongo.
Cette hiérarchisation reprend les travaux de Van Der
Kerken (1944). Le terme tribu renvoie à des origines communes
par rapport à un ancêtre dont sont originaires les membres du
groupe. Observer cette organisation permet de mieux comprendre que
l'utilisation du terme d'ethnie, pour regrouper ces différentes
populations, peut être explicative dans la mesure où les liens de
parenté traduisent également une pyramide des origines
historiques et sociales.
.
1. Les différenciations au sein de l'Ethnie
Mongo.
On distingue deux grands types de Mongo. Les Mongo au sens
restreint et les Mongo au sens étendu. Les premiers sont
considérés comme les Mongo
« véritables », ou bien les
« originaux ». Les seconds auraient a priori des liens de
parenté peu évidents avec un quelconque ancêtre commun. En
revanche, ils ont des similitudes culturelles, ou encore linguistiques. Il
n'est pas simple d'affirmer le contraire de ces idées dans la mesure
où peu de recherches ont eu lieu sur ce domaine.
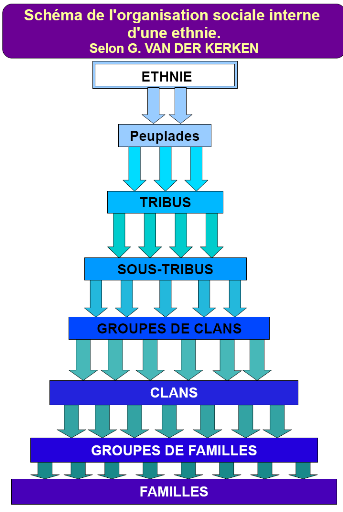
Figure
5.
Cette classification de Van Der Kerken fait
aussi des différenciations régionales. Les Mongo au sens
restreint sont ainsi définis selon des régions. Il y a les Mongo
du Nord, ou « Mongo proprement dit ». Ils sont Mundji ou
Nsongo, Ntomba, Yamongo, ... Ils se trouveraient dans les territoire de
Basankusu, Befale, et Bongandanga. Il y a ensuite les Mongo du centre, et enfin
ceux du Sud.
Il convient d'ajouter que les Mongo du Territoire de Basankusu
se définissent eux mêmes comme les Mongo. C'est-à-dire que
cela va dans le sens des observations et des recherches anciennes.
2. L'organisation sociale.
Chez les Mongo la société est très
hiérarchisée, et la succession est de type patrilinéaire
63(*).
Cette filiation est marquée par le statut important de l'homme :
« La transmission du nom, des biens et des droits s'opère
entre père et fils, la résidence étant le plus souvent
celle de la famille du mari64(*) ».
Comme nous venons de le voir, les Mongo sont répartis
en groupes (appelé « tribu » lors de la
période coloniale ). Ensuite, chaque groupe est réparti dans des
clans, puis dans des lignées.
Un clan est défini comme un ensemble de personnes ayant
des liens de parenté avec un ancêtre commun (extension de la
famille nucléaire). Le clan n'est pas figé, et sa structure est
sans cesse changeante. Ainsi, les mariages des enfants du clan étendent
la taille du clan lui-même. En effet, lors d'un mariage, c'est
très souvent la femme qui vient vivre sur les terres du clan (voire du
lignage). La société Mongo suit l'organisation segmentaire de
type patriarcal : un ancêtre commun est obligatoirement une personne
de sexe masculin.
Les lignées peuvent être de deux sortes. On parle
de lignée primaire et de lignée secondaire. Cette
différenciation est liée à la structure sociale et
familiale. Les lignées primaires sont les enfants (masculin) né
du père de la lignée, tandis que les lignées secondaires
sont composés des petits-enfants du père de la lignée. Le
père de la lignée est également appelé patriarche
ou chef de lignée. Le chef de lignée est très
fréquemment un homme âgé, mais pas obligatoirement, car
c'est le descendant direct de l'ancêtre commun (le fils aîné
par exemple). Il dispose d'un pouvoir social et juridique au sein du groupe.
Cela signifie qu'il a un pouvoir sur les femmes et les enfants du clan. Un
patriarche a une responsabilité forte, il est en quelque sorte de garant
de l'harmonie et de la sauvegarde de la vie de son groupe (Hustaert
G., 1990). Il est politiquement autonome dans cette gestion. Toutes
les personnes âgées ne sont pas pour autant toutes des
patriarches, et un patriarche peut être le chef d'une section de la
lignée, lorsque cette dernière est très ramifiée
(lignées secondaires, primaires,...).
L'autorité juridique et politique du groupe est de type
oligarchique. C'est-à-dire qu'elle se transmet par
hérédité. Cette transmission du pouvoir est la même
pour les guérisseurs (nkanga en lomongo), de père en
fils, mais, contrairement à la fonction de patriarche où c'est
une personne de sexe masculin qui forcément est investi, les
guérisseurs peuvent être selon les cas des femmes.
Le rôle de l'homme est très fort dans les
sociétés patriarcales. Les fils ont donc une grande importance,
mais il y a, là aussi, une hiérarchie. Le fils aîné
est le fils le plus importante au sein de la famille et du lignage car c'est
lui qui héritera du pouvoir, tandis que les frères du fils
aînés sont parfois en retrait. Cette différence entre
l'aîné et le cadet ou le puîné, s'observe pour le
transmission du pouvoir, mais aussi dans les partages comme le souligne
Mune P. : « Qu'ils [les
ancêtres] partagent du poisson, de la viande, de la terre, des
valeurs ou n'importe quoi, ils font toujours ainsi : ils donnent plus
à l'aîné, moins au cadet 65(*)». Cette
organisation de la famille est directement liée à l'organisation
politique dans la mesure où la société et le droit se
confondent.
3. L'organisation politique en zone
rurale.
Il existe en RDC une grande variété de types
d'organisation selon chaque société. On trouve des
sociétés matriarcales dans les Provinces de l'Est du pays par
exemple. Différentes échelles interviennent comme le groupement
(ou chefferie), le village (ou localité), le clan, et les
lignées. Le groupement et le village sont liés à
l'administration tandis que les clans et les lignages (des échelles plus
locales) sont marqués par des modes de gestions plus traditionnelles.
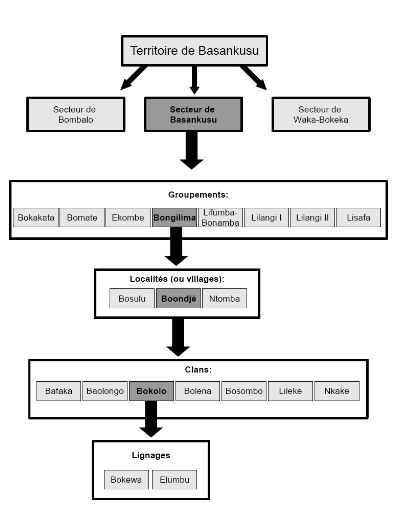
Figure 6 :
Schéma de l'organisation du
territoire
de l'échelle régionale à
l'échelon local.
Source : entretiens dans la localité de
Boondjé (2009)
et De Saint Moulin L. & Kalombo Tshibanda
J.-L. (2005)
A. Les pouvoirs en relation avec l'Etat.
Le groupement est un découpage
administratif mais qui conserve dans certains cas des liens très forts
avec les pratiques anciennes : la lignée régnante peut
diriger une chefferie depuis longtemps (depuis la nomination par les belges du
clan régnant). Le groupement est très souvent investi par un clan
ayant une filiation avec l'ancêtre commun du groupement. A leur
création (au XX ème siècle), les chefferies étaient
établies sur des critères d'homogénéité
ethnique. Ce n'est plus toujours le cas, comme pour le groupement de Bongilima
où le pouvoir a beaucoup changé de clan (3 clans
différents depuis l'arrivée des européens). Les mouvements
de population devenus de plus en plus fréquents ont modifié cette
homogénéité. Les règles concernant la gestion d'une
chefferie ont été mises en place lors de la colonisation. Dans la
gestion des clans et des lignées, le chef ne peut pas choisir
lui-même son héritier. Les chefferies fonctionnent
différemment. Le chef du groupement (ou la cheftaine car une femme peut
être investie à ce poste, de manière peu courante, mais pas
non plus de façon sporadique) transmet parfois le pouvoir par
héritage en remettant le titre écrit de chef à une
personne de son clan qu'il juge digne de ce poste (par exemple du
côté maternel comme un neveu). Une règle existe concernant
le clan régnant : le pouvoir ne peut rester plus d'une
génération en possession d'une lignée, il est obligatoire
que ce ne soit pas la même lignée au sein du clan, qui soit
investie de la position de chef. Le clan investi de la chefferie n'est pas
toujours bien perçu par les habitants dans la mesure où il peut y
avoir des tensions entre l'Etat et les chefs coutumiers.
Le village dispose aussi d'un chef : que
l'on nomme le chef de localité. C'est une autorité d'Etat, dont
le but est de faire l'intermédiaire entre l'Etat et les chefs de clans.
Par exemple, il intervient lors d'une demande de terre. Ce pouvoir est transmis
de manière héréditaire au sein de la lignée, et non
du clan comme pour les chefferies.
B. Du clan aux familles : une organisation
marquée par la structure sociale des Mongo.
Le clan se réfère à une
organisation ancienne, mise en place bien avant l'arrivée des
européens. Chaque clan dispose de ses terres qui sont ensuite
réparties entre les lignées et entre les familles. Cette
structure est très importante en zone rurale, voir
prépondérante dans le mesure où la gestion des terres ne
peut se faire selon l'accord du patriarche. Chaque clan dispose d'une
organisation qui lui est propre. Dans ce sens, la chefferie et le chef de
localité sont en relations étroites entre l'Etat et les chefs
coutumiers. Le clan est le propriétaire des terres, et c'est
sûrement l'acteur foncier le plus présent dans les zones rurales
de la RDC. Comme il a été précisé
précédemment, le clan est en constante évolution,
principalement sa structure sociale. Ce phénomène a des
conséquences fortes dans la mesure où la segmentation croissante
(dans le temps) des lignages au sein du clan tend à réduire de
plus en plus son autorité. De même, la mort d'un patriarche est
souvent un moment où le clan peut se diviser entre les différents
lignages qui le composent.
Le lignage est la structure sociale
située en dessous de la hiérarchie du clan. Plusieurs
lignées forment donc un clan. Chaque lignage a un chef qui est le
représentant de la famille et de l'autorité. Comme pour le clan,
la transmission de ce pouvoir est régi par la coutume: l'héritier
est celui qui a la plus proche parenté avec les anciens chefs : un
fils (ou un neveu lorsque la lignée ne comporte pas de fils). La
lignée de l'aîné de la famille dispose d'un pouvoir plus
important que les lignées « inférieures »
comme pourrait l'être la lignée d'un puîné.
Chapitre 3
La répartition des terres chez
les populations Mongo
« Si le père n'a pas abattu une forêt,
les enfants n'auront pas une jachère. »
« Celui qui ignore le clan de son grand-père
est un esclave. »
Proverbes Mongo
La région où vit le peuple Mongo est
essentiellement forestière. Pour donner un aperçu de la
superficie forestière, prenons le cas de l'aire Maringa-Lopori-Wamba.
Cet espace est composé de près de 93,5% de forêts. Il est
important de préciser que cette aire a été
délimitée car elle comporte de très nombreuses
forêts. Il est donc nécessaire de comprendre et d'analyser les
rapports de propriété en zone forestière dans le mesure
où la forêt couvre quasiment tout l'espace. Il va donc exister des
rapports très forts à la forêt car c'est un espace
vécu, et plus que nécessaire à la survie des populations.
La pauvreté de la région étant forte, la forêt, de
part la « gratuité » de ses services tient une place
considérable pour les populations. Parler de rapports très forts
part d'un postulat, qui s'explique par le fait que les populations vivent, non
pas seulement dans les zones rurales, mais également en zone
forestière, et que la forêt influence les modes de vies, les
activités, etc.
Plusieurs interrogations apparaissent :
§ Comment s'organisent les rapports de
propriété forestière ?
§ Comment s'organisent les rapports fonciers, ainsi que
les rapports entre les populations ?
§ Quel est l'attachement à la
forêt ?
En effet, en observant les photographies aériennes ou
satellites de la forêt de manière très brève, on
peut conclure qu'elle est « vierge » (non-habitée et
non-exploitée par l'homme). Les activités et le peuplement humain
semblent très concentrés en certains points : le long des
routes, autour de pôles urbains.
Ce constat est aussi celui de l'Etat en RDC. Le droit foncier
parle de terres vacantes. Comme cela a été précisé
dans la Partie I, cette enquête qui comporte des volets d'ordre
socio-économique vise à connaître les utilisations du
territoire concerné. L'Etat étant le propriétaire de la
majeure partie des terres qui se trouvent sur son territoire, des jeux
d'échelles vont donc avoir lieu, et ils ne sont ni simples, ni
paisibles. Ce problème n'est pas nouveau, et la propriété
des forêts est depuis longtemps un enjeu important, emprunt de conflits
d'usages.
Voyons cela dans l'histoire récente. Récente car
il n'y pas de sources disponibles dans la littérature avant la
présence belge dans le bassin du Congo. Prenons comme exemple les
travaux du père missionnaire Edmond Boelaert. Celui-ci
fut un ardent défenseur des populations indigènes pendant les
années cinquante, notamment par l'intermédiaire de la Commission
pour la Protection des Indigènes 66(*). Cette analyse va
porter sur l'Enquête menée par BOELAERT en 1954 sur la
propriété foncière chez les Mongo dans le contexte
colonial. Cette enquête comprend 45 entretiens
réalisés par le père Boelaert, repris et
édités par Honoré Vinck, l'actuel
directeur de annales Aequatoria.
Les annales Aequatoria sont les publications du Centre
Aequatoria, un Centre de Recherches Culturelles Africanistes. Leur domaine est
très varié : on y pratique
l' « étude des langues, des cultures et de l'histoire
(pré-coloniale et coloniale) de l'Afrique
sub-saharienne. 67(*)».
Les entretiens ont été réalisés au
début de la décennie 1950, et dans l'actuelle Province de
l'Equateur. Les personnes sont de différents milieux, on trouve ainsi
beaucoup d'élèves, de moniteurs, de personnalités
politiques (comme un Administrateur de Territoire ou des Chefs de District) un
juge-conseiller, deux catéchistes et trois autres personnes sans
véritable spécification. Les entretiens ont été
réalisés par lettres (des questions), d'où une certaine
exactitude des informations car les élèves ont eu la
possibilité de questionner leurs familles et leurs chefs de lignages par
exemple.
Boelaert E. part du principe qu'il y a un
décalage entre la vision de l'Etat Belge et celui des populations
autochtones. Selon l'administration, il y a des forêts sans
propriétaire. C'est cela que conteste le père, et c'est pour le
prouver qu'il réalisa cette enquête.
1. La propriété des
forêts.
Sur les 45 entretiens, pas un seul ne conteste le fait que la
forêt sans propriétaire n'existe pas.
A. Toute portion de terre a un propriétaire.
Pour ne citer que quelques exemples :
§ Pierre Mune, qui a la profession de
moniteur dans une école à Bomputu s'exprime ainsi dans le
troisième entretien: « Aucune forêt n'est sans
propriétaire ; même les forêts qui ne sont pas trop
souvent fréquentées par les gens à la recherche des biens,
celle-là ont des propriétaires. ».
§ Joseph Batokwa explique aussi cela en
d'autres termes, et avec un peu plus de
précision : « Tu ne trouveras jamais des
forêts sans propriétaires. Que ce soient des forêts vierges,
des forêts distantes ou des forêts anciennes, elles ne sont pas
sans propriétaires. »
B. Qui sont les propriétaires des
forêts ?
Les entretiens révèlent qu'il a trois sortes de
propriétaires qui se dégagent. Ces trois différents
« entités » se réfèrent aussi à
une échelle de temps particulière.
1. Le moins présent dans les entretiens, et le plus
ancien dans le temps : Dieu (Njakomba)
§ « Le monde entier appartient à
Dieu. Il avait partagé lui-même ce monde à ses enfants. Ce
sont les hommes. Dans ce partage du monde, il avait tracé des limites
tout en prévoyant la part de chacun. Dieu n'avait pas prévu que
quelqu'un pourrait ravir la part de son semblable. » Tels sont
les mots de Pierre Mune pour qui Dieu est le
« propriétaire du monde ».
§ « Depuis les temps immémoriaux, nous
savons que tous les hommes viennent d'Adam et d'Eve, les parents de tous les
hommes. Comme ils avaient donné naissance aux enfants, ceux-ci à
leur tour, ont donné naissance à leurs enfants et il y eut
beaucoup d'hommes sur la terre. Il (Dieu) ne leur a pas dit de vivre sur un
même endroit. C'est ainsi qu'ils se sont divisés en nombreuses
familles en nombreuses villes. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de villages et
villes disséminés comme vous le voyez dans l'Histoire Sainte.
Depuis la chute de la Tour de Babel il y eut diaspora de la race humaine.
Certains avaient traversé la rivière et certains
étaient restés sur place. Si y avait des gens un peu il partout.
Chaque village avait reçu un lieu de travail. C'est à-dire la
forêt. » Selon Gaston Efoloko, moniteur
dans une école.
Nous percevons bien la dimension temporelle dans ces deux
exemples. Dieu intervient dans l'histoire très ancienne, lors du
début de la présence humaine. On retrouve très
fréquemment l'expression « depuis les temps
immémoriaux », et cela dans presque tout les entretiens. Nous
constatons aussi l'influence de la religion chrétienne bien que celle-ci
soit plus ou moins intégrée dans la culture locale.
Néanmoins, on se réfère à Dieu pour ce qui est
très ancien lorsque la mémoire humaine se perd.
Dieu est également une explication pour
déterminer qui est propriétaire de la forêt .
Après lui viennent les ancêtres à qui il a
donné la propriété de la terre. Le Dieu des Mongo est
considéré comme un père biologique. Cette image du
père est liée à une certaine conception de
l'autorité : cette autorité de Dieu étant primaire et
primordiale (Hustaert G., 1980). L'échelle de temps est
donc plus récente. Les mots de Bassay Alphonse, lui
aussi moniteur explicitent bien ces idées :
§ « Le propriétaire de nos
forêts est Dieu, le créateur de toutes les choses. Viennent
ensuite nos premiers ancêtres qu'il (Dieu) avait
créés. »
2. Une référence obligatoire et
primordiale : les ancêtres.
Les ancêtres tiennent une place très importante
dans la culture Mongo, mais également pour l'ensemble des populations
Bantou. En effet, Dieu en tant que créateur n'est pas vraiment l'objet
d'un culte chez les Bantou. Des cultes ont lieu en ce qui concerne les esprits
tutélaires, mais « leur véritable culte est le
culte familial et tribal des mânes et des
ancêtres 68(*)». Le culte des ancêtres est plus
important que l'animisme vis-à-vis des puissances naturelles et
spirituelles. Chez certaines populations, les ancêtres peuvent même
être des divinités de premier ordre, plus important que Dieu
(Thomas L.-V. et Luneau R., 1969). Quel est
leur rôle dans l'appropriation des terres plus
précisément dans celui des forêts, pour cette
période ?
Voyons les mots des interviewés :
§ « Toutes les forêts ont des
propriétaires et cela remonte aux temps de nos ancêtres. Ceux-ci
sont les auteurs de notre terre. » Tels sont les dires
de Bassay Alphonse.
§ « Les ancêtres sont les premiers
possesseurs des forêts.» Selon Louis
Bosio, chef catéchiste à Yali, aidé par
quatre anciens du village, et Ambroise
Bondamba pour l'écriture de la lettre.
Ce rôle est primordial car il détermine à
qui appartient ensuite la forêt. C'est lié aux lignages, aux
clans, et à la généalogie. Si tel ancêtre avait
telle forêt, cela a perduré jusqu'aux générations
vivantes.
Les ancêtres sont le « fil
conducteur » dans le temps pour déterminer la
propriété présente de la forêt. Les ancêtres
peuvent être considérés comme des lignages
intermédiaires entre l'homme et Dieu. Nous en venons au temps
présent.
3. Le chef de lignage: le
détenteur (présent) de la propriété sur les
forêts :
Le propriétaire des terres est le père de la
lignée. C'est le gestionnaires des forêts et par là
même, des terres que lui ont laissées en héritage ses
ancêtres. Il a le pouvoir sur la forêt tant qu'il est en vie. Le
lignage tient donc une place cruciale dans l'appropriation des forêts. Ce
système de propriété est très ancien et il est
développé partout. Les détenteurs des forêts sont
tous des hommes dans les entretiens réalisés par le
Boelaert E.. Ces pères des lignées, puisqu'ils
descendent d'ancêtres ayant la propriété des forêts,
sont le prolongement familial. La propriété des forêts
n'est donc pas concevable sans ces personnes au pouvoir considérable.
§ « Le père de la progéniture
est le propriétaire de la forêt. C'est lui qui avait tracé
des limites entre lui et les villages voisins, et il avait distribué
à son lignage des portions de la forêt et il s'était
réservé lui-même une portion. » Selon
Joseph Bonkingo et les vieillards qu'il a interviewé
pour répondre aux questions du père.
§ « C'est au géniteur que retient le
problème de la forêt. Depuis les ancêtres, si le père
n'a pas abattu une forêt, l'enfant n'aura pas une jachère. On
parle d'une forêt depuis les ancêtres jusqu'au père qui t'a
engendré. » Louis Efonge.
§ « Pour ce qui concerne le village c'est
le père de sa lignée qui est a sa source. On n'a un village que
grâce au père de la lignée. Le village n'est pas une
personne pour avoir une chose, c'est une personne qui peut l'avoir. C'est la
raison pour laquelle le père de la lignée a une
forêt. » Selon le moniteur à Ingende :
Gabriel Ekonya.
On constate bien le rôle qui est attribué par les
coutumes au chef de lignage. Ces compétences sont vastes puisqu'il a un
pouvoir sur la terre mais aussi sur les hommes. En effet, le rôle des
forêts étant déterminant dans la vie des villages, cela
influence logiquement les hommes. Dans un même village, il peut y avoir
plusieurs pères de lignées, et dans ce cas, chacun dispose d'un
territoire forestier propre. Ce pouvoir des pères de lignées est
justifié par la généalogie, et aussi par Dieu. Les trois
« entités » se complètent pour donner une
légitimité forte au propriétaire pour que ce pouvoir ne
puisse pas être contesté.
Cette citation de Barthélémie
Yefa explique cette idée :
§ « Le propriétaire de nos
forêts c'est Dieu. C'est aussi le père de la
lignée .»
On assiste ici à une comparaison entre Dieu (le
Père) et le père de la lignée. Son pouvoir est donc aussi
d'ordre religieux car il a reçu ses terres du partage effectué
dans les « temps immémoriaux » par Dieu
lui-même.
4. Qui hérite des forêts à la mort du
père de la lignée ?
Une préoccupation forte est de ne pas laisser la
famille sans héritage, et dans le même temps, de ne pas laisser la
forêt sans propriétaires. Les deux se combinent et les
règles d'héritage sont les suivantes :
§ « Même si le propriétaire
est mort, ses arrières petits-fils y sont et ils doivent hériter
la forêt. Ils ne devront pas abandonner sans raison le bien de leur
ancêtre. C'est ainsi que toutes les forêts ont des
propriétaires. » Gabriel Ekonya.
§ « On ne parle pas de l'héritage si
ton ancêtre n'a rien laissé pour toi. Celui qui hérite
c'est le fils aîné du père de la lignée. Il
hérite comme les pères avaient eu en héritage les
forêts de leurs grands-pères, les possesseurs des
forêts : enfin c'est le tour du fils d'avoir une
forêt. » Louis fonge.
C'est la coutume qui fixe les règles de succession, et
c'est parce que les ancêtres (ici, les grands-parents, les parents) ont
hérité de la forêt, que le fils lui aussi aura sa
propriété. Si jamais la famille n'a pas de fils, ou si il y en a
plusieurs, des règles existent pour établir qui
hérite :
§ « Quand le propriétaire de la
forêt meurt, son frère cadet ou son petit-fils hérite de sa
forêt. Mais ; il est dit que s'il n'a pas de frères cadets ou
des enfants, qu'on cédera la forêt même à un
petit-enfant qui fait partie de ce lignage. La forêt ne reviendra pas
à la famille maternelle. » Selon André
Bondenge.
Il est même mentionné qu'un pygmée peut
hériter de la forêt si le propriétaire de la forêt
est son maître et qu'il n'a aucune descendance masculine.
Bien évidemment, ces règles qui organisent la
propriété ne sont pas écrites, il ne s'agit que de
règles orales transmises de générations en
générations. Ce qui veut également dire que ce savoir est
précieux et la personne qui hérite, en plus d'avoir des liens de
parenté avec les ancêtres, doit aussi avoir la connaissance
précise de ce savoir.
Ce savoir est vaste. Il faut connaître les
délimitations, connaître la forêt, par exemple : savoir
situer les endroits tabous ou interdits, ainsi que les zones dangereuses. Il
faut aussi connaître où se trouvent les ressources
précieuses pour la médecine, les rituels, etc. L'héritier
doit aussi être quelqu'un qui a appris la gestion des terres, la
diplomatie avec les autres villages ou les autres clans. Ces compétences
sont larges car il faut agir comme un père envers la famille, le clan,
être aussi instruit sur les rites religieux, les relations avec le monde
surnaturel que sont les ancêtres, les esprits de la nature, etc. Il peut
aussi avoir à agir comme un juge lors des conflits d'usages par exemple.
Il est aussi le propriétaire et il doit donc agir en conséquence.
Par exemple, défendre son bien (aspect primordial) mais il peut aussi
vendre certaines terres ou les louer à quelqu'un.
Le chef de lignage n'agit pas tout seul, on trouve des
notables, des anciens qui l'aident, le conseillent. Cela confère, aux
personnes âgées, un rôle fort car elles ont les
connaissances et donc la légitimitéaux yeux des villageois.
2. Les délimitations spatiales entre les
différents propriétaires des forêts.
De la même manière que toutes les forêts
ont des propriétaires, toutes les forêts ont logiquement des
noms.
Puisque chaque forêt appartient à quelqu'un, il y
a des limites de propriétés. Ces limites ne sont pas connues de
l'Etat mais elles le sont des populations locales. C'est du moins ce qui
ressort des enquêtes.
§ « En effectuant de longues distances dans
ce monde, tu trouveras des limites entre les villages ou entre les lignages.
C'est un véritable constat car ils avaient tracé les limites
lorsqu'ils se partageaient les forêts. Dans nos villages, nous avons
certaines forêts proches de nous, et si deux personnes font leur deux
champs à proximité, ils doivent tracer la limite entre ces deux
champs. » D'après Pierre Mune pour qui
les limites sont des facteurs pour expliquer que toutes les forêts ont
des propriétaires.
§ « C'est entre les villages que nous
voyons les limites des forêts. Ceux qui connaissent ces limites ne sont
que les autochtones. » Pierre
Célestin.
Ces limites sont la plupart du temps des frontières
naturelles : les cours d'eau servent de délimitation dans de
très nombreux exemples. Le réseau hydrographique étant
très développé dans tout le bassin du Congo, c'est un
élément qui fractionne l'espace, et les populations humaines ont
utilisées les avantages de ce réseau. De plus, la pêche
étant pratiquée par les Mongo, il est très important pour
une famille ou clan par exemple, d'avoir un accès aux poissons et aux
cours d'eau qui servent également de voies de communications.
Parfois, les limites sont définies avec une
extrême précision, que les propriétaires se trouvent dans
des situations confuses. Ghislain Nkonyi donne un exemple
frappant :
§ « Quelqu'un avait reçu tout un
lac, c'est-à-dire, les eaux du lac seulement, mais en voulant accoster
sa pirogue sur le bord du lac, un certain lignage vint lui dire qu'il n'avait
que les eaux du lac, et non le bord car son ancêtre n'avait pas
été le propriétaire de cette partie de la terre. C'est
étonnant mais c'est vrai. »
Ce cas précis et peu commun illustre bien le fait que
les limites sont précises et qu'on ne s'approprie pas la terre de
manière facile. Les règles de partages sont établies
depuis longtemps et elles ne semblent pas avoir beaucoup évoluées
depuis les lointains ancêtres.
Pour autant, si les règles ont peu changé, les
limites de propriété ne sont pas figées. Les guerres les
ont fait évoluées dans le temps, car pendant la période
pré-coloniale elles fûrent majoritairement le seul moyen d'obtenir
de nouvelles forêts.
§ « Du vivant de nos ancêtres
jusqu'à maintenant, nous avons un problème sérieux relatif
à la forêt. Les propriétaires des forêts n'ont jamais
toléré qu'un certain village s'attribue leurs forêts. Si
quelqu'un s'en attribue, il y aura une guerre, et beaucoup de gens auront
à perdre la vie. » Selon Odilon
Lokwa.
Lorsqu'un conflit foncier opposait deux protagonistes, et si
aucune issue ne venait résoudre le conflit, c'est la guerre qui
déterminait à qui devait appartenir la forêt.
L'Etat Belge, et l'Etat de la RDC aujourd'hui on un rôle
d'arbitre des conflits. Cela explique pourquoi les guerres tribales concernant
la propriété des forêts n'existent plus aujourd'hui.
3. Comment obtient-on une portion de
terre ?
Les forêts et les terres étant toutes
appropriées, la question de l'obtention de portions de terres se pose.
Dans quelle mesure la forêt peut-être allouée à une
personne du village, mais aussi à une personne étrangère
telle qu'un immigrant ou bien un européen ? Voici ce que
répond Marc Bolumbu aux questions du
père Boelaert :
§ « Si les immigrants et les
étrangers demandent au propriétaire de la forêt un endroit
pour faire les champs ou pour construire des maisons, peut-être pour y
habiter, le propriétaire de la forêt ne peut pas les interdire.
Mais le propriétaire de la forêt ne peut pas leur céder la
forêt pour toujours. Personne n'a le droit de vendre une portion de sa
forêt. Car la forêt d'un homme n'est que la conservation de tous
ses biens. Il capture des poissons, des gibiers, des chenilles et certaines
choses à partir de sa forêt. Sauf les Blancs s'ils achètent
une portion du terrain, et c'est à ce moment que le village leur donne
une portion de terrain acheté. Mais l'on ne distribue pas la
forêt. Non.»
On voit bien avec ces paroles que la forêt peut
être cédée à une personne étrangère au
village, mais il y a des règles précises pour obtenir cette
propriété. M. Bolumbu affirme que l'on ne peut
vendre la forêt, pourtant d'autres entretiens le contredisent comme
Joseph Batokwa :
§ « Le propriétaire de la
forêt peut vendre une portion de sa forêt. Comment peut-il la
vendre ? Il la vend s'il a une dette, et comme il n'a pas d'argent
à donner à son créancier, il lui remet une portion de sa
forêt. »
Il est marquant de constater que la forêt peut servir de
moyen de paiement. Ainsi, une portion de forêt peut servir pour payer une
dette pour un mariage, ou pour payer une indemnité de mort. Cette
indemnité de mort est demandée en cas de faute grave, et si
l'accusé n'a pas l'argent pour payer la somme requise, il doit
céder une portion de forêt.
Cependant, il n'est pas recommandé de vendre sa
forêt car cela pénalise les générations futures du
lignage ou du clan, qui disposeront de moins de terres et seront moins riches
que leurs ancêtres. C'est pour cette raison que vendre sa forêt est
parfois considéré comme un acte fou, insensé. C'est ce que
résume ces mots de Arsène Pambi :
§ « Un père qui est riche mais
imbécile, peut gaspiller sauvagement ses biens sans toutefois se rendre
compte qu'il a derrière lui une grande famille. Et il peut aussi vendre
sa forêt aux gens qui en manquent. Pense-t-il qu'il aura une autre
forêt et d'autres biens ? Ils vont errer ça et là et
ils deviendront des cancres. Nous ne pouvons pas distribuer nos forêts
car Dieu ne viendra pas créer un autre monde. »
Ces paroles montrent bien quelles peuvent être les
conséquences dramatiques d'une mauvaise gestion des forêts. Cela
pénalise les futurs propriétaires des terres issu du même
lignage. Les erreurs ne s'effacent pas, et lorsqu'une forêt est vendue,
elle est perdue à jamais. Cela occasionne des tensions entre les
nouveaux propriétaires et les anciens.
La mauvaise gestion de la propriété du clan, du
lignage est donc la plus grave erreur qui puisse être commise. La
forêt étant souvent tout ce dont dispose le clan ou le lignage,
perdre cette richesse équivaut à être complètement
démuni.
Être chef des terres est donc une responsabilité
lourde qu'il ne faut pas prendre avec légèreté sous peine
de se voir condamné à la pauvreté. De même, les cas
d'adultère peuvent aussi être des raisons qui peuvent faire perdre
des portions de forêts aux clans. La pauvreté est aussi une cause
de la perte de forêt. Si le propriétaire est dans un état
de besoin extrême, il peut être contraint de vendre une partie de
sa forêt.
Après avoir tenté de comprendre comment les
règles d'appropriation chez les Mongos en 1954, nous allons nous pencher
en détail sur la situation actuelle d'un village. L'interrogation
principale est la suivante : les pratiques foncières sont-elles
similaires ? Quelles sont ces pratiques ? Selon quel type d'utilisation de
l'espace (chasse, pêche, agriculture, plantations, etc) ? Nous
allons aussi tenter de voir quelles sont les interactions spatiales entre la
société et le domaine foncier.
Chapitre 4
Les règles foncières selon les modes
d'utilisations de l'espace : étude de cas à l'échelle
d'un village
Cette analyse reprend les recherches effectuées dans la
localité de Boondjé. Ce village se situe le long de l'axe routier
entre Basankusu et le groupement de Bongilima. Long d'environ quatre
kilomètres, la population de ce village est répartie le long de
la route. L'activité principale est l'agriculture, principalement le
maïs et le manioc, viennent ensuite la chasse et aussi la pêche,
lors de la saison sèche.
Les informations requises sur les pratiques foncières
et la gestion locale ont été obtenues avec les populations d'une
partie du village, toutes n'ont pas été consultées.
Seulement quelques clans sont à l'origine de ce travail.
Cette partie va être donc consacrée à
décrire les aperçus de la pratique foncière des
populations Mongo. Par exemple, en comprenant quel est le rôle d'un chef
de terre, ou encore en analysant les droits d'usages selon le type de ressource
(forestières, agricoles, etc).
On distingue ici deux types d'espaces. Le premier est
fortement approprié par les populations, cela va concerner les
habitations, les zones cultivées, les plantations, etc. Le second se
situe plus en zone forestière. Il va concerner les pratiques de chasse,
mais aussi de pêche pour les ruisseaux.
Le premier type d'espace est situé le long des routes,
et dans un périmètre peu éloigné autour des lieux
d'habitations
1. Les espaces anthropisés.
A. L'habitat.
Il n'y a pas de restrictions pour l'établissement de
maison à l'échelle du clan. Chaque personne d'un même clan
a le droit de construire sa maison où il le souhaite. Le chef de lignage
peut tout de même s'opposer à la construction d'une maison sur ses
terres, mais dans la pratique, il ne refuse jamais à quelqu'un de son
groupe de s'établir sur ses terres. Cela est beaucoup plus
compliqué lorsqu'une personne étrangère au clan, ou au
groupement demande la permission de s'établir sur les terres d'un clan.
Bien que cette pratique d'accueil ait été fréquente dans
le passé, il semble qu'aujourd'hui cela soit moins facile. La pression
sur les terres étant plus forte qu'auparavant (avec l'augmentation des
surfaces agricoles), des freins existent actuellement pour l'implantation de
familles et de lignages étrangers au groupement. Au sein d'un lignage,
lorsqu'un fils désire s'installer seul, le père de la
lignée lui donne son accord, et lui choisit un lieu où
s'implanter. Pourtant, les habitations ne donnent pas de droit de
propriété sur le sol. Seul le travail permet de s'approprier la
terre. C'est ainsi qu'une famille peut être accueillie par le clan A,
mais c'est le clan B qui va donner une parcelle de terre pour l'agriculture ou
pour réaliser une plantation. En effet, le clan A ne veut pas
céder des terres, malgré le fait que la famille vive sur ses
terres.
B. Les plantations : le droit de l'arbre.
Que ce soit des palmeraies ou des bananeraies, elles sont
localisées très fréquemment à proximité des
habitations, et cela pour plusieurs raisons. Il est plus pratique pour la
cueillette que les plantations ne soient pas trop éloignés :
donc pour faciliter l'usage. Il est également plus facile de surveiller
les fruits vis-à-vis des voleurs, car lorsque la cueillette des fruits
est proche, cela peut attirer la convoitise. Dans ce sens, certains
propriétaires disposent des pièges pour protéger certains
arbres fruitiers (par exemple, un piège à fils déclencheur
relié à une brique de terre). Les principaux arbres fruitiers,
autres que les palmiers et les bananiers sont les safoutiers et les papayers.
Il y a aussi des raisons biologiques à l'établissement de
plantations proche de l'habitation. Les déchets ménager, surtout
ceux de la cuisine sont donc volontairement situés à
côté de bananiers qui vont bénéficier de ces apports
nutritifs. On trouve aussi des bananiers dans les jachères, ou dans les
forêts secondaires, mais de manière diffuse et il ne s'agit pas de
plantation en tant que telle. Le propriétaire de la bananeraie est la
personne qui a planté les arbres.

Photographie 6
Une bananeraie située à quelques
mètres derrière les habitations du
propriétaire.

Photographie 7
Une bananeraie et son
propriétaire.
Le type de plantation le plus répandu est la palmeraie.
Les palmiers fournissent beaucoup de produits aux habitants (huile, balais,
toitures, poutres, savon, etc.), ils sont donc un signe de richesse, et les
arbres en général sont des ressources indispensables pour les
populations, ils sont au coeur de l'économie rurale. Tout comme les
bananeraies, les palmeraies appartiennent à la personne qui a
travaillé pour l'obtenir. Elle nécessite par ailleurs un travail
important, et c'est le rôle des hommes du lignage de les entretenir. Les
palmeraies peuvent donc appartenir soit au clan, soit à une personne. Le
cas le plus fréquent est l'appropriation par foyer. Le travail est
encore une fois synonyme d'appropriation, si bien que, si quelqu'un
n'entretient plus sa plantation et que les broussailles l'envahissent, le droit
de propriété cesse. Lorsqu'une famille s'établit sur les
terres d'un clan qui n'est pas le sien, les arbres qui se situent proche de son
lieu de vie ne peuvent lui appartenir. Lors de l'abatage pour réaliser
un champ, les arbres tombés reviennent au clan propriétaire. Sa
propriété sera ce qui poussera par la suite. Une
différence s'opère entre les autochtones et les allochtones.
La palmeraie est généralement située
à côté de l'habitation du propriétaire. Cela rend
l'utilisation facile d'autant plus qu'elle peut être fréquente.
Cela facilite aussi la surveillance lorsque les fruits (noix) sont à
maturités. Les plantations permettent également de faire une
barrière de protection entre les habitations et les champs
cultivés. En effet, l'élevage se pratique par
« divagation ». Les chèvres, moutons et les rares
porcs se déplacent librement, et les plantations les empêchent de
se rendre dans les champs pour nuire aux récoltes. Certaines palmeraies
peuvent être grandes, selon les ressources financières
disponibles, car les plants sont chers. Cela explique pourquoi les palmiers
utilisés sont souvent des races sauvages, les plants
améliorés étant chers 69(*).

Photographie 8
Une petite palmeraie
.
Il existait avant la guerre des plantations de
caféiers, mais elles semblent ne pas avoir perdurées
jusqu'à lors. En effet, le café ne permet pas des revenus
réguliers comme pour les palmeraies. Les rentes sont donc plus
sporadiques. Et par ailleurs, cela ne permet pas se nourrir. La création
d'une caféraie étant uniquement à but commercial. C'est
également une culture exigeante par rapport au climat.
C. L'agriculture.
Chaque famille dispose de ses propres parcelles, et de ses
propres jachères. Il n'existe aucune famille ni aucun lignage qui ne
pratique pas l'agriculture. Très répandu, l'agriculture concerne
principalement le maïs et le manioc, et plus rarement l'arachide, le
niébé ou encore l'igname. Le maïs est plutôt une
culture de rente et le manioc se situe entre l'autosubsistance et la culture de
rente. La proximité de zone urbaine entraîne souvent ce type de
cultures.
Lorsqu'une personne décide de défricher pour
faire l'agriculture elle demande au père de la lignée. Un
père d'une lignée ne peut refuser à un membre de sa
famille une portion de terre. L'agriculture se pratique donc sur les terres
lignagères. Le clan n'étant plus toujours une autorité
forte sur les terres par rapport aux différents lignages qui le compose.
Ainsi, lorsqu'un fils décide de ne plus travailler dans la parcelle de
son père, il demande une portion de terre. Cette portion de terre
(souvent une jachère), une fois cédée, appartient à
la personne qui la travaille. Il devient donc propriétaire. La personne
qui défriche une jachère pour faire son propre champ
réalise elle-même les limites de son champ, dans la mesure
où cela ne gène pas le père de la lignée, et les
autres champs du lignage. Le père de la lignée peut favoriser un
fils plutôt qu'un autre, en donnant une bonne terre à celui qu'il
préfère.
Pour les personnes cherchant à cultiver sur des terres
ne leur appartenant pas, il existe diverses possibilités. Il est
possible de louer une partie de terre. La durée d'une location va
dépendre des plantes cultivées. Cette durée peut
être de quelques mois à quelques années. Ces contrats de
locations peuvent être de différents types. Le propriétaire
peut avoir recours à de la main d'oeuvre pour défricher. Dans ce
cas, le défricheur peut avoir le droit de cultiver du maïs, mais il
doit laisser une partie de la parcelle défrichée au
propriétaire pour cultiver du manioc le plus souvent. Cette partie
laissée au propriétaire dépend du contrat passé
entre les deux personnes. Réalisé de manière orale, ce
contrat est avantageux pour le défricheur qui ne dispose pas de terres
pour cultiver, et le propriétaire bénéficie d'une partie
du travail du locataire pour sa propre récolte. D'une manière
générale, la partie laissée au propriétaire ne peut
pas excéder le tiers de la superficie.
Un autre cas existe pour la location. Le propriétaire
laisse à certaines femmes le droit de cultiver du manioc ou de l'igname
sur une de ses parcelles de maïs. En échange de cette mise à
disposition de terres, elles vont pratiquer le désherbage obligatoire
pour la culture du maïs. Il y a donc une association de culture. Le plus
souvent c'est le manioc qui est cultivé par ces femmes. Elles n'ont pas
le droit de cultiver le maïs car cela nécessite d'autres contrats.
Il est aussi possible de louer une terre à un propriétaire, et
les droits de jouissances coutumiers seront définit entre les deux
personnes. Il s'agit en général d'une partie des récoltes,
souvent 10% de celles-ci, mais c'est au propriétaire de définir
ce qu'il désire. Cela peut être de l'argent, des biens selon les
besoins. Chaque demande de terre en location impose d'informer le chef du
groupement ou le chef du village selon les cas, selon les disponibilités
de chacune des autorités.
Photographies 9 et 10 :
A gauche, un champ défriché et les
femmes y travaillant.
A droite, une jeune parcelle de
maïs.

2. Les espaces naturels : forêts et
cours d'eau.
On considère ici les espaces naturels comme des espaces
peu marqués dans le paysage par l'activité humaine. Il s'agit
donc des zones périphériques aux villages. Il y a une
différenciation qui se fait en matière de droit foncier entre les
ruisseaux, les rivières (les zones humides), et la forêt. Le
système foncier ne régit pas de la même manière ces
deux types d'espaces, car les usages sont différents. Les usages
forestiers sont nombreux. Ils concernent la chasse, la cueillette d'arbres
fruitiers, le bois, mais également toutes autres ressources
forestières non-ligneuses.
A. La forêts : à l'origine de nombreuses
ressources.
Chaque clan dispose de ses propres forêts.
L'appropriation des forêts ne se fait pas vraiment au niveau du lignage,
mais au niveau supérieur qu'est le clan. La forêt est
revêtue d'une grande importance car elle pourvoit de nombreuses
ressources essentielles aux Mongo.
Pour commencer nous allons nous intéresser à
la chasse en relation avec les droits d'usages. Dans le
village où se sont déroulés ces enquêtes, la chasse
n'est plus une pratique très encadrée par des règles
précises de propriété. En effet, les droits d'usages sont
directement liés à la présence d'une ressource. De ce
constat découle un « relâchement »
vis-à-vis de la chasse. Tout le monde peut ainsi chasser sur les terres
du village. Par exemple, une personne du clan A peut chasser sur les terres du
clan B sans que cela pose des problèmes. Le chasseur est en effet le
propriétaire du gibier qu'il a lui même chassé, et cela ne
s'oppose pas au partage qu'il fait avec le propriétaire de la
forêt.
Dans d'autres groupements, par exemple, en zone
forestière très enclavée, où se trouve encore du
gibier en abondance (singes, céphalophes, etc), des règles
très précises encadrent cette pratique. Un chasseur
étranger au clan ou au village où il se rend pour chasser
à l'obligation de consulter le chef coutumier. Lors de cette
consultation, le propriétaire des forêts peut demander des dons
comme de l'argent, des cartouches de chasse, ou encore une portion de viande.
Ces règles existent depuis longtemps mais elles semblent s'être
assouplies par rapport à la situation qui prévalait il y a
cinquante ans. En effet, chasser sans l'accord du chef sur les terres d'autrui
pouvait être sévèrement punit : la punition pouvant
aller jusqu'à la mort du chasseur. Dans ce cas, le propriétaire
pouvait aller jusqu'à demander une « rançon de
mort » : une somme à payer pour que la vie soit
laissée au chasseur.
Un autre exemple illustre très bien le rôle que
pouvait avoir le chef : lorsqu'un animal important était
tué, il était obligatoire de faire un partage selon des
règles très précises. Certains animaux étaient
considérés comme royaux : le
léopard (Nkoy), ou encore Bonkono (en
lomongo cela désigne un félin de petit taille, tacheté
comme léopard). Symbole des clans guerrier, la peau de léopard
revenait au patriarche du clan. Aujourd'hui, il semble que cela ne se pratique
plus que dans certaines forêts très enclavées.
Malgré tout, quelqu'un qui se fait surprendre par le propriétaire
coutumier des forêts peut se voir saisit de tout ces biens (armes de
chasse, gibier abattu, etc.). Une croyance existe aussi concernant la chasse.
Elle dit que celui qui ne se présente pas au chef ne pourra rien chasser
car cet accord avec le chef coutumier est synonyme d'abondance de gibier.
Autrement dit, c'est par la consultation du chef que le gibier sera
chassé. Cette règle vaut aussi pour la pêche.
Un autre type de chasse existe : par
piégeage. Ils sont disposés dans les
forêts, parfois très loin des lieux d'habitations, et parfois, un
chasseur peut en avoir plus d'une centaine. Ils vont concerner de petits
mammifères (des rats par exemple), mais ils peuvent aussi concerner des
singes ou des céphalophes. Il est possible que certains
propriétaires refusent qu'une personne dispose des pièges sur ces
terres, mais cela semble ne pas être le cas lors des enquêtes. Il y
a souvent des arrangements entre les deux protagonistes : le
piégeur offre s'il le faut, une portion de sa chasse au
propriétaire de la forêt concerné. Le droit de regard sur
la pratique de la chasse par les pièges n'est pas facile dans la mesure
où certaines terres sont vastes.
B. Les lieux d'eau : sources, ruisseaux et
rivières.
L'eau étant une ressource vitale, chaque lignage a
établi ses habitations à proximité d'une source. Chaque
source est donc appropriée par plusieurs familles (ou foyers). La
répartition des sources explique en partie la répartition des
lignages, et donc des populations. Cela peut être un facteur limitant
l'implantation de population, lorsque toutes les sources proches des routes
sont appropriées, où bien, lorsque les sources sont
éloignées des routes et des zones de peuplement.

Photographie 11 Photographie 12
Source Ekiloko appartenant au lignage Nkoy Pose d'une
nasse sur une clotûre de pêche
Les sources étant le point de départ d'un cour
d'eau, les ruisseaux vont donc avoir des propriétaires. En effet, le
poisson fait partie des ressources importantes pour les populations. Les Mongo
pratiquent le piègeage à l'aide de nasses disposées selon
le sens du courant, et selon la saison. D'une manière
générale, chaque clan et chaque lignage qui est présent
depuis longtemps sur les mêmes terres dispose d'une portion de ruisseau
qui lui appartient. C'est-à-dire, que les ressources dispensées
par le ruisseau sont appropriées, et il semblerait que ce soit
l'administration coloniale qui ait réparti les différentes
portions de ruisseau pour les clans et ensuite pour les lignages. Mune
P. affirme même que les domaines de pêches peuvent, dans
certains cas, appartenir à une personne. Un même ruisseau peut
avoir différents propriétaires. Un ruisseau est donc
divisé en portions bien délimitées selon les
propriétaires. Certaines portions peuvent aussi être
collectives : c'est-à-dire qu'une portion peut appartenir à
un clan. Dans ce cas, l'appropriation se fait par le travail : quelqu'un
qui attrape des poissons en est le propriétaire. En revanche, si le
propriétaire d'une partie de ruisseau a recours à l'aide d'autres
personnes (par exemple pour l'écopage collectif réalisé
par les femmes, l'endiguement pour la réalisation de clôtures, ou
bien la saisie des poissons), ces personnes recevront une partie des poissons
capturés. Ce partage est très important. La pratique de la
pêche se réalise de deux manières différentes, et
ces deux manières ne sont pas gérées de la même
manière. Ainsi, tout le monde peut pratiquer la pêche à
l'hameçon. Aucune restriction semble exister pour cette pêche.
En revanche, la pose de nasses nécessite un accord
passé avec le propriétaire. Entre l'individu et le
propriétaire, la « location » d'une portion de
ruisseau se réalise par des dons, également appelé des
droits de jouissance. Le chef du lignage Bokewa explique ainsi qu'une
personne du groupement voisin lui a remis un porc en échange de la pose
de nasse sur une partie du ruisseau Kungu, et cela pour une année. Un
problème s'est posé lorsqu'une fois l'année
écoulée, les droits de jouissance n'ont pas été
prolongé. Le « locataire » s'est donc vu interdire
l'accès au ruisseau. Les droits de jouissance peuvent être
très variés. C'est le propriétaire qui décide ce
qu'il veut en échange. Cela peut ainsi être de l'argent, mais
aussi une partie des poissons capturés, ou autre. Il semblerait que
cette pratique ait évolué dans la mesure où la pose de
nasse était non-restrictive auparavant (cf. Annexe 5 :
Tableau récapitulatif des droits d'usage, p. 161).
Les forêts et les ruisseaux ont donc des règles
de propriétés précises et distinctes. Il est possible que
la forêt et un ruisseau à proximité aient différents
propriétaires. Si un conflit existe entre les deux propriétaires,
le propriétaire de la forêt peut en interdire l'accès en
pirogue au pêcheur propriétaire.
3. Les limites entre les
propriétaires.
Les limites sont très importantes. Il n'existe pas de
carte, ni de cadastre agricole à l'échelle des villages, alors
les limites sont liées à des éléments naturels. Il
peut s'agir très souvent d'un arbre de forêt primaire (trop
volumineux pour l'abattage), mais aussi les ruisseaux ou des buttes de terres
(appelés collines). Il peut aussi exister des éléments
servant de limites, crées uniquement à cet effet. Il peut s'agir
d'arbres fruitiers, ou encore de rangées de fleurs. Les sentiers en
dehors de la route servent aussi dans certains cas de limites de
propriétés. Il est aussi possible que des troncs d'arbres soient
disposés en ligne sur le sol pour différencier les
propriétaires des champs. Ces limites concernent dans la majorité
des cas l'agriculture et les plantations, les zones de forêts
n'étant souvent pas appropriés de la même manière.
La forêt ne peut appartenir à une famille précise, elle est
la propriété d'un clan, et plus fréquement d'un lignage.
Les buttes ont une importance car elles servent de
repères dans l'espace. N'ayant pas d'unité de mesure, les
habitants estiment leurs propres superficies selon ces buttes. Par exemple un
hectare est l'équivalent de deux buttes sur une même parcelle
agricole.

Photographies 13 et 14
A gauche : limite lignagère (arbre
Entandrofihragma Congoense ou
Lifake en lomongo)
A droite : limite clanique, située le long de
la route, délimitant les clans Bokolo et Baolongo (arbre Dacryodes
Eduli : Safoutier)
Chapitre 5
L'interdépendance entre la structure familiale
et la gestion des terres
« Dans la conception endogène et
traditionnelle, l'affectation de l'espace vise principalement à assurer
la reproduction du groupe dans ses dimensions matérielles, sociales et
idéologiques ».
Le Roy E.70(*)
Pour illustrer les interactions entre l'appropriation des
terres et la société, le cas d'un clan va être
présenté. Il s'agit du clan Bokolo, aujourd'hui divisé en
plusieurs lignées. Certaines de ces lignées ne sont pas
originaires du groupement, et d'autres y vivent depuis très longtemps.
Cette différence est intéressante dans la mesure où les
situations ne sont pas les même selon que les lignées sont dites
autochtones ou allocthones.
Les informations cartographiques ont été
obtenues par des relevés GPS, avec les différents chefs de
lignées. Toutes les terres ne vont pas être concernées par
cette cartographie participative. Les domaines forestiers sont exclus, il
s'agit seulement du finage agricole. Les forêts de chaque lignage sont en
effet très étendues (plusieurs kilomètres de long pour les
lignages originaires du village), et le manque de temps pour les recherches n'a
pas permis de réaliser cette cartographie.
1. La généalogie et
l'évolution du finage.
La structure familiale et la manière dont elle change
dans le temps se répercute sur l'appropriation des terres. Un lignage
présent il y a 100 ans sur des terres peut aujourd'hui avoir
engendré plusieurs autres lignages. Chaque groupe a donc obtenu des
terres pour ses activités agricoles ou autres. Cette évolution de
la structure sociale va donc se traduire par une fragmentation accrue des
terres. Cette corrélation entre la société et le foncier
est un trait marquant de la société Mongo, et l'imbrication entre
les deux est très forte. C'est ce que tente de montrer les deux
schémas suivants. Ces évolutions se font sur une échelle
de temps importante, au minimum un siècle. Il n'est pas possible de
dater cela avec précision.
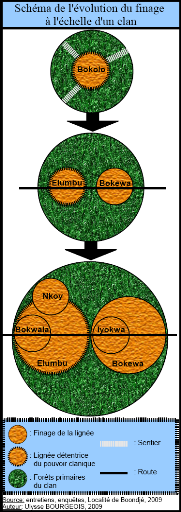

Figure 7 (à gauche) et 8 ( ci-dessus à
droite).
On constate que le clan s'est fractionné au fur et
à mesure que la population de chaque famille a augmenté. L'espace
autrefois réservé à un lignage est donc logiquement devenu
trop restreint, et le clan s'est séparé en deux lignages. Cela a
permis à chaque lignée d'avoir des terres plus vastes, sans que
la proximité engendre des conflits d'usages. Ensuite, et c'est la
période la moins éloignée dans le temps, d'autres
lignées ont été accueilli par les lignées
propriétaires des terres. Cet accueil a sûrement été
réalisé lorsque l'activité agricole n'était pas
aussi importante qu'à l'heure actuelle. En effet, il ne serait plus
possible pour les lignages Bokewa et Elumbu que d'autres lignées
puissent disposer de terres agricoles. Par ailleurs, un lignage peut accepter
d'accueillir des lignées, seulement pour les habitations, et non pas
pour les terres agricoles. Ainsi, les habitations du lignage Nkoy se trouvent
sur les terres de Bokewa, mais c'est Elumbu qui lui a donné des terres
agricoles.
Le pouvoir du clan s'est transmis dans la lignée
Elumbu, car l'ancêtre Bokolo y est affilié par la parenté.
Il faut préciser que le clan n'est plus une structure importante
à présent. Le pouvoir des clans est de moins en moins fort. Peut
être pas dans toute la région, mais, ce sont les lignées
qui ont actuellement de l'importance. Même si certaines
cérémonies ont toujours lieu à l'échelle du clan,
ce type de pouvoir disparaît peu à peu.
2. La répartition des terres entre les
lignées du clan Bokolo.
A. Vue générale des terres et des
lignées.
Nous allons donc nous pencher plus en détail sur le
partage de l'espace entre les lignées. Cet espace est approprié
dans la mesure où il est exploité par la population. Etant
donné que le travail garanti des droits de propriétés,
chaque espace où travaille telle ou telle lignée lui
appartient.
On constate tout d'abord que les lignées
présentes depuis longtemps sur ces terres vont avoir de plus grandes
terres que les lignées qui ont été accueillies plus
récemment. La carte schématique ci-dessus permet d'observer cela.
Cette carte ne représente pas l'ensemble du clan Bokolo. Il ne comprend
pas le lignage Bokewa. Néanmoins, les lignées présentes
permettent d'observer des cas variés : des lignées anciennes
et d'autres récemment installées sur les terres du clan.
Figure 9 :
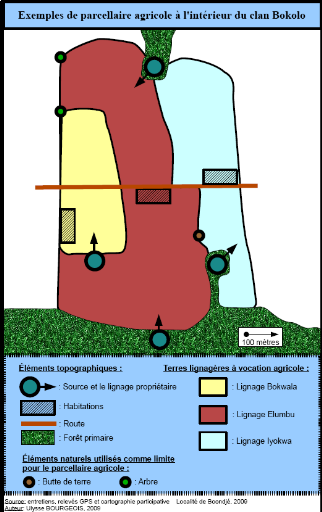
On peut observer comment est organisé l'espace
« vital » de chaque lignée. Les limites entre les
différents lignages sont souvent liées à des
éléments naturels qui servent principalement de repères
dans le paysage. Les habitations sont situées le long de la route, et
c'est de manière concentrique par rapport à la route que se
déploie l'espace agricole. En effet, les terres autour des routes sont
essentiellement liées à l'agriculture, et aux plantations. On
constate aussi une certaine répartition des sources. On peut voir que
le lignage Elumbu dispose de deux points d'eau, contrairement aux autres
lignées. Plus l'espace lignager est vaste, plus la lignée est
ancienne sur ces terres. Ainsi, entre les lignées Iyokwa et Bokwala
(non-originaires du village), il peut y avoir des disparités. La
lignée Iyokwa est en effet plus ancienne que Bokwala, la superficie des
terres exploitées va donc être plus importante.
Pourtant, ces deux lignées se trouvent dans une
situation de plus en plus exiguë : le manque de terre entraîne
une exploitation agricole de tout leur espace respectif. Cela entraîne
dans certains cas des conflits d'usages.
B. L'espace propre à chaque lignée.
1. Les lignées dont les origines
généalogiques sont étrangères au village.
Figure 10 : Figure
11 :
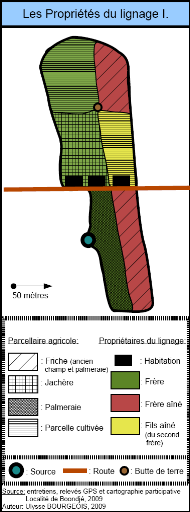
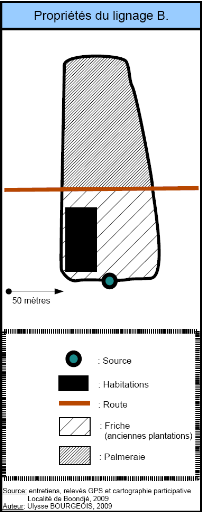
Ces deux représentations des terres lignagères
montrent comment sont réparties les terres au sein des lignages, et cela
montre aussi quelles peuvent être les différences entre deux
lignées non-originaires du village.
Les terres du lignage B (à droite) ont
une superficie assez faible. Cela va avoir des conséquences, car les
fils du chef de la lignée ne vont pas pouvoir accueillir
d'épouses facilement car les terres ne peuvent plus s'étendre.
Lors d'un mariage, c'est la femme qui, en théorie, vient vivre sur les
terres de l'époux. Pourtant, lorsque cela est difficilement possible,
l'époux peut obtenir de la part de la lignée de l'épouse
des terres si ce lignage en dispose. Ainsi, un fils s'est marié avec une
femme du groupement voisin, ce qui permet de cultiver plus facilement que sur
l'espace représenté ci-dessus. On peut voir qu'il y a des friches
dans la partie sud de la route. Cela vient du fait que la terre n'a pas pu
être cédée à nouveau à cause de
rivalités avec la lignée qui peut autoriser la mise en place
d'une autre plantation. Les propriétaires sont la lignée Elumbu,
et ils ne permettent pas au lignage B. de renouveler sa palmeraie. C'est un
phénomène plutôt néfaste pour la lignée B
dans la mesure où on lui refuse d'exploiter la terre, et ainsi, elle
doit chercher à étendre ses terres pour vivre, en dehors du
village. Le mariage dans ce cas est donc un moyen de s'approprier la terre car
il peut donner des droits d'exploitation.
Le lignage I ( à gauche), est lui
aussi de petite taille. Néanmoins, il dispose de palmeraies, et
d'espaces agricoles plus étendus que pour le lignage
précédent. Les terres sont réparties entre les hommes les
plus âgés du lignage. Chaque frère a donc ses
propriétés : plantations et champs. Un des deux
frères dispose de plus de terres que l'autre (en vert sur le
schéma). Cela s'explique par le fait que le frère
aîné n'est plus en mesure de travailler la terre à cause de
son âge. Ses propres parcelles ne sont donc plus exploitées et sa
palmeraie n'est plus vraiment entretenue. Le travail d'entretien d'une
palmeraie est en effet difficile et doit bien évidemment être
continuel dans le temps.
On peut voir qu'un des jeunes fils a obtenu une terre qui lui
est propre (en jaune). Il y pratique l'agriculture. C'est son père
biologique qui lui a donné une parcelle cultivable dans une ancienne
jachère, comme c'est très souvent le cas. Le père est
libre de répartir à ses fils des terres selon sa propre
volonté. Par exemple, un fils est très travailleur : le
père va lui donner à exploiter des terres vastes au possible. Il
n'y a pas de règle précise, mis à part qu'un père
ne peut pas refuser à un de ses fils de cultiver une parcelle. Ce
système de répartition des terres est différent de la mise
en place d'une palmeraie. Il est plus complexe qu'un jeune fils dispose d'une
palmeraie, du fait du coût élevé inhérent à
sa mise en place. De la même manière que le fils dispose de son
propre espace pour cultiver, il va disposer de sa propre maison familiale. Les
deux semblent fréquemment corrélés.
On observe aussi que l'espace réservé aux
jachères est plus faible, dans la mesure où la pression sur les
terres s'accroît plus le lignage devient étendu. La durée
de culture est de deux années environs, la jachère elle
nécessite quatre ou cinq années pour pouvoir être à
nouveau mise en culture. Donc, la pression est forte sur un espace bien
délimité, ce qui peut entraîner, au fur et à mesure
que la population du lignage s'agrandit, une augmentation des terres
cultivées en zone de forêt primaire. Elle se situe au delà
de l'espace représenté sur ces deux schémas.
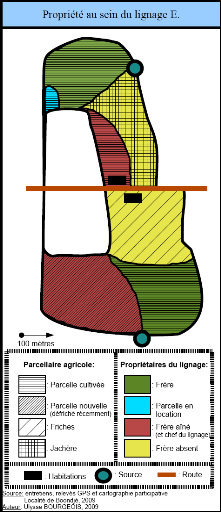
2. Une lignée ancienne sur ses terres.
Figure 12.
Nous allons maintenant nous pencher sur les terres du lignage
E., qui sont plus vaste que les terres des deux précédentes
lignées. Elles sont réparties entre trois personnes : trois
frères, soit les hommes les plus âgés du lignage. Ces
propriétés semblent réparties de manière
homogène entre les trois personnes, mais l'exploitation de chacune de
ces propriétés ne va pas être similaire. Ainsi, un des
frère est absent et ses terres (en jaune) ne vont donc pas être
exploitées. C'est pour cela que l'on observe des jachères ou des
friches. En revanche, les parcelles de couleur verte sont exploitées
entièrement. On y trouve des champs de maïs et de manioc
principalement. A noter qu'il n'y a aucune palmeraie, faute de moyens
financiers. Les jachères sont importantes, ce qui permet de supposer que
la pression sur les terres est moins forte que pour les deux lignages
observés précédemment. On remarque aussi la mise en
location d'une parcelle (en bleu). Cette location a été
octroyée à une personne extérieure au village, pour la
durée d'une récolte. Cela traduit un certain pouvoir sur les
terres dans la mesure où octroyer une parcelle ne peut se faire que si
les terres du lignages sont vastes. C'est pour cela que les lignées
non-originaires du village ne peuvent pas se permettre de mettre une parcelle
de terre en location.
C. Un acteur prépondérant en matière
foncière : le chef de lignée.
Nous allons voir quelles sont les compétences des chefs
de lignées sur les terres. Le chef de lignée est également
appelé patriarche ou encore chef de terre. Il a un rôle
très important car il gère les terres de son lignage. Il est le
garant de la survie des membres de sa famille au sens large.
Transmis par la descendance du côté masculin, le
pouvoir sur la lignée revient donc à l'homme le plus
âgé. Ensuite, ce sera le fils aîné qui sera investi
comme chef. Cette règle de transmission du pouvoir est ancienne, et
c'est pour cela que l'on parle de chef coutumier. Le chef de lignée ne
choisit pas son héritier, ce sont les règles mises en place par
les ancêtres qui déterminent qui obtiendra le pouvoir, lors de la
mort du chef. Il faudrait mieux parler de représentant du lignage
plutôt que de chef. En effet, l'idée de chef tel qu'on l'entend en
Europe n'a pas la même fonction. Il ne s'agit pas de gérer les
terres et les « affaires » du lignage selon la simple
volonté du chef. Il y a des impératifs à respecter, comme
par exemple, permettre aux générations futures d'avoir un espace
où exploiter la terre. Ce pouvoir à donc aussi pour but de
conserver les acquis du lignage, pour que les descendants n'aient pas de
problèmes pour obtenir des terres. En effet, le chef est responsable de
tout le lignage, et son pouvoir peut aller à l'encontre de la population
qu'il représente. Par exemple, si ce dernier vend des terres. De la
même manière que la vente de terre n'est pas bien perçue
par la population Mongo, un chef de terre se doit aussi d'exploiter ses terres,
car ne pas utiliser l'espace (friches) peut être une raison
d'appropriation par les lignages et familles voisines. Laisser la terre
à l'abandon est mal considéré par les membres du lignage
dans la mesure où ceci est vu comme une mauvaise gestion, ce qui peut
entraîner des tensions entre les personnes d'un même lignage. Voici
comment un chef de lignage perçoit une gestion mauvaise :
« Lui, il est chef, mais il ne s'occupe pas
[de ses terres]. Mais pour l'usage, il fait peut-être l'usage
abusif en vendant des terres aux autres, ou bien il vend pas, mais s'il laisse
la terre comme ça, les autres peuvent l'envahir, alors il n'est pas un
bon chef. Mais de toute façon, il reste quand même chef. On doit
le respecter, et si il y a quelque chose qui ne va pas, on doit le
consulter71(*)».
C'est le chef de lignage qui a le pouvoir d'allouer des
terres, ou de mettre à disposition des parcelles agricoles. Evidement,
le chef de lignage est tenu de rester vivre sur les terres du lignage dont il a
la responsabilité. S'il décide de vivre en zone urbaine par
exemple, un autre chef est investi du pouvoir. Il n'existe pas de terre sans
représentant. Les disparités entre les lignage peuvent être
fortes. Par exemple, certains lignages peuvent être composés de
peu de personnes, tandis que d'autres vont être très
peuplés. Lié à l'attrait des pôles urbains et
à l'exode rurale, chaque lignage doit impérativement garder au
moins une famille de peur de se voir approprier les terres par les lignages
voisins. Lorsque beaucoup de membres d'un lignage sont partis vivre ailleurs,
les familles restantes vont donc être en position difficile car ils
peuvent subir des pressions pour que leurs terres soient cédées.
Il est important pour un lignage d'avoir une descendance masculine pour ne pas
perdre la propriété des terres. En effet, les filles sont
amenées à quitter les terres de leur lignage (en
général car il existe toujours des contre-exemples). Donc, il est
important pour une famille d'avoir des fils pour s'occuper des
propriétés. Cela est encore plus vrai pour les plantations (par
exemple pour les palmeraies) car ce sont les hommes qui s'occupent de ce type
de travail. Si une lignée n'a pas de descendance masculine, la
propriété du lignage est donc mise en danger. Le travail du chef
(ou du père de famille) a aussi pour but d'être transmis à
ses enfants.
Synthèse
L'imbrication entre la sphère sociale et
l'appropriation des terres est très forte. C'est la
société qui détermine comment vont être
réparties les terres. Les lignées disposant d'ancêtres
lointains sur les terres disposent de pouvoir plus fort sur les terres que les
lignées arrivées plus récemment sur les terres claniques
et/ou lignagères.
L'appropriation se fait par lignage, et c'est au chef de
lignée que revient la responsabilité de la gestion des
propriétés collectives. Etant donné que c'est l'usage et
le travail de la terre qui est le principal garant de la
propriété, le rôle du chef est primordial pour les
générations futures de son propre lignage. La gestion des terres
propres au lignage est libre dans la mesure où le pouvoir de chef ne
dépend pas d'une autre autorité.
Cependant, la responsabilité sur les terres est
importante, si bien qu'une mauvaise gestion de cet espace peut avoir des
conséquences graves pour les membres du lignage. Le plus souvent, il
s'agit de conserver les acquis, et dans un contexte de pression foncière
accrue, et de migrations vers les pôles urbains, le rôle de chef
tend à prendre de l'importance. Ainsi, lorsqu'une lignée
cède, par la vente ou la location, trop de terres, les membres de la
lignée peuvent subir les conséquences de cette gestion.
PARTIE III :
Les relations difficiles entre deux manières
de gérer les terres
Après avoir tenté de comprendre l'organisation
foncière des populations Mongo, nous allons donc nous pencher sur les
problèmes que cela génère. Ces problèmes, ou ces
tensions sur les terres sont parfois à l'origine de conflits, qui vont
avoir lieux entre différents acteurs, et donc à des
échelles très variables.
Il y a une grande variété de conflits. Ils
peuvent concerner seulement une famille, ou encore concerner deux clans, mais
aussi, des entrepreneurs privés et des ayant droits, des chefs
coutumiers et les autorités d'Etat, etc. Une typologie des conflits va
être établie selon qu'ils concernent le village seulement, les
concessions privées, ou l'Etat. Nous verrons ensuite comment peuvent
être résolus ces conflits : quels sont les acteurs qui
interviennent ? Autrement dit, comment sont localement gérés
les conflits, et dans quels cas vont-ils devant la justice
provinciale ?
Chapitre 1
Les conflits fonciers
« On ne dispute pas la palmeraie avec le
propriétaire d'un ancien
emplacement. »
Proverbe Mongo
« Les conflits sont inhérents à la
vie sociale (...) : entre des désaccords et des litiges qui se
règlent au sein du groupe familial, et des conflits violents, impliquant
de nombreux acteurs et l'intervention de la force publique, il existe une large
gamme de situation intermédiaires72(*) ».
Lavigne Delville P.
1. Les conflits à l'échelle du
village : à l'intérieur de la société
Mongo.
Le village est dans ce raisonnement le point de départ
de la majorité des conflits qui touchent de près ou de loin la
propriété de la terre. Etant donné que les terres rurales
sont toutes sous la propriété d'un chef coutumier, on peut tout
d'abord affirmer que les conflits sont particuliers, et qu'ils ne se
règlent pas toujours selon les lois d'Etat, ainsi que par la justice des
Provinces. L'échelle du village est pour autant un angle d'analyse qui
semble restreint mais cela n'est pourtant pas forcément le cas dans la
réalité. Il y a une grande variété de relations
conflictuelles sur les terres.
a. La famille, le lignage.
Il serait illusoire de croire que parce que l'organisation
sociale, et la propriété de la terre sont à certains
égards solidaire et collective, cela empêche tout conflit
d'émerger. La propriété des terres étant obtenue le
plus souvent par l'héritage, les premiers types de conflits
analysés ici vont être ceux présents au sein de la famille,
étendu ou non.
L'héritage est générateur de conflits.
Ainsi, il existe des rivalités entre héritiers pour la succession
au rang de patriarche. Par exemple, un père de lignée (un
patriarche) a trois fils. Selon la coutume, c'est l'aîné qui,
à la mort du père, héritera du pouvoir. Seulement, si des
jalousies existent, le second frère peut chercher à avoir la
place d'héritier. Ces conflits sont de l'ordre de la succession, mais
étant donné que cette transmission du pouvoir concerne les
terres, les deux sont liés. De plus il est indéniable que le
patriarche dispose d'un pouvoir important, tant sur la famille que sur la
terre. Cela peut donner lieu à des rivalités pour l'obtention du
pouvoir.
L'unité de la famille étant la plus petite
possible en matière de conflit foncier, il convient donc
d'élargir le cadre avec le lignage. Un lignage étant une famille
au sens étendu, il peut exister des rivalités entre deux lignages
voisins. Si deux lignages sont proches les uns des autres, et que l'un deux ne
respecte pas les limites des propriétés, il va s'ensuivre des
conflits, souvent de moindre gravité mais qui peuvent devenir de plus en
plus fort avec le temps. Par exemple, si un lignage dispose de moins de
terres que le lignage voisins. De plus, certaines terres sont moins bonne pour
l'agriculture que d'autres. Le lignage ayant des terres de petites superficies
peut avoir la volonté de s'étendre sur les terres d'un autre.
Dans ce cas précis, il n'est pas évident d'obtenir de nouvelles
terres, d'où, il peut ne pas être possible d'avoir d'autres terres
pour pratiquer cette activité indispensable à l'heure
actuelle : l'agriculture. Des conflits peuvent donc apparaître dans
un contexte d'augmentation de l'activité agricole lié au
déclin de la chasse et dans une moindre mesure de la pêche.
Certains n'ont donc pas toujours la capacité d'obtenir la terre, tandis
que le voisin peut en avoir en abondance.
Souvent ces types de conflits sont aussi liés à
de mauvaises relations de voisinage. Les raisons peuvent être
variés. Par exemple, untel n'apprécie pas le fils d'untel car il
n'aurait pas toujours des relations honnêtes avec les autres. Comme il
l'a déjà été précisé, les bonnes
relations sont importantes pour qui cherche à s'implanter. Souvent, les
gens qui disposent de petites surfaces ne sont pas des autochtones, mais des
venants. Ils ont moins de droit sur la terre que les autres. Leurs
ancêtres ont été accueilli pour leur permettre de vivre
avec leurs familles. Cela leur a conféré certains droits sur leur
terres. Ils exploitent la terre, et cette dernière leur est acquise par
le travail. Cependant, des cas plus complexe s'observent avec les plantations.
Elles génèrent des revenus non-négligeables pour les
propriétaires. Cela peut attirer des convoitises, surtout que la
création d'une plantation nécessite un apport financier
important, que tout paysan ne peut s'offrir. Un cas existe dans le village de
Boondjé : un père de famille est venu demander
l'hospitalité d'un clan. Celui-ci lui a accordé des terres de
petites superficies, mais suffisantes pour la famille. De bonnes relations ont
été instaurées entre les deux voisins. Des terres, pour
faire des palmeraies, ont été cédés sans
problème. Mais avec le temps, les deux chefs sont morts, et il est
toujours possible pour le propriétaire de demander des droits d'usages.
C'est ce qui se passe : les relations entre les voisins sont devenues
mauvaises (liés à des conflits d'ordre religieux par exemple), et
les ayant droits n'ont pas redonné l'autorisation au descendant de la
famille venante pour la création d'une palmeraie. La création
d'une palmeraie nécessite de plus en plus un contrat écrit entre
les propriétaires et la personne qui désire obtenir une
palmeraie. Il faut préciser que s'intégrer dans un village n'est
pas chose facile dans la mesure où l'on est considéré
comme un étranger. Néanmoins, les exemples ne manquent pas de
gens venus de l'extérieur et qui se sont très bien
intégrés avec les voisins et plus largement, avec le village. A
noter également que les gens qui quittent leur terres pour en chercher
de nouvelles, le font parfois à cause de conflits qu'ils peuvent avoir
avec certains voisins, ou même le village.
b. Le rôle de la sorcellerie dans les
conflits.
Ainsi, il existe quelques cas de migrants qui se sont fait
chassés pour des accusations de sorcellerie. Ces accusations
n'étant pas majoritairement rationnelles, il n'est pas facile de
connaître la vérité car les rumeurs peuvent aussi
être puissantes, d'autant plus que la sorcellerie est elle aussi
très puissante. Les Mongo lui portent une attention très forte.
Certaines personnes moins que d'autres, mais c'est un fait à ne pas
sous-estimer dans les conflits fonciers. En effet, la sorcellerie est une
manière de régler les conflits, ou de les aggraver selon le point
de vue. La sorcellerie n'est pas une pratique comme les autres. Pris dans le
sens d'une intervention magique elle est toujours un moyen de nuire à
autrui. Il ne s'agit pas ici de parler de la magie en général. La
sorcellerie est souvent considérée comme très dangereuse,
et beaucoup de suspissions existent à son égard. Elle intervient
beaucoup dans les conflits de terre. A tout les niveaux de conflit, et
même lorsqu'ils concernent l'Etat, la sorcellerie intervient pour
régler certains problèmes. Ce sont des méthodes
illégales en théorie, mais bien réelles dans la pratique.
On parle de magie noire, d'empoisonnements, etc. et cela de manière
très récurrente quand on parle de conflits fonciers. Dans tout
les cas c'est le point le plus grave des conflits car ils peuvent rapidement
conduire à la mort. La mort est la manifestation la plus grave en ce qui
concerne les rivalités de terres. Voici un exemple raconté par
Daniel Likemba Bokoto :
« Je connais dans mon village
[Boondjé], un chef de terre et là il a eu des
problèmes avec quelqu'un d'autre. Et celui-là a utilisé
des enfants la nuit qui sont venus brûler la maison. Lui et ses enfants
à l'intérieur. Heureusement, il n'y a pas eu de
dégâts mortels mais tout les objets ont été
brûlés et il s'est vite avisé. Il voit qu'il est danger. Il
ne peut pas rester habiter ici. Il s'est déplacé,
éparpillé. Lui, il est maintenant à Kinshasa et on a
reconnu que sa maison a été brûlée par son ennemi.
L'enfant qu'il a envoyé a révélé. Au début
ce n'était pas connu mais cet enfant commence maintenant à
dévoiler. Dans ce sens, il cherche le pardon ; il a dit aux enfants
de celui-ci qui est parti :'escuser moi, l'acte qui a été
commis, c'est moi. J'ai été utilisé par celui qui voulait
votre terre et il m'a dit de faire cet acte.' Le monsieur [l'avoueur]
est devenu en danger. Donc être propriétaire des terres, ou
bien gérer des biens cela comporte tout ce qui est
risques 73(*) ».
De nombreux exemples existent sur les pratiques de
sorcelleries en liens avec la propriété des terres. Comme par
exemple, faire en sorte que sur deux fils héritiers du lignage, l'un des
deux devienne stérile, ce dernier aura ainsi de grandes
difficultés pour être mis à la place de chef de terre dans
la mesure où être stérile, est très mal
considéré par la population (accusation une nouvelle fois de
sorcellerie ). Il ne pourra pas non plus avoir des descendants, et donc cela
limite la transmission du pouvoir s'il n'a pas d'héritiers.
On peut également citer l'exemple de trois fils. L'un
d'eux peut décider de faire fuir les autres car il est le dernier fils.
Il ira voir un sorcier (nkanga) pour qu'il soit l'héritier et
donc le chef des terres. C'est ce qu'explique Bangundu
Luyéyé, chef de lignage, âgé de 59
ans :
« si celui-là [le chef] ne
s'occupe pas [des terres], l'autre peut être jaloux et veut
s'approprier les terres. Et parfois, il y a même des difficultés
et les autres s'empoisonnent et tout consort 74(*)».
En effet, la sorcellerie est avant tout utilisée pour
faire fuir une personne ou une famille. Cela consiste en des menaces qui vont
d'une intensité faible à forte. Elle peut juste faire peur, elle
peut détruire des récoltes, rendre malade ou bien tuer des
individus. Les puissances naturelles par exemple peuvent être selon les
Mongo des forces que le sorcier se met à profit. Par exemple, les
catastrophes naturelles vont trouver leurs explications dans des sorts
jetés par quelqu'un qui cherche à obtenir des terres. Il faut
convenir qu'il n'est pas important de prendre un parti pris, ou de porter des
jugements sur la sorcellerie qui sait aussi entretenir tout ces
mystères. Pour autant, la sorcellerie doit être prise dans un sens
large, et aussi comme une perception des populations elles mêmes. En
effet, les populations villageoises sont rares à douter de ces
pratiques. Même la christianisation a peu de poids face à la
tradition de la sorcellerie, et des pratiques magiques. De nombreux aspects de
la vie quotidienne peuvent se référer à la sorcellerie car
le sentiment religieux est très fort chez les Mongo.
c. Le clan.
Concernant les conflits liés aux clans, ils semblent ne
pas être très différents de ceux que nous venons de
décrire. Ainsi, les conflits sont toujours liés à une
volonté d'expansion des propriétés foncières. Cette
extension étant le plus souvent obtenue en défaveur d'un
propriétaire. Il existe donc également des conflits entre les
clans lorsqu'il y a un non-respect des droits coutumiers de
propriétés. Et les conséquences sont les mêmes. Nous
verrons plus tard comment sont réglés par le droit coutumiers ces
différents. Un cas particulier est celui de la proximité des
activités agricoles ou des habitations. Si l'espace agricole est
restreint, deux clans peuvent entrer en conflit si les limites ne sont pas
respectées. C'est le cas entre deux clans de la localité de
Boondjé. Une famille a donc dû chercher un nouvel emplacement pour
vivre et travailler la terre. En effet, si les lieux d'habitations sont
très rarement la cause de conflits, l'agriculture est bien plus sujette
à des tensions. C'est la principale conséquence pour expliquer
l'importance croissante que revêt l'agriculture liée à la
modification des pratiques et des besoins des habitants.
d. Conflits de propriétés liés aux
rivalités de pouvoir au sein des chefferies.
Il existe également certains conflits liés au
pouvoir, mais dont le « théâtre des tensions »
se déroule au sein de la famille. Souvent cela concerne la famille
régnante. Le cas le plus fréquent à lieu au sein de la
famille qui dirige un groupement. Nous avons vu précédemment que
l'héritage du pouvoir de chef de groupement est différent de ce
qui se passe au sein d'une lignée ou d'un clan. L'héritier n'est
pas choisit de la même manière. C'est le vieux chef qui choisit
lui même (par exemple par un testament ou par la remise personnelle du
titre écrit de la chefferie) l'héritier de la chefferie. Il peut
s'agir d'un neveu. Ce système peut parfois générer des
conflits au sein de la famille régnante. La jalousie débouche
ainsi sur des rivalités qui peuvent être fortes. L'organisation
familiale rendant du plus en plus large généalogiquement les
familles peut aussi entraîner ce type de conflits. Au sein d'une
même famille il peut y avoir des personnes ayant des origines proches
extérieures aux villages du groupement. Ce cas entraîne des
conflits, qui commencent à l'échelle de la famille pour concerner
le village lui-même. Les habitants ne préfèrent pas
exclusivement les familles originaires depuis longtemps du village, mais
lorsque la chefferie ne pratique pas une gestion appréciée des
habitants, cela peut rapidement être une justification. Le pouvoir d'une
chefferie appartenant à un clan, il est obligatoire que ce pouvoir
change à chaque génération de lignage. D'où des
oppositions se créent et cela peut empêcher la chefferie de
diriger comme elle le doit. Des rivalités peuvent exister
également entre le chef de la localité et la chefferie. Dans ce
cas, en l'absence du chef de groupement, certains contrats de cession de terre
peuvent être conclu avec le chef de village.
Le choix de l'héritier peut de plus, être
lié à des manoeuvres d'ordre politique, c'est-à-dire que
le chef peut être illégitime pour une majorité d'habitants
du groupement, mais des appuis politiques rendent la chefferie légitime
au niveau territorial, régional, voire national. Pour illustrer un
exemple à l'échelle nationale, le cas du groupement de Bongilima
où la chefferie a des difficultés pour régner efficacement
car le pouvoir auparavant était au sein d'une autre famille. Le pouvoir
est donc passé au sein d'une autre famille, et le pouvoir est en place
du fait de liens avec les autorités politiques nationales. Pour le
Territoire cela vient par exemple des possibles recommandations de
l'Administrateur du Territoire pour qu'une personne soit nommé
plutôt qu'une autre.
Les conflits présent à cette échelle
locale peuvent dans certains cas avoir des conséquences graves, mais la
plus part du temps ce n'est pas le cas. Ces sont des conflits inhérents
à la société Mongo. Nous allons donc nous pencher
maintenant sur les conflits qui concernent les populations locales avec des
acteurs extérieurs à la société Mongo. Ces conflits
sont en général plus lourd de conséquences. En effet,
l'espace est utilisé de manière différente par certains
acteurs fonciers étrangers aux populations locales.
2. Les conflits entre les chefs de terres et les
concessions privées.
Dans ce type de conflit, deux échelles sont
concernés. Les jeux d'échelle sont importants car selon qu'il
s'agisse de conflits entre des lignées (ou des familles) et d'une
entreprise privée qui pratique l'exploitation vivrière, cela va
induire des disproportions en matière de pouvoir et donc de droits
fonciers. On entend ici par concession privée, une entreprise ( il
s'agit d'une entreprise internationale, de nationalité
américaine) installée sur les terres de différents
groupements (le groupement de Bongilima majoritairement, mais aussi de
Bomaté, et Lisafa). La société GAP dispose de deux sites
d'exploitations : la plus importante et la plus ancienne à Lisafa,
et la seconde plus récente à Ndeke. Toutes les deux se trouvent
sur le Territoire de Basankusu, et la superficie des terres de la
société se situe autour de 17 000ha. Cette société
appartient à une multinationale : le Groupe Blattner International.
De nationalité américaine, ce groupe est un des plus important en
RDC de part le nombre d'employés qui est d'environ 6000 personnes. Cette
multinationale est propriétaire de 22 sociétés dans des
domaines divers tels que l'industrie (pneumatiques, scieries) mais aussi les
transports (compagnie aérienne, installations portuaires, transport
fluvial, etc.) ou encore le tertiaire (informatique, assurances). Neanmoins, le
secteur primaire (agriculture et élevage) semble être le plus
important secteur d'activité du groupe. On trouve ainsi des plantations
pour le caoutchouc, l'huile de palme, le café, le cacao et
l'élevage de bétail.
Ce cas va être étudier en détails car il
est révélateur de beaucoup de tensions liées à la
terre. Tensions qui peuvent être variées, et qui ont une histoire.
C'est également un exemple qui illustre la difficulté que peuvent
connaître les populations locales vis-à-vis d'acteurs
extérieurs venu pratiquer des activités économiques.
a. Les plantations de la société Groupe
Agro-Pastoral (GAP) : des conflits déjà anciens.
Photographie 15
Photographie 16
Plantations de G.A.P. En premier plan ; une
caféraie, Chemin séparant deux plantations.
en second plan ; une palmeraie, et plus loin dans
A gauche ; R4, et à droite ; R19.
le paysage ; des forêts.
D'après les riverains, cette compagnie fût
vraisemblablement crée en 1909 par des colons de nationalité
belge. Le nom de cette entreprise semblait être la C.C.B75(*). L'exploitation ne
commença que deux années plus tard : en 1911, toujours selon
les habitants. Les plantations sont en grande majorité des palmiers
à huile (le liya en lomongo, et scientifiquement
Elaeis guineensis,), mais le café semble occuper de plus en
plus de parcelles, et cela depuis le rachat de la compagnie. Le contexte de
cette période est bien évidemment lié à la
domination coloniale. Les terres où se situe les palmeraies ont
été cédés par les propriétaires de
l'époque. Il n'y a pas de précisions sur la manière dont
on été obtenues ces terres. On peut supposer en toute logique,
que cela s'est fait au prix d'avantages économiques. Les chefs et les
notables coutumiers auraient ainsi perçus « quelques sacs
du sel et un montant insignifiant soit 200 F.C. de
l'époque 76(*)». Il ne faut pas non plus
négliger le fait que le colons étaient perçu comme
dominants les habitants de l'époque, et ceux-ci avaient souvent peur des
européens à cause des guerres, et de l'esclavage très
marqué dans cette région de la RDC. Cette société
sera ensuite renommé comme la Compagnie de Commerce et des Plantations
(CCP). Compte tenu de l'organisation foncière, et de la
répartition plus ou moins homogène des familles sur les terres et
les forêts, l'arrivée d'une entreprise qui utilise les terres
à grande échelle, va générer des tensions pour
l'utilisation du sol. Des anciens témoignages obtenus par
Boelaert E. en 1954 dans la province de l'Equateur
témoigne déjà de ce phénomène. Voici les
mots de Nkoi J., recueillit à Lisafa dans le Territoire
de Basankusu :
« Nous sommes très mécontents,
Père, pour nous c'est le comble du malheur car notre village est
à proximité d'une certaine compagnie dénommée C.C.B
. Lisafa. Ils nous ont ravi toutes nos terres ils ont construit de longues
routes à partir de nos maisons jusqu'aux lieux où ils ont
indiqué les distances en kilomètres soit 20 ou 15 km sur les
routes. Toutes ces bornes ne sont là que pour dire aux étrangers
Blancs, qui vont venir nous ravir notre village. Pourquoi doivent-ils se
permettre d'organiser une dispute de nos forêts? Tout cela parce que nous
sommes des Noirs? Ainsi soit-il 77(*) ».
Ces mots traduisent bien les problèmes auxquels sont
confrontés les populations par rapport aux palmeraies. On constate une
domination des exploitants étrangers sur l'espace, et cela ne va pas
sans poser des problèmes pour les villages et les populations qui se
situent dans la zone de culture ou dans un périmètre autour des
plantations. Cela semble être perçut par les populations comme une
spoliation de leurs terres. Voici ce que rajoute Nkoi
J. :
« Ce que l'Etat et la Compagnie ont fait sur nos
terres ne nous plaît pas. Lorsque nous allons terminer nos études;
lorsque ceux qui étaient partis ailleurs vont revenir au village,
où construiront-ils leurs maisons? Iront-ils de nouveau acheter les
terres auprès de l'Etat ? »
Le besoin en terres est très important pour les
populations villageoises. L'Etat et la compagnie agissent d'une manière
coordonné pour réaliser l'appropriation des terres en vue de
l'exploitation des plantations. La période coloniale en RDC est
marquée par de nombreux conflits fonciers entre les populations rurales
et l'Etat Belge. Les chefs de terres ne sont pas tous concernés par les
cessions de terres. Certains cèdent aux compagnies des terres pour
bénéficier des avantages économiques qu'apportent les
européens, d'autres ont certainement refusés de céder leur
terres, tandis que certains chefs y ont été contraint. En effet,
la coutume dans son sens traditionnel autorise difficilement ce processus de
cessions de terres car ces mêmes terres sont aussi perçus comme un
espace vital pour les vivants et pour les enfants, petits-enfants, et ainsi de
suite.
Selon les entretiens réalisés, la gestion par
les Belges qui s'est prolongée jusqu'en 1990 permettait d'obtenir des
avantages et des « aides » telles que la possibilité
de faire des études en ville pour les enfants des ayant droits
concernés, ou encore des matériaux tels que des tôles pour
les toitures, mais aussi du ciment pour les construction d'habitation. Il y
avait aussi des pratiques d'échanges : les produits agricoles et de
la forêt obtenu par les villageois contre des produits importés
des pôles urbains, voire même de l'extérieur de la
région. Le rachat des plantations et de l'usine par des
américains a modifié ces relations. La dégradation de la
situation politique et économique depuis le début les
émeutes nationales du début de la décennie 1990
jusqu'à aujourd'hui tend a augmenter de plus en plus les conflits entre
les ayant droits et la compagnie.
De nombreux conflits ont eu lieux vers les années 2005.
Des cas de violences perpétrées à l'encontre de chefs
coutumiers : « inquiet du mouvement Insurrectionnel du
Mlc78(*) qui, à en croire certaines
sources, se seraient rendus sur les lieux. Conséquence de cette
épreuve punitive les soldats ont pillé et saccagé tous les
biens et maisons de toute la population et cela, au vu et au su de tout le
monde. Scènes macabres : deux chefs coutumiers furent
dénudés, molestés, flagellés et
arrêtés. Jusqu'au moment où nous couchons ces lignes, ces
deux grands chefs se trouvent encore détenus par les
éléments de la police locale 79(*)».
La compagnie employait dans le passé proche de nombreux
hommes des villages environnants, mais les conditions de travail, et les
salaires sont deux raisons qui ont fait que de très nombreux
travailleurs ont quitté la compagnie pour retourner travailler la terre
dans leurs propriétés ancestrales. Il n'y a plus que deux
personnes de Boondjé qui sont engagés pour travailler dans la
société, les autres sont souvent des journaliers. La saison
agricole, mais aussi de pêche n'étant pas régulière
tout le long de l'année, les besoins conduisent parfois certains hommes
à travailler pour la compagnie. Les salaires sont plus bas
qu'auparavant.
Les salaires :
Selon le type de travail, le salaire va être de plus ou
moins élevé, avec des disparités fortes. Une sentinelle
des plantations dispose d'un salaire d'environ 0,5 dollars par jour, tandis
qu'un ramasseur de noix de palme peut gagner autour de 1,6 dollars par jour,
et c'est un des travaux manuel dans les plantations les mieux payer. Il faut
noter aussi que les payes ne sont pas régulières. Ainsi, il y a
des périodes parfois longues où les salaires ne sont pas
versés. C'est devenu très fréquent depuis 2007-2008, et
cela continue encore actuellement. Par exemple, au mois de mai, les salaires
des mois de février, mars et avril n'étaient pas encore
arrivés aux travailleurs.
Toutes ces difficultés conduisent de nombreuses
populations à quitter les terres de la plantation pour retourner
cultiver leurs propres terres. En effet, la compagnie étant la seule
dans tout le Territoire, les populations arrivent de très loin, parfois,
de plus de 150 km. Les migrants quittent souvent des zones exclusivement
forestières (exemple du Territoire de Befale) à cause des
conditions de vie difficiles et du fort enclavement.
Ce contexte est important pour comprendre ensuite les
rivalités et les conflits qui découlent de la politique de la
compagnie.
b. GAP et les ayants droits coutumiers : des relations
conflictuelles.
La surface exploitée par la compagnie est très
majoritairement située sur le groupement de Bongilima comme il l'a
été précisé ci-dessus. Pour observer ceci, il est
nécessaire d'utiliser des photographies satellites pour constater ces
jeux d'échelles. Avant tout, il faut préciser que la
délimitation du groupement n'est pas la même selon les cartes
officielles de l'Atlas de l'organisation administrative de la
RDC80(*). Il n'est pas aisé de connaître
précisément ces limites. Pourtant, il semblerait que le
tracé effectué avec les habitants du groupement soit plus proche
de la réalité administrative que la cartographie de l'Atlas. En
effet, les délimitations ont surtout été
réalisées d'après les éléments
hydrographique : des cours d'eau et des ruisseaux, ce que traduit la
cartographie participative (en rouge).
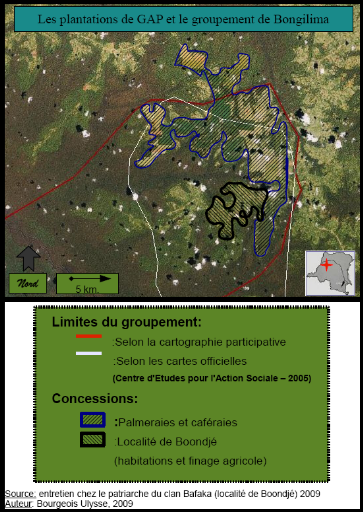
Figure 13.
On constate dans les deux cas, que les plantations (de formes
géométriques, et de teintes de couleurs d'un vert plus clair que
les forêts primaires) occupent une partie importante de la partie nord du
groupement. La localité de Boondjé est le village le plus proche
des plantations, et la partie sud des plantations est située sur les
terres d'ancêtres du village.
Pour illustrer ce type de conflit, nous allons nous focaliser
sur un chef de terre en particulier. Les terres ancestrales de ce lignage sont
très vastes et les ancêtres du propriétaire actuel ont
réalisé des contrats avec la société. Ce sont donc
les descendants qui héritent de cette situation. Chaque palmeraie
nécessite tous les 25 ans un nouveau contrat entre les ayants droits qui
possèdent coutumièrement la terre et la compagnie. Auparavant,
les démarches nécessaires pour obtenir des terres en vue de les
exploiter étaient plus faciles à obtenir. Cette duré de
contrat sur 25 ans vient de l'exemple efficace de l'ancienne CCP. Ce cas est
celui de la palmeraie R4 qui comprend 294 ha. Lorsqu'un contrat est
passé, c'est la chefferie du groupement qui fait l'intermédiaire
entre ces deux groupes. Chaque contrat nécessite un cahier des charges,
avec donc une négociation. Un cahier des charges contient un certains
nombre de « doléances » qui se matérialisent
le plus généralement par des politiques ponctuelles de
développement. Cela peut être la construction de ponts, de routes,
de structures de santé, mais aussi d'écoles, ...La plupart du
temps, le cahier des charges a pour but de répondre aux besoins de la
population (un lignage, un clan) concernée. Cette négociation n'a
pas toujours lieu, c'est-à-dire que le contrat de cession de terre n'est
pas réalisé avec les ayants droits. Cela donne lieu
-évidemment- à des conflits. Sur ce sujet, voici quelle est la
situation d'un chef de terre vis-à-vis de GAP et de l'ex-CCP, selon les
mots d'un voisin :
« En ce qui concerne les terres que nous venons
de visiter : les terres qui ont été vendu à la CCP,
c'est bien les terres du village Boondjé. Mais il y a quand même
le clan qui a la propriété de cette terre. Donc ces terres
là ce sont des terres propres aux ancêtres et ce sont les lignages
(...) qui sont les autochtones. Bien que le groupement ait eut les droits de
jouissances coutumières, mais ils doivent songer d'abord aux
autochtones : les propriétaires des terres. Mais la chose ne se
fait pas parce que nous voyons comme on avait dit l'autre fois que le
groupement n'a pas vraiment eut les jouissances coutumières pour la
replantation de R4. Hors selon les conventions, chaque 25 ans, on doit
renouveler le contrat, et pour renouveler le contrat on doit venir ici voir les
notables, et faire un cahier des charges et voir les besoins de la population.
Mais cela ne se fait pas. Les autorités sont à Kinshasa, et ici
au village, personne n'est contacté ».
Un autre problème émerge de cet entretien :
le groupement ne contacte pas toujours les ayants droits. Ce cas précis
rend les droits des propriétaires coutumiers inexistants, et cela n'est
pas synonyme de paix sociale. En effet, le groupement dispose d'une
autorité plus importante aux yeux de l'Etat que ne peut l'être un
chef de lignage ou un chef de clan. Dans ce cas précis, voici les
difficultés que rencontre un chef de terre pour faire valoir ses
droits :
« ...Chez nous, quand nous écrivons des
pétitions, cela va créer des conflits. Entre nous et le chef.
Nous n'avons pas mot à dire. Nous n'avons pas de moyens. La
société est plus forte. Elle peut nous combattre de toutes les
façons. Plus, nous n'avons pas moyen de parler, même pas mot
à leurs oreilles. (...) Ce n'est pas réveiller les
morts, c'est bien nous : moi et mon frère ici ! Surtout les
problèmes d'R4. On avait renouvelé des conventions, on a vu que
la société apporte des briques et d'autres histoires. Est-ce que
lui il est au courant ? Est-ce que moi je suis au courant ? Nous ne
sommes plus que les deux ! ».
Cet exemple traduit bien l'impuissance que peut avoir un
propriétaire coutumier pour faire valoir une certaine justice. Un autre
cas est le dépôt d'une plainte du chef du groupement de Lisafa,
M. Thy René Essolomwa Nkoy ea Linganga contre le
Gouvernement Belge. Il cherche à rappeler que la chartre qui
régit cette société est toujours liée à une
charte écrite lors de la colonisation. Par ailleurs, il réclame
la saisie de la société ainsi que des dommages et
intérêts d'un millions de dollars pour les préjudices
concernant les ayants droits coutumiers. Etant donné la pauvreté
très importante dans cette région de la RDC, des arrangements
vont donc avoir lieu pour bénéficier soit d'argent, soit de biens
matériels. Certaines chefferies sont parfois très pauvres, et le
contexte d'après-guerre étant très difficile pour la
population dans son ensemble, des cas de corruptions peuvent être
fréquents, et ils peuvent parfois être
généralisés comme une règle. L'appropriation de
terres peut donc être réalisée facilement plus la
pauvreté des ayants droits est forte. Certaines familles et lignages
n'ont donc pas d'autre alternative que de vendre leur terres à la
compagnie. La dernière vente de terre, au village de Bosulu (un des
trois village du groupement) s'est passé en 2008. La vente concernait 50
ha au sud des propriétés de GAP. Ces 50 ha étaient des
forêts primaires, et la vente a été réalisée
pour une somme d'environ 600 dollars. Il y a eu des plaintes des membres de la
famille pour augmenter le prix de vente mais elles n'ont pas abouti. Le chef de
terre ne voulait pas vendre ces terres, mais la compagnie a longtemps
insisté, et il a donc décider de faire cette cession. Certaines
ventes de terres se font pour des sommes inférieures à celles
cité ci-dessus. La pauvreté est donc un facteur de vente, mais
certains refusent désormais toute cession à des personnes
étrangères. On préfère ainsi être pauvre sur
ses terres que riche sur une faible superficie. En effet, il est est
très difficile, voire impossible financièrement de s'approprier
à nouveau une terre auparavant cédée.
3) Les tensions entre les terres urbaines et les
propriétaires coutumiers en zone péri-urbaine.
Les groupements sont des délimitations administratives
plus larges que les villages ou que les concessions privées. Ils ont des
relations avec l'Etat mais ils disposent aussi d'une influence
coutumière dans la mesure où les chefferies sont
gérées par un clan ou une famille reconnues par l'Etat.
De nombreux conflits existent dans ce sens entre les zones
urbaines et les groupements. Etant donné que les villes ne cessent de
s'étendre en zone rurale, deux types de droits sur les terres vont
entrer en contacts. Les groupements étant gouvernés
principalement par la coutume, l'annexion des villes posent de nombreuses
difficultés.
Les exemples ne manquent pas, et pour chaque pôle
urbain, des conflits vont opposer l'Etat et les chefferies. C'est le cas pour
la ville de Basankusu, mais aussi Mbandaka, et de manière encore plus
marqués pour Kinshasa. Les limites urbaines (le bornage) ont
été principalement établies pour la ville de Basankusu en
1957. Ces bornes sont des limites géographiques telles que les
ruisseaux, des rivières (la rivière Lulonga), et parfois des
concessions privées (dans le cas de Basankusu, il s'agit des terres
d'une mission catholique). Compte tenu de l'augmentation de la population
urbaine liée à l'exode rural, les villes s'étendent
obligatoirement au-delà des bornages anciens devenu très
contraignant. Cela entraîne des conflits fonciers entre les chefs de
groupements et les zones urbaines.
Par exemple, le groupement de Lisafa à Bompanga
conteste dans les tribunaux provinciaux depuis plusieurs années le
bornage de la ville. Un autre exemple concerne la ville de Basankusu et Bokela.
La ville ayant étendu elle-même ses limites, elle perçoit
l'impôt sur des terres gérées habituellement par la
coutume. Le point de tension vient du non-respect des droits de jouissance que
veulent continuer à exercer les autorité coutumières
même vis-à-vis de l'Etat. La justice provinciale a, par ailleurs
donné raison à Bokela.
Pour la ville de Mbandaka (capitale de la province de
l'Equateur), l'extension urbaine pose de nombreux problèmes. Bien que la
ville se soit développée sur des terres coutumières, la
plupart des cessions de terres ont commencées à être
remises en question à partir des années de la décennie
1960 81(*). Cela correspond souvent à
l'indépendance : moment du départ des administrateurs
coloniaux (Piermay J.-L., 1993). Certains chefs de terres
écartés sont devenu illégitimes lors de la période
coloniale. Ils revendiquent donc la légitimité sur leur
patrimoine.
Lorsque la ville étend sa juridiction sur les terres
d'un village, cela met un terme à l'autorité coutumière du
chef de village. Il faut préciser que l'autorité d'un chef de
village est bien moins importante que l'autorité de la justice et de la
loi, et ce cas précis est encore plus frappant pour une mégapole
telle que Kinshasa qui ne cesse de s'étendre sur les terres rurales
environnantes.
4) Les différentes manières pour
résoudre juridiquement les conflits fonciers.
La résolution des conflits fonciers se fait de deux
manières. La première est le droit coutumier, la seconde est la
justice d'Etat. Il n'y a pas forcément d'opposition entre ces deux
méthodes. La première intervient en amont, et lorsque qu'aucune
issue favorable est trouvée, c'est dans les tribunaux administratifs que
transitent les dossiers relatifs aux conflits.
a) Les résolutions locales et
coutumières.
Les conflits étant le plus souvent liés à
des limites de propriétés non respectés, c'est à
l'échelle du village et du groupement que vont être transmises les
plaintes. Par exemple, si deux chefs de terres contestent des limites, on
cherche toujours une personne neutre pour servir d'arbitre entre les deux
chefs. Il peut s'agir d'un notable d'un autre clan ou d'une autre famille, mais
aussi du chef de localité. Dans tout les cas un juge coutumier (un
notable) sert d'intermédiaire entre les deux plaignants. Son but va
être de trouver un « terrain » d'entente, le plus
souvent par la discussion (plutôt une
négociation)82(*). Ainsi, ces cas sont fréquents
lorsque des limites de terres ne sont plus vraiment visibles dans le paysage.
Etant donné que les limites sont souvent liées à un arbre,
si celui-ci vient à mourir, la contestation des limites peut être
l'occasion de redéfinir ces frontières. De même lors de la
mort d'un propriétaire, on fait appel à l'histoire et aux
ancêtres pour déterminer qui a raison. Une technique nouvelle
intervient de plus en plus dans un contexte de pression accrue sur les terres.
Il s'agit de planter une rangée de palmiers. Auparavant, la
méthode consistait à mettre des troncs d'arbres.
Voici un exemple de résolution d'un différent
entre deux propriétaires : le point de rivalité concernait
une marge de terre de trois mètres de long. Plutôt que de donner
raison à l'un ou l'autre des protagonistes, le juge coutumier a donc
séparé en deux cette marge de terre, de manière
égalitaire. Le rôle du juge va donc être d'apaiser les
différents entre des propriétaires. Loin d'être une justice
rudimentaire, le droit et la justice coutumière sont très
organisés et ils semblent être des moyens efficaces et
très adaptés à l'échelle locale83(*). Ces règles ne
sont jamais figées, et c'est une des particularité du droit
coutumier. Bien qu'il soit socialement peu favorable de vendre une partie de
terre, il est tout à fait possible de le faire. Aussi bien avant
l'arrivée des européens que maintenant, même si la pratique
a subit des évolutions. De même, une femme peut être
propriétaire de terres. C'est un phénomène très
rare, tout comme le don de terre par héritage à un esclave (un
pygmée) autrefois. Les règles ne sont pas figées, et d'une
certaine manière, ce type de droit reste flexible selon les cas. Un
autre exemple de ces évolutions est la mise en place d'une durée
dans la cession de terre pour les palmeraies. S'inspirant de l'exemple de GAP,
les propriétaires ont repris cette manière de faire dans les
cessions de terres sur 25 années.
Malgré cela, de nombreux conflits ne trouvent pas de
résolution au niveau du village, et c'est dans ce cas l'Etat qui
intervient pour rendre la justice.
b) L'intervention de l'Etat.
Dans les cas où des différents sur les terres ne
trouvent pas d'issues locales, c'est en premier lieu l'Administrateur du
Territoire qui peut tenter de régler ces problèmes. Il dispose du
pouvoir de l'Etat, mais il peut aussi se retrouver dans une situation trop
complexe pour avoir une influence favorable. Dans ce cas, c'est aux tribunaux
de convoquer les propriétaires. Pour régler ces conflits la
justice procède comme ceci : elle cherche à
déterminer qui est le plus ancien propriétaire terrien. Cela
passe par des entretiens avec les notables, l'observation des traces anciennes
d'exploitations ( surtout les arbres tels que les palmiers à huile, les
bananiers, etc.). Ces traces sont souvent localisées dans le finage des
anciens villages avant la politique coloniale d'alignement. Ces anciens
villages sont appelés Liladji en Lomongo (Eladji au
singulier). C'est un processus qui peut être très long si des
documents écrits (des titres de propriétés) sont
inexistants, ce qui est presque toujours le cas.
Ces enquêtes de terrains débouchent souvent sur
une issue favorable, mais il y a également des cas où la justice
ne parvient pas à trancher des situations conflictuelles. Cela
s'explique par différents facteurs. Le premier est que la justice n'est
pas gratuite. Les propriétaires ne disposant pas de revenus leur
permettant, soit de se rendre dans les tribunaux, soit de s'offrir les services
d'un avocat, un bon nombre de conflits fonciers restent
non-réglés. Beaucoup de conflits ne vont même pas en
justice car les déplacements sont important. Par exemple, pour la
Province de l'Equateur, cela impose de se rendre à Mbandaka, le seul
lieu où se trouve des tribunaux. Les Territoires étant
dépourvu d'instances juridiques. Une solution a été
trouvée pour palier à ce problème : une ONG de
nationalité belge (Avocat Sans Frontière) finance la justice
provinciale de Mbandaka. Ce financement permet à un tribunal de se
déplacer tout au long de l'année dans les différents
Territoires pour instruire les dossiers. Les problèmes financiers de
l'Etat et par là même de la justice sont une des explications du
recours aux institutions coutumières. En zone rurale, c'est donc la
justice coutumière qui est largement prédominante. En effet, la
justice est sujette à des cas de corruptions, des rançonnements
que la majorité de la population ne peut
payer : « le phénomène de corruption a
atteint un niveau systémique (...) embrassant toute la vie
nationale au niveau de l'Etat, de la société et des
individus » selon Kilubi F. 84(*). Un autre facteur
explicatif est la lenteur de la justice d'Etat par rapport aux tribunaux
coutumiers.
Voici quelques exemples donné par Gambambo
Gawiya P. qui cite les chiffres d'Unicef et du Ministère des
Affaires Sociales, illustrant l'importance du recours aux tribunaux
coutumiers :
§ Les conflits fonciers sont réglés
à 47% par les tribunaux coutumiers, contre 25% par le droit
écrit, et 27% pour les deux types de tribunaux.
§ Les conflits liés à l'héritage
sont réglés à 69% par les tribunaux coutumiers, contre 13%
par le droit écrit, et 18% pour les deux types de
tribunaux.85(*)
Les conflits fonciers sont majoritairement résolus par
la justice coutumière. Liés à un déficit
très clair de l'Etat pour rendre la justice, les populations n'ont pas
d'autres possibilité. De plus, la justice coutumière est une
manière conciliante concernant les conflits fonciers. Elle participe
ainsi à réduire les tensions, d'une manière
différente de l'Etat car elle est plus légitime pour la
population. La justice de droit écrit est donc presque inexistante dans
un pays où certaines régions sont très enclavés, et
où l'Etat dispose de moins d'influence et de pouvoir par rapport aux
instances coutumières locales.
Chapitre 2
Une gestion territoriale conflictuelle entre les
populations locales et l'Etat
« Les rivalités entre le droit de l'Etat
et les droits locaux, la persistance de ces droits face aux lois nationales
montrent bien qu'un droit, pour exister, doit être accepté. Chaque
pouvoir, une fois fondé, même mythiquement, et accepté,
devient légitime ».
Chrétien J.-P. 86(*)
Dans le contexte qui vient d'être décrit, nous
allons maintenant tenter de comprendre les interactions entre l'Etat et les
pratiques foncières des Mongo. Entre le droit écrit, que l'on
peut qualifier de théorique et les pratiques locales (orales le plus
souvent), on peut se demander lequel de ces deux types d'acteurs fonciers
dispose de l'autorité sur les terres ?
Nous allons aborder dans un premier temps l'Etat, son
influence dans la région, et la manière dont les populations
perçoivent son rôle et ses actions, notamment à travers la
propriété des terres, qui est un point central.
Il ne fait aucun doute que la région
délimitée par les rivières Maringa et Lopori sont des
zones enclavées, reculées, en comparaison à d'autres
régions et provinces de la RDC. Le manque d'infrastructures
routières est un des facteurs explicatif, ainsi que le manque
d'entretien des routes actuelles. L'enclavement de cette région rurale
et forestière se fait tant au niveau économique que politique.
Les périodes de guerres des décennies 1990 jusqu'en 2003 ont
entraîné un replis des instances administratives d'Etat dans cette
région. Les populations se sont donc tournées vers les modes de
gestion coutumiers pendant l'absence de l'Etat lors des conflits qui ont
touchés Basankus dans le début des années 2000. Certains
Territoires n'ont donc pas été administré pendant cette
période. De cette manière l'Etat n'a pas gagné en
légitimité, et le retour de la paix civile dans cette
région a été le moment du retour de l'Etat. Dans ce
contexte, les pratiques foncières ont donc été
marquées par l'influence accrue des coutumes locales et anciennes.
1. Le rôle de l'Etat en matière de
foncier : un pouvoir à relativiser.
A. La prédominance du pouvoir coutumier sur les
terres rurales.
1. La propriété de l'Etat et les populations
locales.
Le sol et le sous-sol appartiennent dans les lois sur le
foncier à l'Etat. L'Etat est le propriétaire des terres. Cette
question de la propriété des terres rurales et/ou
forestières est révélatrice des divergences entre
le droit écrit et le droit coutumier. Selon les réglementations,
certaines terres seraient sans propriétaires. Ce
présupposé se retrouve dans l'enquête de vacance de terre.
Affirmer que certaines terres sont dépourvues de propriétaires
pose de nombreux problèmes par rapport aux ayants droits. En effet, de
nombreuses parties de forêts éloignées des villages peuvent
paraître vacantes mais ce n'est pas le cas dans la réalité.
En majorité, les terres sont réparties aux chefs coutumiers. Peut
être existe-t-il des terres vacantes mais aucun cas me permet de
l'affirmer. Cette notion de terre vacante est présente depuis la
colonisation belge.
Elle est depuis longtemps un instrument au service du milieu
politique et économique pour octroyer des terres. Pour les des
sociétés étrangères par exemple. Les populations
locales font souvent références à cela car en zone rurale,
plus que l'Etat, c'est les chefs coutumiers qui disposent de l'autorité
sur des terres qu'ils estiment les leurs. Voici ce qu'affirme le fils
ainé de Lingolo Isa'Isomba (patriarche du clan Bafaka),
José ITONGA :
« Le sol et le sous-sol
appartiennent à l'Etat. Mais l'Etat a donné la primauté
à celui qui a occupé pour la première fois cette terre.
Ici chez nous, si l'Etat veut planter une palmeraie, ou si il veut partager
à sa population une partie de terre pour les cultures vivrières,
l'Etat envoie le message au chef de groupement qui demandera à ses
notables pour chercher les terrains qui suffit pour répartir la
population. Les terrains appartiennent aux autochtones, et non à l'Etat.
L'Etat c'est l'ensemble de toute les populations. Ce n'est pas qu'il y a une
personne qui est choisit pour être le propriétaire des
terres 87(*)».
Les chefs coutumiers vont donc se retrouvent dans une position
particulière. Eux mêmes sont aussi les propriétaires des
terres. Les lois concernant les terres vacantes participent à un long
processus en Afrique, depuis la présence europèenne. L'Etat
dispose toujours d'un certain monopole (ou appropriation d'Etat) comme le
souligne Cubrilo M. et Goislard
C., en reprenant Le Roy E. :
« L'Etat colonial a construit son monopole
foncier en appliquant la théorie du domaine éminent et en
imaginant la catégorie des terres vacantes et sans maître. La
revendication du monopole foncier a été reprise par les Etats
contemporains, avec parfois des compromis. Car le monopole foncier de l'Etat
appliqué au niveau national est concurrencé par d'autres formes
d'organisation à l'échelle locale88(*) ».
Historiquement, c'est également à travers des
politiques rurales que l'administration coloniale a tentée de modifier
les pratiques foncières. C'est le cas avec la création du
paysannat dans le Congo Belge. Cette politique agricole a été
mise en place à partir de 1936. Cela se traduit par l'accession à
la propriété qui permet en théorie de jouir d'une
liberté économique. En pratique, cela consiste à
établir sur un espace délimité (après des
enquêtes préliminaires) les populations sur des lots choisit par
l'administration. C'est une pratique qui a permis à l'Etat d'exercer un
monopole foncier sur des populations.
Le changement de statut de l'espace est une continuité
qui n'est pas remise en cause encore actuellement. C'est un facteur qui
augmente l'illégitimité de l'Etat auprès des populations
locales, et auprès des chefs de terres. De même, l'Etat africain
est souvent un relais d'enjeux extérieur liés à des
processus économiques globalisés. Pourtier R.
parle de « domination extérieure 89(*) » pour
décrire ces phénomènes en Afrique, où l'on
privilégie les enjeux extérieur plutôt que locaux. Par
exemple, on favorise la mise en place de grandes sociétés
d'exportations plutôt que de développer l'agriculture paysanne qui
représente une activité indispensable pour la très grande
majorité de la populations de la Province de l'Equateur, pour ne citer
qu'elle. Dans ce contexte, on comprend l'utilité des lois sur des terres
qui seraient sans propriétaires, et par là même, on
comprend également que les chefs coutumiers, ou tout ce qui se
réfère à une gestion de type coutumière va
s'opposer au projet de l'Etat.
2. Les acteurs fonciers dans le cas d'une cession de
terre.
Il y a un décalage entre le droit écrit et la
pratique en matière foncière. Les lois sur la
propriété imposent de se référer à l'Etat
dans la cession de terre. Il est donc illégal d'obtenir
une portion de terre sans se référer à l'administration.
Selon les lois, chaque cession de terre doit être obtenue par
l'administration en charge du foncier. A l'échelle du Territoire de
Basankusu ce n'est pas l'administration du Territoire mais auprès du
District faute de mieux. Le district est l'échelon inférieur au
Territoire. L'Etat est le premier interlocuteur pour gérer les affaires
foncières en zone rurale car toute demande de terre est
considéré comme illégale (non conforme au droit
écrit) si elle est réalisée uniquement au niveau des chefs
coutumiers. Il existe deux manières écrites pour les mouvements
fonciers en zone rurale : les titres fonciers coutumiers et l'acte de
cession. Ces deux méthodes permettent la reconnaissance des
propriétés.
Un titre foncier coutumier rend officiel
vis-à-vis de l'Etat une propriété. Lorsqu'une personne
exploite une terre (essentiellement pour les plantations de palmiers, de
caféiers ou de cacaoiers), cela peut permettre une sécurisation
foncière. Ce document (Annexe n°4, p. 160) est
principalement utilisé pour transmettre par héritage des biens
fonciers. La mise en place de ce système est récent, et il n'est
pas du tout généralisé en zone rurale. Ce document
étant payant (3 dollars environ), certains propriétaires n'ont
pas les moyens financiers pour sécuriser leurs biens. Etant donné
que le phénomène de propriété s'accentue, et que la
terre est de plus en plus demandée pour l'agriculture, les titres
fonciers coutumiers peuvent résoudre certaines disputes à propos
de la propriété, par exemple, avec le bornage et le calcul de la
superficie effectués lors de la remise du titre. Malgré tout, les
titres sont aussi parfois remis sans que ces préalables soient
effectués.
L'acte de cession est un moyen lui aussi
récent. Il permet «d'échapper » à la
transmission des terres par les clans, et donc d'échapper aux
règles foncières coutumières. Cette méthode est
proche des titres fonciers car elle concerne le long terme. En effet, les
titres permettent de céder des terres de manière durable. Lors
d'un acte de cession les signataires vont être le chef de groupement, le
chef de localité, ainsi que les notables coutumiers. Il semble que
l'acte de cession soit plus efficace vis-à-vis de la loi qu'un titre
foncier coutumier. Tout comme les titres fonciers, l'acte de cession est
très peu utilisé, de plus tous les mouvements fonciers ne sont
pas pris en compte.
D'après les enquêtes et les entretiens
réalisés auprès des autorités foncières du
District de l'Equateur 90(*), il est primordial d'obtenir une parcelle de
terre en accord avec le droit coutumier local. Ensuite, munit d'un document
écrit, l'acquéreur se rend chez les représentants de
l'Etat pour officialiser la concession. Octroyer des terres sans le
consentement du chef coutumier n'est pas concevable car les conséquences
peuvent être graves si le pouvoir coutumier est ignoré.
Ces conséquences auront pour but de faire partir le
nouveau propriétaire, par la sorcellerie par exemple. Comme cela a
été vu précédemment, les recours dont disposent les
chefs coutumiers pour s'opposer à l'Etat où à une
main-mise dans leur gestion des terres ne sont pas officiels, et ils peuvent ne
pas être rationnels. La sorcellerie, de part son caractère
mystérieux et dangereux représente un moyen de pression
très puissant. De plus, les problèmes dans l'exécution de
la justice et dans les recours officiels quels qu'ils soient sont très
largement inefficaces, d'autant plus lorsque les chefs coutumiers ne disposent
pas de relations avec le milieu politique, ni de moyens financiers importants.
A cela s'ajoute le fait que la régularisation des titres fonciers
coutumiers par les représentants locaux de l'Etat n'est pas
fréquente.
Ils sont nécessaires pour un étranger, mais pour
les clans, les lignages ou les familles, cela se réalise rarement par
écrit. Des documents fonciers officiels représentent un
coût financier que ne peuvent assumer bon nombre de personnes. Il ne
m'est pas possible de le quantifier, cela reste donc du domaine de
l'hypothèse. Néanmoins, les Territoires étant vastes et
pas toujours facile d'accès, l'administration a de grandes
difficultés pour gérer le foncier en zone rurale. Les voies de
communications sont pourtant extrêmement importantes dans
l'édification d'un Etat-nation comme le souligne Pourtier
R. : « Dans l'immense Zaïre la
cohésion de l'Etat est affaiblie par l'incapacité à
maîtriser le transport au sol ; en dehors de quelques rares axes de
qualité, le contrôle des pouvoirs publics se dilue rapidement
dès que l'on quitte les centres urbains91(*) ».
De part le manque de personnel et de moyens adéquats, la gestion
foncière est surtout le fait des chefs coutumiers.
L'Etat n'a donc qu'un rôle d'intermédiaire
vis-à-vis d'un pouvoir coutumier, qui, pris dans son sens large est
très important en zone rurale, voire prédominant. On peut ajouter
également que le pouvoir coutumier est toujours en rivalité avec
l'Etat pour qui le sol et le sous-sol lui appartiennent. Depuis l'époque
coloniale jusqu'à aujourd'hui, la législation concernant la
propriété de la terre est au coeur d'enjeux qui vont de
l'échelle globale pour concerner le local.
Le problème principal vient du fait que l'Etat cherche
légitimement à interférer avec les pratiques
foncières locales, mais sans qu'il y ait de véritables consensus
entre ces deux échelles dans la mesure où la reconnaissance des
droits de propriétés n'est que partielle.
3. La forêt limite-t-elle de l'autorité de
l'Etat ?
La Province de l'Equateur est avant tout marquée par un
tissu forestier très dense. Dans cet espace de forêts,
l'occupation humaine est très peu marquée dans le paysage. On
peut même dire que le peuplement ressemble à un îlot au
milieu d'un océan de forêts. Dans ce contexte, la
prédominance de la forêt entraîne un enclavement important.
Cela rend les déplacements difficiles d'autant plus que cela est
aggravé par le manque d'axes de communication. Les forêts ont
souvent été un frein à l'établissement de
l'autorité de l'Etat. L'histoire donne de nombreux exemples où la
mise en place d'autorité politique régionale a
nécessité des politiques de désenclavement forestier, pas
toujours avec succès comme le souligne Pourtier
R.: « La forêt (...) fit longtemps
écran à l'établissement d'une autorité centrale
efficace : maints administrateurs coloniaux devaient constater impuissants
qu'elle s'y engloutissait 92(*)».
Par exemple, les routes coloniales ont été
conçues à cet effet : pour administrer plus efficacement le
territoire en augmentant les échanges et les déplacements. Les
axes de communications sont d'une grande importance pour la maîtrise
territoriale de l'Etat, et « c'est principalement les routes qui,
aujourd'hui, facilitent le désenclavement et les mouvements de
population 93(*)». L'axe de transport le plus
présent en Afrique est avant tout le réseau routier. Plus de 80%
des transports se font par les routes, et les pays d'Afrique centrale disposent
de la plus faible longueur du réseau routier à l'échelle
du continent avec environ 120 000 km de routes, dont environ 75% sont
considérées en mauvais état. (Ben Hammouda H.
& Koumaré H.94(*), CEA-Bureau d'Afrique Centrale
95(*))
.
La forêt est dans ce raisonnement un facteur qui limite
l'implantation d'une autorité d'Etat. C'est parce que les accès
sont difficiles que l'Etat ne peut prétendre avoir une influence forte
au sein de certaines régions forestières comme c'est le cas dans
cette partie du Bassin du Congo. C'est une explication possible (parmi
d'autres) pour comprendre pourquoi des modes anciens de gestion foncière
semblent restés importants en zone rurale forestière. L'Etat et
l'autorité qui en découle est en effet bien souvent un facteur
non-négligeable de la transformation de ces modes de gestion. Les
diverses lois dont est à l'origine l'Etat centralisé n'ont qu'une
influence faible pour les populations Mongo et sur leurs manières de
gérer le domaine foncier.
Chapitre 3
La prise en compte de telles pratiques foncières
dans la conservation d'espaces naturels
La conservation d'espaces naturels importants en terme de
biodiversité nécessite de s'intégrer dans un contexte
local précis. Les politiques des acteurs environnementaux passent par
des politiques territoriales et le domaine foncier est un élément
nécessaire à prendre en compte.
En effet, les politiques de conservation et de
développement agissent sur le domaine foncier, précisément
sur la manière d'utiliser l'espace. Par exemple, lorsque l'on cherche
à modifier certains usages des forêts.
L'utilisation des ressources forestières est
liée à la manière dont est approprié l'espace. La
propriété des forêts est ainsi importante à
connaître si on cherche à interdire certains
prélèvements aux populations locales.
Nous allons donc nous pencher sur le cas de la pratique de la
chasse et comment elle interagit avec les politiques environnementales.
Ensuite, nous tenterons de mettre en évidence en quoi les forts taux de
couverture forestière sont dû ou non à la manière
dont est organisé le foncier des populations Mongo.
1. La réserve Lomako Yokokala : la
volonté de modifier l'usage de la chasse.
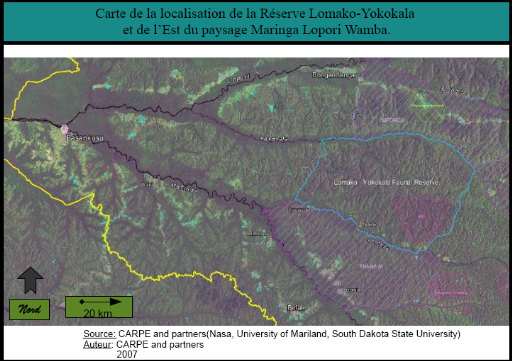
Figure 14.
Cette réserve fût crée en 2006 par l'Etat.
Elle a pour but de protéger la faune encore présente dans la
partie centrale de l'aire M.L.W. Notamment l'espèce Pan
paniscus, c'est-à-dire le singe Bonobo qui se trouve uniquement en
RDC. La création de la réserve est principalement le fait de
l'Etat et AWF intervient pour sa mise en place et sa gestion. Les chefs
coutumiers ont été consultés pour obtenir leur accord
visant à mettre en place cette réserve sur leurs terres. Bien que
ces politiques de conservations soient liées à un besoin de
l'Etat, les populations locales ont en grande majorité la conviction que
cette zone est la propriété de AWF.
Cette réserve à pour but de procurrer un refuge
pour la faune de la région. La pratique de la chasse est en effet
très largement répandue dans toute zone forestière M.L.W.
La chasse est responsable de la raréfaction du gibier dans de nombreuses
forêts. Il faut ajouter que la chasse est une pratique très
ancienne qui est également un trait culturel très important chez
les Mongo, et c'est sans doutes la pratique ancienne la plus importante (avec
la pêche), beaucoup plus que l'agriculture et les plantations. Les
différentes guerres, la pratique agricole a but commerciale ainsi que
les difficultés que connaissent les activités d'élevages
dans la région ( avec la peste porcine par exemple) sont certains des
facteurs qui peuvent permettre de comprendre la disparition du gibier autour
des villages et des pôles urbains de la région. De nombreux
témoignages traduisent des rarefactions d'espèces comme les
singes, mais aussi les éléphants. Auparavant, les
éléphants pouvaient détruire les cultures villageoises
voire le village lui-même. Ce n'est plus le cas, et pour chasser, il est
nécessaire de pénétrer toujours plus loin en forêt.
La pratique de la chasse permet également d'obtenir des revenus
importants aux chasseurs, en plus d'obtenir une nourriture de qualité,
et qui plus est gratuite. En effet, une famille ou une lignée peut
chasser et mettre des pièges dans leurs forêts, voire même
dans des terres ne leur appartenant pas.
Pourtant, ce n'est pas vraiment les populations villageoises
qui pratiquent la chasse. Cette pratique existe mais elle a fortement perdu son
importance, surtout dans les zones proches de pôles urbains, du fait de
la surexploitation de la ressource. La chasse est surtout le fait de campements
localisés profondément en forêt, et par des braconniers. Un
campement peut être composé d'une population très faible
(par exemple une famille), mais il est fort possible de trouver de très
nombreuses populations au sein d'un campement (400 personnes par exemple). On
trouve ainsi des campements autour de la réserve, d'où des
conflits d'usage. Des groupes de chasseurs se rendent fréquemment dans
la réserve. Très enclavé de part les forêts et les
marécages, le gibier y est encore plus abondant que dans d'autres
parties de la région M.L.W. Des conflits opposent les gardes de la
réserve (gardes de l'ICCN 96(*)) à des chasseurs. Parfois de
manière violente comme c'est le cas au Nord de la réserve, dans
le territoire de Bongandanga. La réserve est majoritairement
située sur ce territoire, et c'est une des régions les plus
réticentes à la conservation. Cela vient du fait que la chasse
est très pratiquée par les populations présentes dans
cette région, et l'agriculture n'y est que très faible par
rapport à d'autres territoires comme Djolu ou Basankusu. Ces conflits
d'usage ne concernent pas exclusivement la chasse mais aussi la pêche.
Des populations vivent de la pêche dans toute le paysage M.L.W. et cela
comprend aussi la bordure de la réserve délimitée par les
rivières Lopori au Nord, et Maringa au Sud. L'ICCN avait interdit
l'accès pour la pêche, mais la pêche semble autorisée
aujourd'hui suite à des conflits entre les pêcheurs et les gardes.
Beaucoup de personnes de toute la région forestière où
agit AWF pensent que la chasse est interdite partout, et que la protection du
Bonobo se fait à l'encontre de leurs activités de subsistances.
L'enclavement de la région explique ce manque d'information et de
communication aux populations forestières et villageoises. De plus, la
politique de conservation est récente, et les voies d'accès et de
communications étant rares et dans un état très mauvais,
ces conflits demeurent.
La modification de l'accès au gibier par la
création de la réserve peut aussi entraîner un
phénomène de surchasse dans les périphéries de la
zone protégée. Néanmoins, les droits d'usages sont
stricts concernant les propriétaires des forêts où le
gibier est encore abondant. Il est nécessaire pour un groupe de
chasseurs des villages voisins de demander les autorisations
coutumièrement : par des dons, des contre-partie comme une part de
viande, ou autre, le chasseur va être autorisé à
prélever du gibier. Ainsi, les droits d'usages deviennent ignorés
volontairement lorsque le gibier vient à disparaître. En effet,
cette pratique est liée à l'appropriation des ressources
forestières, et les droits d'usages disparaissent dès que l'usage
n'est plus fréquent.
Corrélée à un engagement très peu
important de l'Etat dans cette zone forestière, la gestion du domaine
foncier est marquée par des pratiques anciennes. Qui plus est, cette
gestion est légitime face à un Etat aux multiples
difficultés. Que ce soit en matière de justice foncière ou
en matière de distribution des terres, la gestion coutumière
exerce donc un pouvoir important dans cette région. C'est dans ce
contexte que la conservation du patrimoine naturel est prise en charge par des
acteurs extérieurs car l'Etat seul ne peut assumer financièrement
de mettre en place de telles politiques. La difficulté vient du fait que
l'ONG, au même titre que l'Etat est considéré par de
nombreuses populations locales comme étrangère. Les critiques ne
vont donc plus se tourner vers l'Etat mais vers l'AWF. Bien que les ONG ne
remplacent pas le rôle d'un Etat, les différentes politiques
d'aménagement mises en place (ou en projet) montrent bien que cela y
ressemble. L'exercice de l'Etat est par ailleurs très lié
à la conservation comme le souligne Rodary E. :
« La conservation s'inscrit en
continuité des logiques étatiques de contrôle des
populations, de contrôle territorial, de marchandisation et
d'étatisation des ressources. Le secteur se construit sur une
homothétie avec l'Etat97(*) ».
Pratiquer des politiques de conservation dans une
région où les défaillances de l'Etat sont flagrantes
(pauvreté, santé, enclavement, corruption, déficit de
l'administration,...) peut être problématique car toutes ses
difficultés seront autant de problème pour les acteurs
extérieurs. Par exemple, bien que l'ONG cherche à appuyer
l'agriculture, le manque d'axes de transports et l'enclavement de certaines
parties du paysage M.L.W. ne relèvent pas du rôle d'une ONG
environnementale, mais bien d'une politique de l'Etat. AWF ne cherche pas
à remplacer le rôle que pourrait jouer un Etat bien ancré
dans son territoire, mais pour limiter la pratique de la chasse elle est
pourtant contrainte d'assumer un peu de ce rôle. Et d'une certaine
manière, la préservation de la faune implique des contreparties
pour développer l'agroforesterie et l'élevage, et donc cela
s'entraîne obligatoirement sur une perte de superficie forestière.
En effet, l'agroforesterie bien que fixée sur un territoire n'est
actuellement pas encore une alternative puissante : elle semble être
encore, qu'un complément pour les paysans concernés. Cela ne
limite donc pas forcément l'agriculture itinéraire sur
brûlis. Ces régulations sur l'espace correspondent à une
maîtrise foncière.
2. L'organisation foncière de
l'espace : un atout pour la conservation ?
Ce système foncier est le reflet de l'organisation de
la société Mongo. Les liens familiaux sont interconnectés
à la gestion foncière. Les familles, les lignages et enfin les
clans ont un rôle important en matière foncière.
Héritée d'une organisation ancienne, la gestion des terres
traduit une adaptation des populations locales. Ce sont elles qui sont les
garants de l'organisation de l'espace face à un Etat qui a peu
d'influence en zone rurale et forestière
Il est donc possible de poser la question de l'impact de ce
type de gestion de la propriété de la terre par rapport aux
milieux naturels : les forts taux de couverture forestière
observables dans cette région sont-ils reliés à cette
organisation foncière ?
Le type d'appropriation des terres peut dans certains cas
être un facteur limitant l'implantation humaine, et les activités
humaines. La terre est précieuse, c'est même un des biens les plus
important pour les Mongo comme il l'a été précisé
à maintes reprises. Les règles de propriétés, ou
encore les droits d'usages limitent l'utilisation intensive de l'espace.
L'agriculture ne peut pas être pratiquée partout, il faut des
autorisations des chefs de terres car les règles sont précises et
il est de plus en plus difficile d'obtenir des parcelles cultivables en dehors
des terres gérés collectivement par les structures familiales,
lignagères et claniques. En attestent les difficultés des
entreprises étrangères et privées qui exploitent les
ressources dans la Province.
Cette gestion foncière est un trait marquant de
l'espace. Etant donné que c'est un système qui peut s'adapter
rapidement car les règles ne sont jamais fixes et lorsque les besoins le
permettent, elles peuvent évoluer. D'après les entretiens, on
constate que ces règles se sont durcies récemment, dans un
contexte de pression accrue sur les terres. Il est primordial que les
propriétés collectives soient transmises aux
générations futures, et la dimension temporelle sur les terres a
donc une influence. Par exemple, si toutes les terres d'un lignage sont
vendues, cela va avoir des conséquences sur les membres -
présents et futurs - du lignage. C'est un contexte très
différent de ce que l'on peut observe dans les forêts du bassin
amazonien où l'appropriation des terres est plus facile à
réaliser par les petits paysans, puis par de grands exploitants
agricoles.
Cette gestion des terres limite donc l'utilisation des terres
en dehors d'une utilisation collective. Pour un étranger, le contexte
foncier actuel peut donc être un problème pour obtenir des
surfaces où pratiquer l'agriculture. La gestion coutumière semble
plus favorable aux membres des familles ou des lignages, et au contraire, elle
est plus restrictive concernant les étrangers lorsqu'ils sont demandeurs
de parcelles pour des activités économiques. L'importance que
revêt les forêts explique aussi qu'il est utile de conserver ces
espaces à l'origine de nombreuses sources de produits naturels
indispensables pour les populations rurales (cf. Fournier
T. : Mémoire de recherche concernant l'utilisation des
plantes et des produits forestiers non-ligneux chez les populations Mongo -
2009).
Une autre explication de la présence d'un couvert
forestier qui n'a pas beaucoup subit d'évolutions dans le temps, est
liée à la pauvreté. Le manque d'outils explique pourquoi
les populations rurales n'utilisent que rarement le bois d'oeuvre dans les
constructions d'habitations. L'exploitation des arbres nécessite des
scies, et de nombreux outils pour travailler le bois, et peu de personnes dans
les villages où se situent ces recherches disposent de tels outils.
C'est pourquoi on peut observer que le défrichage des champs est
difficile et que les arbres présents sur les parcelles ne sont que
rarement utilisés.
Le manque de moyens économiques aux mains des
populations villageoises est donc un facteur explicatif important. Cela semble
être la raison principale de la prédominance du couvert forestier.
Pourtant, l'exploitation des arbres pourrait permettre des revenus financiers
aux populations, dans le cas où ce serait elles mêmes qui
pratiqueraient cette activité, et non une entreprise privée. La
pauvreté limite donc aussi certains prélèvements de
ressources forestières.
Synthèse
Les difficultés que connaît l'Etat sont
révélatrices des tensions autour des terres dans cette
région forestière. La gestion coutumière semble être
très influente, et il ne fait aucun doute que le domaine foncier est
avant tout géré par ce système ancien, plutôt que
par le droit moderne. Le manque d'influence de l'Etat en zone rurale explique
que les populations locales se réfèrent toujours à des
pratiques foncières héritées d'une longue tradition. La
résolution des conflits fonciers est la preuve que la gestion
coutumière est adaptée aux populations. Cette justice
s'intègre à un contexte social et économique
spécifique aux Mongo. Les conflits fonciers sont parfois
inhérents à la vie des habitants et à la structure de la
société. La gestion coutumière tend à
réduire ces problèmes liés à la terre.
Le cas des conflits entre les acteurs privés et les
populations locales traduisent différentes manières de concevoir
l'appropriation des terres. Ils peuvent rarement trouver de résolution
locale, et ils nécessitent de se rendre dans les tribunaux provinciaux.
La terre se retrouve donc au coeur de rapports de forces. Le plus souvent,
entre l'Etat et les chefs coutumiers, comme cela s'observe avec les limites
urbaines et rurales. Le monopole foncier de l'Etat est donc faible dans la
pratique. La gestion coutumière des terres s'intègre
difficilement dans le cadre juridique de la RDC, d'autant plus lorsque les
régions sont enclavées physiquement. La
perméabilité des forêts en matière de
communications, d'échanges, met l'Etat dans une position complexe. Les
territoires sont donc influencés par des pratiques foncières
anciennes même si des évolutions existent. La pression accrue sur
les terres liée à l'augmentation de l'agriculture est un exemple
particulièrement d'actualité.
Ce contexte rend la conservation difficile à mettre en
place. Les acteurs environnementaux sont au coeur des tensions entre la
maîtrise foncière de l'Etat et les pratiques foncières
locales. Les relations (obligatoires) entre les ONG et l'Etat entraînent
des critiques de la part des populations locales, et la modification de
l'utilisation des terres et des forêts suite à la création
de la réserve nécessite une approche intermédiaire. Cette
position d'intermédiaire est complexe à mettre en place dans la
mesure où elle doit s'intégrer dans le droit de l'Etat et en
même temps dans les pratiques foncières des Mongo.
Conclusion générale
L'organisation foncière avant la présence
européenne était réalisée de manière
homogène sur les territoires. Les terres étaient réparties
pour que chaque clan, ou chaque structure sociale dispose de terres assez
vastes pour ses besoins vitaux. Le mode de vie étant fortement
tourné vers la chasse, l'utilisation des ressources était
encadrée par des règles précises, qui ne mettaient pas en
péril les populations animales. En effet, le bassin du Congo est
peuplé d'agriculteurs depuis longtemps. Chaque village (ou campement)
avait ses propres terres, et la répartition des populations semblait
être adaptée aux milieux naturels, avec un certain
équilibre. Ce peuplement limitait par exemple l'apparition de certaines
maladies comme la maladie du sommeil (liée à la mouche
Tsé-Tsé). La réorganisation coloniale avec l'alignement a
favorisé « le réveil » de cette maladie.
Suite à cette modification de l'organisation des terres, de nombreux
villages ont été dépeuplés. Après la
colonisation, la répartition des populations le long des routes n'a pas
empêché la prolongation d'un système foncier
hérité des lointains ancêtres.
Le système de gestion des terres chez les populations
Mongo traduit des interactions très fortes entre l'organisation de la
société et la propriété de la terre au point que
les deux se confondent. Les populations Mongo ont tissé des liens
étroits avec les terres. Le foncier est en corrélation avec un
type de société. Il est également légitimé
par une histoire particulière et des pratiques religieuses comme le
totémisme ou le rôle des ancêtres qui expliquent encore
certains rapports à la terre.
Une gestion coutumière
prépondérante sur les terres.
La grande majorité du pays est rurale. Le droit d'Etat
est principalement efficace en zone urbaine, contrairement aux campagnes et aux
forêts où la propriété des terres est
gérée par les populations locales elles-mêmes. Le foncier
est donc géré localement sans trop d'interférences avec
l'Etat. La gestion foncière telle qu'elle est pratiquée par
l'Etat est parfois en opposition avec une gestion foncière locale
complexe. Le droit national en matière foncière semble beaucoup
moins adapté à la société Mongo. Entre un
système foncier hérité du droit européen et une
gestion marquée par des pratiques foncières anciennes et orales,
il existe des divergences. Les difficultés rencontrées par l'Etat
en RDC, principalement en zone forestière, participent à la
continuité de cette gestion foncière.
Il existe des tentatives pour intégrer plus
efficacement dans le droit la gestion coutumière, mais la grande
diversité des systèmes fonciers en RDC rend très complexe
la création d'une loi à une échelle nationale
centralisée. Il se pourrait par ailleurs que les hommes politiques
craignent de mettre en place une telle loi. C'est un constat propre à la
RDC. La République du Congo voisine impose que tous les titres de
propriétés soient déclarés aux autorités
foncières sous peine d'amendes. Il n'existe pas de telles mesures en
RDC. Il est souvent admis que l'Etat est le seul garant d'une
équité de gestion sur les terres. Ce n'est pourtant pas toujours
le cas. L'Etat peut aussi être à l'origine
d'insécurité foncière. La superposition de
différentes manières de gérer le domaine foncier peut se
faire aux dépends des populations locales. C'est principalement le cas
lorsque la gestion de l'Etat est fortement corrélée à des
élites urbaines. Les populations locales peuvent se retrouver dans des
jeux d'échelles qui leurs sont défavorables.
Les changements récents concernant
l'utilisation des terres.
Ce sont plutôt les logiques extérieures comme la
demande des populations urbaines en viande de brousse, qui modifient les
prélèvements sur les écosystèmes et peuvent
par-là nuire à la préservation des forêts. Ce n'est
pas vraiment l'augmentation de l'agriculture qui est responsable de cela. En
effet, l'agriculture telle qu'elle est pratiquée faute de moyens
techniques financièrement trop coûteux pour les paysans, reste peu
importante dans la région. Les superficies cultivées par famille
sont dans tous les cas assez faibles. Les logiques économiques
extérieures sont prises en compte par AWF, notamment avec la coupe de
bois pour les besoins en chauffage pour la cuisine. Les terres et les
forêts sont donc aussi exploitées pour des populations urbaines.
Les populations locales se trouvent encore une fois au coeur d'enjeux
régionaux, et la faible utilisation des terres de cette région
font qu'elles sont perçues comme disponibles vis-à-vis d'autres
régions de la RDC, exploités plus intensivement.
L'urbanisation croissante de la région entraîne
des modifications dans l'utilisation des terres. Les périphéries
urbaines sont beaucoup plus exploitées par l'agriculture que les
villages en zone forestière. Les besoins des populations ont
évolué, mais le système de gestion des terres reste en
partie le même. L'agriculture est pratiquée dans le but d'avoir
des revenus, et c'est un trait marquant des changements dans l'usage des
terres. C'est une des explications de l'augmentation des conflits fonciers. Les
conflits sont fréquents mais leurs conséquences sont
malgré tout atténuées par le droit coutumier. Les
problèmes sont en effet plus graves lorsque ces conflits concernent les
populations locales et des acteurs extérieurs comme les
sociétés privées. Ces types de conflits sont de plus
rarement résolus à l'échelle locale.
L'enclavement très fort de cette région de la
RDC limite malgré tout les échanges économiques et
sociaux, ce qui participe également à la
« préservation » d'un système foncier ancien,
même si des évolutions ont eu lieu depuis plus de 100 ans. Le
rôle du clan est le meilleur exemple de ces changements, son pouvoir
diminuant de plus en plus.
L'intégration de la conservation aux
pratiques foncières locales.
En tant que vecteur d'une organisation territoriale
marquée par la présence de très vastes forêts, la
gestion foncière des populations Mongo a longtemps été une
manière efficace de préserver ces milieux naturels. En effet,
c'est parce que l'environnement a été utilisé de
manière contrôlé, par une gestion des terres qui implique
de ne pas détruire la forêt car elle doit être disponible
pour les générations futures, que cette région du bassin
du Congo est encore aujourd'hui préservé, mis à part pour
certaines espèces animales comme l'éléphant ou encore les
espèces de singes. Il semble que cette organisation ne mette pas en
péril la forêt. La gestion coutumière peut donc être
perçue comme un facteur de préservation des forêts chez les
Mongo. Cependant, les nouveaux besoins des populations (agriculture,
éducation, santé), tendent à changer les rapports à
la terre. De plus, la vie en zone forestière est parfois
considérée par les populations locales comme un asservissement,
ce qui s'oppose à la vision des acteurs environnementaux.
La difficulté de pratiquer un développement en y
alliant la conservation de la nature est forte, qui plus est si la
région est aussi très enclavée et marquée par une
grande pauvreté. Travailler de consort avec les populations locales est
une avancée positive de la conservation, mais cela étend aussi
les compétences des ONG environnementales. Elles doivent intégrer
les populations et tout ce que cela implique. C'est-à-dire, leur
manière de gérer l'espace, leurs pratiques économiques,
politiques et culturelles. Cet élargissement du champ d'action des ONG
est nouveau, et il nécessite de concevoir différemment les
espaces naturels. En effet, alors que les populations peuvent concevoir leurs
forêts comme des sources potentielles de développement, les
acteurs environnementaux ont parfois certaines réticences à
totalement l'accepter. De la même manière que le
développement durable, lorsqu'il est mis en place, considère
souvent en priorité l'environnement par rapport aux hommes. Certaines
politiques de conservations n'échappent pas à ce constat.
Quelles peuvent être les conséquences de la
modification des activités économiques, et principalement,
favoriser l'agriculture, pour des sociétés où
l'interaction entre l'organisation sociale et l'usage des terres est
très forte ?
Les politiques des acteurs environnementaux correspondent
aussi à des choix de société. Dans quelle mesure les
populations locales sont prêtes à les accepter ?
Il semble que les populations de certaines régions
seraient d'accord pour modifier certaines pratiques, mais d'autres en revanche
y semblent très attachées.
Faut-il imposer certaines politiques chez des populations peu
enclines à changer leur manières d'utiliser les
forêts sous peine de voir émerger des conflits
d'usages ?
Dans quelle mesure est-il possible de limiter ces
tensions ?
Le contact avec les populations locales révèle
que des politiques de développement rural (élevage et
agriculture) semble être bien adaptées aux nouveaux besoins des
populations et permettrait, pour l'élevage, de limiter la chasse. Les
populations présentes où se sont déroulées ces
recherches semblent concernées par l'idée d'encadrer la pratique
de la chasse, à condition que des alternatives soient mises en place.
Dans ce sens, il est fort possible qu'elles désirent s'impliquer dans de
telles politiques. La difficulté est principalement le manque de moyens
économiques et donc matériels. Appuyer les associations paysannes
pourrait, sur le long terme être source de développement. C'est un
travail long qui passe avant tout par la communication avec les populations
locales, pour les impliquer dans ces programmes de conservation. Cette
communication semble être la clef pour que les politiques mises en place
ne se traduisent pas par des rejets de la part des populations.
Selon moi, la conservation doit avant tout être une
opportunité pour les populations paysannes de faire évoluer les
modèles agricoles et l'élevage qui pourraient être
considérablement développés, tout en créant des
revenus pour les populations. Cela rendrait plus aptes des populations à
accepter certaines limitations vis-à-vis de la chasse, qui est une
activité très ancrée dans la culture des Mongo.
Les recherches sur le foncier concernent de nombreux domaines
d'études. Compte tenu de la complexité des jeux d'échelles
entre l'Etat et les pratiques foncières locales, il ne m'est pas
possible de répondre à toutes les questions soulevées par
ces recherches. Dû au manque de temps pour les recherches de terrain, les
relations entre la gestion coutumière nécessitent des
approfondissements, ainsi que d'autres recherches pour corroborer ou non celles
présentées dans ce travail.
BIBLIOGRAPHIE THEMATIQUE
Conservation de la nature :
AUBERTIN C.(coord.) (2005).
Représenter la nature ? ONG et biodiversité. IRD,
Paris, 210 p.
DEPRAZ S. (2008). Géographie des
espaces naturels protégés. Armand Colin, Paris, 320 p
LUKETA SHIMBI H. (2003). Forêts
sacrées et conservation de la biodiversité en Afrique Centrale:
cas de la République Démocratique du Congo. XII
Congrès Forestier, Québec, 7 p.
DOUMENGE C. (1990). La conservation des
écosystèmes forestiers du Zaïre. UICN Tropical Forest
Programm, Gland (Suisse), 242 p.
HADLEY M. (1994) « Associer la
conservation, le développement et la recherche pour l'aménagement
des zones protégées en Afrique »,
Unasylva, n° 176
NGUINGUIRI J.C. (1999). Les Approches
Participatives dans la Gestion des Écosystèmes Forestiers
d'Afrique Centrale. Revue des Initiatives Existantes. CIFOR Occasional
Paper no. 23, Jakarta, 24 p.
RODARY E. & CASTELLANET C. (2003).
Conservation de la nature et développement, l'intégration
impossible ? Karthala, Paris, 310 p.
VAN GIJSEGEM V., BAILLI M., NZALI G. & VAN
GIJSEGEM A. (1999). L'évolution de l'attention
attribuée aux intérêts de la population locale en
matière de protection des forêts tropicales en Afrique
Centrale. Presse de l' Université Laurentienne, Ontario, 19 p.
VERMEULEN C. & KARSENTY
A.(2001). Place et légitimité des terroirs
villageois dans la conservation. Presse agronomique de Gembloux, Gembloux
(Belgique), 14 p.
Domaine Foncier :
BOELAERT E. (1956). Le problème
des terres indigènes au Congo Belge. Centre Aequatoria Bamanya,
Mbandaka, 3 p.
BOELAERT E. (1956). Les trois fictions du
droit foncier congolais. Centre Aequatoria Bamanya, Mbandaka, 28 p.
CUBRILO M., GOISLARD C., & L'ASSOCIATION POUR LA
PROMOTION DES RECHERCHES ET ÉTUDES FONCIÈRES EN AFRIQUE
(1998). Bibliographie et lexique du foncier en Afrique Noire.
Karthala, Paris, 415 p.
LAVIGNE DELVILLE P. (2002). « Le
foncier et la gestion des ressources naturelles ». in,
ANONYME (2003). Mémento de l'agronome.
GRET & Editions Quae, Paris, 1692 p.
LAVIGNE DELVILLE P. & CHAUVEAU J.-P.
(1998). Quelles politiques foncières pour l'Afrique
Rurale ? Réconcilier pratiques, légitimité et
légalité. Karthala, Paris, 744 p.
LE BRIS E., LE ROY E. & LEIMDORFER F.
(1983). Enjeux fonciers en Afrique Noire. Karthala, Paris, 425 p.
LE BRIS E., LE ROY E. & MATHIEU P.
(1991). L'appropriation de la terre en Afrique Noire. Manuel d'analyse, de
décisions et de gestion foncières. Karthala, Paris, 359
p.
LE ROY E., KARSENTY A. & BERTRAND A.
(2003). La sécuralisation foncière en Afrique. Pour une
gestion viable des ressources renouvelables. Karthala, Paris, 302 p.
LE ROY E. (1987). La réforme du
droit de la terre dans certains pays d'Afrique francophone. FAO, Rome, 108
p.
HUSLTAERT G. (1931). Réponse au
premier questionnaire de droit indigène. Centre
Aequatoria Bamanya, Mbandaka, 8 p.
HULSTAERT G.(1955). Droits fonciers
indigènes. Centre Aequatoria Bamanya, Mbandaka, 4 p.
HUSLTAERT G. (1958). Protection des
droits fonciers. Centre Aequatoria Bamanya, Mbandaka, 2 p.
HULSTAERT B. Les droits fonciers Mongo.
Centre Aequatoria Bamanya, Mbandaka, 8 p.
O. IGUE J. (1995). Le territoire et
l'Etat en Afrique. Les dimensions spatiales du développement.
Karthala, Paris, 277 p.
PIERMAY J.L. (1993). Citadins et
quête du sol dans les villes d'Afrique centrale. L'Harmattan, Paris,
579 p.
SAFFACHE P. (2002). Dictionnaire
simplifié de géographie humaine.Centre Régional de
Documentation Pédagogique, Fort-de-France, 345 p.
SOHIER A. (1935). Une branche
inexplorée du droit - Le droit coutumier congolais. Revue
générale de la Colonie Belge, Editions Goemaere, Bruxelles, 37
p.
SOHIER A. (1935). Les juridictions
indigènes congolaises. Institut Royal Colonial Belge, Bulletin des
séances, Bruxelles, 56 p.
Forêts du bassin du Congo :
ACTES DE L'ATELIER NATIONAL SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA FORESTERIE COMMUNAUTAIRE EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO (15-16 mai 2007). Vers une gestion
forestière de proximité. Kinshasa, 211 p.
ASSOCIATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DES BOIS
TROPICAUX (ATIBT), (2007).Étude sur les pratiques
d'aménagement des forêts naturelles de production tropicales
africaines. Paris, 136 p.
C.T.B. (COOPÉRATION TECHNIQUE BELGE)
(2007).Quel avenir pour les forêts de la République
Démocratique du Congo? Instruments et mécanismes innovants pour
une gestion durable des forêts. CTB, Bruxelles, 83 p.
C.T.B.(2007). Numéro
thématique sur les forêts du Congo. Nos forêts, notre
avenir! CTB, Bruxelles, 32 p.
DEBROUX L.(dir.); TOPA G.(dir.); KAIMOWITZ D.(dir.);
KARSENTY A. (dir.) et HART T.(dir.) (2007). La forêt en
République Démocratique du Congo post-conflit. Analyse d'un
Agenda Prioritaire. Center for international forestry research (CIFOR),
Jakarta, 107 p.
DEMANGEOT J. (1999). Tropicalité.
Géographie physique intertropicale. Armand Colin, Paris, 340 p.
KHUNE K. (2005). Utilisation
présente et future des forêts dans la province de l'Equateur en
République Démocratique du Congo. 37 p.
Internet :
http://www.kongo-kinshasa.de/dokumente/divers/kuehne_0507.pdf
P.F.B.C. (Le Partenariat pour les Forêts du
Bassin du Congo) (2006). Les Forêts du Bassin du Congo. Etat
des Forêts 2006. Comission des forêts d'Afrique centrale &
PFBC, Kinshasa, 258 p.
VEYRET Y. & VIGNEAU J.P. (sous la
dir.)(2002). Géographie physique. Milieux et environnement
dans le système terre. Armand Colin, Paris, 368 p.
Populations forestières africaines:
AMSELLE J.-L., M'BOKOLO E.( sous la dir.) & J.P.
CHRETIEN (1999). Au coeur de l'ethnie, Ethnie, tribalisme et Etat
en Afrique. Decouverte, Paris, 225 p.
BAHUCHET S. (Sous la dir.) (2000). Les
Peuples des Forêts Tropicales Aujourd'hui. Volume III. Région
Afrique Centrales. Avenir des peuples des Forêts Tropicales (APFT),
Bruxelles, 456 p.
BAHUCHET S. (Sous la dir.) (2000). Les
Peuples des Forêts Tropicales Aujourd'hui. Volume II Une approche
thématique. Avenir des peuples des Forêts Tropicales (APFT),
Bruxelles, 655 p.
CHRETIEN J.-P. (1983). Histoire rurale de
l'Afrique des Grands Lacs. AFERA, Paris,
285 p.
DESCOLA P.(2005). Par-delà nature
et culture. Gallimard, Paris, 618 p.
DEMBNER SA(1996), « Peuples
forestiers des forêts humides d'Afrique Centrale : Les
pygmées ». Unasylva, n°186
Internet :
http://www.fao.org/docrep/w1033f/w1033f03.htm
DUTERNE B. (2000). Peuples
indigènes et minorités ethniques: les conditions sociales de leur
reconnaissance. Alternatives Sud Vol. II n°2, L'Harmattan, Paris, 19
p.
LE ROY A. (1909). La religion des
primitifs. Institut catholique, Paris, 522 p.
GOUROU P. (1991). L'Afrique Tropicale.
Nain ou géant agricole ? Flammarion, Paris, 199 p.
Populations Mongo :
BOELAERT E., VINCK H., LONKAMA Ch. (1996).
« Arrivée des Blancs sur les bords des rivières
équatoriales ». Annales Aequatoria, n°17, Centre
Aequatoria Bamanya, Mbandaka, p.7-415.
BONGANGO J. (2008). L'organisation
sociale chez les Mongo de Basankusu et sa transformation. Éditions
Publibook, Paris, 248 p.
DE SAINT MOULIN L.(1987),
« Art :Essai d'Histoire de la Population du
Zaïre ». Zaïre-Afrique, n°217,
septembre 1987, Kinshasa
DE ROP A. & BOELAERT E. (1983).
Versions et fragements de l'épopée Mongo N'song'a Lianja,
Partie II. Centre Aequatoria Bamanya, Mbandaka, 517 p.
BAMALA L. & HULSTAERT G. (1988).
« Les ancêtres de Lianja. Prolégomènes
à l'épopée des Mongo ». Etude Aequatoria
5, Centre Aequatoria Bamanya, Mbandaka, 59 p.
HUSLTAERT G. (1972). Une lecture critique
de l'Ethnie Mongo de G. Van Der Kerken. Etude d'Histoire
Africaines III, p. 27-60.
HUSLTAERT G. (1980). Le Dieu des Mongo
(Zaîre). Anthropos, St. Augustin (Allemagne), 46 p.
HUSLTAERT G. (1990). Institutions
coutumières Mongo. Centre Aequatoria Bamanya, Mbandaka, 16 p.
LONKAMA E. B. (1990).
« Eléments pour une ethno-histoire de Basankusu (Equateur,
Zaïre) En marge d'un centenaire (1890-1990) ». Annales
Aequatoria, n°11, Centre Aequatoria Bamanya, Mbandaka, p. 365-408.
NDAYWEL E NZIEM I & alii.(1998).
Histoire générale du Congo. De Boeck Université,
2ème édition, 955 p.
MINISTERE DES AFFAIRES FONCIERES, ENVIRONNEMENT,
PROTECTION DE LA NATURE, PECHE ET FORET (1999).Plan d'action
provinciaux de la biodiversité
MUNE P.(1958). Le groupement de
Petit-Ekonda. Académie royale des sciences coloniales, Bruxelles,
70 p.
TSHINGI KUENO NDOMBASI S. (2007).
Kinshasa à l'épreuve de la déségrégation
nationale. L'Harmattan, Paris, 312 p.
VAN DER KERKEN (1944). L'Ethnie Mongo
Volume 1 Livre I. Bruxelles, 512 p.
VANGROENWEGHE, LUFUNGULA & HULSTAERT
(1986). L'histoire ancienne de Mbandaka. Centre Aequatoria Bamanya,
Mbandaka
VINK H. l'Enquête menée par
BOELAERT en 1954 sur la propriété foncière chez les Mongo
dans le contexte colonial. Centre Aequatoria, Mbandaka, 47 p.
Droit et administration :
CONSTITUTION du 18 février 2006,
Kinshasa,
DE QUIRINI P. (1987). Comment procéder
pour acheter une parcelle et louer une maison ?. CEPAS, Kinshasa, 60 p.
DE SAINT MOULIN L.& KALOMBO TSHIBANDA
J.-L. (2005). Atlas de l'organisation administrative de la
République Démocratique du Congo. Kinshasa
IBANEZ DE IBERO C.(1913). La mise en
valeur du Congo belge; étude de géographie coloniale.
Receuil Sirey, Paris, 248 p.
LOI 73-021 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés, 20 juillet 1973, Kinshasa
Internet :
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20des%20biens/Loi.73.02120.07.1973.htm
LOI 80-008 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime de sûreté, 18 janvier 1980, Kinshasa, 5 p.
Internet :
http://www.droit-afrique.com/images/textes/RDC/RDC%20-%20Foncier%20suretes.pdf
, p. 95-100.
LOI 011/2002 portant sur le Code
forestier, 29 août 2002, kinshasa, 41 p.
O. IGUE J. (1995). Le territoire de
l'Etat en Afrique. Kartala, Paris, 277 P.
SOHIER A. (1935). Une branche
inexplorée du droit - Le droit coutumier congolais. Revue
générale de la colonie belge, Editions Goemaere, Bruxelles, 37
p.
UNICEF, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES & GAMBAMBO
GAWIYA P.(consultant) (1999). Situation des lois
coutumières et des droits des femmes en République
Démocratique du Congo. Kinshasa, 95 p.
VAUTERS A.-J. (1919). L'Etat
Indépendant du Congo ; historique, géographique, physique,
ethnographique, situation économique, organisation
politique. Bruxelles, 527 p.
Internet :
http://www.archive.org/stream/ltatindpendantd01wautgoog/ltatindpendantd01wautgoog_djvu.txt
Autres :
GHASARIAN C. (1997). Introduction
à l'étude de la parenté. Seuil, Paris, 276 p.
INRA / INAO, Internet :
http://terroirsetcultures.frmfrpaca-lr.eu/spip.php?article74
BOUDON R., BESNARD P., CHERKAOUI M., LECUYER
B.-P. (1989). Dictionnaire de Sociologie. Larouse, Paris, 237
p.
ROUX J.-P., ETIENNE J., BLOESS F., NORECK J.-P.
(2004). Dictionnaire de Sociologie, Patriliéaire. Hatier,
Paris, 448 p.
Liste des documents
· Page 4 : Photographie
1 : Une parcelle de manioc et des arbres servant pour les limites de
propriétés
(auteurs : Fournier T. & Bourgeois U.)
· Page 18 : Photographie
2 : Un chef de terre nommé par l'administration belge
Photographie 3 : Un chef
coutumier
(auteur : Van der Kerken G.)
· Page 24 : Figure 1 :
Carte schématique de la réorganisation de l'espace lors de la
colonisation belge
(auteur : Bourgeois U.).
· Page 26 : Photographie
4 : Construction d'une route en zone de forêt inondée
Photographie 5 : Route traversant le village
des Basengere
(auteur : Van der Kerken G.)
· Page 47 : Figure 2 :
Carte de la localisation des populations Mongo en RDC
(auteur: Bourgeois U.)
· Page 50 : Figure 3 :
Carte schématique de l'arrivée puis du peuplement des Mongo de
Basankusu
(auteur : Bourgeois U.)
· Page 51 : Figure 4 :
Organisation des Mongo de Basankusu
(auteur : Bourgeois U.)
· Page 55 : Figure 5 :
Schéma de l'organisation sociale interne d'une ethnie selon G. Van Der
Kerken
(auteur : Bourgeois U.)
· Page 58 : Figure 6 :
Schéma de l'organisation du territoire de l'échelle
régionale à l'échelon local.
(auteur : Bourgeois U.)
· Page 76 : Photographie
6 : Une bananeraie située à quelques mètres
derrière les habitations du propriétaire.
( auteurs : Fournier T. & Bourgeois U.)
Photographie 7 : Une
bananeraie et son propriétaire.
(auteur : D. Likemba Bokoto)
· Page 78 : Photographie
8 : Une petite palmeraie
(auteurs : Fournier T. & Bourgeois U.)
· Page 80 : Photographie
9 : Un champ défriché et les femmes y travaillant
Photographie 10 :Une jeune
parcelle de maïs.
(auteurs : Fournier T. & Bourgeois U.)
· Page 82 : Photographie
11 : Source Ekiloko appartenant au lignage Nkoy
Photographie 12 : Pose d'une nasse sur une
clotûre de pêche
(auteurs : Fournier T. & Bourgeois U.)
· Page 84 : Photographie
13 : Limite lignagère
Photographie 14 : Limite clanique,
située le long de la route, délimitant les clans
Bokolo et Baolongo
(auteurs : Fournier T. & Bourgeois U.)
· Page 86 :Figure 7 :
Schéma de l'évolution du finage à l'échelle d'un
Clan
Figure 8 : Généalogie du
clan Bokolo et les lignées accueillies
(auteur : Bourgeois U.)
· Page 88 : Figure 9 :
Exemples de parcellaire agricole à l'intérieur du clan Bokolo
(auteur : Bourgeois U.)
· Page 89 : Figure 10 :
Carte schématique des propriétés du lignage B.
Figure 11 : Carte schématique des
propriétés du lignage I.
(auteur : Bourgeois U.)
· Page 91 : Figure 12 :
Carte schématique des propriétés du lignage E.
(auteur : Bourgeois U.)
· Page 104 : Photographie
15 : Plantations de G.A.P.
Photographie 16 : Chemin séparant deux
plantations
(auteurs : Fournier T. & Bourgeois U.)
· Page 109 : Figure 13 :
Carte des plantations de G.A.P. et le groupement de Bongilima
(auteur : Bourgeois U.)
· Page 126 : Figure 14 :
Carte de localisation de la réserve Lomako-Yokokala et de l'Est du
paysage Maringa-Lopori-Wamba
(auteurs : CARPE & partners)
Liste des entretiens
Phila Kasa, membre d'AWF (03/2009)
Antoine Tabu, membre d'AWF (04-05/2009)
Le chef de service des affaires foncières du District, M.
Bangoni (13/04/09)
M. le Procureur du tribunal provincial intinérant
(13/04/09)
Patriarche du clan Bafaka M. Lingolo Isi'Somba (29/04/2009 et
21/05/2009)
M. José Itonga (29/04/2009)
Le chef de lignée du lignage Bokewa (04-05/2009)
Le chef de lignée du lignage Elumbu : Ikolombe Elanga
(également Agronome de Secteur) et son frère Pablo Lokamba Elanga
(04-05/2009)
Le chef de lignée du lignage Bokona Bokwala (25/04/09)
Le chef de lignée Paul Loambo (26/04/09)
Le chef de lignée Luyéyé Bangundu
(26/04/09)
Le chef de localité de Boondjé, M. Bowangala, et
son fils Jean-Calvin (04-05/2009)
Le juge de la localité de Boondjé (25/04/09)
M. Pierre Bokewa (04/2009)
M. Balima Ezeckiel Nono (05/2009)
M. Valentin Longoy et M. Daniel Likemba Bokoto (les
interprètes) (04-05/2009)
M. Guillaume Essalo Lofele, bibliothécaire de Bamanya
(03/06/2009)
ANNEXES
ANNEXE 1 :
Définitions
Le foncier se définit comme le mode
d'organisation de l'espace et des populations humaines qui le composent. Il est
au carrefour entre l'environnement et l'homme, avec une priorité pour la
société. Chaque société humaine s'est
installée sur ce que l'on peut appeler un territoire, et c'est par la
compréhension de la manière dont les sociétés
s'installent que l'on peut analyser le foncier. C'est une notion complexe car
elle nécessite de comprendre une société dans son
ensemble. Il faut analyser le droit, le domaine politique, la
société concernée, l'histoire ou encore l'économie
pour le comprendre. Tous ces domaines énumérés sont en
interaction, en imbrication. L'étude du domaine foncier est donc une
étude pluridimensionnelle qui doit aborder différents aspects
pour comprendre un système foncier donné. Il renvoie à une
notion de territoire car il est délimité par des
frontières, des limites, et c'est aussi un fait social total. Le foncier
est par définition l'« Ensemble des éléments
ayant trait à la terre ou plus précisément à la
propriété de la terre. 98(*)» Cela renvoie
à l'organisation des rapports sociaux, à la structure sociale des
populations villageoises, et donc aux statuts sociaux. La
propriété de la terre est également marquée par les
pratiques locales qui ont trait au fait religieux qui influence les rapports
entre les hommes et leurs milieux. Pour comprendre le foncier il est donc
nécessaire de comprendre comment les hommes vivent avec leur
environnement, qui est de manière pratique, leur territoire. Le foncier
est aussi une propriété, et on utilise l'expression
d' « ayant droit [pour parler de] toute
personne ou entité titulaire des droits fonciers coutumiers
99(*) ». L'accès
à la terre va donc être déterminé par des droits
d'usages. Dans notre lieu de recherche, cela concerne les coutumes, car ce sont
ces dernières qui déterminent comment accéder à
une ressource particulière telle que le gibier, la pêche, mais
aussi l'agriculture. L'économie détermine aussi l'accès
aux ressources, avec l'influence du commerce, et du marché au sens
d'offre et de demande.
L'appropriation est une notion proche du
foncier mais qui met l'accent sur l'utilisation des terres. La racine latine
d'approprier traduit l'action de rendre propre à un usage (ad
proprius). C'est un sens juridique, car l'action qui vise à
s'approprier, à bénéficier de la terre s'obtient selon des
règles précises. On parle aussi d'affectation de l'espace dont le
but est d'« assurer la reproduction du groupe dans ses dimensions
matérielles, sociales et
idéologiques 100(*)». L'appropriation de l'espace par les
sociétés humaines est aussi liée à l'appartenance.
C'est l'appartenance à un groupe social qui permet ensuite d'obtenir des
droits sur les terres, ces droits permettant l'utilisation de l'espace et des
ressources présentes. L'appropriation est intimement
corrélée à la société. Des autorités
et des règles vont organiser les rapports entre l'homme et le territoire
vécu. Ces autorités et ces règles juridiques sont souvent
appelées droit coutumier en Afrique. Elles se réfèrent
à une gestion foncière ancienne, avant l'influence du droit
européen à travers la période coloniale. Le terme
coutumier est souvent connoté pour parler d'un mode de gestion
différent vis-à-vis du droit de type européen
qualifié de moderne. La gestion coutumière des terres est en
réalité un mode d'appropriation très complexe, où
on trouve des formes de propriétés collectives et individuelles,
et où c'est plus souvent l'homme qui appartient à la terre que
l'inverse. L'emploi du terme « coutume » est
également justifié par l'emploi juridique de cette terminologie
dans les textes de lois et dans la constitution nationale, ainsi que dans de
nombreux travaux de recherches sur le sujet. La maîtrise de la terre ne
se fait pas par une gestion centralisée mais plutôt par une
gestion locale d'un groupe qui a tissé des liens étroits avec un
territoire. A l'heure actuelle, la gestion coutumière a subit des
évolutions suite au contact forcé avec le droit des Etat-nation.
C'est la société dans son ensemble qui gère les relations
aux territoires, spécialement en zone rurale et forestière. Ces
territoires sont aussi appelés terroir et finages. Les deux termes
renvoient à des définitions différentes.
Le finage (du latin arcfinus ) est
une limite (ou un bornage), une frontière qui permet de définir
l'aire d'influence d'un village. Le finage est donc très lié
à la propriété de l'espace. Il délimite un
territoire où s'exercent les activités des populations qui y
demeurent. Historiquement en Europe, le finage renvoyait aussi à un
territoire sur lequel le propriétaire des terres (au Moyen-Age, le
propriétaire était le seigneur) disposait de droits de
juridiction spécifiques. Le finage, tout comme le terroir sont
les « expressions spatiales d'un système
socio-économique et culturel, [qui] reflètent
nécessairement les modifications que ce système subit au cours du
temps 101(*) ».
On distingue plusieurs grands ensembles dans le
finage qui sont différentiables par leur influence (dans le sens
d'utilisation) sur l'espace : il y a tout d'abord l'habitat, donc
majoritairement le village même s'il existe aussi de petites structures
d'habitations dans les zones forestières appelées campements,
où réside très souvent une famille et plus rarement un
petit nombre de familles. Ensuite on trouve le parcellaire agricole, et dans le
cas précis de notre étude cela concerne surtout des zones
cultivées, et non des pâtures dans la mesure où
l'élevage n'est pas culturellement pratiqué de manière
organisée. Un autre grand ensemble est celui des forêts. C'est le
plus complexe et le plus varié car on y trouve de nombreuses
activités telle la cueillette, la chasse, et autres. Un autre espace est
celui qui concerne les zones humides (forêts inondées,
marécageuses, les fleuves et les cours d'eau). La pêche y est
l'activité majoritaire. La représentation de ces portions
d'espaces est aussi liée à un centre (souvent le village
habité), avec l'idée de proximité et de confins.
L'activité humaine agit dans ce cas comme un gradient où elle
s'affaiblit plus on s'éloigne du centre. Ce type de
représentation est appelée topo-centrique, et elle peut
également permettre de connaître les représentations
propres des populations locales sur leur territoire.
ANNEXE 2 :
Entretien avec le Patriarche du clan Bafaka,
Localité de Boondjé, RDC, avril 2009 ( avec Fournier
T.)

Photographies durant l'entretien.
Assis à gauche : Lingolo ISI'SOMBA.
Assis au centre son fils aîné :
José Itonga
(Auteurs : Fournier T. & Bourgeois U. 29/04/2009)
 
Sur la gauche : Valentin LONGOY
A droite : Daniel LIKEMBA BOKOTO
(interprète de Fournier T.) ;
(mon interprète)
à droite : Lingolo ISI'SOMBA
Ø Est-ce que la coutume a été
conservé par le clan ?
Lingolo ISI'SOMBA :
« Le désordre provient des
autorités. Si le village disparaît ou a des mauvais sorts c'est
à cause des autorités. Les autorités et ses compagnons
sont des fausseurs. Parce qu'à l'époque on avait tué
beaucoup de gibier, parce que les anciens faisaient beaucoup de flèches,
avec des filets. Ces ancêtres peuvent tuer les animaux. Ils ont mis des
règles. Si un homme tue un gibier, il donnera une patte pour le
chanteur, et une pour le groupe tout entier. L'ensemble des personnes, on leur
a donné le nom de Mpao102(*). Une patte pour le chanteur, une patte
pour le reste des gens. Et on partage petit à petit en petits morceaux.
Chaque personne a un petit morceau. C'est ainsi que personne ne pouvait rentrer
au village les mains vides. Tout le monde ne pouvait rentrer les mains vides.
Donc il n'y aura pas de querelles, car chacun aura sa part selon les
règles établies par la coutume. Actuellement il n'y a pas de
règles, il n'y a pas de lois. Si aujourd'hui vous venez chez moi comme
étant beau-frère et vous me demander la terre et je vous octrois,
après vos activités vous avez de l'argent mais vous m'oubliez.
Moi qui vous ait cédé la terre... »
José ITONGA :
« Ce que vous êtes entrain de dire
ça montre comme si vous faîtes une accusation. Ils veulent avoir
des renseignements de nos ancêtres. Depuis l'au-delà sur la
répartition des terres jusqu'à notre installation ici. Comment
nous avons acquis les terres sur place, et même si quelqu'un venait
demander une portion de terre pour cultiver ? Quelles sont les conventions
remplis avec celui-là ?
Les gens vivaient d'une façon séparée
à l'éladji103(*). Cinq personnes dans un campement,
trois personnes dans un campement ; les autres vivaient dans les
agglomérations jusqu'à l'arrivée de l'homme blanc. L'homme
blanc venu nous coloniser, jusqu'à nous imposer sa civilisation. Et
comment on est parvenu à se mettre sur une route ? Comment on a
arrangé les gens pour se mettre sur une route ? On a du
répartir les terrains. Ceux qui n'avaient pas de terre pour se mettre
à côté de la route, ceux-là rentraient dans leur
éladji pour leurs travaux des champs,...Ou soit demandaient aux
propriétaires ou aux autochtones un lopin de terre pour faire la
culture. C'est ça ce qui cadre avec leur travail. »
Esulu'o Kungu eki lifumba ofendaka Lonkomo :
La traversée du peuple Lifumba par la rivière
Lonkomo en passant sur les racines de l'arbre Esulu
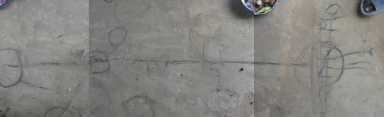 Auteur : Itonga J., 29/04/09 Auteur : Itonga J., 29/04/09
(modèle pour les cartes schématiques p. 24 et p.
50)
Ø Comment le colonisateur a-t-il
modifié les villages ?
Lingolo ISI'SOMBA :
« Les notables de chaque clan : clan de
Bafaka, clan de Bonsombo se réunirent et se demandèrent :
Que pouvons nous faire ? Nous avions été là-bas
[dans l'eladji], et nous sommes maintenant venu. Bolongo boi
c'est l'alignement ancien et Bolongo boné c'est cet alignement.
L'alignement où on a tué Elumbu 104(*). Quand on fait
l'alignement on fait étondo105(*). Le clan de
Bafaka voilà votre piquet 106(*). Bonsombo
voilà votre piquet. Les gens étaient brutaux. Où se limite
le clan Bafaka ? Venez ! Où se limite le clan Bonsombo ?
Venez ! Nous sommes maintenant dans un nouvel alignement. Toi, ta femme et
tes enfants : met toi ici ! Toi, ta femme et tes enfants : met
toi ici !, etc...fin. Mon père était le maître de
cette opération. »
Ø Comment vos ancêtres sont-ils
parvenu à obtenir ces terres ?
José ITONGA :
« Ils étaient venu au début par la
guerre. Il faut commencer avec la guerre. Chasser ceux qui étaient les
autochtones et prendre leurs terres en occupation. Les uns s'enfuyaient et les
autres mourraient. Et ceux qui venaient après récupéraient
ces terres et partageaient la terre. Un autre guerrier se met à Bokolo
et il reçoit sa partie de terre. Celui qui est assis à Bolena
aura ses terres et ses ruisseaux qui sont reconnus. Après c'est l'homme
blanc qui est venu installer la route que nous voyons. Mais les parties de
terres sont reconnues. Le guerrier de Bafaka reçu aussi les
siennes. »
Ø Est-ce qu'il y a des clans qui ont
refusé l'alignement par manque de terres ?
Daniel LIKEMBA BOTOKO:
« Bon, à ce temps là, on ne
pouvait pas refuser parce qu'on faisait peu de cultures. Ce qu'on cultivait
c'était juste pour manger. Donc les terres étaient
vides. »
Ø L'utilisation des
terres :
José ITONGA :
« Actuellement cela devient un grand
problème parce qu'on a envie de cultiver deux hectares par personne. A
l'époque, c'était trente ares. Pour mettre des bananes et le
manioc pour l'usage comestible. Actuellement, on fait les cultures
industrielles. Pour avoir beaucoup de mais, il faut demander les terrains chez
les propriétaires ou encore il peut prendre ça volontairement.
C'est ainsi qu'on arrive dans les tribunaux. »
Ø Est-ce qu'avant que les blancs arrivent il y
avait beaucoup de monde au village ?
José ITONGA :
« Beaucoup beaucoup ! La
civilisation actuelle a donné l'envie aux hommes du village de se
déplacer plus en ville. Pour permettre à leurs enfants
d'étudier dans les école. Hors auparavant, les enfants vivaient
dans les villages pour tuer les gibiers et aider leurs parents. C'est pourquoi
avant, dans les villages, il y avait beaucoup de gens. Actuellement, comme la
civilisation a changé, on a l'habitude de faire étudier les
enfants dans les villes. Parce que les villes ont été construites
et tout cela. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens dans les
villages sont allés s'installer dans les villes. Et les villages ont
manqué de population. Avant il n'y avait pas de sous-bois
107(*) comme vous le voyez. Lorsque les blancs
sont venus et ont aligné les gens, il n'y avait pas beaucoup de
sous-bois. Donc il y avait des gens et peu de terrains. Vous voyez actuellement
des sous-bois, des sous-bois, parce que les gens veulent vivre en
ville. »
Ø Y-a-t-il des propriétaires en
ville ?
José ITONGA :
« Les propriétaires sont là, en
ville. »
Ø Est-ce qu'à partir de
l'arrivé des blancs il y avait encore des guerres pour la
terre ?
Lingolo ISI'SOMBA :
« Il n'y avait pas de guerres
parce que le blanc avait dominé. On l'écoutait lui
seul. »
« En général, les
guerres étaient entre les groupements et les tribus. Mais quand
même, il y avait aussi des guerres entre les clans d'un seul groupement.
Si une personne d'un clan du groupement Boondjé [Bongilima]
touche une femme ou les enfants de Imbolo : lui (Imbolo)
dira : « Attendez, vous qui êtes Djendé Mongo
108(*) ». Et il
part provoquer une guerre en tuant une personne du groupement Nsongo ou
Lilangi. Ceux-ci viendront à leur tour faire la guerre au clan qui a
provoqué Imbolo. Et Imbolo dira : « Vous voyez, vous
avez touché à l'enfant du léopard. Après cela, la
guerre est sortie et les gens meurent. » Mais comme Bonsombo fait la
guerre avec Bafaka, Bolena avec Bafaka, Nkaké et Bafaka, ce n'est pas
Is'Imbolo. »
Lingolo ISI'SOMBA :
« Is'Imbolo était le
premier guerrier. Lui était devant, les autres derrière. Quand
Is'Imbolo crie deux fois, ils se déplacent 109(*). Parce que le
guerrier ne peut pas crier deux fois consécutivement. Alors, les ennemis
diront : « C'est un dangereux guerrier. » Alors
le village se retire, et eux avancent. »
« Moi, je m'appelle Lingolo
Isi'Somba. Is'Imbolo avait fait la guerre contre les Ngombé. Quand il
reculait, il est tombé sur une force. C'est ainsi que les Ngombé
sont venu l'abattre. Après sa mort, le premier né du village, on
l'a surnommé Boondjé Oua. Is'Ifelo. Le premier né
après sa mort, on l'a surnommé Boondjé, mais il
n'était pas de Bafaka, mais de
Ntomba. »
Ø La propriété de l'Etat et
les propriétaires coutumiers :
José ITONGA :
« Le sol et le sous-sol
appartiennent à l'Etat. Mais l'Etat a donné la primauté
à celui qui a occupé pour la première fois cette terre.
Ici chez nous, si l'Etat veut planter une palmeraie, ou si il veut partager
à sa population une partie de terre pour les cultures vivrières,
l'Etat envoie le message au chef de groupement qui demandera à ses
notables pour chercher les terrains qui suffit pour répartir la
population. Les terrains appartiennent aux autochtones, et non à l'Etat.
L'Etat c'est l'ensemble de toutes les populations. Ce n'est pas qu'il y a une
personne qui est choisie pour être le propriétaire des
terres. »
Ø Les moments importants entre les permiers
blancs et le village de Boondjé:
Lingolo ISI'SOMBA :
« Je veux donner trois choses.
La première chose : Le jour de mon baptême,
Père Louis 110(*) était venu à
Boondjé. Il donna le baptême aux gens puis il
dit : « Aujourd'hui, comme je suis venu à la messe,
la lune et le soleil vont se rencontrer à midi ». Mais il y
eut des doutes. Même moi j'étais parmi les douteurs. Mais
c'était accompli.
La deuxième chose : Le groupement était
parti construire les maisons au camp. On avait construit des maisons, et
l'administrateur du Territoire (Italé, un blanc belge)
demanda : « Qui a construit ces maisons ? »
Et Pierre Bolefo répondit : « C'est
Boondjé ». Et l'Administrateur du Territoire ajouta à
Boondjé : Bruxelles. Et depuis se temps, Boondjé se nomme
Mpoto Bruxelles 111(*).
La troisième chose : Le Père Louis,
quand il voullait rentrer en Europe il dit : « Moi je suis
un blanc religieux. Vous m'avez bien servit en m'aidant avec les chaumes, et
mon église est devenu forte à cause de vous Boondjé. Je
vous donne une truie et un verra pour se reproduire en votre faveur.
C'était juste pour montrer la renommé du village de
Boondjé. »
Ø Lors de l'arrivée des Belges, qui
était le premier chef de groupement ?
Lingolo ISI'SOMBA :
« C'est Is'omolo Ea Lowoso. Is'omolo Ea Lowoso
pris conscience de devenir chef et de travailler avec les blancs. Les blancs
venu chez lui dirent : « Toi a Boondjé tu es
compétent pour être chef. » C'est monsieur Charles
Batalatala 112(*) qui demanda la coutume pour savoir
l'endroit où on disséquait le léopard. Ils
répondirent cela se fait chez Lompolé Is'Efanga. On
disséquait le léopard chez Lompolé Is'Efanga. Batalatala
dit : « Boondjé dissèque le
léopard chez Lompolé Is'Efanga ». Même
aujourd'hui, il y a des gens qui ont de l'argent et qui étaient grands.
Il donna la chefferie à Lompolé Is'Efanga. On avait donné
à Is'Efanga la lettre de momination du chef de groupement. On donne
à Lofoko une lettre de nomination de chef de localité. Un jour,
il avait plu et Lofoko vient chez Is'Efanga avec une couverture et il lui
dit : « Vous êtes chef. Inutile de vous
déplacer, il fait froid. Je vous donne la couverture, je vais prendre la
chefferie en votre faveur. Vous entendez ? Je dis la vérité
au nom de Dieu » En revenant de là [de Basankusu], il
pris la lettre au chef de localité. Il garda la lettre de nomination de
la chefferie mais donna la lettre de nomination de la localité.
Après cette nomination, il était invité de temps à
autre à Basankusu. Dans les réunions des chefs de groupements.
Lui, à son tour, demanda à Ifeko de partir à Basankusu.
Celui-ci répondit : «Non ! Botoko, partez pour moi
à Basankusu ». Celui-ci refusa encore, et il appela Ifote.
Ifote dit : « Envoie-moi. » A force de l'aider
à ses occupations, il mit Ifote chef de localité. Il
dit : « Même si je meurs, c'est toujours Ifote le
chef. » Et c'est ainsi qu'après sa mort, Ifote devint le chef
de groupement. Les blancs dirent : « Les fils des chefs de
groupements doivent étudier ». Lingomo (chef de
groupement de Lisafa) fit sortir Bénkanga. Ifote fit sortir Bangondo
et Bokufa fit la même chose. Et les enfants se rendirent à
l'école. Même si je trouve la mort, la chefferie appartient
à Ifote. Quelqu'un qui refuse les demandes des anciens, qui n'est pas
respectueux envers les anciens : tu n'es qu'un vaurien ! Il ne peut
pas te laisser la salive113(*). Bangondo a raté la
bénédiction à cause du refus des demandes. C'est ça
la plaie. Les uns disent : « Nous avons de
l'argent ». Mais l'argent ne peut pas acheter la
bénédiction. La force de la parole fait mûrir les
safoux114(*). »
Ø Pourquoi la chefferie n'est pas dans le
clan Bafaka ?
Lingolo ISI'SOMBA :
« Vous demandez à ce qu'Is'Imbolo puisse
réclamer la chefferie ? Mais non. Les blancs étaient venu
pour dominer les noirs. C'est ainsi que les vaillants guerriers comme
Wéssé à Lilangi et Is'Imbolo à Boondjé,
ceux-là ne pouvaient pas devenir chefs. Parce qu'ils ont fait un geste.
Ils ne voulaient pas entrer en contact avec les blancs. De peur qu'ils soient
dépeuplés des forces de la coutume. Mais il y a un moment qui est
prévu pour que ce pouvoir retourne à Bafaka. Je vous le
prédit. »
Ø D'où provient le nom de
Boondjé ?
Lingolo ISI'SOMBA :
« Le nom de Boondjé c'est ici, à
Bafaka. Puis on vient mettre le nom commun du village Boondjé et du
groupement Bongilima à l'arrivée des blancs. Les blancs ont mis
le nom du groupement Bongilima parce que Boondjé c'est le nom du
village. Boondjé c'est un seul village, mais le groupement entier c'est
Bongilima. Tu entends ? Boondjé c'est ici. Dans tout les groupement
de Bongilima, est-ce que quelqu'un d'autre a le nom de Boondjé ?
Non. Car Boondjé c'est le nom de l'ancêtre de Bafaka. Personne
d'autre n'a mis le nom de Boondjé. Je met le nom Boondjé pour
renouveler le nom de cet ancêtre. Il était ici. Son nom c'est
Is'Aimbolo115(*). Le nom propre c'est Boondjé.
L'authenticité c'est Is'Aimbolo. Après avoir mis au monde un
enfant appelé Imbolo, on l'a appelé
Is'Aimbolo. »
Le dernier message de Lingolo
ISI'SOMBA :
« Les européens étaient venu ici.
Les enfants de l'Europe. Ils étaient venu au Congo. Ils sont
arrivés chez Lingolo Isa'Isomba : une force qui ramasse les troncs
d'arbres116(*). Le léopard est mort mais ses
tâches ne sont pas effacées117(*). »
Chants d'adieu :
« Bosisé Ilonga W'okendaka,
W'okendaka,
One onemba wa emi Lingolo boci Bafaka,
Elo
Lonkémaé ?...Hé !
Adieu pour toujours, toi tu pars,
Toi tu pars,
Celui qui chante c'est Lingolo originaire de
Bafaka,
Le mâle fait Elo ?...Hé !
Bonkono nyama ikenda la nkoy,
Baokéta nda lokolé,
Bonkono bokilengé,
Sombaé ?...Hé !
Bonkono, l'animal qui marche près du
léopard,
On t'appelle avec le lokolé,
Bonkono de Ilengé
Déposez ?...Hé !
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les blancs sont partis, sont partis en Europe.
Ils partent en haut par avion.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Afio fekwa kelantswé mpoto,
Afio fekwa ntswé mpoto,
Ngokendéké,
Sombaé ?...Hé !
L'avion vole pour que je m'en aille en Europe,
L'avion vole que je m'en aille en Europe,
Comme les blancs,
Déposez ?...Hé !
Bayauné bayauné,
Mpoto bayauné,
Mbendélé Bayaunkendé,
Bayaukendé nda baliko bafiko.
Afio fekwa.
Sombaé ?...Hé !
Ils combattent, ils combattent,
Ils combattent en Europe,
Ils marchent, ils marchent,
En-dessous des avions,
L'avion vole,
Déposez ?...Hé !
Toyotungola bonkono atungi,
Bonkono myama ikenda la nkoy.
Sombaé ?...Hé !
Nous voulons délivrer Bonkono qui est
lié,
Bonkono, l'animal qui marche avec le
léopard,
Déposez ?...Hé !
Isa'ISOMBA ouna nkoy befosa,
Mbendélé bouna nkoy befosa,
Bokwokwo ouna nkoy befosa,
Bokwokwo nyama ya liladji.
Isa'Isomba combat le léopard avec les
mains,
Les blancs combattent le léopard avec les
mains,
Bokwokwo combat le léopard avec les mains,
Bokwokwo, l'oiseau des Eladji. »
ANNEXE 3 :
Entretien avec le chef de la lignée Bokewa,
Localité de Boondjé, RDC, avril 2009
 Le chef de la lignée Bokewa (à droite) et sur la
gauche, Le chef de la lignée Bokewa (à droite) et sur la
gauche,
un autre notable du village : le juge.
Ø Quelle propriété pour le
ruisseau appellé Kungu ?
Patriarche de la lignée
BOKEWA :
« On ne partage pas le ruisseau avec quelqu'un.
C'est pour le lignage. Ce ruisseau nous appartient à nous même.
Pas d'autres personnes. Il y a deux ruisseaux. Le ruisseau de Liyoko et de
Kungu. Le ruisseau Kungu nous appartient. Du côté Lilangi aussi.
En ce qui concerne pêcher : en tout cas, on ne peut pas priver les
gens de pêcher. Mais pour les nasses, là pour aller faire des
nasses, il faut demander aux propriétaires, il vous donne et là
vous allez faire des nasses. Quand il [le pêcheur] vient faire
des nasses dans ma partie, il faut qu'il y ait des permissions : des
droits de jouissance. Même les gens de Lilangi, malgré ils ont
quelques parties là-bas, il ne peut jamais aller violer sans toutefois
nous consulter. Puisque c'est notre ruisseau qui sépare le groupement
Lilangi et Boondjé [groupement Bongilima]. Les deux
rives : cela nous appartient. »
« Auparavant, dans le temps des blancs belges,
on séparait deux groupements avec des ruisseaux. Et ce ruisseau, c'est
peut-être pour Lilangi ou pour Boondjé [Bongilima]. Mais
pour le Kungu c'est pour Boondjé. C'est pourquoi le ruisseau Kungu
appartient à nos familles. C'est les belges qui ont donnés
ça à nos ancêtres. »
Ø Conflits de terres. L'Etat est-il le
propriétaires des terres ?
Patriarche de la lignée
BOKEWA :
« Ce sont des mensonges! »
Pierre BOKEWA :
« Même pour les forêts primaires,
l'Etat a donné des limites. Dix hectares, vingt hectares appartiennent
à une personne. Malgré, on dit que le sol et le sous-sol
appartiennent à l'Etat, mais l'Etat a déjà partagé
ça. Ca c'est telle terre qui appartient à tel lignage. Quand il
veut travailler [un locataire], il faut consulter le
propriétaire. »
ANNEXE 4 :
Un titre foncier coutumier
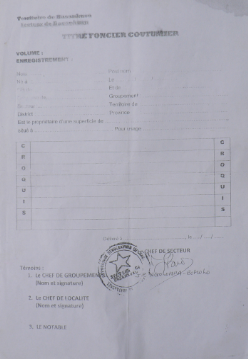
ANNEXE 5 :
Tableau récapitulatif sur l'évolution des
principales activités économiques et leurs droits
d'usage
|
Chasse
|
Pêche
(par piégeage)
|
Agriculture
|
Plantation
|
|
Anciennes pratiques :
|
|
|
Ressource
|
Abondance du gibier
|
Abondance du poisson
|
Peu de parcelles (1/2 ha environ par famille)
|
Peu de superficies
|
|
Rôle de l'activité
|
Activité principale
|
Activité secondaire
|
Activité secondaire d'autosubsistance
|
Activité secondaire
|
|
Droits d'usages
|
Forts et respectés
|
Forts et respectés
|
Peu développés
|
Forts et respectés
|
|
Pratiques actuelles :
|
Zone peu densément peuplée,
enclavée
|
Zone au
Peuplement
dense
|
|
|
Ressource
|
Présence du gibier
|
Rareté du gibier
|
Rareté du poisson
|
Augmentation des parcelles (2ha environ par famille)
|
Augmentation des superficie
|
|
Rôle de l'activité
|
Activité principale
|
Activité secondaire
|
Activité secondaire
|
Activité
Principale, de rente
|
Activité
Principale, de rente
|
|
Droits d'usages
|
Maintenu
/accru
|
Caduques
|
Maintenu
|
Accru
|
Accru
|
|
Les règles sur le contrôle de la
ressource
|
Restriction ; nécessite une autorisation
|
Usage plus ou moins libre
|
Restriction ; nécessite une autorisation
|
Restriction ; nécessite une autorisation
|
Restriction ; nécessite une autorisation
|
* 1 La PRODAELPI est une
association à but non lucratif intitulé: Projet de
Développement Agricole,
Elevage et Pisciculture. Elle fonctionne comme une plate-forme
qui regroupe différentes associations
d'agriculteurs, de planteurs et d'éleveurs de
différents endroits du Territoire de Basankusu. Association
dont fait partie ACEBO pour le village de Boondjé. La
Prodaelpi est un partenaire d'ICRAF et d'AWF
pour le soutien à la paysannerie et au
développement rural.
* 2 Cubrilo M.,
Goislard C., Association pour la promotion des recherches et études
foncières en
Afrique (1998). Bibliographie et lexique du
foncier en Afrique Noir. Paris, p. 5
* 3 D'après l'INSEE,
source Internet pour l'année 2007:
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=98&ref_id=CMPTEF01105
* 4 Veyret Y.&
Vigneau J.-P. (sous la dir.)(2002). Géographie physique.
Milieux et environnement dans
le système terre. Armand Colin, Paris, p. 282
* 5 Van Der
Kerken détaille bien les nombreuses migrations à
l'intérieur de l'ethnie Mongo, liées à des
guerres de possession de la terre, mais aussi liées
à des impératifs comme la proximité de telle ou telle
ressources (un cour d'eau fertile par exemple pour les ethnies qui pratiquent
principalement la pêche et la chasse comme les Ngombé).
VAN DER KERKEN G. (1944). L'Ethnie Mongo
Volume 1 Livre I. Bruxelles, 512 p.
* 6 Ibañez de
Ibero C. (1913). La mise en valeur du Congo belge; étude de
géographie coloniale. Paris,
p. 75.
* 7 Ibañez de
Ibero C., op. cit., p. 76.
* 8 Vauters
A.-J. (1899). L'Etat Indépendant du Congo ;
historique, géographique, physique,
ethnographique, situation économique, organisation
politique. Bruxelles, p. 292.
* 9 Ibañez de
Ibero C., op. cit., p.127.
* 10 Ibañez de
Ibero C., op. cit., p. 77.
* 11 Ibañez de
Ibero C., op. cit., p. 127-128.
* 12 Conférence
de Berlin (15 novembre 1884 au 26 février 1885). Suite
à cette conférence
européenne, le Congo va devenir officiellement la
propriété privée du Roi
* 13 Cité par
Ibañez de Ibero C., op. cit., p. 128.
* 14 Selon le
Père Vermeersh, cité par Ibañez
de Ibero C., op. cit., p. 131
* 15 Par exemple,
l'article 3 de la Charte Coloniale de 18 octobre 1908
précise bien que « Nul ne peut être
contraint de travailler pour le compte de
sociétés ou de particuliers ».
* 16 Ibañez de
Ibero C., op. cit., p. 78.
* 17 Hulstaert
G. (1955). Droits fonciers indigènes. Archives
Aequatoria, Mbandaka, p.142
* 18 Le
lokolé un instrument qui servait à la communication
entre les villages, entre les familles, etc. C'est
un morceau de tronc d'arbre qui est évidé pour
créer une résonance. Il en existe de différentes sortes
que l'on frappe avec des bâtons. Chaque Lokolé ayant un son
spécifique est utilisé pour un message particulier tel que
l'annonce d'un décès, d'une naissance et autres.
* Entretien réalisé chez le
chef du clan Bafaka ; Fils aîné de Lingolo
Isa'Isomba, localité de Boondjé, avril 2009
* 19 Un guerrier originaire du
clan Bokolo et il fût patriarche du clan toujours présent dans la
localité de
Boondjé.
* 20 Terme inconnu
* 21 Le terme de piquet
renvoie à une portion de terre. Il traduit aussi l'idée de
servitude imposée par
le colonisateur.
* 22 Entretien
réalisé chez le chef du clan Bafaka ; Lingolo
Isa'Isomba, localité de Boondjé, 2009
* 23 Op.
cit.; Fils aîné de Lingolo Isa'Isomba,
localité de Boondjé, 2009
* 24 Ibañez de
Ibero C., op. cit., p. 78.
* 25 Dupriez
M., in Ibañez de Ibero C., op. cit.,
p. 137-138
* 26 Il concerne
précisément la gestion des immeubles et biens immobiliers, avec
des règles concernant les
assurances, les moyens de paiement envers l'Etat par les
impôts, mais également entre le locataire et le
propriétaire. On trouve également les règles de gestion
des hypothèques.
Cf. Quatrième partie de la Loi 73-021
* 27 Loi 73-021, 20 juillet
1973, Titre Ier Du Régime Foncier, Chapitre 2, Article 60.
* 28 Loi 73-021, 20 juillet
1973, Titre Ier Du Régime Foncier, Chapitre 2, Article 55
* 29 Loi 73-021, 20 juillet
1973, Titre Ier Du Régime Foncier, Chapitre 2, Article 55 :
« Toutes les autres terres constituent le
domaine privé de l'Etat. Elles sont régies par la présente
loi et
ses mesures d'exécutions. »
* 30 Exemples de
plantations ; « palmier, à raison d'au moins 100
unités par hectare ; de caféiers, a raison
d'au moins 900 unités par hectare ; qui
quinquina, à raison d'au moins 6.940 unités par
hectare »etc...
Article 157.
* 31 Loi 73-021, 20 juillet
1973, Titre Ier Du Régime Foncier, Chapitre 2, Article 157.
* 32 Pour une durée qui
ne peut excéder 25 ans, mais qui peut être renouvelable.
Loi 73-021, 20 juillet 1973, Titre Ier Du Régime Foncier,
Chapitre 2, Article 111
* 33 Loi 73-021, 20 juillet
1973, Titre Ier Du Régime Foncier, Chapitre 2, Article 110
* 34 De Quirini P.
(1987). Comment procéder pour acheter une parcelle et louer
une maison ? CEPAS,
Kinshasa, p. 37
* 35 De Quirini
P., op. cit. p.37
* 36 Code forestier de
2002 ; article 1, définition n°17. La communauté locale
est ainsi « une population
traditionnellement organisée sur la
base de la coutume et unie par des liens de solidarité
claniqué ou
parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est
caractérisée, en outre, par son attachement à un
terroir déterminé ». C'est la
première définition présente dans le droit en RDC, et il
est important de noter que cela ne confère pas à la
communauté locale une personnalité juridique. De plus, cette
définition est très brève, et n'entre pas dans les
détails, par exemple concernant la gestion des terroirs coutumiers.
* 37 Code Forestier, Op.
cit., article 10, paragraphe 2
* 38 Code Forestier, Op.
cit., article 10, paragraphe 3
* 39 Code Forestier, Op.
cit., article 10, paragraphe 4
* 40 Cette externalisation
peut être réalisé sur commande par l'administration, un
bureau d'études
privées par exemple.
* 41 Toutefois, une seconde
année peut éventuellement être à nouveau
accordé : « Le délai accordé pour la
réalisation de l'inventaire peut être
prorogé d'une année au maximum et une seule fois sur demande
motivée du requérant. » Article 68.
* 42 Code forestier, op.
cit., article72
* 43 Association
Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT), (2007).Etude
sur les pratiques
d'aménagement des forêts naturelles de
production tropicales africaines. Paris, p. 21
Application au cas de l'Afrique Centrale ; Volet 1
« Production forestière »
* 44 Code forestier, op.
cit., article 74, paragraphe 2
* 45 Selon l'article 92 :
Pour une superficie supérieure à 300.000 ha, le contrat est
approuvé par décret du
Président de la République.
Pour une superficie de plus de 400.000 ha, c'est une loi qui
doit autoriser le contrat.
Aucune superficie ne peut être mise sous contrat si elle
dépasse 500.000 ha.
* 46 Certaines conventions
autorisant l'exploitation forestière ne sont pas écrites mais
seulement de nature
orale
Cf. Actes de l'atelier national sur le
développement de la foresterie communautaire en République
Démocratique du Congo (15-16 mai 2007).
Vers une gestion forestière de proximité. Kinshasa, p.
69
* 47 Code forestier, op.
cit., article 112
* 48 BOUDON R.,
BESNARD P., CHERKAOUI M., LECUYER B.-P. (1989). Dictionnaire de
Sociologie. Larousse, Paris, p.83-84
* 49 D'après le travail
historique de Ndaywel è Nziem I., Obenga T. & Salmon P.
(1998). Histoire
générale du Congo. De l'héritage ancien
à la République Démocratique. p. 468.
* 50 Amselle J.-L.,
M'Bokolo E. ( sous la dir.) & Chrétien J.-P.(1985). Au
coeur de l'ethnie, Ethnie,
tribalisme et Etat en Afrique. Paris, p. 129
* 51 Ndaywel è
Nziem I., Obenga T. & Salmon P. (1998). Histoire
générale du Congo. De l'héritage
ancien à la République
Démocratique. p. 165-166.
* 52 Van Der Kerken
G. (1944). L'Ethnie Mongo Volume 1 Livre II. Bruxelles, page
782
* 53 Bongando
J. (2008), L'organisation sociale chez les Mongo de Basankusu et
sa transformation,
Editions Publibook, 247 p.
* 54 Ces données
cités par Bongango se réfèrent à
De Saint Moulin L., « Art :Essai d'Histoire de
la
Population du Zaïre», Zaïre-Afrique,
n°217, septembre 1987, Kinshasa, p. 391-405.
* 55 Source :World
Population Prospects :the 2008 Revision Population Database,
Internet :
http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp
* 56 Source :
http://www.congolite.com/page5.htm
* 57 Selon Bongando
J., op cit, pp. 29-30
* 58 Selon les entretiens
réalisés chez le patriarche du clan Bafaka ; Lingolo
Isa'Isomba (localité de Boondjé,
groupement Bongilima).
* 59 Selon Bongando
J., op cit, p. 39
* 60 Descola
P. (2005). Par-delà nature et culture. Ed. Gallimard,
Paris, p. 178.
* 61 Bridier
B. (1991). « La répartition des terres entre
unités d'exploitation. Quelques classifications de la
recherche-développement ». In, Le Bris
E.., Le Roy E. & Mathieu P. (1991). L'appropriation de la
terre en Afrique Noire. Manuel d'analyse, de décisions
et de gestion foncières. Karthala, Paris, p.59
* 62 Le chien est pour les
Mongo une des viandes les plus appréciées. Depuis longtemps, il
est sacrifié du
fait de sa valeur « culinaire » si on peut
dire. Aussi bien pour les Baenga que les Mongo « des
terres ».
* 63 Hulstaert
B. Les droits fonciers Mongo. Centre Aequatoria Bamanya,
Mbandaka, p. 8
* 64 Roux J.-P.,
Etienne J., Bloess F., Noreck J.-P. (2004). Dictionnaire de
Sociologie, Patrilinéaire.
Hâtier, Paris, p. 193
* 65 Mune P.
(1958). Le groupement de Petit-Ekonda. Bruxelles, p.44.
* 66 Instaurée
dès 1896 par Léopold lui-même suite à la
médiatisation d'exactions dans l'actuelle province
de l'Equateur liées à la sanglante récolte
du caoutchouc. Cette commission semble avoir évolué dans le temps
pour être de moins en moins un outils politique, mais plus pour
défendre les droits des populations, dont les Mongo.
* 67 Site Internet du Centre
Aequatoria :
http://www.aequatoria.be/French/HomeFrenchFrameSet.html
* 68 Le Roy A.
(1909). La religion des primitifs. Paris, p.275
* 69 Pour
réalisé un hectare de palmeraie, il faut 144 plants, et le
coût d'une graine est aux alentours de 2
dollars. Sans parler des concessions privées, les
palmeraies ne font donc rarement plus d'1 hectare.
* 70 Le Roy
E., « L'appropriation et les systèmes de
production ». In, Le Bris E.., Le Roy E. &
Mathieu P. (1991). L'appropriation de la
terre en Afrique Noire. Manuel d'analyse, de décisions et de
gestion foncières. Karthala, Paris, p.33
* 71 Entretien
réalisé dans la localité de Boondjé (avril 2009)
avec Bangundu Luyéyé et D. Likemba
Bokoto.
* 72 Lavigne Delville
P. (2002). « Le foncier et la gestion des ressources
naturelles ». in,
ANONYME (2003). Mémento de
l'agronome. GRET & Editions Quae, Paris, 1692 p.
Source internet
http://www.foncier-developpement.org/analyses-et-debats/enjeux-de-methode/gretpublication.2007-10-02.7281890893/view:
* 73 Entretien
réalisé dans la localité de Boondjé (avril 2009)
avec Bangundu Luyéyé et D. Likemba
Bokoto.
* 74 Entretien
réalisé dans la localité de Boondjé (avril 2009)
avec Bangundu Luyéyé et D. Likemba
Bokoto.
* 75 Vinck H.
. op. cit. Enquête menée par Boelaert en 1954 sur la
propriété foncière chez les Mongo dans
le contexte colonial.
* 76 Selon un article
journalistique de Digitalcongo.net (2005). Basankusu en
ébullition !
Kinshasa :
http://www.digitalcongo.net/article/26703
* 77 Vinck
H., op. cit., Entretien n°38 :Jean Nkoi,
C.C.B., Lisafa, Elongo-Kombe, Basankusu. Daté du 25
juillet 1954.
* 78 M.I.C. :Mouvement de
Libération du Congo. Ce groupe armé fût crée lors de
la seconde guerre (1998-
2003), à l'initiative de J.-P. Bemba en 1998, et soutenu
par l'Ouganda.
* 79 Op. Cit.
Digitalcongo.net (2005). Basankusu en
ébullition !
Kinshasa :
http://www.digitalcongo.net/article/26703
* 80 De Saint Moulin
L.& Kalombo Tshibanda J.-L. (2005). Atlas de l'organisation
administrative de la
République Démocratique du Congo.
Kinshasa, p. 54
* 81 Vangroenweghe,
Lufungula & Hulstaert (1986). L'histoire ancienne de
Mbandaka. Mbandaka,
pp.124-125
* 82 Autrement
appelée :palabre.
* 83 Cf : Sohier
A.(1935). Une branche inexplorée du droit - Le droit
coutumier congolais. Revue générale
de la colonie belge, Editions Goemaere, Bruxelles, 37p.
* 84 Kilubi
F. (14/01/2008). La corruption en RDC a atteint son
paroxysme. Le Phare, article de presse,
Kinshasa
Source internet :
http://realisance.afrikblog.com/archives/2008/07/23/index.html
* 85 Unicef et
Ministère des Affaires Sociales et familles ; P. Gambambo Gawiya
(consultant) (1999).
Situation des lois coutumières en RDC.
Kinshasa
* 86 Chrétien
J.-P. (1983). Histoire rurale de l'Afrique des Grands Lacs.
AFERA, Paris, p.156
* 87 Entretien
réalisé chez le chef du clan Bafaka ; José
ITONGA, localité de Boondjé, 2009
Cf. Annexe 2, p. 148
* 88 Cubrilo M.,
Goislard C., Association pour la promotion des recherches et études
foncières en
Afrique (1998). Bibliographie et lexique du
foncier en Afrique Noir. Karthala, Paris, p.340
Le Roy E. (1987). La réforme du droit
de la terre dans certains pays d'Afrique francophone. FAO, Rome, pp.
10-20
* 89 Pourtier
R. (1989). Les espaces de l'Etat in, Tropiques. Lieux et
liens. Editions Orrtom, Paris, p.395
* 90 D'après un
entretien réalisé auprès du Chef de service des affaires
foncières (District) :M. Bangoni
(avril 2009, Basankusu)
* 91 Pourtier
R. (1989). Les espaces de l'Etat in, Tropiques. Lieux et
liens. Editions Orrtom, Paris, p.395
* 92 Pourtier
R. (1989). Les espaces de l'Etat in, Tropiques. Lieux et
liens. Editions Orrtom, Paris, p. 395
* 93 Bouly De Lesdain
S. (2000). Les Peuples des Forêts Tropicales Aujourd'hui -
Volume II, Du sentier à
la route. APFT, Bruxelles, p. 289
* 94 Ben Hammouda H.
et Koumaré H (2004). Les transports et l'intégration
régionale en Afrique.
Maisonneuve & Larose, Paris, p. 51
* 95 CEA - Bureau
d'Afrique Centrale (2004). Les économies d'Afrique
centrale. Maisonneuve & Larose,
Paris, p. 115
* 96 ICCN : Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature
* 97 Rodary E. et
Castellanet C. (2003). Conservation de la nature et
développement : l'intégration
impossible ?. Karthala, Paris
* 98 SAFFACHE
P., Dictionnaire simplifié de géographie
humaine
* 99 Actes de
l'atelier national sur le développement de la foresterie communautaire
en République
Démocratique du Congo
(15-16 mai 2007). Vers une gestion forestière de
proximité. Kinshasa, p. 50.
* 100 LE BRIS E., LE
ROY E. et MATHIEU P. (1991). L'appropriation de la terre en
Afrique Noire. Manuel d'analyse, de décisions et de gestion
foncières. Paris, Karthala, p. 33
* 101 VERMEULEN
C. ( ?). Place et légitimité des terroirs
villageois dans la conservation. APFT,
Bruxelles
* 102 Qui signifie
groupe de gens en Lomongo.
* 103 L'éladji est le
nom traditionnel pour désigner un campement. Dans ce cas, c'est le
campement où
vivaient les populations avant l'arrivée des colons
belges.
* 104 Un guerrier originaire
du clan Bokolo et il fût patriarche du clan toujours présent dans
la localité de
Boondjé.
* 105 Terme inconnu
* 106 Le terme de piquet
renvoie à une portion de terre. Le terme traduit aussi l'idée de
servitude imposé par
le colonisateur.
* 107 Par sous-bois on
entend; une partie de terre où il n'y a pas d'habitation. Cela
sépare le plus souvent les
villages entre eux, mais également les clans et les
maisons.
* 108 En lomongo cela veut
dire un homme fort.
* 109 Cette phrase est un
adage traditionnel. Is'Oyoko s'exprime beaucoup par des adages et des
proverbes.
Cela vient de son anciennetée car les descendants ne
s'expriment plus ainsi.
.
* 110 Le Père Louis
Smolders (1899-1972). Il se trouva comme missionnaire au Congo Belge entre 1929
et
1969. Voici le témoignage de Gabriel Bosamba en
1952 : « un bateau appelé Joseph à bord duquel se
trouvaient beaucoup de prêtres accosta le beach de Nsombo.
Mais les gens en prenaient la fuite. Le prêtre qui connaissait le
lonkundo, le Père Louis, demanda : « Où sont
allés les gens ? » Et tous le monde s'arrêta, les
vieux s'y approchèrent, pas les jeunes, car il y avait 10 personnes,
toutes barbues et vêtues de robe noires. C'était très
effrayant. Le préposé au bateau dit : « Ce
sont des Pères qui prêchent l'enseignement de Dieu ». Il
leur montra une médaille, et enchaîna : « Nous
avons cette médaille d'eux, lors du baptême. » Nous
pensions que le baptême est une chose appartenant à un notable.
Alors tout le monde aller demander le baptême du Père. Mais le
Père donna à chacun la médaille du paîn.
« Si vous voulez le baptême, vous aurez une carte de
baptême. »
* 111 Mpoto signifie en
Lomongo l'occident au sens large, et plus précisément l'Europe et
donc la Belgique.
* 112 Un européen
d'origine belge. Batalatala est un surnom simple pour la
population.
* 113 Par cette expression il
veut dire qu'on « ne peut pas te donner la bénédiction
ou l'héritage ».
* 114 Un proverbe Mongo qui
peut s'expliquer ainsi :les bonnes choses (ici les bonnes paroles, et/ou
les
bonnes actions) sont bénéfiques (elles font
mûrir les safoux). Quelqu'un qui agit convenablement en
respectant les anciens, et donc par-là même la
coutume, peut grâce à ce respect être gratifié par
les anciens de leurs pouvoirs et de leurs biens par héritage.
L'héritage est par ailleurs la plus haute considération (ou
« récompense ») que peut faire un Père
à ses enfants (ses descendants).
* 115 Is'Aimbolo et le
même nom que Is'Imbolo. On peut l'écrire de deux manière
différentes. En effet, le
« a » peut disparaître s'il est devant
une voyelle.
* 116 En lomongo :
Yemba bontona mbolaka befoka. C'est un surnom que l'on donne aux
jeunes hommes
selon leurs caractères et leurs aptitudes dans la vie. Par
exemple, le surnom coutumier de Daniel LIKEMBA est : Botoko
waéké : Le jeune palmier (qui a des épines).
* 117 Un adage en
lomongo : Botsulu boki nkoy. Les tâches du léopard
perdurent après la mort de l'animal. Le
léopard (nkoy) est l'emblème par
excellence des clans guerriers. Et donc c'est toujours un animal qui est
très symbolique pour le clan Bafaka mais d'une manière
générale pour les Mongo qui vivent dans les villages et les
forêts.
| 


