|
MEMOIRE DE FIN DE CYCLE POUR L'OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER
PROFESSIONNEL EN DROIT OPTION : DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE
THEME : DROIT OHADA ET ATTRACTIVITE DES INVESTISSEMENTS
DIRECTS ETRANGERS DANS LES ETATS-PARTIES
Présenté par :TRAORE
Marie-Joëlle
Maitre de stage :
Directeur de
mémoire :
Maitre Batibié Batis BENAO
Dr DJIGUEMDE Wendkouni Judicaël
Avocat à la Cour
Enseignant-chercheur-UTS
Année universitaire : 2020-2021
AVERTISSEMENT
L'Unité de Formation et de Recherche en Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université Saint Thomas d'Aquin n'entend
donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les
mémoires qui doivent être considérées comme propres
à leur auteur.
REMERCIEMENTS
« Remercier c'est reconnaitre que sans l'aide
apportée, rien n'aurait été possible »
Remercier, est une chose tellement simple à imaginer
mais compliquée à réaliser ou écrire tant l'aide
reçue n'est pas quantifiable.
Avant tout développement donc sur ce mémoire,
nous tenons à remercier les personnes qui nous ont aidée et qui
ont eu la gentillesse de nous faire profiter de leurs savoirs durant notre
stage au sein de la Société Civile Professionnelle d'Avocats
LEGALIS, en abrégé SCPA LEGALIS.
Aussi, nous remercions Maître Batibié Batis
BENAO, notre maitre de stage pour sa disponibilité à notre
égard, ses judicieux conseils, sa qualité d'écoute et pour
son encadrement tout au long du stage.
Nous remercions également le reste du personnel de
LEGALIS pour leur disponibilité et pour nous avoir ainsi permis
d'effectuer notre stage dans de très bonnes conditions.
Nous tenons à remercier également notre tuteur
universitaire, Mr. DJIGUEMDE Judicaël, ainsi que le reste du corps
professoral pour cette année de formation au sein de l'Université
Saint Thomas D'Aquin.
Enfin, un profond remerciement à tous les membres de
notre famille, nos proches sans qui rien n'est possible, merci à
vous.
LISTES
DES ABREVIATIONS
AUDCG : Acte Uniforme relatif au Droit
Commercial Général
AUPCAP : Acte Uniforme sur les
Procédures Collectives et Apurement du Passif
AUDSC/GIE : Acte Uniforme relatif au
Droit des sociétés Commerciales et du Groupement
d'Intérêt Economique
AUPSRVE : Acte Uniforme portant
organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des
Voies d'Exécution
AUS : Acte Uniforme sur les
Sûretés
CCJA : Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage
EPIC : Etablissements Industriels et
Commerciaux
IDE : Investissements Directs Etrangers
OCAM : Organisation pour la
Coopération Africaine et Malgache
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires
PVD : Pays en Voie de
Développement
RCCM : Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier
SA : Société Anonyme
SARL : Société à
Responsabilité Limitée
SAS : Société par Actions
Simplifiée
S.D: Sans Date
TVA : Taxe sur la Valeur
Ajoutée
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
2
PREMIERE PARTIE : LA SECURITE JURIDIQUE DES
INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
7
CHAPITRE I : L'APPORT DU DROIT OHADA DANS LA
SECURISATION JURIDIQUE DES IDE
9
Section I : L'accessibilité
matérielle et intellectuelle aux sources du droit
économique
10
Section II : Les actes uniformes OHADA :
normes attractives des IDE
12
CHAPITRE II : L'IMPRECISION DES ACTES
UNIFORMES, SOURCE D'INSECURITE JURIDIQUE DES IDE
19
Section I : L'Acte Uniforme relatif au Droit
Commercial Général (AUDCG)
19
Section II : L'Acte uniforme relatif au
droit des procédures simplifiées de recouvrement et de voies
d'exécutions (AUPSRVE)
23
DEUXIEME PARTIE : LA SECURITE
JUDICIAIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
30
CHAPITRE I : LES ACQUIS DE LA SECURITE
JUDICIAIRE DANS L'ESPACE OHADA
31
Section I : Les fondements de la
sécurité judiciaire dans les textes de l'OHADA
31
Section II : Les manifestations de la
sécurité judiciaire dans l'espace OHADA
35
CHAPITRE II : LE CARACTERE PERFECTIBLE
DE L'ESPACE JUDICIAIRE OHADA
41
Section I : Le cloisonnement des
systèmes judiciaires des Etats-parties à l'OHADA
41
Section II : L'inorganisation de la
circulation des décisions judiciaires nationales
46
CONCLUSION GENERALE
53
ANNEXES
57
BIBLIOGRAPHIE
61
INTRODUCTION GENERALE
Au lendemain de l'indépendance, l'Investissement Direct
Etranger (IDE) était perçu avec beaucoup de méfiance par
la plupart des pays en voie de développement (PVD). En effet, les PVD
considéraient l'IDE comme une forme de domination des puissances
étrangères sur leur économie.
Aujourd'hui, l'on assiste à une chasse et à une
concurrence entre les PVD dans la diversification de leur économie en
vue de mettre en valeur les déterminants susceptibles d'attirer le plus
d'investisseurs étrangers et bénéficier ainsi de tous les
avantages que véhicule l'IDE. Les dirigeants des PVD sont donc
désormais conscients que l'IDE est un véritable vecteur de
croissance et partant contribue au développement économique de
leur pays.
Cette attention particulière en faveur de l'IDE
découle, du fait que l'IDE présente une diversité de
retombées positives. En effet, « sur les plans
théorique et empirique, il est admis que les IDE sont un catalyseur du
développement, notamment via leur contribution à la
création de richesse. Ils participent notamment à la croissance
de l'investissement privé dans le pays d'accueil. Ils favorisent par
ailleurs le transfert de technologies, contribuent à la formation et
à l'amélioration du capital humain et concourent au
développement des entreprises dans un environnement concurrentiel,
notamment à travers l'augmentation de la productivité des
facteurs de production. En outre le développement des IDE entraine une
intégration plus poussée des pays aux échanges
internationaux et devrait avoir pour effet de faciliter l'accès des pays
en développement aux marchés internationaux »1(*).
Dans le dessein de cerner au mieux les
stratégies adoptées par les PVD afin d'attirer les investisseurs
étrangers sur leur territoire, nous avons eu l'opportunité
d'effectuer un stage au sein de la Société Civile Professionnelle
d'Avocats LEGALIS,en abrégé SCPA LEGALIS.
Ce stage qui s'est déroulé du 02 décembre
2019 au 30 juin 2020, nous a emmené à nous intéresser
particulièrement aux moyens utilisées par l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) afin d'accroitre le
flux des investissements au sein des territoires des Etats parties au
Traité.
Notre choix s'explique par le fait que l'OHADA est un
modèle d'intégration atypique. En effet celle-ci regroupe en son
sein dix-sept pays africains et affiche pour ambition de réaliser une
intégration juridique entre ses Etats membres. Si l'on se fie au
Traité constitutif de l'OHADA2(*), cette intégration juridique prend la forme
d'une harmonisation.
L'harmonisation procède avant tout des rapprochements
entre diverses législations. Il ne s'agit pas de faire disparaitre les
droit nationaux au profit d'un droit régional, mais plutôt de
priver le droit national « de la faculté de déterminer
lui-même ses finalités »3(*). Ainsi, le droit national dans le cadre de
l'harmonisation devra « se modifier et évoluer en fonction
d'exigences définies et imposées par le droit [régional]
de sorte que les différents systèmes nationaux présentent
entre eux un certain degré d'homogénéité
résultant de finalités communes »4(*). Ainsi, l'harmonisation auquel
aspire l'OHADA ne « vise pas à instituer un modèle
régional uniforme substituable aux régimes juridique nationaux,
elle vise plutôt à converger vers des objectifs communs, les
législations nationales qui conserveront leurs structures
propres »5(*).
D'avantage un objectif parmi d'autres, la question de
l'attractivité des investissements constitue la raison d'être du
droit OHADA. En effet, d'après Kéba Mbaye, l'un des pères
fondateurs du Traité OHADA, l'OHADA a été mise en place
avant tout pour favoriser l'IDE dans les pays signataires. Il affirmait ainsi
que « lebesoin s'est fait sentir, devant le ralentissement des
investissements, d'essayer de reconstruire l'édifice juridique de
l'ensemble des pays de la zone franc afin de redonner confiance aux
opérateurs économiques »6(*).
Cette lecture de la mission du Traité OHADA est aussi
partagée par un auteur qui affirme par ailleurs que « l'enjeu
majeur pour l'OHADA était d'élaborer un mécanisme
juridique approprié qui puisse pallier les défaillances des
opérateurs économiques et attirer les
investisseurs »7(*). Mais que recouvrent exactement les concepts
d'attractivité économique et d'IDE ?
Il n'est pas aisé de donner une
définition universelle de la notion d'attractivité
économique. Mais si l'on souhaite orienter une définition de
l'attractivité économique dans le sens strict de notre recherche,
elle consisterait à la capacité d'un Etat à attirer le
maximum d'investisseurs sur son territoire en leur offrant un cadre
légal, politique et économique satisfaisant pour
l'établissement de leurs projets, et que ce cadre soit plus favorable
que celui des Etats concurrentiels8(*). Qu'en est- il de l'Investissement direct
étranger ?
Selon la définition du Fonds Monétaire
International (FMI) l'investissement direct étranger (IDE)
désigne « les investissements qu'une entité
résidente d'une économie (l'investisseur direct) effectue dans le
but d'acquérir un intérêt durable dans une entreprise
résidente d'une autre économie (l'entreprise d''investissement
direct)»9(*).
La notion d'intérêt durable est très
importante. En effet, elle sous-entend l'existence d'une relation à long
terme par laquelle l'investisseur direct exerce une influence significative
dans la gestion de l'entreprise, par opposition aux investissements de
portefeuilles10(*). En
effet, on considère que les investisseurs de portefeuille n'exercent
aucune influence sur la gestion d'une société dont ils
possèdent des actions.
L'on peut supposer qu'il existe une relation d'investissement
direct lorsque l'investisseur direct détient au moins 10% des actions
ordinaires ou des droits de vote - pourcentage de détention à
partir duquel l'investisseur est présumé être en mesure
d'influer significativement sur la gestion d'une entreprise ou d'y contribuer.
Aussi, il convient de souligner que la participation peut
être directe mais aussi indirecte, en l'occurrence par le biais d'une
société intermédiaire (filiale, société,
affiliée, succursale). L'investissement direct englobe l'ensemble des
ressources mises à la disposition de l'entreprise, c'est-à-dire
les opérations en capital, les opérations de prêts, et
placement entre affiliés ainsi que les bénéfices
réinvestis. Alors, quels sont les facteurs déterminants des
IDE ? autrement dit, qu'est ce qui peut expliquer le choix d'un
investisseur étranger de s'installer sur un territoire
donné ?
Plusieurs études ont tenté de comprendre
les raisons pouvant justifier la localisation des investissement internationaux
dans les pays en développement11(*). Ces travaux répertorient les facteurs
explicatifs de l'attractivité des IDE en deux grandes
catégories : les facteurs économiques et les facteurs
institutionnels.
Parmi les raisons institutionnelles généralement
évoquées pour promouvoir les IDE au sein d'une économie on
cite principalement le risque pays, la corruption, la mauvaise gouvernance, la
sécurité juridique ou encore la sécurité
judiciaire. En ce qui concerne les déterminants d'ordre
économique des IDE, on retient par exemple le taux de change effectif
réel, l'inflation, la taille du marché, le taux de croissance du
PIB réel, les infrastructures, l'aménagement du territoire, ou
encore les ressources naturelles.
Le contexte international fait d'ouverture et
d'interdépendance exige de la part des Etats l'adoption de politiques et
de pratiques ouvertes en matière d'accueil des investissements
étrangers12(*).
Dans beaucoup de pays du monde en développement et
particulièrement ceux membres de l'OHADA, la question de la protection
et de la sécurité juridique et judiciaire des IDE se posent avec
acuité. En effet, « devant la rareté des ressources
(diminution de l'aide publique au développement et insuffisance de
l'épargne domestique), les IDE sont devenues par la force des choses une
nécessité importante pour d'une part combler les insuffisances
des ressources financières internes, mais permettre aux Etats parties
d'accéder à la technologie et au savoir-faire extérieur
d'autres part. Dans ce contexte particulier, le droit et le pouvoir de la
réglementation deviennent donc un enjeu essentiel en ce qui concerne
l'accueil, la protection et la promotion des investissements directs
étrangers »13(*).Ainsi, au regard de l'importance des IDE pour le
développement économique mais aussi social des Etats parties au
Traité OHADA, il apparaissait intéressant d'étudier
l'apport du droit OHADA à l'attractivité économique des
IDE dans les Etats parties au Traité.
Au titre de l'apport du droit O14(*)HADA à
l'attractivité économique des territoires des Etats parties au
Traité, nous retiendrons, deux avantages comparatifs à savoir la
sécurité juridique et la sécurité judiciaire. En
effet, lors de l'adoption du Traité OHADA en 1993, « les
Hautes parties contractantes au Traité, avaient pris expressément
l'engagement de garantir la sécurité juridique et judiciaire des
activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et
encourager les investissements. C'est ce qu'elles ont fait en adoptant les
différents actes uniformes » et en créant la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA).
Or, plus de deux décennies après l'adoption du
Traité OHADA, le constat est que les investisseurs étrangers ne
se ruent pas aux portes des Etats parties, malgré toutes les garanties
offertes par le droit OHADA. En effet, le flux d'entrée des IDE
demeurent faible en comparaison avec celui d'autres pays africains15(*). Il est alors pertinent de se
demander si le droit OHADA assure vraiment la protection effective des
atteintes légitimes des investisseurs étrangers. En effet, les
investisseurs étrangers face à un système juridique
donné, s'interrogent sur deux aspects avant de s'implanter sur un
territoire : les garanties théoriques qu'offre le système
juridique et la perception pratique du respect de ces garanties.
Afin de répondre à cette question, dans
un premier temps nous nous attacherons à mettre en avant les garanties
juridiques qu'offre le droit OHADA aux investisseurs, mais aussi nous
présenterons les quelques lacunes de ce droit pouvant être
préjudiciables aux investisseurs (partie I). Dans un second temps nous
verrons comment le droit OHADA assure la sécurité judiciaire des
investissements et nous proposeront quelques pistes de réformes pour une
meilleure protection judiciaire des investissements (partie II).
PREMIERE PARTIE : LA SECURITE
JURIDIQUE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
Lors du symposium international sur le cadre juridique
de l'investissement en Afrique qui s'est tenu à Casablanca en 2017, un
auteur affirmait ceci : « Aucun climat juridique ne peut
être favorable sans sécurité juridique »16(*). Mais que recouvre exactement
la notion de sécurité juridique ?
La sécurité juridique est un principe du
droit qui vise à préserver les citoyens contre les effets
secondaires négatifs du droit, en particulier les incohérences ou
la complexité des lois et règlements, ou leurs changements trop
fréquents (insécurité juridique). Elle implique que les
particuliers et les entreprises doivent pouvoir compter sur une stabilisation
minimale des règles de droit et des situations juridiques17(*). A cet effet, la
législation doit réunir un certain nombre
d'éléments que sont la clarté, la simplicité, la
modernité, la cohérence et l'accessibilité18(*).
Le non-respect du principe de sécurité
juridique est susceptible d'engendrer des risques liés aux malentendus,
réclamations, contentieux et de provoquer des ruptures
d'égalité. Par ailleurs, de nombreuses études ont pu
démontrer que le défaut de sécurité juridique et
judiciaire influe sur l'Etat de droit, ce qui a pour conséquence de
freiner les investissements et toute cause ayant un effet, de ralentir le
développement socio-économique d'un pays19(*). Or, l'un des objectifs
fondamentaux de l'OHADA est d'atteindre une sécurité juridique
favorable à un accroissement des investissements dans l'espace OHADA.
Cette priorisation de la sécurité juridique par l'OHADA se
justifie d'autant que pour certains auteurs « elle relève d'un
impératif absolu »20(*), pendant que d'autres la qualifient de «
première valeur sociale à atteindre »21(*).
En proposant des règles modernes et
unifiées, mais aussi accessibles à la connaissance de
l'opérateur économique étranger, l'OHADA promeut et
protège l'investissement étranger. En effet, les Etats de l'OHADA
offrent aux investisseurs des garanties d'ordre normatif et judiciaire. D'un
point de vue normatif, le législateur communautaire a prévu des
règles modernes applicables aux sociétés, depuis leur
création jusqu'à leur faillite. Tout au long de cette
première partie il s'agira donc pour nous de montrer comment l'OHADA
assure la sécurité juridique des IDE à travers ses textes
mais aussi de présenter les lacunes du droit OHADA pouvant être
sources d'insécurité juridique pour les investissements.
CHAPITRE I : L'APPORT DU DROIT OHADA
DANS LA SECURISATION JURIDIQUE DES IDE
Dans l'investissement, comme dans la vie, la prise de
risque est inévitable. En effet, un investissement sans risque n'existe
pas. L'investisseur peut donc faire face à d'énormes risques.
Quelques-uns de ces risques ont un caractère normal, tandis que d'autres
ne l'ont pas. Les risques normaux sont ceux auxquels tout opérateur
économique devraient faire face, car il lui incombe d'en prendre compte.
Ces risques ont pour nom : le rythme de l'évolution du
marché, l'intensité de la pression concurrentielle ; les
qualités du produit fabriqué ou de l'outillage utilisé.
Une erreur d'appréciation de ces éléments peut transformer
la réussite attendue de l'investissement en un échec.
Assurer la sécurité des investissements
c'est donc les protéger des risques anormaux. Il s'agit de risques qui
sont en règle générale imprévisibles car
étrangers à l'environnement économique. Ces risques sont
le plus souvent de nature politique. En effet, les crises politiques et
institutionnelles et les guerres font fuir les investisseurs. Ainsi, la
stabilité politique devient un élément important de
marketing, de nombreux Etats africains afin d'attirer les investisseurs
étrangers. Toutefois à côté de la stabilité
politique, il y a aussi la « sécurité offerte par le
Droit ». En effet, il y a la nécessité de
protéger le droit de propriété, la liberté
d'initiative, des procédures de règlement efficace des
différends, etc. Pour tout dire, les règles juridiques relatives
à l'activité économique et aux procédures
judiciaires constituent un enjeu non négligeable dans la promotion et la
protection des investissements.
L'OHADA, depuis sa création s'est
attelée à mettre en oeuvre des dispositifs visant à
assurer la sécurité juridique des investissements, afin d'attirer
les investisseurs tant nationaux qu'internationaux pour favoriser le
développement économique des territoires des Etats parties. Avec
l'adoption de plusieurs Actes uniformes couvrant le droit des affaires, des
points positifs ont été marqués au niveau de la
sécurité juridique. En effet, les investisseurs connaissent
dorénavant les règles du jeu économique dans tous les
territoires couverts par l'OHADA. Avec la stabilité des textes, il
devient possible pour celui-ci de les connaître et de les intégrer
dans son comportement et sa stratégie d'investissement. Cette
stabilité est d'autant plus garantie que les États Parties n'ont
plus aucun pouvoir pour légiférer unilatéralement dans les
domaines couverts par le Traité de l'OHADA.
Au titre donc de l'apport du droit OHADA dans la
sécurisation juridique des investissements nous retiendrons le fait que
celui-ci facilite l'accès aux sources du droit économique
(section I), mais aussi que les dispositions des actes uniformes favorisent
l'accompagnement de l'investisseur de la création à la fermeture
de l'entreprise (section II).
Section I
: L'accessibilité matérielle et intellectuelle aux sources du
droit économique
Selon un auteur22(*), la sécurité juridique est
« l'idéal de fiabilité d'un droit accessible et
compréhensible qui permet aux sujets de droit de prévoir
raisonnablement les conséquences juridiques de leurs actes ou de leur
comportements ». La sécurité juridique suppose donc
entre autres, l'accessibilité de la norme juridique23(*), sa clarté et son
intelligibilité. Plus de 25 ans après l'entrée en vigueur
du traité OHADA, l'on constate que les normes adoptées par le
législateur OHADA sont accessibles tant sur le plan matériel
qu'intellectuel.
Paragraphe I :
L'accessibilité matérielle
A la fin des années 1980, les investissements
avaient tari en Afrique subsaharienne car les investisseurs avaient
tourné le dos à cette région à cause de la
désuétude, de l'éparpillement et de l'extrême
disparité de ses législations de nature économique. Les
textes étaient archaïques et en déphasage total avec les
besoins de l'époque. Aussi, les sources du droit économique
n'étaient pas aisément identifiables et
« c'était un véritable maquis législatif au
milieu duquel se retrouvaient difficilement les praticiens et à plus
forte raison les profanes et qui ne facilitait pas les relations commerciales
des sociétés avec l'étranger »24(*).
Le droit OHADA a facilité l'accès aux
sources du droit économique sur le plan matériel.
L'accessibilité matérielle se traduit par le fait que le droit
économique est plus facile à connaitre lorsqu'il est contenu dans
les textes d'ensemble (codes). Cette exigence est satisfaite par le droit OHADA
qui est contenu dans les Actes uniformes régissant les
différentes matières du droit économique et dont
l'ensemble est compilé dans un Code que l'on désigne couramment
le « Code vert » de l'OHADA. Avec ce Code, le droit des
affaires dans les Etats parties n'est plus le droit des affaires
burkinabè, ivoirien, sénégalais, togolais, mais un droit
des affaires africains25(*).
En plus du « Code vert », l'OHADA
a aussi mis à la disposition du public un outil efficace d'accès
au droit et à la jurisprudence de l'OHADA. Il s'agit d'une base de
données numériques disponibles sur internet, accessible sur le
site www.ohada.com et sur le site officiel de l'OHADA (www. ohada.org). Tout le
droit OHADA est disponible en accès gratuit sur ce site, ce qui renforce
l'accès aux sources du droit économique dans l'espace de l'OHADA.
L'investisseur qui se trouve donc aux Etats unis et qui souhaiterait avoir une
idée du régime des contrats d'affaires dans un pays membre de
l'OHADA peut, grâce à un simple jeu de clic, accéder en
version officielle aux sources juridiques dont il a besoin.
L'accessibilité matérielle aux sources
du droit économique dans l'espace de l'OHADA ne se réduit pas
uniquement au droit légiféré, elle concerne aussi la
jurisprudence de l'OHADA. En effet, depuis 2010, l'Association pour
l'Unification du Droit des Affaires en Afrique (UNIDA) a publié deux
Répertoires quinquennaux de jurisprudence OHADA recensant l'ensemble des
décisions rendues en application du droit de l'OHADA aussi bien par les
juridictions de fond des États Parties que par la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage sur les périodes 2000 à 2005 et 2006
à 2010. Qu'en est-il de l'accessibilité intellectuelle ?
Paragraphe II :
L'accessibilité intellectuelle
L'accessibilité intellectuelle aux sources du
droit économique dans l'espace de l'OHADA est garantie car
l'investisseur peut connaître de façon détaillée la
règle de droit qui régira son activité s'il décide
d'investir ou s'il a déjà investi et ce, sans le recours aux
services des avocats. Cela représente un gain de temps et donc d'argent.
Aussi, le droit de l'OHADA est facile à connaître car
formulé en des termes abstraits, généraux et impersonnels.
L'accessibilité intellectuelle permet à l'investisseur
d'anticiper les conséquences contentieuses d'une opération
économique.
Par ailleurs, en matière de
sécurité juridique, la supranationalité des Actes
uniformes OHADA prévue à l'article 10 du Traité,
confère à tous les Actes uniformes OHADA une suprématie
totale sur les dispositions de droit interne antérieures et
postérieures. En effet, selon cet article les actes uniformes sont
directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant
toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou
postérieure. « Cette primauté répond à
une logique élémentaire, elle impose qu'aucun Etat ne puisse
invoquer les dispositions de son droit interne pour se soustraire à
l'application du droit communautaire ; la conséquence juridique de
cette prééminence c'est qu'en cas de conflit de lois, la
disposition nationale cesse d'être applicable, cède à la
place communautaire et aucune autre disposition nationale ne peut être
introduite si elle n'est pas conforme à la norme communautaire. Elle a
pour but de faire appliquer sans contestation devant les juridictions
nationales, les normes qui créent en réalité un ordre
juridique, c`est-à-dire un ensemble des normes juridiques
possédant ses propres sources, doté d'organes et de
procédures aptes à les émettre, à les
interpréter ainsi qu'à en faire constater et sanctionner, le cas
échéant la violation »26(*).
L'OHADA en rendant matériellement et
intellectuellement accessible le droit économique, a contribué
à restaurer la confiance des investisseurs. En effet, la certitude de
ses droits est pour l'investisseur la condition de sa sécurité
juridique. Pour réaliser cet objectif de sécurité, l'OHADA
a eu recours à deux instruments : l'un concerne les normes, l'autre
les institutions chargées de les appliquer »27(*). Alors, si le but de l'OHADA
est de favoriser et d'encourager l'investissement dans son espace comme il est
justement rappelé dans son préambule, comment cet objectif est-il
traduit dans les actes uniformes ?
Section II : Les actes uniformes
OHADA : normes attractives des IDE
L'OHADA est venu remédier à
l'insécurité juridique et judiciaire qui prévalait en
Afrique subsaharienne, en créant un espace juridique harmonisé,
ayant permis la relance des investissements. En effet, plusieurs Actes
uniformes harmonisant les matières relevant du droit des affaires ont
été adoptés.
Ces textes adoptés par le Conseil des ministres
induisent des règles communes, simples, modernes et adaptées
à la situation des économies des Etats-parties. Ils apportent une
prévisibilité législative qui était inexistante
auparavant, mettent en place des procédures judiciaires
appropriées et favorisent le recours à l'arbitrage dans le
règlement des différends contractuels28(*). Les dispositions contenues
dans les actes uniformes OHADA favorisent la sécurité juridique
et de ce fait l'attractivité des investissements. L'OHADA accompagne les
investisseurs grâce à son arsenal juridique depuis la
création de l'entreprise jusqu'à la fermeture de celle-ci.
Paragraphe I : La création et le fonctionnement des
sociétés commerciales en droit OHADA
En ce qui concerne les investissements internationaux,
parmi les Actes uniformes en vigueur, trois sont particulièrement
importants. Il s'agit de l'Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique (AUDSC/GIE), de l'Acte uniforme portant organisation des
sûretés (AUS) et enfin de l'Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution (l'AUPRSVE).
L'Acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique édicte le cadre des activités
économiques. En effet, il met à disposition des opérateurs
diverses formes de sociétés allant des sociétés de
personnes aux sociétés de capitaux. Le législateur OHADA
autorise également la création de sociétés
unipersonnelles sous la forme d'une Société à
responsabilité limitée (SARL), d'une Société
anonyme (SA) ou d'une Société par actions simplifiée
(SAS). L'introduction de la SAS a introduit une grande dose de
flexibilité en droit des sociétés. Effet, celle-ci offre
une grande liberté contractuelle aux investisseurs désireux
d'opter pour une société flexible et dotée d'un fort
caractère intuitu personae. Aucun capital social minimum n'y est requis
et le seul organe obligatoire est le président, personne physique ou
morale. Les investisseurs ont donc la possibilité de créer une
société « sur mesure » correspondant au mieux
aux spécificités de leur marché.
Pour illustrer nos propos nous prendrons l'exemple du
projet pétrolier Tchad-Cameroun, qui a vu le jour en 2003. Ce projet a
permis l'exploitation du pétrole du bassin de Doba au Tchad, impliquant
deux États souverains et un consortium de compagnies
pétrolières - qui est largement structuré sur le fondement
des règles OHADA.
Le montage imaginé par les trois sociétés
étrangères (de droit français et américain)
chargées de la construction du projet pétrolier Tchad-Cameroun,
offre un bon exemple de l'intérêt de l'outil OHADA29(*). En effet, la
possibilité pour ces sociétés de se grouper au sein d'une
société en participation conformément aux dispositions de
l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales, a en
effet certainement facilité la réalisation de ce projet30(*). Cela constitue un
progrès juridique incontestable en matière de droit des
sociétés. En effet, les investisseurs étrangers
connaissent désormais les règles applicables en matière de
création d'une société anonyme, de location de locaux
à usage commercial ou encore de contrats de vente de marchandises entre
commerçants.
Le droit OHADA constitue également un
progrès juridique en matière de droit des sûretés.
En effet, l'AUS est un modèle de texte clair et innovant. Il facilite la
réalisation de projets d'investissements transfrontaliers en permettant
la constitution de garanties pour le financement de ces projets ou l'achat de
marchandises (notamment par le gage de créances, le nantissement de
valeurs mobilières, le nantissement de marchandises, etc.). L'AUS a
aussi érigé en règle le gage sans dépossession.
Suivant ce mécanisme, c'est, l'enregistrement de la sûreté
qui prime sur la dépossession, dans un registre ad hoc appelé
RCCM (Registre du commerce et du crédit immobilier). L'AUS a
également institué l'agent des sûretés31(*) qui s'avère utile
lorsqu'un crédit est octroyé par un groupement d'institutions
financières. Cette institution a été initié en vue
de faciliter la constitution, l'inscription, la gestion et la
réalisation des sûretés au profit d'un groupe de
prêteurs détenant chacun une quote-part de la créance de
remboursement du financement consenti. La possibilité d'opérer
comme agent des sûretés est limitée aux institutions
financières et aux établissements de crédits, nationaux ou
étrangers. Un tel établissement ou une telle institution peut
opérer, agissant en son nom et en qualité d'agent des
sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations
garanties l'ayant désigné à cette fin, sans
néanmoins devoir communiquer au tiers l'identité du/des
mandants32(*).
« L'institution crée une dissociation entre la créance
garantie et la sûreté. Ceci est indispensable s`il y a plusieurs
créanciers (par exemple un groupe de banques) qui ont collectivement une
même créance vis-à-vis du même débiteur. En
effet, il n'est pas efficace de devoir recourir au consentement de tous les
créanciers pour chaque démarche qui a trait à la gestion
des sûretés ou de son objet »33(*). Cette sécurité
juridique offerte aux préteurs par ce mécanisme permet de
favoriser d'avantage les investissements importants dans le
développement.
Par ailleurs, le législateur OHADA a prévu
à travers son Acte uniforme sur les procédures simplifiées
de recouvrement et de voies d'exécution, un ensemble de mesures qui
permettent d'assurer la mise en oeuvre des droits du créancier et de
préserver les intérêts du débiteur34(*). On retrouve ainsi la
procédure d'injonction de payer qui se fait par simple requête
adressée à la juridiction présidentielle du tribunal de
première instance du lieu d'exécution du contrat. En ce qui
concerne l'assiette des saisies, elle ne se limite plus aux seuls biens meubles
corporels et aux immeubles mais s'étend désormais aux droits
d'associés aux valeurs mobilières, aux récoltes ou encore
aux rémunérations. Ainsi donc, l'investisseur créancier
dispose d'une large gamme ouverte à lui afin de recouvrer ses
créances en souffrance auprès de débiteurs
indélicats. Aussi, le recours aux dispositions de l'acte uniforme sur
les voies d'exécution a permis d'obtenir la main levée de saisies
ventes diligentées par des nationaux à l'encontre d'un
investisseur étranger35(*).
Paragraphe II : La fin de
l'entreprise
Comme toute personne physique, la personne morale nait et
disparait. Elle nait par l'acte de constitution de société (en
cas de pluralité d'associé) ou d'un acte de constitution
unilatéral (en cas d'associé unique) et disparait par la
dissolution et le cas échéant la liquidation. Alors, quelles sont
les causes de la mort d'une entreprise ?
Dans bon nombre de cas, la disparition de l'entreprise
est dû au fait que celle-ci n'ait pas réussie à surmonter
les difficultés auxquelles elle était confrontée.
Il existe plusieurs critères permettant de
définir une entreprise en difficulté. De manière
générale, une entreprise est en difficulté lorsqu'elle
peine à honorer ses échéances financières, qu'il
s'agisse de mensualités de prêts, factures ou traites qui
demeurent impayées. Des difficultés sociales peuvent
également entrer en cause : une mauvaise gestion du personnel, de
nombreux départ ou un sous-effectifs peuvent, avec la question
financière aggravée la situation.
La plupart des entreprises rencontrent des difficultés
au cours de leur existence, sans que cela puisse être
considéré comme problématique. Il y a un risque pour la
santé de la société dès lors que les
difficultés deviennent chroniques. Il existe alors plusieurs solutions
procédurales pour tenter de stabiliser la situation, ou le cas
échéant, la cessation de l'activité.
Le législateur communautaire à travers l'Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif (AUPCAP) révisé de 2015, accompagne les opérateurs
économiques dans le sauvetage de leurs entreprises en difficulté.
Pour ce faire, le législateur OHADA, a mis en place un
important dispositif qui laisse apparaitre un traitement vigoureux des
difficultés de l'entreprise avant la cessation des paiements. En effet,
il ressort de l'article 1er du nouvel acte uniforme que les procédures
collectives ont des finalités diverses dont une
socio-économique : « préserver les
activités économiques et les niveaux d'emplois des entreprises
débitrices ». Cette disposition a un double
mérite : elle précise de manière explicite la
fonction économique des procédures collectives et justifie aussi
la primauté accordée à la pérennisation de
l'entreprise. Pour ces raisons, le législateur avait mis en place divers
moyens classiques de prévention des difficultés (il s'agit de la
procédure d'alerte36(*) et de celle du règlement
préventif37(*))
auxquels il a ajouté en 2015, la conciliation préalable38(*). Cependant, malgré
toutes ces procédures l'entreprise peut se retrouver en cessation de
paiement39(*). Mais
même à ce stade, le législateur persiste à vouloir
sauver l'entreprise par un traitement curatif qu'il impose. Pour sa survie
l'entreprise en cessation de paiement doit alors subir la procédure de
redressement judiciaire40(*).Toutefois, il peut arriver que la situation de
l'entreprise soit si désastreuse qu'il ne reste au juge que la
décision ultime de la liquidation des biens41(*).
Cependant, la faillite n'est pas la seule cause
possible de la mort d'une société. En effet, la
société en droit OHADA, prend fin pour diverses raisons à
savoir42(*) :
l'expiration du temps pour lequel elle a été
constituée43(*) ; la réalisation ou l'extinction de son
objet44(*) ;
l'annulation du contrat de société45(*) ; la décision des
associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ;
la dissolution anticipée prononcée par la juridiction
compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs
(article 200 de l'AUDCG/GIE) ; par l'effet d'un jugement ordonnant la
liquidation des biens de la société ou pour toute autre cause
prévues par les statuts.
Conclusion du chapitre I :
L'OHADA a été institué en 1993 afin
de relever le défi de l'insécurité juridique et judiciaire
qui sévissait dans les Etats parties et dont la conséquence
était de freiner l'investissement étranger, voir domestique. En
effet, « le législateur de l'OHADA a fait du dogme de la
sécurité juridique et judiciaire le principe fondateur de
l'alliance communautaire »46(*).
La venue de l'OHADA a permis d'introduire un droit
uniforme et d'évincer les droits caducs dont les dispositions
étaient disséminées dans plusieurs textes épars et
archaiques. En effet, pour garantir la sécurité juridique et
judiciaire des activités économiques et restaurer la confiance
des investisseurs, les Etats membres se sont dotés d'un droit des
affaires unifié déclinés en actes uniformes. Dès
lors, l'appropriation du droit OHADA constitue un préalable dans la
sécurisation pérenne du climat des affaires dans l'espace OHADA.
Cependant, bien que l'OHADA ait largement amélioré la pratique
des affaires dans les Etats membres, il n'en demeure pas moins qu'elle
recèle des insuffisances dans le dispositif de ces actes uniformes.
CHAPITRE II : L'IMPRECISION DES
ACTES UNIFORMES, SOURCE D'INSECURITE JURIDIQUE DES IDE
Les Actes uniformes sont la forme juridique
imaginée par le Traité, pour établir des «
règles communes, simples, modernes et adaptées à la
situation de leurs économies respectives [l'économie des Etats
parties]... »47(*).
Un ensemble normatif est susceptible de contribuer à la
sécurité juridique, s'il est à la fois complet,
précis et cohérent.
Même si l'OHADA met incontestablement en place
des dispositifs pour attirer l'investissement étranger, elle peut
cependant être cause de bien des incertitudes pour l'investisseur en
raison des maladresses ou de l'inadéquation de certains Actes uniformes.
Nous nous attarderons sur deux actes uniformes. Il s'agit de
l'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) et de
l'Acte uniforme relatif au droit des procédures simplifiées de
recouvrement et de voies d'exécutions (AUPSRVE). En effet ces deux
textes ont trait à l'implantation de l'investisseur dans le pays
hôte et à l'exploitation de l'activité.
Section I : L'Acte Uniforme relatif
au Droit Commercial Général (AUDCG)
Plus de deux décennies après l'adoption
du Traité OHADA par les Etats africains de la zone franc, et
l'entrée en vigueur des premiers Actes uniformes, la doctrine et la
pratique de cette organisation font état d'un bilan mitigé. Sans
vouloir aborder l'ensemble des lacunes de l'AUDCG, la présente section
s'attarde notamment sur certaines de ses dispositions qui ont fait l'objet de
débats et controverses comme celles relatives au Registre du Commerce et
du Crédit Mobilier (RCCM).
Paragraphe I : Le principe
d'immatriculation au RCCM
En octobre 1993, lors de l'adoption du Traité
relatif à l'harmonisation du droit des affaires, le constat
général et unanime était que le Registre du commerce
était devenu obsolète du fait qu'il ne jouait plus son rôle
dans la sécurisation des affaires. L'Acte uniforme relatif au Droit
Commercial Général adopté le 17 avril 1997 a
institué le RCCM, officialisant ainsi dans son titre la double fonction
d'immatriculation des commerçants et d'inscription de certaines
sûretés mobilières ainsi que du crédit-bail pour
toutes les personnes immatriculées ou non48(*). Le souci des États
parties à l'OHADA étant de créer un espace juridique et
économique commun, ils ont voulu faciliter la collecte et la diffusion
d'informations par les RCCM de chaque pays.
« Dans le régime de l'OHADA, chaque
État doit maintenir à jour un Fichier National consolidé
à partir des divers points d'enregistrement sur le territoire de
l'État concerné, tout en conservant la compétence
exclusive sur son territoire, de procéder aux immatriculations, aux
déclarations d'activités et aux inscriptions au
RCCM »49(*).
Le véritable handicap du RCCM tient au fait
qu'il soit, sur l'ensemble de l'espace OHADA, caractérisé par
l'inaccessibilité de ses données par les acteurs du secteur
privé et public, une gestion lourde encore effectuée sur support
papier, des données peu fiables qui ne sont pas mises à jour
régulièrement et une méconnaissance générale
des opérateurs économiques sur son utilité
informationnelle.
« A cause de cet état de chose la
distance continue d'être un obstacle pour les investisseurs situés
dans d'autres espaces économiques ou entre deux investisseurs
situés dans des pays différents mais membres de l'OHADA.
L'investisseur désirant souscrire l'émission d'actions ou
d'obligations va buter contre l'inaccessibilité de celle-ci alors qu'une
mise en marche effective de ces fichiers aurait permis à un
investisseurs situé aux Etats-Unis d'Amérique de placer des
capitaux par l'achat de titres après avoir obtenu des renseignements
fiables sur le site et ayant reçu une copie des documents y
afférent »50(*).
L'autre problème relatif au RCCM tient au fait
que celui-ci soit tenu par le greffe de la juridiction compétente ou
l'organe compétent dans l'Etat partie51(*). Il y'a par conséquent autant de RCCM que de
ressorts de juridictions commerciales (une dizaine au Niger, quelques deux
cents au Cameroun...).
Par ailleurs, l'insuffisance des informations fournies
par le RCCM constitue aussi une autre lacune. En effet, les informations
fournies par le RCCM se limitent aux renseignements sur la
société, son fonctionnement et sa fin de vie. Comment
prétendre informer les investisseurs si l'on ne prévoit point la
possibilité de publier des informations détaillées
liées aux titres auprès d'une bourse de valeur ?
« Il aurait été nécessaire d'envisager une
rubrique consacrée aux tires sociaux émis ou à
émettre par la société, la précision sur leur
montant nominal minimum et autres informations, même si ce montant peut
varier au gré de l'offre et de la demande comme dans les systèmes
d'économie libérale, ainsi le RCCM constituerait un
système d'information complet car en le consultant on saura directement
si la société est cotée quelles sont les titres qu'elle
vend »52(*).
Aussi, « les inscriptions des
sûretés réelles mobilières, vecteurs essentiels dans
la sécurisation des transactions commerciales et bancaires, sont
actuellement peu fiables et non consultables en temps réel. Or, le RCCM
se doit d'être la première source d`information commerciale,
économique et juridique de l'espace OHADA. Il devrait être un
référentiel permettant de disposer d'information d'ordre
statutaire et signalétique et d'obtenir des bilans d'entreprises, des
informations sur les dirigeants et activités des entreprises, compris
sur leurs engagements financiers à travers les sûretés
mobilières, les privilèges, les crédits-bails, ainsi que
toute décision judiciaire les concernant, notamment les décisions
de faillites, de dissolutions, ventes, etc. »53(*). Tous, ces dysfonctionnements
créent une brèche dans la sécurité juridique. Pour
y remédier, il faudrait privilégier l'informatisation du RCCM.
Paragraphe II : L'informatisation
du RCCM et la protection des données à caractère
personnel
Avec les registres classiques, les personnes physiques
déchues de la qualité de commerçant dans une zone
donnée de l'espace OHADA, parviennent à s'immatriculer dans une
autre localité dudit espace pour y exercer leur activité.
L'informatisation du RCCM, pourrait permettre une
interconnexion entre les différents fichiers de telle sorte qu'il sera
juste question de saisir les informations personnelles du commerçant
dans la base de données pour vérifier l'aptitude de ce dernier
à exercer l'activité commerciale.
L'informatisation permettrait aussi d'éviter
les risques de détérioration et de perte des informations
personnelles des commerçants détenus sur papier, lesquelles
informations sont difficilement reconstituables lorsqu'elles sont sur support
papier. Toutefois, il convient de noter que la dématérialisation
des informations personnelles des individus par l'informatisation du RCCM
appelle à l'observation de certaines règles notamment celle
relative à la protection des données à caractère
personnelles54(*). Mais
quel est le lien entre l'informatisation du RCCM et la protection des
données à caractère personnels ?
Le RCCM contient toutes les informations sur le
commerçant personne physique, lesquelles informations sont des
données à caractère personnel. Alors, comment informatiser
efficacement le RCCM afin de protéger au mieux les informations de ces
commerçants ?
A notre avis, le processus d'informatisation du RCCM
ne pourrait connaitre un véritable succès que par l'adoption par
tous les Etats d'une législation spécifique sur la protection des
données personnelles. Néanmoins, en dépit d'une adoption
par les Etats partie de l'OHADA d'une disposition spécifique relative
à la protection des données, il serait souhaitable pour le
législateur OHADA d'adopter un Acte Uniforme sur les Technologies de
l'Information et de la Communication qui inclurait non seulement un dispositif
légal sur les données personnelles mais aussi, des règles
relatives à la cybercriminalité car prévenant toutes
attaques du système d'information du RCCM.
Le principe d'immatriculation au RCCM n'est pas le
seul point d'achoppement que l'on peut citer. En effet, le principe
d'immunité des personnes morales de droit public ainsi que
l'exécution provisoire, encadrés par l'AUPSRVE, sont aussi des
lacunes du droit communautaire.
Section II : L'Acte uniforme
relatif au droit des procédures simplifiées de recouvrement et de
voies d'exécutions (AUPSRVE)
A défaut d'exécution volontaire ou dans
l'hypothèse d'échec de la procédure simplifiée de
recouvrement de créance, le créancier dispose de moyens de
contrainte légaux pour se faire payer. Il s'agit des voies
d'exécution. En effet, le législateur OHADA a créé
un Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et voies d'exécution qui a constitué une profonde
réforme de la procédure civile en matière de recouvrement
et des voies d'exécution influant ainsi sur les procédures
judiciaires dans l'ensemble des Etats membres.
Cet Acte uniforme présente une
particularité par rapport aux autres Actes puisqu'il abroge toutes les
dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats
Parties ; Et ce, à la différence des autres Actes uniformes
qui, dans leurs dispositions finales, se bornent à abroger les
dispositions contraires applicables dans les Etats Parties. Ainsi, en abrogeant
toutes les dispositions internes, qu'elles soient ou non contraires, les
rédacteurs de cet Acte uniforme ont voulu un ensemble cohérent
renfermant toutes les règles ayant vocation à s'appliquer aux
matières qu'il concerne, à savoir les procédures
simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution.
Le droit OHADA reconnaît à travers
l'AUPSRVE un droit à l'exécution forcée au profit du
créancier, contrebalancé par la reconnaissance d'un principe
général de protection du débiteur s'accompagnant de la
préservation des droits des tiers. Cependant, plusieurs
difficultés d'application peuvent constituer une entrave au bon
déroulement de la procédure de recouvrement des créances.
Alors quelles sont les principales lacunes que nous pouvons relever dans ces
dispositions relatives aux voies d'exécution ?
Paragraphe I : Le principe
d'immunité des personnes morales de droit public
L'immunité d'exécution est à
distinguer de l'immunité de juridiction. Tandis que la première
intervient en aval de la décision de justice, la seconde intervient en
amont et empêche la personne qui en bénéfice d'être
jugé. L'immunité d'exécution porte sur la personne
destinataire de la mesure d'exécution forcée. Autrement dit,
l'immunité d'exécution55(*) est le privilège personnel reconnu à un
débiteur, notamment l'Etat et ses démembrements, qui le soustrait
à toute mesure d'exécution forcée. Cette dernière
est l'exception à la faculté de contrainte que le
créancier a sur son débiteur défaillant. L'immunité
d'exécution est un sérieux obstacle au recouvrement des
créances dans l'espace OHADA. En effet, elle permet à une
catégorie de personnes d'échapper aux mesures d'exécution
forcée. Cependant, le législateur OHADA ne s'est pas
prononcé de façon explicite quant à l'identification
précise des bénéficiaires légaux de
l'immunité d'exécution. Celui-ci semble renvoyer à la loi
nationale pour fixer la liste des personnes concernées par cette
immunité. Par exemple, au Sénégal, l'article 194 al.1 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC), prévoit qu'il n'y a
pas d'exécution forcée ni de mesures conservatoires contre
l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics.
Beaucoup de décisions se réfèrent d'ailleurs
expressément à ces lois internes. Ainsi, au Cameroun, une
juridiction a fait application de la loi camerounaise n° 99/016 du 22
déc. 1999 portant Statut général des Etablissements
publics56(*). De
même, en Côte d'Ivoire, il a été fait
référence à la loi nationale, la loi n° 08-338 du 02
juillet 199857(*).
Or, la CCJA semble avoir une autre lecture de cet article 30.
Selon elle, en énonçant dans son alinéa 1er, le principe
selon lequel il ne peut y avoir d'exécution forcée, ni de mesures
conservatoires contre les personnes qui bénéficient de
l'immunité d'exécution et en envisageant dans son alinéa 2
la possibilité d'opposer la compensation aux personnes morales de droit
public et aux entreprises publiques, l'article 30 pose le principe
général de l'immunité d'exécution au profit de ces
personnes58(*).
L'arrêt rendue par la CCJA dans l'affaire dite
Togo Télécom59(*) renseigne à suffisance sur la position de la
CCJA. Par une interprétation extensive des alinéas 1 et 2 de
l'article 30 de l'AUPSRVE, la haute juridiction assurait l'immunité
d'exécution toutes les entreprises publiques quelle qu'en soit la forme
ou la mission. Cette solution fut confirmée en 2014 par l'arrêt
rendu dans l'affaire dite Port autonome de Lomé60(*). En effet dans un arrêt
du 13 mars 2014, la CCJA avait estimé que les entreprises publiques,
dont le port autonome de Lomé, bénéficient de
l'immunité d'exécution en vertu de l'article 30 alinéa 1
de l'AUPSRVE même si des dispositions nationales les soumettaient aux
règles de droit privé. En réalité, cet arrêt
dévoile toute la véhémence de la CCJA dans sa
volonté de soustraire les entreprises publiques au régime de
droit privé. En l'espèce elle avait reconnu l'immunité
d'exécution à l'entreprise togolaise alors même que la
décision frappée d'appel l'avait seulement condamnée
à payer diverses sommes assortie d'une exécution provisoire. Les
créanciers n'étaient pas encore en possession de titre
exécutoire. Seule une ordonnance de sursis à exécution
était sollicitée parallèlement à l'instance d'appel
devant le président de la juridiction de second degré. Le fait
donc pour les conseils de la société Togo port d'avoir
excipé prématurément de l'immunité
d'exécuté n'avait pas empêché la CCJA de
réitérer sa position en faveur d'une interprétation
extensive de l'article 30 de l'AU susvisé. Deux années plus tard,
des critères d'identification des entités
bénéficiaires de l'immunité d'exécution furent
dégagés par la Cour dans par la Cour dans l'affaire dite Fonds
d'Entretien Routier (FER) pour réitérer sa position sur
l'immunité d'exécution des personnes publiques61(*).
Par son arrêt n° 03/2018 du 26 avril
201862(*), la CCJA a
opéré un revirement de sa jurisprudence en matière
d'immunité d'exécution. La cour avait procédé dans
cette affaire à une nouvelle lecture de ces dispositions en ces
termes : « ... qu'en l'espèce, il est établi que
le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le
capital social est détenu à parts égales par des personnes
privées et par l'Etat du Congo et ses démembrements ; qu'une
telle société étant d'économie mixte, et demeure
une entité de droit privé soumise comme telle aux voies
d'exécution sur ses biens propres ; qu'en lui accordant
l'immunité d'exécution prescrite à l'article 30
susmentionné, la Cour de Kinshasa/Gombe a fait une mauvaise application
de la loi et expose sa décision à la cassation ; qu'il echet
de casser l'arrêt déféré et d'évoquer. A
travers cette solution, la CCJA s'est référée à la
forme privée de l'entreprise pour l'application des voies
d'exécution. Elle venait de tenir en compte de cette
réalité de l'entreprenariat public : la
société d'économie mixte.
En faisant l'économie de ces décisions,
on relève une instabilité de la jurisprudence de la CCJA sur la
détermination des entités bénéficiaires de
l'immunité d'exécution63(*). Pour éviter toutes divergences, il pourrait
être judicieux de préciser le champ de l'immunité
d'exécution accordée aux personnes morales de droit public. Dans
le cadre de la réforme le législateur OHADA pourrait envisager
d'attribuer une immunité d'exécution en fonction de
l'activité (mission de service public) et non d'un critère
purement organique. Ainsi donc lorsque les activités de la personne
publique relèvent du droit privé, l'immunité
d'exécution ne devrait pas s'appliquer. Cette question va
essentiellement concerner les établissements industriels et commerciaux
(EPIC) dont les activités ne relèvent pas du droit privé
mais des services publics marchands. L'immunité d'exécution des
Etats parties à l'OHADA servirait l'attractivité de leurs
économies si elle se limitait sur des biens ou des catégories de
biens utilisés ou destinés à être utilisés
à des fins publiques. Il s'agit là d'une mesure de
revalorisation du droit de créance qui fait de l'Etat commerçant
un justiciable comme tous les autres.
Tandis que la plupart des droits nationaux des pays membres de
l'OHADA prévoient le sursis à exécution provisoire,
l'OHADA en disposé autrement.
Paragraphe II : Les défenses
à exécution
L'article 32 de l'Acte uniforme en matière de
voies d'exécution pose la délicate question du sort des
défenses à l'exécution provisoire telles
qu'organisées en droit interne de certains Etats parties.
Dans l'arrêt du 11 Octobre 2001 dit EPOUX
KARNIB64(*), la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) décidait que l'article 32 de
l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution interdit les défenses
à l'exécution provisoire lorsque celles-ci tendent à
suspendre une exécution forcée déjà entamée.
A contrario, l'on pourrait comprendre que les défenses à
l'exécution provisoire telles que régies par le droit interne de
chaque Etat partie demeurent applicables lorsqu'elles visent non pas à
suspendre une exécution forcée déjà engagée,
mais plutôt à empêcher qu'une telle exécution
commence65(*).Or, le
principe énoncé à l'article 32 est celui d'une
exécution forcée sans obstacle.
A notre avis, il conviendrait de «
sécuriser » la restitution des fonds perçus par le
créancier « provisoire » qui se serait
précipité à diligenter une exécution provisoire. En
effet, l'article 32 n'interdit pas au juge des référés
saisi d'une défense à exécution provisoire de prendre
toute mesure utile compatible qui lui serait faite à titre
reconventionnel par le défendeur, puisque le droit commun est toujours
applicable dès lors qu'une disposition expresse ne l'interdit pas.
Dès lors qu'il ne suspend pas la poursuite de l'exécution
provisoire expressément autorisée par cet article, il peut, en
vertu des pouvoirs que lui confère l'urgence ou la
nécessité de parer à un péril imminent (comme le
risque de ne pas obtenir la restitution des sommes versées), prendre la
mesure utile pour éviter l'impossible restitution, par exemple, en
ordonnant la mise sous séquestre des sommes réclamées dans
l'attente d'une décision définitive. Cette mesure de
séquestre, qui n'est en effet que conservatoire, présente
l'avantage de respecter le droit du débiteur condamné
provisoirement à un procès équitable reconnu comme un
droit supérieur par les articles 3 et 7 de la Charte Africaine des
droits de l'homme et des peuples. En effet, l'interprétation de
l'article 32 retenue par la CCJA depuis l'arrêt de principe de 2001 est
de nature à conduire à une iniquité irréparable
pour le débiteur au cas où le créancier qui a fait
exécuter le titre provisoire se trouverait dans l'impossibilité
de lui restituer ce qu'il a perçu indûment.
Les objectifs visés par l'amélioration
de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de
recouvrement de créances et des voies d'exécution sont la
recherche d'une plus grande efficacité et de
célérité dans le fonctionnement de la justice commerciale.
La réforme qui pourra améliorer cet acte uniforme aura pour
vocation d'offrir aux opérateurs économiques un environnement
propre à promouvoir les investissements privés tant nationaux
qu'étrangers à travers une plus grande confiance dans l'appareil
judiciaire. Elle assurera ainsi à l'OHADA l'image d'un espace
économique au sein duquel les juridictions garantissent la
sécurité des transactions commerciales. Cette initiative servira
de levier et de vecteur de développement économique.
Conclusion du chapitre II :
« L'OHADA s'est dotée de lois appelées
« Actes uniformes » pour faciliter les échanges,
encourager l'investissement des entreprises domestiques et internationales mais
aussi garantir la sécurité juridique et judiciaire. Cet objectif
de sécurité juridique et judiciaire est indispensable pour
drainer des flux importants d'investissement et faire de l'espace OHADA une
cible de premier choix pour les investisseurs
étrangers »66(*).
Ce chapitre nous a permis de présenter les
dysfonctionnement et les obstacles qui constituent une pierre d'achoppement
sur le chemin de l'effectivité pleine et entière du droit OHADA.
En effet, l'on note la présence de lacunes au sein principalement de
deux actes uniformes : l'AUDCG/GIE et l'AUPRSVE. Ces lacunes constituent
une entrave à la sécurité juridique visée par le
législateur communautaire. Le législateur OHADA devrait donc
songer à améliorer ces actes uniformes pour une meilleure
sécurité juridique des IDE
Conclusion de la première
partie :
L'environnement créé par le droit des
affaires OHADA donne aux investisseurs une lisibilité quant au droit
applicable à leurs opérations. Ils peuvent ainsi anticiper les
risques inhérents à leurs activités. Le droit de l'OHADA
garantit donc une certaine prévisibilité du règlement des
conflits qui, jadis, faisait défaut. L'ensemble de l'oeuvre
législative de l'OHADA vise à rassurer les investisseurs.
Toutefois les lacunes de quelques actes uniformes devront être
comblées par le législateur OHADA afin d'assurer au mieux la
sécurité juridique des IDE.
Les promoteurs du droit des affaires ne se sont pas
limités à l'élaboration de normes juridiques. Ils ont eu
également comme souci de donner des garanties judiciaires quant à
leur application. L'uniformisation du droit entamée par l'OHADA
resterait théorique si les normes qu'elle édicte étaient
diversement appliquées et interprétées dans les Etats
membres. L'uni?cation juridique devait nécessairement s'accompagner
d'une uni?cation judiciaire pour garantir aux opérateurs
économiques le principe de l'égalité de traitement. Ainsi
donc, dans la seconde partie il s'agira pour nous de d'aborder le volet de la
sécurité judiciaire des investissements.
DEUXIEME PARTIE : LA SECURITE
JUDICIAIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
Le développement des échanges et des
investissements dans un monde aussi mouvant et à risques a rendu
évident le besoin de sécurité juridique et judiciaire des
activités des entreprises, moteur du développement
économique.
L'OHADA, à travers l'adoption de plusieurs Actes
uniformes couvrant le droit des affaires, a réussi à assurer la
sécurité juridique des investissements internationaux. En effet,
celle-ci offre un cadre légal stable et répond à certaines
préoccupations des investisseurs.
Cependant, si la réalisation de la
sécurité juridique au sein de l'espace OHADA constitue un bon
point de départ, cela n'est pas suffisant pour attirer les investisseurs
étrangers. En effet, il ne suffit pas de vouloir la
sécurité juridique pour qu'elle soit réelle et
perceptible ; encore faut-il en déterminer les modalités de
concrétisation et en définir la philosophie de
réalisation.
Aussi, la sécurité juridique, à elle
seule, ne garantit pas le résultat recherché par la
création de l'espace juridique commun ; elle ne rassure par
ailleurs point les investisseurs. En effet, la sécurité
judiciaire est également un élément important du bon
déroulement d'une opération.
L'OHADA grâce à l'élaboration de
réformes a réussi à améliorer la
sécurité judiciaire des investissements. En effet,
l'avènement de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) a
considérablement contribué à améliorer cette
sécurité judiciaire.
Alors comment se manifeste la sécurité
judiciaire au sein de l'espace OHADA ? Quelles sont les difficultés
auxquelles sont confrontées les justiciables ? Quels sont les
réformes à entreprendre pour une meilleure sécurisation
judiciaire des investissements dans l'espace OHADA ? Telles sont les
questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette partie.
CHAPITRE I : LES ACQUIS DE LA
SECURITE JUDICIAIRE DANS L'ESPACE OHADA
Dans le jargon de l'OHADA, Il est coutumier de
toujours associer les concepts de « sécurité
juridique » et de « sécurité
judiciaire ».
La sécurité judiciaire, souvent
considéré improprement comme synonyme de sécurité
juridique, s'entend d'un sentiment de confiance des opérateurs
économiques et des usagers du service public de la justice dans
l'institution judiciaire. Ce concept est le pendant judiciaire de la
sécurité juridique qui concerne principalement les attentes des
administrés à l'égard du législateur. Cette
confusion conceptuelle entame énormément les efforts de
séduction des aspects judiciaires de l'OHADA à l'endroit de
potentiels investisseurs.
Toutefois, la sécurité judiciaire reste l'un des
objectifs déclarés du législateur OHADA et marque un
certain état d'esprit ; elle est son arme stratégique
d'incitation aux investissements dans l'espace OHADA. Pour s'en convaincre, il
suffit d'interroger les textes de l'OHADA (section I) et d'examiner
l'environnement judiciaire OHADA pour en percevoir les manifestations (section
II).
Section I : Les fondements de
la sécurité judiciaire dans les textes de l'OHADA
La sécurité judiciaire est
consacrée par les textes de l'OHADA. Elle se déduit implicitement
du droit primaire et concrètement du droit dérivé.
Paragraphe I : La
sécurité judiciaire dans le droit primaire OHADA
L'articulation des normes juridiques du système
OHADA place le Traité institutif, signé le 17 octobre 1993, au
sommet de la hiérarchie normative. Ce Traité,
révisé le 17 octobre 2008, en son article premier, dispose que
l'OHADA « a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les
États Parties, par l'élaboration et l'adoption des règles
communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs
économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires
appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour
le règlement des différends contractuels ».
Ce texte n'emploie pas le concept de «
sécurité judiciaire » dans ses dispositions de fond, mais
plutôt l'expression « procédures judiciaires
appropriées ». Néanmoins, le premier considérant du
préambule du Traité révisé réaffirme la
volonté des Etats membres de l'espace OHADA de renforcer la
sécurité juridique et judiciaire sur leurs territoires. Les
« procédures judiciaires appropriées » sont-elles
synonymes du concept « sécurité judiciaire » ?
Une réponse affirmative serait hâtive,
d'autant plus que le terme « judiciaire » n'est employé, par
le Traité, qu'à quatre reprises. Seul l'article 1er du
Traité OHADA, consacrant l'attachement du législateur aux
procédures judiciaires appropriées, laisse présager une
aspiration à la sécurité judiciaire. Quelle que soit la
portée que l'on souhaiterait donner à l'expression «
procédures judiciaires appropriées », il est constant qu'on
ne peut prétendre à une sécurité judiciaire sans la
mise en oeuvre des procédures appropriées devant les institutions
judiciaires.
Aussi, vu le caractère général de
cette expression utilisée par le législateur, ce texte se
présente comme le fondement par défaut de la
sécurité judiciaire en droit OHADA. Pour s'en convaincre, l'on
peut se référer à l'affirmation d'un auteur qui disait
ceci : « un effort considérable a été
accompli à partir de 1992 en vue d'un double objectif. En premier lieu,
il s'agissait de renforcer la sécurité juridique en appliquant
d'abord dans les Etats de la zone franc, puis ultérieurement dans un
cadre africain plus large, un droit des affaires harmonisé, simple,
moderne, et adapté aux besoins des entreprises. En second lieu, il
convenait de garantir une sécurité judiciaire en organisant une
Cour de justice chargée d'interpréter ce droit et de faciliter le
recours à l'arbitrage »67(*).
En outre, nous pouvons également voir, dans les
dispositions des articles 3, 13 et 14 du Traité, d'autres fondements de
la sécurité judiciaire dans l'espace OHADA. Ces textes
créent le cadre général d'interprétation et
d'application du droit uniforme.
L'article 3 institue la Cour suprême de l'espace
juridique intégré : la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
(CCJA). L'article 13, lui, consacre les juridictions de fond des États
Parties comme juge de droit commun du droit uniforme. L'article 14 quant
à lui, définit les attributions (consultatives et contentieuses)
de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
Tous ces éléments démontrent
à quel point le législateur communautaire a tenu aux aspects
judiciaires nécessaires à la réalisation de son projet. Il
ne s'est d'ailleurs pas arrêté à ce cadrage
général. Il est allé plus loin dans les dispositions du
droit dérivé OHADA.
Paragraphe II : La
sécurité judiciaire dans le droit dérivé OHADA
Le législateur OHADA a exprimé la prise
en compte des aspects judiciaires de l'attractivité économique du
droit uniforme à travers les dispositions de l'Acte uniforme sur les
voies d'exécution et de l'Acte uniforme portant sur l'arbitrage.
Le fait que le droit OHADA présente avant tout
un caractère national68(*) est aussi un atout pour la sécurité
judiciaire tant souhaitée par les investisseurs et
véhiculée par l'Acte uniforme sur les voies d'exécution
ainsi que par l'Acte uniforme portant sur l'arbitrage. En effet, ces deux Actes
uniformes étant d'application directe69(*), ils représentent les prémices de la
sécurisation judiciaire des investissements.
Dans l'optique de stabiliser l'environnement
judiciaire, d'attirer et de rassurer les investisseurs, l'uniformisation des
règles relatives au recouvrement simplifié des créances et
aux procédures civiles d'exécution s'est avérée
nécessaire dans tous les États Parties. C'est l'article 2 du
Traité qui classe les voies d'exécution parmi les matières
qui ressortissent du champ du droit uniforme. L'objectif était de lutter
contre les procédures de saisies jugées
irrégulières par les opérateurs économiques et les
difficultés de recouvrement des créances commerciales certaines,
liquides et exigibles. Pour rappel, avant l'avènement de l'OHADA, les
saisies-ventes étaient généralement diligentées par
les nationaux contre les biens des investisseurs étrangers, ce qui ne
servait pas la réputation et l'attractivité de leur espace
économique70(*).
Aussi, le législateur OHADA a doté les
investisseurs d'outils efficaces pour vaincre en temps utile les
résistances abusives des débiteurs récalcitrants
grâce aux procédures simplifiées de recouvrement, telles
que l'injonction de payer et de délivrer ou de restituer.
L'héritage le plus impressionnant de l'OHADA
sur le plan de la sécurité judiciaire est la limitation des
immunités de juridiction et d'exécution des personnes publiques.
Les saisies sont désormais possibles sur les biens de ces derniers et
leurs dettes peuvent désormais donner lieu à compensation avec
leurs créances71(*).
De même, puisqu'ils ne sont pas des acteurs
économiques comme les autres, les pères fondateurs de l'OHADA ont
investi les États d'une charge essentielle à l'effectivité
et l'efficience du droit uniforme. C'est ainsi que l'article 29, alinéa
1 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution dispose que l'Etat est
tenu de prêter son concours à l'exécution des
décisions de justice et des autres titres exécutoires.
Le fait que l'État soit tenu, constitue une garantie
indéniable de sécurité judiciaire pour le justiciable, et
ce d'autant que l'alinéa 3 de l'article 29 de l'Acte uniforme sur les
voies d'exécution pose le principe général de la
responsabilité de l'État du fait de sa carence ou de son refus de
prêter son concours à l'exécution des décisions de
justice et autres titres exécutoires.
Le droit de l'arbitrage OHADA est un autre instrument
de consécration de la sécurité judiciaire dans l'espace
OHADA72(*). Son cadre
institutionnel est organisé par les articles 21 à 26 du
Traité. Son régime est encadré par un Acte uniforme
spécialement dédié au droit de l'arbitrage. L'arbitrage
est un élément de sécurité judiciaire en ce qu'il
est un instrument d'évitement du juge étatique dont
l'indépendance, la compétence et surtout l'impartialité
n'emportent pas généralement l'adhésion des investisseurs.
Il offre une alternative crédible aux investisseurs qui ne font pas
confiance aux institutions judiciaires des États Parties. En effet,
ceux-ci sont à même d'utiliser ce mode alternatif de
résolution des différends, plus approprié à la
conduite de leurs affaires et auquel ils ont le plus confiance, dès lors
qu'ils sont en mesure de choisir librement un arbitre indépendant et
impartial qu'ils investissent du pouvoir de trancher le litige qui les
oppose.
En dehors de tous les autres avantages attractifs de
l'arbitrage, c'est-à-dire l'efficacité et la rapidité, il
conviendra de noter que la confidentialité demeure un aspect important
de l'arbitrage auquel les investisseurs sont intimement liés. Elle est
considérée comme étant l'une des principales motivations
des parties à compromettre, car « l'un des principes
fondamentaux - et des avantages les plus certains - de l'arbitrage
international est son caractère confidentiel »73(*). Les investisseurs pour des
raisons économiques liées à la compétitivité
ou au secret d'affaires74(*) tiennent pour la plupart des cas, à ce que des
différends arbitraux leur concernant soient passés sous le sceau
du secret. Cela permet d'éviter que des concurrents ou que des
médias se saisissent de cette situation pour engendrer des
conséquences néfastes sur la santé financière de
leurs entreprises. Désormais l'OHADA, à travers son arbitrage
très spécifique, propose un mécanisme privé de
résolution des différends qui offre une garantie de
rapidité à tous les investisseurs étrangers afin de ne pas
perdre du temps et de l'argent dans des procédures et recours devant les
tribunaux étatiques.
Toutefois il convient de signaler que la voie de l'arbitrage
n'est pas une solution miracle. En effet, elle ne garantit pas les
investisseurs contre le fait que les tiers peuvent les attraire en justice
devant les juges nationaux75(*), ni contre les contentieux post arbitraux ou
répressifs. On comprend, à la lumière des limites de
l'arbitrage, que la meilleure manière pour que la justice soit
rendue ne consiste pas toujours à éviter le palais de justice.
Alors quelles sont les manifestations de la sécurité judiciaire
dans l'espace OHADA ?
Section II : Les
manifestations de la sécurité judiciaire dans l'espace OHADA
Aujourd'hui, ce qui est frappant, lorsque l'on
s'intéresse à l'attractivité économique de l'espace
OHADA sous l'angle judiciaire, c'est l'illisibilité du régime de
la réalisation judiciaire des droits substantiels que définissent
les Actes uniformes. L'articulation entre le droit communautaire et les droits
nationaux n'est pas toujours simple. Toutefois l'on peut percevoir les
prémices de la sécurité judiciaire tant en amont
(paragraphe I) qu'en aval de l'acte juridictionnel (paragraphe II).
Paragraphe I : En amont de
l'acte juridictionnel
Le législateur communautaire est resté
muet quant au régime juridique de l'accès au juge de droit commun
de l'OHADA, renvoyant la question aux droits processuels des États
Parties. Les manifestations de la sécurité judiciaire en amont de
l'acte juridictionnel ne sont donc pas assez perceptibles dans les dispositions
de l'arsenal juridique de l'OHADA.
Toutefois, sa manifestation peut être
perçue dans l'application de l'article 336 de l'Acte uniforme sur les
voies d'exécution qui dispose que : « Le présent Acte
uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il
concerne dans les États Parties ». L'intérêt pratique
de ce texte est qu'il tranche les conflits de lois de procédure en
faveur du droit uniforme sur les voies d'exécution. Toutes les
dispositions de droit interne, contraires à l'esprit ou à la
lettre des Actes uniformes contenant une disposition de procédure sont
inapplicables au litige76(*). Ce texte met les justiciables à l'abri des
instrumentalisations, à des fins dilatoires, des lois de
procédure nationales. Il sécurise aussi les investissements
contre les risques d'instrumentalisation des législations nationales
favorisant la saisie des biens des investisseurs77(*).
Une autre manifestation de la sécurité
judiciaire en droit de l'OHADA réside dans les procédures
simplifiées de recouvrement de créances. Les procédures
d'injonction de payer, de délivrer ou de restituer un bien meuble sont
autant d'outils mis à la disposition des investisseurs pour d'une part,
sécuriser leur patrimoine contre la résistance des
débiteurs récalcitrants et d'autre part, faire face aux lenteurs
judiciaires et à l'usure du temps78(*). Ainsi, les créances d'origine
contractuelle79(*) ou
celles résultant de l'émission ou de l'acceptation de tout effet
de commerce ou d'un chèque sans provision80(*) peuvent être
recouvrées au terme d'une procédure rapide et
simplifiée81(*).
Il convient aussi de voir dans l'organisation et le
fonctionnement de la CCJA ainsi que dans le statut des juges de cette
juridiction, un gage de sécurité judiciaire. Les attributions
consultatives de la haute juridiction offrent un cadre de dialogue aux
différents acteurs chargés d'appliquer le droit uniforme au
premier degré et en cause d'appel. La procédure d'avis
consultatif prévue par l'article 13 du Traité permet ainsi aux
juridictions nationales de dialoguer avec la haute Cour en amont de l'acte
juridictionnel contentieux en vue d'optimiser l'interprétation du droit
uniforme. Cet instrument processuel a pour objet d'éviter une dispersion
de l'interprétation du droit. Par ailleurs, la compétence
exclusive de la CCJA (article 14 du Traité) concernant les pourvois en
cassation dans toutes les matières énumérées
à l'article 2 du Traité est également un gage de
sécurité judiciaire. Cette compétence exclusive est de
nature à renforcer la confiance des investisseurs dans le système
judiciaire OHADA.
Le pouvoir d'évocation qui est reconnu à
la CCJA est un instrument efficace pour la réalisation de la
sécurité judiciaire et participe à la lutte contre les
lenteurs judiciaires devenues la marque de fabrique de certaines juridictions
africaines82(*). Ce
pouvoir d'évocation qui se transforme dans d'autres circonstances en
« devoir d'évocation », est fondé sur les
nécessités d'une bonne administration de la justice. Le fait de
casser sans renvoi lui permet de juger de plus en plus vite en se substituant
aux juridictions nationales de fond.
Paragraphe II : En aval de
l'acte juridictionnel
La sécurité judiciaire en aval des
décisions de justice est le point ayant le plus préoccupé
la doctrine de droit OHADA. Quoi de plus normal que de se préoccuper de
la satisfaction équitable du justiciable en l'aidant à faire
exécuter la décision de justice consacrant son droit substantiel.
La clé de voûte du système de protection des droits
substantiels, civils et commerciaux, n'est-elle pas à rechercher dans
les voies d'exécution ? En effet, le contentieux de l'exécution
forcée est l'une des préoccupations constantes des praticiens et
de la doctrine de l'espace OHADA54. On le sait, la sécurité
judiciaire après une décision de justice se décline sous
deux formats : la fin du procès, et l'exécution (forcée)
de la décision de justice.
Dans l'espace OHADA, la sécurité
judiciaire se manifeste à travers la réglementation des effets
des décisions de justice. Afin d'éviter toute instrumentalisation
négative des règles de procédure nationale, le
législateur communautaire a soigneusement encadré les effets
attachés aux décisions de la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage et aux sentences arbitrales rendues sous son égide. Pour
éviter que les procès ne s'éternisent et « couper
court à des tentatives détournées de rouvrir un
débat clos »83(*), le Traité OHADA dispose en son article 20 que
: « les arrêts de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ont
l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Ils
reçoivent sur le territoire de chacun des États Parties une
exécution forcée dans les mêmes conditions que les
décisions des juridictions nationales. Dans une même affaire,
aucune décision contraire à un arrêt de la Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution
forcée sur le territoire d'un État Partie ». Attacher aux
décisions de la haute juridiction l'autorité de la chose
jugée et la force exécutoire a pour effet utile d'empêcher
toute remise en cause de l'efficacité des décisions de la CCJA
devant une juridiction nationale.
Le législateur a accordé une importance
particulière à l'exécution des décisions de justice
dans l'espace OHADA. En règle générale, les
décisions de justice doivent être exécutées
spontanément dès qu'elles sont exécutoires,
c'est-à-dire passées en force de chose jugée. Il ne peut
en être autrement que si le débiteur bénéficie d'un
délai de grâce ou le créancier de l'exécution
provisoire. Pour vaincre l'inertie, voire la rébellion des parties
succombantes, le législateur communautaire a organisé le
régime de l'exécution forcée des décisions de
justice par un important Acte uniforme.
Les sentences arbitrales rendues sous l'égide
de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ont, à ce titre,
une force supérieure à celle des jugements étatiques et
des autres sentences arbitrales car elles ne sont soumises qu'à
l'exigence de l'exequatur communautaire dans le pays de l'exécution. Ce
qui constitue une avancée majeure.
En règle générale, les
décisions rendues par les juges du fond acquièrent
autorité de chose jugée, dès leur prononcé, dans le
système OHADA. Toutefois, les voies d'exécution ne peuvent
être mises en oeuvre qu'à partir du moment où elles sont
passées en force de chose jugée, c'est-à-dire
insusceptibles d'une voie de recours suspensive d'exécution. On voit
donc que la condition nécessaire et indispensable pour poursuivre
l'exécution forcée d'une décision de justice est la force
de chose jugée et non la seule autorité de chose jugée.
Cette remarque est particulièrement valable pour les décisions
rendues par les juridictions de première instance. Celles que rendent
les Cours d'appel nationales ont, dès leur prononcé,
autorité de la chose jugée et force de chose jugée car
elles ne peuvent, sauf exception, faire l'objet d'un recours suspensif
d'exécution.
Certains points positifs ont déjà
été marqués sur le terrain du contentieux de
l'exécution dans l'espace juridique OHADA. L'harmonisation du cadre
juridique des notifications des décisions de justice (notifications des
décisions de justice, certificats de non appel ou de non opposition,
mentions obligatoires), l'encadrement du caractère exécutoire des
décisions de justice, le rôle du juge dans le contentieux de
l'exécution sont autant d'avancés sur le chemin de la
restauration de la confiance des investisseurs dans le système
judiciaire OHADA.
Conclusion du Chapitre I :
Ce chapitre nous a permis de dres ser une grille
d'analyse et d'interprétation des aspects judiciaires du droit OHADA,
non pas du point de vue de la théorie juridique ou de la pratique
juridique, mais sous l'angle de ce qu'ils représentent sur le plan de
l'attractivité économique des IDE. En effet, l'orientation de ce
chapitre répond à l'impératif incontournable de la
mondialisation et de la compétition entre les systèmes
juridiques. Cette compétition conduit les investisseurs étrangers
à évaluer les qualités et les défauts de l'offre de
justice proposé par chaque système judiciaire : la
célérité, le couit, la discrétion, la
sécurité, l'indépendance, l'impartialité et bien
d'autres critères.
Ainsi le législateur OHADA a
érigé la mise en oeuvre de procédures judiciaires
appropriées » au rang des objectifs primordiaux de l'OHADA. Et
pour lui donner les moyens de ses objectifs, les pères fondateurs de
l'OHADA ont choisi de créer une instance sui generis compétente
pour unifier l'interprétation et l'application du droit uniforme ;
cette instance n'est autre que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. Cette
haute juridiction est présentée comme le gage de la fiabilisation
du système judiciaire des Etats parties et des procédures
arbitrale diligentée à l'intérieur des Etats qui sont sous
sa juridiction.
Outre l'ouverture classique du droit OHADA à
tout arbitrage ayant son siège dans l'un de ses Etats parties et aux
personnes morales de droit public, l'offre d'arbitrage OHADA étend son
champ d'application matériel à l'arbitrage d'investissement.
Celui-ci est généralement défini comme le forum arbitral
qui accueille des différends opposant un Etat ou une de ses
entités, et une entité privée étrangère
réalisant une opération d'investissement dans cet Etat.
Cependant, en dépit de ces avancées, de nombreuses lacunes
entravent la réalisation de l'espace judiciaire OHADA.
CHAPITRE II : LE CARACTERE
PERFECTIBLE DE L'ESPACE JUDICIAIRE OHADA
L'espace judiciaire OHADA se présente comme une
pyramide. Les juges de fond des juridictions nationales sont juges de droit
commun du droit communautaire OHADA. Une juridiction est qualifiée de
droit commun lorsqu'elle « a vocation à connaitre de toutes
les affaires à moins qu'elles n'aient été
attribuées par la loi à une autre juridiction ». En
d'autres termes, les juridictions de droit commun sont celles qui ont
« une compétence de principe pour connaitre de tous les
litiges sans qu'il soit besoin d'une loi spéciale pour les investir du
pouvoir de juger de telle ou telle affaire ». Tandis que, la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage, constitue au sommet de la pyramide la Cour
de cassation supranationale comme conséquence de cela, les
décisions de la CCJA bénéficient d'une force
exécutoire communautaire.
Si sur le plan juridique l'espace OHADA est plus ou
moins élaboré grâce à l'uniformité des
règles juridiques applicables à l'ensemble des pays
membres84(*), l'on peut
douter cependant de l'existence réelle d'un espace judiciaire OHADA. En
effet, l'absence d'harmonisation de la carte judiciaire et de
coopération entre les juges de l'espace OHADA, contribuent à
obstruer l'instauration d'un véritable espace judiciaire OHADA (Section
I). Aussi, l'absence d'une circulation de la totalité des titres
exécutoires constitue une autre lacune de l'espace judiciaire OHADA
(Section II).
Section I : Le cloisonnement
des systèmes judiciaires des Etats-parties à l'OHADA
Le cloisonnement se manifeste par l'absence
d'harmonisation de la carte judiciaire des Etats membres (paragraphe I), et par
l'absence de coopération entre les juges (paragraphe II).
Paragraphe I : L'absence
d'harmonisation de la carte judiciaire et des procédures judiciaires
OHADA
L'absence d'harmonisation de la carte
judiciaire85(*) s'explique
par plusieurs raisons.
La première raison provient du fait qu'une
bonne partie de la doctrine mais aussi la CCJA estiment que l'OHADA «doit
s'abstenir de toucher à l'organisation judiciaire des Etats-parties ou
à l'organisation administrative des Etats-parties »86(*). En effet, pour la doctrine,
l'OHADA n'a pas pour ambition de modifier l'organisation judiciaire interne des
Etats-membres mais d'uniformiser le droit des affaires. La CCJA quant
à elle, estime qu'il faut reconnaître la compétence des
Etats-membres de l'OHADA vis-à-vis de leur organisation judiciaire telle
qu'organisée par chaque Etat-membre de l'OHADA. « Ainsi, en
matière de voies d'exécution, la CCJA affirme dans l'un de ses
arrêts que le critère d'identification de la juridiction
compétente en matière de saisies conservatoires et des
difficultés d'exécution est la juridiction des urgences telle que
déterminée par l'organisation judiciaire interne de chaque
Etat-membre de l'OHADA »87(*).
L'autre raison que l'on peut soulever « est
la détermination de ce qu'il faudra harmoniser. Faudra-t-il harmoniser
l'organisation des juridictions ainsi que leur fonctionnement ? « Il
est évident qu'on ne pourrait harmoniser toute l'organisation judiciaire
interne des Etats-parties. Il faudra sélectionner les juridictions
à harmoniser. La même difficulté se posera sur le plan
fonctionnel, va-t-il falloir les règles de compétence des
juridictions et les procédures ? dans ce cas, il faudrait examiner
tous les codes de procédure civiles et commerciales des Etats-parties
afin de déterminer l'ensemble des ordres de juridictions présents
des Etats-parties ainsi que leur organisation, leur compétence et leurs
modalités de saisine, etc... Ce qui serait un travail très
fastidieux »88(*).
La dernière raison justifiant cette absence
d'harmonisation de la carte judiciaire, s'explique par le fait que
l'organisation judiciaire est un domaine qui touche directement la
souveraineté de l'Etat. L'Etat est en effet souverain dans la mission
d'organisation de la justice89(*). Les règles de procédure
relèveraient selon les arguments de nature politique de la seule
compétence du souverain90(*). Dans ce cas, il serait difficile de convaincre les
Etats-parties de procéder à une telle harmonisation.
Cependant, en dépit des difficultés que
pose l'harmonisation de la carte judiciaire elle est tout de même
nécessaire. L'une des faiblesses du droit OHADA réside dans la
disparité des formes de juridictions et des procédures. En effet,
en parcourant l'organisation judiciaire des Etats-parties, on constate qu'il y
a des divergences au niveau de l'ordre judiciaire. Comme on le sait, le
contentieux relatif à l'application des Actes uniformes est
réglé en première instance et en appel par les
Etats-parties,91(*) chaque
Etats organisant l'ordre judiciaire à sa guise.
En ce qui concerne les litiges relevant des Actes
uniformes OHADA, on constate qu'il y a trois différentes organisations
des tribunaux chargés de régler les litiges commerciaux dans
l'espace OHADA. Le Tchad92(*) par exemple a créé des juridictions
commerciales. Dans la majeure partie des cas, la compétence de ces
juridictions recouvre l'ensemble des litiges pouvant naître de
l'application des actes uniformes, mais dans certains cas,
l'énumération législative est limitée, comme dans
la République Islamique des Comores. Le Niger93(*) et le
Sénégal94(*), eux, n'ont pas créé des juridictions
commerciales, mais plutôt des chambres commerciales au sein des tribunaux
de première instance. Ces chambres commerciales connaissent des litiges
rattachés aux actes uniformes OHADA. Au Togo95(*), il existe une chambre
commerciale, mais elle est rattachée à la chambre civile de sorte
qu'il existe une confusion entre elles. Le Cameroun96(*) , lui n'a ni
créé des juridictions commerciales, encore moins instauré
des chambres commerciales au sein des tribunaux. Les tribunaux de premier
degré sont compétents pour connaître de toutes les
matières civiles, sociales et commerciales. Dans ces Etats, il n'y a pas
de spécialisation des juges en matière de litiges commerciaux
englobant l'application des Actes uniformes. Ces divergences au sein des
organisations judiciaires ne sont pas attractives pour les investisseurs et ne
garantissent pas la sécurité judiciaire. Il serait souhaitable
qu'on puisse avoir une lisibilité dans tous les Etats parties des
tribunaux chargés de connaître de ces litiges au premier
degré.
A notre avis, la solution la plus avantageuse serait
d'amener les Etats qui n'ont pas de chambre commerciale au sein des
juridictions de droit commun à en créer. Cela conduirait à
une spécialisation du personnel et permettrait d'avoir une
lisibilité des juridictions de fond chargées de trancher les
litiges. Ces chambres commerciales devront aussi exister au sein des cours
d'appel, comme déjà dans la majorité des Etats-parties. Il
serait opportun aussi de dégager des principes directeurs communs de
procédures applicables devant toutes les juridictions appelées
à appliquer le droit uniforme. Le régime pourrait porter sur
l'accès au juge, sur la durée du procès raisonnable, sur
le régime d'administration judiciaire de la preuve, sur le mode
d'introduction d'instance, sur les notifications. Cette harmonisation des
principes directeurs du procès dans l'espace OHADA permettrait aux
services juridiques et aux conseils juridiques habituels des investisseurs
d'avoir une visibilité procédurale97(*). Cependant, les juges des
Etats-parties, en ne coopérant pas entre eux ne favorisent pas
l'instauration d'un véritable espace judiciaire OHADA.
Paragraphe II : L'absence de
coopération entre les juges de l'espace OHADA
Le terme « coopération » appelle quelques
précisions. Il ne s'agit pas de la coopération verticale existant
entre la CCJA et les cours de cassation nationales. Le législateur OHADA
ayant opté pour des rapports de supériorité ou de
supranationalité en privilégiant la méthode du recours en
cassation plutôt que celle du renvoi préjudiciel, la
coopération entre ces juridictions est assez faible. Ce n'est pas de
cette coopération dont nous parlerons ici, mais plutôt de la
coopération horizontale entre les juges nationaux de l'espace OHADA.
Au sein de l'OHADA, il n'existe pas d'instrument
juridique pouvant favoriser la coopération entre les juges nationaux des
Etats-parties. Il n'existe notamment pas de convention d'entraide
judiciaire98(*). Celle qui
est actuellement appliquée dans certains Etats a été
signée à Tananarive en 1961 entre les pays de l'ex-OCAM. Elle
regroupe une bonne partie des Etats-Parties à l'OHADA99(*). Certains Etats signataires de
la convention générale de coopération en matière de
justice ne sont pas membres de l'OHADA, et certains Etats membres de l'OHADA
n'y sont pas partie. Cela a pour conséquence que les juges nationaux des
Etats parties à l'OHADA évoluent en vase clos. « Il n'y
a donc pas véritablement d'espace judiciaire OHADA. Les juges
n'échangent aucune information entre eux. Aussi, il n'est pas
organisé des rencontres pour que les juges puissent échanger
leurs expériences dans l'application du droit OHADA et les
difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les seules rencontres
juridictionnelles qui sont organisées ne concernent que les cours
communautaires des différentes organisations juridictionnelles.
En Europe par exemple, de nombreux instruments visant
à favoriser la coopération judiciaire civile existent. La
convention de Bruxelles adoptée en 1968 fixait les règles en
matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution
des jugements en matière civile et commerciale, l'exécution des
jugements en matière matrimoniale (convention dite Bruxelles II) et une
autre convention relative à la notification des actes. Depuis le
Traité d'Amsterdam, ces conventions ont été
transformées en règlement. Plusieurs de ces instruments
comportent un caractère novateur par rapport à l'entraide
traditionnelle. C'est le cas de la coopération judiciaire dans
l'obtention des preuves civiles. Depuis le règlement du 28 mai 2001
entrée en vigueur le 01 juillet 2004, dans les relations communautaires,
lorsqu'un litige porté devant les tribunaux nécessite la collecte
d'un élément de preuve sur le territoire d'un autre Etat membre
de l'Union, le juge saisi peut s'adresser directement au juge du lieu où
se trouve l'élément recherché afin que celui-ci puisse
effectuer la mesure d'instruction. Aussi, pour déterminer la
compétence judiciaire, un nouveau mode de coopération a
été créé. En effet, dans le règlement
Bruxelles II bis, le juge peut décliner sa compétence et renvoyer
à une juridiction mieux placée pour connaitre de l'affaire. C'est
la théorie du « forum non conveniens ». Par ailleurs
l'obtention de titres immédiatement exécutoire pousse jusqu'au
bout le principe de reconnaissance mutuelle au point de considérer que
la décision prise par le juge d'origine est équivalente dans tous
les autres Etats membres à une décision
nationale »100(*).
Il serait opportun d'instaurer des rencontres entre
les acteurs judiciaires, les juges, les huissiers de justice, les notaires et
les avocats de l'espace OHADA, et instituer un instrument qui permettrait de
faciliter la circulation des titres exécutoires délivrés
dans les Etats-parties. La confiance dans les juges et en la justice n'en
ressortirait que renforcée, ce qui serait un pas vers la
réalisation de la sécurité judiciaire.
L'absence de spécialisation des juges dans
certains Etats-parties en matière du contentieux commercial peut
être un handicap dans la bonne interprétation et application des
dispositions du droit OHADA. Il faudrait donc qu'en plus des dispositions
théoriques des mesures concrètes soient mises pour garantir
l'effectivité du droit OHADA et son application uniforme dans tout
l'espace. Cela ne peut se réaliser que si les juges nationaux
coopèrent entre eux.
La libre circulation des décisions est la
possibilité pour chaque titre de circuler ou de produire des effets dans
les Etats requis sans procédures intermédiaires, ou en l'absence
de reconnaissance ou d'exécution. Hormis à l'article 20 du
traité OHADA précité, le législateur OHADA n'a pas
organisé la circulation des décisions de justice rendues par les
juridictions nationales des Etats parties à l'OHADA.
Section II : L'inorganisation
de la circulation des décisions judiciaires nationales
Aucune disposition n'est consacrée dans le
Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires à
la circulation des décisions judiciaires nationales et des actes
authentiques lorsqu'ils ont appliqué le droit OHADA. Cette
difficulté et l'insécurité juridique qu'elle engendre sont
irritantes lorsqu'elles persistent dans un espace dont l'objectif
affiché est l'intégration régionale. Il faut se
référer aux législations nationales pour connaître
le régime juridique de circulation des jugements (Paragraphe 1) alors
que pour l'instauration d'un véritable espace judiciaire, il faut
nécessairement que l'OHADA organise la circulation des décisions
de justice (Paragraphe 2).
Paragraphe I : L'absence de la
libre circulation des décisions de justice au sein des Etats membres
L'intention du législateur OHADA de ne pas
légiférer sur la circulation des jugements nationaux,
peut-être lue dans l'Acte uniforme OHADA relatif au transport de
marchandises par route. En effet l'article 27 alinéa 3 de cet acte
énonce que « lorsqu'un jugement rendu par une juridiction d'un
Etat-partie est devenu exécutoire dans cet Etat-partie, il devient
également exécutoire dans chacun des autres pays membres
aussitôt, après accomplissement des formalités prescrites
à cet effet dans l'Etat intéressé ». Cela signifie
que la procédure d'exequatur des décisions relatives au transport
de marchandises par route est laissée aux législations
nationales. La seule indication que le législateur donne est que les
formalités requises « ... ne peuvent comporter aucune
révision de l'affaire ». Il s'en suit une diversité de
régimes applicables à la circulation des jugements
définitifs et une insécurité juridique quant à la
circulation des jugements provisoires.
Le fait que l'OHADA ait laissé le soin aux
législateurs nationaux de règlementer les procédures de
reconnaissance et d'exécution des jugements a pour conséquence de
créer une diversité de régime de circulation, parce que
les législations nationales ne sont pas identiques. Certaines sont
souples (cas de la Guinée101(*), du Cameroun102(*)), parce que ne posant pas de conditions excessives
pour la reconnaissance et l'exécution, tandis que d'autres posent des
conditions plus sévères. En revanche, celles du Mali103(*) et du Burkina-Faso104(*) par exemple sont assez
rigides et retiennent sensiblement les mêmes conditions.
Les conditions retenues par la législation la
plus souple sont sensiblement au nombre de deux. L'une relative aux conflits de
procédure et de décisions et l'autre relative à la
contrariété à l'ordre public. Les autres conditions
prévues dans les législations rigides sont : la
compétence internationale du juge, le respect des droits de la
défense, le caractère exécutoire de la décision
dans son pays d'origine. Ces législations ont été
adoptées à une période pendant laquelle le
libéralisme des conditions d'exéquatur n'était pas encore
rependu. Par conséquent elles ne sont plus adaptées à
l'espace OHADA.
Certains Etats ne possèdent même pas de
législation sur la reconnaissance et l'exequatur des jugements ou
préfèrent tout simplement appliquer les conventions de
coopérations judiciaires. La convention la plus englobante105(*) est celle qui a
été signé à Tananarive entre les pays de l'ex-OCAM
en 1961. Or, les conditions posées dans cette convention sont rigides et
inappropriées à un espace où les règles
substantielles ont été unifiées. C'est ainsi qu'à
une ordonnance d'injonction de payer rendue au Cameroun et soumise au juge
Gabonais pour exequatur, ce dernier au lieu d'appliquer la législation
gabonaise, a appliqué les dispositions de la convention de Tananarive de
1961, dont les conditions sont toutes aussi rigides que certaines des
législations nationales. Tout cela nous amène à affirmer
qu'il faille nécessairement que l'OHADA organise la libre circulation
des décisions de justice.
Paragraphe II : Plaidoyer pour
l'instauration d'une libre circulation des décisions de justice
L'instauration de la libre circulation106(*) des décisions de
justice s'appuie sur la notion d'«espace» et postule qu'entre les
Etats-parties à l'OHADA il n'existe plus de frontières juridiques
en matière du droit des affaires. Dans un tel espace, les
décisions rendues dans un Etat doivent automatiquement produire leurs
effets dans les autres Etats parties.
L'instauration de cette libre circulation peut se
faire selon le procédé de l'Union européenne.
Premièrement, en matière d'injonction de payer, de
délivrer ou de restituer, l'ordonnance rendue par le juge devrait
être directement exécutoire sur l'ensemble des Etats-parties
à l'OHADA. Le législateur OHADA devrait de ce fait supprimer
l'exéquatur107(*)
préalable et admettre la possibilité d'exécution
immédiate une fois que le titre serait passé en force de chose
jugée.
La première raison qui justifie la suppression
d'une procédure d'exequatur pour les décisions rendues à
l'issue des procédures simplifiées de recouvrement, est le
caractère certain de la créance108(*). A la lecture de l'Acte uniforme portant
procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution
(AUPRSVE), la forte présomption, ou encore la certitude de la
créance de somme d'argent ou d'objet meuble corporel, est à la
base des procédures simplifiées de recouvrement. En effet, les
articles 1 et 19 énoncent que toute personne qui se prétend
titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible ou d'une
obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel,
peut intenter une procédure simplifiée de recouvrement. Si
à la vue des documents produits, la demande lui paraît
fondée, le président de la juridiction compétente peut
rendre soit une décision portant injonction de payer, soit ordonner la
délivrance ou la restitution du bien meuble corporel. C'est donc dire
que l'utilisation de la procédure dépend de la forte
présomption d'existence de la créance.
La procédure pourrait se dérouler comme
suit : après que la décision portant injonction de payer ou
de délivrer ait été signifiée au débiteur,
si celui-ci ne forme pas opposition dans les 15 jours à compter de la
date de la signification à personne, augmenté des délais
de distance, la décision d'injonction de payer, de délivrer ou de
restituer se transforme automatiquement en titre exécutoire, dont
l'exécution peut être poursuivie dans tous les Etats parties de
l'OHADA. Si le débiteur par contre forme opposition, la décision
d'injonction de payer, de délivrer ou de restituer rendue à
l'issue de l'opposition, deviendra un titre exécutoire OHADA,
après l'expiration des trente jours réservés à
l'appel, à compter de la date de la décision. Si dans le
délai de trente jours, le défendeur fait appel, la
décision survenue à l'issue de l'appel devient
immédiatement exécutoire dans tous les Etats-parties à
l'OHADA sans exequatur109(*).
Ensuite, lorsque le jugement a été rendu
sur la base de débats contradictoires, et que le droit OHADA a
été appliqué, la décision peut être
revêtue automatiquement de l'autorité de la chose et de la force
exécutoire dès lors qu'elle est passée en force de chose
jugée. Cela peut être appliqué, lorsque les délais
pour l'exercice des voies de recours ordinaires sont épuisés sans
que le défendeur ait exercé un recours, ou alors lorsqu'une
décision est survenue à l'issue de l'exercice des voies de
recours.
Le demandeur d'exequatur devra produire à
l'huissier ou à l'agent chargé de l'exécution dans l'Etat
requis une copie certifiée conforme ou l'original de l'acte
d'assignation à comparaître et de la notification de la
décision au défendeur, et le cas échéant, un
certificat de non appel, ou tout autre document attestant que le
défendeur n'a pas exercé de voies de recours dans le pays
d'origine. Un document attestant que la décision est exécutoire
dans son pays d'origine. Ces documents devront être annexés au
procès-verbal de saisie sous peine de nullité de la saisie. La
procédure sera donc inversée et il appartiendra à la
partie qui conteste la force exécutoire de la décision de saisir
le juge de l'exécution pour demander une mainlevée de la saisie.
L'OHADA n'est pas qu'un simple outil technique de
sécrétion du droit. Par l'institution de la CCJA, et par
l'uniformisation de certaines procédures, l'OHADA a réussi
à mettre sur pied un véritable espace judiciaire. La CCJA
à qui l'OHADA a conféré d'importants pouvoirs en
matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes, en
la matière se substitue non seulement aux juridictions suprêmes
nationales par la voie du recours en cassation, mais aussi aux juridictions
nationales de fond à travers le pouvoir d'évocation dont elle
dispose. Toutes ces attributions ont été contestées par la
doctrine parce que favorisant des rapports et les juridictions
nationales110(*).
Toujours est-il que cette hiérarchisation introduisant une structure
pyramidale au sommet de laquelle se trouve la CCJA, et à la base les
juridictions nationales de fond, contribue à l'émergence d'un
espace judiciaire OHADA. Aussi l'uniformisation des voies d'exécution
permet la pratique uniforme des procédures d'exécution sur
l'ensemble de l'espace géographique OHADA, ainsi que la force des
arrêts de la CCJA dans tout l'espace OHADA.
Conclusion chapitre II :
L'espace judiciaire OHADA est loin d'être achevé
dans la mesure où de nombreuses lacunes entravent la réalisation
de cet espace. C'est notamment le cas de l'absence d'harmonisation de la carte
judiciaire des Etats-parties et l'absence de coopération entre les juges
des Etats-parties à l'OHADA. Cette absence de coopération conduit
les juges nationaux des Etat-parties à évoluer en vase clos, ce
qui a des conséquences néfastes sur la circulation des
décisions. Si l'incitation et l'accueil des investissements est
l'objectif principal de l'OHADA, il serait alors préférable que
les institutions de l'OHADA concentrent leurs efforts sur l'essentiel. Nous
avons envie de penser à la réforme des institutions et des
procédures judiciaires garantes de la sécurité
juridique.
Conclusion de la deuxième
partie :
La sécurité judiciaire est entrée
dans l`esprit du droit de l'OHADA par effraction111(*) et peine à entrer par
conviction dans les moeurs des justiciables et des praticiens.
L'OHADA et son droit ne peuvent etre attractifs des
investissements étrangers qu'à la condition que la
sécurité judiciaire soit partagée en
copropriété par la CCJA et les juridictions nationales des Etats
parties. S'il est vrai que la sécurité juridique constitue un
critère d'attractivité des investissements étrangers, seul
la sécurité judiciaire peut en garantir la réalité
et l'efficacité. Associé à la sécurité
juridique, la sécurité judiciaire est un avantage comparatif
décisif pour l'attractivité des investissements dans un contexte
mondialisé de concurrence entre les systèmes juridiques.
Si les pouvoirs publics africains veulent vraiment que
la sécurité judiciaire ne soit pas un vain concept, le
législateur OHADA devrait de concert avec les Etats parties, prendre des
mésures adéquates et efficaces visant à faire des
institutions judiciaires la tete de pont des éléments
d'attraction des investissements dans l'espace OHADA. Le système
juridique de l'OHADA n'est pas réductible à la seule
sécurité juridique, celle-ci doit se coupler avec la
sécurité judiciaire pour qu'enfin les fruits annoncés
tiennent toute la promesse des fleurs portées par les textes du droit
substanciel harmonisé commun aux Etats parties.
CONCLUSION GENERALE
Depuis plus de deux décennies, l'importance de
l'IDE dans l'environnement économique mondial n'est plus à
démontrer tant il est de plus en plus au coeur des débats
économiques internationaux, mais aussi des politiques économiques
gouvernementales.
L'espace OHADA quant à lui, n'échappe
pas à cet engouement autour de l'attractivité des IDE. En effet,
au début des années 90 les investissements étrangers
avaient tari en Afrique subsaharienne à cause l'insécurité
juridique et l'insécurité judiciaire. Afin donc de restaurer la
confiance des investisseurs étrangers mais aussi domestiques les
pères fondateurs de l'OHADA s'accordèrent pour répondre,
par des outils juridiques et judiciaires, aux besoins de développement
de leur territoire.
Toutefois, s'il est indéniable que
d'énormes progrès ont été faits sur le chemin de la
sécurité juridique et judiciaire, d'importants efforts restent
à être accomplis afin d'attirer encore plus les investisseurs
étrangers. En effet, la sécurité juridique et judiciaire
n'est pas toujours garantie du fait des lacunes de certains Actes uniformes de
l'OHADA qui sont de nature à entraver les activités des
investisseurs. La sécurité judiciaire revêt de nombreuses
lacunes telles que l'absence de libre circulation des arrêts et jugements
dans les pays membres de l'espace OHADA. De plus le législateur OHADA
n'a pas unifié les procédures d'exécutions de ces
dernières. Aussi, sur le plan pratique, l'investisseur direct
étranger se heurte à un certain nombre d'obstacles des obstacles
dont l'exécution des décisions de justice. Il s'agit de
l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et
des obstacles liés à l'exécution des sentences arbitrales.
Toutes ces considérations sont de natures à empêcher le
recouvrement de créances par l'investisseur même muni d'une
décision de justice.
Pour être un espace prisé par les
investisseurs, l'OHADA se doit d'harmoniser le cadre des investissements. Pour
réguler le cadre des investissements de manière efficace, l'OHADA
doit au moins harmoniser plusieurs domaines du droit112(*). « En effet,
l'OHADA devrait mettre en chantier un acte uniforme relatif aux investissements
qui aura pour double objectifs d'harmoniser le droit des investissements mais
de permettre également aux Etats de se doter de codes des
investissements adaptés »113(*). Cette harmonisation permettra à l'OHADA de
développer les infrastructures nécessaires afin d'attirer et
retenir les investisseurs étrangers, mais de faire également
d'énormes efforts pour diminuer le taux de risque d'investissement dans
son espace114(*). Cet
acte uniforme sur l'investissement devra être un outil pour les Etats
Parties afin de permettre aux entreprises de : subvenir aux besoins en
fonds propres des entreprises ; d'allouer les ressources et les moyens les
plus adaptés pour la croissance et la performance ; de participer
à la définition d'une stratégie claire et à long
terme pour les entreprises ; d'orienter intelligemment les fonds des
institutions financières vers les entreprises115(*).
Par ailleurs, « l`harmonisation du droit
fiscal au sein de l'espace communautaire pourrait être un outil important
pour inciter les investisseurs à venir dans l'espace OHADA. Elle doit
concerner tous les segments du droit fiscal et passer par une harmonisation de
la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l'impôt sur les
sociétés, les impôts sur le revenu des capitaux
mobiliers...etc. Par exemple, à l'instar de l'Union Européenne,
un numéro de TVA communautaire pourrait être attribué
à chaque société évoluant au sein de l'espace OHADA
pour constituer un régime de fiscalité indirecte harmonisé
et uniformisé applicable à la consommation intérieure sur
le territoire. Par ailleurs, l'OHADA doit permettre aux Etats Parties de ne pas
se livrer à une concurrence faussée en imposant des fourchettes
d'imposition même si chaque Etat aura la latitude de fixer ses taux
d'imposition sur son territoire. L'objectif de tout investissement est de
réaliser un profit et l'impot constitue un déterminant
fondamental dans la prise de décision pour un investissement, c'est la
raison pour laquelle l'harmonisation fiscale doit s'imposer au sein de
l'OHADA»116(*).
En outre, s'il est vrai que la sécurité
juridique constitue un critère d'attractivité des investissements
étrangers117(*),
seule la sécurité judiciaire peut en garantir la
réalité et l'efficacité. Associée à la
sécurité juridique, la sécurité judiciaire est un
avantage comparatif décisif pour l'attractivité des
investissements dans un contexte mondialisé de concurrence entre les
systèmes juridiques. L'OHADA et son droit ne peuvent être
attractifs des investissements étrangers et incitateurs des
investissements domestiques qu'à la condition que le législateur
OHADA légifère sur la circulation des décisions de justice
et des titres exécutoires dans les pays membres de l'OHADA ; les
Etats membres devant harmoniser leur droit processuel à cet effet.
Pour finir, il ne suffit pas d'avoir un droit
attrayant et adapté aux besoins juridiques des investisseurs
étrangers pour attirer et retenir ces derniers. En effet, les
opérateurs économiques ne s'installent que sur les territoires
qui leur offrent les conditions matérielles et infrastructurelles
d'établissement. Malheureusement, la majorité des États de
l'espace de l'OHADA ne répondent suffisamment pas à ce
critère d'attractivité économique. « Il leur
faudrait, dans ce domaine, veiller aux mesures visant à
l'amélioration des systèmes de transport et de
télécommunication, à une mise à niveau constante
des qualifications de la main d'oeuvre ou encore à une revue du
système de contrôle des prix pour éliminer les distorsions
de concurrence. Ces conditions sont indispensables à l'accueil des
entreprises étrangères et à l'incitation au
développement des entreprises locales. En effet, les investissements ne
peuvent affluer que si les conditions favorables au rendement économique
sont réunies et répondent aux besoins des
entreprises »118(*). Par ailleurs, ceux-ci pourraient promouvoir les
atouts du droit OHADA et la confiance qu'il suscite chez les investisseurs dans
le cadre d'un programme commun de développement de l'attractivité
économique de leur territoire. Une telle initiative pourrait être
présentée aux différents salons dédiés aux
investisseurs tant privés qu'institutionnels qui se déroulent au
moins une fois par an en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe. Les
politiques d'attractivité ainsi mises en place pourraient être
conduites avec le concours de tous les acteurs institutionnels de l'OHADA et ne
devraient pas occulter les autres efforts à fournir dans d'autres
domaines tels que l'éducation, l'apprentissage et l'appropriation des
technologies de production119(*).
En somme, il apparait que l'amélioration du
climat des affaires ne se limite pas à l'unification du droit. En effet,
celle-ci exige aussi la mise en oeuvre d'actions de marketing et de promotion
des atouts de ce droit unifié120(*). Si ces actions sont efficacement menées, on
ne parlera plus seulement de l'OHADA « en
marche »121(*), mais de l'OHADA qui marche.
ANNEXES
Tableau : Flux des investissements directs
étrangers des Etats parties au Traité OHAHA en pourcentage du PIB
de 1993 à 2019
|
P
A
|
Bénin
|
BF
|
Cam.
|
Com.
|
RDC
|
RC
|
C.I
|
Gab.
|
Guin.
|
Gui.E.
|
Gui.B.
|
Mali
|
Niger
|
R.Cent.
|
Séné.
|
Tchad
|
togo
|
|
1993
|
-1
|
0,1
|
0
|
0
|
0,1
|
10,7
|
1,6
|
-2,6
|
0,1
|
16,4
|
1,4
|
6,1
|
-1,1
|
-0,8
|
0
|
1
|
-1,5
|
|
1994
|
-0,4
|
1
|
0
|
0,1
|
0
|
0,2
|
1,4
|
-2,4
|
0
|
16,9
|
0,2
|
0,8
|
0,2
|
0,4
|
1,3
|
2,3
|
-0,3
|
|
1995
|
-0,4
|
0,4
|
0,1
|
0,2
|
-0,4
|
5,3
|
1,9
|
-3,9
|
0
|
89,5
|
0
|
4,1
|
0,1
|
0,6
|
0,5
|
2,3
|
-0,6
|
|
1996
|
-0,6
|
0,6
|
0,9
|
0,1
|
0,4
|
2,5
|
1,5
|
-5
|
0,6
|
161,8
|
0,4
|
1
|
0,4
|
1,1
|
0,2
|
2,5
|
0,2
|
|
1997
|
0,5
|
0,4
|
1,4
|
0
|
-0,7
|
-2,1
|
2,3
|
-2,2
|
0,7
|
12,1
|
4,3
|
2,8
|
0,8
|
0,2
|
3
|
2,9
|
0,8
|
|
1998
|
0,5
|
0,2
|
0,5
|
0,1
|
1
|
-8,7
|
3,9
|
3
|
0,5
|
74,1
|
2,1
|
0,3
|
-0,1
|
0,8
|
1,1
|
1,2
|
0,7
|
|
1999
|
0,3
|
0,2
|
0,3
|
0,1
|
0,2
|
-2,9
|
1,2
|
1,9
|
1,8
|
24,8
|
0,3
|
0,9
|
0,1
|
0,6
|
2,5
|
1,6
|
1
|
|
2000
|
-0,4
|
0,8
|
1,5
|
0
|
0,5
|
-3
|
1,4
|
5,5
|
0,3
|
14,8
|
0,2
|
2
|
0,7
|
0,1
|
1,4
|
8,3
|
3,5
|
|
2001
|
0,5
|
0,2
|
-0,1
|
0,3
|
1,4
|
-4,8
|
1,6
|
-2
|
0,1
|
64,4
|
0,1
|
6
|
0,9
|
0,6
|
0,7
|
26,9
|
4,9
|
|
2002
|
-0,5
|
0,4
|
4,1
|
0,1
|
2,1
|
6,6
|
1,2
|
0
|
1
|
17,9
|
0,8
|
-0,3
|
0,3
|
0,6
|
1,2
|
46,3
|
3,4
|
|
2003
|
0,2
|
0,6
|
2,1
|
0,1
|
4,4
|
6,3
|
0,8
|
1,5
|
2,3
|
27,8
|
0,8
|
1,5
|
0,5
|
1
|
1
|
26
|
2,2
|
|
2004
|
-0,7
|
0,3
|
0,4
|
0,1
|
4
|
1,9
|
1,2
|
4
|
2,7
|
7,7
|
0,4
|
1,6
|
0,6
|
1,2
|
1,4
|
10,6
|
3,5
|
|
2005
|
-0,1
|
0,8
|
0,6
|
0,1
|
1,5
|
12
|
1,5
|
3,4
|
3,6
|
9,4
|
1,5
|
2,6
|
1,1
|
0,8
|
1,5
|
-1,5
|
4,2
|
|
2006
|
-0,2
|
1,3
|
0,3
|
0,1
|
1,8
|
18,4
|
1,4
|
2,6
|
3
|
4,7
|
3
|
2,1
|
0,8
|
2,4
|
2,5
|
-3,7
|
3,9
|
|
2007
|
1,7
|
0,3
|
0,8
|
1
|
10,8
|
16,2
|
1,5
|
5,3
|
6,1
|
9,5
|
2,7
|
2,5
|
1,7
|
3,3
|
2,5
|
-3,7
|
2,3
|
|
2008
|
0,5
|
0,4
|
0,1
|
0,5
|
8,7
|
16,7
|
1,4
|
4,5
|
5,5
|
-4
|
0,8
|
2,7
|
3,9
|
5,9
|
2,7
|
4,5
|
1,5
|
|
2009
|
-0,2
|
0,6
|
2,7
|
1,5
|
-1,3
|
12,2
|
1
|
1,2
|
5,2
|
1,4
|
10,9
|
2,3
|
6,3
|
8,6
|
2,1
|
2,1
|
4
|
|
2010
|
0,6
|
0,4
|
1,9
|
0,9
|
12,7
|
11,6
|
1
|
3,6
|
1,5
|
16,8
|
3,1
|
3,5
|
10,1
|
2,9
|
1,7
|
2,9
|
3,6
|
|
2011
|
1,5
|
1,2
|
2,1
|
2,3
|
6,2
|
1,9
|
0,8
|
6,2
|
14,1
|
9,2
|
2,3
|
4,3
|
12,2
|
1,5
|
1,9
|
2,3
|
18,8
|
|
2012
|
2,5
|
2,6
|
1,7
|
1
|
9,9
|
-0,4
|
0,9
|
3,9
|
7,9
|
4,4
|
0,7
|
3,2
|
8,9
|
2,8
|
1,6
|
4,7
|
3,1
|
|
2013
|
2,9
|
3,6
|
1,6
|
0,4
|
5,2
|
10,1
|
1
|
1,8
|
0
|
2,7
|
1,9
|
2,3
|
7
|
0,1
|
1,6
|
4
|
4,2
|
|
2014
|
3,1
|
2,6
|
2
|
0,4
|
4,2
|
16,1
|
1,2
|
6,9
|
-0,8
|
0,8
|
2,7
|
1
|
7,6
|
0,2
|
2
|
-4,8
|
1,2
|
|
2015
|
1,3
|
2
|
2,2
|
0,5
|
3,1
|
36
|
1,1
|
0,3
|
0,6
|
1,8
|
1,8
|
2,1
|
5,5
|
0,2
|
2,3
|
5,1
|
6,2
|
|
2016
|
1,1
|
3
|
2
|
0,4
|
2,5
|
0,5
|
1,2
|
8,9
|
18,8
|
0,5
|
1,2
|
2,5
|
2,9
|
0,4
|
2,5
|
2,4
|
-2,8
|
|
2017
|
1,6
|
0
|
2,3
|
0,4
|
2,8
|
39,8
|
1,9
|
8,8
|
5,6
|
2,5
|
1,2
|
3,6
|
3
|
0,3
|
2,8
|
3,6
|
1,4
|
|
2018
|
1,4
|
1,7
|
1,9
|
0,5
|
3
|
31,6
|
1,1
|
8,2
|
3
|
3
|
1,4
|
2,7
|
3,6
|
0,8
|
3,7
|
4,1
|
-2,5
|
|
2019
|
1,5
|
1
|
2,6
|
0,3
|
2,7
|
26,4
|
1,5
|
9,2
|
0,3
|
4
|
5
|
2,9
|
5,6
|
1,2
|
4,2
|
5
|
4,8
|
Source de données : Banque
mondiale
L'analyse de ce tableau permet de constater que
l'évolution des IDE dans l'espace OHADA ne présente pas une
tendance à la hausse régulière.La tendance principale des
flux d'IDE à destination de l'OHADA est une évolution en dent de
scie.
Aussi les variations cycliques sont presque identiques pour
tous les pays de l'espace OHADA. Les quelques pays qui tirent leur
épingle du jeu sont la République du Congo, la Guinnée
Equatoriale, le Tchad ou encore le Niger.
Evolution de l'entrée nette des IDE en
pourcentage du PIB pour les 17 pays membres de l'espace OHADA de 1993 à
2019
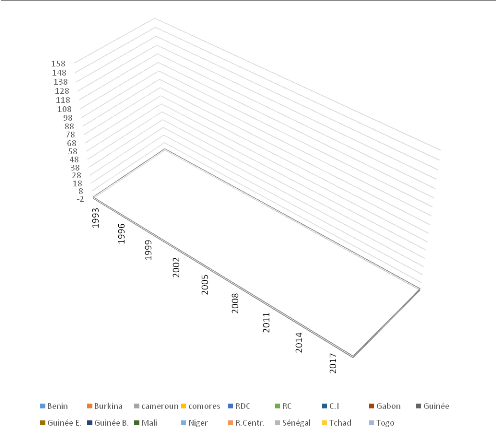
Source : Données de la Banque
mondiale.
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES
ATCHOUKEU Brice, NGWE
Marie-Andrée, BLACK YONDO Lionel, et al.,
Guide pour la modernisation du Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier et des fichiers dans l'espace OHADA (RCCM), éd.
Société Financière Internationale, (s.d), 186p.
ANOUKAHA François,
CISSE Abdoulaye, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM
Josette, POUGOUE Paul-Gérard, et al.,
OHADA-Sociétés commerciales et GIE, Bruxelles, Bruylant,
2002, 589 p.
BOULOUIS Jean, Droit institutionnel des
communautés européennes, 2ème édition,
Paris, Montchrestien, 1990, 321 p.
BOY Laurence, RACINE
Jean-Baptiste et SIIRIAINEN Fabrice (dir),
Sécurité juridique et droit économique, coll.
« Droit, économie, international », Bruxelles,
Larcier, 2008, 586p.
CADIET Loïc, NORMAND
Jacques et AMRANI-MEKKI Soraya, Théorie
générale du procès, Paris, PUF, 2010, 1024 p.
CHARVIN Robert, Investissement
international et droit au développement, Paris, L'Harmattan, 2002,
203 p.
FOUCHARD Philippe, GAILLARD
Emmanuel, GOLDMAN Berthold, Traité de l'arbitrage
commercial international, Paris, LexisNexis, 1996, 1225p.
GARINOT Jean-Marie, Le secret des
affaires, Paris, LexisNexis, 1ère éd., vol.
41,2013, 404 p.
GUINCHARD Serge et DEBARD
Thierry, Lexique des termes juridiques 2018-2019, Paris, Dalloz,
26ème édition, 2018, 1163 p.
KUATE TAMEGHE Sylvain Sorel, La
protection du débiteur dans les procédures individuelles
d'exécution, Paris, L'Harmattan, 2005, 458 p.
MOTULSKY Henri, Pour une
délimitation plus précise de l'autorité de la chose
jugée en matière civile, Dalloz - Sirey, 1958, chron. 1,
reprod. Ecrits. Etudes et notes de procédure civile, Paris, Dalloz,
2009, 392p.
POUGOUE Paul-Gérard,
L'Attractivité économique du droit OHADA, in
encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, 2275p.
ROUBIER Paul, Théorie
générale du droit. Histoire des doctrines juridique et
philosophie des valeurs sociales, Sirey,2e éd., 1951, 337p.
SAGAERTVincent, « Le régime
du droit des sûretés de l'OHADA : quelques observations
comparatives », in Le droit de l'OHADA : son insertion en
République Démocratique du Congo, Bruxelles, Bruylant, 2012, 354
p.
SAYEGH Joseph ISSA,
LOHOUES-OBLE Jacqueline, OHADA, Harmonisation du droit des
affaires, Bruxelles, Bruylant, 2002, 245p.
II- THESES ET MEMOIRES
BOKUNGU Roger, L'effet abrogatoire des
actes uniformes de l'OHADA. Principe et zones d`ombres, Mémoire de
master en droit, université catholique du Congo, 2016, 30 p.
FALL Cheick Lo, La protection juridique
des investissements directs étrangers dans les pays en
développement : l'exemple de l'Afrique de l'ouest,
Thèse de doctorat de la faculté de l'université de
Bordeaux, 2018, 721p.
KEREFrance, Les problématiques
juridiques liées à l'implantation des sociétés
étrangères dans l'espace OHADA, Thèse en
préparation à Bordeaux, dans le cadre de l'Ecole doctorale en
droit, en partenariat avec l'Institut de recherche en droit des affaires et
patrimoine depuis le 31-10-2016.
MKIMER Laila, Les effets des
investissements directs étrangers sur la croissance des pays
méditerranéens, Master 2 recherche macroéconomique,
Université Sud Toulon Var-, 2009, 68p.
NDI Evelyne Patience Memphil,
Attractivité économique des investissements directs
étrangers en zone CEMAC : harmonisation des instruments juridiques aux
règles internationales, Thèse pour le Doctorat en Droit,
Université Nice Sophia Antipolis, 2015, 380p.
NGNIDJIO TSAPI Marlize Elodie,
L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace
OHADA, Mémoire de maitrise en droit, Université de Dschang,
2009, 97 p.
PIAZZON Thomas, La sécurité
juridique, Coll. de thèses, Droit et notariat, t. 35, Paris,
éd. Defrenois, Lextenso, 2009, 630 p.
TJOUEN Alex-François, Les rapports
entre les juridictions suprêmes nationales et la Cour Commune de Justice
et d'Arbitrage de l'Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA), Thèse de doctorat en droit privé, Lille, 2006,
420 p.
III- ARTICLES ET COMMUNICATION
AVOM Désiré, ONGO
NKOUA Bruno Emmanuel, « Foreign Direct Investment in Central
Africa : what are the Relevant Determinants ? An empirical
investigation », African integration and Development Review,
august 2013, vol6.N°2 p.29-47.
AGBODJAN Prince Hervé,
« Quelle place réserver à l'investissement direct
étranger dans le droit OHADA ? Réflexions à partir
des expériences européenne et
nord-américaines », Bulletin de droit
économique, 2017, p.3.
AKUE Michel Akouété,
« Organisation judiciaire du Togo », p. 4, en ligne :
https://www.ohada.com , consulté le 25 janvier 2021 à 10h31.
ALGADI Aziber Seïd, «
L'attractivité contractuelle du droit des procédures collectives
de l'espace OHADA », Droit & Expertise, 3 octobre 2012, p.8.
ANOUKAHA François, « L'OHADA
en marche », 2002, p.1 et 7, Ohadata D-04-36.
Banque mondiale, Investissements
étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants), en
ligne : https://donnees.banquemondiale.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD ,
consulté le 21 juin 2021 à 08h10.
BISSOON Ourvashi, « Can better
institutions attract more Foreign Direct Investment (FDI) ? Evidence from
developing countries», Journal of European Economy, vol.11, 2012,
p.38-61.
Cabinet d'Avocats Maitres JANDJO et
KOÏTA, N'DIAYE Alioune, « organisation judiciaire du
Sénégal », p.10, en ligne : https://www.ohada.com ,
consulté le 25 janvier 2021 à 9h25.
CISSEAbdoulaye, « L'harmonisation
du droit des affaires en Afrique : l'expérience de l'OHADA à
l'épreuve de sa première décennie », Revue
internationale de droit économique, 2004, p.199.
COUSIN Barthélemy et
CARTRON Aude-Marie., « la fiabilisation des
systèmes judiciaires nationaux : un effet secondaire méconnu de
l'OHADA », p.4, Ohadata D-03-30.
ETOUNDI Félix Onana, L'OHADA et la
sécurité juridique et judiciaire, vecteur de
développement, 22e Congrès international des huissiers de
justice, UIHJ, Madrid, 2-5 juin 2015, p.1.
DJE Patricia, « Les
déterminants des investissements directs étrangers dans les pays
en développement : leçons pour l'UEMOA », Document
d'Etude et de Recherche, N° DER/07/03, BCEAO, septembre 2007, p.4.
GUYON Yves,
« Conclusion », in Petites affiches : le quotidien
juridique, n° 205, 13octobre 2004, p.59.
« Investissement : sécurité
juridique, l'autre enjeu pour le climat des affaires en Afrique », La
Tribune Afrique, en ligne :
https://afrique.latribune.frfinances/investissement/2017-12-15/investissement-securite-juridique-l-autre-enjeu-pour-le-climat-des-affaires-en-afrique-761929.html
, consulté le 03 juillet à 10h06.
KAMGA Joseph, « Réflexions
concrètes sur les aspects judiciaires de l'attractivité
économique du système juridique de l'OHADA », revue
des juristes de sciences PO, n°5, 2005, p.31, Ohadata D-12-85.
KALIEU ELONGO Rachel Yvette, «
organisation judiciaire du Cameroun », p.5 et 7, en ligne :
https://www.ohada.com , consulté le 25 janvier 2021 10h43.
KAMGA Joseph, « L'apport du droit
de l'OHADA à l'attractivité des investissements étrangers
dans les Etats parties », Revue des Juristes de Sciences Po,
n°5, 2012, p.49 et 51.
KAYUDI MISAMU Coco, « Actes
uniformes et la sécurité des investissements : quelles
réalités dans l'espace OHADA ? Une sécurité
réelle mais une effectivité contrainte », Grenoble,
2017, p.2 et 7.
Les investissements étrangers dans l'espace
OHADA : brèves réflexions pour une meilleure
attractivité , Le blog de Maitre Daouda BA, en ligne
https://blogavocat.fr/space/daouda.ba/contentles-investissements-dans-%C3%A9trangers-dans-m-%E2%80%99espace-ohada-br%C3%A8ves-r%C3%A9flexions-pour-une-meilleure-attractivit%C3%A9_
consulté le 21 juin 2021 à 07h30.
MADJENOUN Jocelyn, « organisation
judiciaire du Tchad », p.12, en ligne : https://www.ohada.com ,
consulté le 25 janvier 2021 à 9h12.
MASAMBA Roger, « L'OHADA et le
climat des d'investissement en Afrique », Penant,
n°855, Avril-juin 2006, p.137 et 142, Ohadata D-06-49.
MASAMBA Roger, « Avantages comparatifs
des Actes uniformes de l'OHADA », Penant, n° 869, 2009, p.
501.
MBAYE Kéba, « Avant-propos sur
l'OHADA », numéro spécial sur l'OHADA, Penant,
n°827,1998, p.125.
MENETREY Séverine, « La
place de l'investissement dans l'OHADA », article publié in
Questions de droit économique : les défis des Etats africains,
Bruxelles, Larcier, 2011, 440.p, Ohadata D-13-37, p.8.
MEYER Pierre, « La
sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA »,
Penant, n°855, avril-juin 2006, p.151, (disponible sur Ohadata
D-06-50).
NGONO Véronique Carole,
« Réflexions sur l'espace judiciaire OHADA »,
Revue de l'ERSUMA, n°6, janvier 2016, p.20 et 26, Ohadata
D-15-14
NIANG Bira Lo, « L'immunité
d'exécution à la lumière de la jurisprudence de la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA », RAMReS,
2019, p.124.
OHADA : trois questions à Renaud BEAUCHARD, en
ligne : https://www.ihej.org , consulté le 12 décembre 2020
à 17h10.
POUGOUE Paul-Gérard,
« L'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des
contrats : les tribulations d'un universitaire », p.8, Ohadata
D-07-41.
TALFI Bachir, « organisation
judiciaire du Niger », p.9, en ligne : https://www.ohada.com ,
consulté le 25 janvier 2021 à 9h20.
TCHAKOUA Jean-Marie, « L'espace dans le
système d'arbitrage de la Cour Commune de justice et d'Arbitrage »,
Penant, janvier-Mars 2005, p 842.
TEYSSIE Bernard, « L'impératif de
sécurité juridique », in Le monde du droit, Écrits
rédigés en l'honneur de Jacques Boyer, Économica, 2008,
p.986.
IV- LEGISLATION
A- LOIS
Loi 22-99 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure
civile (promulguée par le décret 99-244 du 9 juillet 1999, J.0.
BF. N°3 spécial du 15 juillet 1999, p.2).
Loi N° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du
contentieux de l'exécution et fixant les conditions de
l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes
publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères.
B- DECRETS
Décret D/98/N° 100/PRG/SGG du 16 juin 1998 portant
code de procédure civile économique et administrative de la
république de Guinée.
Décret N°99-254/P-RM du 15 septembre 1999 portant
Code de procédure civile commerciale et sociale du Mali.
C- TEXTES COMMUNAUTAIRES
Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution,
adopté à Libreville (Gabon) le 10 avril 1998 et entré en
vigueur le 10 juillet 1998.
Acte uniforme révisé portant sur le droit
commercial général adopté à Lomé (Togo) le
15/12/2010 et publié au journal officiel de l'OHADA n°21 du
15/02/2011.
Acte uniforme révisé portant organisation des
sûretés adopté à Lomé (Togo) le 15/12/2010 et
publié au journal officiel de l'OHADA n°22 du 15/02/11.
Acte uniforme révisé relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique adopté à Ouagadougou (Burkina Faso) le
30/01/2014 et publié au Journal Officiel de l'OHADA n°
Spécial du 04/02/2014.
Acte uniforme portant organisation des procédures
collectives d'apurement du passif adopté à Grand-Bassam (Cote
d'Ivoire) le 10/09/2015 et publié au Journal officiel de l'OHADA n°
Spécial du 25/09/2015.
Traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique (OHADA), adopté le 17 octobre 1993 à
Port-Louis (iles Maurice), J.O. OHADA, n° 4, 1er nov. 1997.
Traité portant révision du Traité relatif
à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires en Afrique
adopté le 17/10/2008 à Québec (Canada) et publié au
journal officiel de l'OHADA n°20 du 01/11/2009.
V- JURISPRUDENCE
CCJA, 11 octobre 2001, arrêt n°002/2001 :
époux Karnib c/ Société Général de
Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI), Ohadata J-02-06.
CCJA, 10 janvier 2002, arrêt n°3,
Société ivoirienne d'emballage métallique dite SIEM c/
Sté ATOU et BICICI, Ohadata J-02-25.
CCJA, 19 juin 2003, arrêts n°012/2003,
n°013/2003 et n°014/2003.
TPI Bafoussan, 28 janvier 2004, ord. de
référé n° 37, SNEC SA c/ Djeukou Joseph, Ohadata
J-05-01.
TPI Bouaké, 23 juin 2005, n° 105, Institut
National Polytechnique Houphouët Boigny c/ Mian Assa Séraphin.
CCJA, 7 juillet 2005, arrêt n° 43/2005 : Aziablevi
Yovo et autres c/ Société Togo Télécom, recueil de
jurisprudence de la CCJA, n°6, juin-décembre 2005, p.25.
TPI de Bafoussam, 16 juin 2006, n° 84/Civ., Affaire Sagne
Boubou Cylaine C/ First Trust Savings and Loan, Ohadata J-07-61.
CCJA, 29 juin 2006, arrêt n° 15 du, Affaire C.D c/
Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, Le
Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 22, Ohadata J-07-29.
CCJA, 1er février 2007, arrêt n°004/2007,
pourvoi n° 021/2004/PC du 16/02/2004, Affaire : MAMBO Serges Henri
Séraphin c/ Société SAGA-CI, Recueil de Jurisprudence
n° 9 - Janvier/Juin 2007, p. 5.
CCJA, 13 mars 2014, arrêt n° 024/2014, pourvoi
n°022/2008/PC du 21 avril 2008 : KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18
autres c/Société TOGO-PORT dite port autonome de Lomé,
Ohadata J-15-115.
CCJA, 18 mars 2016, arrêt n° 44/2016,
pourvoi : n°153/2012/PC du 02 novembre 2012 : GNANKOU GOTH
Philippe c/ FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER dit « FER » ;
Société EOBANK Cote d'Ivoire.
CCJA, 26 avril 2018, arrêt n° 103/2018 : MBULU
MUSECO c/ La Société des Grands Hôtels du Congo SA et 10
autres.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
I
REMERCIEMENTS
II
LISTES DES ABREVIATIONS
III
SOMMAIRE
IV
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : LA SECURITE JURIDIQUE DES
INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
7
CHAPITRE I : L'APPORT DU DROIT OHADA DANS LA
SECURISATION JURIDIQUE DES IDE
9
Section I : L'accessibilité
matérielle et intellectuelle aux sources du droit
économique
10
Paragraphe I : L'accessibilité
matérielle
10
Paragraphe II : L'accessibilité
intellectuelle
11
Section II : Les actes uniformes OHADA :
normes attractives des IDE
12
Paragraphe I : La création et le
fonctionnement des sociétés commerciales en droit
OHADA
13
Paragraphe II : La fin de
l'entreprise
16
CHAPITRE II : L'IMPRECISION DES ACTES
UNIFORMES, SOURCE D'INSECURITE JURIDIQUE DES IDE
19
Section I : L'Acte Uniforme relatif au Droit
Commercial Général (AUDCG)
19
Paragraphe I : Le principe d'immatriculation
au RCCM
19
Paragraphe II : L'informatisation du RCCM et
la protection des données à caractère
personnel
21
Section II : L'Acte uniforme relatif au
droit des procédures simplifiées de recouvrement et de voies
d'exécutions (AUPSRVE)
23
Paragraphe I : Le principe d'immunité
des personnes morales de droit public
23
Paragraphe II : Les défenses à
exécution
26
DEUXIEME PARTIE : LA SECURITE
JUDICIAIRE DES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX
30
CHAPITRE I : LES ACQUIS DE LA SECURITE
JUDICIAIRE DANS L'ESPACE OHADA
31
Section I : Les fondements de la
sécurité judiciaire dans les textes de l'OHADA
31
Paragraphe I : La
sécurité judiciaire dans le droit primaire OHADA
31
Paragraphe II : La
sécurité judiciaire dans le droit dérivé
OHADA
33
Section II : Les manifestations de la
sécurité judiciaire dans l'espace OHADA
35
Paragraphe I : En amont de l'acte
juridictionnel
36
Paragraphe II : En aval de l'acte
juridictionnel
37
CHAPITRE II : LE CARACTERE PERFECTIBLE
DE L'ESPACE JUDICIAIRE OHADA
41
Section I : Le cloisonnement des
systèmes judiciaires des Etats-parties à l'OHADA
41
Paragraphe I : L'absence
d'harmonisation de la carte judiciaire et des procédures judiciaires
OHADA
41
Paragraphe II : L'absence de
coopération entre les juges de l'espace OHADA
44
Section II : L'inorganisation de la
circulation des décisions judiciaires nationales
46
Paragraphe I : L'absence de la libre
circulation des décisions de justice au sein des Etats
membres
47
Paragraphe II : Plaidoyer pour
l'instauration d'une libre circulation des décisions de
justice
48
CONCLUSION GENERALE
53
ANNEXES
57
BIBLIOGRAPHIE
61
* 1Patricia DJE,
« Les déterminants des investissements directs
étrangers dans les pays en développement : leçons
pour l'UEMOA », Document d'Etude et de Recherche, N° DER/07/03,
BCEAO, septembre 2007, p.4.
* 2 Traité relatif
à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA),
adopté le 17 octobre 1993 à Port-Louis (iles Maurice), J.O.
OHADA, n° 4, 1er nov. 1997.
* 3 Jean BOULOUIS, Droit
institutionnel des communautés européennes, Paris,
Montchrestien , 2ème édition, 1990, p.196.
* 4 Ibid.
* 5 Prince Hervé
AGBODJAN, « Quelle place réserver à l'investissement
direct étranger dans le droit OHADA ? Réflexions à
partir des expériences européenne et
nord-américaines », Bulletin de droit
économique, 2017, p.3.
* 6 Kéba MBAYE, «
Avant-propos sur l'OHADA », numéro spécial sur l'OHADA,
Penant, n°827, 1998, p.125.
* 7 Aziber Seïd ALGADI,
« L'attractivité contractuelle du droit des procédures
collectives de l'espace OHADA », Droit & Expertise, 3 octobre
2012, p.8.
* 8 Evelyne Patience Memphil
NDI, Attractivité économique des investissements directs
étrangers en zone CEMAC : harmonisation des instruments juridiques aux
règles internationales, Thèse pour le Doctorat en Droit,
Université Nice Sophia Antipolis, 2015, p29.
* 9 Laila MKIMER, Les
effets des investissements directs étrangers sur la croissance des pays
méditerranéens, Master 2 recherche macroéconomique,
Université Sud Toulon Var-, 2009, p.7.
* 10 Un investissement de
portefeuille est l'acquisition d'obligations ou d'actions pour un motif
financier.
* 11 Voir par exempleBISSOON
Ourvashi, « Can better institutions attract more Foreign Direct
Investment (FDI) ? Evidence from developing countries», Journal
of European Economy, vol.11, 2012, p.38-61; AVOM Désiré,
ONGO NKOUA Bruno Emmanuel, « Foreign Direct Investment in Central
Africa : what are the Relevant Determinants ? An empirical
investigation », African integration and Development Review,
august 2013, vol6.N°2 p.29-47.
* 12Cheick Lo Fall, La
protection juridique des investissements directs étrangers dans les pays
en développement : l'exemple de l'Afrique de l'ouest,
Thèse de doctorat de la faculté de l'université de
Bordeaux, 2018, 721p.
* 13Ibid., p.32.
* 14 François
ANOUKAHA, « L'OHADA en marche», 2002, p.7, Ohadata D-04-36.
* 15 Par exemple en 2019, la
valeur des IDE entrants au Burkina Faso était de 162,97 millions $, du
Benin: 218,21 millions $, et celui du Niger: 717,5 millions $. Par contre celle
de l'Afrique du Sud était de 5116, 10 millions $ et celle du
Nigéria: 2305,10 millions $. Voir, la Banque Mondiale, Investissements
étrangers directs, entrées nettes (BDP, $ US courants), en ligne:
https://donnees.banquemondiale.org/BX.KLT.DINV.WD
, consulté le 21 juin 2021 à 08h10.
* 16
« Investissement : sécurité juridique, l'autre
enjeu pour le climat des affaires en Afrique », La Tribune Afrique,
en ligne :
https://afrique.latribune.frfinances/investissement/2017-12-15/investissement-securite-juridique-l-autre-enjeu-pour-le-climat-des-affaires-en-afrique-761929.html
, consulté le 03 juillet à 10h06.
* 17 Serge GUINCHARD et
Thierry DEBARD, Lexique des termes juridiques 2018-2019,
26ème édition, Paris, Dalloz, 2018, p998.
* 18 Roger MASAMBA,
« L'OHADA et le climat des d'investissement en Afrique »,
Penant, n°855, Avril-juin 2006, p.137 et 142, Ohadata D-06-49.
* 19Félix Onana
ETOUNDI, L'OHADA et la sécurité juridique et judiciaire,
vecteur de développement, 22ème Congrès
international des huissiers de justice, UIHJ, Madrid, 2-5 juin 2015, p.1.
* 20 Bernard TEYSSIE,
« L'impératif de sécurité juridique», Le
monde du droit, écrits rédigés en l'honneur de
Jacques BOYER, Economica, 2008, p.986.
* 21 Paul ROUBIER,
Théorie générale du droit. Histoire des doctrines
juridiques et philosophie des valeurs sociales, 2ème
éd., Sirey, 1951, p.269.
* 22Thomas PIAZZON, La
sécurité juridique, Coll. de thèses, Droit et
notariat, t. 35, Paris, éd. Defrenois, Lextenso, 2009, p.84.
* 23 L'accessibilité
c'est la possibilité pour les sujets de droit de connaitre les
règles applicables de sorte à agir en connaissance de cause.
* 24 François
ANOUKAHA, Abdoulaye CISSE, Ndiaw DIOUF, Josette NGUEBOU TOUKAM,
Paul-Gérard POUGOUE, et al., OHADA-Sociétés
commerciales et GIE, Bruxelles, Bruylant, 2002, 589p.
* 25L'OHADA est ouverte
à tous les Etats membre de l'Union Africaine.
* 26Roger BOKUNGU,
L'effet abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA. Principe et zones
d`ombres, Mémoire de master en droit, université catholique
du Congo, 2016, p20.
* 27 Pierre MEYER,
« La sécurité juridique et judiciaire dans l'espace
OHADA », Penant, n°855, avril-juin 2006, p.151,
(disponible sur Ohadata D-06-50).
* 28Coco KAYUDI MISAMU,
« Actes uniformes et la sécurité des investissements :
quelles réalités dans l'espace OHADA ? Une
sécurité réelle mais une effectivité
contrainte », Grenoble, 2017, p.2.
* 29Séverine
MENETREY, « La place de l'investissement dans l'OHADA »,
article publié in Questions de droit économique : les
défis des Etats africains, Bruxelles, Larcier, 2011, 440.p, (voir
Ohadata D-13-37, p.8).
* 30 Voir Barthélemy
COUSIN et Aude-Marie CARTON, « la fiabilisation des systèmes
judiciaires nationaux : un effet secondaire méconnu de l'OHADA »,
p.4, Ohadata D-03-30.
* 31 La possibilité
d'opérer comme agent des suretés est limitée aux
institutions financières et aux établissement de crédit,
nationaux ou étrangers.
* 32Vincent SAGAERT,
« Le régime du droit des sûretés de
l'OHADA : quelques observations comparatives », in Le droit
de l'OHADA : son insertion en République
Démocratique du Congo, Bruxelles, Bruylant, 2012, p.212.
* 33 Coco KAYUDI MISAMU,
op.cit., p.7.
* 34 Sylvain Sorel KUATE
TAMEGHE, La protection du débiteur dans les procédures
individuelles d'exécution, Paris, L'Harmattan, 2005, p.27.
* 35 Les saisies
étaient irrégulières pour plusieurs raisons, notamment
parce qu'elles étaient diligentées en l'absence de titre
exécutoire.
* 36La procédure
d'alerte est un ensemble de mesures prises par le commissaire aux comptes ou
par les associés afin d'attirer l'attention sur certains dangers qui
menacent l'entreprise.
* 37 C'est une
procédure ouverte au débiiteur qui sans etre en cessation de
paiements, justifie de difficultés financières ou
économiques sérieuse (voir article 6 de l'AUPCAP).
* 38Elle vise à
favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux
créanciers ainsi que le cas échéant ses contractants
habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux
difficultés de l'entreprise (voir article 5-5 de l'AUPCAP).
* 39 Une entreprise en
cessation de paiements est celle-là qui se trouve dans
l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son
passif disponible.
* 40 Elle est une
procédure qui vise à sauvegarder l'entreprise et apurer son
passif au moyen d'un concordat de redressement.
* 41 Elle consiste à
réaliser l'actif du débiteur afin d'apurer son passif.
* 42 Voir article 200 de
l'AUDSC/GIE.
* 43 La
société est constituée pour une durée et la
durée maximale est de 99 ans. Il va de soi donc, que lorsque la
société est constituée pour une durée moindre (10
ans par exemple), qu'elle puisse prendre fin à l'expiration de ce
délai.
* 44 Il y'a
réalisation de l'objet lorsque l'opération pour laquelle la
société a été créée a
été entièrement réalisée. Il y'a extinction
de l'objet lorsqu'en raison d'un obstacle, la société ne peut
plus exercer son activité.
* 45 Lorsque la
société est annulée pour non-respect des conditions de
formation, il y'a dissolution de celle-ci.
* 46Abdoulaye CISSE,
« L'harmonisation du droit des affaires en Afrique :
l'expérience de l'OHADA à l'épreuve de sa première
décennie », Revue internationale de droit
économique, 2004, p.199.
* 47Article 1er
du Traité OHADA.
* 48Voir articles 34 et 35
de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit
commercial général.
* 49 Coco KAYUDI MISAMU,
op.cit., p.7.
* 50 Ibid.
* 51 Article 36 de
l'AUDCG.
* 52Marlize Elodie NGINDJO
TSAPI, L'information de l'acquéreur des titres sociaux dans l'espace
OHADA, Mémoire de maitrise en droit, Université de Dschang,
2009, p.17.
* 53 Brice ATCHOUKEU,
Marie-Andrée NGWE, Lionel BLACK YONDO, et al., Guide pour la
modernisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et des
fichiers dans l'espace OHADA (RCCM), éd. Société
Financière Internationale, (s.d), p.11.
* 54Dans le cas
d'espèce les données à caractère personnel
désignent l'identification du commerçant personne physique.
* 55Article 30 alinéa
1 de l'AUVE.
* 56 TPI Bafoussan, 28
janvier 2004, ord. de référé n° 37, SNEC SA c/
Djeukou Joseph, Ohadata J-05-01.
* 57 TPI Bouaké, 23
juin 2005, n° 105, Institut National Polytechnique Houphouët Boigny
c/ Mian Assa Séraphin.
* 58 CCJA, 7 juillet 2005,
arrêt n° 43/2005 : Aziablevi Yovo et autres c/ Société
Togo Télécom, recueil de jurisprudence de la CCJA, n°6,
juin-décembre 2005, p.25.
* 59 Ibid.
* 60 CCJA, 13 mars 2014,
arrêt n° 024/2014, pourvoi n°022/2008/PC du 21 avril
2008 : KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres c/Société
TOGO-PORT dite port autonome de Lomé, Ohadata J-15-115.
* 61 CCJA, 18 mars 2016,
arrêt n° 44/2016, pourvoi : n°153/2012/PC du 02 novembre
2012 : GNANKOU GOTH Philippe c/ FONDS D'ENTRETIEN ROUTIER dit
« FER » ; Société EOBANK Cote
d'Ivoire.
* 62 CCJA, 26 avril 2018,
arrêt n° 103/2018 : MBULU MUSECO c/ La Société des
Grands Hôtels du Congo SA et 10 autres.
* 63Bira Lo NIANG,
« L'immunité d'exécution à la lumière de
la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de
l'OHADA », RAMReS, 2019, p.124.
* 64 CCJA, 11 octobre 2001,
arrêt n°002/2001 : époux Karnib c/
Société Général de Banques en Côte d'Ivoire
(SGBCI), Ohadata J-02-06.
* 65CCJA, 19 juin 2003,
arrêts n°012/2003, n°013/2003 et n°014/2003.
* 66France KERE, Les
problématiques juridiques liées à l'implantation des
sociétés étrangères dans l'espace OHADA,
Thèse en préparation à Bordeaux, dans le cadre de
l'Ecole doctorale en droit, en partenariat avec l'Institut de recherche en
droit des affaires et patrimoine depuis le 31-10-2016.
* 67Yves GUYON,
« Conclusion », in Petites affiches : le quotidien
juridique, n° 205, 13octobre 2004, p.59.
* 68Paul-Gérard
POUGOUE, « L'avant-projet d'Acte uniforme OHADA sur le droit des
contrats : les tribulations d'un universitaire », p.8, Ohadata
D-07-41.
* 69Article 10 du
Traité OHADA.
* 70 Barthélemy
COUSIN, op.cit., p.4.
* 71Roger MASAMBA, «
Avantages comparatifs des Actes uniformes de l'OHADA », Penant,
n° 869, 2009, p. 501.
* 72 L'article 2 du
Traité fait de l'arbitrage l'une des matières qui entre dans le
champ de l'OHADA.
* 73Philippe FOUCHARD,
Emmanuel GAILLARD, Berthold GOLDMAN, Traité de l'arbitrage
commercial international, Paris, LexisNexis, 1996, p.169.
* 74 Jean-Marie GARINOT,
Le secret des affaires, 1er éd, vol. 41, Paris, LexisNexis,
2013, p.327.
* 75 Sur les fondements
délictuels ou contractuels en l'absence de toute clause arbitrale ou
meme en formant une tierce opposition contre la sentence.
* 76CCJA, 10 janvier 2002,
arrêt n°3, Société ivoirienne d'emballage
métallique dite SIEM c/ Sté ATOU et BICICI, Ohadata J-02-25.
* 77 Barthélemy
COUSIN, op.cit., p.4.
* 78 CCJA, 1er
février 2007, arrêt n°004/2007, pourvoi n° 021/2004/PC
du 16/02/2004, Affaire : MAMBO Serges Henri Séraphin c/
Société SAGA-CI, Recueil de Jurisprudence n° 9 -
Janvier/Juin 2007, p. 5.
* 79 CCJA, 29 juin 2006,
arrêt n° 15 du, Affaire C.D c/ Société Ivoirienne
d'Assurances Mutuelles dite SIDAM, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 22,
Ohadata J-07-29.
* 80 TPI de Bafoussam, 16
juin 2006, n° 84/Civ., Affaire Sagne Boubou Cylaine C/ First Trust Savings
and Loan, Ohadata J-07-61.
* 81 Article de l'APSRVE.
* 82 Alex-François
TJOUEN, Les rapports entre les juridictions suprêmes nationales et la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'Organisation pour Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Thèse de doctorat en droit
privé, Lille, 2006, 420p.
* 83Henri MOTULSKY, Pour
une délimitation plus précise de l'autorité de la chose
jugée en matière civile, Dalloz - Sirey, 1958, chron. 1,
reprod. Ecrits. Etudes et notes de procédure civile, Paris, Dalloz,
2009, p.20
* 84Voir l'autre
définition de la notion d`espace donnée par Jean-Marie TCHAKOUA,
« L'espace dans le système d'arbitrage de la Cour Commune de
justice et d'Arbitrage », Penant, janvier-Mars 2005, p 842.
* 85La carte judiciaire
définit la répartition des tribunaux sur l'espace OHADA.
* 86 Joseph ISSA SAYEGH,
Jacqueline LOHOUES-OBLE, OHADA, Harmonisation du droit des affaires,
Bruxelles, Bruylant, 2002, p.55.
* 87 Véronique Carole
NGONO, « Réflexions sur l'espace judiciaire OHADA »,
Revue de l'ERSUMA, n°6, janvier 2016, p.20 et 26, Ohadata
D-15-14.
* 88 Ibid.
* 89 Loïc CADIET,
Jacques NORMAND et Soraya AMRANI-MEKKI, Théorie
générale du procès, Paris, PUF, 2010, p.262.
* 90 Ibid.
* 91 Article 13 du
Traité OHADA.
* 92 Jocelyn MADJENOUN,
« organisation judiciaire du Tchad », p.12, en ligne :
https://www.ohada.com , consulté le 25 janvier 2021 à 9h12.
* 93 Bachir TALFI,
« organisation judiciaire du Niger », p.9, en ligne :
https://www.ohada.com , consulté le 25 janvier 2021 à 9h20.
* 94 Cabinet d'avocats
Maitres JANDJO et KOÏTA, Alioune N'DIAYE, « organisation judiciaire
du Sénégal », p.10, en ligne : https://www.ohada.com ,
consulté le 25 janvier 2021 à 9h25.
* 95 Michel AKOUETE AKUE,
« Organisation judiciaire du Togo », p. 4, en ligne :
https://www.ohada.com , consulté le 25 janvier 2021 à 10h31.
* 96Rachel Yvette KALIEU
ELONGO, « organisation judiciaire du Cameroun », p.5 et 7, en
ligne : https://www.ohada.com, consulté le 25 janvier 2021
10h43.
* 97 Joseph KAMGA,
« Réflexions concrètes sur les aspects judiciaires de
l'attractivité économique du système juridique de
l'OHADA », revue des juristes de sciences PO, n°5,
2005, p.31, Ohadata D-12-85.
* 98 OHADA : trois questions
à Renaud BEAUCHARD, en ligne : https://www.ihej.org ,
consulté le 12 décembre 2020 à 17h10.
* 99 Neuf pays au total.
* 100Véronique
Carole NGONO, op.cit., p.26.
* 101Article 585 et s. du
Code de procédure civile, économique et administrative.
* 102 Loi N° 2007/001
du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécution et
fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions
judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences
arbitrales étrangères.
* 103Article 517 du Code de
procédure civile commerciale et sociale.
* 104 Article 668 et s. Du
Code de procédure civile.
* 105 Celle qui regroupe le
plu grand nombre d'Etats parties à l'OHADA.
* 106 La libre circulation
désigne la possibilité pour chaque titre de circuler, au mieux de
produire des effets dans les Etats requis sans procédures
intermédiaires, entendus ici comme des procédures de
reconnaissance ou exécution.
* 107Il convient de
rappeler que l'exéquatur n'a pas pour vocation de réviser le
jugement au fond mais plutôt d'examiner si la décision rendue dans
le respect des droits de la défense, si elle est conforme à
l'ordre public communautaire.
* 108 Articles 1, 2, 5, 19
et 23 de l'AUPRSVE.
* 109Cette proposition
résulte de l'analyse des articles 7, 9, 10, 14, 15, 23 et 25 de
l'AUPRSVE.
* 110 Joseph KAMGA,
op.cit., p.4.
* 111En effet aucun article
du corps du traité OHADA ne parle de la sécurité
judiciaire. Seul le premier considérant du préambule
réaffirme la détermination du législateur OHADA à
accomplir des nouveaux progrès en vue de renforcer la
sécurité juridique et judiciaire.
* 112 Les investissements
étrangers dans l'espace OHADA : brèves réflexions
pour une meilleure attractivité , Le blog de Maitre Daouda BA, en
ligne
https://blogavocat.fr/space/daouda.ba/contentles-investissements-dans-%C3%A9trangers-dans-m-%E2%80%99espace-ohada-br%C3%A8ves-r%C3%A9flexions-pour-une-meilleure-attractivit%C3%A9_
consulté le 21 juin 2021 à 07h30.
* 113Ibid.
* 114 Paul-Gérad
POUGOUE, POUGOUE Paul-Gérard, L'Attractivité
économique du droit OHADA, in encyclopédie du droit OHADA,
Lamy, 2011, p.383 et ss.
* 115 Les investissements
étrangers dans l'espace OHADA : brèves réflexions
pour une meilleure attractivité , Le blog de Maitre Daouda BA, en
ligne
https://blogavocat.fr/space/daouda.ba/contentles-investissements-dans-%C3%A9trangers-dans-m-%E2%80%99espace-ohada-br%C3%A8ves-r%C3%A9flexions-pour-une-meilleure-attractivit%C3%A9_
consulté le 21 juin 2021 à 07h30.
* 116 Ibid.
* 117Laurence BOY,
Jean-Baptiste RACINE et Fabrice SIIRIAINEN (dir), Sécurité
juridique et droit économique, coll. « Droit,
économie, international », Bruxelles, Larcier, 2008, p.18.
* 118 Joseph KAMGA, KAMGA
Joseph, « L'apport du droit de l'OHADA à l'attractivité
des investissements étrangers dans les Etats parties », Revue
des Juristes de Sciences Po, n°5, 2012, p.49.
* 119Ibid., p.51.
* 120Ibid.
* 121 François
ANOUKAHA, « L'OHADA en marche », 2002, p.1 et 7, Ohadata
D-04-36.
|
|



