UNIVERSITE D'ETAT D'HAITI
UEH
INSTITUT NATIONAL D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DES
HAUTES ETUDES INTERNATIONALES
INAGHEI
DEPARTEMENT DES SCIENCES ADMINISTRATIVES
L'accès au crédit auprès des
banques et les activités des coopératives d'épargne et de
crédit en Haïti au regard de la situation socioéconomique
des gens à faibles revenus (2003-2009) : cas de KOTELAM dans les
communes de Delmas et de Pétion-ville.
Par
Nick SIMEON
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du grade de licence
en Sciences administratives
Option
Gestion des Affaires
Port-au-Prince, Mars 2015
Remerciements
Ce projet est préparé dans le cadre de notre
sortie de mémoire à l'Institut National d'Administration, de
Gestion et des Hautes Etudes Internationales (INAGHEI). Pour arriver à
la réalisation de ce travail, nous avons reçu beaucoup de
supports. Nous tenons à remercier tout d'abord le Grand Architecte de
l'Univers qui nous a donné : la santé et nous protège
durant toute la durée de notre étude et depuis notre existence.
Nous remercions, le Professeur Charles ABELLARD, notre directeur de
mémoire, qui avait mis tout son temps à nous aider malgré
les contraintes venues de toute part à réussir ce projet. Nous
nous en voudrons de ne pas signaler de façon particulière les
encouragements déployés par le professeur Smith E. METELLUS qui,
en dépit de toutes ses préoccupations, a su se créer des
possibilités et combien nécessaire à la réalisation
de ce mémoire de sortie
Nos remerciements vont également à l'endroit de
mes deux frères Judex SIMEON, Riccardo SIMEON et ma p'tite soeur
Hermione SIMEON et surtout `'Manmie et Papi'' qui nous `ont supporté
économiquement dans le cadre de ce travail de recherche. Nous
remercions ensuite tous les dirigeants, tous les employés de la KOTELAM
qui n'hésitaient pas une seconde à nous donner toutes les
informations relatives à la caisse, spécialement les agents de
crédit de Delmas et de Pétion ville qui nous ont beaucoup
aidés dans la réalisation de l'enquête. Nous remercions
également notre cousin, Pagany LEONARD qui était toujours
là pour nous apporter son support dans nos recherches.
Nous ne saurions terminer sans ne pas remercier tous nos
condisciples de l'INAGHEI plus particulièrement Walson Lops, Stanley
Deronis et Fritznel Jn Baptiste pour leur support moral, tous ceux et celles
qui d'une façon ou d'une autre nous ont aidé et vous aussi qui en
ce moment consacrez ce temps pour la consultation de ce document, nous vous
devons toute notre gratitude.
Présentation des hypothèses
Constatation empirique : Les
difficultés d'accès au crédit auprès des banques,
constituant un blocage pour les gens à faibles revenus en Haïti,
ont été diminuées avec les activités
intensifiées des coopératives d'épargne et de
crédit qui leur ont facilité la tâche et contribué
plus ou moins à l'amélioration de leur situation
socioéconomique.
Hypothèse générale :
Au cours de la période 2003-2009, les difficultés
d'accès au crédit auprès des banques, constituant un
blocage pour les gens à faibles revenus en Haïti, ont
été diminuées avec les activités
intensifiées des coopératives d'épargne et de
crédit, notamment la KOTELAM, qui leur ont facilité la
tâche et contribué plus ou moins à l'amélioration de
leur situation socioéconomique.
Hypothèse secondaire I : Au cours
de la période 2003-2009, les difficultés d'accès au
crédit auprès des banques, constituant un blocage pour les gens
à faibles revenus en Haïti, ont été diminuées
avec les activités intensifiées des coopératives
d'épargne et de crédit, notamment la KOTELAM, qui leur ont
facilité la tâche dans les communes de Delmas et de
Pétion-ville.
Hypothèse secondaire II : Au
cours de la période 2003-2009, la KOTELAM a contribué plus ou
moins à l'amélioration de la situation socioéconomique des
sociétaires à faibles revenus dans les communes de Delmas et de
Pétion-ville.
TABLE DES MATIÈRES
Remerciements
.................................................................................................................................ii
Page des
hypothèses.........................................................................................................................iii
Table des
matières............................................................................................................................iv
Liste des abréviations
.......................................................................................................................xi
Liste des tableaux et des graphes
.....................................................................................................xiv
Sommaire.........................................................................................................................................xv
Introduction......................................................................................................................................20
Chapitre I
Les courants de pensée orientant le cadre
théorique, conceptuel et méthodologique en vue de la
vérification de l'hypothèse générale :
Au cours de la période 2003-2009, les
difficultés d'accès au crédit auprès des banques,
constituant un blocage pour les gens à faibles revenus en Haïti,
ont été aplanies avec les activités intensifiées
des coopératives d'épargne et de crédit qui leur ont
facilité la tâche et contribué plus ou moins à
l'amélioration de leur situation
socioéconomique.......................................................................................................25
1.1 CADRE
THÉORIQUE...........................................................................................................................25
1.1.1 La théorie des
institutionnalistes................................................................................................26
1.1.2 La théorie des
welfaristes.........................................................................................26
1.1.3 La théorie de référence :
l'approche
intégrale.................................................................27
1.2 LE CADRE CONCEPTUEL / OPÉRATIONNALISATION
DES CONCEPTS........................................................28
1.2.1 Coopérative d'épargne et de
crédit............................................................................
28
1.2.2
Crédit...............................................................................................................28
1.2.3 Les difficultés d'accès au
crédit................................................................................29
1.2.4
Banque............................................................................................................29
1.2.5
Blocage............................................................................................................29
1.2.6 Les gens à faibles
revenus..........................................................................................................30
1.2.7 Situation
socioéconomique....................................................................................30
1.3 MÉTHODOLOGIE DE
RECHERCHE......................................................................................................31
1.3.1
Méthode.....................................................................................................................................31
1.3.2 Méthode
qualitative....................................................................................................................32
1.3.3 Méthode
statistique....................................................................................................................32
1.3.4 Méthode
structuro-fonctionnaliste.............................................................................................32
1.3.5 Méthode
analytique....................................................................................................................33
1.4.1 Techniques
documentaires.........................................................................................................33
1.4.2
Echantillon.................................................................................................................................34
1.4.3 Observation
directe...................................................................................................................34
1.4.4
Entrevue.....................................................................................................................................34
1.5 LES LIMITES DU
TRAVAIL.................................................................................................................35
1.5.1 Le limite dans le temps
.............................................................................................................35
1.5.2 Le limite dans
l'espace...............................................................................................................35
1.6 LES
CONTRAINTES...........................................................................................................................35
CHAPITRE II
Les banques, les activités des
coopératives d'épargne et de crédit au regard des
sociétaires :
Généralités............................................................................................................................................36
2.1 DÉFINITION D'UNE
COOPÉRATIVE........................................................................................................36
2.1.1 Historique de la
coopérative......................................................................................................38
2.1.2 Les coopératives dans
l'antiquité................................................................................................39
2.1.3 Les coopératives
contemporaines..............................................................................................40
2.1.4 Les principaux buts des
coopératives..........................................................................................41
2.1.5 Les principes fondamentaux des
coopératives...........................................................................43
2.2 LES COOPÉRATIVES EN AFRIQUE DE L'EST ET DE
L'OUEST.....................................................................45
2.2.1 La coopérative au
Bengladesh...................................................................................................46
2.2.2 La coopérative en
France..........................................................................................................46
CHAPITRE III
Historique des Coopératives d'Epargne et de
Crédit en Haïti, notamment la kotelam dans les communes de Delmas
et de
Pétion-ville.....................................................................................48
3.1 Présentation des communes de
Delmas....................................................................48
3.1.1
Education.......................................................................................................50
3.1.2
Santé.............................................................................................................50
3.1.3
Religion.........................................................................................................50
3.1.4
Politique.........................................................................................................50
3.1.5
Electricité...................................................................................................................................51
3.1.6 Commerce et
Justice..........................................................................................51
3.2 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE
PÉTION-VILLE...........................................................................52
3.2.1
Education.......................................................................................................53
3.2.2
Santé.............................................................................................................53
3.2.3
Religion.........................................................................................................53
3.2.4 Commerce et
Finance..........................................................................................53
3.2.5 Culture et
loisir.................................................................................................54
3.3 HISTOIRE DU MOUVEMENT COOPÉRATIF EN
HAÏTI.........................................................................55
3.3.1 Genèse du mouvement coopératif
haïtien...................................................................55
3.3.2 Les formes de coopératives modernes en
Haïti.............................................................55
3.3.3 Epanouissement des coopératives d'épargne
et de crédit.................................................56
3.3.4 Impact des décisions politiques sur la
coopérative en
Haïti......................................................57
3.4 LA
KOTELAM..........................................................................................................................60
3.4.1 La constitution de la
KOTELAM............................................................................60
3.4.2 Siège social et
territoire........................................................................................60
3.4.3 Mission et objectif de la
KOTELAM....................................................................60
3.5 LES
MEMBRES.............................................................................................................................61
3.5.1 Les sociétaires actifs ou membres
réguliers...............................................................................61
3.5.2 Les membres
auxiliaires.......................................................................................61
3.5.3 Les sociétaires
inactifs.........................................................................................61
3.5.4 Doits et devoirs des
sociétaires..............................................................................61
3.5.5 Les produits de la
KOTELAM...................................................................................................62
3.6 LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRÊTS DE LA
KOTELAM.........................................................................62
3.6.1 Les conditions d'avoir accès au crédit
à la KOTELAM..................................................63
3.6.2 Condition pour un
employé........................................................................................................63
3.6.3 Condition pour un
commerçant..............................................................................64
3.6.4 Les modalités de
remboursements...........................................................................65
3.6.5 Cadre légal des coopératives
d'épargnes et de
crédit..............................................65
CHAPITRE IV
Les difficultés d'accès au crédit
des gens à faibles revenus auprès des banques au regard des
activités des coopératives d'épargne et de crédit,
notamment la kotelam dans les communes de Delmas et de Pétion-ville
(2003-2009)/vérification de l'hypothèse secondaire
I.................................................................................................................................................................66
4.1 LE FONCTIONNEMENT DU CRÉDIT EN
HAÏTI........................................................................66
4.1.1 Le portefeuille de crédit des banques des
banques commerciales............................................67
4.1.2 La situation des institutions de
Microfinance...............................................................70
4.2 LES DIFFÉRENTES SOURCES DE DIFFICULTÉS DU
CRÉDIT..........................................................................72
4.2.1 Les difficultés venues des institutions
Etatiques........................................................................72
4.2.2
L'Adresse........................................................................................................72
4.2.3 Le problème
d'identification...................................................................................73
4.2.4
L'Assurance.....................................................................................................74
4.3 LES DIFFICULTÉS DU CÔTÉ DES
EMPRUNTEURS.....................................................................74
4.3.1 Secteur
d'investissement.......................................................................................75
4.3.2
Solvabilité.......................................................................................................75
4.4 LES CONTRAINTES AU NIVEAU DES
BANQUES......................................................................76
4.4.1 Taux
d'intérêts...........................................................................................................................76
4.4.2 Les
garanties.....................................................................................................76
4.4.3 Le
temps.........................................................................................................77
CHAPITRE V
La KOTELAM et la situation socioéconomique des
sociétaires dans les communes de Delmas et de
Pétion-ville....................................................................................................................79
5.1 Les résultats obtenus sur le plan
économique et
social..............................................................80
5.1.1 Les résultats sur le plan
économique..........................................................................................80
5.1.2 Les rapports de la
kotelam..........................................................................................................81
5.1.1 La couche la plus touché de
la coopérative par statut
matrimonial..........................................89
5.2 Les résultats sur le plan
social.................................................................................................91
5.2.1 Les secteurs d'activités touchés par les
prêts des
coopératives..................................................91
5.2.2 Impact social des prêts sur les femmes à
faibles revenus...........................................................92
5.2.3 L'impact des prêts accordés aux
sociétaires...............................................................................94
Conclusion et
suggestions.....................................................................................................................96
Bibliographie.........................................................................................................................................100
Questionnaires
(enquête)......................................................................................................................103
LISTE DES ABREVIATIONS
ACDI : Association Canadienne de
Développement International
ACI : Alliance Coopérative
Internationale
ANACAPH : Association Nationales des Caisses
Populaires
ANIMH : Association Nationale des
Institutions de Microfinance
BIT : Bureau International du Travail
BRH : Banque de la République
d'Haïti
CEC : Coopérative d'épargne
et de crédit
CNC : Conseil National de Crédit
DID : Développement International
Desjardins
ID : Initiative de Développement
IHSI : Institut Haïtien de Statistique
et d'Informatique
IMF : Institution de Microfinance
INAGHEI : Institut National d'Administration,
de Gestion et des Hautes Etudes International
KOTELAM : Koperativ Tèt Ansanm pou
Lavi Miyò
OIT : Organisation Internationale du
Travail
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PDG : Président Directeur
Général
PME : Petite et Moyenne Entreprise
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement
UEH : Université d'Etat
d'Haïti
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Représentation géographique de
la commune Delmas........................................49
Tableau 2 : Situation globale du secteur de la
Microfinance en 2009......................................71
Tableau 3 : L'ensemble des dossiers traités par le
comité de Crédit en 2009..............................82
Tableau 4 : Dossiers traités par la direction
générale
....................................................................83
Tableau 5 : Les principaux indicateurs de la KOTELAM de 2003
à 2007................................. 85
Tableau 6 : Tableau représentant le statut
matrimonial des membres .................................... 90
Tableau 7 : Les secteurs touchés par les prêts
octroyés.......................................................92
Tableau 8 : Les montants des prêts accordés aux
sociétaire..................................................93
LISTE DES GRAPHES
Graphe 1 : L'évolution des épargnes des
sociétaires de 2003 à
2009......................................88
Graphe 2 : La tendance du portefeuille de Crédit
de la kotelam de 2003à2009.......................... 89
SOMMAIRE
La majorité des pays pauvres fait face à un
problème commun qui est l'Aide Internationale. La plupart de ces pays se
base sur l'aide de la communauté internationale pour améliorer la
situation de leur population économiquement ainsi que socialement. Un
objectif qui est difficile à atteindre pour beaucoup d'analystes du
développement. Selon ces analystes, le meilleur moyen de soulager la
misère d'un peuple du point de vu économique, c'est d'abord, et
avant tout, lui permettre de mobiliser les ressources internes du pays en les
valorisant et en faisant une gestion rationnelle de ces ressources.
Le coopératisme qui a sa philosophie basée sur
la participation économique et sociale de tout les gens qui font parti
d'un tel mouvement, est toute suite considérée comme un
élément qui peut créer des bases économiques au
sein de ces populations démunies. Beaucoup de pays en Afrique en
Amérique et même en Europe ont connu l'expérience du
mouvement coopératif. Ce mouvement est présent en Haïti et a
créé sa place dans la vie économique de la population
surtout ceux qui n'ont pas accès facile au système financier
formel.
Au cours de ces dernières années, nous avons
observe qu'il y a une certaine partie de la population Haïtienne qui
continue à avoir confiance dans le mouvement coopératif surtout
dans les coopératives d'Epargne et de crédit. Pour avoir une
idée claire sur le mouvement coopératif , nous avons
essayé de voir l'évolution de ce mouvement au cours du
commencement des années 2000 tout en essayant de poser la
problématique du mouvement coopératif en Haïti en tenant
compte des différents moments très difficiles que ce mouvement a
connu.
Problématique - Le mouvement
coopératif haïtien a pris une autre tournure au début des
années 2000. On a assisté à une augmentation sans
précédente du nombre de coopératives dans tous les
départements du pays surtout dans le département de l'ouest. La
grande majorité, pour ne pas dire la totalité était des
coopératives d'épargnes et de crédits. Des
coopératives qui ne respectaient pas totalement les valeurs et les
principes prévus par l'Alliance Coopérative Internationale
(ACI), et la violation de ces principes et de ces valeurs étaient
à la base des événements de 2002 qui avait mis le
mouvement coopératif haïtien dans une situation très
difficile.
Malgré la crise de 2002 beaucoup de coopératives
ont pu résister et continuer à donner des services à ses
sociétaires. Après une dizaine d'années environ des
améliorations ont été réalisées dans le
secteur. Selon le directeur du Conseil National des Coopératives (CNC)
Monsieur Frantz PRINVIL à l' occasion de la journée mondiale des
coopératives en 20071(*). « « Les
coopératives d'épargnes et de crédit étaient de 233
sur tout le territoire national, la somme épargnée par ces
coopératives étaient de l'ordre de 1 milliard 500 millions de
gourdes dont 1 milliard 300 millions gourdes retournent aux sociétaires
sous formes de crédit et 51,30% de ces crédits sont
alloués aux femmes. 2(*) » »
Selon les statistiques de l'Association Nationale des Caisses
Populaires haïtiennes (ANACAPH) en décembre 2009, le total
d'actifs des caisses d'épargne et de crédit était de 231,
8139,408 gourdes3(*). Le
total d'épargne 1, 626, 089,738 gourdes, le portefeuille de
crédit 1, 355,010,882 gourdes, l'avoir des caisses 474, 679,428gourdes
et le nombre de clients 309,160. 4(*)
Ces données nous permettent de voir l'évolution
des coopératives d'épargné et de crédit. On a pu
remarquer une certaine stabilité au niveau des coopératives
malgré la crise de 2002. De 2007 à 2009, les résultats
montrent que les coopératives étaient en train de grandir, de
gagner du terrain, de remontée la pente et de donner l'espoir au
mouvement coopératif.
Tenant compte de la remontée de ce secteur ne
s'avère-t-il pas important de connaitre la relation existante entre la
coopérative et la situation socioéconomique des
sociétaires en Haïti plus spécialement dans les communes de
Delmas et de Pétion ville ? D'où la nécessité
de ces interrogations. Les coopératives qui évoluent dans les
communes de Delmas et de Pétion ville facilitent-elles à ses
membres d'avoir accès au crédit ? y a-t-il vraiment des
difficultés aux gens à faibles revenus d'avoir accès au
crédit dans les institutions bancaires ? La quantité de
crédit donnée par les coopératives permet-elle à
augmenter le portefeuille des petites entreprises ? Ont-elles
apporté une amélioration au niveau du crédit et de
l'épargne ? Peuvent-elles améliorer la situation
socioéconomique des sociétaires de la commune de Delmas et de
Pétion-vile ?La réponse à l'ensemble de ces
interrogations permet de comprendre l'importance du mouvement coopératif
au sein d'une communauté et plus spécialement dans les pays ou
l'accès au crédit dans les banques commerciales sont difficiles.
Pour arriver à ces réponses, nous avons considéré
la coopérative KOTELAM comme cas d'étude pour son
expérience dans le secteur coopératif pour la
vérification de notre Hypothèse principale qui est divisée
en deux hypothèses secondaires.
Hypothèse générale.
Au cours de la période 2003-2009, les
difficultés d'accès au crédit auprès des banques,
constituant un blocage pour les gens à faibles revenus en Haïti,
ont été diminuées avec les activités
intensifiées des coopératives d'épargne et de
crédit, notamment la Kotelam qui leur ont facilité la tâche
et contribué plus ou moins à l'amélioration de leur
situation socioéconomique.
Hypothèse secondaire I.
Les difficultés d'accès au crédit
auprès des banques, constituant un blocage pour les gens à
faibles revenus en Haïti, ont été diminuées avec les
activités intensifiées des coopératives d'épargne
et de crédit, notamment la Kotelam qui leur a facilité la
tâche dans les communes de Delmas et de Pétion-ville au cours de
la période 2003-2009
Hypothèse secondaire II.
Au cours de la période 2003-2009, la KOTELAM a
contribué plus ou moins à l'amélioration de la situation
socioéconomique des sociétaires à faibles revenus dans les
communes de Delmas et de Pétion-ville.
Cadre théorique et conceptuel :
Le mouvement coopératif est considéré en Haïti comme
un outil important pour arriver à soulager la misère des plus
démunis. Beaucoup de théories ont montré l'importance des
associations et entreprise de microfinance dans les pays en difficultés
économiques. Nous avons considéré trois théories
dans notre travail : la théorie des Welfaristes, la théorie
des Institutionnalistes et la théorie des Minimalistes ou l'Approche
Intégrale. Cette dernière a servi de toile de fonds de notre
étude car elle se base s sur l'aide financier des pauvres et aussi sur
la formation de ces gens, ce qui peut donner une certaine
pérennité dans les actions entreprises par les
bénéficiaires.
Pour arriver à la vérification de nos
hypothèses, nous avons divisée notre travail en cinq chapitres.
Dans le premier chapitre nous essayons de voir les différentes
théories qui ont un rapport avec notre sujet et enfin nous avons choisi
notre théorie de référence. Nous avons défini aussi
nos différents concepts et comme tout travail scientifique nous avons
utilise des méthodes en évoquant les techniques par lesquelles
nous arrivons à réaliser le document et enfin nous avons
limité notre travail dans le temps et dans l'espace.
Dans le Deuxième chapitre, nous énumérons
quelques définitions de la coopérative. Nous retraçons
d'abord l'histoire de la coopérative dans le temps depuis
l'époque contemporaine jusqu'à nos jours et ensuite
l'évolution de la coopérative dans quelques pays d'Afrique et en
Europe. le troisième chapitre est divisée en trois parties avec
d'abord la présentation des villes que nous avons
considéré pour la réalisation de notre enquête et
ensuite la présentation de la KOTELAM qui est notre cas d'étude
et enfin l'histoire de la coopérative en Haïti.
Le quatrième chapitre qui s'intitule : Les
difficultés d'accès au crédit des gens à faibles
revenus au près des banques au regard des activités des
coopératives d'épargne et de crédit notamment la kotelam
dans les communes de Delmas et de Pétion-ville (2003-2009) est le
chapitre a travers lequel nous vérifions notre hypothèse
secondaire I. nous essayons tente de comparer les résultats des
différentes institutions de microcrédit ensuite les portefeuilles
de Crédit de ces institutions et finalement les différentes types
de difficultés qui rendent l'accès au Crédit auprès
des banques si difficiles pour les gens à faible revenu.
Le quatrième chapitre contient un ensemble de
résultats de la KOTELAM pendant la période que nous choisi pour
mener notre recherche, les impacts des crédits octroyés aux
sociétaires sur le plan économique et social. C'est à
partir de toutes ces données que nous avons arrivée à
vérifier notre Deuxième hypothèse secondaire et de pouvoir
aussi formuler nos recommandations. Ainsi essayons-nous à partir de ce
document qui ne représente pas une analyse détaillée et
exhaustive sur la situation socioéconomique des sociétaires,
mais qui est quand même le fruit de nombreuses recherches et d'une
enquête menée auprès de ceux qui ont
bénéficié des produits de la coopérative à
apporter un peu de lumière sur ce secteur en justifiant nos
hypothèses.
INTRODUCTION
La réalisation et la présentation d'un travail
de recherche est une étape importante dans le processus de l'obtention
du grade de Licence en Gestion des affaires à l'Institut National
d'Administration, de Gestion et des Hautes Etudes Internationales (INAGHEI).
C'est dans cette optique que nous avons réalisé ce travail en
traitant ce sujet : L'accès au crédit
auprès des banques et les activités des coopératives
d'épargne et de crédit en Haïti au regard de la situation
socioéconomique des gens à faibles revenus (2003-2009) : cas
de KOTELAM dans les communes de Delmas et de Pétion
ville. En effet, depuis l'existence de l'homme, il est toujours
dominé par un souci qui est de gagner sa vie. Toutes les
activités dans lesquelles il s'engage, consistent à la
réalisation des choses matérielles pour satisfaire ses besoins.
En effet, le changement de civilisation de l'homme primitif au civilisé
a fait que l'homme rencontre d'autres problèmes économiques et
sociaux dans son évolution5(*). Il existe une étroite relation entre la
situation économique et la situation sociale d'un pays6(*). Il est évident plus
qu'un pays est pauvre plus il confronte à des problèmes
économiques et sociaux beaucoup plus complexe, il est aussi plus
difficile pour que la majorité des habitants ait accès au
système bancaire c'est-à-dire le système financier formel
et de pouvoir bénéficier des produits financiers tels que
l'épargne le crédit etc. Le développement des petites et
moyennes entreprises deviennent très difficile ce qui empêche une
amélioration de la classe des plus démunis.
En fait, voulant faire face à ces problèmes qui
ravagent les pays les plus pauvres, les habitants se trouvent dans l'obligation
de se mettre ensemble afin de porter un soulagement à leur situation si
précaire, d'où la nécessite de se coopérer. La
coopérative devient un élément essentiel dans ces genres
de situation et se propage dans presque tous les continents de la
planète dans un temps très court. Du point de vu
économique la coopérative d'épargne et de crédit a
rapidement créé une place dans la vie des coopérateurs.
En Haïti, les législateurs7(*) n'étaient pas restés sans
réaction face à ce mouvement car depuis en 1960 ils ont
affirmé que le mouvement coopératif « est de nature
à contribuer au relèvement économique et social de nos
populations tant urbaines que rurales »8(*) . Ils ont fait cela pour favoriser ceux de la
population qui croupissent dans la misère. Le mouvement de part ses
caractéristiques est à la fois économique et social. Il
peut contribuer à l'amélioration de la vie de toute une couche de
la population, il rend l'homme libre de son destin et capable de décider
sur son avenir.9(*) Tenant
compte de tous ces caractéristiques du mouvement coopératif, nous
avons réalisé cette recherche en vu de comprendre un peu plus ce
que la coopérative, surtout celle d'épargne et de crédit a
apporté aux sociétaires de l'air métropolitaine de
Port-au-Prince plus spécialement dans les communes de Delmas et de
Pétion Ville. Pour la réalisation de ce travail de recherche,
nous avons utilisé une méthodologie qui nous permet de bien
agencer notre recherche. Le travail est divisé en cinq (5) chapitres qui
nous facilitent l'élaboration des différentes théories
relatives à la coopérative et à la vérification de
nos hypothèses de recherche.
D'abord, dans le premier chapitre, nous avons
énoncé quelques théories sur le secteur de la Microfinance
en général, car la coopérative, surtout les
coopératives d'épargne et de crédit de part son mode de
fonctionnement est toujours considérée comme une entreprise de
Microfinance, en fait c'est une branche de la Microfinance. Ces théories
permettent de comprendre les différents points de vue des analystes sur
ce secteur. Ensuite nous présentons notre cadre conceptuel qui nous
aide à conceptualiser les concepts utiliser au cours de notre recherche.
En fin, nous présentons la méthodologie que nous avons
utilisée pour la réalisation de ce travail de recherche.
A travers le deuxième chapitre, nous
présentons l'histoire de la coopérative dans l'antiquité
et celle contemporaine. Ce chapitre permet de connaitre l'origine de la
coopérative, et son début dans l'histoire de l'humanité.
Nous essayons de voir aussi les expériences de quelques
autres pays en Europe, en Amérique et surtout sur le continent Africain
avec le mouvement coopératif.
Dans le troisième chapitre, nous avons mis l'accent
sur les communes ou nous avons effectué notre recherche. Nous
présentons les communes du point de vu social, économique et
géographique à partir d'une recherche effectuée par
l' Institut Haïtien de statistique et d'informatique qu'il a
réalisée en 1998. Dans la deuxième partie du chapitre nous
présentons la KOTELAM10(*) avec ses différents produits, sa mission ses
objectif etc. Ces éléments nous donnent une idée des
différents produits qu'on peut trouver dans une coopérative et
dans la troisième partie nous présentons l'histoire de la
coopérative en Haïti.
Le quatrième chapitre est constitué par
l'ensemble des éléments qui nous permet de vérifier notre
hypothèse secondaire I en démontrant combien il est difficile
pour des sociétaires potentiels d'avoir accès au crédit
des banques. Nous avons identifié les différentes sources des
difficultés. Nous avons aussi montré les responsables de ces
contraintes tant au niveau du système bancaire qu'au niveau de l'Etat.
Le cinquième chapitre est divisé en deux parties, dans la
première partie nous avons tenté de présenter la
situation de la `'Koperativ Tèt Ansanm pou Lavi Miyò''
pendant quelques années pour nous aider à comprendre un peu plus
le dynamisme du mouvement coopératif beaucoup plus.Dans une
deuxième partie nous avançons les résultats de notre
enquête sur le plan économique et social. Ces résultats
nous permettent de justifier nos deux hypothèses secondaires en un mot
l'hypothèse générale en démontrant par des
résultats tirés de notre recherche et de tous ceux et celles qui
avaient déjà effectués des recherches dans ce domaine. En
développant le quatrième et le cinquième chapitre, nous
avons pu constater qu'il est vraiment difficile aux gens de faibles revenus
ainsi qu'aux sociétaires potentiels de pouvoir trouver du crédit
au sein des institutions bancaires et que les coopératives
d'épargne et de crédit donnent un accès beaucoup plus
facile et facilitent dans une certaine mesure l'amélioration
socioéconomique des gens qui ont bénéficiés de
leurs produits financiers.
Enfin compte, nous pouvons dire que sous aucun prétexte
nous ne pouvons pas considérer ce travail de recherche comme une
innovation bien qu'il soit difficile d'apprécier la participation
réelle du coopératisme dans l'évolution
de l'économie nationale. Cette étude trouvera son sens dans
la présentation de l'importance de la coopérative au niveau du
secteur féminin et de l'économie des communes en
général. Nous espérerons que les faiblesses de notre
recherche sera comblées par des chercheurs qui ont ce même champ
d'intérêt, à cause des difficultés que nous avons
confrontée dans la collecte des données tant sur le terrain que
dans les institutions étatiques. Tenant compte de la remontée de
ce secteur ne s'avère-t-il pas important de chercher à savoir la
relation qu'il y a entre le mouvement coopératif et l'évolution
de la situation socioéconomique des sociétaires dans les communes
ou se trouve la kotelam ?
D'où la nécessité de ces interrogations.
Les instituions qui de microcrédit qui évoluent dans les
communes de Delmas et de Pétion ville facilitent-elles à ses
membres d'avoir accès au crédit ? La quantité de
crédit donnée par les coopératives permet-elle à
augmenter le portefeuille des petites entreprises ? Ont-elles
apporté une amélioration au niveau du crédit et de
l'épargne ? Peuvent-elles améliorer la situation
socioéconomique des sociétaires de la commune de Delmas et de
Pétion-ville ?
CHAPITRE I
Les courants de pensée orientant le cadre
théorique, conceptuel et méthodologique en vue de la
vérification de l'hypothèse générale.
Ce chapitre est divisé en trois parties. La
première partie nous permet de mettre en évidence les
théories qui sous-tendent notre domaine de recherche. Dans la
deuxième partie, nous essayons d'opérationnaliser nos concepts
et enfin la troisième section traite de la méthodologie que nous
avons utilisée pour la pleine et entière réalisation de ce
travail.
1.1.1 CADRE THÉORIQUE
La coopérative est l'une des Institutions de
Microfinance qui vise à donner des services aux gens de faibles revenus
en leur facilitant à avoir accès à des services financiers
(l'épargne, le crédit etc.). Ce mouvement se renforce avec l'aide
des pays qui ont pu établir et mettre en pratique les principes de base
de la coopérative. Au Canada, le Développement Internationale
Desjardins11(*) (DID) aide
beaucoup de pays en Afrique et en Amérique à pérenniser le
mouvement coopératif. Beaucoup de théoriciens de la
matière voient la coopérative comme une institution capable de
résoudre beaucoup de problèmes. C'est ainsi que
l'ex-secrétaire générale des nations unis a eu à
dire que « Les coopératives12(*) sont des entreprises économiques qui peuvent
être adaptées et valables dans la poursuite du
développement économique et social à l'avantage de tous
les peuples » Nous allons passer en revue les différentes
théories que nous avons considéré dans le cadre de notre
travail.
1.1.2 THÉORIE DES
INSTITUTIONNALISTES : Les théoriciens des
institutionnalistes, Otero 1999 et Rhyne 1998, pensent que le
microcrédit est incapable d'engendrer d'impact significatif sur le
niveau général de la pauvreté dans le monde, surtout dans
les pays sous-développés si les Institutions de Microfinance
dépendent essentiellement du financement des donneurs13(*). Les théoriciens de ce
courant de pensée font remarquer que le capital financier
nécessaire pour assurer la pérennité des IMF d'un tel
système dépasse de loin ce que l'aide internationale est
prête ou même capable de fournir. Ils font
référence aussi à la volatilité des ressources
financières de l'aide, voire leur cessation en fonction des
intérêts changeants des donneurs pour mettre en exergue les
risques liés au développement d'IMF dépendant du
financement des bailleurs.
1.1.3 THÉORIE DES WELFARISTES :
Dans leur thèse, les welfaristes13(*) ne visent pas en priorité l'efficacité
financière et technique, mais plutôt une certaine
équité sociale qui consiste à « soulager
immédiatement le fardeau quotidien de la pauvreté, comme premier
pas aidant les gens à échapper de la pauvreté à
long terme14(*). Dans
cette approche les femmes représentent la clientèle cible et le
crédit doit être destiné aux plus pauvres et leur faciliter
la création de leur propre emploi.
1.1.4 LA THÉORIE DE RÉFÉRENCE :
APPROCHE INTÉGRALE
Selon les théoriciens Littlefield et Richard en 2001,
Les Institutions de Microfinance de type intégral ont quant à
elles, une conception globale de l'offre qui consiste à combiner et
à proposer une gamme de services d'intermédiation
financière et sociale à sa clientèle. Elles basent ce mode
d'intervention sur le constat que certains clients ne possèdent pas les
capacités entrepreneuriales nécessaires à la bonne marche
de leur activité. Ils ont fait savoir aussi que Les services
d'accompagnement (alphabétisation, formation, etc.)
fournis par les Institutions Microfinance peuvent être
bénéfiques pour les deux parties, notamment en limitant les
risques de non remboursement.
Nous avons choisi l'approche intégrale pour orienter
notre travail, car nous pensons que l'aide internationale ne suffit pas pour
aider les gens à sortir de leur marasme économique. Nous croyons
aussi que la meilleure solution, ce n'est pas de soulager la misère des
gens sur une courte durée mais plutôt de leur aider à
s'intégrer dans la vie économique normale tant par la formation
c'est-à-dire les alphabétiser que par l'information en les
orientant vers les activités qu'ils peuvent mener pour que ses
activités soient pérennes et rentables.. Selon des
sociétaires de la Kotelam, les réunions de formation de la caisse
les aident à comprendre comment mieux utiliser l'argent emprunté
de la caisse. Tenant compte que les théoriciens de l'approche
intégrale croient que les mesures d'accompagnement sont
nécessaire pour les sociétaires c'est pour cela que nous
considérons cette approche comme notre théorie principale car
nous croyons pour que les caisses populaires soient beaucoup plus performantes
il faut qu'il y ait des formations continuées pour les
sociétaires. Car le manque de formation des sociétaires est aussi
une barrière pour eux de mieux gérer et faire grandir leur petit
commerce.
1.2 CADRE CONCEPTUEL/OU OPÉRATIONNALISATION DES
CONCEPTS.
A travers cette partie, nous essayons de définir les
différents termes et expressions qui nous paraissent nécessaire
pour appréhender et approfondir le sujet.
1.2.2 DÉFINITION D'UNE COOPÉRATIVE
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
Pour pallier à la situation de crise qui régnait
dans le pays dans les années 2000 beaucoup de décisions ont
été prises par les autorités étatiques. Ils ont
défini une coopérative d'épargne et de crédit
ainsi ; c'est une association financière circonscrite `a ses
sociétaires c'est-à-dire de recevoir des fonds de ses
sociétaires et de leur faire du crédit selon l'article de cette
loi. Son existence légale vient du Conseil National Coopérative
(CNC) Banque de la République d'Haïti.15(*)
Une coopérative d'épargne et de
crédit16(*) (C.E.C) est une coopérative telle que
définie précédemment mais qui a la particularité de
traiter des questions d'argent au profit de ses membres (sociétaires).
C'est donc à la fois une association et une entreprise
financière. Elle est aussi appelée Caisse
populaire.17(*)
1.2.3 CRÉDIT :
Le crédit est un acte de confiance comportant
l'échange de deux prestations dissociées dans le temps :
bien ou moyen de paiement ou de remboursement.18(*)
1.3 LES DIFFICULTÉS D'ACCÈS AU
CRÉDIT :
Généralement, on parle de difficultés,
quand on a des contraintes de faire ou de réaliser quelque chose. Dans
notre recherche nous parlons de difficultés d'accès au
crédit comme les différentes barrières, les conditions,
les modalités ou les balises qui empêchent une personne d'une
certaine classe sociale19(*) ou économique de trouver du crédit dans
une institution bancaire quelconque. Les barrières peuvent être
financières, identitaires, structurelles et même politiques.
1.3.1 BANQUE :
Une banque peut avoir différente
définition dépendant de la catégorie de banque. Dans notre
recherche nous considérons une banque comme une entreprise qui fait le
commerce de l'argent tout en contrôlant les différents risques. Sa
mission principale peut être la gestion de l'argent des clients ou de ses
actions, de facilitées les transactions en utilisant des chèques
ou des cartes bancaires et prêter de l'argent. Ce dernier attire notre
attention car au cours de notre recherche nous essayons de voir les contraintes
que peuvent avoir certains clients potentiels pour avoir du crédit au
sein d'une institution bancaire.
1.3.2 BLOCAGE :
Selon le robert de poche :
difficultés d'adaptation a une situation a une situation, ou action de
bloquer. En ce qui nous concerne dans notre travail, le blocage est l'ensemble
des contraintes qui empêchent les gens aux faibles revenus de pouvoir
avoir accès au crédit dans le système financier formel
c'est-à-dire les institutions bancaires et autres.
1.3.3 LES GENS À FAIBLES REVENUS
Economiquement, une société peut être
divisée en plusieurs catégories sociales. Dans le cas de notre
étude, nous avons considéré une catégorie qui
est : les gens à faibles revenus. C'est une catégorie, en
Haïti, qui a accès difficilement à des produits financiers
offerts par nos banques les empêchant d'entreprendre de grandes
activités économiques
1.3.4 SITUATION SOCIOÉCONOMIQUE :
La socioéconomie ou socio-économie est
un mélange entre les
sciences
économiques et la
sociologie. Elle vise
à intégrer les outils des sciences économiques avec ceux
de la sociologie afin d'examiner l'évolution économique des
sociétés. Devant les apories de l'économie
néoclassique à expliquer certaines caractéristiques des
comportements humains ou des institutions.20(*) Notre travail garde la même idée en
analysant les impacts des produits financiers sur la vie des sociétaires
surtout ceux malgré les contraintes qui ont eu du crédit au
près des institutions de microcrédit pendant une époque
considérée sur le plan économique et social.
1.4 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
1.4.1 LES MÉTHODES
La recherche scientifique possède des
éléments qui permettent d'aboutir à des résultats
qui peuvent être utiles dans n'importe quel domaine de la
société. Parmi ces éléments la méthode est
considérée comme indispensable. On définit la
méthode comme un ensemble de démarches que suit le chercheur
pour arriver à démontrer la vérité dans sa
quasi-totalité.21(*) Pour d'autres chercheurs, la méthode est
considérée comme une suite logique qu'on utilise tout au long ou
a tous les différents niveaux d'une recherche scientifique en vue
d'aboutir à la connaissance de la vérité22(*). Selon GRAWITZ, (2001 :17),
une méthode est un ensemble d'opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuit, pour les démontrer et les vérifier.23(*)Tenant compte de toutes ces
définitions et de toute son importance dans une recherche scientifique
nous avons utilisé différentes types de méthodes pour la
réalisation de notre travail tel que :
1.4.2 MÉTHODE QUALITATIVE
Les chiffres, les résultats mathématiques ne
sont pas les éléments primordiaux de la méthode
qualitative. Elle considère surtout les échantillons, des cas
particuliers pour faire ses études en l'analysant de manière
très globale24(*).
C'est pour cela qu'on le considère comme étant une méthode
intensive. Le comportement, les opinions, les valeurs les croyances des
personnes sélectionnées font partis des éléments
que s'intéresse la méthode qualitative. Pendant notre recherche,
l'utilisation de la méthode qualitative nous a permis de collecter les
intentions des personnes questionnées et la qualité de ses
opinions.
1.4.3 MÉTHODE STATISTIQUE
On utilise des variables dans l'application de cette
méthode, celles-ci sont des caractéristiques ou des informations,
qui, dans une recherche, peuvent prendre plusieurs types de valeurs et de fait
sont mesurables25(*).
La méthode statistique est celle qui nous a permis au
niveau de notre recherche de quantifier nos résultats et de pouvoir
construire nos graphes et nos différents tableaux.
1.4.4 MÉTHODE STRUCTURO-FONCTIONNALISTE
Le fonctionnalisme prend sa source ou commence à partir
d'une théorie selon laquelle tout élément d'un
système social d'une façon d'une autre aide à conserver
ou à assurer la survie de ce système social.26(*) On désigne par le terme
structure, une réalité constituée d'éléments
ayant entre eux des relations déterminées de telle sorte que la
modification d'une de ces relations transforme ou modifie l'ensemble de cette
réalité (INTERAYAMAHANGA, 2007).
L'utilisation de cette méthode nous a permis de mieux
comprendre le fonctionnement de la coopérative en elle-même et son
importance dans l'amélioration de la situation socioéconomique
des sociétaires.
1.4.5 MÉTHODE ANALYTIQUE
Selon LECOURT (2006 :13), la méthode analytique
consiste à diviser un problème complexe en sous problèmes
plus simples. Elle consiste à étudier séparément
les cas en dehors de l'ensemble dont ils font parti. Elle permet d'analyser
systématiquement toutes les informations ainsi que les données
récoltées. Nous l'avons utilisée dans notre travail de
recherche pour sa pertinence.
A partir de cette méthode nous arrivons à faire
une analyse approfondie de toutes les données que nous avons recueillies
au cours de notre recherche. Il nous permet de vérifier aussi nos
hypothèses de recherche surtout.
Comme approche méthodologique, nous comptons utiliser
des méthodes permettant d'établir le lien existant entre les
prestations des services des coopératives et la situation
socioéconomique des sociétaires dans la commune de
Port-au-Prince, spécialement au centre ville de Port-au-Prince à
Delmas et à Pétion ville.
1.4.6 TECHNIQUES DOCUMENTAIRES
Pour la réalisation de ce travail de recherche
c'est-à-dire la vérification des hypothèses nous avons
d'abord. Consulté des documents officiels de la République
d'Haïti : des documents du Conseil National des Coopératives (
CNC), de l'Institut Haïtien de Statistiques et d'Informatiques (IHSI), du
Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)
et des études faites par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) Ensuite des mémoires d'étudiants, des
articles de journaux et enfin des oeuvres des Hauteurs qui ont
déjà effectué des recherches dans le secteur
1.4.7 ECHANTILLON
Nous avons utilisé environ cent (100)
sociétaires ayant bénéficié des services des
coopératives dans la commune de Port-au-Prince, particulièrement
au centre ville, de Delmas de Pétion Ville et surtout ceux de la
KOTELAM. On leur a soumis un questionnaire qui nous a permis de collecter les
informations pertinentes sur leur situation socioéconomique, ainsi nous
avons arrivé à la vérification de nos
hypothèses.
1.4.8 Observation directe
Par définition c'est « « Aller voir
sur place, être physiquement présent dans la situation, la
regarder se dérouler en temps réel pour en rendre compte. En un
mot : il s'agit de l'observation du réel et de son compte
rendu » ». A partir de ce que nous avons observé
nous avons approfondi notre savoir à travers cette recherche
scientifique et mieux comprendre la relation existante entre la
coopérative et ses sociétaires et leurs situations sociale et
économique.
1.3.9 Entrevue
Cet outil permet de savoir l'opinion des sociétaires
sur le fonctionnement des coopératives. Nous avons réalisé
notre entrevue à partir d'un questionnaire avec des questions
dirigés c'est-à-dire des questions qui ont rapport directement
à notre recherche.
1.5 LES LIMITES DU TRAVAIL
1.5.1 LIMITE DANS LE TEMPS
Notre travail de recherche s'étend sur une
période de quatre (6) années de l'évolution du mouvement
coopérative de 2003 à 2009.
1.5.2 LIMITE DANS L'ESPACE
Ce travail que nous effectuons pourrait être
nécessaire pour beaucoup de secteur dans le pays. Mais faisant face des
carences d'informations, nous avons considéré la ville de
Port-au-Prince plus spécialement le centre ville, la commune de Delmas
et de peton ville pour mener notre recherche, notre choix de la KOTELAM nous
permettra d'avoir accès plus facile a des informations et aussi elle est
présente dans toutes ces communes.
1.6 LES CONTRAINTES
Nous avons rencontré des difficultés dans la
réalisation de notre recherche. D'abord les données sur les
institutions financières ne sont pas faciles à trouver et non pas
toujours disponible au grand public. Dans les réalisations de notre
entrevue beaucoup de sociétaires refusent de donner les informations
pensant qu'on peut les utiliser à d'autres fins autres que la
vérification de nos hypothèses
CHAPITRE II
LES BANQUES, LES ACTIVITÉS DES
COOPÉRATIVES D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AU REGARD DES
SOCIÉTAIRES : GÉNÉRALITÉS.
A travers ce chapitre nous présentons, selon notre
recherche, l'historique de la coopérative depuis l'antiquité
jusqu'à la période contemporaine, les expériences de
certains pays en Europe et en Afrique. Nous retraçons aussi
l'évolution du mouvement coopératif en Haïti depuis sa
naissance au commencement du 19eme siècle.
2.1 COOPÉRATIVE Le mot
coopération trouve son origine dans la langue latine27(*). Le préfixe `'CO''=Cum
qui signifie : ensemble ou avec, le `'opérer''= opero, as, atum,
avi, oprare qui signifie faire route, mettre en mouvement, travailler,
actionner, agir.28(*)
Quelques définitions du terme
« Coopérative ».
Selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT), c'est
une association de personnes qui se sont volontairement groupées pour
atteindre un but économique commun par la constitution d'une entreprise
dirigée démocratiquement en fournissant une quote-part
équitable du capital nécessaire et en acceptant une juste
participation aux risques et fruits de cette entreprise.29(*) Pour le chercheur
Boucher30(*) « « [...] la
coopérative est une école de formation où chacun apprend
à travailler en groupe et à partager le pouvoir et l'information.
Sa contribution est d'importance à la démocratisation du
milieu » » Le petit Larousse mentionne qu'il s'agit d'un
« Groupement pratiquant la coopération 31(*)», c'est-à-dire
« une méthode d'action économique par laquelle des
personnes ayants des intérêts communs constituant une entreprise
où les droits de chacun à la gestion sont égaux et
où le profit est reparti entre les seuls associes au prorata de leurs
activités 32(*)». D'autre part, on peut lire dans le
dictionnaire de la comptabilité qu'une coopérative est un
« groupement dont l'objet est de réduire, au
bénéfice de ses membres et par l'effort de ceux-ci, le prix de
revient et, le cas échéant, le prix de vente de certains produits
ou de certains services.33(*)
Au niveau de l'Alliance Coopérative Internationale.,
le terme `'coopératif'' eut à connaitre divers changements
interprétatifs. Tout d'abord, en 1895, elle déclarait dans son
article 7 : « L'Alliance ... considère la
coopération comme un terrain neutre, sur lequel les personnes d'opinions
les plus variées et de croyances les plus diverses peuvent se rencontrer
et agir en commun ». A cette époque, la coopérative
était notée comme''...un groupe de personnes qui ont un
même besoin et décide de mettre en commun leur argent pour
résoudre un problème économique34(*). Plus tard, au congrès
de Vienne de 1966, on a eu la définition
suivante : « Une coopérative est une association de
personnes qui ont ensemble un but commun et qui veulent atteindre ce but par le
biais d'une entreprise démocratique, par une juste participation aux
risques et aux fruits de cette entreprise35(*).
Dans la déclaration sur l'identité
coopérative approuvée par l'assemblée
générale de l'Alliance Coopérative
Internationale, au congres de Manchester -23 septembre 1995, elle se
définit comme suit : « Une coopérative est une
association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire
leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs
au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et
où le pouvoir est exercé démocratiquement 36(*)». Une définition
qui s'ajuste a l'évolution du mouvement coopératif par rapport
à son environnement. Selon la Loi sur la coopérative
Haïtienne dans son article 2. La coopérative est définie
comme une association autonome de personnes volontairement réunies pour
satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et
culturelles communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété
est collective et où le pouvoir est exercé
démocratiquement.37(*)
2.1.1 HISTORIQUE DE LA COOPÉRATIVE
Dès le lancement du mouvement coopératif
beaucoup de secteurs de la vie politiques embrassent ce mouvement. La
coopérative se différencie de l'entreprise capitaliste par un
ensemble de principes de base. On parle toujours de démocratie dans le
mouvement avec son principe un homme une voix et la répartition du trop
perçu en fonction des activités et non des capitaux.38(*) Selon un théoricien
français de la coopérative, Charles Gide39(*), il pense que la France peut
devenir une république coopérative, où les principales
activités socio-économiques seraient entreprises sous forme de
coopérative. Cette dernière pourrait être
considérée comme une autre alternative entre le système
capitaliste et le système socialisme. D'autres théoriciens, comme
FAUQUET ou POISSON beaucoup moins catégorique seraient satisfaits
d'avoir un mouvement coopératif à coté des
activités publiques et privées40(*).
Pour beaucoup de théoriciens le mouvement
coopératif est né de la méchanceté du
système capitalisme. Les capitalistes considèrent ces
théoriciens comme des utopistes.41(*)
2.1.2 LES COOPÉRATIVES DANS
L'ANTIQUITÉ
Le Dr Hans Müller, le premier secrétaire de
l'Alliance Coopérative Internationale, dans une étude a quelque
lumière sur l'existence des formes coopératives dans
l'antiquité42(*).
Dans cette étude, il souligne qu'à partir du Vème
siècle avant Jésus Christ et jusqu`au période des
migrations massives, il y avait certainement dans l'ancienne Egypte des formes
coopératives de quelque sorte. Mais, étant données les
conditions économiques et sociales de l'épargne, leur
caractère était bien différents de celles de nos jours.
Dans cette même étude, il dit qu'il a des raisons de croire que
les coopératives existaient aussi en Babylonie43(*).
Il se base sur le code d'Hammourabi44(*), sixième roi du pays,
pour maintenir que la location des terres y avait souvent un caractère
coopératif. Les paysans louaient de large portion de terre qu'ils
cultivaient, soit en commun, pareillement au cas des kolkhozes 45(*) russes, soit individuellement
après les avoir partagés entre eux. D'autre part, il avance que
des formes coopératives similaires aux coopératives agricoles
existaient aussi au sein de l'artisanat et du commerce. Pour d'autres
théoriciens comme Draperie, les confréries d'assistance et de
sépulture de l'antiquité romaine ont apparemment la même
philosophie que la coopérative contemporaine. Cependant, il
considère que les véritables coopératives ont vu le jour
au XIXème siècle46(*) à un moment ou l'industrialisation croit
à un rythme très élevé47(*).
2.1.3 LES COOPÉRATIVES CONTEMPORAINES
Dans le passé, les pratiques visionnaires de certains
moines franciscains qui avaient fondé au xv siècle des monts de
piété présentaient des orientations communautaires.
Toujours en Europe, en 1849, un bourgmestre prussien Friedrich Wilhelm
Raiffeisen, fondé en Rhénanie la première
société coopérative d'épargne et de crédit,
une institution qui offre des services d'épargne aux populations
ouvrières pauvres et exclues des banques classiques. L'épargne
collectée permet de consentir des crédits à d'autres
sociétaires. Ces organismes sont dits mutualistes. Le mutualisme y
compris le financier connait à partir de 1941, un développement
assez exceptionnel au pays basque espagnol autour des coopératives de
Mondragon48(*). Mis
à part le cas de Mondragon les organismes et institutions qui se
développent sur cette base en Europe et en Amérique du Nord,
puis, après la seconde guerre mondiale dans les pays du sud se
focalisent sur l'épargne et offre peu de service de crédit.
2.1.4 LES PRINCIPAUX BUTS DES COOPÉRATIFS
Les coopératives comme toutes institutions
financières ont des buts à atteindre Durant l'évolution du
mouvement, de nombreux coopératifs d'épargne et de crédit
ont été créé et ont principalement pour
buts49(*) :
- De protéger leurs membres contre les revers de
fortune, les résultats du chômage, la maladie et l'indigence en
leur enseignant les bienfaits inappréciables, d'une sage
prévoyance appuyée sur la coopération, notamment, en
faisant naitre et en développant chez eux le goût et la pratique
constante et vigoureuse de l'épargne.
- De leur venir en aide par l'usage sage et prudent du
crédit sous forme de prêt et avances dont l'emploi,
préalablement, communiqué à la société et
approuvé par elle. Est conforme à l'esprit de sa fondation
- De permettre aux personnes dépourvues de fortune,
mais honnêtes et laborieuses, d'en faire partie en leur accordant la
facilité de s'acquitter des parts sociales souscrites par des versements
hebdomadaires très minimes.
- D'assurer la pratique des vertus chrétiennes et
sociales qui distinguent le bon citoyen, le travailleur laborieux et
intègre, en exigeant avant tout des sociétaires emprunteurs des
garanties morales de premier ordre.
- De combattre l'usure au moyen de la coopération, en
offrant à tous ceux qui le méritent par leur amour de travail,
leur habilité et l'honnêteté de leur conduite, le
crédit dont ils ont besoin dans l'exercice de leur état, assurant
leur indépendance vis-à-vis des préteurs qui
prélèvent des commissions ou intérêts exorbitants,
ou de ceux qui imposent d'autres conditions de crédit trop
onéreux
- De féconder l'esprit et le travail local, industriel
ou agricole, par l'emploi prudent de l'épargne produite dans la
circonscription même de la société.
- De répandre parmi ses membres la connaissance
pratique des principes élémentaires de la science
économique
- De leur enseigner le respect de leurs engagements, ainsi que
les avantages qui résultent inévitablement pour ceux qui
remplissent fidèlement les obligations qu'ils ont souscrites.
- De créer et d'accroitre la confiance mutuelle entre
les sociétaires par des rapports économiques basés sur la
foi des garanties d'un ordre élevé, puisqu'elles reposent en
très grande partie sur la moralité, l'honnêteté,
l'ordre, l'amour du travail et de la prévoyance.
2.1.5 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX D'UNE
COOPÉRATIVE
Les principes coopératifs50(*) constituent les lignes
directrices qui permettent aux coopératives de mettre leurs valeurs en
pratique
Adhésion volontaire et ouverte à
tous
Les coopératives sont des organisations fondées
sur le volontariat et ouvertes à toutes les personnes aptes à
utiliser leurs services et déterminées à prendre leurs
responsabilités en tant que membres, et ce, sans discrimination
fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'allégeance
politique ou la religion.
Pouvoir démocratique des membres
Les coopératives sont des organisations
démocratiques dirigées par leurs membres qui participent
activement à l'établissement des politiques et à la prise
de décisions. Les hommes et les femmes élus comme
représentants des membres sont responsables devant eux. Dans les
coopératives de premier niveau, les membres ont des droits de vote
égaux en vertu de la règle « un membre, une
voix : les coopératives d'autres niveaux sont aussi
organisées de manière démocratique.
Participation économique des
membres
Les membres contribuent de manière équitable au
capital de leurs coopératives et en ont le contrôle. Une partie au
moins de ce capital est habituellement la propriété commune de la
coopérative. Les membres ne bénéficient habituellement que
d'une rémunération limitée du capital souscrit comme
condition de leur adhésion. Les membres affectent les excédents
à tout ou partie des objectifs suivants : le developpement de leur
coopérative, éventuellement par la dotation de réserves
dont une partie au moins est impartageable, des ristournes aux membres en
proportion de leurs transactions avec la coopérative et le soutien
d'autres activites approuvées par les membres.
Autonomie et Indépendance
Les coopératives sont des organisations autonomes
d'entraide, gérées par leurs membres. La conclusion d'accord avec
d'autres organisations, y compris des gouvernements ou la recherche de fonds
à partir de sources extérieures , doit se faire dans des
conditions qui préservent le pouvoir démocratique des membres et
maintiennent indépendance de leur coopérative.
Education formation et information
Les coopératives fournissent à leurs membres,
leurs dirigeants élus, leurs gestionnaires, et leurs employés
l'éducation et la formation requises pour pouvoir contribuer
effectivement au developpement de leur coopérative. Elles informent le
grand public en particulier les jeunes et les leaders d'opinion sur la nature
et les avantages de la coopération.
Coopération entre les
coopératives
Pour apporter un meilleur service à leurs membres et
renforcer le mouvement coopératif, les coopératives oeuvrent
ensemble au sein de structures locales, régionales, nationales et
internationales.
Engagement envers la communauté
Les coopératives contribuent au developpement durable
de leur communauté dans le cadre d'orientation approuvées par
leurs membres.
2.2 LA COOPÉRATIVE EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DE
L'EST
Le mouvement coopératif n'avait pas pris beaucoup de
temps pour arriver à s'installer dans presque tous les continents. En
Afrique, ou beaucoup de pays font face à des problèmes
économiques et sociaux, la coopérative avait très vite
organiser à aider les plus pauvres surtout avec l'aide de
l'ACECA51(*) qui les
aident à mobiliser les ressources disponibles pour pouvoir faciliter la
mise en place des institutions devant favoriser aux gens les plus pauvres de
trouver du crédit.
Le mouvement coopératif africain a connu une certaine
stabilité avec la grande assemblée générale de
l'ACECA qui a eu lieu au mois d'août 1969 qui du même coup a
établit le siège de cette association à Nairobi52(*). Cette assemblée avait
été organisée par les représentants de tous les
pays membres environs vingt trois (23) pays. L'association des
coopératives d'épargne et de crédit en Afrique a eu une
ouverture internationale avec son affiliation au conseil Mondial des
coopératives d'épargne et de crédit53(*) qui constituée par un
ensemble d'autres associations telles que : ACCU (Asie) ACECA (Afrique) ;
COLAC (Amérique Latine) CUNA (Etats-Unis d'Amérique. Avec l'aide
de beaucoup de pays plus avancés dans le secteur l'ACECA arrivent
à introduire le mouvement dans d'autres pays d'Afrique et les aider
à apporter des produits financiers qui leur permettaient de porter un
certain soulagement à leurs problèmes économiques et
sociaux.
2.2.1 LA COOPÉRATIVE AU BENGLADESH
Bengladesh est considérée comme un pays
où la coopérative a eu une très grande réussite
surtout avec l'implantation du Gramen Bank54(*) dans les années 70. L'expérience de la
Bengladesh a été reprise dans beaucoup de pays dans le monde
entier. On arrive à créer des institutions qui ont pu aider les
gens les plus pauvres à trouver du crédit, à créer
leur gagne pain et les services financiers qui sont disponibles aux gens des
classes les plus aisées. La Grameen Bank avec ses 7 millions de
bangladeshies pauvres est considérée comme un exemple de
réussite indiscutable partout dans le monde entier, cependant on voit
que la réussite de ce mouvement est beaucoup plus favorable dans les
pays ou la population a une densité très élevée.
L'expérience de la Grameen Bank montre clairement les
pauvres peuvent trouver des moyens pour rembourser les prêts et en
mémé améliorer à un certain niveau leur situation
socioéconomique. Yunus (2003 : 7)
2.2.2 LA COOPÉRATIVE EN FRANCE
Le mouvement coopératif se trouve même dans les
pays développés ou les gens ont plus facilement accès aux
systèmes financiers formels. En France, le microcrédit a connu
une très grande santé économique en luttant contre
l'exclusion bancaire et sociale. C'est ainsi que le Président Chirac a
eu à dire que : « il faut adapter les normes bancaires et
internationales aux réalités de la Microfinance... afin de
libérer sa potentialité.»55(*). Une déclaration qui montre que les gens ont
pris conscience de la potentialité et de l'importance du
microcrédit. Généralement en France, étant un
pays développé, les gens ont doit aux services du crédit
sous deux formes principales. Il y a le microcrédit personnel et le
microcrédit professionnel.
Le microcrédit personnel56(*) est donné aux gens de
petites bourses qui aimeraient avoir une voiture ou un équipement
quelconque. On leur accorde ce prêt à des taux dérisoires
moins de 4% cependant un montant maximum de 3000 euros. Les gens ont pour
obligation de rembourse le montant du prêt ainsi que les
intérêts car on ne fait pas de don et après le
remboursement total les gens n'ont rien à voir avec le bureau de
microcrédit. MAURI, (1995 : 4). L'autre forme du microcrédit
qui est le microcrédit professionnel57(*) aide les gens qui ont des idées
d'entreprendre des activités c'est-a-dire créer leurs propres
activités. Le montant maximum que le membre peut trouver est de 25, 000
euros. En France, les banques mutualistes sont soumises à une
législation particulière du code monétaire et financier,
les banques coopératives les plus populaires sont : le
réseau bancaire du
Groupe
Caisse d'Épargne et des
Banques
Populaires devenu le Groupe
BPCE en 2009. Ce groupe
bancaire regroupe aussi des banques non coopératives (comme
Natixis) , les banques
coopératives du groupe sont :
la Nef, le
Crédit
Coopératif , les Caisses régionales de
Crédit
agricole
Le mouvement coopératif a connu une très bonne
renommée à travers le monde entier après les annexes 70.
C'est ainsi qu'on a assisté surtout dans beaucoup pays d'Afrique la
création de beaucoup de groupement de type coopératif mutualiste.
CHAPITRE III
HISTORIQUE DES COOPÉRATIVES D'EPARGNE ET DE
CRÉDIT EN HAÏTI NOTAMMENT DANS LES COMMUNES DE DELMAS ET DE
PÉTION-VILLE.
Ce chapitre contient, d'abord, une brève
présentation des communes que nous avons approchée à notre
enquête pour recueillir les données devant faciliter la
vérification de nos hypothèses ensuite nous faisons un rappel
historique sur les grandes périodes qui ont marqué la
coopérative en Haïti et, en dernière lieu nous mettons en
évidence la koperativ Tèt Ansanm pou Lavi Miyò (KOTELAM),
celle qui nous a permis de recueillir des données statistiques et nous
faciliter la tâche d'interviewer des sociétaires. En fait, celle
qui nous a permis de réalisé notre travail de recherche.
3.1 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE DELMAS
Au début des années 80, Delmas faisait partie de
la commune de Port-au-Prince. Le décret du 15 décembre 1982 donna
le statut de commune au quartier de Delmas. La première section
communale de Delmas est une ville côtière. Elle possède
cinq sections communales, les habitants de Delmas sont des Delmasiens.58(*)
Selon les données de l'Institut Haïtien des
statistiques et de l'informatique (IHSI), en 1998, la population de la commune
de Delmas était estimée à 296,462 habitants et selon
leurs projections, elle pourra atteindre près de 380,000
âmes59(*) en 2004.
La superficie de la commune de Delmas est estimée à
84.21km2 sa densité était de 3521 habitants/km2 en
1998 et en 2004, elle éteindra près de 4510 habitants/km2
Tableau 1
Tableau représentant la situation
géographique de Delmas
|
Position géographique de la commune de
Delmas
|
|
Coordonnées
|
18° 33? Nord 72°18? Ouest 18.55,-72.3
|
|
Altitude
|
194m
|
|
Superficie
|
2774 ha=27,74km2
|
|
Démographie
|
|
Population
|
359
|
|
Densité
|
12 957,9b/km2
|
Source : IHSI, Recensement 2009, site (
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delmas_(Ha%C3%AFti)),
aout 2009.
3.1.1 EDUCATION
Sur le plan éducatif, Le ministère de
l'éducation nationale de la jeunesse et des sports n'est pas
représenté dans la commune de Delmas. On enregistré (101)
Kindergaten plus de cent soixante dix (170) écoles primaires dont
cinquante (50) publiques et plus de cent vingt (120) privées ont
été inventoriées dans la commune. Trente et une (31)
écoles secondaires dont trois (3) publiques, une (1) de type
communautaire, vingt six (26) privées et une (1) de mission ont
été répertoriées. De plus, on y retrouve
près de dix huit (18) écoles professionnelles, deux (2)
universités et cinq (5) écoles supérieures60(*)
3.1.2 SANTÉ
La commune de Delmas n'avait que (9) hôpitaux dont six
(6) privés et trois (3) publics, un (1) centre de santé avec lit,
deux (2) centres de santé sans lit, dix huit (18)61(*) cliniques et 4 polycliniques
jusqu'à l'année de 1998. On a dénombré environ
cent soixante huit médecins, sept dentistes, soixante dix neuf
infirmières, un personnel qui ne peut en aucun répondre aux
besoins de la population.
3.1.3 RELIGION Comme dans toutes les autres
communes de la capitale, les temples sont vraiment présents. On a eu
plus quatre vingt seize temples ont été répertoriés
dans la commune, les temples les plus retrouvés sont ceux des
pencôtises
3.1.4 POLITIQUE La commune de Delmas a (6)
six représentations de parti politiques légalement reconnus. On
a enregistre quelques organisions populaires surtout au bas de Delmas et un
groupement de femmes. Il y a aussi des organisations internationales et des ONG
qui évoluent au niveau de la commune.
3.1.5 ELECTRICITÉ.
La quasi-totalité de la commune est
électrifiée. On alimente les zones en fonction des
activités qui se trouvent dans la zone, tout dépend si elle est
commerciale ou résidentielle. La commune a un bureau postal qui offrent
deux types de service : au bureau des boites postales sont disponibles
où le client peut venir recueillir ses courriers et en même temps
des employés assurent la distribution des courriers à
l'intérieur de la commune. Un bureau de téléphone, huit
(8) stations de radio, et deux Stations de télévision ont
été également dénombrés dans la
commune.62(*)
3.1.6 COMMERCE ET JUSTICE
La commune de Delmas possédait
environ 5 coopératives, avant la crise de 2002, il y avait environ
treize banques commerciales. Sur le plan de l'hôtellerie on a enregistre
une vingtaine de restaurant et sept hôtels qui répondent plus ou
moins aux besoins de la population.
Concernant les infrastructures Administratives et
juridiques, il y avait pas mal de contraintes, la commune n'avait pas une
présence policière suffisante pour assurer la
sécurité de la commune. Malgré la présence d'un
commissariat et de trois sous-commissariats.
La commune de Delmas est la commune qui
possédait beaucoup plus d'industries. Plus de 250 matériaux de
constructions et un nombre exorbitant au niveau des produits alimentaires, des
grandes boutiques et des dépôts de toute sorte. Grace a ces
multiples entreprises, il y a une très grande circulation dans la
commune d'où la présence de plus de 17 pompe à essence. Le
football reste le sport le plus populaire dans la commune.
L'ensemble de ces données nous donnent une idée
de la situation de la vie des gens dans la commune de Delmas. Nous allons voir
aussi les données de la commune de Pétion ville avant même
d'aborder le point spécifique que nous allons développer.
3.2 COMMUNE DE PÉTION VILLE
L'idée de la fondation de
Pétion ville était mise en branle par le Président Jean
Pierre. Il avait voulu fonder une ville en mémoire des héros de
l'indépendance. Tous les présidents qui sont arrivées sur
le pouvoir après Jean pierre Boyer ont essayé d'apporter soit sur
le plan commercial ou infrastructurel quelque chose à cette nouvelle
ville. Ils ont fait tous ces travaux tous dans le but de montrer leur respect
aux Héros de l'indépendance.63(*)
Les habitants de la commune de Pétion-ville portent le
nom de Pétion-villois. La commune a cinq sections communales. Le climat
varie dépendant de la zone ou l'on se trouve.
Selon les données du recensement de l'IHSI,
en 1998, la population de la commune de Pétion-ville était
estimée à 133005 habitants et en 3004 elle pourra atteindre plus
de 154,000 habitants. Pour une superficie de 137.97 km2, sa
densité était de 1964 habitants par km2 en 1998, elle
atteindra près de 1120 habitants/km2 en
2004.64(*)
3.2.1 EDUCATION
La commune de Pétion-ville
est dotée d'un bureau d'inspection scolaire. On a dénombré
une bagatelle de 40 Kindergaten et plus de 250 écoles de
différentes catégories tant secondaire que fondamentales. Il n'y
avait qu'une école supérieure.65(*).
3.2.2 SANTÉ
La question de santé dans la commune
de Pétion-ville n'est pas trop différente des autres communes du
pays. Le nombre du personnel disponible est vraiment inferieur par rapport
à la taille de la population. Pour toute la population de
Pétion-ville on a décompté environ quarante neuf
médecins, six dentistes, (29) infirmières, quatre vingt une
auxiliaires, soixante dix matrones certifiées. Sept techniciens de
laboratoire et huit (8) radiologues ont été
dénombrées au sein de l'établissement sanitaire de cette
commune.
3.2.3 RELIGION
Il existait plus de 400 temples de différentes
religions dans la commune de Pétion-ville. De même que les autres
communes les temples pencotises se trouvent en tête de liste en
matière de nombre de temples religieux.
3.2.4 COMMERCE ET FINANCE
La commune de Pétion-ville est l'une des communes du
pays qui possèdent beaucoup plus de restaurant et d'hôtels que
toutes les autres communes. La même recherche de l'IHSI montre que
Pétion ville a quinze (15) hôtels, vingt cinq restaurants et huit
banques.une coopérative et trois centres de coopérative de
commercialisation66(*)
Vingt trois (23) markets (Grant et petit), vingt trois grandes
boutiques, quinze centre de provisions alimentaires, dix matériaux de
construction dix dépôts gazeuses, et autres articles divers, huit
(8) stations d'essence, quatre (4) morgues privées, quinze pharmacies,
des librairies, des shops et autres forment établissement commerciaux et
économiques de la commune. La commune de Port-au-Prince a eu sa
première caisse d'épargne et de crédit en février
1952 connu sous le nom de caisse populaire Ste Anne. Cette caisse a
été gérée par le révérant Père
Kébreu Emmanuel. 67(*)
3.2.5 CULTURE ET LOISIR
La commune possède plusieurs salles
dansantes, des boites de nuits qui assurent la vie nocturne dans la ville. Il y
a des lieux historiques naturels, deux bibliothèques68(*). Les oeuvres artisanales sont
vraiment présentes dans la commune de Pétion-ville. Il existe une
très grande quantité de galerie d'art un peu partout à
Pétion-ville.
Histoire du mouvement coopératif en
Haïti
3.3.1 LA GENÈSE DU MOUVEMENT COOPÉRATIF
HAÏTIEN
Le mouvement coopératif de part son objectif et son
mode de fonctionnement a un début presque identique dans beaucoup de
pays ou se trouve le mouvement. Au commence du 20eme siècle
soit dans les années 1906, les premières idées de
coopérative d'épargne et de crédit (CEC), étaient
véhiculées par le docteur Louis Joseph Janvier69(*) en Haïti. En 1936,
le Syndicat des Producteurs de Pommes de Terre à la vallée de
Jacmel a été créé à l'initiative du
Père Bonneau (Curé de la vallée) avec comme collaborateur
Granville Laroche. Ce Syndicat qui était en fait une coopérative
de producteur de Pomme de Terre. Le terme syndicat ayant été
improprement employé.70(*)
3.3.2 LES FORMES DE COOPÉRATIVES MODERNES EN
HAÏTI
Le mouvement coopératif Haïtien a connu plusieurs
étapes selon des théoriciens de ce mouvement. Pour certains on
avait eu une coopérative moderne dans l'année 1937 avec
l'expérience d'Elie Vernet (ou Elimec Vernet) à port-`a-piment du
Nord. Cette coopérative a été fondée avec des
cultivateurs de l'époque.71(*) Depuis cette époque, on a assisté
à la création de beaucoup de coopératives dans plusieurs
villes du pays. En 1937, la coopérative de Port à Piment du nord
fut créée .La période 1946-1953 allait être la
période d'implantations des premières caisses populaires. Le 22
septembre 1946, la caisse Populaire - La Petite Epargne de la Vallée de
Jacmel fut fondée72(*). Elle avait pour objectif principal d'aider les plus
démunis de la région. Le 27 mars 1946, la Caisse Populaire
Ste Anne de Camp-Perrin73(*) fut créé avec également pour
objectif de soulager la misère des plus démunis. Le 3 novembre
1946, la coopérative d'Epargne et de Crédit de Cavaillon fut
créée. L'année 1949 vit la création de la
première Caisse Populaire des cayes.
3.3.3 L'ÉPANOUISSEMENT DES CAISSES D'EPARGNE ET DE
CRÉDIT.
Entre 1949 et 1953, grâce au concours du Père
Henn Langlais fondateur de la Caisse populaire de Camp-Perrin (1946) et au
support du service coopératif Interaméricain de Production
Agricole (SCIPA) 41 Caisse Populaires furent fondée dans le pays dont
11 dans l'Ouest et le Sud-est, 6 dans le Sud, 8 dans le Centre et l'Artibonite
7 dans le Nord et le Nord Ouest etc. Pendant la même période
d'autres Caisses furent créée telle la Force Paysanne à
Marbial (15 juin1950) la Caisse Concorde (Artibonite 1950), la première
Caisse populaire de la capitale Caisse populaire St Gérard (septembre
1951). Au 31 décembre 1952 47 Caisses populaires étaient
dénombrées à travers le pays ;
Les Caisses populaires fondées au cours de cette
période étaient presque toutes l'initiative des prêtes
(Curé Pères Oblats) dans le Sud et de pasteurs et avaient pour
mission des produits et services financiers aux plus pauvres. Elles constituent
donc des institutions de Microfinance a part entière
Au cours des années 60 avec la montée des
coopératives a travers tout le pays la législation Haïtienne
a déjà pris des décisions importantes en donnant le statut
de personnalités civiles aux coopératives par le décret du
27 octobre 196074(*) en son article 18. Les
autorités étatiques n'étaient pas hostiles au mouvement.
Car ils pensent qu'elles peuvent créer des bases pour assurer le
développement économique des plus démunis75(*). C'est pour cela que le Dr
François DUVALIER a déclaré que
« « Les coopératives pourraient
représenter l'avenir de la nation76(*) » ». Une
déclaration qui montre l'importance donnée a ce mouvement qui se
distingue des autres de trois (3) façons77(*) d'abord a) participation à la
propriété b) participation au pouvoir c) participation aux
résultats. En fait c'est une entreprise faite par et pour ses
sociétaires.
La majorité des coopératives sont fondée
sur l'initiative des religieux. La possibilité qu'ils ont de trouver un
groupe de personnes qui se réunissent chaque semaine leur donnent cet
accès78(*). Cet
ainsi Christian Girault a eu à penser que si les hommes religieux
laisseraient tomber ce mouvement la majorité des coopératives
connaitraient leur effondrement de manière très vite.79(*)
3.3.4 L'IMPACT DES DÉCISIONS POLITIQUES SUR LA
COOPÉRATIVE EN HAÏTI
La situation politique du pays, avec l'arrivée du
Président François DUVALIER va marquer une lenteur dans la
création de nouvelles caisses populaires dans le pays. La période
1950- 1969 va marquer un net ralentissement du mouvement des caisses populaires
en Haiti.il n y eut que quatre à voir le jour 2 dans le Nord, 1 dans le
Sud et 1 dans l'Ouest. La première caisse populaire de Pétion
Ville (23 mars 1963). Cette période politique a été
très hostile à toute forme d'association et a freiné le
mouvement au cours de la période 1946-1953.
Au cours de la période 1970 jusqu'à 1979 le
mouvement des caisses populaires allaient connaitre un certain regain avec la
création de 11 caisses dont 4 dans le Nord 1 dans le Sud et six dans
l'Ouest. Face à ce regain de confiance la législation
haïtienne avait pris des décisions, comme le décret du 27
octobre 1960 et selon l'article 18, elle donne la personnalité civile
aux coopératives constituées.80(*)
Pour garantir la continuité du mouvement
coopératif. Les dirigeants des coopératifs Haïtien
cherchaient avoir une reconnaissance internationale en essayant d'avoir une
place dans les organisations internationales. Ainsi, Haïti faisait parti
des membres fondateurs de la Confédération des
Coopératives de la Caraïbe et du Centre Amérique.81(*)
La période 1980-1994 verra une véritable
flambée du mouvement des coopératives d'épargne et de
crédit avec la fondation de 18 caisses dans le Sud est et 7 dans e
Nord. Cette remontée a permis à environ 38000 familles82(*) de
bénéficiées des produits de la coopérative avec un
chiffre d'affaire d'environ 21, 000,000.00 gdes. Une situation qui demandait
encore la participation de beaucoup de secteur de la vie économique pour
assurer la continuité du mouvement.83(*)
Les gouvernements ne sont pas restés
indifférents face à la montée du mouvement
coopératif c'est ainsi le 1er mai 1988 son Excellence
Monsieur le Président Lesly Manigat a proposé la création
d'un `'bien rural coopératif `'. Le gouvernement
voulait mettre des portions de terre du domaine privé de l'état
à la disposition de certaines coopératives rurales. Dans les
milieux ou les conditions sont possibles.84(*) Les autres gouvernements qui succèdent celui
de son excellence Manigat n'ignorait pas l'importance du mouvement
coopératif car le président Jean Bertrand ARISTIDE a eu à
évoquer article 1 de la constitution Haïtienne Une
république, indivisible, souveraine, indépendante,
coopérative85(*)...
pour montrer son attachement au mouvement coopératif. Ces
décisions nous référent à la théorie de
Dominique GENTIL dans son livre `' Les pratiques coopératives en milieu
rural africain'' qui dit86(*) : « En règle
générale, les évolutions coopératives ont à
la fois leur rythme propre et sont dépendantes des changements dans leur
environnement économique et sociologique »
Selon un recensement du RMCH il existait environ 79 caisses
populaires dans le pays et on assistait à une augmentions très
vite avec environ 348 en 1999.87(*) Ce nombre de coopératives exorbitant qui se
trouvent dans le pays à causer pas mal de problèmes car, le
Conseil national des coopératives n'a pas pu réguler la situation
des coopératives dans leur fonctionnement malgré la mise en
application de beaucoup de décret comme celui de 198188(*) régissant les
coopératives.
La période 1994-2004 aura été
marquée par la création des coopératives offrant de
taux de 10 à 12% les mois sur les
dépôts à terme. Elles connurent une grande
débâcle au cours du premier semestre de l'année 2002 et ont
par la favorise l'émergence d'une nouvelle législation (loi du 9
juillet 2002) sur les coopératives d'Epargne et de Crédit. En
2003, 121 caisses populaires disposant d'un actif de plus d'un million de
gourdes ont été recenses.
Présentation de la coopérative
KOTELAM
3.4.1 A) LA CONSTITUTION DE LA KOTELAM
La Koperativ Tèt Ansanm pou Lavi Miyò (KOTELAM)
est une caisse d'épargne et de crédit fondée le 28
novembre 1989. Cette initiative a été prise par Monsieur Frantz
PRINVIL qui véhiculait cette idée un peu partout dans le
pays.89(*).
3.4.2 SIÈGE SOCIAL ET
TERRITOIRE : La KOTELAM a son siège social
à Port-au-Prince, plus spécialement à l'avenue Magloire
Ambroise, cependant, l'administration a le droit de changer l'adresse à
n'importe quel moment dans le département. Suivant la loi du 26 juin
2002 la kotelam ou toute autre caisse n'a le droit d'avoir des comptoirs que
dans le département ou elle a son siège social. Comme toute
institution elle a des objets.
3.4.3 MISSION ET OBJECTIF DE LA KOTELAM
La KOTELAM a notamment pour mission 90(*) : De collecter
l'épargne de ses membres en vue de les faires fructifier ; De
consentir du crédit à ses membres ; D'offrir tout autre
service financier dans l'intérêt de ses membres ; De
favoriser la solidarité et la coopération entre les Kotelamistes,
la KOTELAM et d'autres organismes coopératifs ; De promouvoir
l'éducation économique, sociale et coopérative etc.
L'objectif à court terme de la
Kotelam : avoir un portefeuille de crédit de 300 millions de
gourdes ; atteindre 90 mille sociétaires a la fin de l'exercice
2014-2015 ; avoir deux nouvelles succursales dans la zone
métropolitaine ; interconnecter les comptoirs. A moyen terme ;
donner tous les services financiers que les sociétaires ont besoin et a
long terme avoir une couverture surtout le département de l'ouest,
développer de nouveau partenariat avec d'autres caisses soeurs ;
faire de la coopérative l'un des meilleurs choix des agents
économiques.
3.5 LES MEMBRES : IL EXISTE TROIS CATÉGORIES
DE MEMBRES À LA KOTELAM : LES SOCIÉTAIRES OU MEMBRE
RÉGULIER, LES MEMBRES AUXILIAIRES ET LES SOCIÉTAIRES
INACTIFS.
3.5.1 LES SOCIÉTAIRES ACTIFS OU MEMBRES
RÉGULIERS : Ce sont ceux qui répondent
à toutes les conditions d'admission. Ils sont libres d'exercer tous les
droits que leurs accorde le privilège d'être membre
régulier. Entre autres, ils ont droits de vote à
l'Assemblée Générale et ont la possibilité
d'être élus dirigeants.
3.5.2 LES MEMBRES AUXILIAIRES Les membres
auxiliaires91(*) sont des
personnes mineures et des personnes morales. Ils ont droit aux services de la
caisse. Ils ne peuvent détenir que des parts permanents. Ils n'ont pas
de droit de vote et ne sont pas éligibles non plus à aucune
fonction au sein de la caisse
3.5.3 LES SOCIÉTAIRES INACTIFS Les
sociétaires inactifs sont des membres de la caisse qui ne font pas de
transaction avec la caisse depuis plus de douze (12) mois. Ils n'ont pas donc
pas droit de vote et ne sont pas éligibles non plus à aucune
fonction au sein de la caisse, jusqu'à ce qu'ils recouvrent leur statut
de membres actifs.
3.5.4 DOITS ET DEVOIRS DES SOCIÉTAIRES
Les sociétaires de la caisse ont le droit de :
a) voter aux assemblées générales
b) se porter candidat aux divers postes des membres des
conseils et comités ;
c) consulter le registre de la société et les
documents prévus aux statuts
d) réaliser avec la société toutes les
opérations décrites dans les statuts
Comme dans toute société ou les gens ont des
droits ils ont aussi des devoirs à la
KOTELAM aussi les sociétaires ont des devoirs ; de respecter les
statuts et les règlements internes ; de se conformer aux
décisions de l'assemblée générale et du conseil
d'administration de la société ; d'effectuer
régulièrement des transactions avec la
société ; de participer aux assemblées
générales
3.5.5 LES PRODUITS DE LA KOTELAM
Les différents92(*) types d'épargne offerts par la KOTELAM
a) Epargne à vue, Epargne spécialisé
b) Epargne à terme, Epargne boni ou Epargne sol
c) Epargne en dollars US, Dépôt direct
Autres services
a) Transfert d'argent via money gram
b) Attestation de capital, Achat et vente de dollars US.
3.6.1 LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRÊTS DE LA
KOTELAM
a) Prêt normal ou prêt personnel pour les
commerçants, les employés et les employeurs
b) Prêt sur salaire pour les salariés
c) Prêts sur Carnets
d) Petits crédits ou `'Kredi Jaret''
NB. Tous ces prêts sont accordes avec un taux
d'intérêts dégressifs93(*)non pas un taux 94(*) linéaire.
3.6.2 LES CONDITIONS D'AVOIR ACCÈS AU CRÉDIT
À LA KOTELAM
Pour avoir accès au crédit, le membre doit
remplir les conditions suivantes95(*) :
` En général à la KOTELAM on donne du
crédit à une personne qui ;
a) a une activité qui lui permet d'avoir un salaire
mensuel ou un revenu qu'on peut identifier
b) est majeur mais ne pas être âge de plus de 65
ans (sauf si le prêt est garantie totalement par l'épargne
à la caisse) ;
c) qui fait partie des sociétaires actifs ou appart
entière et on utilise le crédit individuel96(*) comme méthode pour
accorder les prêts.
3.6.3 POUR UNE PERSONNE QUI EST UN EMPLOYÉ IL LUI
FAUT ;
a) Une lettre récente (moins que trois mois)
b) Une Copie de la souche de son dernier cheque, de sa fiche
de paie, ou de son livret d'épargne
c) Une copie de son contrat de bail ou de son titre de
propriété
d) Un pro forma, un devis ou quelque chose d'autre que le
comité peut demander pour prouver le besoin à satisfaire, ou
l'objectif à atteindre.
e) Une photo d'identité.
f) Une pièce d'identité soit Passeport, Permis
de conduire, carte d'identification etc. mais cette pièce doit
être livrée par l'Etat
e) Trois personnes de références leur nom,
adresse et téléphone Un avaliseur, si ce dernier est un
employé, il lui faut ; une lettre récente et une copie de la
souche de son dernier cheque ou fiche de paie ou de son livret
d'épargne. Si elle est un commerçant ou une commerçante il
lui faut ; sa patente et une pièce d'identité après
on fera une évaluation de son stock pour pouvoir déterminer sa
capacité.
f) une épargne obligatoire97(*) couramment appelé cash
collatéral, comme toute autre entreprise financière on paie un
frais de dossier de 3%98(*) au moment du décaissement. Ce frais est
obligatoire pour tous. Sauf pour un prêt sur salaire
3.6.4 POUR LES COMMERÇANTS (TES) IL FAUT ;
a) Etre membre de la caisse c'est-à-dire avoir un
livret
b) Avoir une copie de son contrat de bail ou de son titre de
propriété
c) Avoir un stock de marchandises disponible
d) Avoir trois personnes de références, leur
nom, adresse et téléphone
e) Dégager une capacité après
évaluation prouvant que la personne est en mesure de rembourser le
prêt.
f) Avoir un avaliseur avec les mêmes conditions que
celui du salarié
3.6.4 LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENTS
Le remboursement est fait suivant la capacité
financière du sociétaire et suivant ce qui a été
dit dans la reconnaissance de dette. Il ne peut être modifié sauf
qu'en cas de renégociation. Chaque remboursement comprend normalement
une partie en capital et en intérêt. Le remboursement se fait
mensuellement. Si le prêt est en retard le membre aura à payer le
capital plus les intérêts plus les pénalités. -Si
les informations fournies par le membre sur la demande d'emprunt
s'avéraient fausses ou si les conditions du prêt ne soient pas
respectées, le prêt pourrait être exigible en tout temps
3.6.5 CADRE LÉGALE DES COOPÉRATIFS
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT.
Les coopératives d'épargne et de crédit,
comme toutes les autres institutions financières du pays, ont un cadre
légal qui régit leur fonctionnement. Les caisses populaires ont
pour boussole la loi du 22 juillet 2002. Cette loi a
été élaborée après les moments difficiles
qu'a connu le mouvement coopératif au début des années
2000. Cette loi comporte 151 articles. Chacun de ces articles traite un point
sur la coopérative. A travers cette loi, les coopératives ont un
même droit et une manière unique de fonctionner. Les
coopératives se trouvent maintenant sur les ordres de la banque centrale
en passant par le Conseil National des Coopératives. A partir de cette
décision, on définit les différents composants que peuvent
avoir les coopératives et les rôles des dirigeants. A travers
l'article on a définit les sigles relatifs a la coopératives pour
éviter d'avoir plusieurs interprétations des concepts. Au niveau
de l'article 40 on indique la manière dont on doit faire
l'assemblée générale. De l'article 146 à 150 on
parle des dispositions transitoires et finales sur les coopératives
d'épargne et de crédit. Nous pouvons dire cette loi a une
importance capitale pour la pérennité de ce mouvement combien
important dans l'économie Haïtienne qui fait face à pas mal
de difficultés.
CHAPITRE IV
LES DIFFICULTÉS D'ACCÈS AU CRÉDIT
DES SOCIÉTAIRES POTENTIELS AU PRÈS DES BANQUES AU REGARD DES
ACTIVITÉS DES COOPÉRATIVES D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
NOTAMMENT LA KOTELAM DANS LES COMMUNES DE DELMAS ET DE PÉTION-VILLE
(2003-2009)/VÉRIFICATION DE L'HYPOTHÈSE SECONDAIRE I.
Nous avons vérifié notre hypothèse
secondaire I à partir des différents titres que nous avons
développés au cours de cette partie de notre travail. Nous avons
fait un panorama du crédit dans le système bancaire en
Haïti. Nous avons aussi présenté des données
comparatives sur la situation des différents secteurs qui
évoluent dans le système de la microfinance pendant
l'année 2009. La dernière partie se compose des différents
types de difficultés qui rendent l'accès difficile auprès
du système bancaire.
4.1 LE FONCTIONNEMENT DU CRÉDIT EN
HAÏTI.
Au niveau du secteur formel haïtien, l'accès au
crédit des gens qui ont de faibles revenus est difficile à cause
de nombreux problèmes qui sont liés, soit à la mauvaise
gouvernance du pays en général soit au fonctionnement du secteur
financier. Nous allons tenter d'identifier les problèmes auxquels que
font face cette catégorie de la population qui constituent en partie
l'espoir et l'avenir de ce pays.
D'abord, dans tout pays ou le système capitaliste
fonctionne normalement, il existe des conditions fondamentales qui peuvent
donner à quelqu'un d'avoir accès au crédit et en
même temps donner une certaine garantie aux entrepreneurs la
possibilité d'assurer le recouvrement des argents empruntés aux
clients ou aux sociétaires. La situation est très difficile en
Haïti par rapport à l'irresponsabilité de nombreuses
entités Etatiques.
La majorité des institutions bancaires étaient
des banques commerciales en 2003, on a eu : deux (2) banques commerciales
d'État, neuf (9) banques à capitaux privés haïtiens
dont sept(7) banques commerciales et deux (2) banques d'épargne et de
logement, et deux (2) succursales de banques étrangères. Arriver
en 2009 la configuration n'a pas changé. Le pays n'a connu aucune
banque de développement. On a seulement la Banque Interaméricaine
de Développement sur la place mais qui a une mission toute à fait
particulière. Tenant compte de la mission et de l'objectif des banques
commerciales il parait difficile de connaitre un vrai développement.
La majorité des institutions financières
confrontent des problèmes communs et sont presque dans
l'impossibilité de porter des solutions immédiats qui peuvent
garantir la pérennité de leurs entreprises. Faisant face à
ces difficultés de toutes sortes, le crédit devient de plus en
plus difficile surtout au niveau des banques commerciales qui gèrent
l'argent des actionnaires. Avant de soulever quelques problèmes qui
empêchent les gens à faibles revenus d'accéder au
crédit selon les dirigeants des institutions financières, nous
allons voir la situation générale du pays par rapport à
l'ensemble des institutions de Microfinance.
Les institutions bancaires, avec les multiples conditions
à remplir pour avoir du crédit restent les institutions les moins
accessibles pour avoir du crédit surtout pour les gens qui n'ont pas de
grands revenus et des garanties qui peuvent répondre au crédit en
cas de catastrophe ou de faillite. Pour vérifier notre hypothèse
nous tenons à voir la situation des institutions bancaires au niveau de
portefeuille de crédit et l'épargne pour tout le pays pour que
nous puissions avoir une idée de la situation
4.1.1 LE PORTEFEUILLE DE CRÉDIT DES BANQUES
COMMERCIALES
Les banques occupent une place très importantes dans
toute économie capitaliste qui sont ; soit en évolution soit
pour garantir une stabilité économique. Le crédit reste la
pièce maitresse de toutes ces sociétés, car de nos jours
aucune societé ne peut pas connaitre de réussite sans donner une
certaine facilité aux anciens et à tous investisseurs potentiels
l'accès au crédit. Cependant nous avons constaté une
situation différente dans l'économie haïtienne.
À la fin de l'année fiscale 2001
c'est-à-dire au 30 septembre 2001, la situation du portefeuille de
crédit du système bancaire99(*) se présente comme suit : 10,6 milliards
de gourdes de prêts dont l'encours est supérieur à 75,000
gdes. Les prêts100(*) à court terme s'élèvent
à environ 6,3 milliards de gourdes pour un total de 2,095 emprunteurs,
1.5 milliards de gourdes à moyen terme à un nombre de 2,166
clients et 2,8 milliards de gourdes pour des prêts à long terme
pour 1962 clients. Au cours de cette année on a constaté
qu'environ 12 milliards de gourdes ont été
décaissé.101(*)
Pour arriver en 2005 la situation ne s'améliorait pas.
Les gens aux petits revenus ne trouvent pas toujours des portes de sortir.
L'économiste Fritz DESHOMMES a eu à dire qu'il y a une sorte
de subvention des riches emprunteurs par les gens de petits revenus qui
essayent de faire de l'épargne102(*). Selon le rapport de la Banque de la
république d'Haïti103(*) (BRH), 80% des crédits accordées sont
faits par une minorité qui évaluait à environ 10 % des
emprunteurs104(*) et ils
ont eu des montants qui dépassent les 500 milles gourdes. Ces chiffres
montrent que le crédit bancaire est destiné aux gens qui ont
déjà un minimum de moyens économique et qui appartient
à une catégorie sociale plus ou moins élevée.
Pour beaucoup d'économistes qui analysent
l'économie haïtienne, ils concluent que l'économie
haïtienne est confrontée aux contraintes multiples, mais
particulièrement structurelle, elle aussi frappée d'une crise de
bancarisation. Le budget de la république d'Haïti ne
représente plus un outil pour orienter la politique
macroéconomique dans ce pays mais plutôt pour garantir de petits
projets de substitution. La politique monétaire en vigueur favorise le
haut taux d'intérêt et pénalise l'investissement local
contrairement à ce que les autorités prônent dans
l'élaboration de leur politique économique.
Nous nous referons à une étude
réalisée en 2009 pour appréhender les problèmes
dans le secteur du crédit en Haïti. La majorité du
crédit donné en Haïti vient du secteur de la Microfinance
car elle favorise en partie aux gens de trouver du crédit en
dépit de toutes les difficultés que les clients peuvent
confronter.
4.1.2 LA SITUATION DES INSTITUIONS DE MICROFINANCE EN
2009
Dans la recherche de la vérification de notre
hypothèse basant sur les difficultés des gens d'avoir
accès au crédit nous avons considéré une
étude qui a été menée en 2009 par l'USAID sur
l'évolution des institutions de Microfinance. On a
considéré un échantillon de plus de 81
institutions105(*) pour
la réalisation du travail un nombre valable pour secteur à
l'étude.
Selon une étude menée auprès des
institutions de Microfinance on a enregistré au 30 septembre 2009 la
situation suivante. L'actif total du secteur formel de la Microfinance
s'élève à 6.9 milliards106(*) de gourdes et est réparti entre 196
institutions regroupées en quatre catégories (CEC, IMF
affiliées aux banques, ONG, et autres). Nous avons quatres (4)
institutions de Microfinance qui sont affiliées à des banques
commerciales,
Pour un total de 233,186 emprunteurs environ
dans le pays on a un portefeuille de 4.4
milliards de gourdes. Le montant de l'épargne du
secteur à la fin de l'année fiscale était estimé
à 3.1 milliards de gourdes pour 951,755
déposants. Les coopératives d'épargne
et de crédit (CEC) occupent la première place en termes
d'épargne des déposants avec un total de 70.65 %
environ.107(*)
Les coopératives d'épargne et de crédit
se trouvent aussi en première place en terme de montant de portefeuille.
Elles facilitent une plus grande partie de la population en
nécessité d'avoir accès au crédit avec leurs
très faibles moyens économiques et leur situation sociale si
difficile. Nous présentons la situation dans le tableau ci-dessous
Tableau 2
Situation globale du secteur de microfinance en
2009
Volume (en HTG)
|
Type d'IMF
|
Portefeuille
|
%
|
Dépôts
|
%
|
|
CEC
|
1,776,405,485
|
39,95%
|
2,208,859,824
|
70,65%
|
|
Banques
|
1,304,747,068
|
29.34%
|
15,919,238
|
0.51%
|
|
ONG
|
236,897,099
|
33%
|
51,809,269
|
1.66%
|
|
Autres
|
1,128,918,013
|
25,39%
|
849,763,764
|
27,18%
|
|
Total
|
4,446,967,664
|
100.00%
|
3,126,352,095
|
100.00%
|
|
Structure du secteur
|
# emprunteurs
|
%
|
# deposants
|
%
|
|
CEC
|
46,320
|
19,86%
|
598,620
|
62.90%
|
|
Banques
|
28,719
|
12.32%
|
7,246
|
0.76%
|
|
ONG
|
33,659
|
14.43%
|
37,001
|
3.89%
|
|
Autres
|
124,488
|
53,39%
|
308,888
|
32.45%
|
|
Total
|
233,16
|
100%
|
951,755
|
100.00%
|
Source : Tableau réalisé à
partir de l'Etude réalisée sur les institutions de microfinance
en 2009, à Port-au-Prince, par stratégie management groupe,
p32.
Le tableau ci-dessus montre de manière chiffrée
la situation au niveau des différents secteurs qui évoluent dans
le microcrédit. Nous arrivons à comprendre aussi la partition des
coopératives d'épargne et de crédit dans la vie
économique des gens tant au niveau de l'épargne que de
crédit. Une situation qui montre que se sont les institutions qui sont
formées par et pour la population qui donnent leur donnent beaucoup plus
de services financiers et non pas les institutions importées comme les
organisations non-gouvernementales (ONG).
4.2 LES DIFFÉRENTES SOURCES DE
DIFFICULTÉS
Au cours de cette étude,
nous avons tenté de voir les difficultés qui
empêchent les instituions bancaires de donner du crédit. Selon
notre recherche nous avons pu constater que les difficultés viennent de
sources différentes. Il y a des difficultés qui sont liées
au fonctionnement des sociétaires soit volontairement ou non et des
difficultés qui sont liées à la politique mise en place
par les institutions financières. A travers notre étude nous
voyons que l'Etat est aussi responsable dans la difficulté des gens
d'avoir accès au crédit.
4.2.1 LES DIFFICULTÉS VENUES DES INSTITUTIONS
ÉTATIQUES.
Les difficultés auprès des banques augment
surtout avec celles de l'état haïtien une situation qui rend les
banques encore moins accessible car au niveau des banques on tient comptes
beaucoup de tous ces détails pour pouvoir mieux garantir le recouvrement
en cas de difficultés de paiement auprès d'un quelconque tierce
personne. Ces mesures sont souvent favorables aux actionnaires, mais elles
pénalisent très fortement les sociétaires potentiels car
elles créent beaucoup plus de barrière. Voyons quelques
contraintes venus des institutions étatiques.
4.2.2 L'ADRESSE
Une très grande majorité de la population a un
problème d'adresse. Le problème de l'exode rural favorise la
création et augment beaucoup de bidonville dans le pays surtout au
niveau de la région métropolitaine. Les adresses peuvent changer
de temps à autre une situation qui peut être très
compliquée pour les institutions financières au cas où le
membre donnerait des problèmes dans le remboursement du prêt. Il y
a toujours une prolongation dans les adresses. La grande majorité de ces
prolongations sont des bidonvilles ou le chaos fait rage dans les adresses. Il
n'existe pas vraiment aucune institution de régularisation dans le
secteur. Le déplacement d'un citoyen d'un quartier à un autre
n'est pas contrôlé. Le contrôle du nombre d'habitants par
km2 reste selon la volonté des habitants. Une situation
vraiment catastrophique.
4.2.3 LE PROBLÈME D'IDENTIFICATION
Le problème d'indentification a toute son importance
dans le processus d'octroi du crédit en Haïti. Même au niveau
de l'Etat qui devrait assurer l'identification des gens le problème se
pose. Un numéro d'identification peut être valable dans une
institution quelconque et non dans une autre. Un citoyen a doit à deux
pièces, un numéro d'immatricule fiscale (NIF) et une carte
d'identification Nationale communément appelé CIN. Une
sociétaire peut décider d'utiliser ces deux pièces dans
deux institutions différentes pour lui faciliter l'accès au
crédit en donnant de fausses adresses et de fausses informations.
Il n'existe pas un point commun entre les pièces
d'identification émises par les autorités étatiques. La
seule chose qu'on pourrait utiliser comme point commun c'est la photo de la
personne qui parfois peut être à peine visible dans la
pièce. Un problème qui peut paraitre pas trop grave mais qui peut
avoir des conséquences néfastes dans le suivi du dossier.
4.2.4 ASSURANCE
Le problème
d'assurance108(*)est présent au niveau des couches les plus
défavorisées. Les petites et moyennes entreprises n'ont
pratiquement aucune police assurance. Ces entreprises restent des institutions
très fragiles face aux catastrophes naturelles et aux troubles
politiques. Au cas ou l'un de ces malheurs arrive les institutions
financières sont directement des victimes car ils n'ont d'autres moyens
soit de refinancer les victimes ou de radier ces prêts. Un autre
problème de plus qui pousse les institutions bancaires à diminuer
le nombre de client qui se trouvent dans ces situations.
4.3 LES DIFFICULTÉS DU CÔTÉ DES
EMPRUNTEURS
Dans cette partie nous énumérons quelques
difficultés du coté des emprunteurs. La plupart de ces
difficultés viennent surtout dans la formulation de la demande
auprès des institutions. La grande majorité des emprunteurs ne
savent pas vraiment comment élaborer un plan d'affaires pour arriver
à convaincre les prêteurs. Ils font choix de n'importe quel
secteur pour investir. Les banques essayent surtout de financer les gens qui
entreprennent les activités qui donnent des résultats à
cours terme car le client aura à rembourser l'argent mensuellement. Les
prêts à long sont beaucoup plus risquées et plus difficile
dans à rembourser durant les derniers versements si le membre n'a pas pu
réaliser un bon fond déroulement.
4.3.1 LE SECTEUR D'INVESTISSEMENT.
Le secteur choisi par les emprunteurs pour investir l'argent
des banques peut être lui aussi confère comme une barrière
dans l'octroi des prêts. Il existe des secteurs qui sont des cancers pour
l'environnement. Si nous considérons comme exemple, les gens qui
achètent du charbon de bois dans les villes de province pour les
revendre au niveau des villes surtout dans la région
métropolitaine. Cette dernière est l'activité principale
qui entraine la dégradation de notre environnement.
Beaucoup de banques commerciales n'acceptent pas de financer
ces gens d'activités. Il existe encore d'autres commerces qui sont
interdits par l'Etat comme la vente de la drogue, la culture du cannabis et
tant d'autres encore.
4.3.2 SOLVABILITÉ
La solvabilité109(*) constitue un problème pour un bon nombre de
clients ou de potentiels sociétaires qui n'ont pas pu avoir du
crédit au niveau du secteur formel. Une grande majorité de client
sollicite des prêts le plus souvent quand elle se trouve dans des
situations difficiles à résoudre non pas pour augmenter ou
créer de nouvelle institution. Cette catégorie fait face souvent
à ce problème de solvabilité.
Il y a des gens qui sollicitent des montant très
élevés pour que même si on fait une réduction il
pourrait utiliser le reste pour leur atteindre objectif, cette méthode
découle le plus souvent sur un refus total de la demande car dans ces
genres de cas le membre ou le client peut paraitre totalement en dessous du
minimum d'épargne demandé pour pouvoir faire du crédit.
4.4 LES BARRIÈRES LIÉES DIRECTEMENT AUX
BANQUES
Les critères établis par les banques
commerciales constituent des barrières en quelque sorte pour une
très grande catégorie des gens qui veulent solliciter des
prêts. Les banques ne veulent pas prendre n'importe quels risques. Elles
prennent des risques calculés. Pour éviter des problèmes
de recouvrement. Ces contraintes sont néfastes pour les clients mais
elles garantissent une certaine pérennité dans l'existence de ces
institutions pour éviter qu'elles fassent faillites.
Le crédit représente un élément
clef dans les recettes de ces institutions c'est-à-dire les trop
perçus ou les dividendes cependant une mauvaise gestion du crédit
peuvent conduire en un temps record à la faillite et même à
la disparition de l'institution. Dans les paragraphes qui suivent nous allons
présenter quelques éléments qui constituent la
barrière pour les genres aux revenus moyens ou aux faibles revenus.
4.4.1 LE TAUX D'INTÉRÊT
Les institutions offrent du crédit, c'est d'abord, dans
l'optique de réaliser des intérêts pour pouvoir couvrir ses
coûts fixes et ses coûts variables. Face à la monté
des prix et de l'inflation les institutions appliquent très souvent des
taux exorbitants. Il n y a aucune intervention de l'Etat, le marché est
libre. Les banques commerciales profitent de cette liberté qu'offre le
système d'économie libérale pour augmenter leur taux
d'intérêts en moyenne 7% l'an. La hausse du taux empêchent
les gens de faire des prêts car ils ont des versements que souvent
l'activité qu'ils vont entreprendre ne peuvent pas répondre.
4.4.2 LES GARANTIES
Généralement, à coté des
activités commerciales et/ou le salaire des emprunteurs les banques
commerciales réclament d'autres bien qui pourraient servir de garanties
en de non paiement du crédit. Les institutions ont le plein droit sur
les biens données en garanties. Les gens sont souvent dans l'embarras de
trouver des biens de valeurs pour donner en garanties.
Les institutions demandent le plus souvent des titres de
propriété des terrains ou des voitures, une situation parait
souvent très compliquée car il ya un problème de cadastre
dans le pays. Les pièces ne sont pas toujours authentique encore une
autre faillite de l'Etat que les clients seuls sont les premiers victimes.
4.4.3 LE TEMPS
Le temps joue un rôle très important dans le
processus du crédit. Les banques offrent parfois des durées qui
ne facilitent pas les clients de rembourser les emprunts. Les crédits
à long terme sont très rares, elles appliquent ces
méthodes pour ne pas encourir trop de risques. En matière de
crédit, il existe une relation étroite entre le temps de
remboursement et le montant des versements ; tant le temps de
remboursement est long tant le montant des versements est plus bas l'inverse
est aussi vrai.
Le fait qu'en général les temps sont courts, les
clients se trouvent dans la difficulté de répondre à ces
critères. Ce facteur là empêche au gens d'investir dans
certain domaine comme l'agriculture et l'élevage car ces domaines
demandent une longue période de temps pour retrouver les
résultats escompter.
La situation des clients ou des potentiels sociétaires
sont très compliquée pour avoir du crédit. Nous avons pu
remarquer que les difficultés viennent de plusieurs sources
différentes et les responsables ne se montrent pas vraiment
dévouer pour une remise en question de cette problématique qui
ravage la classe moyenne et les plus défavorisées de ce pays. Les
politiques de crédit110(*) des institutions financières surtout les
banques commerciales ne favorisent pas vraiment l'émergence de nouvelles
classes d'investisseurs. Les taux d'intérêts en vigueur ne sont
pas toujours des intérêts
dégressifs111(*)mais plutôt des intérêts
linéaires112(*)
L'identification de toutes ces contraintes montrent combien il
est difficile d'accéder au crédit en Haïti. Une situation
qui n'est autre que la vérification de notre hypothèse secondaire
I car une grande majorité de la population qui veulent avoir du
crédit auprès des banques commerciales rencontrent chaque jours
ces problèmes et sont souvent en difficultés de les
contourner.
CHAPITRE V
LA KOTELAM ET LA SITUATION SOCIOÉCONOMIQUE DES
SOCIÉTAIRES DANS LES COMMUNES DE DELMAS ET DE PÉTION-VILLE.
La première partie de ce chapitre est consacrée
à la présentation des résultats de notre enquête
sur le plan économique. Nous présentons aussi ceux de
la `'Koperativ Tèt Ansanm pou Lavi Miyò'' (KOTELAM) pendant
quelques années surtout les rapports de crédit pour nous aider
à mieux appréhender l'apport économique de la
coopérative KOTELAM dans l'amélioration de la situation
socioéconomique de ses sociétaires. Dans une deuxième
partie nous avançons les résultats de notre enquête sur le
plan social en nous appuyant surtout sur l'impact des actions
coopératives sur l'évolution des femmes qui se trouvent dans des
situations très difficiles. Ces résultats nous permettent de
vérifier notre hypothèse en prouvant que la kotelam a joué
sa partition à l'amélioration de la situation
socioéconomique des sociétaires qui ont
bénéficiés du crédit au sein de la caisse.
5.1 LES RÉSULTATS OBTENUS SUR LE PLAN
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Cette partie de notre recherche présente la
coopérative avec les impacts qu'elle a menés dans la vie
socioéconomiques des sociétaires. Quoique l'échantillon
considéré de la population en question ne soit pas trop
représentatif. Cependant, l'ensemble des données recueillies nous
ont permis avec toute la prudence cartésienne qui s'impose d'arriver
à avancer ces résultats sur le plan économique et social
des sociétaires qui ont bénéficiés du crédit
au niveau de la kotelam.
5.1.1 SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE
De part son apport au sein des ménages de petites
bourses, les coopératives d'épargnes et de crédit ont pu
jouer un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie
de ces agents économiques. De nos jours, même les banques
commerciales, cherchent à trouver des politiques économiques plus
particulièrement des politiques de crédit leur permettant de
mettre en place des services de microcrédit. Les institutions bancaires
adoptent ces stratégies en vue répondre aux besoins de la
majorité de la population exclue du système financier formel.
Les Coopératives d'Epargnes et de Crédit, selon
les résultats que l'on a obtenu après notre enquête
auprès des sociétaires de la `'Koperativ Tèt ansanm pou
Lavi Miyò''(KOTELAM), donnent la possibilité à tous ceux
qui ont un petit commerce de trouver du crédit, surtout aux petits
détaillants de pouvoir augmenter leurs stocks de marchandises. Les
crédits donnés au sein de cette coopérative permettent
à ceux qui ont un minimum d'épargne, qui a un revenu ou un
salaire fixe de pouvoir démarrer leur propre entreprise. Cependant,
dans beaucoup de cas, les gens font leur investissement dans l'achat des
produits venus de l'extérieur une pratique qui ne rend pas vraiment
service à la production nationale car 95% de leurs stocks sont venus de
l'étranger.
Beaucoup ont témoigné que grâce aux
crédits des coopératives ils arrivent à payer leur bail et
même avoir leur propre maison. Plus de 85 % de sociétaires que
nous arrivons à questionner pensent qu'ils ne trouveraient pas toutes
ces possibilités dans le système bancaire par rapport à
leur capital disponible et le nombre volumineux de garanties qu'il
réclamerait. Le mouvement coopérative, en dépit, de toutes
ses faiblesses a pu joueur sa partition dans la survie de ceux qui ont pris
part.
Etant donné que nous avons considéré la
kotelam comme un exemple parmi tant d'autres qui arrive à donner une
certaine satisfaction à leur sociétaire, nous allons
présenter des résultats de cette coopérative pendant la
période de notre étude. Nous pensons qu'en analysant
l'évolution de ces données statistiques d'année en
année il sera plus facile de voir est ce qu'il est important de
promouvoir une telle initiative surtout dans un pays pauvre comme Haïti
où l'accès au crédit est très difficile. Les
résultats que nous présentons sont conformes aux documents de la
kotelam.
5.1.2 LES RAPPORTS DE CRÉDIT DE LA KOTELAM
Nous avons considéré le rapport du comité
de crédit de 2002 de la KOTELAM et celui de 2009 pour pouvoir nous
faire une idée de l'évolution du nombre de crédits
accordés et leurs montants. Les tableaux ci-dessous contiennent les
donnés des deux années considérées. Pour
l'année 2002 ou le mouvement coopératif a connu une crise
à nulle autre pareille la KOTELAM grâce à la participation
de ses membres a su traverser cette époque aussi difficile. A la fin de
l'exercice La KOTELAM avait un portefeuille de crédit de 27, 622,380.00
gourdes pour 578 crédits. Une situation qui n'était pas du tout
favorable à la perennite de l'association. Les années se
succèdent et la coopérative a grandi. Pour arriver en 2009 les
chiffres ont changé et dans les tableaux ci-dessous nous avons les
donnees sur le déroulement du crédit pour l'annee 2009.
Tableau 3
L'ensemble des dossiers traités par le
comité de crédit en 2009
|
Mois
|
Nombre de réunion
|
Nombre de folio
|
Montant demandé
|
Montant accordé
|
Montant refusé
|
|
Octobre
|
2
|
16
|
7 165 000
|
4 200 000
|
2 965 000
|
|
Novembre
|
2
|
20
|
8540 000
|
5 936 000
|
2 604 000
|
|
Décembre
|
2
|
15
|
7 190 000
|
6 650 000
|
540 000
|
|
Janvier
|
1
|
14
|
6 760 000
|
5 355 000
|
1 405 000
|
|
Février
|
2
|
7
|
3 040 000
|
2 940 000
|
100 000
|
|
Mars
|
2
|
15
|
7 220 000
|
4700 000
|
2 520 000
|
|
Avril
|
2
|
14
|
6 450 000
|
4 180 000
|
2 270 000
|
|
Mai
|
1
|
15
|
13 287 000
|
8 750 000
|
4 537 000
|
|
Juin
|
1
|
12
|
4 410 000
|
3 455 000
|
955 000
|
|
Juillet
|
2
|
25
|
23 455 000
|
20 615 000
|
2 840 000
|
|
Aout
|
4
|
18
|
8 550 000
|
6395 000
|
1 955 000
|
|
Sous-total
|
21
|
171
|
96 067 000
|
73 376 00
|
22 691 000
|
Source : Comite de crédit, Rapports annuel de
crédit de la kotelam 2008, Port-au-Prince, kotelam p, 9.
Tableau 4
Dossiers traités par la direction
générale
|
Mois
|
Nombre de folio
|
Montant demandé
|
Montant accordé
|
Montant refusé
|
|
Septembre
|
72
|
4 591 250
|
3 873 750
|
717 500
|
|
Octobre
|
123
|
6 411 000
|
5 529 000
|
882 000
|
|
Novembre
|
122
|
4 779 500
|
3 999 500
|
780 000
|
|
Décembre
|
134
|
4 255 700
|
3 753 200
|
502 500
|
|
Janvier
|
105
|
4 984 000
|
4427 000
|
557 000
|
|
Février
|
128
|
7 368 000
|
6 445 000
|
923 500
|
|
Mars
|
109
|
6 092 500
|
5 278 500
|
814 000
|
|
Avril
|
92
|
6 155 000
|
5 437 500
|
717 500
|
|
Mai
|
87
|
4 845 500
|
4 474 000
|
371 500
|
|
Juin
|
114
|
6 068 200
|
5 433 000
|
635 200
|
|
Juillet
|
125
|
8 155 700
|
7 243 000
|
912 700
|
|
Aout
|
119
|
6 846 000
|
6 032 500
|
813 500
|
|
Sous-total
|
1 358
|
70 552 850
|
61 925 950
|
8 626 900
|
|
TOTAL
|
1529
|
1 666 619 850
|
135 301 950
|
31 317 900
|
Source : Comite de crédit, rapports annuel
des crédits traité par le comité de crédit de la
kotelam 2008, p, 14
En analysant ces deux tableaux nous avons pu remarquer que la
demande de crédit augment chaque année et même à un
rythme exorbitant car les gens ont soif du crédit. Ce que nous pouvons
constater en 2002 la KOTELAM a accorde 25, 768,560 pour 578 sociétaires
soit une moyenne de 44,582.28 gourdes par sociétaire tandis que pour
l'année 2009 elle accorde 31, 317,900 gourdes pour 1529
sociétaire soit une moyenne de 20,482.6 gourdes par sociétaire.
La moyenne de crédit des deux années nous montre que la KOTELAM
donne beaucoup plus de petits crédits. Elle ne cherche pas les
sociétaires qui veulent emprunter des millions seulement mais
plutôt elle cherche à accompagner les gens à faibles
revenus qui sont dans le besoin. Il n y a pas seulement le crédit au
sein de la caisse c'est pour cela que nous tenons à présenter des
statistiques pour cinq (5) autres années afin de mieux comprendre
l'évolution de la caisse dans le tableau ci-dessous.
Tableau 5
Le tableau des Principaux indicateurs de la
KOTELAM (2003-2007)
|
Bilan 2003 2004 2005 2006
2007
|
|
Actif
|
60 790 315
|
69 279 909
|
95 372 170
|
119 354 290
|
154 555 847
|
|
Disponibilités
|
25 465 759
|
23 697 674
|
24 240 423
|
40 546
|
48 175 100
|
|
Portefeuille de crédit
|
31 584 078
|
37294 857
|
61 018 496
|
76 760 433
|
98 771 133
|
|
Epargne des sociétaires
|
45 093 229
|
50 890 216
|
69 567 900
|
84 734 426
|
114 663 718
|
|
Emprunts-fonds de crédit
|
700 000
|
500 000
|
300 000
|
100 000
|
0
|
|
Capital social
|
2881 659
|
3607 281
|
4943 314
|
59 867 522
|
6 692 298
|
|
Avoirs des sociétaires
|
13 958 666
|
16 040 524
|
22 974 407
|
29 867 522
|
34801 802
|
|
|
Etats des résultats
|
|
|
|
|
|
|
Revenus d'intérêts
|
10 161 268
|
15687 398
|
16 205 768
|
22 825 638
|
28 750 704
|
|
Frais d'intérêts
|
1 800 268
|
2 461 499
|
1 490 817
|
1 147 635
|
2 140 726
|
|
Revenus nets avant dotation à la provision
|
9 506 457
|
14 551 544
|
18 004 864
|
25 479 053
|
30 920 665
|
|
(Suite du tableau 5)
|
|
Dotation à la provision pour créances
douteuses
|
1 002 209
|
4 850 689
|
1 503 440
|
6 334 780
|
4145 745
|
|
Revenus nets avants dépenses d'exploitations
|
8 504 248
|
9 700 855
|
16 501 424
|
19 144 273
|
26 774 920
|
|
Dépenses d'exploitations
|
4702 417
|
7 969 711
|
10 482 137
|
12 851 587
|
22 330 134
|
|
Subvention
|
|
8008
|
8008
|
82 000
|
0
|
|
Résultat avant impôt
|
3 801 831
|
17 3915
|
6027 295
|
6 374 686
|
4444 786
|
|
Impôt sur le revenu
|
381 800
|
17 3915
|
602 730
|
637 469
|
444 479
|
|
Résultat de l'exercice
|
3 436 202
|
1 565 237
|
5 424 565
|
5 737 217
|
4 000 307
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres indicateurs
|
|
|
|
|
|
|
Points de services
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
|
Nombres de sociétaires
|
|
|
|
|
26057
|
Source : construit à partir de l'ensemble
des rapports de crédit de la kotelam à Port-au-Prince, de 2003
à 2007 en considérant les principaux indicateurs.
Ce tableau qui contient le bilan des 5 années
consécutives à la crise montre que la tendance était
toujours positive. Le portefeuille de crédit qui est un indicateur vital
pour la pérennité de la coopérative était toujours
positive ce qui montre que le mouvement n'était pas mort. Même
après la crise il y avait des gens qui ont gardé confiance et
continuent à soutenir le mouvement. Les résultats prouvent aussi
qu'il y avait une bonne gestion de la part des dirigeants des différents
comités.
La coopérative d'épargne et de crédit a
comme principale source de revenus les épargnes collectées
auprès de ses sociétaires. Toutes les activités qu'elle va
entreprendre dépendent du niveau d'épargne de l'ensemble de ses
sociétaires. Ayant confiance dans cette entreprise qui sont crée
à partir de leurs propres fonds, chaque année le volume de
l'épargne des sociétaires augmente a un rythme très
considérable tel est le cas pour la Koperativ Tèt Ansanm pou Lavi
Miyò (KOTELAM). Nous avons réalisé cette figure ci-dessous
pour pouvoir mieux comprendre la tendance.
Graphe 1
L'évolution des épargnes des
sociétaires de 2003 à 2009
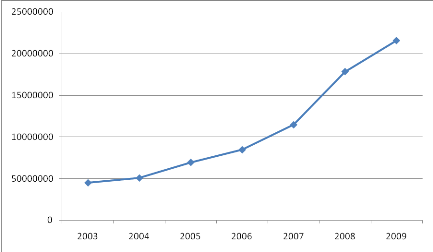
Source : Figure réalisée en tenant
compte de l'évolution de l'épargne des sociétaires de
2003 à 2009, p, 25.
Faisant face toujours à des difficultés de
trouver du crédit au niveau du système financier formel les
sociétaires s'accrochent toujours à la coopérative car eux
aussi sont propriétaires de l'entreprise. La demande de crédit
ne cesse encore d'augmenter c'est ce que nous avons démontré dans
le graphe ci-dessous.
Graphe 2
La tendance du portefeuille de crédit de la
kotelam 2003-009
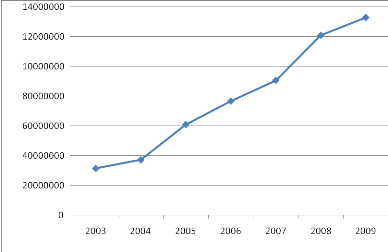
Source : réalisé en considérant
l'évolution du portefeuille de crédit de la kotelam de 2003
à 2009 à Port-au-Prince.
En analysant ces deux tableaux nous avons pu remarquer que la
demande de crédit augment chaque année et même à un
rythme exorbitant car les gens ont soif du crédit. De 2003 à 2008
la demande a augmente de plus de 92%.
5.1.3 LA COUCHE LA PLUS TOUCHÉ DE LA
COOPÉRATIVE PAR STATUT MATRIMONIAL
La coopérative est surtout
fréquentée par des gens de petits revenus, cependant il y a une
catégorie de ses membres qui sont beaucoup intéressés que
d'autres ce tableau construit à partir des donnés recueillies de
notre recherche nous démontre la situation.
Tableau 6
Tableau représentant le Statut matrimonial des
membres
|
Statut matrimonial
|
|
Célibataire
|
Marié
|
Divorcé
|
Autre
|
Total
|
|
Sexe
|
Homme
|
26
|
28
|
5
|
3
|
62
|
|
Femme
|
13
|
41
|
13
|
21
|
88
|
|
Total
|
39
|
69
|
18
|
24
|
150
|
Source : Tableau réalisé en compilant les
données recueillies au cours de notre enquête à
Port-au-Prince, pendant le mois de mars 2014 sur l'impact des prêts
accordés aux sociétaires.
Les résultats obtenus à travers ce tableau
montrent que les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes dans le
secteur coopératif soit (59% contre 41%. Peut-on considérer la
coopérative comme une activité des femmes ? Ceux qui ont
déjà menés des enquêtes dans ce secteur ne trouvent
des résultats différents que le notre. Les femmes sont beaucoup
plus présentent dans les commerce de détail pour certains c'est
le moteur de la création de la valeur ajoutée.
Le tableau montre aussi que les gens qui sont mariées
sont très présents dans le mouvement coopératif. Cette
présence est due surtout à cause de leur responsabilité
familiale. Ils ont le devoir de répondre à leurs besoins par
exemple (payer l'écolage, l'électricité, le bail etc.).
Les femmes sont aussi plus présentes encore de part leurs engagements au
sein de leur foyer.
La KOTELAM qui est considérée par plus d'un
comme un survivant de la grande crise qui a frappé le mouvement
coopératif Haïtien au commencement du 21ème
siècle nous a présenté des chiffres pouvant nous aider
à comprendre l'impact de la crise.113(*)
5.2 SUR LE PLAN SOCIAL
L'objectif même de la vision qui se propage au sein du
mouvement coopératif est de faire aux membres adhérents que par
des actions communes qu'ils peuvent arriver à résoudre des
problèmes quotidiens auxquels ils font face.
Pour beaucoup d'acteurs économiques, la
coopérative est une entreprise économique et s'occupe seulement
des affaires relatives à ce secteur. Cependant d'autres pensent que les
coopératives d'épargne et de crédit ne sont pas seulement
des entreprises commerciales. Mais des institutions qui peuvent apporter des
changements au niveau social dans la région ou le département
où elle se trouve et surtout aux couches les plus démunis. A
travers cette partie de notre recherche nous essayons de voir les secteurs dans
lesquels les gens investissent beaucoup plus les prêts qu'ils
reçoivent des coopératives et les impacts qu'ils ont eu sur leur
niveau de vie.
5.2.1 LES SECTEURS D'ACTIVITÉS TOUCHÉS PAR
LES PRÊTS DES COOPÉRATIVES
Les prêts donnés par les coopératives sont
investis dans déférente types d'activités. L'utilisation
des prêts sont faites selon le but du sociétaire comme pour la
construction, l'écolage, loyer, voyage etc. Et pour le secteur
commercial on a studio de beauté, produit cométique shop de
vêtement, produit alimentaire etc. ce dernier qu'est le produit
alimentaire est le secteur ou l'on trouve beaucoup plus de sociétaires
et se sont souvent de petits détaillants qui cherchent à gagner
leur vie. Cependant selon des analyses des experts dans le secteur il montre
qu'il faut encourager les sociétaires à faire les investissements
surtout dans des entreprises de production car l'achat des marchandises venues
de l'étranger et les revendre sur le marché local ne contribue
pas suffisamment à un developpement durable du pays. Regardons ce que
nous avons trouvé comme résultat à partir de
l'échantillon que nous avons consulté lors de notre recherche.
Tableau 7
Tableau des secteurs touchés par les
prêts octroyés.
|
Activités
|
Construction
|
Ecolage
|
Loyer
|
Produit cosmétiques
|
Produit alimentaires
|
autres
|
Total
|
|
Membres
|
13
|
19
|
15
|
18
|
57
|
28
|
150
|
Source : tableau réalisé à
partir des données recueillies pendant notre enquête à
Port-au-Prince, mars, 2014
Les résultats obtenus à partir de ce tableau
montrent que la grande majorité des prêts accordés sont
utilisés dans le commerce des produits alimentaires. Soit 38% des
prêts se trouvent dans ce secteur. Une situation qui n'est pas trop
profitable à long terme pour le pays car un investissement dans la
production locale serait beaucoup plus avantageux.
5.2.2 IMPACT SOCIAL DES PRÊTS SUR LES FEMMES
À FAIBLES REVENUS.
Généralement dans les pays
sous-développés, ou l'accès au crédit est
très difficile, les femmes sont souvent les plus difficiles à
réussir à assurer leur survie. La coopérative qui est la
pour aider les gens les plus pauvres à sortir de leur marasme
économique a donné la possibilité à cette
catégorie de se débrouiller. La KOTELAM grâce à sa
politique de crédit aide beaucoup de femmes à avoir du
crédit. La majorité des crédits inferieurs à 100,
000 gourdes sont accordés aux femmes. Cette formule rendent les femmes
beaucoup plus autonome, à avoir une certaine indépendance sociale
et apprendre à gagner leur vie avec leurs propres stratégies.
Regardons les résultats que nous avons obtenus dans notre enquête
sur la répartition des différents montants.
Tableau 8
Les montants des prêts accordés aux
sociétaires
|
Montants
|
1 000-25,000
|
25,001-50,000
|
50,001-100,000
|
100,001-3 00,0000
|
|
|
Femme
|
35
|
25
|
21
|
8
|
89
|
|
Homme
|
13
|
11
|
16
|
21
|
61
|
|
Total
|
48
|
36
|
37
|
29
|
150
|
Source : Ce tableau a été
réalisé à partir de la compilation des différents
montants accordés aux sociétaires, pendant la période
considéré pour la réalisation de notre recherche
Les résultats montrent que les femmes ont plus de
crédit que les femmes sur le total des prêts. Cependant, la marge
est beaucoup plus large dans les prêts inferieurs à 100,000
gourdes. Pour les montants les plus les élevés, les hommes ont un
plus fort pourcentage. Cette observation est tout à fait normale car,
Dans sa politique de crédit. la KOTELAM veut donner du crédit
pas seulement aux gens les plus capables mais au plus grand nombre.
Etant un secteur très démocratique, le mouvement
coopératif ne tend à exclure les femmes au contraire elles sont
les premiers bénéficiaires du mouvement coopératif. En
fait nous pouvons dire que les coopératives servent dans une certaine
mesure de base économique pour la mise en valeur les capacités
des femmes qui de jour en jour se montrent qu'elles peuvent devenir le
squelette de la croissance de notre économie si précaire. En
général, selon la tendance dégagée à travers
les portefeuilles de crédit du secteur de la coopérative
d'épargne et de crédit, les femmes sont beaucoup plus
crédibles que les hommes. Cette perception est une vérité
dans le cas de notre étude car à la KOTELAM plus de 65 % du
portefeuille de crédit à risque se trouvent entre les mais des
hommes.
5.2.3 L'IMPACT DES PRÊTS ACCORDÉS AUX
SOCIÉTAIRES
Une grande partie de l'échantillon de la population que
nous avons questionné pendant notre enquête montre que les
prêts qu'ils ont bénéficiés de la coopérative
KOTELAM leur permet d'améliorer leur mode de vie, de payer
l'écolage de leurs enfants. Grâce au crédit qu'ils trouvent
à kotelam ils peuvent payer plusieurs d'écolage et avoir assez de
temps pour se récupérer. Tenant compte de l'importance de
l'éducation dans une societé surtout dans un pays pauvre comme
Haïti avoir la possibilité d'envoyer des enfants à
l'école représente un atout très considérable pour
l'avenir du pays car la meilleure façon de réduire le taux de
délinquance c'est de faciliter aux enfants la possibilité de se
rendre à l'école. Beaucoup de coopérateurs
témoignent qu'ils arrivent à payer leur bail grâce au
crédit des coopératives. Ils peuvent prendre le crédit
pour une durée d'un an et avoir la possibilité de travailler
pendant douze mois pour se préparer pour les prochaines années.
Profitant de la durée du crédit, ils arrivent même à
faire de l'épargné pour se procurer un terrain et arrive un jour
à avoir leur propre maison.
La coopérative aide les membres à satisfaire
certains besoins économiques et sociaux vraiment pour mieux s'assurer
que les sociétaires vont pouvoir gérer et utiliser à bon
escient les prêts, ils ont mis des séances de formation
hebdomadaire. Pendant ces formations, les membres ont aussi la
possibilité d'apprendre l'évolution du marché en faisant
des échanges d'idées entre eux. Ils partagent leurs
expériences et aussi ils apprennent comment cette entreprise qui
fonctionne à partir de leur epargne évolue par rapport aux
autres acteurs financiers qui ont le même produit. La formation que
donne les coopératives spécialement la kotelam à ses
sociétaires est d'une importance capitale car elle permet aux
sociétaires de se situer au niveau de l'échelle sociale et de
prendre conscience de leur situation pour avancer et améliorer leur
condition de vie sociale.
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
Cette étude que nous avons menée dans le
département de l'Ouest spécialement dans les communes de Delmas
et de Pétion ville révèle des résultats
très significatifs pour une compréhension de la situation
économique et sociale des sociétaires des coopératives.
Notre recherche était basée sur la vérification de nos
deux hypothèses. La première hypothèse était
question de vérifier qu'au cours de la période 2003-2009, les
difficultés d'accès au crédit auprès des banques,
constituant un blocage pour les sociétaires potentiels en Haïti,
ont été diminuées avec les activités
intensifiées des coopératives d'épargne et de
crédit qui leur ont facilité la tâche, notamment la KOTELAM
dans les communes de Delmas et de Pétion-ville.
Pour arriver à vérifier cette hypothèse
nous avons réalisé une enquête auprès des
sociétaires qui ont bénéficiés du crédit
plus spécialement ceux de la kotelam. On a utilisé un
questionnaire pendant nos recherches pour pouvoir diriger l'entrevue avec les
sociétaires. Nous avons pu constater à partir des données
collectées que les gens à faibles revenus sont vraiment dans la
difficulté de trouver du crédit auprès des banques
commerciales à cause des différents types de contraintes que nous
avons développées dans le chapitre III. La
préférence de cette catégorie était plutôt
les coopératives d'épargne et de crédit qui leur
facilitent l'accès au crédit en dépit de leur situation
critique.
Nous avons considéré la Kotelam comme exemple
pour la vérification de notre deuxième hypothèse qui
parlait de la contribution plus ou moins de la kotelam dans
l'amélioration de la situation des sociétaires dans les communes
de Delmas et de Pétion ville au cours de la période 2003-2009.
Nous avons vérifié cette hypothèse au chapitre IV en
démontrant comment chaque année le portefeuille et le nombre de
client qui ont accès au crédit ne cessent d'augmenter à un
rythme très raisonnable. Nous avons registré à plusieurs
reprises des sociétaires ont renouvelé leurs en comparant les
avantages de la kotelam aux autres microfinances de types
non-coopératives. Il nous raconte comment l'accès au
crédit leur permet de satisfaire leur besoin de base d'envoyer leurs
enfants à l'école, d'augmenter la taille de leurs business,
d'aller à l'hôpital et même de commencer à
bâtir leur propre maison enfin de changer leur situation
économique et social.
Tenant compte des résultats de notre recherche, il est
évident que sur le plan économique les coopératives
d'épargne et de crédit, plus particulièrement la kotelam,
arrivent quand même à les aider à faire face aux
problèmes économiques les plus criant. Accrocher à l'un
de ces objectifs principaux qui est de créer une situation favorable
pour les gens qui sont exclus du système financier formel de trouver des
services financiers, nous pouvons dire qu'en regardant les résultats de
notre recherche cet objectif était quasi totalement respecter dans les
différentes communes. Un objectif qui ne peut contribuer qu'à une
meilleure situation sociale des sociétaires.
Beaucoup d'instances économiques nationales et
même au niveau internationales reconnaissent que le mouvement
coopératif peut aider vraiment un peuple à sortir de la
misère car selon un document de la banque mondiale l'expérience
des coopératives n'est pas négative car ces organisations
permettent une participation au développement rural qui serait difficile
à assumer d'une autre manière.
En fait, nous pouvons dire que malgré les crises
politiques qui rongent Haïti spécialement les communes ou nous
avons mené notre étude, nous, Haïtiens conscients de notre
état, doivent savoir que l'amélioration de la situation sociale
et économique de ce pays doit commencer par la mise en commun de nos
efforts personnels non pas par l'aide de la communauté internationale
car aucun pays pauvre ne réussit pas à sortir de sa
pauvreté grâce à l'aide internationale.
La coopérative a déjà montré
qu'elle peut aider à la collecte de l'épargne dans les milieux
ruraux et ainsi donner la possibilité aux gens les plus démunis
de trouver du crédit. Nous pouvons dire qu'étymologiquement la
coopérative garde son sens car il permet aux sociétaires de vivre
ensemble et faire la route ensemble vers une amélioration sociale et
économique. Cependant, nous avons pu remarquer des failles au niveau
du mouvement c'est ainsi que nous avons tenu à formuler quelques
recommandations.
SUGGESTIONS
Pour arriver vraiment à une meilleure
amélioration socioéconomique et d'un plus grand nombre de
sociétaires, le mouvement coopératif haïtien doit être
développé et restructuré de manière à se
rapprocher beaucoup plus des agents économiques, notamment en milieu
rural, pour la collecte de l'épargne et l'octroi de crédits aux
activités de production. Pour arriver à atteindre cet objectif
par rapport à l'observation et les données que nous avons
recueillies au cours de notre recherche nous tenons à faire ces
recommandations qui pourraient rendre le secteur beaucoup plus dynamique.
L'implication de l'Etat. Les autorités
étatiques ont un rôle à jouer pour arriver à ce
changement et à une meilleure exploitation du mouvement
coopératif. Considérant que le marché financier
Haïtien a connu de nouvelles évolutions au cours de ces
dernières années, donc il s'avérait nécessaire que
de nouvelles lois soient créées pour régulariser le
marché avec le mouvement coopératif. Il est important que les
législateurs, avant de se pencher soit sur une proposition de lois ou
projet de lois, tiennent compte des besoins des coopérateurs et de
toutes les recherches qui ont été effectuées dans le
secteur afin que les lois, au lieu de réglementer le système ne
causent pas beaucoup plus de tort au système.
Tenant compte de la situation économique du pays,
l'Etat doit avoir une plus grande implication dans le secteur il ne doit pas ce
comporter seulement comme arbitre. L'Etat doit apporter son aide dans
l'implantation des nouvelles coopératives. Il peut donner de l'aide au
niveau financier car en général les coûts sont souvent
très élevés dans le démarrage des
coopératives.
Espace géographique des
coopératives. Les coopératives doivent pouvoir
s'établir dans tout le pays, c'est-à-dire une coopérative
ne doit pas restreindre à servir seulement les membres d'un seul
département mais plutôt elle doit avoir une portée
nationale tout en tenant compte de sa capacité. Une révision sur
le décret114(*)
réglementant l'organisation des coopératives pourrait faciliter
cet épanouissement.
Les produits des coopératives. Les
coopératives doivent offrir beaucoup plus de produit financier afin
d'avoir un plus grand nombre de sociétaires. Les caisses populaires
doivent faciliter beaucoup plus les gens à faibles revenus à
avoir du crédit. Elles doivent donner beaucoup plus de petits
crédits c'est-à-dire des montants inferieurs à 25, 000
gourdes.
La formation des sociétaires. La
formation, comme dans toutes les activités financières et
même humaines, est toujours considérée comme un
élément indispensable pour la pérennisation de quelque le
type d'activité que ce soit. Pour cela, nous demandons à ce que
les dirigeants des coopératives mettent une formation continue au niveau
des coopératives. Il faut aider les gens à avoir une idée
sur les risques qui existent dans les secteurs d'activité les plus en
vogue pour qu'ils ne fassent pas de mauvais investissement, il faut aider aussi
les sociétaires pendant les séances de formation à
comprendre l'importance des investissements dans les projets de production
locale.
BIBLIOGRAPHIE
1. AKTOUF, Omar, Méthodologie des
sciences sociales et approche qualitative des organisations,
Montréal, Les Presses de l'Université du
Québec, 1987, 213 p
2. ANACAPH, Rapport sur la situation des
caisses populaires, ANACAPH, 17 mars 2009. www.anacaph.coop
3. Association Nationale des Caisses Populaires
Haïtiennes (ANACAPH), Projet de Loi sur les
Coopératives d'épargne et de crédit, ANACAPH, 2002,
35p.
4. Banque de la République d'Haïti
(BRH), Rapport annuel, activité économique, BRH,
Port-au-Prince, 2005. 135p.
5. Banque de la République d'Haïti
(BRH), Rapport annuel, l'évolution du système bancaire,
BRH, Port-au-Prince, 2001, 142p.
6. BERNARD, Yves et COLLI Jean Claude,
vocabulaire économique et financier, 6eme
édition, Seuil, 1996, 1515p.
7. BIJOUX, Legrand, Cour Supérieur de
coopératisme, Mimeo, Paris, 1980, 138p.
8. Cahier du participant, Le démarrage
d'une coopérative, IRFEC, 1996, 45p.
9. CHRISTIAN, Robert Hilaire, historique de
la coopérative en Haïti, 2009, 167p.
10. Conseil National des Coopératives,
bulletin d'information du Conseil National des
Coopératives, sixième année, no.2, juin, 1985,
27p.
11. Constitution Haïtienne, centre
oecuménique des droits de l'homme, 1987, article, p, 4
12. DESHOMMES, Fritz, Politiques
économiques en Haïti, rétrospectives et perspectives,
Port-au-Prince, Cahiers Universitaires, 2005, 234p
13. DESROCHE, François Le projet
coopératif. Paris, Editions ouvrières 1976, 461P
14. DRAPERIE, Jean-François, Mouvement
Coopérative, alternatives Economique Poche n° 022- janvier 2006, 35p.
15. DURKEIM, Emile, Les règles de la
méthode sociologique, Paris, les Presses universitaires de France
(16eme édition, 1973, 149p.
16. ELIE, Jean Renol, Des coopératives
pourquoi faire? Groupe Haïtien de Recherché et d'Action
Pédagogiques (GHRAP), 1991, 262p.
17. FRANCOIS, Duvalier, oeuvres essentiels
(Tome II), la marche à la présidence, Port-au-Prince, Presses
nationales d'Haïti, 1968, 457p.
18. FRANCOIS, Lhermite, recensement sur
l'industrie de la microfinance haïtienne, USAID, Port-au-Prince, 2009,
77p.
19. GENTIL, Dominique, Les pratiques
coopératives en milieu rural Africain, l'Harmattan, Paris, 1950,
148p.
20. GIRAULT, Christian, Le commerce du
café en Haïti, Habitants, spéculateurs et exportateurs,
Centre national de la recherché scientifique, Paris, 1982, 293p.
21. GRAWITZ, Madeleine, Méthode des
sciences sociales, Dalloz Sirey, Paris, 2000, 1109p.
22. HENRY, Bazin, Le secteur privé
Haïtien à l'orée du troisième millénaire:
défis et nouveaux rôles, Port-au-Prince, 1999. 318p.
23. Jacques CHIRAC, Rapport de la
Conférence Internationale sur la Microfinance, Paris, 20 juin 2005,
122p.
24. JEAN, Poincy, Précis
d'introduction à l'économie, Port-au-Prince, 2006, 159p.
25. KOTELAM, Document de formation des
nouveaux membres, Port-au-Prince, Conseil d'Administration, mars 2012, 37p.
26. KOTELAM, Rapport financier,
Port-au-Prince, le levier, 2007, 17p.
27. Législation Haïtienne, la loi
sur les coopératives, Port-au-Prince, Le Moniteur, 1960, 32p.
28. Législation Haïtienne, la Loi
sur les coopératives, Port-au-Prince, Le Moniteur, 1987, 27p.
29. METELLUS, Smith E, Méthodologie de
la recherché scientifique, Port-au-Prince, 2010, 58p.
30. PYLE, Larson et ZIN,
Initiation à la comptabilité financière et administrative,
Québec, 3eme éd, canado-François, 1985,
210p.
31. SEJOUR, Hervé, Le
coopératisme à la lumière du christianisme,
Port-au-Prince, bibliothèque nationale, 1996, 227p...
32. SYLVAIN, Fernand. Dictionnaire de la
comptabilité, Paris, Institut Canadien des comptables
Agréés, 1977, 258p.
Kestoynè Ankèt sou sitiyasyon manb ki
fè prè nan KOTELAM
A) Enfòmatyon pèsonèl sou manb
lan
1) Sèks : ? M ? F
2) Aj : ? 18-30 ? 31-40 ? 50-60
? 60-703)
Zòn- aktivite : ? Komin Delma ? komin
Potoprens ? komin Petyon vil
4) Nan ki sektè aktivite ou ye ?
? Komès ? Pwofesè ? Taxi ?
trafik ? stidio bote ? kenkayri ? lot aktivite
B) Eksperyans manb LAN AK Koperativ epi AK
kotelam
1) Depi konbyen tan ou nan KOTELAM ?
? 0-5 ? 6-10 ? 11-15 ? 16-20 ?
20-25
2) Eske ou te nan Koperativ anvan ou te vin nan
kotelam ?
? Wi ? Non
3) Ki kalite aktivite ou kon'n fè ak kòb yo kon
n prete'w yo ?
? Komès ? peye lekol ? konstriktyon ? peye
lwaye ? lot aktivite
4) Eske ou konn satisfè de kantite kob yo konn prete w
yo ?
? Wi ? Non ? Ti kras
5) Eske enterè a pa twop pou wou?
? Wi ? Non ? Ti kras
6) Eske ou satisfe de tan yo ba w pou remèt kòb
la ?
? Wi ? Non ? Ti kras
7) Nan ki entèval kòb yo kon'n ba w yo kon'n
ye ?
? 1000-25000 25 001-50 000 50001-100,000 100001-3000 000
8) Eske Kredi ou fè yo ede w amelyore la vi w ?
? Wi ? Non ? Ti kras
9) Eske ou swete al mande kob ankò ?
? Wi ? Non ?Ti kras
10) Poukisa se kotelam ou chwazi ki se you koperativ ou pa al
la bank pito
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* 1 Le nouvelliste,
Port-au-Prince, No 36 537, 22 juillet 2007, p7
* 2 Ibid.
* 3 ANACAPH, Rapport sur la
situation des caisses populaires, Port-au-Prince, Décembre 2009, p7
www.anacaph.coop
* 4 Ibid.
* 5 Jean POINCY, Précis
d'introduction à l'économie, Port-au-Prince, 2006, P 8.
* 6 Ibid., p 10
* 7 Législateurs :
sont les responsables d'élaboration et de vote de loi
* 8 ÉLIE, Jean
Rénol / Des coopératives, pourquoi faire ? H ; 334.9 ;
e42c ; 1991, Bibliothèque nationale, Port-au-Prince, p23
* 9 Ibid., p 27
* 10 KOTELAM : koperativ
Tèt Ansanm pou Lavi Miyò, Port-au-Prince, fondée en
1989.
* 11 Institution
Québécoise d'encadrement des coopératives en particulier
des coopec selon un alliage de principes des pionniers de Rochdale et de ceux
du fonctionnaire québécois dénommé : Gabriel
Alphonse Desjardins.
* 12 Le Quotidien du peuple,
Rôle des coopératives dans l'économie mondiale, 2 juillet,
2001, Ottawa, p22
* 13 Welfariste est
communément admis en français comme l'adjectif
dérivé du mot anglais welfare qui signifie
l'effort social engagé pour promouvoir le bien-être
matériel et physique des personnes dans le besoin.
* 14 www.microfinance.lu,
Théorie des welfaristes sur la microfinance,
www.microfinance.lu.
25/6/2013
* 15 Ibid., p, 14
* 16 On dit coopérative
d'Epargne et de Crédit (CEC) ou Caisse Populaire ou encore banque
populaire dans quelques pays
* 17 Conseil d'Administration,
Document de formation des nouveaux membres, KOTELAM, Port-au-Prince, mars
2012, p, 13
* 18Bernard, Yves et Colli
Jean Claude, vocabulaire économique et financier,
6eme édition, Seuil, 1996, 1515p.
* 19 Classe sociale: selon
joseph fitcher « c'est une catégorie de gens dont la situation
dans la vie est relativement similaire, prise en gros, leur statut
socioéconomique est à peu près de même niveau, ils
s'approchent entre eux plus facilement qu'ils n'accèdent auprès
de ceux qui se situent à d'autres niveaux sociaux.
* 20 Wilkipedia,
socioéconomie,
www.wilkipedia.socio.com,
No version 101198830, 12/02/2014
* 21Le Robert de poche, 2014,
p, 454.
* 22Smith. E. METELLUS,
Méthodologie de la recherché scientifique, 2010, p 3.
* 23 Madeleine GRAWITZ,
Méthode des sciences sociales 11e, Dalloz, 2001, p, 17.
* 24 Ibid., p, 23
* 25 Emile
DURKEIM, Les règles de la méthode sociologique,
Paris, les Presses universitaires de France 16eme édition,
1973, p, 37.
* 26Omar AKTOUF
Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des
organisations. Une introduction à la démarche classique et une
critique.
Montréal : Les Presses de l'Université
du Québec, 1987, p210
* 27 Herve Séjour, Le
coopératisme à la lumière du christianisme,
Port-au-Prince, p.17
* 28 Ibid. p.17
* 29OTI (Organisation
Internationale du Travail), Genève, Recommandations 127, 1966
* 30Boucher,
Coopérative: Source de développement durable, Le nouvelliste,
Port-au-Prince, No 27865, 23juillet 2001
* 31 Le petit Larousse, p.
221.
* 32 Ibid., p. 220-221
* 33 Sylvain Fernand,
Dictionnaire de la comptabilité, Institut Canadien des comptables
Agréés, Paris, 1977, p24.
* 34 Alliance
Coopérative Internationale, chapitre I, art 7,1985, p13.
* 35 Ibid., p 19.
* 36 `'Le démarrage
d'une coopérative'', cahier du participant, @IRFEC-mars 1996, p.5
* 37 Mémoire de
L'Association nationale des caisses populaires Haïtiennes (ANACAPH) soumis
au parlement de la république d'Haïti et projet de Loi sur les
coopératives d'épargne et de crédit avril, 2002, p, 14.
Loi vote au parlement Haïtien le 15/4/2002
* 38 Démocratie
coopérative et répartition du trop perçu en fonction des
activités et des capitaux, deux des sept grands principes de base de la
coopérative.
* 39 Charles GIDE,
économiste François, née à Uzès (1847-1932).
Il a développée le principe coopératif.
* 40 Cf.
références générales et spécifiques dans
DESROCHE (H.) - Le projet coopératif. Paris, Editions ouvrières
1976 - p. 461
* 41 Représentant d'une
réalité idéale et sans défaut, une
société parfaite ou encore une communauté d'individus
vivant heureux et en harmonie. (François Rabelais (1534)
* 42 Dr Hans Müller,
<< Alternum>>, Handworterbuch des Genossen Chafswesens,
Harausgregeben von Prof. Dr V. Totomiantz, Berlin, Verlab Struppe und Wickler.,
p245.
* 43 Babylonie est un pays qui
existait 2350 ans avant JESUS CHRIST
* 44 Le Code Hammourabi est un
texte juridique babylonien daté d'environ 1750 av. J.C. dont la majeure
partie est constituée de décision de justice.
* 45 Exploitation agricole
collective en Russie
* 46 Jean-François
DRAPERIE, la Recma. « Mouvement Coopérative », alternatives
Economique Poche n° 022- janvier 2006
* 47 Ibid.
* 48 Coopération
Mondragon est un groupe basque de 256 entreprises et entités en 2008. La
plus grande partie des entreprises de cette coopération sont des
entreprises coopératives. Elle se divise en quatres qui évoluent
dans des secteurs différents : la finance, la distribution et la
connaissance avec des aires de recherche et de formation. Elle
considérée comme la plus grande groupe coopératif du monde
entier.
* 49 Fédération
des caisses populaires Desjardins, loi, règlements et déontologie
des caisses populaires et fédération , Québec, 1996,
p,34.
* 50 Alliance
coopérative internationale, Manchester, AIC, 1995
* 51 ACECA L'Association des
coopératives d'épargne et de Crédit en Afrique qui
consiste à encadrer le mouvement coopérative dans tout le
continent à fin de garantir une certaine pérennité.
* 52 Nairobi : Capital du
Kenya ou a eu lieu l'assemblée de l'Association des Coopératives
d'Epargne et de Crédit en Afrique.
* 53 Le Conseil mondial des
Coopératives d'Epargne et de Crédit a son siège à
Washington aux Etats unis. Il est crée par les associations
affiliées en 1970 et connu sous le nom de WOCUU (World Council of
crédit Union)
* 54 Grameen bank, de
manière littérale signifie banques des villages. Cette banque se
spécialise dans le mouvement coopératif d'Epargne et de
crédit. Son fondateur est l'économiste Muhammad YUNUS elle a
été créée au Bengladesh.
* 55 Discours de M. Jacques
CHIRAC, l'ex Président de la république de France à
l'occasion de la Conférence international de Paris sur la Microfinance.
(Paris, 20 juin 2005)
* 56 Cette forme de prêt
leur permet d'acheter des produits de consommation
* 57 Cette autre forme de
microcrédit s'intéresse surtout aux gens qui ont l'idée
d'entrepreneuriat, qui ont un plan de créer leur propre activité
économique.
* 58 Institut Haïtien de
statistique et d'informatique, Carte géographie et population de Delmas,
1999, retrouve sur le site. (
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delmas_(Ha%C3%AFti)).
* 59 Ibid.
* 60 Document de Recensement
Institut Haïtien de Statistique et de l'Informatique, 1998, p25.
* 61 Bid, p 27
* 62 Ibid., p32
* 63 Ibid., p 33
* 64 Ibid.
* 65 Ibid., p 35
* 66 Ibid, p 37.
* 67Henry Bazin, Le secteur
privé Haïtien à l'orée du troisième
millénaire: défis et nouveaux rôles, Port-au-Prince, 1999.
P 6
* 68 Ibid., p 8
* 69 Christian Robert, Histoire
de la Microfinance en Haïti, (cours dispense à l'inaghei),
Port-au-Prince, 2009, p 4
* 70 Ibid., p 6
* 71 Jean Renol ELIE, Des
coopératives pourquoi faire? Programme paysan, groupe Haïtien de
recherché et d'action pédagogiques (GHRAP), 2001 p, 8.
* 72 ibid., p8
* 73 Ibid., p 15
* 74 Législation
Haïtienne, la loi sur les coopératives, Le Moniteur, 1960, p 4
* 75 Ibid., p 17
* 76H. (Dr F. Duvalier OEuvres
essentielles : Tome II), p 45
* 77 PYLE, Larson et zin
collecte, « entreprise coopérative », in initiation
à la comptabilité financière et administrative, 3eme
éd, canado-François, 1985.
* 78 GIRAULT, Christian, Le
commerce du café en Haïti, Habitants, spéculateurs et
exportateurs, Centre national de la recherché scientifique, Paris,
1982, 293p
* 79 ibid.
* 80 Législation
Haïtienne, la Loi sur les coopératives, le moniteur, 1987, p 6.
* 81Dr Legrand BIJOUX, cour
supérieur de coopératisme (Guide du professeur) mimeo, Paris,
1980, p, 28.
* 82 Coopératives en
Haïti, bulletin d'information du Conseil National des Coopératives,
sixième année, no.2, juin, 1985, p, 5
* 83 Ibid., p 7
* 84Le Progressiste
Haïtien (journal du gouvernement), 3 mai, 1988, p, 17.
* 85 Constitution
Haïtienne, centre oecuménique des droits de l'homme, 1987,
article5, p, 4.
* 86 Dominique GENTIL, Les
pratiques coopératives en milieu rural Africain, l'Harmattan, Paris,
1950, p67.
* 87 Revitalisation du
Mouvement Coopératif Haïtien, recensement 1999, p, 23
* 88 A noter que les
coopératives, régissant par le décret de 1981 ont pu
trouver l'appui du DID, car on considère que cette approche
économique a connu une réussite quasi-totale au Québec.
* 89Comite de surveillance de
la Kotelam, Manuel de formation des nouveaux sociétaires, KOTELAM, 2008,
p, 13.
* 90 Ibid., p, 15
* 91 Ibid, p 17
* 92 Ibid p, p22
* 93 Un intérêt
calcule sur le solde du prêt en début de période
* 94 Un intérêt
calculé sur le montant original du prêt pendant toute la
durée de ce dernier.
* 95 Comite de crédit de
la Kotelam, Documents de prêt de la kotelam, 2014, p, 3.
* 96 Cette méthodologie
est celle dans laquelle le crédit est accordé à un
individu qui en assume seule la
responsabilité directement auprès de l'institution
créancière.
* 97 Il s'agit d'une obligation
faite à l'emprunteur de laisser dans un compte bloqué
auprès du prêteur une
Fraction (ou pourcentage) du montant du prêt, ou
d'accumuler préalablement dans un compte d'épargne
une fraction du montant du prêt sollicité.
* 98 Ils représentent un
prélèvement effectué en amont par le prêteur sur le
montant du prêt. Ils sont exprimés
en pourcentage du montant nominal du prêt.
* 99 BRH (Banque de la
Republique d'Haïti), Rapport annuel, 2001, p 5
* 100 Ibid.
* 101 Ibid.
* 102 Fritz DESHOMMES,
politiques économiques en Haïti, rétrospectives et
perspectives, Port-au-Prince, Ed, Cahiers Universitaires. 2005, p95.
* 103 BRH ; Banque de la
République d'Haïti. C'est elle qui gouverne toutes les autres
banques. On l'appelle aussi la banque des banques.
* 104 BRH (Banque de la
republique d'Haiti) rapport annuel, 2005, p23.
* 105 François,
Lhermite, recensement sur l'industrie de la microfinance
haïtienne, USAID, Port-au-Prince, 2009, p32.
* 106 Ibid.
* 107 Ibid., p, 35
* 108
Une assurance est un service qui fournit une
prestation lors de la survenance d'un événement incertain et
aléatoire souvent appelé "
risque". La
prestation, généralement financière, peut être
destinée à un individu, une association ou une entreprise, en
échange de la perception d'une
cotisation ou
prime.
* 109
La solvabilité est la mesure de la
capacité d'une personne physique ou morale à payer ses
dettes sur le
court, moyen et long terme
* 110 Elle est
déterminée par les conditions de crédit, le taux
d'intérêt, la durée des prêts, les garanties, les
autres coûts, les montants minimum et maximum.
* 111 Un intérêt
calculé sur le solde du prêt en début de période
* 112 Un intérêt
calculé sur le montant original du prêt pendant toute la
durée de ce dernier.
* 113 Conseil
d'administration, rapport annuel 2007, KOTELAM, p, 21.
* 114 Loi sur les
coopératives d'épargne et de crédit, en
référence au décret du 2 avril 1981, le Moniteur, 10
juillet 2002, p5



