0.1. INTRODUCTION GENERALE
0.2. Choix et intérêt du
sujet
Le domaine hydraulique nous intéresse au premier chef
compte tenu de son utilité dans divers usines et industries. Nous voyons
ici les implications directes ou indirectes dans le vaste chantier de la
construction du pays. De même, étant donné que le circuit
de traitement des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel
s'avère être indispensable pour l'humanité de nos jours.
Voilà ce qui explique notre motivation. Ainsi nous nous
sommes résolus dans le cadre de ce travail de fin de cycle,
d'approfondir notre connaissance acquise tout au long de notre formation
à l'Institut Supérieur Pédagogique et Technique de
Kinshasa ISPT-KIN en sigle un peu plus dans ce domaine que nous aimons bien et
de pouvoir maximiser notre chance de trouver du travail dans ce domaine.
0.3. Problématique
Comme on le sait pertinemment bien,
sans l'eau, pas de vie. Elle est repartie sur une très grande
étendue de la planète terre. Etant considéré comme
un trésor pour l'homme dans ses diverses activités voire
même la vie des végétaux et des animaux, elle est sans
aucun doute un constituant nécessaire.
A ce titre, et compte tenu de son importance, reconnaissons
que toutes les entreprises de façon générale ont besoin de
l'eau pour leur bon fonctionnement, tout comme l'usine de Kwilu-Ngongo. A titre
d'exemple on peut citer les industries agroalimentaires, les usines
hydrauliques, les laveries minérales, etc.
L'eau qui coule est ordinairement saine, la pollution de l'eau
est presque toujours due aux activités humaines, même si cette
pollution est parfois accidentelle. La principale conséquence de la
pollution de l'eau est une diminution de la quantité et de la
qualité de l'eau potable que l'homme utilise. Et cette pollution de
l'eau peut avoir de graves conséquences sur la santé de l'homme.
Les maladies liées à la contamination de l'eau
représentent une charge considérable pour l'humanité.
Face à l'accroissement de la pollution des eaux
usées rejetées dans le milieu naturel, responsables des maladies
qui provoquent la réduction de l'espérance de vie de l'homme sur
la terre, les difficultés de traitement de ces eaux augmentent aussi car
les produits artificiels générés par les scientifiques ne
sont pas toujours biodégradables. Aujourd'hui, on ne peut nullement s'en
passer. Cependant une question mérite
d'être posée :
Toutes les eaux usées qui influent le milieu naturel et
qui constituent beaucoup des sources de maladies faut-il les laisser dans notre
environnement ? Que devons-nous faire ? Et comme dans la plupart des
pays il n'y a pas de services de suivi ou de surveillance
épidémique efficace pour la protection de la santé des
populations, comment peut-on agir à ce stade ?
0.4. Hypothèse du
travail
Depuis un certain temps, la compagnie sucrière de
Kwilu-Ngongo occupe une place importante dans la réalisation
budgétaire de notre pays grâce à sa production, nous osons
croire que cela a un effet positif sur la vie sociale et économique des
habitants du Congo.
Dans la cité de Kwilu-Ngongo où nous avons
mené notre étude, le besoin de l'eau qui coule n'a cessé
d'augmenter du jour au jour pour les habitants. Certes, l'usine de Kwilu-Ngongo
devrait penser réhabiliter leur circuit de traitement de ces eaux
usées avant rejet dans le milieu naturel pour éviter la
pollution, les maladies qui peuvent ruiner la vie des habitants. C'est par
là que nous avons proposé la réhabilitation du circuit de
traitement des eaux usées de l'usine de Kwilu-Ngongo au Kongo
Central.
0.5. But et objectif du
travail
Le but poursuivi dans ce travail est d'équiper notre
bibliothèque de l'institut supérieur pédagogique et
technique (ISPT) en sigle sur le plan théorique et descriptif d'un
document de référence sur le traitement des eaux usées
provenant des circuits industriels.
L'objectif général de ce travail est d'attirer
l'attention des étudiants qui seront appelés à oeuvre dans
ce domaine sur le traitement des eaux usées.
Nous allons donc dans ce travail proposer à l'usine de
Kwilu-Ngongo au Kongocentral de réhabiliter son circuit de traitement
des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel enfin de
résoudre les problèmes dus à la pollution de l'eau qui
coule naturellement car ce sont ces eaux que les habitants utilisent dans leurs
maisons pour les travaux ménagers, le nettoyage corporel, ainsi la
pollution de l'eau dans cette région sera réduite.
0.6. Méthodologie du travail
Pour arriver à bien
élaborer ce travail, nous avons utilisé plusieurs méthodes
et techniques de recherche qui nous permettront de définir quelques
concepts de base ayant trait à notre sujet, il s'agit de:
v Méthode historique
Elle nous a permis de retracer l'historique et
l'évolution du circuit actuel de traitement des eaux usées de
l'usine de Kwilu-Ngongo
v Méthode documentaire
Elle nous a permis de consulter les ouvrages, les travaux de
fin d'études et les notes de cours en rapport avec le sujet. Nous avons
aussi consulté l'internet et nous avons fait une descente dans le
village concerné afin de procéder à des interviews
(enquêtes sur terrain)
v Interview
Cette méthode nous a permis de recueillir les
informations relatives à notre sujet auprès des responsables en
charge de ce département.
0.7. Délimitation du travail
Pour être plus bref et compte
tenu du volume de la matière, nous n'allons nullement concevoir ou
installer un système de traitement d'eaux usées pour la compagnie
sucrière de Kwilu-Ngongo, mais nous nous limitons ici à la
description de traitement des eaux usées de l'usine de Kwilu-Ngongo et
nous voulons simplement faire ressortir les paramètres utiles, les
mécanismes saillants pour réduire les quantités des eaux
usées dans lacité de Kwilu-Ngongo au Kongo Central.
0.8. Subdivision du travail
Hormis l'introduction et la
conclusion générale, notre travail se subdivise en trois
chapitres à savoir :
ü Le premier chapitre expose la théorie
générale des eaux usées ;
ü Le second chapitre présent la
généralité sur la compagnie sucrière de
Kwilu-Ngongo;
ü Le dernier chapitre traite la réhabilitation du
circuit de traitement des eaux usées de l'usine de Kwilu-Ngongo.
CHAPITRE I : THEORIE
GENERALE DES EAUX USEES
I.0. PREAMBULE
L'eau usée est le synonyme de l'eau résiduaire.
L'utilisation des eaux engendre un nouveau produit appelé effluent ou
eau usée. Les problèmes liés aux eaux usées sont
aussi anciens que ces eaux elles même et ils s'aggravent suivant la
croissance démographique, l'amélioration de la qualité de
vie des populations et le développement des activités
industrielles.
Conserver nos habitudes actuelles revient à favoriser
l'aggravation des négligences qui sont déjà
considérables. D'après les estimations, bien plus de 80 % des
eaux usées à travers le monde (plus de 95 % dans certains pays en
développement) sont rejetées dans l'environnement sans
traitement. Les conséquences sont alarmantes. La pollution de l'eau
s'aggrave dans la plupart des fleuves d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
Latine. En 2012, plus de 800 000 décès à travers le monde
étaient causés par une eau potable contaminée, des
installations de lavage de mains inadéquates et des services
d'assainissement inappropriés. Dans les mers et les océans, les
zones mortes désoxygénées causées par la
décharge des eaux usées non traitées augmentent à
un rythme soutenu, affectant environ 245 000 km²
d'écosystèmes marins, ce qui a un impact sur la pêche, les
moyens de subsistance et les chaînes alimentaires.
Les eaux usées sont utilisées pour des usages
domestiques, industriels ou même agricole, constituant donc un effluent
pollué qui sont rejetées dans un émissaire d'égout.
Ils regroupent les eaux usées domestiques (les eaux de vannes et les
eaux Ménagères), les eaux de ruissellement et les effluents
industriels (eaux usées des usines).
A l'échelle mondiale, le traitement des eaux
usées constitue le premier enjeu de santé publique ; plus de
900 enfants de moins de 5 ans tombent malades et meurent chaque année
liée à l'absence de traitement des eaux et au manque
d'hygiène induit.Les eaux usées ont été longtemps
considérées comme un fardeau en matière d'assainissement,
lorsqu'elles ne sont pas tout simplement ignorées. Avec la
raréfaction de l'eau dans plusieurs régions, cette situation
connaît une évolution, et on reconnaît de plus en plus
l'importance de la collecte, du traitement et de la réutilisation des
eaux usées.
Dans une maison, les eaux usées proviennent
principalement de la cuisine et de la salle de bain, elles sont appelées
eaux grises ou eaux de vannes qui proviennent des toilettes. Les principaux
constituants néfastes des eaux usées sont les nitrates
(NO3-1) et les phosphates (P04-3),
mais les eaux usées contiennent ainsi des métaux lourds des PCB
(polychlory de biphenil), des hydrocarbures et parfois des médicaments.
Il est donc essentiel d'accroître l'acceptation sociale
de l'utilisation des eaux usées afin de favoriser le progrès dans
ce sens. C'est en cela que l'éducation et la formation, ainsi que les
nouvelles formes de sensibilisation, sont importantes pour changer la
perception des risques liés à la santé et aborder les
préoccupations socioculturelles, afin de favoriser l'acceptation du
public. C'est également profitable. En tant que composante essentielle
d'une économie circulaire, l'utilisation des eaux usées et la
récupération des sous-produits peuvent générer de
nouvelles opportunités d'affaires et permettre de
récupérer de l'énergie, des nutriments, des métaux
et d'autres sous-produits.
I.1. LES DEFINITIONS DES EAUX USEES
Nous avons pu nous apercevoir qu'il existe un éventail
de définitions des eaux usées, qui peuvent ne pas avoir le
même sens pour tout le monde. Les ingénieurs, les urbanistes, les
gestionnaires de l'environnement et les chercheurs, sans oublier des nombreux
organismes des Nations Unies, ont abordé différents aspects des
eaux usées dans de nombreux rapports, chacun avec une perspective et un
vocabulaire propres. Nous nous sommes efforcés de nous appuyer sur
plusieurs de ces documents, comme en témoigne la longue liste des
références, afin de présenter un compte rendu
équilibré, factuel et neutre de la masse de connaissances
actuelles, couvrant les évolutions les plus récentes dans le
domaine de la gestion des eaux usées, et les divers avantages et
opportunités qu'elle offre dans un contexte d'économie
circulaire.
En parlant de l'eau usée il semble important d'avoir
une idée sur sa définition, son origine et ses
caractéristiques, ainsi que les différentes méthodes de la
pollution de l'eau.
Par définition :
Ø Les eaux usées sont des eaux
altérées par les activités humaines à la suite d'un
usage domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre.
Ø Les eaux usées, sont des eaux chargées
de polluants, solubles ou non, provenant essentiellement de l'activité
humaine. Une eau usée est généralement un mélange
de matières polluantes répondant à ces catégories,
dispersées ou dissoutes dans l'eau qui a servi aux besoins domestiques
ou industriels. Donc sous la terminologie d'eau résiduaire, on groupe
des eaux d'origines très diverses qui ont perdu leurs puretés ;
c'est-à-dire leurs propriétés naturelles par l'effet des
polluants après avoir été utilisées dans des
activités humaines (domestiques, industrielles ou agricoles).
Ce sont des eaux qui sont de nature à polluer les
milieux dans lesquels elles seront déversées.
La question des eaux usées n'est pas une simple
question de gestion des ressources en eau. Elle affecte l'environnement et tous
les êtres vivants, et peut avoir des impacts directs sur les
économies, aussi bien matures qu'émergentes. Par ailleurs, les
flux d'eaux usées contiennent un certain nombre de matières
utiles, telles que des nutriments, des métaux et des matières
organiques qui, tout comme l'eau elle-même, peuvent être extraites
et utilisées à d'autres fins productives. À ce titre, les
eaux usées constituent une précieuse ressource qui, si elle est
gérée de façon durable, peut devenir un pilier essentiel
de l'économie circulaire. Les retombées de l'amélioration
de la façon dont nous gérons les eaux sont énormes, avec
des avantages partagés pour les sociétés et
l'environnement.
I.2. LA CLASSIFICATION DES EAUX USEES
D'après les origines des eaux usées on peut les
classer comme suit:
- Les eaux usées domestiques (EUD);
- Les eaux usées urbaines (EUU) ;
- Les eaux usées industrielles (EUI).
I.2.1. Les eaux
usées domestiques
Les eaux usées domestiques (EUD) comprennent les eaux
ménagères (eaux de toilette, de lessive, de cuisine) et les eaux
de vannes (urines et matières fécales).

Figure (I-1):Image représentative d'un
circuit des eaux usées domestiques.
Les eaux usées domestiques contiennent des
matières minérales et des matières Organiques. Les
matières minérales (chlorures, phosphates, sulfates, etc.) et les
matières Organiques constituées de composés ternaires,
tels que les sucres et les graisses (formés de Carbone, oxygène
et hydrogène, mais aussi d'azote et dans certains cas, d'autres corps
tels que soufre, phosphore, fer, etc.).
Ces eaux sont généralement constituées de
matières organiques dégradables et de matières
minérales. Ces substances sont sous forme dissoute ou en suspension.
Elles se composent essentiellement des eaux de vanne d'évacuation de
toilette et des eaux ménagères d'évacuation des cuisines,
salles de bains.
Elles proviennent essentiellement :
· Des eaux de cuisine qui contiennent des matières
minérales en suspension provenant du lavage des légumes, des
substances alimentaires à base de matières organiques (glucides,
lipides, protides) et des produits détergents utilisés pour le
lavage de la vaisselle et ayant pour effet la solubilisation des graisses ;
· Des eaux de buanderie contenant principalement des
détergents;
· Des eaux de salle de bain chargées en produits
utilisés pour l'hygiène corporelle, généralement
des matières grasses hydrocarbonées;
· Des eaux de vannes qui proviennent des sanitaires
(w.c), très chargées en matières organiques
hydrocarbonées, en composés azotés, phosphatés et
microorganismes.
La pollution journalière produite par une personne
utilisant de 150 à 200 litres d'eau est évaluée à
:
ü de 70 à 90 grammes de matières en
suspension ;
ü de 60 à 70 grammes de matières
organiques ;
ü de 15 à 17 grammes de matières
azotées ;
ü 4 grammes de phosphore ;
ü plusieurs milliards de germes pour 100 ml.
I.2.2. Les eaux usées urbaines
Les eaux usées urbaines (EUU) comprennent les eaux de
ruissellement (eaux pluviales, eaux d'arrosage des voies publiques, eaux de
lavage des caniveaux, des marchés et des cours).

Figure (I-2):Image représentative d'un
circuit des eaux usées urbaines.
Les eaux qui ruissellent sur les toitures, les cours, les
jardins, les espaces verts, les Voies publiques et les marchés
entraînent toutes sortes de déchets minéraux et organiques
tels que : de la terre, des limons, des boues, des sables, des déchets
végétaux (herbes, pailles, feuilles, graines, etc.). Et toutes
sortes de micropolluants (hydrocarbures, pesticides venant des jardins,
détergents utilisés pour le lavage des cours, des voies
publiques, des automobiles, débris microscopiques de caoutchouc venant
de l'usure des pneumatiques des véhicules, plomb venant du plomb
tétra éthyle contenu dans l'essence, retombées diverses de
l'atmosphère, provenant notamment des cheminées domestiques et
des cheminées d'usines.).
Donc ces eaux sont l'issue :
· Des apports directs dus aux traitements des milieux
aquatiques et semi aquatiques tels que le désherbage des plans d'eau,
des zones inondables (faucardage chimique) et des fossés, ainsi que la
démoustication des plans d'eau et des zones inondables (étangs et
marais) ;
· Des apports indirects dus en particulier à
l'entraînement par ruissellement, aux eaux de rinçage des
appareils de traitement, aux résidus présents dans des emballages
non correctement rincés ou détruits, aux eaux résiduaires
des usines de fabrication et de conditionnement.
La composition et les caractéristiques des eaux
usées urbaines (EUU) sont peu variables par rapport aux eaux
usées industrielles (EUI).
I.2.3. Les eaux usées industrielles
Tous les rejets résultant d'une utilisation de l'eau
autre que domestique sont qualifiés de rejets industriels. Cette
définition concerne les rejets des usines, mais aussi les rejets
d'activités artisanales ou commerciales : blanchisserie, restaurant,
laboratoire d'analyses médicales, etc.

Image (I-3):Image représentative d'un
circuit des eaux usées industrielles.
La variété des eaux usées industrielles
(EUI) est très grande. Certaines de ces eaux sont toxiques pour la flore
et la faune aquatiques, ou pour l'homme. Il faut bien distinguer les eaux
résiduaires et les liquides résiduaires de certaines
industries.
Les eaux industrielles sont celles qui ont été
utilisées dans des circuits de réfrigération, qui ont
servi à nettoyer ou laver des appareils, des machines, des
installations, des matières premières ou des produits d'une
usine, ou qui ont servi à retenir des poussières de fumées
; Elles peuvent contenir des substances chimiques utilisées au cours des
fabrications. Les liquides industriels sont des liquides résultant des
fabrications ; C'est le cas des solutions de produits chimiques, des solutions
de sous-produits, c'est le cas des liquides acides provenant de la vidange des
cuves de décapage des métaux.
Les rejets industriels peuvent donc suivre trois voies
d'assainissement :
-Ils sont directement rejetés dans le réseau
domestique ;
-Ils sont prétraités puis rejetés dans le
réseau domestique ;
-Ils sont entièrement traités sur place et
rejetés dans le milieu naturel.
Les caractéristiques des eaux usées
industrielles subissent des grandes variations, elles dépendent d'une
multitude de paramètres-type de l'industrie, la production, le
nettoyage, les différentes étapes du procédé industriel, l'état de l'appareil,... Par
ailleurs, il existe des caractéristiques communes entre les effluents de
la même industrie.
En termes de volume et type de polluants, les effluents
industriels présentent le plus souvent une charge importante et un
risque de dysfonctionnement structurel et fonctionnel des réseaux
d'assainissement et des dispositifs de traitement des eaux usées. Ces
risques sont d'autant plus grands que les industries sont localisées en
amont du réseau d'assainissement. Les déchets et les effluents
industriels définissent largement la qualité et le taux de
pollution de ces eaux usées. On peut néanmoins, faire un
classement des principaux rejets industriels suivant la nature des
inconvénients qu'ils déversent et les principaux polluants
transitant dans les eaux usées d'origine industrielle sont :
· Pollution due aux matières en suspension
minérales (lavage de charbon, carrière, tamisage du sable et
gravier, industries productrices d'engrais phosphatés....) ;
· Pollution due aux matières en solution
minérales (usine de décapage, galvanisation...) ;
· Pollution due aux matières organiques et
graisses (industries agroalimentaires, équarrissages, pâte
à papier...) ;
· Pollution due aux rejets hydrocarbonés et
chimiques divers (raffineries de pétrole, porcherie, produits
pharmaceutiques.....) ;
· Pollution due aux rejets toxiques (déchets
radioactifs non traités, effluents radioactifs des industries
nucléaires....).
· Pollution organique (les métaux toxiques, les
toxines organiques, les matières colorées, les huiles et
graisses, les sels).
Les eaux résiduaires d'origine industrielle ont
généralement une composition plus spécifique et
directement liée au type d'industrie considérée.
Indépendamment de la charge de la pollution organique ou
minérale, de leur caractère putrescible ou non, elles peuvent
présenter des caractéristiques de toxicité propres
liées aux produits chimiques transportés.
A cet effet, il s'agit de veiller à ce que les
caractéristiques physico-chimiquesdes eaux usées industrielles
rejetées dans les cours d'eau ou dans le milieu naturel restent soient
telles que leur impact sur le milieu aquatique soit minimisé. A cette
fin, des normes générales et sectorielles de rejet sont mises en
place. En outre, un mécanisme de taxation de ces rejets basé sur
leur charge polluante incite les entreprises à traiter leurs effluents
de sorte que leur teneur en polluants soit inférieure aux normes.
I.3. LA COMPOSITION DES EAUX USEES
La composition des eaux usées, est extrêmement
variable en fonction de leur origine. Elles peuvent contenir des nombreuses
substances, sous forme solide ou dissoute, ainsi que des nombreux
microorganismes. En fonction de leurs caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques et du danger sanitaire qu'elles représentent, ces
substances peuvent être classées en quatre groupes : les
matières en suspension, les micro-organismes, les éléments
traces minéraux ou organiques, et les substances nutritives.
Tableau (I-1) : Composition des eaux
usées
|
Constituants
|
Concentration (mg/l)
|
|
Fort
|
Moyen
|
Faible
|
|
Solides totaux
|
1200
|
700
|
350
|
|
Solides dissous
|
850
|
500
|
250
|
|
Solides suspendus
|
350
|
200
|
100
|
|
Azote (en N)
|
85
|
40
|
20
|
|
Phosphore (en P)
|
20
|
10
|
6
|
|
Chlore 1
|
100
|
50
|
30
|
|
Alcalinité
|
200
|
100
|
50
|
|
Graisses
|
150
|
100
|
50
|
|
DBO5
|
300
|
200
|
100
|
La DBO5 est la demande biochimique
en oxygène à 20°C pendant 5 jours, c'est une mesure de la
matière organique biodégradable dans les eaux usées. Elle
dépend de :
- L'activité humaine et la nature des effluents
industriels éventuellement rejetés dans le réseau
urbain.
- La composition des eaux d'alimentation en eau potable, et la
nature des matériaux des canalisations d'eau.
I.3.1. Les matières en suspension
Les matières en suspension sont en majeure partie de
nature biodégradable. La plus grande part des microorganismes
pathogènes contenus dans les eaux usées est transportée
par les MES. Elles donnent également à l'eau une apparence
trouble, un mauvais goût et une mauvaise odeur. Cependant, elles peuvent
avoir un intérêt pour l'irrigation des cultures.
I.3.2. Les micropolluants organiques et non
organiques
Les micropolluants sont des éléments
présents en quantité infinitésimale dans les eaux
usées. La voie de contamination principale, dans le cas d'une
réutilisation des eaux usées épurées, est
l'ingestion. C'est la contamination par voie indirecte qui est
généralement préoccupante. Ainsi, certains micropolluants,
comme les métaux lourds ou les pesticides, peuvent s'accumuler dans les
tissus des êtres vivants, et notamment dans les plantes cultivées.
Il peut donc y avoir une contamination de la chaîne alimentaire et une
concentration de ces polluants dans les organismes.
I.3.2.1. Eléments traces
Les métaux lourds que l'on trouve dans les eaux
usées urbaines sont extrêmement nombreux ; les plus abondants sont
le fer, le zinc, le cuivre et le plomb.
Les autres métaux (manganèse, aluminium, chrome,
arsenic, sélénium, mercure, cadmium, molybdène, nickel,
etc.) sont présents à l'état de traces. Certains
éléments traces, peu nombreux, sont reconnus nécessaires,
en très faibles quantités, au développement des
végétaux : le bore, le fer, le manganèse, le zinc, le
cuivre et le molybdène. L'irrigation, à partir d'eaux
usées, va apporter ces éléments.
I.3.2.2. les micropolluants organiques
Les micropolluants d'origine organique sont extrêmement
nombreux et variés, ce qui rend difficile l'appréciation de leur
dangerosité. Ils proviennent de l'utilisation domestique de
détergents, pesticides, solvants, et également des eaux pluviales
: eaux de ruissellement sur les terres agricoles, sur le réseau routier,
etc.
Ils peuvent aussi provenir de rejets industriels quand ceux-ci
sont déversés dans les égouts ou même des
traitements de désinfections des effluents par le chlore.
Dans le sol, ces micropolluants restent liés à
la matière organique ou absorbés sur les particules du sol.
Cependant, quelques composés ioniques (pesticides organochlorés,
solvants chlorés) peuvent être entraînés en
profondeur.
En raison de la faible solubilité de ces
éléments organiques, on les retrouvera concentrés dans les
boues et c'est surtout lors de l'épandage de ces dernières que
leurs teneurs devront être contrôlées.
Les pesticides sont les éléments traces les plus
surveillés, et une étude d'impact et de métabolisme est
obligatoire avant leur mise sur le marché. Par contre, le danger
représenté par tous les autres polluants organiques est encore
mal apprécié actuellement. Les contrôles de routine ne
permettent pas de repérer toutes les toxines.
I.3.2.3. Les substances nutritives
L'azote, le phosphore, le potassium, les
oligo-éléments, le zinc, le bore et le soufre, indispensables
à la vie des végétaux, se trouvent en quantités
appréciables, mais en proportions très variables par rapport aux
besoins de la végétation, dans les eaux usées
épurées ou non. D'une façon générale, une
lame d'eau résiduaire de 100 mm peut apporter à l'hectare :
§ De 16 à 62 kg d'azote ;
§ De 2 à 69 kg de potassium ;
§ De 4 à 24 kg de phosphore ;
§ De 18 à 208 kg de calcium ;
§ De 9 à 100 kg de magnésium ;
§ De 27 à 182 kg de sodium.
a. L'azote
L'azote se trouve dans l'eau usée sous forme organique
ou ammoniacale dissoute. Il est souvent oxydé pour éviter une
consommation d'oxygène (O2) dans la nature et un risque de
toxicité par l'ammoniaque gazeux dissous (NH3), en
équilibre avec l'ion ammoniac (NH4+).
b. Le phosphore
La concentration en phosphore dans les effluents secondaires
varie de 6 à 15 mg/l (soit 15 à 35 mg/l) .Cette quantité
est en général trop faible pour modifier le rendement. Mais s'il
y a excès, il est pour l'essentiel retenu dans le sol par des
réactions d'adsorption et de précipitation; cette
rétention est d'autant plus effective que le sol contient des oxydes de
fer, d'aluminium ou du calcium en quantités importantes. On ne rencontre
pas en général de problèmes liés à un
excès de phosphore.
c. Le potassium (K+)
Le potassium est présent dans les effluents secondaires
à hauteur de 10 à 30 mg/l (12 à 36 mg/l de K20)
et permet donc de répondre partiellement aux besoins.
d. le Chlore et le sodium
Leur origine est :
§ Naturelle ;
§ humaine ;
§ industrielle (potasse, industrie
pétrolière, galvanoplastie, agroalimentaire). Les chlorures et le
sodium peuvent également poser problème, notamment en bord de
mer, quand les réseaux d'égout drainent des eaux
phréatiques saumâtres.
I.4. LES CARACTERISTIQUES
DES EAUX USEES
I.4.1. Les caractéristiques physiques
a. La température
La température est un facteur écologique
important du milieu. Elle permet de corriger les paramètres d'analyse
dont les valeurs sont liées à la température
(conductivité notamment). Il est important de connaitre la
température de l'eau avec une bonne précision, en effet celle-ci
joue un rôle dans la solubilité des sels et surtout des gaz, dans
la dissociation des sels dissous donc sur la conductivité
électrique, dans la détermination du pH, pour la connaissance de
l'origine de l'eau et des mélanges éventuels. Elle agit aussi
comme un facteur physiologique agissant sur le métabolisme de croissance
des micro-organismes vivant dans l'eau.
b. La conductivité
La conductivité mesure la capacité de l'eau
à conduire le courant entre deux électrodes. La plupart des
matières dissoutes dans l'eau se trouvent sous forme d'ions
chargés électriquement. La mesure de la conductivité
permet donc d'apprécier la quantité de sels dissous dans
l'eau.
c. La turbidité
La turbidité représente l'opacité d'un
milieu trouble. C'est la réduction de la transparence d'un liquide due
à la présence de matière non dissoutes. Elle est
causée, dans les eaux, par la présence des matières en
suspension (MES) fines, comme les argiles, les grains de silice et les
micro-organismes. Une faible part de la turbidité peut être due
également à la présence des matières
colloïdales d'origine organique ou minérale.
d. Les matières en suspension (MES)
Les MES représentent les matières qui ne sont ni
à l'état dissous ni à l'état colloïdales, donc
filtrable. Elles sont organiques ou minérales et permettent une bonne
évaluation du degré de pollution d'une eau.
e. Les matières décantables
Des nombreuses particules peuvent constituer des
impuretés d'une eau. Les techniques analytiques nécessaires
à leurs déterminations dépendent des dimensions de ces
particules. Les impuretés présentes dans l'eau ont pour origine
soit des substances minérales, végétales ou animales.
Les matières décantables sont les
matières des grandes tailles, entre 40 micromètres et 5
millimètres et qui se déposent sans traitement physique et
chimique.
I.4.2. Les caractéristiques
chimiques
a. Le pH
Le pH est un paramètre qui permet de mesurer
l'acidité, l'alcalinité ou la basicité d'une
eau.
b. L'Oxygène dissous
La concentration en oxygène dissous est un
paramètre essentiel dans le maintien de la vie, et donc dans les
phénomènes de dégradation de la matière organique
et de la photosynthèse.
Une eau très aérée est
généralement sursaturée en oxygène (torrent), alors
qu'une eau chargée en matières organiques dégradables par
des micro-organismes est sous-saturée. En effet, la forte
présence de matière organique, dans un plan d'eau par exemple,
permet aux microorganismes de se développer tout en consommant de
l'oxygène.
c. La Demande biologique en oxygène
(DBO5)
Exprime la quantité d'oxygène nécessaire
à la destruction ou à la dégradation des matières
organiques présentent dans les eaux usées par les microorganismes
du milieu. Mesurée par la consommation d'oxygène à
20°C à l'obscurité pendent 5 jours
d'incubation d'un échantillon préalablement ensemencé,
temps qui assure l'oxydation biologique des matières organiques
carbonées.
d. La Demande chimique en oxygène
(DCO)
C'est la mesure de la quantité d'oxygène
nécessaire qui correspond à la quantité desmatières
oxydables par oxygène renfermé dans un effluent. Elles
représentent la plupart descomposés organiques
(détergents, matières fécales).
e. Le Carbone organique total (COT)
Le carbone organique est constitué d'une grande
diversité de composés organiques à plusieurs états
d'oxydation, dont certains sont susceptibles d'être oxydés par des
procédés chimiques ou biologiques. Ces fractions sont
caractérisées par la demande chimique en oxygène (DCO) et
la demande biologique en oxygène (DBO).
Certaines matières organiques échappent à
ces mesures ; dans ce cas, le dosage du COT est mieux adapté. Il est
indépendant de l'état d'oxydation de la matière organique
et ne mesure pas les éléments inorganiques tels que l'azote et
l'hydrogène qui peuvent être pris en compte par la DCO et la
DBO.
La détermination porte sur les composés
organiques fixés ou volatils, naturels ou synthétiques,
présents dans les eaux résiduaires (celluloses, sucres, huiles,
etc.). Suivant que l'eau a été préalablement
filtrée ou non, on obtiendra le carbone dissous (DCO) ou le carbone
organique total (COT). Cette mesure permet de faciliter l'estimation de la
demande en oxygène liée aux rejets, et d'établir
éventuellement une corrélation avec la DBO et la DCO.
f. L'Azote
Dans les eaux usées domestiques, l'azote est sous forme
organique et ammoniacale, on le dose par mesure du N-NTK (Azote Totale
Kjeldahl). Azote Kjeldahl = Azote ammoniacal + Azote organique.
L'azote organique, composant majeur des protéines, est
recyclé en continu par les plantes et les animaux. L'azote ammoniacal
est présent sous deux formes en solution, l'ammoniac NH3 et l'ammonium
NH4+, dont les proportions relatives dépendent du
pH et de la température. L'ammonium est souvent dominant ; c'est
pourquoi, ce terme est employé pour désigner l'azote ammoniacal ;
en milieu oxydant, l'ammonium se transforme en nitrites puis en nitrates; ce
qui induit une consommation d'oxygène.
g. Les Nitrites
(NO2-1)
Les ions nitrites (NO2-) sont un stade
intermédiaire entre l'ammonium (NH4+) et les ions
nitratent (NO3-1). Les bactéries nitrifiantes
(nitrosomonas) transforment l'ammonium en nitrites. Cette opération, qui
nécessite une forte consommation d'oxygène, est la
nitratation.
Les nitrites proviennent de la réduction
bactérienne des nitrates, appelée dénitrification. Les
nitrites constituent un poison dangereux pour les organismes aquatiques,
même à de très faibles concentrations. La toxicité
augmente avec la température.
h. Les Nitrates (N03-1)
Les nitrates constituent le stade final de l'oxydation de
l'azote organique dans l'eau. Les bactéries nitratâtes
(nitrobacters) transforment les nitrites en nitrates. Les nitrates ne sont pas
toxiques ; mais des teneurs élevées en nitrates provoquent une
prolifération algale qui contribue à l'eutrophisation du milieu.
Leur potentiel danger reste néanmoins relatif à leur
réduction en nitrates.
I.4.3. Les caractéristiques
microbiologiques
La détermination de la flore aérobie
mésophile totale, des coliformes totaux, coliformes fécaux,
staphylocoque, streptocoque, salmonelles et les shigelles, ainsi que certains
pathogènes peuvent donner une indication sur les risques liés
à l'utilisation de certains types d'eaux.
I.5. LES SOURCES DE POLLUTIONS DES EAUX
USEES
Ce tableau si dessous reprend d'une manière
détaillée les substances, les origines et les effets de
pollutions des eaux usées :
Tableau (I-02) : les sources de
pollutions des eaux usées
|
Substances
|
Origines
|
Effets
|
|
Hydrocarbures
Essences, huiles,
Fioul.
|
Transports routiers,
industries, accidents
pétroliers, fuites lors des
déchargements des
pétroliers, lessivage par
la pluie des zones
urbaines (parking, route).
|
Altération des mécanismes
physiologiques de tous les
organismes vivants.
|
|
Métaux lourds
|
Transports routiers,
industries métallurgiques
et pétrochimiques,
peinture et carénage des
bateaux.
|
Affectent surtout les animaux
Ralentissement de la croissance
Altération des organes
Classement par ordre de nocivité
croissante :
Hg>Ag>Cu>Cd>Zn>Pb>Cr>Ni>Co.
|
|
Pesticides et
Insecticides
|
Utilisation domestique,
Agriculture.
|
Trouble du métabolisme et du
système neurologique
Altération des processus
Enzymatiques.
|
|
Composés azotés
et phosphatés
|
Agriculture, aquaculture,
industries
agroalimentaires, eaux
usées domestiques.
|
Phénomène d'anoxie et
d'eutrophisation
|
|
Détergents
|
Eaux usées domestiques,
Industries.
|
Affectent les plantes et les algues
Effet amplifié si combinaison avec
des hydrocarbures.
|
|
Matières en
suspension MES
|
Eaux usées domestiques,
lessivages des sols,
industries.
|
Donnent à l'eau une apparence trouble, un mauvais
goût et une mauvaise odeur.
|
Il est important de noter que les cours d'eau ont une
capacité naturelle et son environnement peut être durable. Les
zones privées d'oxygène par la pollution entraînent la mort
de la faune et de la flore ou créent des barrières
infranchissables empêchant notamment la migration des poissons
grâce aux substances, et les effets de la pollution des eaux naturelles.
La présence excessive de phosphates, en particulier, favorise le
phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire la
prolifération d'algues qui nuisent à la faune aquatique, peuvent
rendre la baignade dangereuse et perturbent la production d'eau potable.
Trois principaux paramètres mesurent les
matières polluantes des eaux usées :
ü Les matières en suspension (MES)
exprimées en mg par litre. Ce sont les matières non dissoutes de
diamètre supérieur à 1mm contenues dans l'eau. Elles
comportent à la fois des éléments minéraux et
organiques et décantent spontanément.
ü La demande biochimique en oxygène (DBO),
exprimée en mg d'oxygène par litre. Elle exprime la
quantité de matières organiques biodégradables
présentes dans l'eau. Plus précisément, ce
paramètre mesure la quantité d'oxygène nécessaire
à la destruction des matières organiques grâce aux
phénomènes d'oxydation par voie aérobie. Pour mesurer ce
paramètre, on prend comme référence la quantité
d'oxygène consommé au bout de cinq jours. C'est la DBO5, demande
biochimique en oxygène sur cinq jours.
ü La demande chimique en oxygène (DCO),
exprimée en mg d'oxygène par litre. Elle représente la
teneur totale de l'eau en matières oxydables. Ce paramètre
correspond à la quantité d'oxygène qu'il faut fournir pour
oxyder par voie chimique ces matières.
Les teneurs en azote et en phosphore sont également des
paramètres très importants, à cause des problèmes
d'eutrophisation expliqués plus haut. Cette fragilité du milieu
naturel a été prise en compte par la réglementation avec
la notion de "zones sensibles".
Les eaux usées contiennent aussi des contaminants
microbiologiques, bactéries, virus pathogènes et parasites, le
rejet des eaux usées à proximité de lieux de baignade ou
de zone d'élevage de coquillages fait courir un risque pour la
santé. Il doit faire l'objet de précautions
particulières.
Pour quantifier globalement les matières polluantes
contenues dans les eaux usées domestiques (et assimilées), on
utilise comme unité de mesure "l'équivalent-habitant" : EH.
La notion d'équivalent habitant est utilisée pour quantifier la
pollution émise par une agglomération à partir de la
population qui y réside et des autres activités non
domestiques.
I.6. LA POLLUTION DE L'EAU
I.6.1. Définition de la pollution
Le problème de la pollution se pose avec urgence
aujourd'hui, non plus que le phénomène de pollution soit nouveau
mais à cause du déséquilibre qui s'accuse entre leur
émission et leur résorption. L'existence humaine, comme toute
existence animale, est naturellement polluante : il nous faut manger
fréquemment et respirer continuellement et ce que nous rejetons est
polluant. Autant que nous avons pris à l'environnement ce qui nous est
nécessaire, autant ce que nous lui rendons sera nocif.
On appelle pollution, toute intervention de l'homme dans les
équilibres naturels par la mise en circulation de substances toxiques,
nuisibles, ou encombrantes, qui trouble ou empêche l'évolution
naturelle du milieu.
En d'autre terme, c'est une modification défavorable du
milieu naturel pouvant affecter l'homme directement ou à travers des
ressources agricoles, l'eau et les autres matières biologiques en
altérant les objets physiques qu'il possède.
I.6.2. Origine de la pollution de l'eau
La pollution de l'eau a plusieurs origines
1) Suivant la nature des agents polluants, on distingue :
a. La pollution biologique
Elle résulte de l'introduction dans un milieu (eau,
air, aliment) d'organismes vivants altéragènes (bactéries
ou virus) généralement microscopiques ou de la présence de
ces organismes dans ce milieu au-delà d'une certaine concentration. Il
faut savoir que les aliments constituent un milieu favorable à la
croissance microbienne.
Bref elle concerne toutes les bactéries ou les virus
contenus dans les déjections humaines ou animales. Rejetées par
les villes ou l'élevage, ces déjections s'infiltrent dans les
sols et finissent par rejoindre les nappes souterraines qui alimentent la mer
et les eaux douces. Elles contribuent ainsi à la pollution des eaux de
la planète.
b. La pollution chimique
On retrouve dans la mer et dans les sols des substances
chimiques dangereuses pour l'environnement. Elles peuvent êtres issues
des rejets des stations d'épuration, de l'agriculture (dans les
pesticides qui sont utilisés), de l'industrie, des transports ...les
excès de sels nutritifs, pesticides, métaux et autres substances
toxiques sont déversés chaque jour et menacent la chaîne
alimentaire.
En effet, les substances chimiques s'accumulent dans tous les
organismes. Elles contaminent d'abord les espèces
végétales, qui sont directement reliées à la terre
et se nourrissent de ce qu'elle contient, puis les organismes qui se
nourrissent d'elles etc ...
Le phénomène remonte ainsi toute la chaîne
alimentaire et finit par toucher les plus grands mammifères et l'homme.
C'est ainsi que des nombreuses espèces animales et
végétales sont fragilisées. Elles tombent malades et
parfois meurent.
Les agents polluants sont :
v Détersifs, matières plastiques,
pesticides ;
v Métaux lourds, aérosols divers ;
v Dérivés de carbone, soufre et azote.
Cette pollution se réalise lorsque les polluants
cités sont introduits dans un milieu donné au-delà d'un
certain taux.
c. La pollution physique
Il s'agit de tous les déchets physiques que l'on
retrouve sur les sols et au fond des océans. Par exemple le
pétrole, les bouteilles en plastique, le papier, le carton etc.....
d'où l'importance de bien faire le tri dans les poubelles entre les
matières non recyclables (citées ci-dessus) et les autres ! Nous
pouvons ainsi les traiter différemment des autres déchets et
faire en sorte qu'elles polluent moins l'environnement.
Lorsque s'introduit un facteur physique
altéragène (chaleur, bruit et vibration a basse fréquence,
rayonnement,...) dans un milieu et il y est au-delà d'un certain
niveau.
2) Suivant le milieu ou la matière par laquelle les
pollutions contaminent l'organisme (audition, inhalation ou voie
cutanée) la classification écologique considère le milieu
dans lequel les polluants sont émis et où ils exercent leurs
méfaits. On distingue ainsi :
a. La pollution de sols
Le sol constitue en bien des cas l'intermédiaire entre
l'atmosphère et l'hydrosphère pour une fraction de la
quantité totale de chaque polluant que l'homme rejette dans l'air. Les
polluants ainsi accumulés restent en place des années, ce qui ne
fait que transporter une partie de la pollution du sol à
l'atmosphère.
b. La pollution de l'air
La pollution de l'air a des effets variés sur la
santé et sur l'environnement, c'est un phénomène local,
continental et mondial. Mais aujourd'hui, la plupart de gens sont
exposés à la pollution des automobilistes et des transports
routiers. Les effets de la pollution sur la santé augmentent en fonction
des concentrations, des substances polluantes dans l'air et d'exploitation.
Les principales sources sont :
v La combustion par les foyers fixes ;
v Les transports terrestres, maritimes et
aériens ;
v Les procédés industriels :
sidérurgie, pétrole, métaux non ferreux ;
v L'incinération et le traitement des déchets de
différente nature.
La pollution atmosphérique se vit surtout en milieu
urbain où il y a la concentration des industries, des foyers
domestiques, mais aussi la circulation des véhicules à moteurs
à combustion interne. Les polluants rejetés se
répartissent en deux groupes :
v Les poussières ;
v Les gaz et les vapeurs toxiques.
Notons que les vents dispersent aussi les agents polluants en
altitude et assurent ainsi leur circulation atmosphérique. Pour
résoudre ces problèmes, nous devons éviter l'abondance
dévastatrice. Pour ce faire, il faut comprendre, organiser,
contrôler et prévoir ce milieu.
Les divers aspects de la pollution sont liés les uns
aux autres, aussi scientifique que politique. Du point de vue scientifique, la
capacité de prédation des bouleversements écologiques
exige que l'on comprenne les processus physiques, chimiques, biologiques et
sociaux qui gouvernent la terre et les interactions entre ces différents
processus au sein du système terrestre.
Du point de vue politique, les réponses aux
problèmes de pollution mettent en lumière la
nécessité de développer des politiques internationales
coordonnées en matière d'énergie, de technologie,
d'utilisation de terre et de développement économiques. Il nous
faut en définitive pour l'avenir une technologie puissante et consciente
afin de réconcilier écologie et économie et s'assurer un
développement durable de la biosphère où le terme
déchet sera banni.
c. La pollution de l'eau
La pollution des eaux représente les aspects les plus
inquiétants de la dégradation du milieu naturel par la
civilisation contemporaine. Jusqu'à un passé récent, les
eaux marines étaient considérées comme la solution
poubelle pour tous les déchets industriels et domestiques. La pollution
des eaux est une réalité et même une menace pour la vie
humaine. Les effets dépendent de la solubilité du polluant dans
l'eau.
Les déchets solubles comme les nitrates, les phosphates
favorisent la prolifération des algues dans les rivières, ce qui
peut entrainer la disparition des certaines espèces de poissons.
L'eau est dite polluée lorsque l'état d'un cours
d'eau est, directement ou indirectement, modifié par les
activités de l'homme. Il est ainsi plus difficile de l'utiliser voire
dangereux. Et oui, des eaux polluées peuvent grandement affecter notre
environnement et la vie des nombreuses espèces animales et
végétales.
Eaux pluviales
Activités agricoles
Activités industrielles
Usage domestique
Pollution de l'eau due :
A la nature des récepteurs
A l'intensité des rejets
A la durée des émissions
A la nature des matières polluantes
Figure (I-4):La nature de la pollution de
l'eau
Que pouvons-nous faire pour lutter contre la nature de la
pollution de l'eau ?
Les activités humaines sont responsables de la
détérioration des milieux aquatiques. Nous avons non seulement
détérioré la qualité de l'eau avec l'industrie,
l'agriculture, le transport, notre vie au quotidien, mais nous avons aussi
contaminé les autres organismes vivants qui maintenant polluent à
leur tour.
Quand nous avons compris cela, nous pouvons aussi comprendre
que nous sommes les seuls capables de faire quelque chose pour arrêter ce
processus. Parce-que, d'ici quelques années les fonds marins seront
définitivement détruits et de nombreuses espèces de
poissons et mammifères auront peut-être disparus. Si à
notre niveau nous préservons l'eau et la vie qu'elle renferme, en voici
quelques gestes simples que nous pouvons faire au quotidien et peut-être
qu'en nous y mettant tous nous pourrons corriger nos erreurs du passé
!
· Ne gaspiller pas l'eau :
fermer le robinet pendant que nous brossons les dents.
· Respecter les règlementations en
matière de pêche: les espèces protégées, les
tailles minimales, les périodes autorisées. Ne pêcher pas
plus que votre consommation.
· Ne jeter pas de produits dangereux dans l'eau :
l'huile de vidange, les solvants... réduire notre utilisation de
produits nocifs : lessives, détergents.
Collectées par le réseau d'assainissement, les
eaux usées contiennent de nombreux éléments polluants,
provenant de la population, des activités commerciales, industrielles et
agricoles et des phénomènes naturels.
Les eaux usées se caractérisent par des
paramètres physico-chimiques et bactériologiques, qui permettent
de déterminer leur éventuelle origine et de connaitre
l'importance de leur charge polluante. Avant qu'elles ne soient rejetées
dans le milieu naturel et ne le dégradent, elles doivent
impérativement obéir à des normes établies pour
protéger les milieux récepteurs contre la pollution. Pour cela,
elles sont acheminées vers une station d'épuration où
elles subissent plusieurs phases de traitements.
Les eaux usées de différentes compositions et de
diverses origines constituent un problème pour la nature lors du rejet
sans subir de traitements au préalable. Afin de montrer
l'intérêt de leur traitement, nous avons présenté
dans ce chapitre d'une part, les origines, la composition et
caractéristiques des eaux usées, et d'autre part, les
différentes méthodes et sources de la pollution des eaux
usées.
CHAPITRE II :
GENERALITE SUR LA COMPAGNIE SUCRIERE DE
KWILU-NGONGO

Figure (II-1):logo de
la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo.
II.0. INTRODUCTION
Dans le présent chapitre, nous allons faire l'analyse
et l'étude du système existant. Pour y arriver nous avons fait la
présentation générale de la compagnie sucrière de
Kwilu-Ngongo, ensuite l'étude analytique du circuit hydraulique
existant.
II.1. BREF HISTORIQUE
C'est le 08 avril 1925 que fut fondée la compagnie
sucrière de Kwilu-Ngongo, appelée à l'époque
compagnie sucrière congolaise par le compte LIPPENS, financée par
un puissant organisme privé Belge (SOGESUCRE).
Le site de Kwilu-Ngongo était choisi pour installer
cette société à caractère agro-industriel et
commercial. Mais, il a fallu défricher et planter, terrasser et
construire. Le travail était énorme avec un objectif ambitieux.
Après s'être livré pendant trois ans à un
véritable travail de pionnier pour implanter la culture de la canne
à sucre et l'industrie sucrière, ce fut en 1928 que vient enfin
la première récolte et l'usine ne produisit que 800 tonnes de
sucre pour une période de productions d'une durée de six mois.
En 1970, la production s'est élevée à
40.000 tonnes de sucre. Après 1973, la compagnie sucrière fut
nationalisée pour devenir O.N.D.S (office national du sucre) ; puis en
1977, elle fut rétrocédée à ses anciens
propriétaires (SOGE SUCRE) qui devraient réserver à
l'état congolais une participation de 40% dans le capital et
désormais l'unité s'appelle compagnie sucrière de
Kwilu-Ngongo. Grace à des investissements importants
réalisés à la demande des gouvernements congolais, la
plantation de 10.200 ha a connu une extension de 30.800 ha. La capacité
de l'usine évolue d'une façon croissante à tel point que
vers les années 1984 la quantité du sucre sortie de Kwilu-Ngongo
atteignait 50.000 tonnes. Actuellement la compagnie évolue du jour au
jour.
Pendant l'an 2006, la compagnie avait atteint une production
record de 85246,5 tonnes de sucre. En 2007, la compagnie avait aussi atteint
une production record de 86028 tonnes de sucre. Et pour l'année 2018,
l'objectif était d'atteindre 92000 tonnes de sucre net. Mais
après le travail effectué pendant 137 jours et nuits la
production réalisée a été 90280 tonnes de sucre ce
qui constitue un grand record par rapport à toutes les productions
déjà réalisées par l'entreprise.
II.2. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE
 Figure (II-2):Carte géographique de la
concession de la compagnie sucrière. Figure (II-2):Carte géographique de la
concession de la compagnie sucrière.
La compagnie sucrière est une société a
caractère agro-industriel et commercial, dont l'actionneur principal
était « SOGESUCRE » à Bruxelles, communément
appelée aujourd'hui « GROUPE SUCRIER, SA ».
Elle a sa direction générale et son siège
d'exploitation en Belgique, un centre de production qui se situe à 17 Km
de la route nationale n°1 dans le secteur de KWILU NGONGO, district des
cataractes, province du kongo central en République Démocratique
du Congo.

Figure (II-3) : Image
géographique de la concession de la compagnie sucrière.
La concession de la compagnie sucrière est
située dans la province du Kongo Central, dans le district des
cataractes, secteur de Kwilu-Ngongo et Gombe-sud ; territoire de
Mbanza-Ngungu et de secteur Kimpese situé dans le territoire de
Songololo. En considérant la voie ferrée, Kwilu-Ngongo est
situé à 175 km de Matadi et à 190 km de Kinshasa.
Les coordonnées géographiques sont 25° 30'
de latitude sud et 14°30' de longitude Est, à une altitude
approximative de 401 m par rapport à la mer. La température
moyenne annuelle est de 21,60 à 28°c. La zone connait une mi-
session sèche de janvier et février tandis que la saison
sèche franche s'étend de mi-mai à septembre.
II.3. L'IMPACT SOCIO - ECONOMIQUE
A part la production du sucre qui est l'activité
principale de la société, la Sucrière entreprend d'autres
actions à impact visible pour le social des populations des
régions voisines ;
v Les soins de santé sont dispensés aux
travailleurs, à leurs enfants, aux parents du travailleur ainsi
qu'à leurs épouses ;
v La Compagnie Sucrière possède un lycée
renommé dans la province du Kongo Central avec les sections primaire et
secondaire et un corps enseignant qualifié dont la prise en charge est
assurée totalement par la sucrière ;
v La présence d'un Guest-House et autres cercles
d'agréments dans les camps des travailleurs comme lieux de loisir et de
détente offrent un bon cadre de divertissement pour les travailleurs
ainsi que leurs familles ;
v Un relais de télévision diffuse à
travers la concession les programmes accessibles gratuitement
(télédistribution gratuite).
II.4. ACTIVITE DE LA COMPAGNIE SUCRIERE DE
KWILU-NGONGO
La compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo étant une
compagnie à caractère agro-industriel, elle a pour objectif
principal de produire et commercialiser du sucre. Mais elle a pu
développer d'autres industries telles que la distillerie pour la
production de l'alcool à partir de la mélasse qui est un
sous-produit du sucre, une unité pour la production de l'oxygène,
de l'acétylène et de la chaux éteinte. Et actuellement une
unité de fabrication des produits spiritueux est aussi
opérationnelle et enfin une unité Kwilu-brique pour la production
des pavés.
La compagnie sucrière est une société par
action à responsabilité limitée en sigle « SARL
». Elle est aussi une société paraétatique dont
l'Etat Congolais est partenaire pour 40% et 60% pour le Groupe sucrier
belge.
En tant que société à caractère
agro-industriel, la compagnie sucrière entreprend trois principales
activités pour la production de son sucre notamment :
Ø L'activité culturale ;
Ø L'activité industrielle ;
Ø L'activité commerciale.
II.4.1. L'activité culturale
C'est l'activité principale de l'entreprise dans la
mesure où la culture de la canne à sucre constitue la
matière première pour la production du sucre. C'est la direction
agronomique qui s'occupe de la culture et de l `entretien. Celle-ci comprend le
service d'exploitation agricole, la mécanisation agricole et une
division de recherche agronomique qui travaille en collaboration avec la
mécanisation agro-industrielle.
La compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo fonctionne
pendant deux périodes de fabrication à savoir :
§ L'inter campagne ;
§ La campagne.
v L'INTER CAMPAGNE
C'est la période pendant laquelle l'Usine est au repos
pour des raisons d'entretien général, signalant que celle-ci
coïncide avec la saison des pluies. C'est aussi la période dont le
regard des Autorités est fixé vers la Direction Agronomique pour
l'entretien de la Canne qui est dans le champ.
v LA CAMPAGNE
C'est la période pendant laquelle l'Usine est en
fonctionnement pour la fabrication du Sucre, elle coïncide avec la saison
sèche.
II.4.2. l'activité
industrielle
La direction de l'usine comprend trois départements
dont celui d'entretien électrique, celui de la mécanisation et
enfin celui de la fabrication du sucre. Cette direction travaille en
collaboration avec la direction agronomique.
II.4.3. l'activité commerciale
Vues les activités de l'entreprise, la compagnie
sucrière s'efforce de satisfaire tant soit peu les besoins des
Consommateurs locaux qu'étrangers en poursuivant ses objectifs qui sont
d'ordre financier, social et économique.
a. Objectif financier
La raison d'être de toute entreprise est non seulement
la satisfaction des besoins des consommateurs, mais aussi la réalisation
du profit qui est une nécessité pour sa survie. Pour permettre de
financer l'outil de production et de satisfaire les besoins de la main
d'oeuvre, il faudrait que les produits puissent couvrir l'ensemble des charges
de l'entreprise.
b. Objectif social
Il faut noter que l'homme est l'acteur principal dans
l'entreprise, c'est-à-dire il est au centre des activités de
l'entreprise, c'est pour cette raison que l'entreprise cherche à motiver
ses travailleurs et à améliorer leurs conditions de vie pour
augmenter la productivité de chaque individu. Ceci est aussi rendu
possible par une production efficiente pour atteindre un niveau optimal de
profit.
c. Objectif économique
Pour sauvegarder la viabilité de l'entreprise, elle
doit produire les biens et services pouvant satisfaire les consommateurs. La
sucrière produit et commercialise le sucre et ses sous-produits,
participe au développement du pays dans plusieurs domaine :
§ Industrialisation ;
§ Marché d'emploi ;
§ Recettes fiscales.
Notons que la production et la commercialisation du sucre
s'inscrivent dans le cadre de son activité principale.
II.5. LA STRUCTURE DE LA SUCRIERE DE
KWILU-NGONGO
a. L'organigramme de la compagnie sucrière de
Kwilu-Ngongo

b. L'organigramme technique de l'usine
Direction usine
Département
Mécanique
Département
Électrique
Département
Fabrication
Département
Division fabrication
Division mécanique
Division électrique
Entretien électrique usine
Régulation
Atelier électrique et froid
Industries connexes
Traitement
Des eaux
Secteur 4
Secteur 5
Secteur 3
Secteur 2
Secteur 1
Laboratoire
Usine
c. Effectif des travailleurs de la compagnie
sucrière
La compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo est une grande
société. Elle regorge 2000 travailleurs engagés
permanents, hormis les saisonniers dont l'effectif était de 1500 en
2016-2017. Bref, le nombre de travailleurs varie d'une année à
une autre, car il y a de licenciement, de mort et de retraite et les
engagements.
II.6. NOTION DU BUDGET DE LA COMPAGNIE
SUCRIERE
L'objectif ultime de toute entreprise étant de
maximiser le profit, la compagnie sucrière est obligée de mettre
en place tous les moyens pouvant lui permettre d'en arriver c'est-à-dire
prévoir les dépenses et recettes possible, puis les comparer aux
réalisations effectives pour enfin dégager le solde. Ceci est
donc facilité par le budget.
v TYPES
Du point de vue fonctionnement, la compagnie sucrière
répartit ses activités en deux périodes. C'est ainsi que
nous avons deux types de budget à savoir :
-Le budget campagnequi concerne la
période allant du 1er juillet au 30 Novembre d'une année à
la cour delaquelle est produit du sucre ;
-Le budget inter campagnequi couvre
la période allant du 1er Décembre de l'année N au 30 juin
de l'annéeN+1 durant laquelle on procède à l'entretien des
plantations de canne à sucre et des machines, l'usine étant
àl'arrêt.
II.7. PRODUCTION JOURNALIERE
Actuellement avec la modernisation de la technologie
industrielle, les moulins de la Compagnie ont une capacité de broyer 4
500 à 5 000 tonnes de Cannes à Sucre par jour, soit une
production d'environ 25 tonnes du Sucre par heure, donc la Sucrière peut
produire 600 tonnes du Sucre au maximum par jour s'il n'y a pas eu interruption
qui peut être causée par une panne.
a. Présentation de la chaine de production
De deux plantes utilisées dans la production du sucre
à savoir, la betterave et la canne à sucre, la sucrière de
Kwilu-Ngongo extrait le sucre de la canne à sucre.
Avant d'être mis en sachet pour être
commercialiser, les cannes mures venant des champs sont acheminées
à l'usine soit par voie ferroviaire soit par route pour passer
successivement par les opérations suivantes :
v Réception : Une fois à
l'usine les cannes passent par des balances à bascule où elles
sont pesées en vue d'une meilleure évaluation de la
quantité réceptionnée.
On y distingue, la bascule pour la voie ferroviaire (bascule
rail) et pour la voie routière (bascule route)
v Déchargement : Le
déchargement des cannes se fait ensuite sur deux tables à canne
à l'aide des ponts roulants. La sucrière en a essentiellement
quatre, deux alimentant le moulin 2000 Tonnes et les deux autres celui de 3000
T. Ces ponts roulants soulèvent jusqu'à 7 Tonnes de cannes.
v Préparation des cannes : cette
étape est cruciale du moment où une mauvaise préparation
risque d'influencer négativement l'extraction du jus, d'où
mauvais rendement. Cette préparation se fait à l'aide des coupes
cannes et du Shredder. Ces coupes cannes.
v Extraction du jus : Pour extraire le jus on
fait passer les cannes émiettées successivement dans une
série de cinq moulins (ce qui constitue une batterie) où elles
sont broyées. A la sortie du moulin on obtient deux produits, la bagasse
(combustible de la chaudière) et le vesou (jus sale). Il y a deux
batteries ayant respectivement une capacité de broyage de 2000 et 3000
Tonnes par jour.
v Epuration du jus : le vesou est d'abord
pesé et ensuite épuré par défécation. On
commence par un chaulage suivi d'une floculation et enfin une
décantation. On obtient ainsi un jus clair. Les résidus sont
utilisés comme engrais dans les plantations. (Bac à jus,
Clarificateur, Réchauffeur)
v Evaporation : le jus après
épuration contient environs 60% d'eau. Cette eau est donc
évaporée dans des évaporateurs pour obtenir un jus
concentré.
v Cristallisation : le sirop obtenu
après évaporation est ensuite concentré davantage par une
sorte d'évaporateur mais des plus grandes dimensions pour obtenir les
masse-cuites (cristaux de sucre).
v Centrifugation ou Turbinage : les cristaux
de sucre obtenus après cristallisation sont ensuite introduits dans des
essoreuses où ils sont séparés des éboues par la
force centrifuge.
v Séchage : les cristaux obtenus sont
ensuite séchés dans un granulateur à tambour
(rotatif).
v Tamisage : Après séchage, les
cristaux sont tamisés sur un tamis rotex afin de les séparer des
blocs de sucre ne s'étant pas cristalliser.
v Ensachage : Le sucre produit est alors mis
dans des sachets des ensacheuses robotiser ensuite mis dans des sacs afin
d'être commercialisé.
II.8. CIRCUIT HYDRAULIQUE DE LA COMPAGNIE SUCRIERE

Figure (II-4): Vue d'ensemble de l'usine de la
Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo.
Comme toute autre compagnie agro-industrielle, la compagnie
sucrière de Kwilu-Ngongo possède trois (3) pompes centrifuges au
service à l'usine qui tirent de l'eau à partir de la
rivière Kwilu vers l'usine pour diverses utilisations ; entre autre
refroidissement des machines, lavage tout entier de l'usine...... etc.
Et chaque pompe a un débit de 1800 m3/h.
D'après le calcul général de la capacité de chaque
pompe, nous aurons en bref les résultats suivant :
1800 m3/h × 3 pompes = 5400
m3/h
5400 m3/h × 24 h = 129.600
m3/j
D'où l'usine de la compagnie sucrière tire
chaque jour 129.600 m3/j.
Les eaux tirées par l'usine de la compagnie
sucrière de la rivière Kwilu ne sont pas traitées mais
elles passent par les dégrillages qui sont associés en
série représentée de la manière suivante :
- Pré - dégrillage qui a l'espacement des
barreaux de 30 - 100 mm ;
- Dégrillage moyen qui a l'espacement des barreaux de
10 - 30 mm et ;
- Dégrillage fin qui a l'espacement des barreaux
inferieur a 10 mm.
Quoique l'eau tirée dans la rivière Kwilu
par l'usine de Kwilu-Ngongo passe par plusieurs dégrillages, son
état est toujours sablé.

Figure (II-5) :Pré -
dégrilleur destiné à retenir les objets flottants avant
l'entrée de l'usine de kwilu-Ngongo.

Figure (II-6): Exemples des cris flottants
retenus par un Pré - dégrilleur à l'entrée de
l'usine de Kwilu-Ngongo.
Apres usage de l'eau tirée de la rivière Kwilu
vers l'usine, Ces eaux sont déversées dans les caniveaux et sont
acheminées aux bassins de décantation et ensuite rejetées
dans le milieu naturel sans pourtant être traitées, c'est à
dire on y injecte pas les produits de traitement des eaux usées aux
niveaux des bassins de stockage avant rejet. D'où l'eau rejetée
dans la rivière kwilu est salle.
Puisque nous allons parler des solutions à prendre cela
revient à étudier profondément la situation d'autant plus
que les véritables besoins doivent être identifiés. Sur ce,
ce chapitre a servi de cadre à l'étude existante dans laquelle la
Compagnie présente actuellement. Les différents problèmes
liés au rejet des eaux usées de l'usine dans le milieu naturel
ont été passés en revue.
Ainsi donc, à l'issue de cette étude, les
expressions des besoins ainsi que la proposition des solutions seront cependant
l'objet du chapitre suivant. Les lignes qui suivent vont servir de cadre pour
réaliser des solutions retenues.
CHAPITRE III :
CIRCUIT DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE L'USINE
DE KWILU-NGONGO
III.0. INTRODUCTION
Au présent chapitre de notre travail, nous allons mener
une étude complète d'un circuit de traitement des eaux
usées afin de faire des propositions de solutions aux failles
constatées dans l'actuel circuit de traitement des eaux usées de
l'usine de Kwilu-Ngongo.
Ø Pourquoi a-t-on choisi de traiter les eaux
usées de l'usine de Kwilu-Ngongo
Tout d'abord, il faut savoir qu'en République
Démocratique du Congo tout comme dans la cité de Kwilu-Ngongo,
nous ne pouvons pas rejeter les eaux usées dans la nature sans qu'elles
n'aient été préalablement traitées. C'est pourquoi
celles-ci doivent passer par un réseau d'assainissement afin de suivre
tout une procédure exacte de traitement dans une station
d'épuration.
La pollution des eaux usées est devenue un
impératif pour notre société moderne. En effet, le
développement des activités humaines s'accompagne
inévitablement d'une production croissante des rejets polluants. Le
traitement des eaux usées répond à des
préoccupations essentiellesde préservation de l'environnement.
Ce qui constitueà l'échelle mondiale le premier enjeu de
santé publique.
La technologie du traitement et du rejet des eaux usées
est bien avancée actuellement dans la plupart des pays
industrialisés. Les processus spécifiques auxquels on recourt
pour traiter ces eaux dépendent de plusieurs facteurs.
II serait certes souhaitable que l'usine de Kwilu-Ngongo
profite de l'expérience acquise en la matière par les pays
industrialisés, mais l'adoption aveugle de pratiques établies,
quel que soit leur apparence d'efficacité, ne convient pas. Chaque
problème de traitement des eaux usées est unique et sa
résolution doit être adaptée aux ressources locales en eau,
en hommes et en matériaux. Malheureusement aucune technologie du
traitement des eaux usées industrielles de l'usine qui soit applicable
dans la cité de Kwilu-Ngongo en voie de développement n'a encore
été mise au point. Le présent travail aura atteint son but
s'il aide à établir des procédés techniques de
traitement des eaux usées qui soient spécialement applicables
dans cette cité de Kwilu-Ngongo au Kongo Central.
III.1. LE CIRCUIT DE PRODUCTION DES EAUX USEES A LA SUCRIERE
D'après les études faites sur terrain, nous
avons remarqué que la compagniesucrière de Kwilu-Ngongo
possède plusieurs circuits de production des eaux usées qui est
la cause de la pollution du milieu naturel de la cité de Kwilu-Ngongo.
Ces eaux sont de nature différente et de contenu diffèrent, entre
autre nous citons :
§ Les eaux usées provenant des installations
sanitaires (Douche et W.C) ;
§ Les eaux usées provenant du garage ;
§ Les eaux usées de refroidissement et de lavage
des équipements ou machines ;
§ les eaux de pluie et de ruissellement, drainant avec
elles des déchets.
III.2. LES CONTENUS DES EAUX USEES DE LA SUCRIERE
III.2.1. Les eaux usées des installations
sanitaires
Pour vivre, le personnel dégage par son corps plusieurs
déchets parmi lesquels on peut citer :
- les vomissures ;
- les urines ;
- les selles ;
- les divers papiers utilisés dans les lavages, les W.C
......
Les produits utilisés dans les installations sanitaires
donnent les eaux usées chargées des odeurs et des matières
fécales qui sont excrétée par l'effet d'une
évacuation naturelle.
III.2.2. Les eaux usées de garage
Les principales opérations au garage sont les suivantes
:
- le chargement, déchargement des produits ;
- les entretiens/Réparations ;
- la peinture de véhicules ;
- le nettoyage des pièces et des outils ;
- la pose et la dépose des engins bruts.
· Les produits utilisés sont :
- les lubrifiants ;
- les huiles minérales ;
- les huiles de frein ;
- les fluides de climatisation ;
- les colles,les peintures ;
- les détergents, les dégraissants ;
- les lave-glaces.
· Le contenu de l'eau :
Les produits utilisés dans le garage donnent les eaux
usées chargées des hydrocarbures, des solvants, des
dégraissants, des graisses, des huiles....
III.2.3. Les eaux usées de refroidissement et
de lavage des machines
· Les principales opérations se
présentent comme suit :
- le nettoyage des fosses ;
- le lavage des sols ;
- le refroidissement des machines ;
- le nettoyage des outils de travails souillés.
· Les produits utilisés sont :
- les liquides de refroidissements ;
- les solvants organiques de nettoyage
halogénés ;
- l'eau, le détergent, le dégraissant.
· Le contenu de l'eau
Les produits utilisés dans le refroidissement et le
lavage des machines génèrentdes eaux usées
souillées d'hydrocarbures et de détergents qui ont tendance
à former une émulsion (eau/graisse). Chargées en MEST,
DBO, DCO, pH, détergents.
III.2.4. Les eaux de pluie et de ruissellement
· Les principales opérations sont :
- l'évacuation des déchets dans
l'environnement ;
- l'évacuation des flottants dans l'environnement.
· produits utilisés :
- les eaux naturelles.
· contenu de l'eau
Les eaux de pluie et de ruissellement sont
chargées des déchets, des flottants qui polluent l'environnement.
III.3.PROPOSITION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA
SUCRIERE
Les solutions à mettre en oeuvre consistent à
prendre en mesure les caractéristiques des traitements des eaux
usées avant rejet dans le milieu naturel, car les eaux en provenance de
l'usine de la compagnie sucrière contiennent des résidus de
produits biodégradables.Les rejets des eaux usées pourront
être rejetés dans l'environnement après avoir
été traitées par les étapes nécessaire qui
sont les suivantes :
- Le prétraitement des eaux usées ;
- Le traitement primaire des eaux usées ;
- Le traitement secondaire ou biologique des eaux
usées ;
- Le traitement tertiaire des eaux usées ;
- Le traitement des odeurs des eaux usées ;
- Le traitement des boues ;
- La désinfestation.
En passant par ces étapes classiques, les eaux
usées de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo trouveront des
solutions appropriées avant rejet dans le milieu naturel.
III.4. LES ETAPES CLASSIQUESDE TRAITEMENT DES EAUX
USEES

Figure (III-1):Schéma classique de
traitement des eaux usées.
III.4.1. LE PRETRAITEMENT DES EAUX USEES

Figure (III-2):étapes de
prétraitement des eaux.
Le prétraitement constitue une partie importante du
procédé de traitement des eaux usées puisqu'il permet aux
principales étapes de traitement situées en aval de fonctionner
correctement. Le prétraitement vise l'élimination des particules
grossières en flottation et en suspension, des sables, des
excédents de graisses et d'huile.
Si l'unité de prétraitement n'est pas
correctement conçue les variations de débit peuvent causer des
problèmes de fonctionnement pour les procédés
situés en aval (côté vers lequel l'eau descend dans un
cours d'eau). Ceci est particulièrement vrai pour les plus petites
stations d'épuration.
a. le but
Le prétraitement consiste à débarrasser
(enlever) des particules grossières solides tels que les branches, les
plastiques, les serviettes hygiéniques, etc... ;
b. le procédé
Le procédé de prétraitement des eaux
usées se déroule en trois phases
· le dégrillage
Il consiste à un tamisage : l'eau usée
passe à travers une grille dont les mailles sont de plus en plus
serrées.
Ces grilles sont généralement constituées
de barreaux métalliques placés dans le canal d'amenée des
eaux. Lorsque le nettoyage est manuel, la grille est inclinée de 30
à 45° sur la verticale, pour le nettoyage mécanique
l'inclinaison est de 30°. L'écartement des barreaux
détermine la quantité de matières à retenir. Ces
grilles sont à nettoyer régulièrement,soit manuel ou soit
mécanique pour éviter leur colmatage.
· le dessablage
Au dégrillage s'adjoint deux étapes
supplémentaires de finissage à savoir le dessablage et le
dégraissage (déshuilage).
Le dessablage débarrasse les eaux usées des
sables et des graviers par sédimentation. L'écoulement de l'eau
à une vitesse réduite dans le bassin appelé dessableur
entraine leur dépôt au fond de l'ouvrage.
Les matières minérales de granulométrie
inferieure à 200m doivent être maintenues en suspension par de
puissances spécifiques de brassage suffisant afin d'éviter leur
dépôt dans les ouvrages. Les sables extraits contiennent encore
une proportion élevée de matières organiques (pouvant
atteindre 50% de matières volatiles sèches) liées
à leur adsorption.
· le dégraissage ou le
déshuilage
Les sables récupérés sont essorés,
puis lavés avant d'être soit envoyés en décharge.
Ces sables, s'ils ne sont pas éliminés, peuvent
se déposer plus loin et provoquer une usure plus rapide des
éléments mécaniques comme les canalisations du
réseau d'assainissement des eaux usées.
C'est généralement le principe de flottation qui
est utilisé pour l'élimination des huiles. Son principe est
basé sur l'injection au fond du bassin de déshuilage, qui permet
de faire remonter rapidement les graisses en surface (les graisses sont
hydrophobes) ou elles sont éliminées ensuite par raclage.
Leur élimination évite l'encrassement des
ouvrages notamment les canalisations. Les graisses non retenues peuvent
engendrer un certain nombre de difficultés sur l'installation de
traitement comme :
Ø le colmatage des conduites ou de certains
supports ;
Ø les anomalies de fonctionnement de certains
organes ;
Ø les risques de moussage biologique.
La graisse contribue pour une part significative à la
demande chimique en oxygène (DCO), l'efficacité de
dégraisseur n'est pas important de l'ordre de 5 à 25% pour des
eaux résiduaires domestiques, la présence de cet ouvrage reste en
général indispensable, excepté s'il est prévu un
décanteur d'une zone de contact munie d'un dispositif de reprise des
flottants.
Il existe deux types de dégraisseurs qui
sont :
Ø le dégraisseur statique ;
Ø le dégraisseur aéré.
Nous allons noter que : le dessablage et le
déshuilage se réalisent le plus souvent dans un même
ouvrage ; les sables chutent au fond de celui-ci tandis que les graisses
remontent en surface. Le déshuilage peut aussi se faire par
coalescence.
III.4.2. LE TRAITEMENT PRIMAIRE
a. le but
Eliminer par décantation une forte proportion de
matières minérales ou organiques en suspension. Ce traitement
primaire ne permet d'obtenir qu'une épuration partielle des eaux
usées, 50 à 60 % des matières en suspension sont
éliminées. Une phase de traitement secondaire doit être
conduite.
b. le procédé
La décantation primaire classique consiste en une
séparation de l'élément solide et liquide sous l'effet de
la pesanteur.
Les matières solides se déposent au fond du
décanteur pour former les boues primaires à
récupérer par raclage. On élimine ainsi 50% de la
matière en suspension et réduit d'environ 30% le Demande
Biologique en Oxygène (DBO) et la Demande Chimique en Oxygène
(DCO).
c. la décantation lamellaire
Permet d'éliminer plus de 70% des matières en
suspension et de diminuer plus de 40% la Demande Biologique en Oxygène
(DBO) et la Demande Chimique en Oxygène (DCO).
d. la décantation
Elle est améliorée lorsqu'elle s'accompagne
d'une floculation préalable par l'adjonction qui provoque
l'agglomération des fines particules. La coagulation-floculation permet
d'éliminer jusqu'à 90% des matières en suspension et 75%
de la Demande Biologique en Oxygène (DBO).
C'est un procédé de traitement physico-chimique
d'épuration de l'eau, utilisé pour le traitement de
potabilisation ou le traitement d'eau usée.
Les particules colloïdales sont
caractérisées par deux points essentiels : d'une part elles
ont un diamètre très faible de 1mm, d'autre part, elles ont la
particularité d'être chargées
électro-négativement, engendrant des forces de répulsion
inter colloïdales. Ces deux points confèrent aux matières
colloïdales une vitesse de sédimentation extrêmement faible
que l'on peut même considérer comme nulle dans le cadre du
traitement de l'eau.
La coagulation-floculation est un procédé
permettant en deux temps, de s'affranchir de cette absence de
sédimentation. Cette technique permet de s'attaquer aux deux
caractéristiques mentionnées rendant impossible une
élimination naturelle des particules colloïdales.
e. la coagulation
Dans un premiers temps, la coagulation, par un ajout de sels
métalliques généralement de fer ou d'aluminium, permet de
supprimer les répulsions inter colloïdales, les cations
métalliques se lient aux matières colloïdales.
f. la floculation
Dans un second temps, la floculation permet de s'attaquer au
problème de faible diamètre des colloïdes. Le
véritable souci est en fait la masse qui ne permet pas une
sédimentation naturelle et exploitable dans le cadre d'un traitement. La
solution exploitée par la floculation est de provoquer grâce
à l'ajout de floculant, une agglomération des particules
colloïdales.
Par la suite, cet agglomérat de matières
colloïdales appelé foc, dispose d'une masse suffisante pour voir se
décanter. Le floculant ajouté va jouer le rôle de colle
entre les colloïdes.
g. la filtration
Pour un circuit de traitement d'eau classique, les divers
traitements sont : le mélange rapide avec un coagulant (la
floculation) et la filtration avec une batterie de filtre. Les matériaux
de filtration rencontrés doivent êtres insolubles, non-friable, et
ne doivent reléguer aucune substance susceptible d'altérer les
qualités de l'eau. Les trois matériaux les plus employées
sont :
Ø le sable : utilisé en filtration, ce
matériau naturel à base de silice provient des rivières,
des gisements naturels, des dunes obtenu à partir des galets marins. sa
densité réelle est environ 2,5 à 2,7 ;
Ø l'anthracite : c'est un matériau à
base de carbone, obtenu par calcination de matières
végétales telle que le bois ou la tourbe. il se présente
sous la forme de grains durs et anguleux. sa densité réelle est
de l'ordre de 1,45 à 1,75 ;
Ø le charbon actif : est également un
matériau a la base de Carbonne, obtenue par calcination et
hydrogénation de bois, huile de tourbe ou de coco.
Notons que pour la filtration classique les plus courantes
sont les sables et l'anthracite. Le sable est employé en mono couche ou
associé à de l'anthracite dans les filtres bicouches.
N.B : La décantation après avoir
rassemblé les différentes petites parties en des plus grosses, il
va maintenant falloir les faire décanter tous dans un corps
immobile ; les particules en suspension plus lourdes que l'eau sont
soumises à leurs poids, elles chutent lentement pour s'accumuler sur le
fond : c'est la décantation.
Une des techniques la plus simple concerne la
décantation statique par exemple avec un décanteur
vertical : l'alimentation se fait par le haut, les particules
sédimentent et peuvent être récupérées au
fond du cône, tandis que l'eau traitée est évacuée
par le haut par débordement. La vitesse de sédimentation est
généralement faible il faut donc faire appel à la
décantation dynamique.
Les décanteurs actuellement utilisés dans
l'usine sont les décanteurs horizontaux à lamelles utile pour
depetites installations mais pour de grosses installations, on
préfèrera des décanteurs verticaux ou l'eau est
alimentée dans la partie centrale. Après cette très
importante décantation, il reste encore à éliminer les
plus petites grâces à une filtration.
III.4.3. LE TRAITEMENT SECONDAIRE OU
BIOLOGIQUE
a. but
D'éliminer les matières polluantes solubles
(carbone, azote et le phosphore). C'est un traitement biologique
élémentaire ; on élimine ainsi les sucres, les
graisses, les protéines..., ceux-ci sont nocifs pour l'environnement
puisque leur dégradation implique la consommation de l'oxygène
dissous dans l'eau a la survie des animaux aquatiques.
b. procédé
Le traitement secondaire est réalisé en trois
étapes successives
· la dégradation
C'est l'élimination des composés organiques
solubles au moyen des bactéries hétérogènes et des
micro-organismes.
· la nitrification
L'azote organique dans les eaux usées se transforme en
azote ammoniacal (NH+4). Le traitement consiste à
oxyder l'ammoniaque en nitrite pas en nitrate par des bactéries
nitrifiantes qui sont en croissance dans le CO2 de l'air.
· la dénitrification
C'est une étape facultative qui consiste à
dénitrater l'eau chargée de nitrates qui peut être
mélangée partiellement à l'eau usée
alimentée à la station. Les nitrates sont réduits en
diazote(N2) qui s'échappe dans l'atmosphère. Notons que les
nitrates sont à l'origine d'évanouissement d'algues dans
certaines eaux.
Les traitements biologiques se classent en plusieurs
catégories. D'une part on a les techniques :
Ø Anaérobie c'est- à- dire se
déroule en absence de l'oxygène ;
Ø aérobie c'est-à-dire nécessitant
un apport d'oxygène. c'est le procédé des boues
activées qui est le plus répandu. d'autre part on a :
v les procédés intensifs :
Les eaux usées sont envoyées dans une
série de bassin au minimum trois. L'oxygène est apporté
par l'atmosphère et les rayons solaires détruisent aussi certains
germes.
On peut procéder à des cultures
bactériennes qui consomment les matières polluantes. Ces sont des
procédés artificiels ayant deux variantes.
Les installations à cultures libres ou la culture
bactérienne sont maintenue en suspension dans le courant des eaux
usées à traiter. Selon le principe des cultures libres ces
matières organiques contenues dans l'eau se transforment en carbone sous
la forme de dioxyde de carbone CO2.
Les résidus ainsi formés contenant ces stocks
des bactéries sont appelés boues. Le recyclage d'une partie des
boues produites par les systèmes d'épuration permet de maintenir
la masse de bactéries contenues dans les bassins d'aération
à un niveau compatible avec les performances d'épuration. Les
traitements par boues activées éliminent 85% à 95% de la
Demande Biologique en Oxygène, selon les installations. C'est le
traitement biologique le plus simple et le plus fréquemment
utilisé.
III.4.4. LE TRAITEMENT TERTIAIRE
a. but
Le traitement primaire et secondaire ne détruit pas
complètement les germes présents dans les rejets domestiques. Des
procédés d'élimination supplémentaire sont donc
employés lorsque les eaux traitées sont rejetées en zone
de baignade, de piscine ou d'élevage de coquillages et des lacs. Le
traitement tertiaire n'est pas toujours réalisé.
Cette étape permet de réduire le nombre de
bactéries, donc de germes pathogènes dans l'eau traitée.
Ce traitement tertiaire inclut plusieurs processus suivants :
Ø les désinfections par le chlore ou l'azote
c'est pour éliminer les germes pathogènes ;
Ø la neutralisation des métaux en solution dans
l'eau faisant varier le PH de l'eau dans certaines plages, on obtient une
décantation de ces polluants ;
Ø le traitement aux ultraviolets : dans les cadres
du traitement d'eaux usées, on rencontre souvent la
coagulation-floculation comme système de traitement tertiaire dans une
station d'épuration urbaine destinée à éliminer la
pollution phosphorée.
b. procédé
L'éventail des techniques de désinfection est
assez large. Plusieurs types de réactifs sont utilisés ; les
plus usuels sont : le chlore, l'ozone, le rayonnement solaire, les
ultraviolets.
Ø un réactif désinfectant
On ajoute aux eaux traitées, avant leur rejet dans le
milieu naturel le chlore. Car c'est le désinfectant le plus courant.
Ø le lagunage naturel
Le traitement tertiaire assure l'exploitation des
microorganismes pathogènes au rayonnement solaire. Ce rayonnement
provoque une destruction de germes d'autant plus efficace que le temps de
séjour des eaux traitées est élevé (50 à 60
jours). Cependant, l'efficacité de ce traitement s'amoindrit si
l'exposition aux rayons solaires se réduit, pendant la saison
sèche ou lors de la mise en suspension des sédiments ; par
contre il faut installer en aval une station biologique classique.
Ø les ultraviolets
Les ultraviolets sont en plus utilisés, depuis quelques
années pour désinfecter les eaux usées urbaines. Un bon
rendement des ultraviolets nécessite un investissement important, mais
l'avantage est de ne pas entrainer l'apparition des sous-produits de
désinfection. Il existe une certaine variété de
système sur le marché.
Le principe traditionnel de désinfection par
rayonnement ultraviolet consiste à soumettre l'eau à traiter
à une source e rayonnement en le faisant transiter à travers un
canal contenant une série de lampes submergées. L'on trouve aussi
un système basé sur des réacteurs mono-lampes qui offrent
des avantages au niveau de la maintenance des coûts d'utilisation.
Ø la déphosphoration
L'élimination du phosphore ou déphosphoration,
peut être réalisée par deux types de traitements :
· par la voie physico-chimique
En ce qui concerne le traitement physico-chimique,
l'adjonction du réactif, comme de sels de fer ou d'aluminium permet
d'obtenir une précipitation des phosphates insolubles et leur
élimination par décantation.
Ces techniques, les plus utilisées actuellement,
éliminent entre 80 à 90% du phosphore, mais engendrent une
importante production des boues.
· par la voie biologique
Il consiste à provoquer l'accumulation du phosphore
dans les cultures bactériennes des boues. Les mécanismes de la
phosphatation biologique sont relativement complexe et leur rendement variable
en fonction notamment de la pollution carbonée des nitrates
présent dans les eaux usées.
Le rendement moyen est environ 60% dans les grosses
installations physico- chimiques, pour atteindre les niveaux de rejets
requis.
III.4.5. LE TRAITEMENT DES ODEURS
Les premières phases du traitement le
dégrillage, déshuilage et la phase anaérobie du traitement
biologique sont généralement confinées dans des
bâtiments plus ou moins étanches afin que les mauvaises odeurs ne
se répandent pas dans l'environnement de la station de traitement des
eaux usées.
Ce qui provoquerait des nuisances olfactives inacceptables
pour les riverains. Cet air nauséabond est collecté et
traité. Il passe par trois tours de lavage : une à l'acide
sulfurique, une à la javel et à la soude.
III.4.6. LE TRAITEMENT DES BOUES
Les boues de traitement des eaux usées sont les
principaux déchets produits par une station d'épuration. Ces
sédiments résiduaires sont surtout constitués des
bactéries mortes et des matières organiques
minéralisées. On distingue différents types de boues selon
les traitements appliqués pour les eaux usées.
Ø les boues primaires : ce sont les
dépôts récupérés par une simple
décantation de matières minérales (sable, terre, ...)
mais aussi des matières organiques ;
Ø les boues physico-chimiques : ressemble aux
boues primaires sauf que durant le traitement de l'eau usée, il a
été rajouté un réactif (sels de fer, d'aluminium et
les autres agents floculant) ;
Ø les boues biologiques appelées boues
secondaires sont très organiques car elles sont principalement
constituées de corps bactériens et de leurs secrétions.
On distingue aussi :
§ Les boues mixtes constituées d'un mélange
de boues primaires et biologiques, elles proviennent de la plupart des stations
de traitement complet ;
§ Les boues d'aération obtenues sans
décantation primaire avec des matières. Les boues sont
concentrées, mais organiques et donc moins susceptibles de produire des
nuisances.
a. les caractéristiques d'une boue
Une boue est aussi représentée par des
données numériques qui permettent de
caractériser :
· la siccité
Les boues sont constituées d'eau et de matières
sèches. La siccité est le pourcentage massique de matière
sèche ; ainsi une boue avec une siccité de 10%
présente une humidité de 90%
ü le taux de matières volatiles ou matières
volatiles sèches (MVS). les matières sèches sont
constituées des matières minérales, des matières
volatiles sèches.
La concentration en matières volatiles sèches
est un taux par rapport aux matières sèches totales. Le suivi de
ce taux permet de connaitre la stabilité d'une boue.
· la consistance
C'est une donnée obligatoire à connaitre pour toute
manipulation des boues. La consistance est un état physique
dépendant de la siccité.
ü Boues liquides : siccité de 0 à
10% ;
ü boues pâteuses : siccité de 10 à
25% ;
ü Boues solides : siccité de 25 à 85%.
Selon les traitements des boues ; elles ont des
caractéristiques différentes. Les boues subsistent à
plusieurs traitements tels que le conditionnement qui va permettre de les
rendre stable.
b. but
Le but du traitement des boues est de stabiliser ces boues,
les rendre inertes par le moyen qui peut être physico- chimique avec la
chaux par exemple, ou biologique en laissant séjourner les boues dans
des digesteurs, gros stocker chauffé et brassé en
anaérobie.
Le traitement comprend ensuite des ouvrages de
décantation ; on parle alors d'épaississement qui va
réduire le volume des boues par tassement naturel ou mécanique,
séchage et drainage.
Lorsque les boues des eaux usées sont exemptes de
produits toxiques, on peut les recycler en agriculture moyennant un
conditionnement propre à faciliter leur manutention et leur entreposage
sur site (traitement à la chaux). Lorsqu'elles sont polluées, il
est nécessaire de les mettre en décharge.
Si la mise en décharge de boues est interdite, la seule
filière autorisée est l'élimination thermique (usine
d'incinération des ordures ménagères, cimenteries).
c. lesdébouchés des boues
Les boues sont le plus souvent mises en décharge ou
valorisées en agriculture par épandage ou compostage. Elles
peuvent aussi avant l'épandage être digérées par des
bactéries anaérobies pour produire du biogaz qui lui-même
valorisé en électricité, chaleur etc.... elles peuvent
aussi être incinérées, seules ou avec des ordures
ménagères.
III.4.7. LES PRODUITS DE TRAITEMENT DES EAUX
(DESINFECTION)
La désinfection des eaux est la dernière
étape de traitement des eaux, elle élimine tous les
micro-organismes qui pourraient être dangereux pour notre santé.
Avant la consommation ou avant rejet des eaux usées dans le milieu
naturel les produits suivant doivent être appliquée pour
désinfecter l'eau des éléments résistants dans les
étapes de traitement précédent :
v Ozonation : L'eau est
désinfectée grâce à l'ozone, qui a une action
bactéricide et antivirus. Ce gaz, mélangé à l'eau,
agit aussi sur les matières organiques en les cassant en morceaux. Il
améliore également la couleur et la saveur de l'eau ;
v Chloration : Du chlore est
ajouté à la sortie de l'usine de production et sur
différents points du réseau de distribution afin d'éviter
le développement de bactéries et de maintenir la qualité
de l'eau tout au long de son parcours dans les canalisations et dans le milieu
naturel.
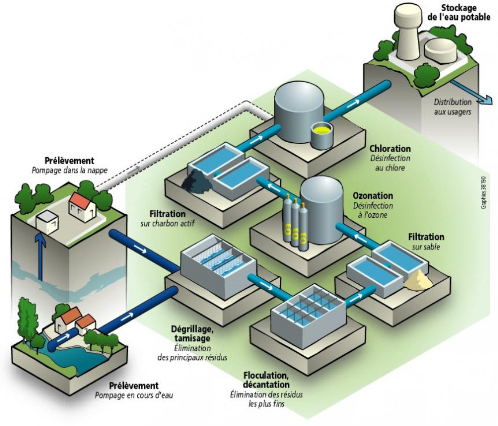
Figure (III-3):schéma
représentatif des produits de traitement des eaux.
III.5. LES RESULTATS OBTENUS
Apres usage de l'eau tirée de la rivière
Kwilu vers l'usine. Ces eaux seront déversées dans les caniveaux
et ensuite acheminées aux bassins de décantation et
rejetées dans le milieu naturel après avoir suivis les
traitements nécessaire, c'est à dire on injecte dans la
rivière Kwilu le rejet qui ne sont pas de nature à polluer l'eau.
D'où l'eau rejetée dans la rivière Kwilu répond
à des normes sur l'impact de la santé humaine. Ce
procédé constitue donc une solution viable pour augmenter les
ressources en eau de bonne qualité.
Apres extraction ou séparation des composants dans les
eaux usées les matières entrantes sont décomposées
en composants comme l'ammoniac, le dioxyde de carbone ou les minéraux
propres. On procède ensuite à une synthèse microbienne
très intensive et efficace dans laquelle l'azote présent est
collecté en tant que protéine d'origine microbienne (à des
rendements de l'ordre de 100 %) qui peut ensuite être utilisée
à des fins de production alimentaire ou d'aliments pour les animaux.
Après le traitement approprié de l'eau
usée nous allons réutiliser de l'eau usée et de
récupérer des ressources. La réutilisation de l'eau est
intéressante et viable sur le plan économique dès lors
qu'il existe une possibilité d'amortir les coûts en traitant les
eaux usées de façon à atteindre un niveau de
qualité acceptable pour l'usager. L'eau de récupération
(après un traitement « adapté à l'usage prévu
») offre des perspectives en faveur d'un approvisionnement en eau fiable
et durable des villes, alors qu'un nombre croissant d'entre elles sont
contraintes de chercher de nouvelles sources d'approvisionnement, ou des
sources plus éloignées, afin de satisfaire une demande
grandissante.
Après utilisation nous avons la possibilité de
récupérer l'énergie dans les eaux usées. Si leur
collecte et leur traitement impliquent une importante consommation
d'énergie, les eaux usées elles-mêmes sont une source
d'énergie dont l'immense potentiel est sous-exploité. Il est
possible de récupérer l'énergie chimique, thermique et
hydraulique des eaux usées sous la forme de biogaz, de
chauffage/climatisation et de production d'électricité par le
biais de processus internes et externes. Des technologies existent pour la
récupération d'énergie sur place au moyen de
procédés de traitement des boues/bio solides
intégrés aux stations de traitement des eaux usées. La
récupération d'énergie hors site consiste en
l'incinération des boues dans des stations centralisées par le
biais de procédés de traitement thermiques. On compte notamment
parmi les technologies les plus récentes les piles à combustible
microbiennes, qui permettent de produire de la bioélectricité
à partir des boues et à l'aide des bactéries, de la
granulation aérobie des boues, de l'oxydation anaérobie de
l'ammonium et de la manipulation de la biomasse. Il existe aussi des
possibilités en matière d'énergie combinée et de
récupération des nutriments.
La récupération d'énergie offre un
potentiel commercial considérable en termes de réduction de la
consommation d'énergie, des coûts d'exploitation.
III.6. ETUDE TECHNOLOGIQUE
a.la détermination du débit de la
rivière Kwilu
v la section droite de la rivière Kwilu est :
Ø saison de pluie
12,47 m de largeur
12,47 × 9,2 = 114,72 m2
9,2 m de profondeur
Ø saison sèche
11,06 m de largeur
11,06 × 7,1 = 78,52 m2
7,1 m de profondeur
Pendant la saison de pluie le débit de la
rivière Kwilu c'est différencie de la saison sèche par une
profondeur de 2,1m et par la largeur de 1,41m. C'est la veut dire que dans
chaque saison il y'a augmentation ou soit diminution de la largeur et de la
profondeur.
v la vitesse du cours d'eau :
À l'intervalle de deux butées de longueur de 5m,
faisons flotter une bouteille plastique = temps = 1 minutes 30 secondes
V=  , e= espace en m, t= temps en s v= , e= espace en m, t= temps en s v=   0,0556 m/s 0,0556 m/s
Le débit = section × vitesse
Ø saison de pluie
114,72  0,0556=6,378m3/s 0,0556=6,378m3/s
Ø saison sèche
78,52  0,0556 = 4,365m3/s 0,0556 = 4,365m3/s
b. calcul du volume d'eau Veen une
journée (24 heures)
Ve= débit × temps
Ø saison de pluie
Ve =6,378 m3 / s × 24
h/Jour × 3600S/Heures= 551059,2m3/jour
Ø saison sèche
Ve=4,365m3 / s × 24 h/Jour
× 3600S/Heures= 377136m3/jour
III.7. LES MATERIELSUTILISES
Le tableau qui suit représente d'une manière
détaillée le matériel que nous proposons dans notre
circuit de traitement des eaux usées de l'usine de
Kwilu-Ngongo :
|
TRAITEMENT
|
MATERIEL
|
|
Prétraitement
|
Un système de dégrillage + un bassin de
dessablage muni d'un racleur de fond et de surface.
|
|
Traitement primaire
|
Un décanteur
|
|
Traitement secondaire
|
Un bassin d'aération, un dispositif de recirculation des
boues, un dispositif d'extraction et d'évacuation des boues en
excès, un dispositif de brassage et d'appart d'oxygène dans le
bassin d'aération.
|
|
Traitement tertiaire
|
Un bassin
|
|
Traitement des odeurs
|
Lavage acide sulfurique, lavage javel et lavage soude.
|
|
Traitement des boues
|
Un décanteur + racleur.
|
|
Les produits de traitement
|
L'ozonation et le chlore de plus ou moins 25L/Jour
|
NB : les couts des matériels cités ci-dessus
varient d'une année à une autre selon le fournisseur choisie,
mais il est évident que la tarification est un peu plus
élevée car il s'agit de la technique de traitement des eaux.
III.8. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA THEORIE DU
CIRCUIT DE TRAITEMENT DES EAUX USEES APPLIQUEE A LA COMPAGNIE
SUCRIERE
a. SCHEMA FONCTIONNEL
Le traitement primaire
Le traitement secondaire
Le traitement tertiaire
Leprétraitement des eaux
eusine
Consiste à réduire le nombre de bactéries,
de germes pathogènes présent dans l'eau.
Suivi de procédé suivant :
-le traitement des odeurs
-le traitement des boues
-
Consiste à éliminer les matières
polluantes solubles au moyen de :
-la dégradation
- la nitrification
- dénitrification
Consiste à éliminer une forte proportion de
matières minérales ou organiques en suspension au moyen
de :
- la décantation
- la filtration
- la floculation
- la coagulation
Les eaux usées sont acheminées jusqu'à la
station d'épuration par des réseaux d'assainissement.
Consiste à débarrasser des particules solides par
les procédés :
- le dégrillage
- le dessablage
-le dégraissage ou le déshuilage
b. EXPLICATION DU FONCTIONNEMENT
Généralement un circuit de traitement des eaux
usées comporte plusieurs procédés qui permettent de
réduire efficacement les matières polluantes avant rejet dans le
milieu naturel.
Le traitement se réalise par élimination des
éléments les plus grossiers (objets encombrants) jusqu'aux
éléments microscopiques (matières dissoutes). Les
techniques mises en oeuvre sont variables et retenues en fonction d'une
série de paramètres tels que :
- la nature des eaux usées ;
- la qualité du traitement souhaitée ;
- la nature du milieu ;
- le cout du traitement.
Bien que les techniques mises en oeuvre pour réaliser
le traitement des eaux usées puissent varier d'une installation à
l'autre, les différentes étapes souvent rencontrées dans
un circuit de traitement des eaux sont assez semblables et importantes.
Le fonctionnement du circuit de traitement des eaux
usées se réalise de la manière suivante :
Les eaux qui vient de l'usine ont plusieurs cause de nature
différente, après utilisation sont acheminées par un
réseau d'assainissement jusqu'à la station d'épuration ou
encore le circuit de traitement des eaux usées, elle sera
éliminées des particules grossières en flottation et en
suspension pour qu'elles arrivent dans un dégrillage dont les mailles
sont de plus en plus serrées qui est constituées de barreaux
métalliques placés dans le réseau d'assainissement, par
cette grille les eaux seront éliminées de certaines particules
au passage.
Les eaux qui sont débarrassées des particules
grossières en suspension dans les grilles précédentes
(dégrillage) seront versées dans un écoulement des eaux
à une vitesse réduite dans un bassin appelé dessableur. Le
dessablage débarrasse les eaux usées des sables et des graviers
par sédimentation malgré que les sables extraits contiennent
encore une proportion élevée des matières organiques
pouvant atteindre 50% de matières volatiles sèches liées
à leur adsorption.
Après le premier bassin les eaux usées passent
par le dégraissage ou le déshuilage, cette étape va
débarrasser des sables récupérés par le dessableur
de l'huile et de graisse. Le dessablage et le dégraissage se
réalisent le plus souvent dans un même ouvrage, les sables chutent
au fond de celui-ci tandis que les graisses remontent en sur surface et tout ce
procédé est appelé en gros le prétraitement
classique des eaux dans le premier bassin.
Dans la seconde étape l'eau est éliminée
au moyen de la décantation une forte proportion de matières
minérales ou organiques. Et cette décantation primaire classique
consiste en une séparation de l'élément solide et liquide
sous l'effet de la pesanteur.
L'eau sortant de la deuxième étape est
éliminé de matières polluantes solubles puisque leur
dégradation implique la consommation de l'oxygène dissous dans
l'eau à la survie des animaux aquatiques entre autre les poissons et
autres animaux, ce dernier va débarrasser l'eau de tout ce qui est
éléments chimiques, éléments organiques, germes
pathogènes et les mauvaises odeurs venant du sable et des boues. Apres
tous ces passages aux diverses étapes nous aurons l'eau traitée
qui sera déversée dans la rivière Kwilu en aval sans
inconvénient pour les habitants de la cité de Kwilu-Ngongo et
sans non plus la pollution de l'environnement et des animaux aquatiques qu'on
trouve actuellement.
Nous avons étudié le fonctionnement du circuit
de traitement des eaux usées pour un avant-projet de la mise en place
pour l'usine de Kwilu-Ngongo au Kongo Central un circuit de traitement des eaux
usées par différente étapes.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre étude portant sur la
proposition d'un circuit de traitement des eaux usées à l'usine
de Kwilu-Ngongo au Kongo central.
Cette étude a été menée dans la
cité de Kwilu-Ngongo, sur l'axe de l'usine de la compagnie
sucrière, plus précisément dans la province de Kongo
central; la population de cette citée évolue sur un site
difficile en matière de la consommation de l'eau qui coule
naturellement. La passivité et l'inefficacité des actions des
populations face aux dangers doivent susciter une réelle volonté
pour l'amélioration de l'environnement et la consommation de l'eau qui
coule naturellement.
Notre objectif général que nous nous sommes
fixée vise à améliorer les conditions de vie de la
population en matière de résoudre les problèmes due
à la pollution de l'eau qui coule naturellement car c'est sont ces eaux
dont les habitants utilisent dans leurs maisons pour les travaux
ménagers, le nettoyage corporel, ainsi la pollution de l'eau dans cette
citée sera moindre.
On ne peut relever le défi de résoudre les
problèmes de la pollution de l'eau qui coule naturellement dans la
rivière Kwilu sans un changement radical de la part de rejet des eaux
usées de la compagnie sucrière de Kwilu-Ngongo. Ensuite, les
problèmes ne seront résolus que si des solutions simples et
adaptées au contexte local sont trouvées.
C'est pourquoi nous avons donc dans cette étude pu
proposer le traitement des eaux usées de l'usine de Kwilu-Ngongo avant
rejet dans le milieu naturel enfin d'éviter la pollution de l'eau qui
coule naturellement dont la population a ont besoin pour leurs diverses
utilisations.
Loin de nous la pensée d'avoir parfaitement accompli ce
travail, et comme toute oeuvre humaine est l'objet de quelques
imperfections.
Nous sommes ouverts à toutes les remarques et
suggestions qui nous permettent d'améliorer la prochaine
étude.
BIBLIOGRAPHIE
1. Ouvrage :
- Rodier, J. (1966) L'analyse chimique et physico-chimique
de l'eau; eaux naturelles, eaux usées,
3eéd. Paris, 18p.
- VALIRON 1984 : Gestion des eaux usées,
Principes-Moyens-Structures, éd Complète, Paris, 43p.
- LAROUSSE, 2012 : Dictionnaire Petit LAROUSSE,
éd. Larousse, Paris, France.
- Organisation mondiale de la Sante (1973) La
réutilisation des effluents: méthodes de traitement des eaux
usées et mesures de protection sanitaire. Rapport d'une
réunion d'experts de l'OMS, Genève (Ser. Rapp.
techn. Org. mond. Sante, N° 517).
- JP NDONGO, 2006, Rapport de présentation sur
l'état de l'environnement de la zone de Kwilu-Ngongo, éd
d'étude, 35p.
- Document du service de SEMEP, 2004, Recensement des
points d'eau par secteur sanitaire du Kongo Central.
- Laboratoire D'analyse De La Qualité du fluides,
2014, analyse microbiologique et physico-chimique des eaux
usées.
- ECKENFELDER W.W., 1982,
Gestion des eaux usées urbaines et industrielles. Technique
et Documentation. Lavoisier.
- ECHACJ.P., BOUTIN P., MERCIER B., NUER P., 1987. Traitement
des eaux usées. Edition Eyrolles.
2. Sites internet
- http://www.google.fr
- www.wikipedia.org/
3. Notes Inédites
- Docteur KALOMBO : syllabus de cours d'environnement,
ISPT-KIN, 2018-2019, Cours Inédits.
- CT BARWANI : syllabus de cours d'IMRS, ISPT-KIN,
2014-2015, Cours Inédits.
4. Travaux de TFC
- KABONGO DITU Arly : Avant-projet de l'installation
d'une station d'épuration des eaux usées. Cas de la
pédiatrie de Kalembe-lembe. 2011-2012 (ISPT-KIN).
- KAWELA MAYINZA Nancy : Etude d'une station de
phytoépuration des eaux usées. 2016-2017 (ISPT-KIN).
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHES
................................................................................................................i
DEDICACES
.................................................................................................................ii
REMERCIEMENTS
.......................................................................................................iii
INTRODUCTION GENERALE
.......................................................................................1
0.1. Choix et intérêt du sujet
.........................................................................1
0.2. Problématique
.........................................................................................1
0.3. Hypothèse du travail
...............................................................................2
0.4. But et objectif du travail
.........................................................................2
0.5. Méthodologie du
travail ..........................................................................3
0.6. Délimitation du
travail .............................................................................3
0.7. Subdivision du
travail ..............................................................................4
CHAPITRE I : THEORIE GENERALE DES EAUX USEES
..............................................5
I.0. PREAMBULE
......................................................................................................5
I.1. LES DEFINITIONS DES EAUX USEES
...............................................................6
I.2. LA CLASSIFICATION DES EAUX USEES
...........................................................7
I.2.1. Les eaux usées domestiques
.....................................................................8
I.2.2. Les eaux usées
urbaines ............................................................................9
I.2.3. Les eaux usées
industrielles .....................................................................10
I.3. LA COMPOSITION DES EAUX USEES
.............................................................13
I.3.1. Les matières en suspension
.....................................................................14
I.3.2. Les micropolluants organiques et non organiques
..................................14
I.4. LES CARACTERISTIQUES DES EAUX USEES
..................................................17
I.5. LES SOURCES DE POLLUTIONS DES EAUX USEES
........................................20
I.6. LA POLLUTION DE L'EAU
...............................................................................23
CHAPITRE II:GENERALITE SUR LA COMPAGNIE SUCRIERE DE
KWILU-NGONGO..29
INTRODUCTION
....................................................................................................29
II.1. BREF HISTORIQUE
........................................................................................29
II.2. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE
...................................................................30
II.3. L'IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE
...................................................................32
II.4. ACTIVITE DE LA COMPAGNIE SUCRIERE DE KWILU-NGONGO
...................32
II.5. LA STRUCTURE DE LA SUCRIERE DE KWILU-NGONGO
...............................35
II.6. NOTION DU BUDGET DE LA COMPAGNIE SUCRIERE
..................................37
II.7. PRODUCTION JOURNALIERE
........................................................................37
II.8. CIRCUIT HYDRAULIQUE DE LA COMPAGNIE SUCRIERE
.............................39
CHAPITRE III : CIRCUIT DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE
L'USINE DE KWILU-NGONGO
.......................................................................................................42
III.0. INTRODUCTION
............................................................................................42
III.1. LE CIRCUIT DE PRODUCTION DES EAUX USEES DE LA SUCRIERE
............43
III.2. LES CONTENUS DES EAUX USEES DE LA SUCRIERE
...................................43
III.3. PROPOSITIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE LA SUCRIERE
......45
III.4. LES ETAPES CLASSIQUES DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
...................46
III.4.1. LE PRETRAITEMENT DES EAUX USEES
................................................47
III.4.2. LE TRAITEMENT PRIMAIRE
...................................................................49
III.4.3. LE TRAITEMENT SECONDAIRE OU BIOLOGIQUE
.................................52
III.4.4. LE TRAITEMENT TERTIAIRE
.................................................................53
III.4.5. LE TRAITEMENT DES ODEURS
.............................................................55
III.4.6. LE TRAITEMENT DES BOUES
................................................................55
III.4.7. LES PRODUITS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
............................57
III.5. LES RESULTATS OBTENUS
...........................................................................59
III.6. ETUDE TECHNOLOGIQUE
.............................................................................60
III.7. LES MATERIELS UTILISES
............................................................................62
III.8. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA THEORIE DU CIRCUIT DE
TRAITEMENT DES EAUX USEES APPLIQUEE A LA COMPAGNIE SUCRIERE ............63
CONCLUSION GENERALE
..........................................................................................66
BIBLIOGRAPHIE
....................................................................................................... 67
| 


