EPIGRAPHE
« Une croissance plus forte dans le secteur de biens
échangés que dans le secteur de biens non échangés
engendre une appréciation réelle tandis que la situation inverse
provoque une dépréciation réelle ».
Isaac Evariste
DEDICACE
A toi Eternel Dieu des armées céleste pour ta
protection divine ainsi que ta grâce sur ma vie, que ton nom soit
béni à jamais car aucun mot ne suffira pour exprimer notre
gratitude. Nos profonds remerciements s'adressent à notre cher parent
Jean MUTOMBO et MBULA Grâce qui se sont voués corps et âme
à notre éducation pour faire de nous ce que nous sommes
actuellement. Car sans vous, je ne serai utile dans la société.
Que votre amour continue jusqu'à la fin de notre vie.
Isaac MUKONKOLE
REMERCIEMENTS
C'est de tout coeur qu'au seuil de ce
travail, nous faisons l'agréable devoir d'exprimer nos vifs
remerciements à tous ceux dont le concourt nous a été
précieux pour réaliser cette oeuvre, car dit-on, l'union fait la
force.
De ce fait, nous remercions toutes les autorités de
l'université de Kamina (UNIKAM) pour avoir organisé à son
sein l'agréable faculté des Sciences Economiques et de Gestion,
laquelle découle notre formation.
Nos remerciements sincères et chaleureux s'adressent au
corps enseignant de ladite faculté pour l'encadrement et la formation
à notre égard pendant ces trois années d'études.
Nous remercions spécialement le Chef de Travaux
SimpliceBANZA MAKONGA, pour son dévouement dans ce travail avec ses
multiples et importantes préoccupations mais prenant la direction de ce
travail avec beaucoup des rigueurs.
« Vita sine amicisinsidiarumplena est »
dixit. « La vie sans ami est pleine d'embuche » dit-on. Les
conseils sages, les motivations constructives et éducatives venant des
amis et connaissances nous obligent à leur dire sincèrement
merci : NUMBI BANZA Gaétan, LUBANDA MBUEBUE Mélina, ILUNGA
MITONGA Daniel.
Que tous les héros dans l'ombre qui y ont
contribué, de loin ou de près, trouvent ici l'expression de notre
gratitude.
Isaac MUKONKOLE K.
INTRODUCTION
L'un des éléments les plus indéniables de
la Politique économique d'un pays, ouvert sur l'extérieur, est le
taux de change. Ce dernier est considéré à la fois comme
un moyen de régulation monétaire et un outil par excellence de
compétitivité d'un pays. L'objectif ultime de toute
économie est d'atteindre les grands équilibres du carré
magique ; à s'avoir la stabilité des prix, la croissance
économique, le plein-emploi et l'équilibre de la balance
commerciale, la régulation des équilibres internes et externes de
l'économie nécessitent une mise en oeuvre d'une politique
économique. La politique monétaire et la politique de change sont
deux instruments de la politique économique.
A travers le monde, nous constatons que chaque pays a une
monnaie, lui permettant d'évaluer le prix des biens et services ;
ce qui fait que le taux de change joue un rôle pivot ou central dans le
commerce international en permettant de comparer les prix des biens et services
produits dans différents pays. Les ménages utilisent le taux de
change lorsqu'ils veulent convertir des prix de monnaie étranger en
monnaie nationale.
Les taux de change sont au coeur des relations
économiques internationales et font partie intégrante du paysage
quotidien des agents économiques. L'essor des relations commerciales et
financières internationales et l'indépendance croissante qui en
est la conséquence sont un premier élément explicatif de
l'importance stratégique de cette variable (taux de change).
En plus de sa dimension économique et
financière, le taux de change joue un rôle fondamental en tant
qu'instrument ou objectif de la politique économique, voire en tant que
symbole de la puissance politique. Dans le monde totalement globalisé et
sans règles formelles, les économistes cherchent à
appréhender les évolutions et les déterminants des taux de
change, de plus en plus volatils et échappant à tout
contrôle. Jour après jour il y a toujours évolution de la
principale devise utilisée dans la ville de Kamina qui est le dollar.
Dans tout pays, il y a des flux monétaires entrants et
des flux monétaires sortants. Ces mouvements traduisent la
présence des différentes monnaies qui entrent en relation par le
biais de la conversion ; cette dernière est une opération
strictement comptable faisant recours aux taux de change.
Aujourd'hui, les opérations qui étaient
impossibles par la monnaie unique sont devenues possibles grâce à
la méthode de taux de change qui facilite la confrontation des
différentes monnaies. Avec cette nouvelle option, les échanges
n'ont pas atteint la perfection car certains pays ont tendance à
être strictement créanciers et d'autres débiteurs par le
fait même de l'inégalité dans la conversion des monnaies
aux marchés des changes.
A cet effet, cette imperfection donne la possibilité
auxopérateurs économiques à avoir latendance de
spéculer à la hausse le prix des produits manufacturés
importés sur le marché afin de s'adapter aux fluctuations du taux
de change. L'instabilité accrue du taux de change à
l'intérieur de pays s'accompagne d'un ralentissement de la croissance
économique.
C'est la présence de cette instabilité
observée dans le chef de la monnaie congolaise par rapport aux autres
monnaies et le fait que l'économie congolaise est dollarisée, qui
nous a poussés à mener une étude sur les effets que
pourrait provoquer l'évolution du cours entre ces deux monnaies.
C'est ainsi que nous avons centré notre analyse sur
l'impact du taux de change sur le prix des produits manufacturés
importés dans la ville de Kamina, comme la question principale. Alors
pour y parvenir, nous avons structuré notre sujet de la manière
ci-après, outre l'introduction et la conclusion :
Chapitre premier :Cadre
théorique sur le taux de change
Dans ce chapitre, nous allons décrire les points
suivants : problématique, objectifs de la recherche,
hypothèse de la recherche, intérêt et choix de la
recherche
Chapitre deuxième :
Cadre méthodologique du taux de change
Dans ce deuxième chapitre nous allons développer
les points suivants : modèle d'appréciation du taux de
change et méthode d'estimation et d'analyse.
Chapitre troisième :
Implication du taux de change dans son évolution du prix
de produits manufacturés importés dans la ville de Kamina
Dans ce dernier chapitre, nous allons présenter les
données, les traiter et les interpréter.
Et cela pour une période allant de 2018 à 2020
soit une période trois ans, alors pour récolter les informations
relatives à notre recherche, les techniques documentaires et
d'observations nous ont été utiles.
CHAPITRE PREMIER : CADRE THEORIQUE SUR LE TAUX DE
CHANGE
1.1. PROBLEMATIQUE, OBJECTIFS DE LA RECHERCHE,
HYPOTHESE DE LA RECHERCHE, INTERET ET CHOIX DE LA RECHERCHE
1. PROBLEMATIQUE
La problématique est définit comme étant
un ensemble des problèmes, un ensemble d'inquiétudes, un ensemble
de préoccupation qu'un chercheurs attend résoudre dans son
travail. (Banza Makonga, S., 2019 - 2020).
Selon(Philippe Breton, 2012), une problématique d'une
manière générale désigne le processus intellectuel
par lequel on arrive à la formulation systématique des lacunes ou
déficiences dans l'état de nos connaissances sur un sujet ou sur
un domaine donné.
Selon(Beaud, 2006) « La problématique est
définit comme étant l'ensemble des questions posées dans
un domaine de la science en vue de rechercher des solutions qui
s'imposent ».
D'abord nous allons essayer de projeter un regard vers le
passé de notre histoire des années 1990 et 1996 afin d'avoir une
image sur les réalités actuelles.Le système
monétaire du Congo a été marqué
précisément par un disfonctionnement qui a entamé
fortement la valeur de la monnaie nationale. Les manifestations le plus
évidentes de cette crise de la monnaie furent l'hyperinflation, la
dollarisation de l'économie, la crise aigüe des liquidités
dans les banques, la perte de crédibilité de la Banque Central et
le rejet de certains signes monétaires par la population.
Ainsi, toute économie qui se veut dynamique et
prospère a toujours aspiré a plusieurs objectifs au nombre des
quels la croissance économique, le plein emploi, la stabilité des
prix ainsi que l'équilibre budgétaire et extérieur qui
constituent les quatre objectifs fondamentaux que pour suit tout le
gouvernement.
D'aucun n'ignorent le rôle important que joue la monnaie
au sein de l'économie à travers ses trois fonctions essentiel
qu'elle remplit à savoir : intermédiaires des échanges,
unité de compte et réserve de valeur.
S'inscrivant ainsi à cette logique, la monnaie
nationale ne saurait remplir convenablement ses fonctions essentielles si elle
ne jouit pas d'une certaine stabilité dans ses rapports d'échange
avec les produits sur le marché. La solidité et la croissance du
système financier en dépendent.
Avec le déchainement de l'hyperinflation et le
dérèglement des mécanismes de paiement, l'économie
congolaise avait connu au cours d'une décennie passée un
désordre monétaire sans précédent : le
dysfonctionnement monétaire s'était si amplifié que la
monnaie nationale se déprécierait à des taux jamais
observés auparavant à tel point qu'elle avaitfini par être
substitue par le dollar américain, d'où la dollarisation de
l'espace monétaire congolais.
Cette dérive inflationniste a été
favorisée notamment par le laxisme budgétaire et le rationnement
du financement extérieur consécutif à la suspension des
programmes d'ajustement et de la coopération avec le pays.
Dans un contexte de laxisme tant budgétaire que
monétaire, les liens dynamique entre le taux de change ; le prix et les
impulsions monétaires deviennent quelque peu difficile à
expliquer. Ainsi l'on observe le plus souvent que le marché de change
donne généralement le ton de dépréciation
monétaire, en ce sens que les agents économiques se
réfèrent constamment aux cours de change pour justifier
l'ajustement à la hausse du prix. Par moment le marché des biens
et services développe le premier la tendance inflationniste lorsqu'il se
forme des attentes d'une dépréciation prochaine de la monnaie
nationale face à la devise américaine.
Face à cette réalité, en
République Démocratique du Congo, la monnaie nationale et les
devises circulent concomitamment, et les prix intérieurs sont
fixés pour certains et voir la plus part des biens et services en
devises, surtout en dollars américain.
La variation de cours de change semble avoir une incidence
directe sur les prix des dits biens et services. De même, le mouvement
des prix se répercutent autant sur le taux de change. Seulement, quand
la monnaie nationale s'apprécie les prix intérieurs semblent
être rigides à la baisse.
Etant donné que la problématique est
perçue comme « L'ensemble des questions auxquelles les
hypothèses tentent de donner les réponses. Elles peuvent
être neutres, d'observation courante partant sur le fait de la vie
quotidienne ou des faits découverts au cours d'une recherche ayant
d'autres objectifs ». (Grawitz, 2000)
Au regard de ce qui précède, l'interrogation que
suscite la présente recherche se propose impact du taux de change sur
la consommation des produits manufacturés importés dans la ville
de Kamina comme préoccupation principale où découle celles
de la recherche ci-après :
n Y-a-t-ils les causalités qui soient à la base
de la variation du taux de change dans la ville de Kamina ?
n Les conséquences liées à la variation
du taux de change qui impactent sur les produits manufacturés
importés dans la Ville de Kamina, sont-elles négative ou
positives ?
2. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
Les objectifs de la recherche fixés par notre
étude, se regroupe en deux catégories, il s'agit d'un objectif
général et des objectifs spécifiques.
1. OBJECTIF GENERAL
Nous cherchons à savoir l'impact du taux de change sur
le prix des produits manufacturés importés dans la Province du
Haut-Lomami.
2. OBJECTIF SPECIFIQUE
Les objectifs visés par notre étude sont divers
et devront permettre aux opérateurs économiques de tirer
pleinement profit :
- Identifier les variables qui influencent la variation du
taux de change qui constituent la perte sèche du consommateur ;
- Identifier les conséquences liées à la
variation du taux de changesur le prix des produits manufacturés
importés ;
- Savoir comme la variation du taux de change impacte le
pouvoir d'achat des consommateurs.
3. HYPOTHESE DE LA RECHERCHE
Deux sortes d'hypothèses servent de piliers à la
construction d'une théorie (Gingras, 2009) :
- Les axiomes : les propositions de portée
universelle que l'on renonce à démontrer (souvent parce que les
estimesévidentes) et qui servent de fondement à la
réflexion théorique ;
- Leshypothèses générales : les
propositions synthétiques visant à accorder les axiomes aux
données disponibles dans des contextes empiriques particuliers ;
Ce terme est formé étymologiquement de deux
racines(Aktouf, 1987)
- Hypo : Sous, en dessous, en deçà ;
et
- Thèse : proposition à soutenir, à
démontrer.
Les hypothèses constituent donc les soubassements, les
fondations préliminaires de ce qui est à démontrer ou
à vérifier sur le terrain.
Nos hypothèses seront orientées de la
manière suivante :
Pour ce qui est d'une causalité à la base de la
variation du taux de change dans la ville de Kamina. Il est évident que
les causes sont multiples mais nous allons simplement essayer de nous
étaler sur les plus pertinents.
Au Congo la dollarisation a pris davantage la forme d'une
substitution pure de monnaies, la substitution d'actifs étant
marginale. Les marchés financiers congolais sont en effet rudimentaires.
Ainsi, Les principales causes de la hausse du taux de change.
PRIMO
La rareté des dollars américains
(USD). Tout part de la légère dépréciation du
franc congolais qui se justifie par la hausse de la demande de devises et une
contraction de l'offre.En effet, les anticipations alimentent la demande pour
le motif de précaution alors que la baisse de l'offre tient surtout au
retard d'approvisionnement des banques en dollars américains suite
notamment aux perturbations du trafic aérien.
SECUNDO
Les banques commerciales n'ont plus assez de liquidités
en dollars américains. Cette situation s'explique par la fermeture
des frontières non seulement de la Rd Congo mais de plusieurs pays du
monde avec comme conséquence l'arrêt des trafics
aériens.
Dans ce contexte, les banques commerciales qui ont souvent
l'habitude d'importer des devises conformément aux normes
financières internationales ont du mal à le faire actuellement
pour répondre aux besoins de leurs clientèles respectives,
surtout des opérateurs économiques en ce moment où les
besoins en importations des biens ne cessent d'accroître.
TERTIO
La spéculation sur le marché de
change. Elle s'explique par des anticipations irrationnelles de
l'évolution des cours des monnaies.
Cela signifie que des changeurs des monnaies auprès de
qui, les opérateurs économiques, en quête des devises, se
tournent pour acheter des devises et satisfaire à leurs besoins non
rencontrés par les banques, se permettent d'augmenter le taux de change
de la devise suite à la rareté de cette dernière sur le
marché monétaire afin d'en tirer profit individuel à court
termes.
La
réglementation de change en vigueur en République
Démocratique du Congo interdit aux changeur de monnaie
(cambistes) la spéculation et la volatilité sur le
marché de change. Cela implique que dans le cadre de leurs transactions
d'achat et de vente de devises contre les francs congolais, ils sont astreints
à appliquer un taux vendeur qui n'excède pas les 2,5% du taux
acheteur.
En ce qui concerne la deuxième question, nous savons
bien évidemment qu'il existe un lien fort entre le taux de change et
l'inflation ceci est justifié par rapport à la parité des
taux d'intérêt, la parité des pouvoirs d'achat (PPA) est
l'une de relations les plus utilisées en finance internationale et
constitue souvent une hypothèse de base de nombreuses théories
sur les taux de change. On peut prévoir l'évolution du cours
relatif des devises en comparant le prix d'un panier de biens et services dans
différents pays. Cette théorie est fondée sur
l'idée que les taux de change devraient être fixés par
rapport au prix relatif des biens de consommation entre deux pays.
L'évolution du taux d'inflation d'un pays serait alors
immédiatement compensée par un mouvement opposé du taux de
change. Lorsque les prix augmentent dans un pays, alors la devise de ce pays
devrait se déprécier pour que la parité soit
rétablie.
4. Variable endogène
Variable exogène
Le prix des Produits manufacturés
Le Taux de Change
Indicateur
Indicateur
Le prix des Produits manufacturés
ffaire réalisés
Le Taux de Change
Y=f(x)
Y
x
Source : Elaborer par nous-même.
1.1.4. INTERET ET CHOIX DE LA RECHERCHE
1. INTERET DE LA RECHERCHE
L'intérêt apporté à ce sujet est
celui de savoir si le taux de change a un effet sur les prix des biens
importés de consommation dans la Province du Haut-Lomami et plus
particulièrement dans la ville de Kamina.C'est aussi une occasion pour
nous d'approfondir les théories acquises sur le taux de change et pourra
aider d'autres chercheurs qui traiteront ce sujet sous d'autres dimensions et
vont s'en inspirer, et éventuellement nous compléter pour une
meilleure évolution scientifique.
1.1. INTERET ECONOMIQUE
De ce point de vue, ce travail ouvrira des nouvelles horizons
à la Banque Centrale du Congo (BCC) de la manière dont il faut
stabiliser le taux de change et de trouver des pistes de solution
nécessaire.
1.2. INTERET SOCIAL
Quant au social, ce travail aidera aux divers
opérateurs économiques de faire confiance à la monnaie
nationale, de leurs trouver un mode de d'équilibre entre l'offre et la
demande (les entreprises et leurs clients).
1.3. INTERET PERSONNEL
Il est vrai que ce travail nous permettrons aussi d'affronter
ou d'enrichir nos connaissances. Ce travail nous a également
été très utile pour nous parce qu'il nous a permis aussi
de répondre aux exigences académiques, celle de pouvoir faire une
rédaction à la fin de chaque cycle.
2. CHOIX DE LA RECHERCHE
Le choix que nous avons porté à ce sujet n'est
pas un fruit du hasard et n'en demeure pas moins important, il est dû par
le fait que le marché de change et celui des biens et services
importés aujourd'hui dans la Province du haut-Lomami agissent en
interdépendance (il existe une relation étroite entre les 2 types
de marchés c'est-à-dire le marché de change et celui de
biens et services), ceci constitue une préoccupation majeure pour nous
du fait que ça affecte la vie au quotidien de la population en
général et celle des PME et entreprises en particulier.
1.2. REVUE DE LA LITTERATURE DE TAUX DE
CHANGE
1.2.1. THEORIES EXPLICATIVES SUR LE TAUX DE CHANGE ET SUR
LE PRIX
1.2.1.1. NOTION DE LA MONNAIE
a. Définition de la monnaie
La monnaie telle qu'elle apparaît de nos jours se
présente sous des formes diverses et en mutation permanente :
pièces métalliques, billets, des dépôts à
vue...etc. en outre la monnaie sert une multitude de fonctions : unité
de compte, moyen de paiement, actif de placement et instrument de la politique
économique. (AKISAHU, 2020 - 2021)
Pour aborder les questions monétaires et comprendre
l'état actuel des choses, une démarche judicieuse consistera
à remonter dans le temps et suivre progressivement le processus des
innovations financières. Mais avant d'aborder cette question nous allons
définir au préalable qu'est-ce qu'on entend par monnaie.
I-1 Définition fonctionnelle de la monnaie
La monnaie peut être définie par les fonctions
qu'elle assure. Elle remplit quatre fonctions essentielles, c'est à la
fois une unité de compte, un moyen de paiement, une réserve de
valeur et un instrument de politique économique.
I-1-1 La monnaie, unité de compte
La monnaie sert en tant qu'unité de mesure ou bien un
numéraire qui permet d'exprimer la valeur des différents biens en
une seule unité. Dans le cadre d'une économie de troc, donc
absence de monnaie, la valeur d'un bien est exprimée par rapport aux
autres biens, on parle de prix relatifs, ainsi si on a n biens, on a 2
Si parmi ces n biens, un va jouer le rôle de monnaie,
donc assurer le rôle de numéraire, la valeur de tous les biens va
être exprimée par rapport à ce numéraire, dans ce
cas on aura n-1 prix absolus.
I-1-2 La monnaie, moyen de
paiement
Dans cette fonction, la monnaie apparaît comme un bien
intermédiaire qui permet de dissocier les opérations d'achat et
de vente qui sont confondues dans le cadre d'un système de troc. Il
s'agit d'un intermédiaire obligé dans les échanges, tous
les biens s'échangent contre de la monnaie qui, à son tour,
s'échange contre des biens.
R. Clower indique que dans une économie
monétaire, les biens achètent la monnaie et celle-ci
achète les biens, mais les biens n'achètent pas les biens. Pour
assurer ce rôle, la monnaie doit avoir cours légal, elle ne peut
être refusée dans les paiements.
Dans un système de troc, l'échange ne peut avoir
lieu que s'il y a doubles coïncidence des besoins, tout agent doit trouver
non seulement quelqu'un qui soit prêt à lui vendre les biens qu'il
cherche mais aussi qui accepte en échange les biens dont l'agent
dispose.
Comme cette double coïncidence risque d'être
exceptionnelle, il y aura en fait un blocage de l'échange.
L'introduction de la monnaie comme intermédiaire des échanges
permet ainsi de scinder l'opération de troc en deux et résoudre
le problème de la double coïncidence.
I-1-3 La monnaie, réserve de valeur
La monnaie permet de constituer une réserve de pouvoir
d'achat à partir du moment où les opérations recettes et
dépenses ne sont pas synchronisées. Dès que la monnaie est
un moyen d'échange, il est possible de la conserver. La monnaie permet
d'étaler les achats dans le temps, elle représente un lien entre
le présent et le futur, c'est un instrument d'épargne.
Il est à noter que certains biens peuvent constituer
une réserve de valeur plus sûre que la monnaie. Néanmoins,
cette dernière présente l'avantage d'être la plus liquide,
elle n'a pas besoin d'être transformée, elle est utilisée
immédiatement dans les paiements.
Mais contrairement aux autres actifs, le rendement nominal de
la monnaie est nul, c'est sa qualité d'être liquide, sans
coût de transaction, qui fait que les agents économiques la
détiennent.
I-1-4 La monnaie, instrument de politique
économique
Cette fonction est relativement récente, elle ne date
que du début du 20ème siècle. La monnaie constitue un
outil puissant entre les mains des autorités publiques car elle permet
d'influencer considérablement l'activité économique. La
politique monétaire peut servir des objectifs de croissance et de
stabilité de prix.
I-2 Définition institutionnelle
La monnaie n'apparaît, en tant que moyen de paiement,
comme nécessité impérieuse que dans le cadre d'une
économie fondée sur l'échange.
L'état actuel des choses où la monnaie n'a pas
de valeur intrinsèque, fait que la stabilité de sa valeur, dans
le sens de conservation de son pouvoir d'achat entre deux transactions, n'est
possible que si les agents économiques ont confiance en cette monnaie.
C'est l'Etat qui assure cette garantie en lui conférant un cours
légal.
L'acceptation et l'utilisation d'une monnaie repose ainsi sur
une convention implicite, les agents économiques l'acceptent parce
qu'ils font confiance en l'autorité qui en est l'émetteur. Et
c'est là qu'elle prend une dimension institutionnelle, elle peut
être considérée au même titre que les institutions
sociales qui servent l'intérêt public.
b. Formes de la monnaie et fonctions de la
monnaie
Après avoir définie la monnaie à partir
de ses fonctions, nous pouvons à présent analyser ses
différentes formes.
Au cours de l'histoire la monnaie a pris des formes diverses
suivant un processus de dématérialisation, les formes
monétaires sont passées de la monnaies marchandise à la
monnaie virtuelles dans l'ère contemporaine.
Actuellement, la monnaie est essentiellement scripturale,
c'est-à-dire constituée d'avoir matérialisés par
une inscription dans les comptes bancaires ou postaux dont les principaux
instruments de circulation sont les chèques et les cartes bancaires.
Nous allons poursuivre notre analyse en démontrant ce
qu'a été la monnaie avant d'avoir cette forme actuelle.
1.2.1.1.1. LA MONNAIE MARCHANDISE
Depuis, l'ancien temps dans nos sociétés
humaines certains biens ou objets ont été
sélectionnés comme monnaie en raison de la valeur qu'ils
revêtaient.
Ces objets ou marchandises ont été divers selon
les sociétés : en Europe occidentale le bétail, en Afrique
noire, les ethnologues ont souvent observé dans les
sociétés traditionnelles l'emploi monétaire du mil, du
sel, des coquillages et en Egypte le chat.
En effet, ces objets renferment certains inconvénients
à savoir : ils sont périssables, leur indivisibilité
constituée un obstacle sérieux à la conclusion de petites
transactions.
C'est ainsi que l'or et l'argent ce sont imposés comme
instruments monétaires non seulement parce qu'ils sont indestructibles
mais aussi parce qu'ils sont divisibles. Il sied de signaler que la monnaie
marchandise renferme un inconvénient majeur : elle est encombrante,
c'est-à-dire son utilisation n'est pas commode dans les transactions.
1.2.1.1.2. LA MONNAIE FIDUCIAIRE
La monnaie fiduciaire était apparue à la suite
des dépôts des agents économiques en or et en argent
auprès des orfèvres. Ces derniers délivraient un
reçu en contre partie de ces dépôts.
En effet, la monnaie fiduciaire, c'est une monnaie qui est
fondée sur la confiance à son émetteur. Le terme
fiduciaire vient du mot latin « fiducia » qui signifie «
confiance ». Fondée sur la confiance car la remise et l'acceptation
de ces reçus ne soulevaient aucune difficulté par le
détenteur de l'or. Donc il accordait la confiance à
l'orfèvre.
Aujourd'hui cette monnaie fiduciaire est constituée par
l'ensemble des billets et pièces en circulation. C'est un instrument
monétaire dont le pouvoir d'émission revient à la banque
centrale d'un pays ou au pouvoir public. Pour la RDC c'est la Banque Centrale
du Congo, BCC en sigle.
1.2.1.1.3. LA MONNAIE SCRIPTURALE
Cette monnaie est dénommée scripturale parce
qu'elle est inscrite sur les livres des établissements émetteurs
essentiellement les banques.
La monnaie scripturale est créée par les
dépôts à vue des particuliers auprès des banques
commerciales. Ces dernières inscrivent au crédit des comptes de
particulier la somme déposée pour constater ces
dépôts.
Donc toutes les transactions s'effectuées à
partir de jeu d'écrire sur des registres, débit et crédit,
il n'y a pas la manipulation de billets. Cette monnaie est
représentée principalement par le chèque.
1.2.1.1.4. LA MONNAIE ELECTRONIQUE
La monnaie électronique peut être définie
comme l'ensemble des techniques informatiques, magnétiques,
électroniques et télématique permettant l'échange
de fonds sans support de papier.(Dominique, 2004)
L'avènement de la monnaie électronique va de
pair avec l'utilisation des nouvelles technologies de l'informatique et de la
communication, NTIC en sigle. Le concept de monnaie électronique est
apparu avec la technologie de la carte à microcircuit et son utilisation
dans des cartes prépayées multi prestataires.
Plus récemment, les nouvelles perspectives offertes par
des réseaux ouverts de type internet ont élargi les
potentialités de développement de la monnaie électronique
qui prend deux formes principales :
1) Le porte-monnaie électronique (PME), qui repose sur
l'utilisation du microprocesseur d'une carte, sur lequel sont
enregistrés des signes électroniques représentant un
pouvoir d'achat transférable à un nombre élevé de
bénéficiaires potentiels ;
2) Le portemonnaie virtuel (PMV), pour lequel ces même
signes électroniques sont stockés dans la mémoire d'un
ordinateur et permettent d'effectuer des transactions à distance en
utilisant de télécommunication du type internet.
c. Création et distribution de la monnaie
À la base même de ce processus de création
et de distribution monétaire se trouve un agent économique
(ménage, entreprise) qui souhaite acquérir un bien ou financer un
surcroît de dépenses sans avoir les ressources financières
correspondantes.
En l'absence de crédit, cet agent ne pourrait pas
réaliser immédiatement son projet et devrait attendre
de disposer des ressources nécessaires pour le faire, ce
qui dans certains cas pourrait prendre des années, voire ne jamais se
réaliser (par exemple acheter une maison pour un particulier).
Toutefois, grâce aux crédits qu'elles accordent
à leurs clients, les banques commerciales vont permettre à une
grande partie de ces projets de se matérialiser. Les banques
commerciales jouent un rôle de prestataire de service financier pour les
particuliers et les entreprises qui les situent au coeur du financement de
l'économie et en font un acteur majeur de celui-ci.
Deux façons d'octroyer des crédits :
Il y a cependant deux façons pour les banques
commerciales d'octroyer des crédits à leurs clients.
Utiliser les dépôts
existants
La première consiste à utiliser les
dépôts de leur clientèle qui sont non employés.
Ce faisant, les banques transfèrent des ressources en provenance
d'agents en capacité d'épargne vers des agents ayant des besoins
de financement.
Comme les dépôts de leurs clients sont
généralement liquides à court terme et que les prêts
qu'elles accordent sont à plus long terme, les banques pratiquent la
transformation d'une épargne liquide préexistante en financements
plus adaptés aux besoins de l'économie. Ce processus est
résumé par l'adage « les dépôts font les
crédits«Toutefois, il s'agit ici d'un simple transfert d'une
catégorie d'agents vers une autre, et il n'y a donc pas de
création monétaire.
Créer de la monnaie
La seconde façon pour les banques commerciales
d'octroyer des crédits à leurs clients consiste justement
à créer de la monnaie, c'est à dire à
effectuer un prêt sans avoir les montants correspondant en ressources.
Pour ce faire, les banques commerciales vont créditer
le compte courant de leur client du montant du prêt accordé. Par
un simple jeu d'écriture, elles vont ainsi créer de la monnaie.
Dans ce cas, « les crédits font les
dépôts » puisque le montant du crédit
octroyé vient alimenter le compte courant du client de la banque
commerciale.
C'est grâce à ce processus que le stock de
monnaie en circulation croît en liaison avec les besoins de monnaie du
système économique. Seules les banques commerciales ont ce
pouvoir de création monétaire.(finance pour tous, 2019)
1.2.1.1.5. LA MASSE MONETAIRE
La quantité de monnaie disponible dans une
économie à un moment donné est mesurée par la masse
monétaire. La masse monétaire c'est l'ensemble des moyens de
paiement détenus par les agents non financiers.
LES COMPOSANTES DE LA MASSE MONETAIRE
La quantité de monnaie en circulation dans une
économie est mesurée par les agrégats monétaires
dont on peut grouper du plus liquide au moins liquide : l'agrégat M1,
l'agrégat M2 et l'agrégat M3. Ces agrégats constituent la
masse monétaire, ils ont pour objet de recenser les avoirs
détenus par les agents économiques non financiers.
M1 ou disponibilités monétaires : il comprend
les moyens de paiement au sens stricte ou la monnaie proprement dite,
composée de la monnaie fiduciaire (billets et pièces
métalliques) émise par l'Etat (Banque
Centrale oud Trésor Public) la monnaie scripturale
(dépôt à vue) émise par les banques commerciales ou
banques de dépôt10.
En d'autres termes il regroupe les instruments de paiement mis
à la disposition du public.
L'agrégat M2 rassemble l'agrégat M1 et les
placements à terme effectué auprès des
établissements de crédit et du Trésor. Pour être
plus précis M2 = M1 + dépôts à terme
c'est-à-dire quasi monnaie.
L'agrégat M3 comprend l'agrégat M2
augmenté de placement à terme, les titres à court terme
négociables, les dépôts à vue et les autres
dépôts et titre du marché monétaire en devise.
D'une façon générale, la structure des
agrégats monétaires n'est pas immobile et sa modification est due
à des origines conjoncturelles (évolution des taux
d'intérêt par exemple) et à des origines structurelles
(fiscalité).
LES CONTREPARTIES DE LA MASSE MONETAIRE
Les contre parties de la masse monétaire constituent la
source de la création monétaire au profit des agents non
financiers. On distingue trois contre parties de la masse monétaire :
les avoirs extérieurs nets, les créances nettes sur l'Etat et les
crédits à l'économie.
- Les avoirs extérieurs nets mesurent l'incidence sur
le stock de monnaie des transactions courantes et en capital entre les agents
non financiers résidents et les non-résidents,
- Les créances nettes sur l'Etat retracent
l'endettement net de l'Etat vis-à-vis du système bancaire dans
son ensemble,
- Les crédits à l'économie décrivent
le financement accordés aux agents économiques non financiers par
les établissements de crédit. Ces deux dernières
contreparties forment le crédit intérieur.
On aura remarqué que les contreparties de la masse
monétaire se retrouvent dans les différents postes de l'actif du
bilan d'une banque centrale. (AKISAHO, 2020 - 2021)
1.2.1.2. POLITIQUE MONETAIRE
1.2.1.2.1. Fondements théoriques
La politique monétaire est l'un des instruments de la
politique économique, c'est l'ensemble des moyens dont dispose les
autorités monétaire pour agir sur l'activité
économique par l'intermédiaire de la masse monétaire et
des taux d'intérêt. En d'autres termes c'est un ensemble des
moyens dont disposent les Etats ou les autorités monétaires
(banque centrale), pour agir sur l'activité économique par
l'intermédiaire de l'offre monétaire.
1.2.1.2.2.EFFETS ECONOMIQUES DE LA POLITIQUE
MONETAIRE
Les effets de la politique monétaire ne sont pas
appréhendés de la même manière selon que l'analyse
est d'inspiration Keynésienne ou néoclassique (BERNARD, 2007).
Ces différentes analyses sont démontrées
dans les lignes quisuivent.
a) Analyse keynésienne
Si l'économie est en deçà du plein
emploi, la politique monétaire a deux impacts. Elle agit en premier lieu
sur le PIB et l'emploi ; elle intervient, en deuxième lieu sur le niveau
du taux d'intérêt. Ces effets passent par la baisse du taux
d'intérêt que la banque centrale provoque en accroissant l'offre
de monnaie.
La diminution du taux d'intérêt induit une hausse
de l'investissement qui par la suite l'intermédiaire du multiplicateur,
augmente le PIB réel, la demande globale et les emplois. Pour les
économistes keynésiens, si elle a des effets sur
l'activité économique, la politique monétaire est
cependant moins efficace que la politique budgétaire.
Pour soutenir cette affirmation ils avaient avancé
deuxarguments :
- Le premier invoque l'inélasticité de la
demande d'investissement aux taux d'intérêt. Keynes pensait en
effet que l'investissement dépendait fondamentalement de
l'efficacité marginale du capital, lequel est gouverné par les
prévisions et les anticipations des entrepreneurs, et très peu
par les taux d'intérêt.
- Le deuxième argument, celui de la trappe à
liquidité, énonce que la politique monétaire devient
totalement inefficace lorsque le taux d'intérêt est très
bas. Keynes pensait que le taux d'intérêt pouvait atteindre un
niveau si faible qu'arrivé en ce point les agents économiques ne
pouvaient plus anticiper la moindre baisse.
Dans ce contexte, les agents renoncent à détenir
des actifs financiers car leurs prix sont très élevés. La
demande de monnaie est alors une demande pour le seul motif de transaction, et
elle ne dépend du taux d'intérêt (BERNARD B. ,., 2007).
b) Analyse néoclassique
L'hypothèse de la neutralité de la monnaie
(proposition qui stipule qu'un changement de l'offre de monnaie n'a pas l'effet
sur les variables réelles de l'économie) a été
reprise et systématisée par le courant néoclassique pour
qui la politique monétaire est sans effet sur la production et
l'emploi.
A long terme, l'inflation est la seul conséquence d'une
politique monétaire expansive. Une politique de relance monétaire
n'aboutit à long terme qu'à augmenter le taux d'inflation et
à laisser le PIB et le chômage à leurs niveaux naturels.
1.2.1.2.3. CANAUX DE TRANSMISSION DE LA POLITIQUE
MONETAIRE
Les canaux de transmission de la politique sont les voies par
lesquelles les instruments à la disposition d'une banque centrale
modifient les comportements des agents dans le but d'atteindre les objectifs
qu'elle s'est fixé.
Ces canaux peuvent être objectifs ou subjectifs. Parmi
les canaux dits « objectifs », deux revêtent une
particulière importance : le canal du taux d'intérêt et le
canal du crédit, auxquels s'ajoutent le canal du bilan, le canal du
cours des actions et celui du taux de change.
Les canaux (subjectifs) sont liés aux anticipations des
marchés sur base d'annonces et d'interventions de la banque centrale.
L'hypothèse ici privilégiée pour illustrer ces
mécanismes est celle d'une baisse des taux d'intérêt.
1.2.1.2.4.OBJECTIFS DE LA POLITIQUE MONETAIRE
La politique monétaire a des objectifs dits ultimes et
ceux ditsspécifiques ou intermédiaires. Ainsi, dans cette section
nous allons essayer de potasser ces différents objectifs.
1. Objectifs ultimes
Les objectifs ultimes ou finals de la politique
monétairecoïncident avec ceux de la politique économique
générale, en l'occurrence la stabilité des prix,
l'équilibre extérieur, la croissance économique et le
plein emploi.
En d'autres termes c'est la recherche du carré magique.
? Stabilité des prix
C'est un objectif qui vise singulièrement à
esquiver tant l'inflation que la déflation. L'objectif de
stabilité de prix, comme le nom l'indique il pointe à maintenir
stable le niveau général des prix afin de ne pas assister
à des situations d'inflation dans une économie.
2. Objectifs spécifiques ou
intermédiaires
Par (objectif intermédiaire) on
définit une notion, unconcept, ou un agrégat représentatif
d'un ensemble de comportements sur lequel les autorités estiment avoir
une influence et dont elles pensentqu'ils relient à l'objectif final par
une relation plus ou moins connue et plus ou moins stable (DIDIER, 1992).
Ainsi, les banques centrales à qui reviennent les
décisions monétaires peuvent porter leur choix entre divers types
d'objectifs spécifiques que nous pouvons regrouper en trois : les
objectifs quantitatifs, les objectifs du taux d'intérêt et ceux du
taux de croissance. C'est-à-dire les autorités monétaires
visent à stabiliser le taux de croissance de la masse monétaire
à un niveau aussi proche que possible du taux de croissance de
l'économie réelle, le niveau du taux d'intérêt ainsi
que le niveau du taux de change.
1.2.1.2.5.INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE
MONETAIRE
La banque centrale dispose d'un certain nombred'instruments
qui l'aide à contrôler l'offre de monnaie. Ces instruments peuvent
être regroupés au nombre de trois : les interventions sur le
marché monétaire ou opérations d'open market, les
réservés obligatoires et le taux d'escompte.
1.2.1.2.6.INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE OU
OPERATIONS D'OPEN MARKET
On parle d'opération d'open lorsque market lorsque
labanque centrale achète et vend les obligations d'Etat. L'argent que la
banque centrale utilise pour acheter ces obligations augmente la base
monétaire et donc l'offre de monnaie. A l'inverse l'argent qu'elle
reçoit lorsqu'elle vend ces obligations réduit la base de monnaie
et donc l'offre de monnaie.
1.2.1.2.7.RESERVES OBLIGATOIRES
Elles désignent les réglementations par
lesquelles les banques centrales obligent les banques commerciales à
respecter un coefficient de réserves minimal. Toute hausse du
coefficient des réserves obligatoires réduit le multiplicateur et
donc l'offre de monnaie.
1.2.1.2.8.TAUX D'ESCOMPTE
C'est le taux d'intérêt que prélève
la banque centrale lorsqu'elles cossent des prêts aux banques
commerciales.(GREGORY & M, 2010,)
Les banques commerciales empruntent auprès de la banque
centrale lorsque leurs réserves sont suffisantes pour respecter le
coefficient des réserves obligatoires.
Plus le taux d'escompte est faible moins il est couteux
d'emprunter auprès de la banque centrale et plus les banques
commerciales ont recours à cette modalité de financement. En
conséquence toute réduction du taux d'escompte accroit la base
monétaire et donc l'offre de monnaie.
1.2.1.3. NOTIONS SUR LE PRIX
Définition du
prix
Le prix désigne la valeur d'un bien ou d'un
service. Le prix est exprimé généralement en
unité monétaire, comme l'euro ou le dollar. Autrement dit,
le prix est la valeur qu'un individu est disposé à
débourser en contrepartie de la cession d'un bien ou d'un service.
En théorie, le prix est le reflet de
l'équilibre
entre
l'offre et la demande. Lorsque l'offre est importante, le prix est
très souvent plus faible et inversement. La fixation d'un prix est
donc liée à la rareté, à la disponibilité du
bien ou du service et à la demande. Plus un bien est rare plus son prix
est élevé et inversement.
Selon l'objet concerné, le périmètre et
la méthode de détermination du prix varie. On rencontre ainsi
différentes sortes de prix :
· Le
prix
d'achat.
· Le
prix de vente, qui
indique le prix auquel un commerçant déclare être
disposé à céder la chose et qui ne doit pas être
inférieur au coût de revient (interdiction légale de
la
vente à
perte) ;
· Le
prix de
revient, censé refléter l'ensemble des dépenses
liées aux
intrants et à
la fabrication d'un produit ou d'un service ;
· Le
prix
d'acceptabilité ou
prix
psychologique, qui définit le prix qu'une grande partie de la
clientèle trouve justifié pour l'acquisition d'un bien ou d'un
service ;
· Le
prix
de cession, qui indique le prix auquel est facturée une cession
entre deux services d'une même entreprise ou entre deux filiales d'un
même groupe.
Sur un marché libre le prix reflète
l'équilibre entre l'offre et la demande. Pour
Karl
Marx l'équilibre tend à se fixer autour de la valeur du
travail incorporéé
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix
- cite_note-3. Ricardo estime également que le "prix
réel" correspond à la quantité de travail incorporé
mais constate que le "prix courant" est fonction de l'offre et de la demande.
Le prix courant aurait tendance à se rapprocher du prix naturel. Selon
Adam Smith le prix se dissocie de la "valeur réelle" car il tient compte
de la valeur de la monnaie qui, elle, est variable.
André
Orléan estime que la fixation d'un prix peut s'établir
par mimétisme et non en fonction du travail incorporé ou de
l'utilité. Pour Jacques Perrin, les institutions jouent ou doivent jouer
un rôle dans la constitution des prix en prenant en compte
l'utilité sociale.(Wikipédia, 2021)
En
microéconomie,
l'offre et la demande est un
modèle
économique de détermination des prix dans un
marché. Ce modèle énonce que, toutes choses étant
égales par ailleurs, dans un marché concurrentiel, le prix
unitaire d'un bien ou d'un autre élément négocié
comme de la main-d'oeuvre ou des actifs financiers, varie jusqu'au moment
où la quantité demandée (au prix courant) sera
égale à la quantité fournie (au prix courant),
résultant à un
équilibre
économique entre prix et quantité
négociée.
Si la théorie de l'offre et de la demande recouvre
pour
Roger
Guesnerie une intuition ancienne, sa formalisation débute en
1838 lorsqu'
Augustin
Cournot introduit la courbe de la demande. Plus tard,
Alfred
Marshall introduit une courbe de l'offre représentant l'offre
en fonction des
prix. Dans le cadre de la
théorie de l'
équilibre
partiel entre l'offre et la demande, à l'intersection de ces
deux courbes se trouvent le prix et la demande d'équilibre.
L'intérêt du modèle de l'offre et de la demande est qu'il
permet, hors du formalisme complexe de l'
équilibre
général, d'appréhender de façon intuitive les
mécanismes à l'oeuvre dans la décision d'
allocation
des ressources en
économie
de marché.(Wikipédia, 2021)
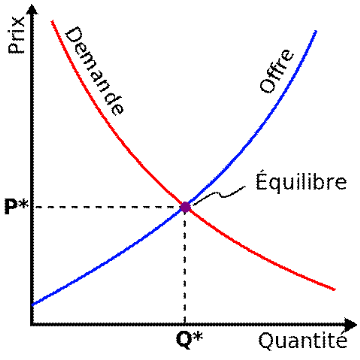
1.2.1.4. NOTIONS SUR LA POLITIQUE DE CHANGE
Le régime de change ou régime de taux de change,
d'une zone monétaire fait partie de la politique monétaire
adopté par les autorités monétaires, qui détermine
en grande partie le comportement du taux de change de la monnaie
vis-à-vis des autres devises (ou d'une devise en particulier).
Le régime de change désigne l'ensemble des
règles par lesquelles un pays ou un ensemble de pays organisent la
détermination des taux de change. Il existe une grande
variété de taux de change correspondant plus ou moins à
deux grands types de régimes : le régime des changes fixes et le
régime de changes flottant ou flexibles.
Le choix d'un régime de change par rapport à une
autre relève de la politique monétaire décidée par
un pays ou une zone monétaire.
a. Régime de change fixe
Dans ce régime le taux de change est fixé
arbitrairement par les autorités monétaires. L'équilibre
du marché des changes est assuré par l'intervention de la banque
centrale qui vend les devises étrangères si l'offre
dépasse la demande des devises et achète les devises si l'offre
est inférieure à la demande.
Un régime de change fixe peut être
accompagné d'un non convertibilité de la monnaie concerné.
Dans ce cas il n'existe pas de marché des changes (à part
éventuellement un marché parallèle, à taux
généralement décoté par rapport aux taux officiel)
permettant aux particuliers et aux entreprises, domestiques et
étrangères, de l'acheter ou de la vendre librement. Cette
opération ne peut se faire qu'en passant par la banque centrale
elle-même(Wikipédia, 2020).
b. Régime de change
flottant
Le régime de change flottant est basé sur la
détermination du cours de change de chaque monnaie par rapport aux
autres par la confrontation de l'offre et la demande des diverses devises sur
le marché des changes sans intervention des autorités
monétaires.(Wikipédia, s.d.)
Toutefois, en cas de forte instabilité du cours de
change une autorité monétaire peut intervenir sur le
marché de change soit en vendant ou en achetant une ou des devises soit
en instaurant le contrôle de change.
Dans un régime de change flexible (ou flottant),
à l'inverse, aucun engagement n'est pris au sujet du taux de change, qui
évolue librement, en fonction de l'offre et de la demande sur le
marché des changes.
1.2.1.5. NOTIONS SUR TAUX DE CHANGE(Types de taux de
change)
Le taux de change peut être défini au certain
c'est-à-dire le prix d'une unité de monnaie nationale par rapport
à une monnaie étrangère ; à l'incertain
c'est-à-dire le prix d'une unité de monnaie
étrangère par rapport à la monnaie nationale.(Fulbert,
2018-2019)
Le taux de change détermine donc la valeur
extérieur d'une monnaie, lorsque le taux de change augmente, on parle
d'unedépréciation monétaire et lorsqu'il diminue l'on
d'une appréciation monétaire.Le taux de change entre deux pays
est le prix auquel se font les échanges entre eux.
1.2.1.5.1. Types de taux de change
Les économistes définissent deux taux de change
: le taux de change nominal et le taux de change réel.
Cela étant nous allons essayer de décortiquer
chacun d'eux afin d'avoir une idée sur ce qu'ils renferment.
a. Le taux de change nominal
Le taux de change nominal est le prix relatif des monnaies de
deux pays. En d'autres termes c'est le nombre d'unités monétaires
que l'on peut obtenir en échange d'une unité d'une autre
monnaie.
Ainsi, lorsque l'on dit que le taux de change entre le dollar
américain et le franc congolais est de 2000 FC par dollar, sa signifie
qu'il est possible de recevoir sur les marchés de change, 2000 FC en
échange d'un dollar. Lorsqu'on parle du taux de change entre deux pays,
on pense généralement au taux de change nominal.
Nous pouvons distinguer deux manières d'exprimer le
taux de change : si un dollar permet d'acquérir 2000 FC, alors 1 FC
s'échangera contre 0,0005 dollar.
C'est ainsi que nous pouvons dire le taux de change est
alternativement de 2000 FC par dollar ou de 0,0005 dollar par franccongolais.
Ces deux manières d'exprimer le taux de change sont strictement
équivalentes.
b. Le taux de change réel
Le taux de change réel est le prix relatif des biens
entre deux pays, c'est-à-dire qu'il exprime les prix relatifs des
produits étrangers par rapport aux produits nationaux exprimés en
monnaie nationale. Il nous dit à quel taux il est possible
d'échanger les biens d'un pays contre les biens d'un autre : quelque
fois il est appelé termes de l'échange.
Pour bien comprendre la relation entre le taux de change
nominal et réel, prenons le cas d'un bien unique que produisent beaucoup
de pays : le ciment.
Supposons qu'un sac de ciment congolais coute 20000FC et un
sac de ciment équivalent américain vaut 20$. Pour comparer les
prix de ces deux sacs de ciment, nous devons les convertir en monnaie commune.
Si 2000 FC vaut 1$, le sac congolais coute 10$, soit la moitié de ce que
coute le sac de ciment américain. En d'autres termes aux prix courants,
il est possible d'échanger deux sacs de ciment congolais contre un seul
sac américain.
Le taux de change réel entre deux pays se calcul
à partir du taux de change nominal et de niveau des prix dans chacun des
pays concernés. Si le taux de change réel est
élevé, les biens étrangers sont relativement bon
marché et les biens intérieurs relativement chers. Si le taux de
change réel est faible, les biens étrangers sont relativement
chers et les biens intérieurs relativement bon marché(GREGORY,
Macroéconomie, Traduction de la 7e Ed. Américaine pour JIHAD C.
EL Naboulsi, 5e Ed. Française, 2010).
1.2.1.5.2. Déterminants du taux de
change
La formation de taux de change est influencée par quelques
facteurs que nous allons illustrer dans ce paragraphe et dont on peut regrouper
en trois.
1. La balance des transactions courantes
:
Si les exportations de biens et de services d'un pays vers la
RDC sont inférieures aux importations de biens et de services ; on a
alors un déficit du solde de la balance des transactions courantes de ce
pays par rapport à la RDC.
Si les exportations sont supérieures aux importations,
si les sorties de dollar sont supérieures aux entrées de franc
congolais, si la demande de franc congolais est plus forte que la demande de
dollar, et enfin si la demande de franc congolais est supérieure
à l'offre de franc congolais alors il y a une hausse du cours de franc
congolais par rapport au dollar.
Baisse du taux de change de dollar par rapport aux francs
congolais, il va falloir plus de dollar pour avoir 1 FC. Ainsi, nous pouvons
conclure qu'une balancecourante excédentaire apprécie le taux de
change et une balance courante déficitaire le déprécie.
2. Différentiel d'inflation :
Il se définit l'écart entre le taux d'inflation
du pays et celui de ses partenaires commerciaux.Si les sorties de franc
congolais sont supérieures aux entrés de dollars, si la demande
de dollars est supérieures à la demande de FC et si la demande de
dollars est supérieure à l'offre de dollars alors il va y avoir
une hausse du cours du $ par rapport aux FC jusqu'à ce que cette hausse
compenses le différentiel d'inflation.
3. Taux d'intérêt :
Leur influence est évidente : si un pays augmente ses
taux d'intérêt, alors les placements qu'il propose deviennent plus
attractifs. Son taux de change va s'apprécier.(Taux de change et
régimes de change, s.d.)
Si l'entrée de dollar est supérieure à la
sortie de FC, si la demande de FC est supérieure à la demande de
dollar et si l'offre de dollar est supérieure à la demande de
dollar, alors il va y avoir une baisse du cours du dollar par rapport
aux FC.
Afin de mieux comprendre les évolutions de
détermination des taux de change, plusieurs approches théoriques
ont été proposées. Nous reteindrons trois théories
:
1.2.2. THEORIE EMPIRIQUES SUR LE TAUX DE CHANGE ET
SUR LE PRIX
Lanotiondutauxdechangeestunthèmeclédel'économiequinecessed'attirerl'attentiondeschercheurs.Ainsi,ledomainedelascience,plusprécisément
celuidelarechercheresteundomaineoùlacomplémentarité,lareformulationetlescritiquessesuccèdent.
Ilnousasembléjudicieuxdechercherdanscettesectionsinotre
préoccupationdelavariationdutauxdechangeetseseffetssurlebien-êtredelapopulationn'auraitpasfaitl'objetd'unautretravail.
Certesquela
questiondelavariationdutauxdechangeaétéaucoeurdesplusieurschercheursquenousallonspasserenrevue.
Parmi ces travaux, nous citons :
1. LepremiertravailestceluideJoseph
JDESAMMALUMBALAdel'universitéWilliamBoothRDC(Licenciéenéconomiemonétaireetinternationalede2010),danssonétudeintitulée:
«l'incidencedutauxdechangesurlaconsommationdesménagesKinoisde1999à2009».
L'objectifdecedernierétaitdechercher
àcomprendreles
comportementsqu'adoptentlesménagesKinoisensituationdesvariationsdetauxdechange.Surce,lechercheurs'étaitposédeuxprincipales
questionsquisont:commentsecomportentlesménagesKinoisensituationdevariationdetauxdechange?Cettevariationdetauxdechangeaffecte-ellelebudgetconsacréauxdépensesdeconsommationdeménagesetàqueldegré?
Ilaréponduanticipativementdecettefaçon:lavariationdetauxdechangeàuneincidencedirectesurlesdifférentesdépensesdesménagesetelleaffectelebudgetconsacréàladépensedeconsommationplusparticulièrement.
Pourvérifierceshypothèses;
lechercheurs'estservid'uncertainnombredeméthodesetdetechniquesquisont:laméthodedescriptiveetlestechniquesdocumentaireetstatistiqueetplusspécialementautroisièmechapitre,ilautilisélaméthodestatistiquederégressionlinéairesimple.Ainsi,plusparticulièrement,lechercheurs'estfocaliséauxménagesKinoisàlasuitedelavariationdetauxdechangedurantlapériodede199à2009.
Après l'étude et l'analyse des données,
il a conclu de la manière : la variation permanente de taux de change
affiche une tendance à la hausse. C'est ainsi qu'une augmentation
permanente de l'offre de monnaie provoque une augmentation du niveau
générale de prix ; a-t-il conclut que toute choses égale
par ailleurs, une augmentation permanente de l'offre de monnaie entraine une
dépréciation proportionnelle de la monnaie par rapport aux
monnaies étrangères.
Ainsi, a-t-il clore que lorsqu'il y a hausse du niveau
générale de prix à la consommation, ceci a pour effet de
diminuer le pouvoir d'achat de ménages sur le marché.
2. Le second est celui de Isidore MURHI MIHIGO de
l'université catholique de BUKAVU (travail de fin de cycle 2010)
intitulé :« Impact de l'évolution du taux de change sur la
vie socio-économique à BUKAVU.
Son objectif était de découvrir les effets de
l'évolution du taux de change dans la ville de BUKAVU et aussi la
compréhension du cours de change et ses implications
économiques.
De ce fait, le chercheur s'est posé la question de
savoir, quel a été l'impact de 1'évolution du cours de
change à BUKAVU pendant la période allant de 2007 à
2009
Son hypothèse était : l'évolution du taux
de change dépendent des anticipations et de préférences de
détention des diverses à place et lieu de la monnaie nationale
aurait des effets néfastes sur la vie socio-économique en
générale, notamment sur le prix des biens et services
commercialisés et consommés dans la ville de BUKAVU si elle n'est
pas contrôlée.
Pour vérifier cette hypothèse, il est
passé par la méthode historique, l'approche analytique,
l'approche comparative, l'approche documentaire et les techniques d'entretien,
d'enquête et d'interview qui lui ont permis d'atteindre l'objectif et de
récolter les données.
Il était arrivé à la conclusion par
laquelle l'évolution des prix des biens et services et
l'évolution du taux de change sont positivement corrélés
du fait que l'une influence l'autre mais de manière proportionnelle.
3. Le troisième travail est celui de LAISI ITONGWA de
l'université de Kinshasa (travail de fin de cycle 2014) intitulé
« Analyse de l'impact du taux de change sur le prix des biens de
consommation en RDC de 2001 à 2014 ».
Dans ce thème de recherche, l'objectif était
celui de déterminer l'impact du taux de change sur le prix des biens de
consommation.
Il s'est posé deux questions pour constituer sa
problématique :
ï Quelle est la cause principale de la stabilité
du taux de change sur le monde des changes ?
ï Dans quelles proportions les taux de change influence-t-il
les prix des biens de consommation en RDC ?
A ces questions, il a répondu de la manière
suivante :
ü Le régime de changes flottants adopté
depuis 2001serait la cause principale de la stabilité du taux sur le
marché des changes ;
ü Le taux de change influencerait les prix des biens de
consommations dans une certaine proportion en RDC.
En vue d'aboutir à des résultats attendus, il a
fait recours à un certain nombre de méthodes et techniques qui
sont : la méthode comparative, la méthode statistique, la
méthode inductive, la méthode déductive, la technique
documentaire et l'intérêt.
Apres études et analyses sur ce thème, le
chercheur est arrivé à la conclusion selon laquelle le taux de
change à des effets sur l'inflation en RDC, mais aussi sur l'inflation
étant donné que l'inflation est la finalité de la hausse
généralisée de prix sur l'ensemble de
l'économie.
Au vu de cette revue théorique et empirique
constituée des trois travaux analysés ci-haut, nous avons tous
analysé sur presque un même thème de recherche :«
L'incidence ou les effets de la variation du taux de change ».Nous avons
constaté un point de démarcation entre ces travaux et
lenôtre ;nous nous sommes bornés sur «L'Impact du taux de
change sur le prix des produits manufacturés importés dans la
ville de Kamina ».Etant donné que les produits de
premières nécessités ont un effet direct sur la vie
humaine.
La principale différence réside en ce que notre
étude se focalise principalement dans la Province du Haut-Lomami et plus
précisément dans la ville de Kamina.
1.2.3. COURANTS DE PENSEESSUR LE TAUX DE CHANGE ET SUR LE
PRIX
L'approche macroéconomique de la détermination
des taux de change consiste à construire des modèles
macroéconomiques (théoriques ou
économétriques) ; à assurer (par la présence
d'effets de richesse et par la spécification des politiques
monétaires et budgétaires) que ces modèles comportent un
long terme bien défini ; à faire l'hypothèse que,
durant la trajectoire, les agents financiers anticipent parfaitement
l'évolution du taux de change. Les modèles décrivent alors
des trajectoires du taux de change, anticipés par les agents, qui
convergent vers leur valeur de long terme (voir Benassy et Sterdyniak, 1992).
À la suite d'un choc, le taux de change effectue un saut non
anticipé par les agents, puis atteint sa nouvelle valeur de long terme
selon une trajectoire parfaitement anticipée. Malgré leur
cohérence, ces modèles n'ont guère de pouvoir
prédictif à court-moyen terme. Les modèles
macroéconomiques de taux de change, estimés sous forme
structurelle ou sous forme réduite, (les modèles
monétaristes à prix flexibles, le modèle de Dornbusch
à prix rigides, les modèles patrimoniaux ou de portefeuille qui
incorporent les stocks d'actifs), ne font pas mieux, hors de leur
période d'estimation, que le modèle de marche aléatoire
qui prédit que le taux de change demain sera le taux de change
d'aujourd'hui. Ce résultat, d'abord mis en évidence par Meese et
Rogoff (1983, 1988) a été confirmé par les études
ultérieures (la plus récente étant celle de Cheung, Chinn
et Garcia Pascual, 2003). Par ailleurs, de nombreuses études ont
montré que les anticipations des marchés (mesurées par les
différences de taux d'intérêt entre devises ou par les
réponses des intervenants à des enquêtes d'opinion) n'ont
aucun pouvoir prédictif.
Face à cet échec, une approche plus modeste se
limite à calculer un taux de change d'équilibre de long terme,
celui qui permet la réalisation simultanée de l'équilibre
interne (taux de chômage d'équilibre) et de l'équilibre
externe (position extérieure nette stable). Cette approche propose aux
marchés financiers un point d'ancrage à partir duquel les agents
peuvent former leurs anticipations. Elle permet d'évaluer l'existence et
l'ampleur de la sur (ou sous) évaluation des monnaies. Elle
définit des parités d'équilibre que les autorités
peuvent utiliser pour élaborer des stratégies de gestion du taux
de change ou de coordination des politiques de change.
Cette approche suppose que les agents considèrent ces
parités comme crédibles et qu'ils anticipent un retour du taux de
change à son niveau d'équilibre. Le premier point peut soulever
de forts doutes dans la mesure où les taux de change ainsi
calculés comportent une forte incertitude (de 10 à 30 %
selon Bayoumi et al., 1994). Le point crucial est cependant celui
de la trajectoire de retour à l'équilibre. Quels sont les
mécanismes qui l'impulsent ? Quels sont les délais
d'ajustement ? La trajectoire est-elle monotone ? Peut-on directement
placer le taux de change à son niveau d'équilibre ?
L'analyse en termes de taux de change d'équilibre ne peut se passer
d'une étude approfondie de la dynamique du taux de change ; plus
l'économie comporte de variables rigides (les prix, les salaires
réels, les stocks d'actifs), plus la dynamique est lente et complexe,
moins il est crédible qu'elle soit anticipée par les
marchés et que les spéculateurs utilisent le niveau de long terme
pour leurs anticipations ; moins le long terme ainsi défini est
utilisable par les pouvoirs publics pour guider leur stratégies de
change.
1. Les théories classiques de la monnaie :
L'absence de la notion du taux de change Par
définition, l'approche classique repose principalement sur la
conservation paradigmatique de la loi de J.B Say de débouchés
pour justifier son caractère dichotomique de la sphère
réelle à la sphère financière qui doivent
être étudiées séparément.
Lors de cette première partie on va aborder les
théories classiques de la monnaie en signalant que celles-ci ont
été apparues dans un contexte de l'étalon-or,
c'est-à-dire une fixité du taux de change, ce qui signifie
l'absence de celui-ci dans leurs analyses, commençant par les apports de
David Hume puis ceux de J.S Mill et en fin David Ricardo comme étant les
économistes classiques les plus connus dans ce domaine.
1.2. J.B Say : le rôle de la monnaie dans
les échanges
La théorie de la monnaie de Say découle de sa
théorie de valeur, en fait, la demande et l'offre qui déterminent
les prix que la valeur de la monnaie, ces précisions approfondies de Say
lui permettre de se rapprocher avec celles de Ricardo pour formuler la nouvelle
version de la théorie quantitative de la monnaie.
D'ailleurs, l'influence de Say3 sur la question
monétaire apparaît moins profonde et prit parfois des aspects
étranges ; il définit la monnaie comme une réserve de
valeur, car la vente d'un produit n'est pas immédiatement suivie par un
achat. Par conséquent, l'origine de la valeur d'un objet, c'est son
utilité, la monnaie inspire sa valeur à son rôle
d'intermédiation dans les échanges, pour cela on peut fabriquer
la monnaie à partir des matières qui n'ont pas aucune valeur
elles-mêmes (feuilles, papiers...).
La valeur de la monnaie diminue proportionnellement à
l'augmentation de sa quantité. Si au contraire, la production de biens
d'un pays augmente, la demande de monnaie se développe et les prix
diminuent. Say semble appuyer implicitement ses arguments sur l'équation
des transactions [Alain Béraud et Théma]. Or, Say va plus loin et
estime que l'émission de la monnaie à partir d'ex-nihilo,
pourrait être l'origine des crises. En fin, il est incontestablement que
les économistes et les historiens sous-estiment la participation de Say
dans la théorie monétaire. Celui-ci s'inspire beaucoup de
l'enseignement d'Adam Smith et David Ricardo.
1.3. David Ricardo : le cadre institutionnel de la
politique monétaire
Selon David Ricardo la composition de la monnaie doit se
concentrer spécifiquement sur les billets convertibles en lingots, cette
émission devrait être faite par cinq commissaires publics
responsables devant le parlement, indépendants vis-à-vis les
autorités publiques. Ces derniers ne donnent pas de la monnaie au
gouvernement, en cas de besoin de monnaie de la part du gouvernement le seul
moyen pour satisfaire ce besoin passe soit par l'impôt, soit par
l'émission des titres publics, ou en empruntant aux banques du pays.
Au fond, Ricardo néglige aucune existence
d'hiérarchisation du système bancaire5 , en effet la banque dans
laquelle prévoit Ricardo ne prête pas à autres banques et
elle ne les refinance pas, ajoutons à cela l'absence d'un marché
interbancaire.
En fin David Ricardo demeure l'un des pionniers de la
politique monétaire via sa théorie quantitative de la monnaie et
ses propositions pour réformer la banque de l'Angleterre en 1844. Il
souhaite rendre national l'émission des billets par la création
d'une banque nationale publique pour assurer la stabilité de la valeur
de la monnaie. Selon lui cette banque pourrait avoir une politique active.
Nous sommes parvenues à démontrer les apports de
la théorie classiques par rapport les questions monétaires
commençant par David Hume, Ricardo, J.B. Say et autres. Cependant un
point reste un élément perturbateur de cette théorie
classique, c'est l'absence de l'intégration de la monnaie dans le tissu
productif de l'économie réelle, comme étant une voile des
échanges et un séisme des prix dans le cadre conceptuel de
l'équilibre.
2. Approches réelles du taux de change
L'importance de ces approches réelles est de permettre
de mesurer le taux de change théorique (le taux de change PPA
d'équilibre) vers lequel il faudrait normalement converger la valeur du
taux de change observé.
3. Les approches financières et
monétaires du taux de change
Parmi les limites fondamentales des théories
réelles des taux de changes est que celles-ci négligent, ou tout
le moins sous-estiment, la fonction des facteurs financiers en tant que
principaux déterminants des mouvements des taux de changes. Il est vrai
que la majorité de ces théories fondées sur les
échanges des biens et services ont été
évolué dans une période où les flux financiers
internationaux étaient encore peu importants et très
réglementés. Aujourd'hui, les transactions financières
induisent à un volume d'échanges de devises très important
que les opérations courantes. En fait, le volume annuel des
échanges de biens et services est de 20000 milliards de dollars par an,
tandis que, celui-ci des devises atteint les 530013 milliards de dollars par
jours. Cependant, l'analyse des déterminants financiers des taux de
change s'articule autour deux théories principales : Les analyses qui
mettent en relief l'impact des variables monétaires et
financières. Puis, Les analyses qui montrent la volatilité des
taux de changes.
3.1. Les explications théoriques de la
volatilité du taux de change
Les économistes focalisent leurs travaux sur deux
catégories de modèles pour expliquer la volatilité du taux
de change après la remise en cause de système de Breton Woods, la
première délimite son champ d'application sur le modèle de
« sur-réaction » des changes. Tandis que le deuxième
modèle met l'accent sur le rôle primordial des indices
psychologiques et des anticipations pour cerner les sources des bulles
spéculatives.
3.2.1. La théorie de la sur-réaction
des taux de change.
Cette théorie présentée pour la
première fois par Dornbusch en 1976, en effet, son axe principal repose
sur l'idée que la volatilité du taux de change peut expliquer par
les différences entre les vitesses d'ajustement sur les marchés
financiers ou réels. En fait, Dornbusch, fait l'hypothèse que les
prix des marchés financiers s'ajustent immédiatement aux
variations de l'offre et de la demande, tandis que les prix des biens et
services sont rigides à court terme. Ce déséquilibre peut
être à l'origine de sur-ajustement16. A court terme, ce sont les
flux des capitaux qui dominent le marché des changes et
l'équilibre de celui-ci suppose le remplissage de la condition de PTI :
le gap du taux d'intérêt entre deux monnaies est égal au
taux anticipé de dépréciation du taux de change. Les
prévisions de change sont basées sur la PPA et ramènent
donc le taux de change vers son niveau d'équilibre.
Il y ainsi sur-réaction (overshooting) du taux de
change, au sens où le mouvement immédiat du change est trop fort
et doit être compensé par la suite. En effet, dans un second
temps, à la suite de la dépréciation initiale de la
monnaie, les échanges de biens et services réagissent par une
amélioration de la balance courante qui amène une
appréciation de la monnaie jusqu'à ce que la norme de PPA soit
à nouveau respectée [Dominique P, 2010].
En général, malgré l'importance de ce
modèle dans une période très déstabilisante
marquée par la fin des années de « les trente glorieuses
» et la remise en cause du système de Breton Woods, ceci n'a pas pu
expliquer la surévaluation durable des devises internationales
(notamment le billet vert) entre 1980 et 1985. Pourtant, la théorie des
bulles spéculatives a été évoluée pour
approfondir davantage le rôle des anticipations du taux de change
réel et son évolution.
3.2.2. La théorie des bulles
spéculatives rationnelles :
La surévaluation du dollar à partir des
années 1980 et également le krach boursier de 1987 ont
constitué le point de départ d'un nouveau paradigme de
l'instabilité. En effet, l'idée de commencement s'est
focalisée sur l'existence des écarts durables entre la valeur du
taux de change et la valeur d'équilibre de ses fondamentaux (taux
d'intérêt, inflation,...), cette différence on l'appelle
« bulle spéculative17 » car il tend à se gonfler. Par
définition, Cette théorie rejette l'hypothèse de
rationalité dans les anticipations des investisseurs et remet en
question la notion de symétrie de l'information.
Pourtant, il y en a deux courants en concurrence substantielle
entre eux, d'une part le fondateur de la micro-économie Léon
Walras qui s'est inspiré d'une théorie basée sur trois
postulats : l'homogénéité des comportements,
l'équilibre général et l'anticipation rationnelle. D'autre
part, on trouve l'Ecole du père fondateur de la macro-économie
moderne ; c'est l'approche keynésienne qui introduit les comportements
mimétiques et met en avant,
l'hétérogénéité des opérateurs et
leurs interactions, Celle-ci apparaît plus séduisante parce
qu'elle fournit un soubassement plus adapté au fonctionnement effectif
des marchés, et semble plus claire pour expliquer la psychologie des
différents intervenants dans le marché. Au sens de Krugman «
le marché n'a pas bien fait ses comptes », c'est-à-dire les
opérateurs du marché n'ont pas exploité l'information
totale disponible sur le caractère « insoutenable » de
l'appréciation continue de la monnaie, en l'occurrence, avec le
renforcement des déficits « jumeaux » (budgétaires et
extérieurs) des Etats, ce qui a produit, une série de crises de
changes et par là, l'apparition de nouveaux modèles pour
l'expliquer.
4. Les approches macroéconomiques du taux
de change
L'anticipation du processus de l'évolution du taux de
change demeure une source de fragilité dans l'analyse
macroéconomique. Malgré sa cohérence en théorie,
les modèles empiriques de la macroéconomie échouent
évidement à faire mieux que la marche au hasard. Les
prévisions des marchés n'ont aucun pouvoir prédictif.
Cette partie discutera les théories du taux de change
réel d'équilibre (FEER, DEER, BEER et NATREX). En fait,
l'hypothèse de Williamson18 (1985) a connu une très grande
victoire et a beaucoup pesé dans les accords de Louvre en 1987 du G7. En
général, nous avons trois principales approches dont l'approche
macroéconomique (FEER, DEER), l'approche économétrique
(BEER) et l'approche dynamique (NATREX).
CHAPITRE DEUXIEME : CADRE METHODOLOGIQUE DE LA
RECHERCHE
Dans ce chapitre, il s'agit d'énoncer et de
décrire la méthode et les techniques utilisées dans la
collecte des informations que pour leur analyse. Ces techniques et
méthodes combinées et empruntées en économie vont
nous servir pour la réalisation de notre étude.
Surtout dans la deuxième et troisième partie,
ils nous seront utiles dans deux phases à savoir :
· La phase de récolte de données sur
terrain ;
· La phase d'analyse de données recueillies
auprès des chercheurs.
Nous avons recouru aux techniques documentaires et d'interview
étant comme le moyen permettant d'atteindre un but, pour récolter
les données.
II.1. LE MODELE D'APPRECIATION DU TAUX DE
CHANGE
3.1. Les modèles de change fondés
sur les variables financières :
A partir des années 1970, une nouvelle
génération des modèles de détermination du taux de
change a été apparue pour essayer de justifier les nouvelles
mutations du système monétaire international en
conséquence du flottement généralisé qui
commençait à se manifester à l'égard des
modèles néo-keynésiens.
3.1.1. L'approche monétaire des taux de
changes :
La théorie monétaire du change qui a
été développé par Fränkel (1976) s'inscrit
dans le contexte d'un régime de changes flexibles dont elle cherche
à prouver sa supériorité sur celui des changes fixes qui
viennent d'être abandonnée.
En fait, le commencement du courant monétariste est
basé sur la demande de monnaie, en tant qu'une relation
macroéconomique très solide et plus stable. Cette formule
dépend d'une manière classique du revenu, des prix et des taux
d'intérêt ;
(1) M = P.L (y, i)
(2) M* = P*. L (y*, i*)
Puisque :
M et M* : les stocks de monnaie nationale et
étrangère ; P et P* représentent les niveaux
généraux des prix nationaux et étrangers ; Y et y*
représentent le revenu national et étranger ; i et i* sont les
taux d'intérêt réels interne et externe.
Les formules (1) et (2) prouvent l'équilibre sur les
marchés monétaires national et international à partir des
stocks de monnaies offerts (M et M*) contrôlés par la banque
centrale, du niveau des prix (P et P*) supposés flexibles et des
fonctions du revenu et des taux d'intérêt supposés
semblables dans les différents pays pour simplifier.
Le taux de change est introduit dans ce modèle en
revenant à la PPA, ce qui donne :
(3) P = E.P* [E est le taux de change (cotation à
l'incertain14)]
1. La théorie de la parité des
pouvoir d'achats (PPA)
La théorie de la parité des pouvoirs d'achats
définit que les variations de taux de change reflètent les
changements de prix relatifs entre deux pays, Cette théorie,
énoncée pour la première fois par RICARDO, puis
développée par CASSEL (PEYRARD j, 1986).
Le pouvoir d'achat de la monnaie c'est une unité
monétaire qu'on peut fournir pour avoir une quantité des biens et
services.
Donc la théorie de pouvoir d'achat indique une baisse
de pouvoir d'achat par rapport à la monnaie local qui se traduit par une
augmentation de la monnaie nationale et une dépréciation
proportionnelle de la monnaie sur un marché de change. L'approche de la
parité des pouvoir d'achats présente deux versions :
· Version « absolue » postule que le pouvoir
d'achat d'une monnaie nationale est identique sur le marché
intérieur et à l'étranger. Cette version implique :
S= P / P*
S : taux de change ;
P : niveau des prix domestiques ;
P* : niveau des prix étrangers.
On peut remarquer que les prix nationaux exprimés en
monnaie étrangère pouvant s'exprimer sous la forme P = SP*. De
même, les prix étrangers exprimés en monnaie nationale
(prix à l'importation) s'écrivent : P* =P/S.
La version absolue de la PPA, en terme nominaux, réduit
donc le taux de change à un simple rapport entre les deux indices de
prix des pays considérés. (DRUNAT.J, 1994)
En terme réels, le taux de change se définit
comme le rapport entre deux pouvoirs d'achat c'est-à-dire, S =SP*/P.
Ainsi, le taux de change réel dans la version absolue
de la PPA est égal à l'unité (s = ((P/P*) P) / P = 1).
· Version « relative » est moins restrictive
que la version absolue. En effet, il n'est plus nécessaire que le taux
de change soit égal au rapport des indices de prix mais simplement qu'il
enregistre les mêmes variations.
La PPA relative c'est l'évolution des prix et des taux
de change qui acceptant de protéger le rapport entre le pouvoir d'achat
de la monnaie nationale par rapport a la monnaie d'un autre pays
étranger. Donc la version relative implique :
S= P - P*
S : variation relative du taux de change ;
P et P*: variation relatives des prix domestiques et
étrangers.
· Les critiques à la théorie de la PPA
Trois critiques sont formulées contre cette
théorie
La loi du prix unique ne peut pas être
vérifiée approximativement Si la PPA ni pas confirmée sur
les marchés, mais malgré la loi de prix unique n'est pas
vérifier, les prix et le taux de change ne s'éloigne pas au PPA.
La réclamation sur l'invariance des prix relatifs est
nécessaire pour que la parité de pouvoir d'achat relative se
vérifie.
Les devises n'étaient pas recherché pour un
pouvoir d'achat mais de transférer les fonds ou les moyens de
spéculation. Le taux de change est déterminé par le niveau
des prix national par rapport aux prix étrangers. Ces niveaux
indépendants de taux de change.
3.1.2. Milton Friedman et sa défense du
flottement pur de la monnaie :
En 1953 M. Friedman avait publié un article qui reste
jusqu'aujourd'hui un cadre référentiel en matière du
flottement de monnaie, dans lequel cet économiste américain qui
est au même temps le chef de l'école monétariste a
défendu avec véhémence l'adoption d'un régime du
flottement pur comme étant le seul moyen qui pourrait réaliser
l'objectif d'une économie mondiale libre et prospère.
L'essence de cette théorie trouve ses fondements dans
la théorie monétariste, à laquelle suggère que les
prix doivent être flexibles et, surtout, les trois prix basiques de
l'économie : taux de change, taux d'intérêt et salaires, de
manière à ce que les ajustements du marché conduisent
à une économie d'équilibres internes et externes. Selon
l'optique d'un certain pays, étant donné que les prix et les
salaires à l'extérieur ne seront pas suffisamment flexibles. Il
est nécessaire que le taux de change le soit, afin que se réalise
les ajustements des chocs, qu'ils soient réels ou monétaires
[Bruno Martarello De Conti et al, 2007]. Dans ce cas, fixer artificiellement le
taux de change n'éliminerait pas les causes de cette instabilité
et, bien au contraire, augmenterait la volatilité des autres variables
économiques. En fait, Le passage vers plus de flexibilité est
considéré comme une étape primordiale pour la constitution
d'une économie mature puisque, comme on l'a vu
précédemment avec Friedman, un régime de change flexible
serait capable de protéger les pays contre des chocs externes et
d'augmenter l'indépendance de la politique monétaire.
Malgré tout ça et bien d'autres, les partisans
du système flexible annoncent que, pour que, les gains de ceci se
réalisent, il faudrait remplir un certain nombre de conditions, à
savoir l'existence d'un marché de change suffisamment liquide et
efficace. Dans les années 1990, il y avait plusieurs travaux empiriques
qui ont essayé d'expliquer la relation (4) pour un grand nombre de pays,
en l'occurrence par Baillie et McMahon qui ont démontré que ces
vérifications empiriques se sont révélées
décevantes, en se basant sur l'instabilité de la fonction de la
demande de monnaie. La vérité évidente est que la tendance
en faveur du système de change flexible est une conséquence
inévitable de l'accroissement de la circulation du capital international
[EICHENGREEN, 2000].
Ainsi, le marché des changes semble efficient d'un
point de vue spéculatif à court terme alors qu'à
moyen/long termes, c'est l'efficience macroéconomique qui semble
prévaloir sur un tel marché [Antoine Bouveret et Gabriele, 2009].
En outre, ces modèles occupaient une place pertinente
dans son début, mais de plus en plus et avec l'évolution qu'a
connu le monde de la finance ceux-ci ont marqué beaucoup de
défaillances, chose qui nécessite l'émergence de nouveaux
modèles à savoir ceux de la volatilité du taux de
change.
III.2. PRESENTATION ET ESTIMATION DU PARAMETRE DU MODELE
ECONOMETRIQUE
Les variables qui doivent être utilisées sont
déterminés ; Soit par des études déjà
existantes qui peuvent fournir aussi des variables additionnelles ; ou
encore par l'information instituée spécialement pour
répondre à un besoin.
C'est pourquoi nous allons prendre en compte seulement les
variables le plus pertinentes, les moins importantes non inclure dans le
modèle. Le modèle qui va nous servir se présente de la
manière suivante :
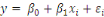
Ce modèle signifie simplement que :
 è
è  = Variable expliquée ou dépendante représentant la
ième observation faite sur les prix de certains produits
manufacturés dans la ville de Kamina.
= Variable expliquée ou dépendante représentant la
ième observation faite sur les prix de certains produits
manufacturés dans la ville de Kamina.
è i = La première
ièmeobservation faite sur la variation
considérée
 è
è  = Paramètres ou estimateurs du modèle
= Paramètres ou estimateurs du modèle
 è
è  = Variable explicative représentant la ième
observation sur le taux de change
= Variable explicative représentant la ième
observation sur le taux de change
 è
è  = Le terme d'erreur.
= Le terme d'erreur.
Sachant que le taux de change a un lien étroit avec le
prix des produits manufacturés, conformément à la
théorique économique le résultat attendu de notre
modèle est 
 0.
0.
Pour ce qui est du modèle, l'estimateur fonction d'une
variable aléatoire, 
 est lui-même une variable aléatoire et par allusion
à la méthode de moindre carré ordinaire, nos estimateurs
se présentent sous la formule ci-après :
est lui-même une variable aléatoire et par allusion
à la méthode de moindre carré ordinaire, nos estimateurs
se présentent sous la formule ci-après :
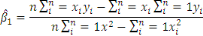
II.2.1. VERIFICATION DU MODELE DANS SON ENSEMBLE
(R²)
Pour tester les hypothèses, nous allons suivre la
démarche suivante
* Calculer le coefficient de déterminant R² sous
la formule suivante :

* Tester le modèle globalement (test de Fisher). Le
teste de ficher est basé sur le coefficient de déterminent pour
connaitre si le modèle élaboré a une signification.
H0 :R² = 0 : Le modèle est
non significatif, c'est-à-dire il y a au moins une variable qui
explique le modèle.
H1 :R² ? 0 : Le modèle est
significatif, c'est-à-dire il y a au moins une variable qui explique le
modèle. Ainsi :
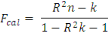

* Tester le modèle individuellement (test de student)
sous ces formules.


 )
)
CHAP. III : IMPLICATION DE TAUX DE CHANGE DANS SON
EVOLUTION DU PRIX DE PRODUITS MANUFACTURES IMPORTES DANS LA VILLE DE
KAMINA
II.1. DEFINITION DU PROBLEME
L'économie de la République Démocratique
du Congo (RDC) est extravertie, c'est-à-dire son économie est
tournée vers l'extérieur.
C'est ainsi que analyser l'impact du taux de changer sur les
prix des biens de consommation produit localement serait injuste aussi
longtemps que le pays reçoive au jour les jours les biens en provenance
de l'étranger.
La proportion de la variation des produits manufacturés
sur le marché est donc conditionnée par les variations du taux de
change.
Ainsi si le taux de change d'un pays donné est faible
et que donc, les biens qu'il produit sont relativement bon marché, les
résidents de ce pays achèteront peu de biens et services à
l'étranger, au contraire des résidents des autres pays, pour la
même raison. Les exportations nettes de ce pays seront donc
élevées.
Un taux faible est synonyme de l'appréciation
monétaire. C'est l'inverse qui se passe lorsque le taux de change est
élevé rendant élevé aussi le prix des biens
intérieurs par rapport à celui des biens étrangers.
Dans ce cas, les résidents du pays concerné
achètent de nombreux biens importés, alors que les autres pays ne
lui achètent que peu des biens et services, ses exportations nettes sont
faibles.
En effet, la variation du taux de change sur les prix des
produits manufacturés dans la ville de Kamina a des conséquences
selon que le taux de change se dépréciés ou
s'appréciés.
Dans le cas de la dépréciation de la monnaie
nationale c'est-à-dire qu'il y a hausse du taux de change, les prix des
produits manufacturés se trouvant sur le territoire national ou dans la
ville de Kamina vont sans doute augmenter.
III.2. PRESENTATION DES DONNEES
Après la démonstration par des notions
théoriques, nous allons enfin procéder par une
démonstration pratique sur base des données
récoltées.
Tableau N°1 : Présentation des données
sur base d'un produit qui est le sucre.
|
ANNEE
|
Y
|
X
|
|
2011
|
51500
|
910
|
|
2012
|
5500
|
915
|
|
2013
|
67000
|
925,5
|
|
2014
|
65000
|
924
|
|
2015
|
65800
|
928
|
|
2016
|
115000
|
1216
|
|
2017
|
135000
|
1596
|
|
2018
|
150000
|
1636
|
|
2019
|
152000
|
1650
|
|
2020
|
154000
|
2031
|
Y :Le prix en francs
X :Taux de change
Tableau N°2 :Evolution du taux
de change sur les produits manufacturés importés en dollar
américain.
|
PRODUIT MANUFACTURE
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Bidon OKI
|
29,85$
|
28,99$
|
29,05$
|
|
OEuf (Plateau)
|
4,48$
|
4,64$
|
4,19$
|
|
Carton Thomson
|
47,76$
|
49,28$
|
44,31$
|
|
Sac de sucre
|
53,73$
|
55,07$
|
49,24$
|
|
Sac Sel
|
10,75$
|
55,07$
|
20,68$
|
Source : Elaboré par nous-même sur base des
données récoltées
Le tableau 2 qui parle sur l'évolution des prix des
biens et services à Kamina montre comment ces derniers ont
évolué pendant toute la période de notre investigation,
soit de 2018 - 2020.
Nous voyons une hausse des produits manufacturés
importés sur le marché variés comme suit, le Bidon Oki est
passé de 38 000Fc à 50 000Fc soit une hausse de prix
de 40%de 2017 à 2018.
Signalons la hausse du prix d'un plateau d'oeufs qui est
passé de 7500Fc à 8500Fc de 2018 à 2020, soit 11% de la
hausse de prix par rapport au prix de 2018. Par la suite, nous voyons le carton
de Thomson qui est passé au prix de 80000Fc à 90000Fc entre 2018
et 2020, soit une variation de 11,1% de prix par rapport à
l'année 2018.
Nous avons constatés la hausse du prix du sac de
sucré passé de 45000Fc à 90 000Fc, soit 50% du prix
par rapport à la période de 2017 et 2020. Enfin, le prix d'un sac
de sucre est passé de 45000Fc à 90000, soit 50% du prix
comparativement aux années 2017-2020.
III.4. TRAITEMENT DES DONNEES
1. ANALYSE DE CORRELATION
Ce test va nous faciliter de vérifier s'il y a
corrélationentre la variable expliquée et la variable
explicative.
Tableau N°3 : Analyse de
corrélation
|
Y
|
X
|
|
Y
|
1
|
0.61804
|
|
X
|
0.61804
|
1
|
Source : Traitement sur Eview sur base des
données du tableau N°1.
Par rapport aux données de ce tableau, nous constatons
que la variable explicative (Taux de change) est fortement
corrélée avec la variable expliquée (prix de produits
manufacturés importés) car la valeur de corrélation est
supérieure à 0 et est proche de 1 soit 0,61804.
2. MESURE D'ADEQUATION
Cette mesure par un rapport, nous permet de vérifier la
convenance parfaite du modèle.
Tableau N°4 :Mesure de
l'adéquation du modèle
|
Statistiques de la régression
|
|
Coefficient de détermination multiple
|
0,90140043
|
|
Coefficient de détermination  
|
0,81252273
|
|
Coefficient de détermination  
|
0,78908808
|
|
Erreur-type
|
192,274447
|
|
Observations
|
10
|
Source : Traitement avec l'application Eview, sur
base des données du tableau N°1.
Ce tableau d'adéquation qui analyse notre modèle
révèle que le coefficient de déterminationR² est
0,81252273soit 0,81, qui n'est pas proche de 1 ; et le coefficient de
détermination ajusté 
 est de 0,78908808 soit 0,78 qui est une valeur supérieur
à 0, ce niveau nous devrions déduire que notre modèleest
adéquat parce que les signes des coefficientsestimés sont tel que
repris dans l'hypothèse dans notre modèle avec un seul produit
manufacturé qui est le sucre. Ainsi, nous concluons que notre
modèle est adéquat avec 10 comme n ; taille de
l'échantillon ou le nombre d'observations.
est de 0,78908808 soit 0,78 qui est une valeur supérieur
à 0, ce niveau nous devrions déduire que notre modèleest
adéquat parce que les signes des coefficientsestimés sont tel que
repris dans l'hypothèse dans notre modèle avec un seul produit
manufacturé qui est le sucre. Ainsi, nous concluons que notre
modèle est adéquat avec 10 comme n ; taille de
l'échantillon ou le nombre d'observations.
3. ANALYSE DE LA VARIANCE ET DE LA SIGNIFICATIVITE DU
MODELE
3.1. ANALYSE DE LA VARIANCE
Tableau N°4 : ANALYSE DE LA
VARIANCE ET DE LA SIGNIFICATIVITE DU MODELE
|
Y
|
X
|
|
Y
|
2572558000
|
12450680
|
|
X
|
12450680
|
157755.5025
|
|
|
Degré de liberté
|
Somme des carrés
|
Moyenne des carrés
|
F
|
Valeur critique de F
|
|
Régression
|
1
|
1281799,322
|
1281799,322
|
34,6718406
|
0,000366559
|
|
Résidus
|
8
|
295755,7028
|
36969,46285
|
|
|
|
Total
|
9
|
1577555,025
|
|
|
|
Le tableau 4, relatif à l'analyse de la variance
(ANOVA : Analysis Of Variance) et de la significativité du
modèle, présente dans la colonne de degré de
liberté : le nombre des paramètres (k) moins un ou (k-1) qui
est égal à 1, les observations (n) moins les paramètres
(k) ou (n-k) qui est égal à 8 dont le total égal à
9 soit (n-1) ; dans la colonne de somme des carrés : la somme
des carrés des résidus (SCR) qui équivaut à
295755,7028 dans le tableau, la somme des carrés expliquées (SCE)
avec pour valeur 1281799,322 et la sommes de SCE et SCR qui est la somme des
carrés totale (SCT) qui a pour valeur 1577555,025; dans la colonne
moyenne des carrés 
 avec pour valeur 1281799,322 et
avec pour valeur 1281799,322 et 
 avec pour valeur 202799805; F est le ratio du test Fisher qui est de
36969,46285; la valeurs critique de F égale à 0,000366559 le
point de la courbe de la distribution de la statistique F de test sous
l'hypothèse nulle qui définit un ensemble de valeurs pour
lesquelles l'hypothèse nulle doit être rejetée ;
généralement cette valeur a toujours été
comparée à un seuil de 5% soit 0,05 et si la valeur critique de F
est inférieure à ce seuil ; comme dans notre cas, cela
traduit la significativité de notre modèle.
avec pour valeur 202799805; F est le ratio du test Fisher qui est de
36969,46285; la valeurs critique de F égale à 0,000366559 le
point de la courbe de la distribution de la statistique F de test sous
l'hypothèse nulle qui définit un ensemble de valeurs pour
lesquelles l'hypothèse nulle doit être rejetée ;
généralement cette valeur a toujours été
comparée à un seuil de 5% soit 0,05 et si la valeur critique de F
est inférieure à ce seuil ; comme dans notre cas, cela
traduit la significativité de notre modèle.
Après la lecture de ce tableau nous allons passer
à l'interprétation même du tableau d'ANOVA (Analysis of
Variance), nous allons considérer la valeur de F, ce dernier est un
ratio qui détermine la significativité d'un modèle, c'est
aussi une mesure de la performance du modèle.
Pour nous permettre de valider notre hypothèse, nous
passons au test ci-après :
Test d'hypothèses : sachant que 


 Le modèle n'est pas significatif ou encore le modèle
n'est pas performant
Le modèle n'est pas significatif ou encore le modèle
n'est pas performant

 Le modèle est significatif ou encore le modèle est
performant
Le modèle est significatif ou encore le modèle est
performant
Si 
 : on rejette
: on rejette 
 et on accepte
et on accepte 

F (test F calculé) et F* (test F théorique cfr
table statistique)

 Et
Et 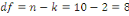
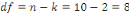 au dénominateur et
au dénominateur et

 Au numérateur
Au numérateur
Ainsi 
 soit
soit
 , au seuil de 5%,
, au seuil de 5%, 
 4,33
4,33
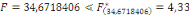
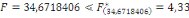 : On rejette
: On rejette 
 et on accepte
et on accepte
 , ainsi notre modèle n'est pas significatif et n'est pas
performant.
, ainsi notre modèle n'est pas significatif et n'est pas
performant.
4. ANALYSE DE LA SIGNIFICATIVITE DES
COEFFICIENTS
Tableau N°5 : ANALYSE DE LA SIGNIFICATION DES
COEFFICIENTS
|
|
Coefficients
|
Erreur-type
|
Statistique t
|
Probabilité
|
|
Constante
|
573,642089
|
133,4525742
|
4,298471517
|
0,00262117
|
|
Variable X 1
|
0,007280474
|
0,001236435
|
5,888279934
|
0,00036656
|
Le tableau 5, nous montre les valeurs des paramètres
estimés dans la deuxième colonne d'où, nous pouvons
réécrire notre équation de la manière
suivante :

Cette équation nous montre que les paramètres
estimés 
 et est de0,007280474; quant à la statistique t :
et est de0,007280474; quant à la statistique t :
Test d'hypothèses
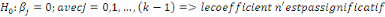
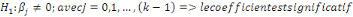
Le test statistique : 
 et
et 
 ces tests sont donnés dans le tableau ci haut dans la colonne
quatre.
ces tests sont donnés dans le tableau ci haut dans la colonne
quatre.
Si 
 où t* est la valeur critique de la table de Student pour un
risque fixé et un nombre de degré de liberté égal
à (n-k) soit 10
où t* est la valeur critique de la table de Student pour un
risque fixé et un nombre de degré de liberté égal
à (n-k) soit 10


 On rejette
On rejette 
 et on accepte
et on accepte 
 : le coefficient est significativement différent de zéro
et la variable joue un rôle explicatif dans le modèle.
: le coefficient est significativement différent de zéro
et la variable joue un rôle explicatif dans le modèle.
Ainsi au seuil de 5% tous les coefficients 
 sont significativement différents de zéro et la variable
crédits octroyé joue un rôle explicatif dans le
modèle.
sont significativement différents de zéro et la variable
crédits octroyé joue un rôle explicatif dans le
modèle.
En ce qui concerne la dispersion des coefficients autour de
leur moyenne, la constante
 est plus dispersée contrairement à
est plus dispersée contrairement à
 ,leurs valeurs sont respectivement de 573,642089et 0,007280474
,leurs valeurs sont respectivement de 573,642089et 0,007280474
D'où la variable explicative a la valeur
resserrée qui se rapproche de leur moyenne, autrement leur valeur tend
vers leur moyenne.
III.5. IMPACT DU TAUX DE CHANGE SUR LE PRIX DES
PRODUITS MANUFACTURES IMPORTES
Dance ce paragraphe, nous allons présenter d'une
analyse objective qui explique réellement impact du taux de change sur
le prix des produits manufactures importes dans la ville de Kamina et cela en
comparaison avec les données présentées ci-haut dans
différents tableaux.
De ce fait, nous réalisons que le taux de change est un
élément principal servant de référence dans la
fixation de prix de produits manufacturés importés dans la Ville
de Kamina. Ce dernier, permet à l'offreur ou vendeur d'avoir une vision
nette du gain attendu car, étant donné que c'est le
bénéfice qui permet à un opérateur
économique de survivre, il est donc indispensable que l'offreur puisse
s'attendre à un bénéfice.
Ainsi d'une manière claire et précise, la
présentation des données de tableaux N°1 et N°2
ci-dessus expliquent d'une manière concrète et prouvent l'impact
qu'a le taux de change sur le prix des produits manufacturés
importés dans la Ville de Kamina. Nous voyons que le tableau N°2
nous présente les différents taux de change et les
différents prix des produits manufacturés se trouvant dans la
Ville de Kamina qui évoluent de manière globale de façon
ascendante chaque année. Brièvement, le tableau N°2 nous a
démontré que lorsque le taux de change augment ce dernier impact
directement et positivement sur les prix des produits manufacturés
importés.
Par rapport à cette expérience, passons à
l'étape suivante afin de donner suggérer et de donner quelques
recommandations.
III.4. RECOMMANDATIONS
Après avoir fait une profonde étude sur l'impact
du taux de change sur le prix de produits manufacturés, nous avons
constaté ce qui suit :
- Manque d'investissement ou des investisseurs ;
- La fixation du taux de change qui ne suit pas la conjoncture
économique du pays ;
- Faible niveaux de production de biens et services sur le
territoire national.
Ainsi, sur base des problèmes rencontrés dans
tout au long de notre sujet, nous faisons les recommandations suivantes :
Premièrement à l'Etat congolais de mettre en
place un plan de relance économique visant à accroitre d'une
manière considérable les exportations et à limiter les
importations qu'aux produits manufacturés, et d'accorder l'autonomie et
l'indépendance à la Banque Centrale du Congo.
Que l'Etat intervient avec sa politique monétaire en
investissant ses moyens dans différents secteurs de production de
monnaie à couvrir ou à diminuer les importations ;
Par la suite, la Banque Centrale du Congo doit procéder
à desmeilleuresanticipations en créant des réserves en
devise pouvantcouvrir les fluctuations du taux de change de manière
à prévenir la hausse des prix sur les produits
manufacturés.
La BCC doit nécessairement établir les
mécanismes liés à la surveillance de la variation du taux
de change pour éviter la dépréciation du franc congolais
face au dollar américain.
Que le gouvernement puisse établir certaines sanctions
contre toute personne fixant d'une manière illicite le taux de change
pour les détenteurs des dollars et surtout les cambistes.
Pour terminer, nous recommandons aux ménages congolais
et plus particulièrement à ceux de la ville de Kamina d'accorder
leur confiance à la monnaie nationale.
CONCLUSION
Qui commence bien, finit bien, disent les français.
Nous voici arrivé à la fin de notre Travail de Fin de Cycle dont
le sujet est « Impact du taux de change sur le prix des produits
manufacturés importés dans la ville de Kamina ».
Travail mené en une période allant de 2018
à 2020, soit une période trois ans. Nous pouvons conclure sur ces
réflexions que, dans la situation actuelle, il est important que le
problèmelié au taux de change soit une affaire de tous, de la
base au sommet car ce dernier affecte directement toute consommation d'un
produit manufacturé importé.
Pour parvenir à mieux comprendre la question
liée au taux de change, nous avons procédé à une
problématique qui était celle de savoir :
o Y-a-t-ils les causalités qui soient à la base
de la variation du taux de change dans la ville de Kamina ?
o Les conséquences liées à la variation
du taux de change qui impactent sur les produits manufacturés
importés dans la Ville de Kamina, sont-elles négative ou
positives ?
Nos hypothèses ont été formulées
de la manière suivante :
Pour ce qui est d'une causalité à la base de la
variation du taux de change dans la ville de Kamina. Il est évident que
les causes sont multiples mais nous allons simplement essayer de nous
étaler sur les plus pertinents.
En ce qui concerne notre deuxième problématique,
nous savons bien évidemment qu'il existe un lien fort entre le taux de
change et l'inflation ceci est justifié par rapport à la
parité des taux d'intérêt, la parité des pouvoirs
d'achat (PPA) est l'une de relations les plus utilisées en finance
internationale et constitue souvent une hypothèse de base de nombreuses
théories sur les taux de change. On peut prévoir
l'évolution du cours relatif des devises en comparant le prix d'un
panier de biens et services dans différents pays. Cette théorie
est fondée sur l'idée que les taux de change devraient être
fixés par rapport au prix relatif des biens de consommation entre deux
pays. L'évolution du taux d'inflation d'un pays serait alors
immédiatement compensée par un mouvement opposé du taux de
change. Lorsque les prix augmentent dans un pays, alors la devise de ce pays
devrait se déprécier pour que la parité soit
rétablie.
Ainsi, hormis l'introduction et la conclusion, notre travail
est subdivisé en trois chapitres, dont le premier est basé sur le
cadre théorique sur le taux de change, ayant comme fond les
théories nécessaires cadrant avec le sujet d'étude. Le
deuxième chapitre, qui s'intitule cadre méthodologique de la
recherche de taux de change qui a objet de présenter la méthode
et l'appréciation du taux de change. Enfin, le troisième et le
dernier qui a comme titre d'étude implication de taux de change dans
son évolution de produits manufacturés importés dans la
ville de Kamina.
De ce fait, les critiques et suggestions faites sont à
prendre en compte, car elles constituent pour nous une pierre angulaire afin
d'arriver à apporter des solutions aux problèmes liés au
taux de change dans la ville de Kamina.
Nous ne croyons, en fait avoir épuisé tous les
points et reconnaissant le caractère imparfait de toute oeuvre humaine.
Ainsi, les critiques et suggestions seront les bienvenues et pourront nous
aider à réaliser un travail amélioré dans nos
prochaines recherches.
BIBLIOGRAPHIE
1. Akisaho, O. (2020 - 2021). Notes de cours
d'économie monétaire, G3 Economie. Kamina: Université
de Kamina.
2. Akisahu, O. (2020 - 2021). Cours d'Economie
Monétaire. Kamina.
3. Aktouf. (1987). Méthodologie des sciences
sociales et approches qualitative des organisations. Quebec: Presse
universitaire de Quebec.
4. Banza Makonga, S. (2019 - 2020). Cours de
Méthode de recherche scientifique. Kamina.
5. Beaud, M. (2006). L'art de la thèse, Comment
préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse
de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du
net (Vol. 316). Paris: La Découverte.
6. BERNARD, B. ,. (2007). Initiation à la
macroéconomie 9e Edition. Paris: Dunod.
7. BERNARD, B. e. (2007). Initiation à la
macroéconomie, 9e Edition. Paris: Dunod.
8. DIDIER, B. (1992). La Monnaie. (L. r.
éditeur, Éd.) Paris.
9. Dominique, P. (2004). La monnaie et ses
mécanismes 4e Edition (éd. Paris). Paris la
découverte.
10. DRUNAT.J, D. M. (1994). les théories
explicatives du taux de change : de Cassel au début des années
80. Paris, de Boek.
11. finance pour tous. (2019). finance pour tous.
Récupéré sur
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/theories-economiques/creation-monetaire/la-creation-monetaire-comment-ca-marche/
12. Fulbert, M. M. (2018-2019). Notes de Cours
d'économie politique 1. Kamina: Université de Kamina.
13. Gingras. (2009). Recherche sociale de la
problématique à la collecte des donnés. Quebec:
Presse universitaire de Quebec.
14. Grawitz. (2000). Methode des sciences sociales.
Paris, France: Dalloz.
15. Gregory. (2010). Macroéconomie, Traduction de
la 7e Ed. Américaine pour JIHAD C. EL Naboulsi, 5e Ed.
Française. Paris: de Boeck.
16. GregorY, & M. (2010,). acroéconomie.
Traduction de la 7 Ed. Américaine par JIHAD C. EL Naboulsi, 5 Ed.
Française. M, de Boeck.
17. La méthode de résolution employée par
les auteurs repose sur la construction d'une maquette de long terme du
commerce. (s.d.).
18. PEYRARD j, S. G. (1986). Risque de change et gestion
de l'entreprise. Paris: Vuibert.
19. Philippe Breton, S. P. (2012). L'explosion de la
communication (éd. Reperes, Vol. 384 pages). (L. Découverte,
Éd.) Paris.
20. Simplice Banza Makonga. (2020-2021). Notes de cours de
recheches de Méthodes Quantitatives.
21. Taux de change et régimes de change.
(s.d.). Récupéré sur http://www.ac-grenoble.fr/.../doc
22. Wikipédia. (s.d.). Récupéré
sur https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_change
23. Wikipédia. (2020 , AVRIL 15).
Wikipédia. Récupéré sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_change
24. Wikipédia. (2020, AVRIL 15).
Wikipédia. Récupéré sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_change
25. Wikipédia. (2021, Août 5).
Récupéré sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix
26. Wikipédia. (2021, Juin 17).
Récupéré sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Offre_et_demande



