|
1
INTRODUCTION
« En tant que réalisateur de films
d'animation, [É] je me suis senti Ð et me sens toujours
Ð proche de Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy et du grand Harry Langdon.
»1 Voilà les références de Chuck
Jones2 lorsqu'il tente de décrire sa carrière.
Curieusement, il ne s'agit pas de grands animateurs, mais d'acteurs et
réalisateurs comiques qui s'inscrivent dans un genre bien particulier :
le burlesque. Désigné par le terme slapstick dans les
pays anglophones, ce genre semble concerner, à première vue, des
films dont l'humour serait fondé sur la violence : la traduction
littérale de slapstick étant coup de
bâton. Bien que les films de Chaplin ou de Laurel et Hardy (pour ne
citer qu'eux) comportent bon nombre de chutes ou de coups, l'essence-même
de leur langage comique repose avant tout sur un point : l'usage du gag.
Défini comme étant un moyen de « créer une
surprise en trompant une attente », ou comme « le plus long
chemin pour aller d'un point à un autre »3, le gag
se distingue du simple effet comique en faisant appel « à
l'intelligence et au raisonnement du spectateur de par son organisation
délibérée, là où l'effet comique (chutes,
grimaces, incidents) ne provoquerait qu'un rire instinctif.
»4 Le burlesque n'est donc pas qu'une histoire de coup de
bâton, mais relève plutôt d'une organisation précise
dont le centre de gravité serait le personnage. C'est justement ce qui
pourrait expliquer l'héritage revendiqué par Chuck Jones. Car
s'il est un domaine où le personnage tient une place centrale, c'est
bien celui du cinéma d'animation.
Se dissociant du cinéma en prise de vue réelle,
le cinéma d'animation est souvent qualifié de genre à part
entière. Pourtant, la diversité des ambiances et des personnages
qui en découlent met en évidence le fait que l'animation peut
traiter de plusieurs genres, du
1 Charles M. JONES, Chuck Jones, ou l'autobiographie
débridée du créateur de Bip-bip, du coyote et leurs
amis..., Dreamland éditeur, 1995, p.128.
2 Réalisateur, producteur, scénariste, acteur et
compositeur américain, Chuck Jones (1912-2002), fut l'un des plus grands
animateurs de sa génération. Après avoir
fréquenté la Chouinard Art Institute (aujourd'hui
California Institute of The Arts), il a notamment travaillé
pour Walter Lantz (1899-1994), le créateur de Woody-Woodpecker, et pour
les studios Disney. Mais l'essentiel de sa carrière fut consacré
à la branche animation du studio Warner Bros., dans laquelle il
collabora avec Tex Avery (1908-1980), et où il participa à la
création de nombreux personnages tels que Daffy Duck, Bugs Bunny, ou
encore Bip-Bip et Coyote. Auteur de plus de 300 courts-métrages, et
maintes fois nominé aux Oscars, Chuck Jones a profondément
marqué l'histoire du cinéma d'animation.
3 Jean-Pierre Coursodon et Francis Bordat, cités dans
Emmanuel DREUX, Le cinéma burlesque ou la subversion par le
geste, L'Harmattan, 2007, p.73.
4 Ibid. p.77.
2
western au film policier, en passant par la comédie
romantique. Il s'agit donc plutôt d'une technique ou, pour être
plus précis, d'un ensemble de techniques utilisées dans le but de
donner la vie (du latin animare) à un être qui n'existe
pas réellement. Pour animer un personnage et le monde qui l'entoure, la
principale technique a être adoptée par les grands pionniers de
cet art fut celle du dessin animé. En reproduisant à la main
différentes poses du personnage, l'animation consiste à faire
défiler toutes ces images et à restituer le mouvement par le
principe de la persistance rétinienne. Cependant, la définition
qui permet de saisir au mieux les enjeux du cinéma d'animation reste
celle de Norman Mc Laren : « L'animation, ce n'est pas l'art de
dessins qui bougent, mais l'art du mouvement qui est dessiné. »
En d'autres termes, il s'agit pour l'animateur de maîtriser tous les
aspects du mouvement pour le restituer à l'image avant même que
celle-ci soit articulée avec les autres dessins. Cette maîtrise du
mouvement est, là aussi un point commun à l'acteur burlesque et
à l'animateur, et donc au personnage animé. Cela passe notamment
par un sens de l'observation aiguisé que revendiquent des
réalisateurs plus récents, comme Jacques Tati et Pierre
Étaix, cinéastes burlesques inspirés par les grands
comiques de l'âge d'or du slapstick. Cependant les artistes
évoluant dans ce registre se font de plus en plus rares et le burlesque,
notamment avec l'arrivée du cinéma parlant, a de plus en plus de
mal à imposer la magie de l'expression corporelle. L'évolution du
burlesque passe donc par sa dissolution dans les autres genres, comme dans le
film d'action, où Jackie Chan s'est fait le maître des cascades et
autres exploits physiques chers à Buster Keaton. Il reste
néanmoins un domaine dans lequel le slapstick a laissé
des traces, c'est celui du cinéma d'animation.
Mais aujourd'hui, la technique reine du dessin animé
n'est plus la seule qui attire le public. Avec l'avènement de
l'ordinateur et des nouvelles technologies, l'animation par images de
synthèse a progressivement gagné du terrain sur le dessin
animé traditionnel. S'il est un studio qui domine cette nouvelle
technique d'animation, c'est bien Pixar, car cette domination est telle que le
nom du studio plane sur chaque film d'animation assisté par ordinateur,
au grand dam de son principal concurrent (Dreamworks SKG). Une question se pose
alors. Que reste-t-il de l'héritage laissé par les grands
maîtres du burlesque dans ces production ultra-modernes ? Chercher des
réponses à cette question, revient avant tout à
étudier un point fondamental du comique burlesque, le personnage et sa
difficile relation au monde qui l'entoure. La recherche se portera alors sur
les personnages au sein des
3
productions Pixar, et tentera de démontrer en quoi ces
héros témoignent du lien qui unit le slapstick au cinéma
d'animation.
Il s'agira de développer, dans un premier temps, les
caractéristiques physiques du héros Pixar, car la première
approche d'un personnage animé, comme d'un personnage burlesque
relève du corps. La genèse de ces premiers corps animés
par ordinateur permettra de rendre compte des méthodes de travail
utilisées au sein du studio, mais aussi de décliner les
différents corps burlesques qui en sont nés. Les
particularités de ces personnages donneront lieu à une
étude de leur rapport au délire comique, domaine
étroitement lié au langage du slapstick, mais aussi de
définir la situation de ces corps dans l'espace. Dans un second temps,
une approche de ces personnages en tant qu'objets de divertissement permettra
de cerner l'importance du merveilleux dans le domaine du concret, pour mieux
appréhender les héros Pixar comme des artistes en
représentation. Enfin, une troisième partie s'attachera à
déterminer ce qui caractérise ces individus par-delà leur
aspect physique, notamment à travers leurs rapport avec le monde
mécanique, avec la communauté à laquelle ils sont
censés appartenir, puis avec le pouvoir qui régit leur monde.
4
CHAPITRE I : D É CLINAISONS DU CORPS
BURLESQUE
Avant de devenir ce géant de l'animation, Pixar
n'était, à l'origine, qu'un petit groupe de chercheurs en
infographie ne disposant que de peu de moyens et d'une technologie encore
rudimentaire. Pour comprendre comment le studio a pu s'épanouir, il faut
revenir sur ses premières années, en saisir les conditions de
travail, cerner ce vers quoi tendaient les personnes qui y évoluaient
à l'époque. Il ne faut pas l'oublier, Pixar est avant tout la
contraction des termes pixel (surface élémentaire
constituant l'image numérique) et art. Déjà,
cette dénomination marque un grand paradoxe : l'association, pour ne pas
dire la fusion, d'une technologie pour le moins impersonnelle et de la
création artistique dans sa plus pure expression. Comment ce jeune
studio est-il parvenu à concilier la tradition du coup de crayon
à la modernité de l'ordinateur, pour donner forme à ses
personnages ? C'est d'abord par une appréhension progressive de l'outil
informatique que se sont forgés les premiers corps en image de
synthèse. Par cette progression, le studio a donné naissance
à tout un éventail d'objets animés, dont le moyen
d'expression principal était celui du corps. C'est notamment par le
recours à un langage comique exclusivement physique que les studios ont
pu exploiter le potentiel burlesque des protagonistes de leurs films, au point
d'appliquer ce langage aux personnages humains, jusqu'à les transformer
littéralement en objets.
I.1/ Genèse des premiers corps Pixar
Au cours d'un entretien avec Paul Grimault1, en
1985, Jean-Pierre Pagliano questionna le cinéaste sur sa vision de
l'animation par ordinateur. Ce dernier en avait déjà une
idée bien arrêtée :
« L'ordinateur est une très belle invention, un
outil extraordinaire pour certaines choses. Ça m'amuserait de jouer avec
mais ça ne me servirait à rien pour ce que j'ai choisi de faire.
Si je faisais des films scientifiques ou techniques, je m'en servirais : il y a
des spécialistes et vous, vous êtes à leur disposition. Il
faut leur dire : « Je voudrais bien avoir ça » et le
gars vous dit « c'est possible » ou « c'est pas
possible ». On commence à être dépendant de
quelqu'un d'autre [É] et à ce moment-là, on s'efface
fatalement devant le moyen. Le moyen, pour moi, c'est bien si je le
contrôle. »2
1 Paul Grimault (1905-1994) est un cinéaste d'animation
français. Il est l'auteur de dessins animés poétiques,
comme Le Petit Soldat (1947) ou encore Le Roi et l'Oiseau
(1980) tous deux co-écrits par Jacques Prévert. Son oeuvre a
marqué la scène internationale, au point d'influencer des
cinéastes japonais comme Hayao Miyazaki.
2 Jean-Pierre PAGLIANO, Paul Grimault, Dreamland, 1998,
p.141.
5
Il faut dire qu'à l'époque, l'animation par
ordinateur n'en n'est qu'à ses balbutiements. Mais un petit groupe de
chercheurs de la division informatique de Lucasfilm Ltd., défriche un
terrain méconnu : celui de l'imagerie numérique. Edwin
Catmull1 et Alvy Ray Smith2 sont à la tête
de cette équipe, bientôt rejoints par John Lasseter au
début des années 80. Ce dernier est recruté pour mettre en
forme les avancées technologiques des chercheurs. Car, jusqu'alors, les
images de démonstration des nouveaux logiciels étaient
réalisées par les inventeurs eux-mêmes. « C'est
comme aller dans un musée où les tableaux auraient
été peints par les fabricants des toiles et des pinceaux »3
s'étonne John Lasseter.
L'arrivée de ce dernier marque donc le lancement d'un
projet voué à promouvoir les travaux du groupe : un court
métrage d'animation.
« Ed Catmull et Alvy Ray Smith m'ont demandé de
réfléchir à un personnage composé de formes
géométriques simples [É]. Je me suis alors
intéressé à Ub Iwerks, à la simplicité de
ses premiers dessins animés de Mickey Mouse. J'ai donc commencé
à dessiner André, un personnage composé de formes simples.
»4
Certes, les premières aventures de Mickey se
caractérisent par la simplicité des traits, mais la
fluidité et le rythme impulsés aux corps des personnages sont
très soignés. Walt Disney et Ub Iwerks s'étaient
d'ailleurs inspirés des corps de Buster Keaton et de Charlie Chaplin
pour concevoir ces personnages. Car comme le souligne Dick Tomasovic,
« le corps du toon et le corps burlesque sont des corps mobiles,
malléables, ils sont les premiers objets de l'action du cinéma
d'animation. »5 Le cadre rigide des formes
géométriques imposées par l'outil informatique à
Lasseter posent donc problème à l'ancien animateur des studios
Disney : « Je me souviens avoir dit à Ed [Catmull] :
« Bon sang, j'adorerais avoir une forme flexible », c'est grâce
à son corps qu'un personnage de dessin animé devient expressif.
»6
1 Né en 1945, Edwin Earl Catmull est un docteur en
informatique spécialiste de l'image de synthèse. Il entre chez
LucasFilm en 1979, où il travaille sur les premières images
générées par ordinateur. En 1986, il fonde Pixar avec
Steve Jobs, et développe des logiciels importants dans le domaine de
l'animation par ordinateur.
2 Ingénieur américain né en 1943, Alvy
Ray Smith est, au même titre que son confrère Ed Catmull, un
pionnier de l'infographie.
3 Extrait du documentaire de Tony KAPLAN et Erica MILSOM,
Pixar Shorts, a Short Story, 2007.
4 ibid.
5 Dick TOMASOVIC, Le corps en abîme, Sur la figurine
et le cinéma d'animation, Rouge Profond, 2006, p.53.
6 John Lasseter in, Tony KAPLAN et Erica MILSOM, op.
cit, 2007.
6
Ces débuts hésitants appuient la thèse de
Paul Grimault selon laquelle les limites technologiques de l'ordinateur
constituent une barrière à la créativité. Edwin
Catmull va justement repousser ces limites en mettant au point le
procédé de la goutte d'eau (annexe 1). S'appuyant sur
les fameuses formes géométriques imposées par les
logiciels, cette goutte d'eau se compose de deux hémisphères : le
plus grand constituant la base de l'objet à animer, et le plus petit
faisant office de sommet. L'ordinateur remplit alors automatiquement la section
qui sépare ces deux hémisphères indépendants l'un
de l'autre. L'objet final devient malléable, et se rapproche de la
flexibilité d'un personnage animé à la main. John Lasseter
résume ainsi la façon dont il s'est affranchi des ces contraintes
: « L'art met la technologie au défi et celle-ci inspire l'art.
»1 Un second personnage est donc développé
autour de ce nouveau procédé : Wally B., un bourdon doté
de pattes en formes de bonbons de gélatine.
I.2/ Des objets animés...
I.2.1/ Expression du corps géométrique
Si Les Aventures d'André et Wally B. sont un
exploit technologique, le film n'est qu'une étape dans l'apprivoisement
de l'animation par ordinateur. En effet, pour poursuivre le parallèle
opéré par Paul Grimault entre le dessin animé traditionnel
et ces expérimentations informatiques, « une animation c'est
faire vivre, faire respirer, prendre le personnage de l'intérieur, qu'on
ait l'impression que c'est lui qui décide s'il va marcher, s'il va
courir [É]. »2 Il est évident que
John Lasseter ne pouvait se satisfaire de ces démonstrations simplistes
et aspirait à des projets capables d'ouvrir un champ plus large à
l'animation pure.
C'est à partir de 1986, date à laquelle Steve
Jobs3 rachète la branche infographie de Lucasfilm pour en
faire une société indépendante, que l'équipe
d'André et Wally B. se voit offrir des perspectives encore plus
stimulantes. Pixar se détourne peu à peu de ses
1 ibid.
2 Paul Grimault, cité dans Jean-Pierre PAGLIANO, Paul
Grimault, Dreamland Editeur, 1998, p.143.
3 Steve Jobs est né en 1955, en Californie. Il
s'intéresse très tôt à l'électronique et
fonde, à seulement 21 ans, la société Apple. Il fonde
Pixar en 1986, avant de devenir l'actionnaire principal de la firme Disney. Ses
réussites phénoménales dans les domaines de l'industrie
informatique et de la production cinématographique en font un des hommes
les plus influents de ces trente dernières années.
7
fonctions initiales (le développement de logiciels
d'imagerie dans le domaine industriel et médical) pour se consacrer
pleinement à ce qui n'était jusqu'alors qu'une vitrine :
l'animation.
Pour présenter leur nouvelle entreprise, Ed Catmull et
Alvy Ray Smith demandent à John Lasseter d'imaginer de nouveaux
personnages dans le cadre d'un second court métrage, le premier film
estampillé du logo Pixar.
« Je me demandais ce que je pouvais bien faire. Sur ma
table de dessin, j'avais une lampe d'architecte. Une lampe Luxo. Elle avait des
formes géométriques simples, alors je l'ai
modélisée. C'est là que j'ai pensé aux algorithmes
pour les ombres que nous développions dans le bureau. Nous avons
décidé de combiner les deux et d'en faire un film. »1
L'émulation entre la technologie et l'art fonctionne
une fois de plus. Lasseter pousse les chercheurs à développer de
nouveaux logiciels qui libèrent de nouvelles idées
nécessitant d'autres innovations. Ce cercle vertueux place alors le tout
jeune studio à la pointe des recherches dans le domaine de l'image de
synthèse.
Pour bien rendre compte des moyens dont disposait cette
équipe, il faut rappeler que les membres de Pixar occupaient le
même bureau et se partageaient les quelques (précieux) ordinateurs
dont disposait le studio. Loren Carpenter2 rapporte que «
le processeur d'un téléphone mobile est cent fois plus rapide que
celui du studio »3 à l'époque. C'est donc
une véritable équipe de pionniers qui débarque à
une conférence du SIGGRAPH4 de 1986 : « Il y avait
des ateliers, des panels et des projections en soirée. C'était
une sorte de festival pour les mordus d'informatique. »5
Après des mois d'efforts et de calculs, le studio Pixar peut enfin
présenter Luxo Jr., l'histoire d'une petite lampe de bureau qui
joue avec une balle sous le regard éclairé d'un de ses parents.
« Le film ne dure que deux minutes trente, mais avant la fin, tout le
monde était debout en train d'applaudir. »6 se
rappelle John Lasseter.
« Je n'oublierai jamais quand Jim Blinn, l'un des
géants du graphisme assisté par ordinateur, est venu me voir
après la projection. Il m'a dit : « John, j'ai une question
à te poser. » Je me suis dit : « Oh, non. Jim Blinn.
Il va me poser des questions sur l'algorithme pour les ombres. J'en suis
sûr. Je n'y connais rien. » Il m'a dit : « John, la
lampe adulte était une maman ou un papa ? » Je me suis
contenté de sourire en pensant : « On a réussi
». On avait réussi notre pari. On s'intéressait aux
1 John Lasseter in, Tony KAPLAN et Erica MILSOM, op.
cit, 2007.
2 Loren Carpenter est un ingénieur en infographie
américain. Il développe des algorithmes pour l'imagerie
numérique au sein de LucasFilm, avant d'être intégré
à la société Pixar.
3 In, Tony KAPLAN et Erica MILSOM, op. cit,
2007.
4 Le SIGGRAPH (Special Interest Group in GRAPHics) est un
séminaire américain sur l'infographie organisé chaque
année depuis 1974.
5 John Lasseter in, Tony KAPLAN et Erica MILSOM, op.
cit, 2007.
6 Ibid.
8
personnages. »1
Car Luxo Jr. est véritablement une borne dans
l'histoire de l'animation, dans le sens où il s'agit du premier film
entièrement réalisé en images de synthèse dont les
personnages, bien que muets, expriment une grande palette de sentiments. Le
tour de force de Pixar fut alors de parvenir à éclipser la
prouesse technologique par des personnages dont la crédibilité
repose avant tout sur le potentiel expressif de l'objet en tant que corps.
I.2.2/ Musicalité du corps
Luxo Jr. fut certes une réussite d'un point de vue
scénaristique et esthétique, mais le caractère particulier
de ce personnage était la façon dont celui-ci s'exprimait : sans
aucune parole.
L'expression corporelle, nous l'avons souligné, reste
le principal moyen de communication pour cet objet vivant. Cependant, il faut
également signaler l'importance des sons produits par ce corps. En
effet, chaque geste ou déplacement s'accompagne d'un cliquetis
métallique, d'un grincement de ressort. Par ces sons, le personnage
revendique non seulement sa crédibilité (tous trahissent la
matière, la facture de l'objet), mais aussi sa capacité à
communiquer à travers ce qui le définit, au-delà de sa
mutité. Après la gestuelle, il y aurait donc une deuxième
alternative à l'expression orale : l'expression sonore, une sorte de
musicalité inhérente à l'anatomie et aux attributs du
personnage.
C'est par cette expression sonore que se caractérise
également le héros de Tin Toy (John Lasseter, 1988). Le
film s'ouvre par un lent panoramique sur un plancher, dévoilant un sac,
une boîte ouverte, puis un jouet immobile : Tinny. Ce nom, tout comme le
titre du film, en appelle à l'idée du tintement. Car Tinny est
musical, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un homme-orchestre ou
plutôt d'un jouet-orchestre. D'abord immobile devant la boîte dont
on vient de le sortir, Tinny regarde autour de lui et perçoit des rires
d'enfants. Ces rires sont ceux de Billy, un bébé
s'avançant à quatre pattes vers son nouveau jouet. Par crainte
d'être malmené par cet immense bébé, le jouet tente
de s'éclipser, mais son premier pas actionne la grosse caisse et les
cymbales greffées à son dos. C'est ainsi que Tinny
découvre sa condition d'homme-orchestre. Ses mains, prisonnières
d'un accordéon, ne lui serviront qu'à jouer de la musique, et
chaque pas qu'il fera sera accompagné d'un
1 Ibid.
9
son. Lorsque le bébé remarque Tinny, ce dernier
n'a d'autre choix que d'accélérer sa fuite, provoquant ainsi
l'emballement de sa mécanique.
Loin d'être mélodieuse, la musique que joue Tinny
est celle de sa propre peur. Car plus il fuit le danger, plus ses
déplacements sont bruyants et attirent le bébé. À
la grosse caisse et aux cymbales s'ajoutent alors l'accordéon, la
trompette et le xylophone, véritable déchaînement de notes
qui permet à cette curieuse poursuite entre un bébé et son
jouet de révéler les propriétés de ce corps
définitivement musical. Tinny ne peut pas fuir ses problèmes
puisque son corps tout entier en est la source. Quand il panique, c'est la
grosse caisse qui fait office de coeur en battant la chamade, tandis que la
trompette traduit son essoufflement. Et sa boîte, qui pourrait lui servir
d'abri, n'est qu'un prisme déformant à travers lequel le
bébé, déjà immense par rapport au jouet,
paraît plus monstrueux encore. Tinny se réfugie donc sous le
canapé et découvre une quinzaine de jouets apeurés, fuyant
le même danger que lui. C'est alors qu'il prend conscience de sa fonction
: divertir. La découverte du corps par cet apprentissage sonore le
libère de la peur. Tinny va alors s'efforcer d'attirer l'attention de
Billy pour remplir son rôle de jouet.
Attirer l'attention par le divertissement, est bien la
principale préoccupation d'un homme-orchestre. Et le potentiel expressif
de la musique à travers le corps semble tellement riche que le studio a
produit un second court métrage sur ce thème intitulé
One Man Band (Andrew Jimenez et Mark Andrews, 2OO6).
Il ne s'agit plus ici de jouets, mais de deux hommes se
disputant l'unique pièce d'or d'une petite fille, par le biais d'un
concours de musique improvisé.
Si ces deux personnages pratiquent le même
métier, ils sont autant opposés physiquement que musicalement. En
effet, la silhouette élancée de Treble, son visage triangulaire
et ses gestes précis et rapides s'accordent parfaitement avec le genre
d'instruments dont il joue, essentiellement des instruments à cordes. De
l'autre côté de la place déserte où se
déroule l'action, Bass est un homme-orchestre porté sur les
instruments à vent et les percussions. La grosse caisse située
devant lui est traversée par un accordéon (faisant de Bass une
possible déclinaison de Tinny), tandis qu'une clarinette, un tuba et
diverses trompettes complètent son équipement (annexe 2).
À la rigoureuse simplicité des
10
cordes s'oppose donc l'opulent apparat des cuivres. Ce
contraste se traduit jusque dans l'habillement, puisque la fraise et le
pantalon de Bass reprennent le motif de son accordéon. « On
entend le bruit de leur accoutrement à chaque fois qu'ils bougent. C'est
très réaliste. »1 À tous ces
détails s'ajoutent les noms des deux hommes-orchestre : Treble et Bass.
Le premier désigne littéralement, en anglais, une note
aigüe, mais rappelle également le terme treble clef (la
clef de sol). Quant au second, il peut à la fois qualifier un son grave
et un instrument de musique (guitare basse, contrebasse, etc.) ou encore la
clef de fa (bass clef). Par extension, Bass incarne le contrepoint
musical de Treble.
En se disputant la pièce de la petite Tippy, les deux
hommes-orchestres se lancent dans une compétition qui va crescendo, tout
comme la bande-son. De par leur fonction, Treble et Bass ne se répondent
qu'en jouant leur musique, de plus en plus fort, de plus en plus vite, avec de
plus en plus de virtuosité. Cet affrontement musical tourne presque
à l'agression (aussi bien visuelle que sonore), et l'enfant
effrayée laisse tomber sa pièce d'or qui roule jusqu'à une
bouche d'égout pour y disparaître. À partir de la chute de
la pièce, la musique s'arrête net pour laisser le loisir aux deux
musiciens de regarder l'objet de leur rivalité leur échapper. Aux
concerts tonitruants répond l'ironie du sort à travers le
lointain cliquetis de la pièce au fond de l'égout. Chacun des
personnages, surpris par ce dénouement, regarde les deux autres avec un
étonnement qui ne laisse pas de place à la parole. Ce qui
remplace la musique, c'est le geste et rien d'autre. En guise de
réparation, la fillette réclame un violon à Treble en
tendant une main vindicative et se lance dans un solo époustouflant. La
compétition musicale lancée par les hommes-orchestres est
finalement remportée par l'arbitre.
L'exemple de ces deux films prouve, s'il le fallait, la force
de suggestion de la musique dans la caractérisation des personnages. Et
aux fausses notes maladroites de Tinny répondent les mélodies
endiablées de Treble et Bass. Pour One Man Band, l'histoire et
les personnages ont été construits en grande partie autour de la
musique du film. Car Michael Giacchino, compositeur phare du studio, n'avait
pas les images devant lui pour composer, seules quelques indications lui furent
fournies sur le genre de musique et d'instruments à utiliser. Tout comme
l'homme-orchestre est fondamentalement lié à ses instruments,
le
1 Andrew Rimenez, commentaire de One Man Band, DVD,
Buena Vista Home Entertainment, 2007.
11
récit et les personnages furent adaptés à
la musique, ce qui donne une véritable crédibilité
à l'ensemble. Mais ce que nous retiendrons de Tin Toy et de
One Man Band, c'est la capacité du studio à se
débarrasser de la parole pour revenir aux origines même du
cinéma : le gestuelle et le sonore. Les corps de Tinny, Treble et Bass,
qu'ils soient de chair ou de métal, sont avant tout des machines
à produire des sons et non des mots. Leurs phrases, marmonnées ou
parfaitement prononcées, sont essentiellement musicales, et ne sont
là que pour une chose : traduire les sentiments du personnage. Le corps
burlesque est, en ce sens, une sorte de métronome de l'action. C'est lui
qui insuffle le rythme à l'histoire, en battant la mesure à
travers ses instruments. Ce phénomène produit une parfaite
harmonie entre ce qui est donné à voir et ce qui est donné
à entendre. Dans ce domaine, Jerry Lewis renversait ce
procédé car, bien qu'excellent musicien, il se plaisait à
démontrer ses talents de mime dans des numéros de playback
gestuels où l'action de son personnage se modelait à la
bande-son. Ainsi, dans Who's Minding the Store ? (Franck
Tashlin1, 1963), il réalise un étonnant numéro
de secrétaire tapant un texte avec une machine à écrire
invisible. Rowan Atkinson reprendra cette idée en l'appliquant à
la batterie, dans un numéro non moins virtuose.2
1 Frank Tashlin fut, dès les années 30, un des
plus grands animateurs américains. Après avoir collaboré
avec Tex Avery, Chuck Jones, ou encore Walt Disney, il abandonna l'animation
pour réaliser des films burlesques et fut notamment un collaborateur
important de Jerry Lewis.
2 Rowan Atkinson est un comédien britannique issu du
théâtre. Outre des apparitions remarquées au cinéma
et des rôles importants dans plusieurs séries outre-Manche, il
s'est fait connaître du reste du monde en créant le personnage de
Mr. Bean en 1989. Le sketch de la batterie invisible est extrait de son one-man
show Rowan Atkinson Live, enregistré à Boston en 1991,
et co-écrit avec son fidèle ami et collaborateur, Richard
Curtis.
12
I.2.3/ Mobilité et immobilité
« Pour le dire en une formule, le vivant s'inscrit dans
l'ordre du mouvement (le mouvement étant la possibilité de bouger
ou non); les figurines, elles, relèvent du mouvant : elles sont
condamnées à être mues continuellement, à être
bougées sans cesse pour dissimuler l'inertie totale qui les fige. La vie
c'est le mouvement, l'illusion de vie, c'est le mouvant. »1
L'art de l'animation ne se résumerait donc pas à
sa simple définition étymologique : donner la vie, mais
il s'agirait en réalité de donner l'illusion de la vie. Chez
Pixar, malgré l'utilisation exclusive de l'image de synthèse,
John Lasseter et ses collègues ne se focalisent pas sur la reproduction
fidèle de la réalité. Comme le rappelait Laurent Roth
à l'occasion de la sortie de Toy Story :
« Toute la réflexion de Lasseter au sujet de
l'animation des jouets du film travaille sur la limite subtile à trouver
entre l'humanisation à tout crin de la marionnette (croire au jouet
comme s'il
était vivant) et sa fatale immobilité d'objet
intrinsèquement inerte (le jouet n'est jamais qu'un objet mort).
»2
C'est justement sur cette dualité entre le mobile et
l'inerte que repose Toy Story. Premier long métrage du studio,
le film reprend l'idée de Tin Toy, à la
différence près que les jouets ne bougent qu'en l'absence des
humains. Ce principe n'est pas neuf, puisque Paul Grimault le prenait
déjà comme base pour Le Petit Soldat (1947). Mais pour
Lasseter, les images générées par ordinateur souffrent
plus de l'immobilité que les autres techniques d'animation3.
Le défi du studio était donc double. Il s'agissait de faire
oublier l'aspect inédit des images en donnant l'impression que les
jouets (objets inertes par définition) étaient vivants. Pour ce
faire, l'équipe du film prend le parti de travailler d'abord sur la
matérialité des corps à animer4, puis de
s'appuyer sur cette matérialité pour développer l'aspect
psychologique des personnages. Car les héros de Toy Story sont
avant tout des personnages pensants, à l'image de Félix le Chat
que son créateur, Otto Messmer5 avait élaboré
après avoir étudié les premières comédies de
Charlie Chaplin :
1 Dick TOMASOVIC, Le corps en abîme, Sur la figurine et
le cinéma d'animation, Rouge Profond, 2006, p.30.
2 Laurent ROTH, L'enfant et les sortilèges,
Cahiers du Cinéma n°501, avril 1996, p.12.
3 John LASSETER, « Viewpoint », Animation Magazine,
mars-avril 1994, p.45.
4 Dans le documentaire de Leslie Iwerks, The Pixar
Story (2007), Lasseter rapporte que les premières recherches
pour Toy Story consistèrent à acheter des jouets
existants pour mieux cerner la matière, la flexibilité,
l'amplitude des mouvements de chaque personnage potentiel.
5 Otto Messmer (1892-1983) est un animateur américain
auteur de très nombreux dessins animés. Son imagination et son
sens de la mise en scène du personnage dessiné firent le
succès de Félix le Chat dont il est le créateur.
13
« Les connaissances qu'il avait ainsi acquises du geste,
du mime, de l'expression et du langage corporel lui permirent de donner
à Félix un style de mouvement unique. Tandis que les autres
personnages de dessins animés de l'époque se contentèrent
de se déplacer à l'écran, Félix, lui, semblait
réfléchir avant d'agir [...] »1
Réfléchir avant d'agir, c'est bien sur ce point
que les personnages de Toy Story construisent leur
crédibilité de figurines vivantes. En effet, la
première séquence du film montre Andy, un petit garçon,
s'amusant dans sa chambre avec ses jouets : une poupée-cowboy
ventriloque, un dinosaure en plastique, ou encore un cochon-tirelire. Mais
dès que l'enfant sort de la pièce, ses jouets s'animent
littéralement : ils regardent autour d'eux, se parlent et,
déjà, le caractère de chacun commence à se
dessiner. Le spectateur comprend alors que ces personnages constituent une
véritable communauté qui mène une double-vie : elle
remplit sa fonction première en tant que divertissement inerte d'Andy,
et elle prend vie devant le public. Celui-ci, initié au secret des
jouets, les considère donc davantage comme des personnages simulant leur
immobilité, que comme des êtres sans vie dont la capacité
à se mouvoir ne serait qu' artificielle.
Woody, le cowboy et héros principal de la trilogie
Toy Story, est un exemple des plus éloquents concernant ces allers
et retours entre l'inertie et la mobilité. Ainsi, lorsqu'il se retrouve
dans la chambre de Sid, le voisin teigneux d'Andy, Woody subit une
séance de torture pour le moins inhabituelle : Sid, jouant les
interrogateurs sadique, place une loupe entre les rayons du soleil et le front
en plastique du héros (annexe 3). La lente brûlure laisse
déjà apparaître une légère fumée quand
Sid est appelé par sa mère et se précipite au
rez-de-chaussée. Dès que la porte claque, Woody bondit en
laissant échapper le cri de douleur qu'il retenait jusqu'alors. C'est
par ce genre de séquences que le personnage gagne en
crédibilité puisque même les plans qui trahissent son
statut d'objet inerte ne sont là que pour souligner la force vitale
contenue par ce même objet. Toy Story 2 ne déroge pas
à la règle et pousse le vice encore plus loin en mettant Woody
dans une situation des plus désagréables. Quand Geri, le
restaurateur de jouets, vient réparer le cowboy, ce dernier doit prendre
sa pose habituelle, les yeux grands ouverts, tandis qu'un très gros plan
montre un énorme coton-tige s'approchant dangereusement de la pupille de
Woody pour enfin la frotter lentement, délicatement, minutieusement.
Encore une fois, ce plan met en relief l'épreuve subie par le jouet,
mais il instille au spectateur, crispé sur son fauteuil, une
1 Charles SOLOMON, Les pionniers du dessin animé
américain, Paris, Dreamland, 1996, p.66.
14
impression dérangeante, car il en appelle à un
réflexe naturel d'identification au personnage. Ce genre de plan, assez
rare au cinéma de par l'inconfort qu'il produit (à l'image du
plan de l'oeil coupé par un rasoir dans Un chien
andalou1), est néanmoins exploité avec Jim
Carrey, grand héritier de Jerry Lewis. Dans Yes Man (Peyton
Reed, 2008), son personnage fait un cauchemar dans lequel il est figé
sur son canapé, les yeux et la bouche ouverts. C'est alors qu'une mouche
vient se poser sur son oeil gauche, sans que celui-ci ne réagisse
(annexe 4). La même gêne physique se fait alors sentir,
mais l'homme ne bougera pas, pour la bonne raison que ses amis rentrent chez
lui, et constatent négligemment sa mort ! Là encore,
l'immobilité s'oppose au vivant. Et, comme pour se jouer de cette
état morbide, les héros de Toy Story décident de
dévoiler leur secret à Sid. Mais la mise en scène qu'il
choisissent pour effrayer leur bourreau est calquée sur le réveil
de morts vivants. Des jouets sortent de terre en boitant, d'autres rampent,
etc. Sid, paniqué par cette incroyable découverte, s'enfuit
d'ailleurs en criant : « Les jouets sont vivants! ».
Pourtant, de nombreux personnages comiques choisissent
l'inertie comme moyen d'éviter la mort ou, du moins, les
problèmes. Ainsi, quand Keaton se réfugie sous une bâche
pour échapper à la police, c'est pour se retrouver sur la statue
fraîchement inaugurée d'un cheval blanc. Keaton doit alors rester
de marbre pour ne pas dévoiler cette ruse improvisée et ce,
malgré que la monture cède lentement sous le poids de son
cavalier.2 Chaplin n'est pas en reste lorsqu'il s'improvise pied de
lampe en se cachant sous un abat-jour3, ou quand il se
déguise en arbre pour sauver ses frères d'armes.4
Ces exemples sont à la fois l'illustration d'une
fixité faisant office d'ultime refuge (surtout quand l'abri initial est
détruit par un chien ravageur, annexe 5), mais sont
également la preuve que le personnage animé, tout comme le
personnage burlesque, peut se fondre dans le décor avec une
facilité déconcertante, à l'image des rats qui se cachent
sur les dalles noires du carrelage de la cuisine de Ratatouille (Brad
Bird, 2007) (annexe 6). L'immobilité est donc une alternative
à la disparition du corps. Alors que l'essentiel de son pouvoir de
divertissement se fonde sur le geste, sur la capacité à se
mouvoir, le personnage Pixar opte souvent pour une inertie qui se veut
salvatrice, et qui, paradoxalement, lui assure de rester au premier plan de
l'action.
1 Luis Bunuel, 1929.
2 The Goat (1921), Buster Keaton et Mal St. Clair.
3 The Adventurer (1917), Charlie Chaplin.
4 Shoulder Arms (1918), Charlie Chaplin.
15
I.3/ É aux corps-objets
Se fondre dans le décor, tout comme Harold Lloyd
« se confond avec un mur tapissé en se plaçant
simplement contre lui , recouvert d'un tissu au même dessin
»1 (A Sailor Made Man, de Fred Newmayer, 1921),
ou comment illustrer l'appartenance du corps au domaine du concret ? Cet effet
comique a traversé les décennies, puisqu'il est repris dans le
film de Zach Braff, Garden State (2004) (annexe 7), tout
comme dans Monsters Inc. (Pete Docter, David Silverman et Lee Unkrich,
2001), où un monstre-caméléon se sert de son pouvoir de
mimétisme pour espionner les autres. Ainsi placé sur le
même plan que le décor, le corps se retrouve relégué
au simple statut d'objet, il fait, pour ainsi dire tapisserie. Avant
de dégager les enjeux d'un tel déplacement, il faut se pencher
sur les différentes méthodes de réification
utilisées chez Pixar.
Le premier niveau de passage du corps à l'état
d'objet repose, la plupart du temps, sur une simple allusion visuelle. Dans
Up (Pete Docter et Bob Peterson, 2009), alors que Carl Fredricksen, un
retraité aigri, décide de quitter sa vie monotone en faisant
s'envoler sa maison grâce à des milliers de ballons, Russell, un
jeune scout, est embarqué malgré lui dans l'aventure. Poursuivis
par un chasseur fou aux commandes d'un dirigeable, Carl et Russell doivent
faire face à des situations pour le moins incongrues. En effet, alors
que Russell se retrouve suspendu dans les airs au tuyau d'arrosage de la maison
de Carl, il percute la cabine du dirigeable et trahit sa présence en
glissant lentement le long de la paroi vitrée, dans un crissement proche
de celui d'un ballon de baudruche. Le motif du ballon ressurgit un peu plus
tard lorsque le même personnage, plutôt rond, doit éviter
les fléchettes lancées par les avions qui le poursuivent. Le lien
est rapidement fait entre la morphologie de l'enfant, le bruit de ballon
produit et l'éclatement imaginaire que pourrait causer une de ces
fléchettes.
Mais cet amalgame entre l'image que le corps renvoie et
l'utilisation qui peut en être faite devient un ressort comique important
avec le personnage de Slim dans A Bug's Life (John Lasseter et Andrew
Stanton, 1998). De par sa taille et sa minceur, ce phasme est
quasi-exclusivement utilisé comme un objet. Il se plaint d'ailleurs de
ne jouer que le rôle du balai au sein de la troupe de cirque à
laquelle il appartient. Son patron lui répond alors :
1 Petr KRAL, Le burlesque ou la morale de la tarte à
la crème, Ramsay, 2007, p.113.
16
« T'espérais quoi avec ton physique ? »
Car le corps de Slim n'est plus ni moins qu'un long bâton faisant
tour à tour office d'épée, de barre de limbo, ou encore de
tige de fleur. Il est même confondu avec une branche (ce qui,
après tout, est la fonction première du corps d'un phasme), et se
décrit comme « la branche avec des bras » pour aider
ses amis à le localiser. Le cas de ce personnage fait écho
à celui de Buster Keaton qui, durant les premières années
de sa carrière, jouait les « serpillères humaines
»1. Son père, Joe, l'utilise « pour
balayer le sol ou en le jetant dans les coulisses [É] à l'aide
d'une poignée de valise cousue discrètement au dos du veston de
Buster. Le balai humain fait ainsi son entrée dans le
vaudeville. »2
Le cas de Slim n'est pas isolé dans la filmographie du
studio, et nombreux sont les personnages à prétendre au statut
d'objet. C'est notamment le cas de Bloat, ce diodon3 qui se prend
pour un cric gonflable dans Finding Nemo (Andrew Stanton et Lee
Unkrich, 2003), ou encore de ce petit monstre qui utilise sa langue comme une
corde à sauter dans Monsters Inc. (annexe 8).
Cependant, le corps réifié le plus
éloquent reste celui d'Helen Parr dans The Incredibles (Brad
Bird, 2004). Mère de famille dans une société où
elle est condamnée, comme tous les autres super-héros, à
ne pas utiliser ses pouvoirs, elle reprend néanmoins du service sous les
traits d'Elastigirl. Comme Slim, son nom a trait à son physique,
puisqu'elle peut étirer son corps comme un élastique. Ainsi,
Elastigirl épouse la forme d'un tunnel pour éviter le
véhicule qui s'approche d'elle, se transforme en parachute
improvisé pour secourir ses enfants du crash d'un avion, avant de
devenir un zodiaque de fortune pour atteindre la terre. Ce zodiaque reste
d'ailleurs purement familial, puisque Dash, son fils, doté du pouvoir de
la vitesse, fait office de propulseur à l'embarcation (annexe
9).
En faisant du corps un objet usuel, les studios Pixar
perpétuent la tradition comique des premiers temps. Car, comme le
remarque Petr Kràl, l'objet « dans le slapstick, est
comme doué d'une vie propre, à l'égal de l'homme; on peut
même dire que, de tous les partenaires du protagoniste, il est le seul
qui puisse lui disputer sa suprématie. »4 Et
1 Buster KEATON, Charles SAMUELS, Slapstick, L'Atalante,
1984, p.21.
2 Peter KRAVANJA, Buster Keaton, Portrait d'un corps
comique, Portaparole, 2007, p.19.
3 Aussi appelé poisson-hérisson, le diodon a la
capacité de remplir son corps d'eau jusqu'à devenir presque
sphérique.
4 Petr KRAL, Le burlesque ou la morale de la tarte à
la crème, Ramsay, 2007, p.111.
puisque les objets s'immiscent dans le monde des vivants, le
personnage burlesque, qu'il soit humain ou animal, se fait un plaisir de
piétiner les plates-bandes des objets.
En s'attachant, dans un premier temps, à
maîtriser le langage du corps par l'animation d'objets (chaise, lampes,
monocycle, etc.), les créateurs du studio ont inscrit leur personnages
dans la tradition burlesque. Avec le temps, l'amélioration des outils a
permis de développer les expressions faciales, et donc le langage
parlé. Mais la force des personnages Pixar repose sur l'héritage
de ces différentes étapes. Car tout en découvrant de
nouveaux moyens de communiquer pour leurs créatures, les animateurs ont
gardé en tête le potentiel expressif du geste, du mouvement. Ces
corps de pixels sont devenus des corps de plus en plus crédibles. Par
cet attachement au concret, à la matérialité du corps, ces
personnages ont évolué jusqu'à atteindre le plein
aboutissement du corps burlesque : la réification. En faisant des objets
des êtres animés (tout comme Charley Bowers se plaisait à
le faire)1, Pixar fonde une grande partie de son propos comique sur
le décalage entre la nature du corps manufacturé et la
personnification de ce corps. C'est en retournant ce principe comme un gant (le
personnage chosifié) que le même décalage se produit.
17
1 cf. A Wild Roomer et Egged Up (Charley
Bowers, 1926).
18
CHAPITRE II : LE CORPS COMME OBJET DU DÉLIRE
La première donnée commune au burlesque et
à l'animation semble être le délire qui s'installe
progressivement dans chaque film. Libres de toute convention, l'un comme
l'autre constituèrent dès leurs débuts des avant-gardes
artistiques et techniques de premier ordre. De nombreux caricaturistes,
illustrateurs et animateurs entrèrent dans le cinéma par le biais
du burlesque, et Charley Bowers, cité plus haut, fut l'une de ces
passerelles en réalisant plusieurs courts métrages
mêlant slapstick traditionnel et animation image par image.
Ainsi, dans A Wild Roomer (1926), son personnage met au point une
machine capable de tout faire. Le film comporte notamment une séquence
dans laquelle cette machine anime la poupée qu'elle vient de fabriquer.
« Ce que dit cette séquence, ce n'est rien de moins, ni de plus
d'ailleurs, que le pouvoir de l'animation à animer [...j
»1 Les productions Pixar regorgent de séquences
illustrant ce propos. Étant donné que le personnage burlesque est
avant tout un corps défini par ses gestes, sa démarche, sa
flexibilité, sa mobilité (et donc son immobilité), quels
sont ces mouvements qui amènent le spectateur à rire de lui et
avec lui ? Pour répondre à cette question, il faut avant tout
s'attarder sur le motif de la marionnette à l'intérieur
même des films Pixar, avant de se pencher sur les épreuves subies
par ces corps burlesques dans un monde qui ne les ménage pas.
II.1/ La valse des pantins
Dans les dessins animés de Tex Avery, « les
protagonistes commentent leur propre nature de créatures
dessinées. Sur l'un d'eux est tatouée l'inscription : ''Mon corps
est la propriété de la Warner''. »2 Ce
procédé est repris avec la présence du copyright
Disney sur le postérieur de Buzz l'éclair dans Toy
Story. Outre l'aspect comique de ce marketing assumé, la question
de la conscience d'être une figurine traverse toute l'intrigue. Woody
assène sans arrêt à Buzz une des phrases qui a fait le
succès du film : « You are a toy ! ». Ce recul du
personnage animé vis-à-vis de sa condition renvoie au
questionnement du
1 Dick TOMASOVIC, Le corps en abîme, Sur la figurine et
le cinéma d'animation, Rouge Profond, 2006, p.24.
2 Robert BENAYOUN, Le mystère Tex Avery, Editions
du Point, 2008, p.77.
19
motif de la marionnette. Certes, plusieurs créatures
factices apparaissent dans les films du studio, comme l'oiseau fabriqué
par les insectes dans A Bug's Life, mais la question de la marionnette
est centrale lorsqu'il s'agit d'interroger l'essence même de
l'animation.
Woody, figurine faite de tissu rembourré et de
plastique ne déroge pas à la règle de la
matérialité chère à Lasseter. Sa démarche,
liée à sa composition, joue un rôle important dans la
façon dont on le perçoit, et le personnage s'en amuse dans
Toy Story 2 (John Lasseter, Lee Unkrich et Ash Brannon, 1999), lorsqu'il
sort de sa boîte en jouant le stéréotype du shérif
sûr de lui (annexe 10). L'effet comique repose alors sur le
décalage ente le ridicule de son évidente condition de figurine
et le caractère viril du personnage qu'il tente d'incarner. La figurine
est alors le vecteur d'une certaine idée burlesque qui serait,
« dans l'art, ce qui amplifie sans cesse la force d'expansion du
comique en reconduisant ses effets à leur source
»1.
Mais le traitement de la figurine en tant que motif comique ne
date pas d'hier. En effet, avec le développement de la
mécanisation du travail au début du XX ème siècle,
l'homme a dû habituer son corps à des rythmes imposés qui
ont donné naissance à un rapport au corps inédit. Les
burlesques des premiers temps se sont inspirés de ces marionnettes d'un
genre nouveau pour développer le thème du pantin. Dans The
Circus (1928), Chaplin reprend l'idée de l'immobilité comme
point de fuite en se faisant passer pour un automate. Passé du monde du
vivant au monde des choses, Chaplin interroge alors la figure de Charlot en
plaçant son personnage dans un double niveau de représentation :
Chaplin joue Charlot qui joue l'automate. Le personnage burlesque serait-il
envisageable en tant que simple marionnette sujette au bon vouloir de son
créateur ? Si la réponse par l'affirmative n'est pas
évidente pour le slapstick pur, elle semble assez nette en ce
qui concerne l'animation. Et cette mise en abîme du métier
d'animateur est particulièrement présente dans
Ratatouille.
L'intrigue du film repose sur Remy, un rat dont les talents de
cuisinier vont l'amener à être adopté par Linguini, un
jeune commis du plus grand restaurant de Paris. Comprenant rapidement leurs
qualités complémentaires (savoir faire la cuisine et savoir faire
l'humain),
1 Elie DURING, Du comique au burlesque : Bergson, Art
Press, Hors-série N°24 : Le burlesque, une aventure
moderne, ocotbre 2003.
20
ils mettent au point un subterfuge : Remy, caché sous
la toque de Linguini, contrôle les gestes du jeune homme en tirant sur
certaines mèches de ses cheveux (annexe 11).
Les premiers essais chez Linguini révèlent la
difficulté de l'exercice, notamment quand Remy essaie de lui faire faire
sauter une crêpe, celle-ci brise une fenêtre pour atterrir sur le
pare-brise d'une voiture (du moins peut-on le deviner au crissements de pneus
qui se font entendre en contrebas). Ce gag est également présent
dans Johnny English (Peter Howitt, 2002) où Rowan Atkinson joue
un agent secret parfaitement incompétent, et provoque un accident en
voulant lancer sa veste avec désinvolture sur un portemanteau, laquelle
passe par la fenêtre située juste à côté.
Après s'être entraînés, Remy et
Linguini testent leur méthode en cuisine. Mais quand le rat veut se
faire entendre de son partenaire, il n'a d'autres solutions que de le mordre,
provoquant, chez le jeune homme, grimaces, spasmes et sursauts. Ces
contractions soudaines de Linguini pourraient faire croire à un
ensorcellement vaudou où le corps serait à la fois la
poupée (les morsures remplaçant ici les fameuses aiguilles) et la
cible du sort (annexe 12). En cela, le personnage s'avère un
champ d'expérimentation idéal pour les animateurs, puisque les
gestes produits par son corps peuvent (et doivent) être tout sauf
habituels.
Et ce phénomène se reproduit quand Remy
débarque en cuisine et s'aperçoit que Linguini s'est endormi. Il
déploie alors toutes ses forces pour le réveiller, en vain.
Lorsqu'une des collègues entre dans la pièce, Linguini, toujours
endormi, se meut à son insu. Le rat se fait non plus le marionnettiste
d'un complice, mais d'une créature provisoirement privée du
contrôle de son corps. Linguini est donc animé par les
créateurs du film, mais aussi réanimé par
Remy.
Le jeune cuisinier vit d'ailleurs mal un statut qu'il renie :
« Je ne suis pas une marionnette ! Et tu n'es pas mon manipulateur !
» lance-t-il à Remy. C'est pourtant le rat qui est
maître à bord, puisqu'il parvient à diriger Linguini avec
une virtuosité qui révèle la souplesse de ce corps
à son propriétaire.1 Ainsi, Remy accomplit une
manoeuvre délicate en faisant passer sa marionnette sous un plateau,
à la manière d'un danseur de limbo,
1 Le nom du personnage s'inspire certainement du terme
linguine, qui désigne une sorte de spaghetti plat.
21
stupéfiant tout le monde (y compris Linguini) (annexe
13).
Outre le fait d'exploiter cette relation
marionnettiste/marionnette, le cas de ce duo improbable souligne
également la capacité du corps animé à s'affranchir
de gestes préconçus. Et cette double animation,
créé un décalage entre ce qui est attendu du personnage et
ce qu'il peut effectivement réaliser. Dès lors qu'il sort du
mouvement ordinaire, le corps s'inscrit dans le registre du comique physique,
donc burlesque.
II.2/ À l'épreuve du monde
Comme expliqué plus haut, Otto Messmer s'est
inspiré de Chaplin pour créer Félix le Chat. En dehors de
la personnalité attribuée à Félix, ce qui le
caractérise, c'est sa propension à moduler son corps lorsqu'il en
a besoin. Il transforme ainsi sa queue en parapluie ou en manche de banjo et
ses oreilles en paire de ciseaux.1 Plus tard, c'est Tex Avery qui
s'amusera à décomposer physiquement ses personnages.2
Mais le dessin animé n'est pas le seul domaine dans lequel le corps
outrepasse les lois de la physique. Le comique de Laurel et Hardy, par exemple,
« consiste à éprouver par tous les moyens la
résistance du corps à travers des métamorphoses proches du
cartoon »3. Le délire comique s'appuie en grande
partie sur ces facultés extraordinaires du corps à se
déformer. De ce point de vue, les héros Pixar ne dérogent
pas à la règle. De Woody, maltraité par Buzz (Toy
Story), puis par Jessie (Toy Story 2) (annexe 14),
à Dory, le poisson amnésique de Finding Nemo
écartelé par des mouettes (annexe 15), tous
subissent les foudres d'un monde qui ne leur fait aucun cadeau. Cependant,
trois personnages se distinguent par leur faculté à supporter ces
atteintes à l'intégrité physique : M. Patate (Toy
Story), Émile (Ratatouille) et Mike (Monsters
Inc.).
Avant d'être un personnage de Toy Story,
Monsieur Patate est un jouet commercialisé depuis les années 1950
dont les membres, et les composantes du visage
1 Felix the Cat as Romeeow (Otto Messmer, 1927).
2 Le loup est un exemple récurrent de ce
procédé dans l'oeuvreTex Avery, notamment dans Red Hot Riding
Hood (1943).
3 Stéphane GOUDET, Qui êtes-vous Laurel et
Hardy ?, conférence du 9 décembre 2009, organisée
dans le cadre de l'hommage rendu au duo par la Cinémathèque
française du 9 décembre 2009 au 11 janvier 2010.
22
devaient, à l'origine être fixés sur des
légumes de toutes sortes. Peu à peu, le jouet s'est
popularisé et est devenu une pomme de terre de plastique dotée de
trous servant à fixer une grande variété d'yeux, de
bouches, de nez différents, et permettant ainsi aux enfants de
créer leurs propres personnages. De par ce rôle de support concret
à la créativité, Monsieur Patate a été un
objet plus que stimulant pour les animateurs de la trilogie dont il est un
héros récurrent. Dès les premières minutes de
Toy Story, il affiche sa capacité à moduler son visage en se
prenant pour un tableau de Picasso. Par cette première apparition,
Monsieur Patate ouvre la voie à une quantité de
représentations de son corps, et montre une totale insensibilité
à ses déformations. Son corps n'est plus qu'un terrain
miné d'effets comique : une tape un peu forte dans le dos lui fait
sauter un oeil, une chute trop violente entraîne la dispersion de tous
les éléments qui le composent, comme s'il explosait
littéralement (annexe 16). Ce véritable puzzle ambulant
lutte perpétuellement pour rassembler ses morceaux. Et quand, dans un
élan sportif, il tente de se muscler, ses maigres bras restent
agrippés à ce qui lui sert d'haltère, l'abandonnant
à une chute certaine. L'affront de cet objet au corps, Jerry Lewis en a
déjà fait les frais, mais avec des conséquences
différentes. En effet, au lieu de se détacher sous le poids de
l'haltère, ses bras s'étirent exagérément dans
The Nutty Professor (Jerry Lewis, 1963) (annexe 17). Dans ce
cas précis, le personnage animé permet de dépasser la
simple déformation du corps de l'acteur, en poussant le vice à la
dislocation des membres. Dans Toy Story 3, Monsieur Patate
accède à un autre niveau de recomposition du corps lorsqu'il fixe
ses différents éléments à un concombre, ou encore
à une tortilla, renouant ainsi avec la première version qui avait
été faite du jouet au début de sa commercialisation.
Enfin, dans ce dernier volet, Madame Patate (dont les
propriétés physiques sont les mêmes que son mari) joue un
rôle important dans le déroulement de l'action grâce
à l'oeil qu'elle a perdu. Cet oeil est, en fait, un moyen pour la bande
de jouets de savoir à distance ce qui se passe dans la chambre d'Andy.
Le délire burlesque du corps fragmenté contamine alors la mise en
forme du film, avec l'utilisation de plans subjectifs faisant office de
caméra involontairement infiltrée.
Le cas de Monsieur Patate est, pour ainsi dire, l'exact
opposé de celui d'Émile. Quand le premier se disperse, le second,
lui, se concentre, se densifie. Car le frère de Remy
23
ne partage pas sa finesse de goût. En tant que rat, il
fait honneur à sa réputation et se goinfre de tout ce qu'il peut
trouver. Alors que Remy teste une nouvelle recette sur le toit d'une maison,
les deux rats sont foudroyés et projetés au sol. Cet incident
donne alors une saveur particulière au met encore fumant qu'Émile
qualifie aussitôt de foudrée, traduisant ainsi sa
capacité à s'octroyer les choses dans leur immédiate
concrétude. En outre, ce qui, pour son frère, constitue une
source d'écoeurement, devient pour Émile un simple moyen de se
gaver encore et encore. Dans son chapitre intitulé Manger le
monde1, Petr Kràl souligne cette avidité de la
réalité commune à la majorité des personnages
burlesques qui « poussent bel et bien leur goût du monde et du
concret jusqu'à réellement y mordre. »1 Cette gloutonne
immédiateté est pleinement satisfaite lorsque Remy ouvre la porte
du garde-manger du restaurant à sa colonie. Alors qu'il tente de se
fondre dans ce décor comestible en arborant une ceinture d'asperges,
Émile ne résiste pas à la tentation de goûter au
raisin suspendu près de lui. Finalement, c'est une grappe au moins aussi
grosse que lui qu'il gobe grain par grain. Ce gobage excessif fait de ce corps
une sorte de grenade dont l'explosion semble inévitable. Et quand
Émile s'élance pour atteindre l'ultime grain de raisin, son corps
trop lourd renverse la meule de fromage sur laquelle il se trouvait. Celle-ci
lui retombe alors dessus, transformant Émile en véritable canon
à raisins (annexe 18). Ainsi, le concret rattrape ceux qui en
abusent. Ce sont justement ces excès qui permettent de
représenter le corps d'une autre façon, de le redécouvrir,
comme celui de Laurel, noyé de l'intérieur après avoir
absorbé toute l'eau du tonneau dans lequel il se
trouvait2 (annexe 19).
Mike Wazowski diffère des deux personnages par sa
capacité à attirer les coups. Dans Monsters Inc., les
monstres passent dans le monde des humains par des portes donnant sur des
chambres d'enfants. En faisant peur à ses derniers, ils récoltent
leurs cris qui servent d'énergie à la ville de Monstropolis. Mike
est le coach de Sully, le champion en matière de terreur, et sa
vitalité n'a d'égal que le calme de son partenaire. Car il ne
connaît pas de repos et son agitation implique, la plupart du temps, une
atteinte à son intégrité physique. Son corps est, en
effet, une boule sans véritables aspérités. Et quand les
autres veulent s'en saisir, ce sont ses membres qui en pâtissent.
Tiraillé entre ses obligations
1 Petr KRAL, Le burlesque ou la morale de la tarte à
la crème, Ramsay, 2007, p.190.
1 Ibid.
2 Below Zero, de James Parrott, 1930.
24
professionnelles et sa vie amoureuse, Mike se retrouve
écartelé par Sully et sa dulcinée, à tel point que
ses membres menacent de se détacher de son corps (annexe 20).
Mike fait rire à ses dépens, et aux dépens de son corps.
Chaque fois, c'est sa morphologie qui est remise en question, comme un objet
dont le monde n'accepte pas la forme. Ses membres, tiraillés ou mordus,
sont appelés à disparaître, tandis que cet oeil-tronc ne
cesse d'être écrasé, étiré, ou aspiré.
Tout concourt à trouver une utilité à un personnage qui,
au départ, n'est que l'entraîneur de la star de Monstropolis. Car
les objets aussi s'acharnent sur lui, et une chute malencontreuse dans une
poubelle fait tomber une pile de livres qui atterrit dans la bouche de Mike,
comme si le monde cherchait à la faire taire (annexe 21).
Après tout, ce à quoi il est destiné n'a rien
à voir avec la parole puisque son pouvoir comique réside dans ses
déboires physiques. Et lorsqu'il doit faire rire l'enfant que Sully a
recueilli, c'est en s'attaquant à son propre corps, en étirant
son unique paupière, en sautant sur une poutre métallique tout en
écartant volontairement les jambes, ou en se coinçant la
tête dans une porte (annexe 22). S'il n'est qu'un oeil, c'est
parce qu'il est voué à observer, et non à commenter le
monde qui l'entoure. Car la première qualité d'un comique reste
l'observation, et c'est par la conscience des choses (et donc de son corps) que
Mike trouve sa vocation : faire rire, et ne prétendre à rien
d'autre.
Déchiré, brûlé, tordu,
écartelé, ou encore, décomposé, les personnages
Pixar sont un terrain propice au délire burlesque. Ces corps
maltraités, véritables instruments de l'action, ont un point
commun, celui de survivre à ces agressions. Cette désacralisation
du corps permet, non seulement d'en affirmer la maîtrise, mais aussi de
multiplier les ressources comiques de cet objet burlesque qui ne semble pas
connaître de limites.
25
CHAPITRE III : LE CORPS DANS L'ESPACE
Sujets à toutes sortes de brutalités physiques,
les personnages des productions Pixar sont le lieu de l'action autant que le
monde dans lequel ils évoluent. Mais comment se situent-ils dans ce
décor qui les entoure ? La liberté de mouvement qui les
caractérise imprime souvent à l'image la marque de leur passage.
En cela, le plan d'ensemble est un moyen d'inscrire ces corps agités
dans un cadre précis, même s'ils s'échappent parfois du
champ, pour exister en dehors des limites imposées.
III.1/ Laisser sa trace
Bien que subissant les foudres d'un monde cruel, tous ces
corps semblent, à terme, ne pas en garder trace. Ce rapport aux coups,
aux marques, n'est pas réciproque, puisque le monde qui les accueille
est sans cesse transformé par l'action de ces personnages. Cette manie
de marquer le territoire du sceau de son incompétence, de sa maladresse
ou de son inconscience, est un trait fondamental de l'existence du héros
burlesque. Laurel et Hardy, par exemple, sont passés maîtres dans
l'art de la destruction progressive, quant à Monsieur Hulot, il
déclenche un feu d'artifice imprévu (Les Vacances de Monsieur
Hulot, Jacques Tati, 1953), ou laisse involontairement des traces de pas
sur le sol, puis sur le bureau d'une secrétaire (Mon Oncle,
Jacques Tati,1958). Quoiqu'il en soit, le décor sort rarement indemne du
passage d'un personnage burlesque. Et lorsque celui-ci est animé, le
risque de ne pas rendre les choses dans leur état d'origine est encore
plus grand.1
Pendant que les humains attendent patiemment à bord
d'un immense vaisseau spatial (L'Axiom), Wall-e, dont le rôle est de
nettoyer la terre de ses déchets, , tombe amoureux de Eve, un robot en
quête d'une forme de vie. Alors que Eve montre sa puissance en tournant
sur elle-même à une vitesse folle, Wall-e se rapproche un peu trop
et reçoit un coup qui le projette contre la paroi métallique de
son abri. Un peu étourdi, il se laisse tomber, dévoilant
l'empreinte de son corps sur le mur.2 Mais Wall-e ne se limite pas
à
1 Félix le Chat est l'exemple le plus flagrant de la
transformation du monde selon la volonté du héros.
2 Dans Toy Story 2, Buzz l'éclair laisse une
marque identique contre un jeu prévu à cette effet (annexe
23).
26
ce genre de maladresse, car à bord de L'Axiom, sa
fonction de compresseur de déchets attire l'attention de M-O, un robot
chargé du nettoyage d'un vaisseau déjà aseptisé.
Dès que Wall-e avance, ses chenilles laissent la preuve de sa
saleté. L'impudence de cet être impur est aussitôt
effacé par le robot obsédé par sa mission. Wall-e, comme
pour vérifier ce qu'on lui reproche, se permet d'avancer
délicatement un pied pour le poser sur le sol, tout juste nettoyé
par M-O. Ce geste, outre l'impertinence qu'il sous-tend, n'est qu'une
manière d'appréhender ce nouveau monde en en testant les limites.
Mais l'importance de cette mission de nettoyage systématique n'est pas
assimilée par Wall-e qui poursuit son chemin, suivi à la trace
par M-O. Ce motif de l'empreinte laissée comme une piste derrière
son auteur est d'ailleurs repris par un robot-peintre
déréglé, un peu plus tard dans le film.
Bob Parr, dans The Incredibles, modifie
également le décor par une force surhumaine qu'il a du mal
à contrôler. Et quand son odieux patron dépasse les bornes,
Bob le saisit par le cou et lui fait traverser plusieurs murs, abolissant les
barrières entre les espaces impersonnels de la compagnie d'assurance
pour laquelle il travaille (annexe 24). Plus tard, en sortant de sa
voiture, ce même personnage manque de tomber à cause d'un
skateboard abandonné près de la portière. En se rattrapant
au toit du véhicule, Bob se crispe et déforme la carrosserie.
Cette tendance à adapter le monde par la destruction, le remodelage, est
commune à Playtime (Jacques Tati, 1967), où il est
« nécessaire de modifier l'espace pour se l'approprier, de le
re-découper à la mesure de l'homme »1
Le décor serait-il insuffisant pour laisser s'exprimer
le personnage burlesque, au point que celui-ci s'emploierait à le
modifier ? Rien n'est moins sûr. Mais ce qui semble ce dégager de
cette fâcheuse tendance à l'altération de l'objet ou de la
surface, c'est le désir de s'affranchir des contraintes physiques
susceptibles d'enfermer le corps dans une routine du mouvement à
laquelle il se refuse.
1 Stéphane GOUDET, Like Home (2004), documentaire
d'analyse de Playtime.
27
III.2/ De l'importance du plan d'ensemble
Avant de traiter du plan d'ensemble, il est nécessaire
de le définir ou, du moins, de tenter d'en cerner les enjeux. Car la
notion d'échelle de plans est toute relative. Dans Wall-e, par
exemple, un plan montre, sur fond noir, un vaisseau spatial se rapprochant de
la Terre. Mais le cadre s'élargit peu à peu, laissant
apparaître le capitaine de l'Axiom, une maquette de son vaisseau dans la
main droite et un globe terrestre dans la main gauche, se projetant un possible
atterrissage. Ce qui ressemblait, au départ, à un plan
général, s'avère être le très gros plan d'un
fantasme du capitaine. Se distinguant du plan général (qui
embrasse tout un paysage), le plan d'ensemble « permet d'inscrire le
corps (reconnaissable) du protagoniste dans un décor donné et de
mettre en valeur les interactions entre l'un et l'autre.
»1 Dans le cas du genre burlesque, le plan d'ensemble est
un outil idéal pour développer toute une panoplie de mouvements,
et pour mettre en exergue le difficile rapport qu'entretient le personnage avec
le monde.
Le plan d'ensemble aèrerait donc l'action, laisserait
respirer le corps, lui laissant tout le champ nécessaire à
l'épanouissement de son expression. Mais c'est aussi un moyen de
révéler l'extrême isolement du personnage. Isolé,
Bob Parr l'est incontestablement lorsqu'il sort la tête de son bureau
ouvert pour observer l'ensemble de la salle, qui n'est pas sans rappeler un des
plans les plus fameux de Playtime (annexe 25). Isolée
également, la maison de Carl Fredricksen dans Up, qui se
retrouve cernée par un immense chantier, et semble vouée à
la destruction. Cette simple exposition permet d'amener l'idée d'une
fuite de ce monde par les airs, comme va le faire Carl. La solitude par le vide
est une constante dans la filmographie du studio, puisque dans Lifted
(Gary Rydstrom, 2006), un extraterrestre gaffeur fait s'écraser une
soucoupe-volante sur une maison. Lorsque la soucoupe décolle, elle
laisse un énorme cratère au milieu duquel subsiste un minuscule
îlot où un jeune homme dort profondément (annexe 26).
Le vide qui entoure le personnage est d'autant plus inquiétant que
celui-ci l'ignore. L'enjeu du plan d'ensemble est, ici, de rendre le public
complice de la chute inévitable du personnage dès son
réveil.
Cependant, ces espaces vierges de tout autre personnage ne le
restent jamais très
1 Stéphane GOUDET, Buster Keaton, Editions
Cahiers du Cinéma, collection Grands Cinéastes, Paris, 2008,
p.51.
28
longtemps. À l'image de la rue déserte
submergée par une multitude de policiers lancés à la
poursuite du héros (Cops, Buster Keaton, 1922), le vide,
destiné initialement à la pleine expression du corps burlesque,
se retrouve envahi par la foule. Ce genre de plans est très
répandu dans Cars (John Lasseter, 2006), où une jeune
voiture de course, Flash Mc Queen, se retrouve au centre d'un immense circuit
automobile. Le crépitement des appareils photos et les phares des
voiture font alors ressortir l'incroyable foule que peuvent contenir les
tribunes. La solitude par le vide est ici remplacée par une solitude par
la foule, car le héros devient le point de chute de l'attention de tous
les autres personnages. Le thème du corps exposé au regard, et
donc au jugement de l'autre, est aussi présent dans Presto
(Doug Sweetland, 2008). Un magicien, au prise avec son lapin
récalcitrant, doit faire preuve d'une grande maîtrise pour ne pas
gâcher son numéro. Encore une fois, le plan d'ensemble rappelle la
situation du magicien, à ceci près que, l'ajout de la
plongée rend la foule de spectateurs encore plus oppressante (annexe
27). Sur le même principe de mise en scène, Dory et Marin,
deux poissons malchanceux, atterrissent sur le quai d'un port de plaisance, au
beau milieu d'une nuée de mouette. La fixité de tous les
personnages, ajoutée à la multitude du danger, permet de
mélanger subtilement l'angoisse et le rire, tout en résumant la
délicatesses de la situation (Finding Nemo, Andrew Stanton et
Lee Unkrich, 2003) (annexe 28)1.
Cette fonction synthétique du plan d'ensemble est
exploitée dans Toy Story 2, lorsque les jouets se lancent au
secours de Woody. Pour traverser une rue dont le trafic est important, les
personnages se cachent sous des cônes de signalisation et provoquent une
série d'accidents sans s'en apercevoir. Les héros se
félicitent de la réussite de l'opération
lors d'un dernier plan montrant une rue totalement
embouteillée par un carambolage. Le plan d'ensemble s'avère donc
un outil narratif relativement important, d'autant qu'il permet
d'évaluer le rapport qu'entretient le corps burlesque avec les
situations les plus délicates. Dory et Marin s'immobilisent car ils ont
conscience du danger qui les entoure, tandis que les jouets poursuivent leur
chemin, pensant, à tort, avoir bien négocié une
étape inquiétante de leur périple. Et qu'importe si le
plan d'ensemble ne met pas le corps à l'abri de la foule et du danger
(bien au contraire), ces personnages ont une botte secrète : le
hors-champ.
1 Ce plan est d'ailleurs un hommage appuyé au film
d'Alfred Hitchcock, The Birds (1963).
29
III.3/ Vers le hors-champ et au-delà
Le hors-champ relève de tout ce qui est situé en
dehors du cadre, c'est-à-dire «l'ensemble des
éléments (personnages, décors, etc.) qui, n'étant
pas inclus dans le champ, lui sont néanmoins rattachés
imaginairement, pour le spectateur, par un moyen
quelconque».1 Nombreux sont les auteurs burlesques qui ont
utilisé le hors-champ dans leurs films, en ne montrant que l'amorce de
l'action, laissant le loisir au spectateur d'en deviner la chute.
Un des gags les plus exploités dans le genre burlesque
reste celui de la voiture qui échappe au contrôle de son
chauffeur. Dans Get Out and Get Under (Hal Roach, 1920), Harold Lloyd
prend grand soin de son automobile avant de la démarrer. Mais au lieu
d'avancer, celle-ci recule, traversant le mur du garage. En 1989, le personnage
de Mister Bean remet au goût du jour l'alliance comique de l'accident et
du hors-champ en engageant sa voiture dans une voie sans issue. L'automobile
sort du champ, un choc se fait entendre, puis une roue entre par le bord
supérieur du cadre, rebondit sur la chaussée et s'immobilise.
Mister Bean réapparaît et regarde la roue, puis se retourne vers
le lieu d'un supposé accident, avant de traverser le cadre en
courant.2 Mike's New Car (Pete Docter et Roger Gould, 2002)
réutilise ce même gag, quand Mike, au volant de sa voiture, se
prépare à une marche-arrière. Mais un démarrage en
trombe mal négocié le fait sortir du cadre en marche-avant. Comme
chez Mister Bean (et comme bien d'autres avant lui), le son provenant du
hors-champ laisse penser à un accident. Hypothèse
confirmée par le retour de la voiture en plusieurs étapes,
puisqu'elle est en pièces. Ce court métrage opère une
fusion entre le gag de Lloyd et celui de Mister Bean, mais c'est avant tout la
chute reposant sur le hors-champ qui lui donne tout son sel. Par ce recours
à la litote3, le hors-champ instaure un « rapport
direct entre le non-vu et l'assomption du spectateur. »4
Le public est donc un élément à part entière du gag
à travers le hors-champ, puisque c'est ce qu'il imagine en dehors du
cadre qui lie l'image au son qui lui succède.
Le son est, dans ce cas précis, un allié des
plus sûrs pour s'assurer de l'adhésion du
1 J. AUMONT, A. BERGALA, M. MARIÉ, M. VERNET,
Esthétique du Film, Nathan, Paris, 1983, p.15.
2 Mister Bean (épisode pilote), de John Howard
Davies, 1989.
3 Figure de style consistant à dire moins pour faire
entendre plus.
4 Serge ABIAAD, Le hors-champ dans le cinéma des
premiers temps,
Cadrage.net, février 2005.
30
public au gag. Ce principe se vérifie dans Up,
où Russell après avoir grimpé sur les épaules de
Carl pour atteindre la maison en lévitation, tente de monter à la
corde. Tandis que la caméra cadre le haut du corps du vieil homme, les
bruyants efforts de Russell (hors-champ), de plus en plus
éloignés, sous-entendent une progression de l'enfant vers la
maison. Mais, en s'élargissant, le cadre révèle que
Russell n'a pas bougé d'un pouce. La surprise créée par le
décalage entre l'ascension sonore du personnage et sa stagnation
physique déclenche ainsi le rire.
Bien qu'utilisant le hors-champ comme un espace
supplémentaire consacré au gag, les personnages des productions
Pixar ne s'en contentent pas. Pour reprendre le fameux cri de guerre de Buzz
l'éclair : « Vers l'infini et au-delà », il
semblerait que ces corps difficilement contrôlables, s'échappent
vers le hors-champ et au-delà. Ainsi, le bêtisier de A Bug's
Life évacue totalement l'existence des animateurs, puisqu'il
révèle la présence d'insectes occupant les rôles
fictifs des techniciens derrière une caméra qui n'existe pas
(puisqu'il s'agit d'animation). La frontière du film, déjà
déplacée dans le hors-champ, n'est plus le
générique. D'ailleurs, les héros du film
réapparaissent furtivement dans Toy Story 2, tout comme
Tinny, caché sous le lit du jeune homme victime d'une tentative
d'enlèvement extra-terrestre dans Lifted. Les exemples de
personnages échappés de leur film d'origine sont si nombreux
qu'une grande partie des ouvrages et sites Internet consacrés au studio
s'amusent à répertorier toutes ces incursions. Le
générique de fin de Cars rend un hommage clairement
affiché aux précédentes productions du studio en montrant
les personnages du film au drive-in local, en train de regarder, entre
autres, Toy Car Story dont les héros sont deux voitures
nommées Woody et Buzz Light Car. Par ce procédé,
« les réalisateurs renversent le cours normal des choses,
puisqu'il est normalement entendu que ces animaux, monstres, insectes
ne peuvent pas exister dans la vraie vie. Ces bêtisiers donnent ainsi une
vie réelle à ces artefacts, ces simulacres
».1 Mais cette perméabilité des films entre
eux, contribuent, par ces auto-références, à la
construction d'un monde Pixar dans lequel il serait admis que les
personnages puissent circuler librement. L'apparition incongrue d'une
silhouette connue dans un film qui lui est étranger est une touche
burlesque supplémentaire dans l'oeuvre du studio. Après tout,
Monsieur Hulot ne se permet-il pas une apparition dans Domicile Conjugal
(François Truffaut, 1970) ?2
1 Sébastien DENIS, Le cinéma d'animation,
Armand Colin Cinéma, Paris, 2007, p.202.
2 Dans ce cas, le personnage n'est pas interprété
par Tati, mais par sa doublure lumière, Jacques Cottin.
31
Cette irrépressible volonté de mouvement, dans
le film, sur ses bords et en-dehors, prouve le désir de liberté
qui contamine tout personnage burlesque. Non content d'être au centre de
son propre film, le héros Pixar s'octroie le pouvoir de s'en
évader, s'affranchissant des codes qui emprisonnent son corps dans un
cadre trop strict pour le délire qui l'habite.
32
CHAPITRE I : VERS LE MERVEILLEUX
En répertoriant les propriétés
extraordinaires du corps burlesque, il paraît évident que celui-ci
est fait pour autre chose que la simple chute auquel il est souvent
rattaché. De par sa condition de personnage animé, le
héros Pixar, tout comme les héros du slapstick
traditionnel, tend tout son être vers la fantaisie. Ses fuites vers
des horizons étrangers au film auquel il appartient le prouvent. Cette
fantaisie revendiquée par les créateurs du studio depuis sa
création, repose notamment sur un principe que John Lasseter
résume ainsi :
« Depuis que je travaille dans cette branche du
cinéma, on dit toujours que la quête du Graal en terme d'image de
synthèse est d'arriver à créer des êtres humains
parfaitement réalistes. En fait, ça n'a pas vraiment
d'intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est le fantastique. Il
nous suffit de mettre une petite dose de réalisme dans les décors
ou certains effets de nos univers pour faire passer toute la fantaisie qui se
trouve autour. Nous ne voulons pas attirer l'attention du public sur un effet
particulier, au détriment de l'histoire. »1
Baigné dans cette fantaisie, les personnages ne sont
donc pas créés dans une tentative de reproduction de la
réalité, mais bien à travers une
réalité qui leur est propre. Par quel biais ces personnages
constituent les principaux relais de la magie comique qui opère dans ces
univers ? Pour en avoir un aperçu, il faut d'abord déterminer une
certaine idée du quotidien des personnages que se font les
créateurs des films, mais également traiter un motif
récurrent dans la filmographie du studio, celui de la suspension du
réel, comme une pause durant laquelle la réalité est mise
à mal par la fantaisie.
I.I/ L'extraordinaire quotidien
Qualifier le quotidien d'extraordinaire revient à
mettre en évidence le paradoxe qu'implique la fantaisie décrite
plus haut, lorsque la rencontre du merveilleux et du routinier donne lieu
à des situations pour le moins comiques. Par exemple, dans Le Grand
Amour (Pierre Étaix2, 1968), Pierre, le personnage
principal, s'évade de la monotonie de sa vie conjugale le temps d'un
rêve où les voitures sont remplacées par des lits. Il
emprunte
1 cité dans Pascal PINTEAU, Effets spéciaux, un
siècle d'histoire, Minerva, 2003, p.261.
2 Clown, illustrateur, gagman, magicien, fondateur de
l'École Nationale du Cirque, Pierre Étaix est également un
auteur majeur du cinéma (burlesque), avec l'écriture et la
réalisation de cinq films durant les années 1960 : Le
Soupirant (1963), Yoyo (1964), Tant qu'on a la santé
(1965), Le Grand Amour (1968) et Pays de Cocagne
(1969).
33
une petite route de campagne et découvre un homme,
arrêté sur le bas-côté, et allongé sous son
lit pour le réparer, les mains pleines de cambouis. Plus loin, Pierre
aperçoit un lit carbonisé, à la diagonale, contre un arbre
qu'il semble avoir percuté. Il s'arrête ensuite pour prendre une
charmante auto-stoppeuse (dans ce cas, ne devrait-on pas dire lit-stoppeuse
?) qui n'est autre qu'Agnès, sa secrétaire dont il est
secrètement amoureux. S'en suit un accident entre deux dormeurs qui
descendent de leur lit pour s'expliquer, le passage d'un agriculteur tractant
(lui aussi sur sa couche) un canapé rempli de fumier, ou encore, une
route embouteillée par des lits. Au-delà de la splendide
poésie de cette métaphore de la vie amoureuse, Pierre
Étaix donne un ton comique à ce cheminement onirique en
appliquant les aléas de l'automobiliste au domaine du lit. Ce
déplacement de détails concrets vers le rêve installe une
sorte de nouvelle réalité qui rend ce rêve crédible.
Cette séquence donne
tout son sens au burlesque qui « flirte avec le
merveilleux » quand « son extravagance et ses folles
imaginations l'éloignent du commun et de la raison pour faire
naître un monde quasi-fantastique et grotesque -ou d'un
réalisme supérieur - proche de celui du rêve.
»1
Cette approche est, depuis longtemps, acquise chez Pixar et,
bien que les personnages soient plus originaux les uns que les autres (lampes
de bureau, monocycle, jouets, poissons, monstres, insectes, robots, etc.), leur
crédibilité repose sur le monde dans lequel chacun évolue.
Ainsi, chaque nouveau film est l'occasion de créer un univers autour des
personnages, avec d'innombrables références à la
réalité dans ce qu'elle a de plus banal. La colonie des fourmis
dans A Bug's Life est organisée d'après le modèle
naturel (une reine à la tête d'ouvrières), mais son
quotidien est ponctuée de rapprochements évidents avec le monde
des humains. Les champignons fluorescents deviennent des lampadaires, et la
ville des insectes reproduit les codes d'une ville moderne, avec, en guise de
feux de signalisation, une luciole qui passe d'une ampoule rouge à une
ampoule verte. La méthode ainsi utilisée pour donner corps
à ce monde fictif repose sur la dissonance née de «
l'invraisemblable sur des données humaines et sérieuses
»2.
Ce ressort comique qu'est la réalité des
personnages calquée sur celle du spectateur est également
développée dans Finding Nemo. Au début du film,
Marin, poisson-clown,
1 Emmanuel DREUX, Le cinéma burlesque ou la subversion
par le geste, L'Harmattan, 2007, p.44.
2 Henri DIAMANT-BERGER, « Les Genres »,
Cinémagazine n°27, 22 juillet 1921. Cité dans Emmanuel
DREUX, Le cinéma burlesque ou la subversion par le geste,
L'Harmattan, Paris, 2007, p.39.
34
accompagne son fils, Nemo, à l'école. Au milieu
des anémones et autres coraux, les bancs de poissons circulent dans un
ordre bien établi. Cette fois, ce n'est pas une luciole, mais un poisson
rouge en forme d'éventail qui se déploie pour permettre à
Nemo et son père de traverser (annexe 29). Cette idée de
réguler le trafic sous-marin avait déjà été
explorée par Buster Keaton pour The Navigator (1924)
(annexe 30), mais il s'agissait plus d'une digression que d'un
enrichissement de l'intrigue, ce dont Keaton se rendit compte, décidant
de renoncer à cette scène. Il est difficile de savoir si les
scénaristes de Finding Nemo ont eu vent de cette scène
quand ils ont mis au point cette séquence. En tous les cas, ici, l'effet
fonctionne car, contrairement au gag de Keaton, il s'inscrit dans une logique
d'illustration du quotidien des poissons.
Une autre approche, tout aussi prolifique en matière de
fantaisie, consiste en une exploitation particulière d'objets banals
sortis de leur contexte. Le tuyau d'arrosage faisant office de corde dans
Up est un exemple de ces réinterprétations de l 'objet qui
fourmillent dans le film.
« J'aime l'idée que les objets du quotidien aient
une nouvelle fonction [É] Au début du film, on a fait la liste de
tous les objets qu'un vieil homme pouvait posséder, afin de savoir
comment les utiliser dans un contexte d'aventure. Il y a ce pot de pilules
qu'il jette au sol, et qui fait déraper Muntz. Il se sert de son
appareil auditif, qu'il lance comme une grenade. »1
Si les objets quotidiens d'un vieil homme au milieu d'un film
d'aventures sont une grande source d'inspiration, la vie d'une famille de
super-héros dans un quartier pavillonnaire ne l'est pas moins. Le
dîner de la famille Parr (The Incredibles) le prouve. Tandis que
la mère tente de raisonner son fils indiscipliné, le père,
distrait aide ce dernier à couper sa viande. Rien de plus banal,
à la différence près que le fils peut courir à la
vitesse de la lumière, que sa soeur peut se rendre invisible, que le
corps de la mère est élastique et que le père dispose
d'une force colossale. Ces détails, qui n'en sont pas, transforment un
repas familial en un modèle d'anarchie. Et quand quelqu'un sonne
à la porte, tous s'arrêtent net, le temps de réaliser que
leurs pouvoirs ne doivent pas être découverts (annexe 31).
En un quart de seconde, tout rentre dans l'ordre, pour faire bonne figure
devant le nouvel arrivant. Ces va-et-vient incessants entre le banal et
l'extraordinaire sont le pendant comique de ce véritable film d'action.
Il suffit que la famille reprenne du service, en costume de super-héros,
pour que les aléas de la vie quotidienne ressurgissent
inévitablement. C'est
1 Pete Docter, dans les commentaires du dvd de Up
(2009).
35
notamment le cas lorsque Bob/Mr. Incredible, au volant d'un
van suspendu à un engin volant par les membres étirés de
sa femme (Helen/Elastigirl) (annexe 32), répond à ses
enfants qui s'impatientent : « On arrivera quand on arrivera ! ».
Cette réplique fleurant le départ en vacances n'est pas
isolée, puisqu'une fois arrivée sur la terre ferme, Helen remonte
dans le véhicule et se dispute avec son mari au sujet de
l'itinéraire à prendre pour rejoindre la mission qui les
attend.
Tous ces moments de flottements entre la réalité
telle qu'elle est connue du public et telle qu'elle est
représentée à l'écran installe une folie douce dans
l'action. Ce délire communique avec le réel par des situations
où le corps du héros est, sinon le centre de gravité, un
élément décisif de l'équilibre entre le quotidien
et le merveilleux.
I.2/ Le réel en suspens
Suspendre une situation pour en retarder l'issue, voilà
une des solutions préférées du personnage burlesque.
Ainsi, « les réflexes de défense aboutissent chez
Charlot à une résorption du temps par l'espace
»1. Mais Chaplin n'est le seul cinéaste à
utiliser ce refuge. Dans Cops, alors qu'il tente de fuir les
policiers, Buster Keaton grimpe sur une échelle appuyée à
une palissade. Pour ne pas être rejoint sur son perchoir, il place
l'échelle en équilibre, se retrouvant le balancier d'un objet
dont les deux extrémités sont la promesse d'une arrestation
(annexe 33). Sous le poids des agents accrochés à
l'échelle, Keaton est projeté dans les airs et en profite pour
s'échapper. Sans s'éloigner du monde concret, le héros
opte pour une suspension de la réalité, une sorte de
parenthèse enchantée qui retarderait le fatal dénouement
de la situation. Ce motif du refuge dans la pause de l'action est
omniprésent dans la filmographie du studio Pixar. Dans Finding
Nemo, Marin et Dory dorment au creux d'un masque de plongée
suspendu à l'extrémité d'une immense épave en
équilibre au bord d'une fosse sous-marine (annexe 34). Leur
réveil entraîne la chute du bateau, manquant de peu de les
écraser. Cette situation fait écho à celle de Charlot et
de son acolyte dans The Gold Rush (Charlie Chaplin, 1925), se
réveillant dans un chalet qui, déplacé par la
tempête, se retrouve en équilibre au bord d'une falaise
(annexe 34).
1 André BAZIN, Charlie Chaplin, Cerf, Collection
7e Art, Paris, 1973, p.17.
36
Outre un manque de chance inouï, les protagonistes
parviennent, dans les deux films, à se tirer de ces situations
délicates. Mais celles-ci sont l'occasion pour le burlesque de
côtoyer un langage cinématographique particulier, celui du
suspense. En effet, les plans ouvrant ces séquences montrent le danger
immédiat qui guette des personnages inconscients du leur posture.
L'effet de bascule appliqué à la maison comme à
l'épave, est un moyen de faire pencher aléatoirement le destin du
héros entre une issue fatale et une solution quasi-miraculeuse. Ces
situations d'équilibre instable sont aussi le symbole d'un refus
provisoire de la réalité, comme une sorte de refuge psychologique
où rien ne peut arriver puisque personne ne bouge.
Cependant, la suspension du réel n'accrédite pas
toujours cette thèse, puisqu'elle est aussi un moyen de mettre en
évidence un rapport de force à l'avantage du héros. Dans
For the Birds (Ralph Eggleston, 2000), de petits oiseaux bleus
piaillent tranquillement sur une ligne électrique, quand un immense
oiseau s'invite au milieu du groupe. Immédiatement, les autres se
liguent contre lui et tentent de le faire tomber en s'attaquant à ses
pattes. Mais, sous le poids de la victime, le câble électrique se
rapproche dangereusement du sol. Le grand oiseau, déjà en contact
avec la terre, a désormais le pouvoir de propulser ces bourreaux dans
les airs, en laissant cette ligne à haute tension (dans les deux sens du
terme) reprendre sa forme initiale (annexe 35). Ce plan très
bref laisse néanmoins le temps au spectateur de prendre plaisir à
anticiper les conséquences de ce lâcher-prise salvateur. Cette
fois, la suspension de l'action n'est pas un moyen de retarder le
dénouement, mais plutôt une façon de tendre le ressort
comique de la situation à son maximum pour mieux en savourer la
détente.
37
CHAPITRE II : RETOUR AUX SOURCES
Qu'ils soient équilibristes, traités comme des
marionnettes, ou maltraités en tant que corps animés, les
personnages des productions Pixar ont un point commun, celui d'être en
constante représentation. Car ils possèdent la capacité
d'accéder à un degré supérieur de liberté en
s'affranchissant, par le spectacle, des carcans susceptibles de freiner leur
potentiel expressif.
En 1908, Ricciotto Canudo considérait
déjà le cinéma comme le meilleur moyen de retranscrire
« l'élément de la rapidité absolument
précise », « la précision extrême du
spectacle »1. Car la précision est intimement
lié au registre burlesque, lequel repose avant tout sur le
timing2, indispensable à la réussite d'un
gag, et inextricablement lié à la notion de rythme. La rigueur
nécessaire à cette synchronicité, tous les grands
burlesques, sans exception, l'ont apprise au contact du public, sur les
scènes de music-hall, ou sur la piste d'un cirque. L'histoire du genre
burlesque, au sens cinématographique du terme, prend sa source sur les
planches, et non devant la caméra. Rares sont les films des studios
Pixar qui n'ont pas un lien plus ou moins ténu avec le monde du
spectacle. Mais quelles sont les manifestations de ce lien ? Pour les
déterminer, il faut avant tout s'attarder sur le vecteur de spectacle le
plus utilisé, dans l'animation comme dans les films burlesques
traditionnels, à savoir la musique, laquelle implique très
souvent un numéro de danse plus ou moins chorégraphié.
Mais la musique est aussi une manière d'introduire deux autres genres de
divertissement qui ne sont pas étrangers au burlesque : la magie et le
cirque.
II.1/ La musique comme source de l'action
Dès les premières années du
cinéma, la musique s'impose comme un élément
indispensable, à tel point qu'elle devient rapidement le sujet de
prédilection de bon nombre de films.
1 cité dans Emmanuel DREUX, Le cinéma
burlesque ou la subversion par le geste, L'Harmattan, Paris, 2007, p.
33.
2 Le timing est un terme anglais désignant, dans
le cas du gag, le moment le plus opportun pour une action, qui passe par la
synchronisation du personnage avec les éléments qui l'entourent.
En quelque sorte, un bon timing signifie faire le bon geste au bon
moment.
38
« Il est peu de longs métrages du muet qui ne
comportent une scène de danse populaire, de bal, de ballet classique, de
fête foraine, de réunion chantante, de café, de concert, de
revue de music-hall, d'opéra, [...] de baladins, de chanson ou de
réjouissance populaire autour d'un instrument. »1
Les films d'animation ne sont pas en reste, puisque la
possibilité de régler à l'image près l'action sur
le rythme de la musique permet d'obtenir des effets saisissants. Les
premières aventures de Mickey vont d'ailleurs dans ce sens, et leur
succès fut si grand que le procédé, pourtant
utilisé par d'autres studios, fut surnommé mickeymousing
(le terme est toujours utilisé, qu'il s'agisse de cinéma
d'animation ou de films en prise de vue réelle). Michel Chion ajoute que
« s'il y eut jamais des films musicaux, ce furent, bien plus que tous
les autres, les cartoons de la série Silly Symphonies2 de
Walt Disney »3. Au fil du temps, les studios Disney n'ont
cessé d'accorder une place prépondérante à la
musique dans leurs films et les productions Pixar ne dérogent pas
à la règle.
En effet, la musique n'est pas seulement utilisée pour
souligner les particularités physiques du personnage, comme c'est le cas
pour le motif de l'homme-orchestre. Puisqu'il ne faut pas se fier à
« l'insuffisante et réductrice formule habituelle [selon
laquelle] la musique accompagne le film, nous dirons qu'elle le
co-irrigue et le co-structure »4. Car l'enjeu du
thème musical chez Pixar n'est pas d'illustrer les images, mais de les
lier entre elles, pour immerger le personnage dans une situation bien
précise.
Le studio développe ce principe en se rapprochant
notamment d'une certaine tradition musicale burlesque : celle du jazz. Car s'il
est un genre de musique mitoyen au dessin animé et au
slapstick, c'est bien le jazz. D'abord parce qu'il « a
été l'un des ferments des avant-gardes [dont le burlesque et
l'animation] dès les années 1910 et 1920
»5, ensuite parce les notions de rythme et de
liberté semblent les deux seules règles fondamentales qui
régissent ces trois mouvements.6 Mais Petr Kràl
évoque un autre point commun au
1 Michel CHION, La musique au cinéma, Fayard,
1995, p.43.
2 Les Silly Symphonies sont une série de
courts métrages animés et produits par les studios Disney entre
1929 et 1939.
La série officielle compte près de 80 films qui
permirent au studio d'affirmer sa suprématie dans le domaine du dessin
animé, et de perfectionner son style.
3 Michel CHION, La musique au cinéma, Fayard,
1995, p.95.
4 Ibid., p.215.
5 Sébastien DENIS, Le cinéma d'animation,
Armand Colin, Paris, 2007, p.84.
6 Ainsi, dans Le burlesque ou la morale de la tarte
à la crème (Ramsay, 2007) , Petr KRËL qualifie le
slapstick de cinéma jazziste. (p.56)
39
burlesque et au jazz, celui de leur caractère
urbain.1 La ville est d'ailleurs le principal vecteur de cette
musique dans A Bug's Life. Dès l'instant où Flik arrive
dans la ville, un thème jazz commence à envahir la bande-son,
pour faire ressortir le caractère rural de Flik, déjà
accoutré comme un randonneur. Le traitement de cette séquence
à travers le jazz permet d'installer le héros dans une sorte
d'émerveillement face à la foisonnante diversité
d'individus et de mouvements qui contraste avec la rigoureuse uniformité
de sa colonie. Soulignée par ce contexte musical, la ville
apparaît alors comme une porte donnant sur tous les possibles.
S'il peut suggérer l'impact d'un lieu sur le
héros, le jazz est aussi employé pour renforcer l'adhésion
du public à une certaine approche des personnages. C'est le cas dans
Monsters Inc., dont la musique a suscité quelques
débats. Randy Newman2 se rappelle :
« Les créateurs du film aimaient le jazz des
années 40. J'avais utilisé ce style dans 1001 Pattes
(A Bug's Life), dans The City. C'est ce qu'il voulaient
d'un point de vue affectif. Ce n'est pas nécessairement ce que j'aurais
fait si j'avais été seul. J'aurais sans doute opté pour un
style plus mécanique, plus industriel [...]»3.
Cette divergence de point de vue concerne la séquence
où Sully et Mike entrent dans l'espace réservé à
l'approvisionnement en cris d'enfants. Et si les créateurs ont
opté pour du jazz, c'est parce qu'ils voulaient sans doute
atténuer l'aspect négatif du travail des monstres. The Scare
Floor (malgré sa signification : "L' Effrayodrome") est donc un
morceau de jazz enlevé durant lequel les deux héros saluent leurs
collègues en plaisantant. Cette façon d'amener la fonction des
monstres par la décontraction du geste, de la démarche et surtout
par la musique, rend ces derniers plus sympathiques qu' horrifiques.
C'est d'ailleurs dans ce même lieu que Sully et Mike se
mettent en scène pour la première fois. Pour ne pas
révéler la présence d'une petite fille au milieu des
monstres, les deux héros intègrent une phrase compromettante
prononcée un peu trop fort dans un simulacre de comédie musicale.
Le générique de fin montre la première
représentation de cette pièce (qui résume l'histoire du
film) jouée, écrite, dirigée et produite par un Mike
Wazowski égocentrique. Monsters Inc. reste donc jusqu'au bout
une métaphore du
1 Ibid., p.59.
2 Auteur, compositeur et interprète, Randy Newman (de
son vrai nom Randall Stuart Newman) fut un chanteur engagé dans les
années 1970, avant de composer de nombreuses musiques de films (dont six
pour Pixar).
3 Randy Newman, dans un entretien accordé à
Jérémie Noyer, pour Media Magic, juillet 2009.
40
spectacle, par des va-et-vient incessants entre la
scène (représentée par les chambres d'enfants) et les
coulisses (la ville des monstres). La musique, dans ce qu'elle apporte à
l'ambiance, est ici un élément moteur de l'action, notamment
parce qu'elle est diégétique1.
En effet, dans la filmographie du studio, de nombreuses
séquences visent à introduire la source de la musique, comme
dans Toy Story 2, où Woody et Jessie actionnent une platine
vinyle en courant sur le disque.2 Ce n'est plus la musique qui
entraîne l'action, mais l'action des personnages qui permet la musique.
Wall-e pousse cette interaction encore plus loin en devenant lui-même la
source du son. En effet, ses yeux étant également des
caméras, il a pour habitude d'enregistrer les choses qui le marquent. Il
se transforme alors en projecteur pour montrer un extrait de Hello Dolly
! (Gene Kelly, 1969) à Eve, reproduisant la chorégraphie du
film. Dans les productions Pixar, la musique existe autour des personnages,
grâces aux personnages, et à travers eux, les transformant tour
à tour en chanteur, en danseur ou en musicien.
1 Est diégétique un élément qui
fait partie du récit. Une musique diégétique est donc une
musique dont la source est intégrée à la narration.
2 Pierrick Sorin, plasticien et vidéaste
français, a d'ailleurs réalisé un théâtre
optique basé sur le même principe pour l'exposition «
Jacques Tati, Deux temps, trois mouvements », du 8 avril au 2
août 2009, à la Cinémathèque française,
où il se projetait, déguisé en Monsieur Hulot, et
actionnant un disque en courant dessus (annexe 36).
41
II.2/ La piste aux étoiles
« Comprenant que l'art du clown, cette «
profession » comme le dit Chaplin « fait de vingt
métiers à la fois » procède et s'accomplit
pleinement à l'écoute des réactions du public, sorte de
caisse de résonance de son comique, il n'ait pas vain de rappeler que la
quasi-totalité des clowns cinématographiques [seuls Harold Lloyd,
Oliver Hardy et Max Linder ont une formation théâtrale] ont fait
l'apprentissage de leur métier au cirque et au music-hall. »1
Ce langage du cirque n'est pas étranger à
l'univers Pixar. Même si de nombreux ouvrages consacrés au studio
affirment que le premier être humain à y avoir été
animé serait le bébé de Tin Toy, il y eut, avant
lui, Lumpy, le clown de Red's Dream (John Lasseter, 1987). Et ce n'est
certainement pas un hasard si cette première tentative d'humanité
se résume en un clown maladroit, personnage burlesque par excellence. Un
autre clown, Rictus (annexe 37), apparaît dans Toy Story 3
(Lee Unkrich, 2010), et confirme le lien qui unit Pixar au monde du
cirque. Il s'agit alors d'établir, à travers différents
exemples, les qualités circassiennes2 qui font des
héros créés par le studio des artistes complets, et qui
leur donnent toute légitimité en tant que personnages
burlesques.
Dès Luxo Jr., le personnage principal
s'inscrit dans la tradition du cirque en s'essayant à un simple
numéro d'équilibriste sur une balle. Le motif de cette balle est
le même que celui de la piste de cirque de Red's Dream (annexe 38).
Les deux films, de par cette continuité, ont initié une
sorte de fil rouge au coeur de la filmographie du studio, d'autant plus
qu'à la présence de Lumpy s'ajoute le numéro de jonglage
de Red, le monocycle. L'art de la jonglerie permet alors de mettre en
évidence le fait que Red est un objet, sans bras, et renforce d'autant
plus l'adresse du héros.
Cependant, le cirque est surtout présent dans A
Bug's Life, avec la troupe d'artistes que composent les insectes
recrutés par Flik pour aider sa colonie. Des poux acrobates à la
chenille qui fait le clown, tous ces insectes sont liés à leur
fonction par leur physique. Cette troupe est ainsi l'occasion d'associer des
personnages très différents les uns des autres, à l'image
de Slim, le phasme longiligne, et Heimlich, la chenille gloutonne (annexe
39).
1 Odile CREPIN-ÉTAIX, Les prolongements des
langages du clown chez les clowns cinématographiques,
Université de Paris 8 - Vincennes, département Cinéma et
Audiovisuel.
2 L'adjectif circassien (relatif au cirque) ne figure
pas dans le dictionnaire, il est pourtant largement utilisé par les
artistes de cirque.
42
Le cirque est aussi un des lieux les plus aptes à
produire du spectacle, à mettre les personnages dans des situations
loufoques, comme c'est le cas du Monsieur Loyal de cette troupe, une puce
survoltée. Cette dernière draine le langage comique de tous les
artistes en passant de l'un à l'autre par des sauts fulgurants, donnant
forme à ce groupe disparate.
En outre, la mise en abîme de la représentation
permet, tout comme Chaplin dans The Circus, de traiter de la relation
qu'entretiennent les artistes avec leur public. Dans ce cas précis, la
troupe est loin de faire l'unanimité, surtout quand l'énorme
scarabée censé être une bête sauvage, se met à
pleurer au premier coup de fouet sur ses pattes. Dès lors, les artistes
sont pris à parti par des spectateurs, comme Francis, une coccinelle
ulcérée par les sifflements misogynes de deux mouches. La version
française, donne à voir un contraste outrageusement poussé
entre l'aspect féminin de l'insecte et sa voix, puisqu'il s'agit de la
voix de Patrick Poivey, doubleur officiel de Bruce Willis, figure de la
virilité ultime.
Maîtrisant la jongle, la comédie, l'acrobatie, et
toutes les autres disciplines rattachées au cirque, ces personnages
semblent inspirer les héros des films suivants. Car en dehors de la
piste, les numéros se succèdent. Dans Toy Story, Buzz
réalise une cascade époustouflante pour prouver aux jouets qu'il
peut voler. Dans la suite de leurs aventures, Buzz, Woody et Bullseye forment
une colonne à trois au grand galop, synthétisant l'acrobatie et
la performance équestre. Enfin, dernier exemple parmi tant d'autres,
Remy et Émile s'improvisent trapézistes sur un lustre pour fuir
la fureur assassine de la vieille dame qui les a découvert (annexe
40). Les héros Pixar sont tous des acrobates potentiels, des
artistes dans l'âme. C'est justement leur condition de personnages
animés qui les inscrit dans un monde où toutes les performances
physiques sont possibles.
43
II.3/ Apparitions et disparitions
Non loin du monde du cirque, la magie est un domaine où
le héros burlesque parvient à s'exprimer dans toute sa fantaisie.
Dans Presto, le prestidigitateur dispose de deux chapeaux magiques qui
communiquent l'un avec l'autre. C'est justement à partir de ces chapeaux
que le scénario se développe, donnant au lapin blanc du magicien
un vrai moyen de se venger du traitement qu'il subit (annexe 41). Car,
une fois encore, le langage comique repose sur les souffrances infligées
au corps du personnage. Le chapeau magique est donc un outil parfait pour
tendre des pièges, puisque le héros ignore ce qu'il va trouver en
y plongeant sa main. En l'occurrence, il s'agira d'une tapette à souris,
d'un panneau électrique, d'une échelle, ou encore, d'un conduit
aspirant. Plus qu'un simple ressort narratif, cet accessoire merveilleux est
aussi une façon de mettre en évidence le partage de la
scène et des coulisses. Car le film donne à voir les deux
côtés du rideau rouge, et donc deux spectacles différents.
Le lapin, en coulisse, refuse de rentrer dans le chapeau avant d'avoir eu sa
carotte. Le magicien, sur scène, ne veut pas lui céder et doit
sauver les apparences. Le tandem se livre alors à un règlement de
compte par chapeaux interposés, mais le lapin prend rapidement le
dessus. Tout l'intérêt du film repose sur le fait que l'assistance
ne sait pas ce qui se passe en coulisse. Les coups encaissés par le
magicien sont perçus comme autant de preuves de ses talents. Il finit
par remporter un véritable triomphe.
Cette dualité entre les coulisses et la scène
est un des éléments centraux de Monsters Inc. Les
portes, qui symbolisent la frontière entre le spectacle et la
réalité, font l'objet d'une séquence
particulièrement haletante, où Sully et Mike tentent
d'échapper à leur ennemi. Juchés sur une porte, les deux
héros sont entraînés dans une salle aux dimensions
hallucinantes, où ces frontières entre Monstropolis et le monde
des enfants sont rangées dans un ordre bien précis. Pour semer
leur ennemi, Sully et Mike passent par différentes portes, et traversent
tour à tour, une chambre sur une plage, une maison près du Mont
Fuji, et un hôtel parisien. Véritables
téléportations, ces passages permettent d'ouvrir d'infinies
possibilités à cette poursuite. Mais ce qu'ils
révèlent surtout, c'est la capacité du corps à
disparaître et à réapparaître à des endroits
inattendus, tout en gardant son caractère comique par une chute ou une
main coincée dans une porte.
Dans Presto comme dans Monsters Inc.,
l'intérêt de ces scènes repose sur un principe cher
à Buster Keaton : « concilier le dysfonctionnement grotesque ou
la chute dérisoire et l'exploit invraisemblable, le fonctionnement
miraculeux qui provoque l'émerveillement »1.
44
1 Stéphane GOUDET, Buster Keaton, Cahiers du
Cinéma, Paris, 2008, p.23.
45
Chapitre I : De l'organique au mécanique (et
vice versa)
Lorsque naît le cinéma, à la fin du XIXe
siècle, la révolution industrielle poursuit sa course. Les
États-unis sont particulièrement actifs dans l'expansion des
moyens de production et de transport modernes et cet « accomplissement
de la société industrielle entraîne une mécanisation
du travail et, en conséquence, une mécanisation des corps
»1. La machine et l'homme doivent donc cohabiter, et ces
nouveaux rapports ne sont pas sans créer des situations incongrues dont
le cinéma comique naissant va rapidement s'emparer. Le
slapstick qui, comme le cinéma d'animation, permet aux objets de
prendre vie, est surtout un cinéma de son temps. C'est ainsi
que les premiers auteurs burlesques inscrivent assez naturellement ces
nouvelles machines dans leurs films, et ce rapport entre le mécanique et
le vivant sera une source constante d'inspiration pour leurs héritiers.
Puisque nous nous proposons de traiter des personnages burlesques dans les
productions Pixar, il est logique de nous intéresser aux
mécanismes en tout genre qui parcourent la filmographie du studio. De la
voiture à l'ascenseur, en passant par une simple
télécommande, l'électronique, la robotique et tous les
moyens modernes qui régissent notre quotidien, sont autant d'ennemis
potentiels, de bombes à retardement dont la rencontre avec le vivant
serait le détonateur. C'est justement cette frontière entre le
machinique et l'organique qui reste difficile à définir car, d'un
film à l'autre, le vivant change de camps. Du poisson-clown au monstre,
du super-héros au robot, chaque personnage doit faire face, avec plus ou
moins de réussite, à la présence de systèmes
automatisés. Face à l'omniprésence de la machine, comment
ces personnages vont-ils revendiquer leur statut d'êtres vivants ? Pour
répondre à cette question, il faut d'abord s'attarder sur le
caractère particulier que revêt l'automobile dans les productions
Pixar. Personnage à part entière ou simple moyen de locomotion,
la voiture est un objet burlesque incontournable. Mais un autre
élément intervient dans cette relation
organique/mécanique: le tapis roulant, mécanisme dont les
personnages subissent régulièrement le mouvement
perpétuel. En effet, le vivant se retrouve souvent pris dans l'engrenage
des machines. Sa seule issue sera d'en prendre les commandes.
1 Olivier MAILLART, Entre le monde technique et
l'humanité ludique, dans La vie filmique des marionnettes,
Presses universitaires de Paris 10, 2008, p.78.
46
I.1/ La voiture, un personnage burlesque ?
« En 1874 à Morez, Paul Jacquemin conçoit
une voiture à vapeur à quatre roues, il a l'étrange
idée de l'essayer la nuit. Les habitants alors réveillés
en sursaut par un bruit d'enfer seront
terrifiés. Cette anecdote n'aurait-elle pas pu inspirer
quelques images animées pour un film comique ? »1
L'anecdote renvoie évidemment à l'entrée
pétaradante de la voiture dans Les Vacances de Monsieur Hulot
(Jacques Tati, 1953). Et cette même séquence traduit l'importance
du rôle de l'automobile dans la caractérisation du personnage.
Née quasiment en même temps que le cinéma, l'automobile a
su tirer profit de cet art nouveau pour entrer peu à peu dans
l'imaginaire collectif. Dès les années 1910, le
slapstick s'empare de ce nouvel objet pour construire des gags de plus en
plus élaborés. La première apparition de Chaplin sous les
traits du vagabond a lieu à l'occasion d'une course de voiture pour
enfants (Kid Auto Races at Venice, 1914). Son personnage tente de se
faire remarquer par la caméra et, déjà, le
mécanique et le vivant se disputent le premier rôle. Si tous les
maîtres du slapstick américain ont exploité son
potentiel comique, c'est surtout avec Laurel et Hardy que l'automobile s'est
révélée un partenaire précieux pour les
numéros comiques, et leurs fameuses Ford T restent l'un des symboles les
plus prégnants du cinéma burlesque. Ainsi, lorsque le duo tente
de vendre des sapins de Noël (en plein mois de juillet !), un client
récalcitrant se lance dans la destruction progressive de leur voiture
(Big Business, 1929). Dans une autre de leurs aventures, après
avoir respiré des gaz hilarants, ils provoquent, au volant de leur
engin, un embouteillage monstre (Leave' em laughing, 1928). Certes, la
voiture est un élément central dans les intrigues respectives de
ces films, mais c'est surtout dans A Perfect Day (Joyeux
Pique-Nique, 1929) que son rôle l'élève au statut de
personnage à part entière. Dans ce film, les deux compères
s'apprêtent à prendre la route pour pique-niquer en famille. Mais
à la maladresse du duo s'ajoute la mauvaise volonté d'une voiture
qui ne veut pas démarrer, et qui semble liguer tous ses
éléments pour empêcher le départ du petit groupe. Le
même schéma narratif est repris dans Mike's New Car. Le
héros vante la richesse des options de son nouveau véhicule,
avant d'en être la victime. Le sommet est atteint lorsque Mike tente de
refermer le capot de sa voiture et se fait littéralement avaler, tout
comme Harold Lloyd (Get Out and Get Under, 1920), à la
1 Maurice GIRARD, L'automobile fait son cinéma,
Éditions Du May, 2006, p.12.
47
différence près que Mike semble broyé
proprement par la rotation du moteur. Ces situations démontrent non
seulement l'incompétence du héros burlesque, mais
présentent également l'automobile comme un objet doté
d'une personnalité dont elle fait usage pour renvoyer le personnage
à sa vanité.
Jacques Tati va plus loin dans Trafic (1971) en
accordant certes le rôle principal à une voiture née de
l'imagination de Monsieur Hulot, mais surtout en mettant en scène des
véhicules qui échappent totalement au contrôle de leurs
propriétaires. Ainsi, lors d'un carambolage mémorable, les
voitures se lancent dans une véritable chorégraphie dont les
conducteurs ne peuvent être que spectateurs. Un plan
particulièrement évocateur montre d'ailleurs une voiture
poursuivant une de ses roues en ouvrant et en refermant son capot comme un
prédateur qui cherche à attraper sa proie. L'automobile, en tant
qu'élément incontournable de la vie moderne, s'invite donc dans
le cercle des protagonistes, au point de voler la vedette aux héros
habituels.
Fils d'un concessionnaire, John Lasseter a toujours
été fasciné par les automobiles. Dans le prolongement de
sa recherche sur les objets animés, il s'est logiquement lancé
dans la réalisation d'un film ayant des voitures pour personnages. Dans
Cars (2006), les humains sont totalement évacués, ou
plutôt remplacés par des véhicules anthropomorphes. Pour
rompre avec l'aspect traditionnel de la voiture animée les
créateurs des personnages placent les yeux au niveau du pare-brise, et
non au niveau des phares, effaçant définitivement
l'éventualité d'une présence humaine. Pourtant,
l'essentiel du langage comique du film consiste en l'application
systématique des moeurs humaines au monde mécanique. L'homme
remplacé par la voiture n'a paradoxalement jamais été
aussi présent. Si la définition du rire selon Bergson se
résume par « du mécanique plaqué sur du vivant
»1, la réciproque semble vérifiée.
L'automobile a tenté de s'imposer en tant que
personnage burlesque à part entière en reléguant le
protagoniste au statut de victime de l'action. Mais la relative domination du
mécanique sur l'organique n'est qu'une façon de renforcer la
place du vivant dans le langage comique. Car un objet, en soi, n'est pas
drôle s'il n'interagit pas avec l'humain.
1 Henri BERGSON, Le Rire, Essai sur la signification du
comique, PUF, 2007.
48
Ainsi, une voiture prise d'une envie de liberté,
pourrait très bien se mettre à rouler toute seule, elle ne serait
drôle qu'avec le concours d'un être vivant. Un film en prise de vue
réelle ne permettrait donc pas de développer une histoire telle
que celle de Cars, pour la simple raison que l'absence physique de
l'organique ne pourrait être remplacée par sa présence
psychologique. Car la crédibilité des personnages du film de
Lasseter repose avant tout sur le fait que ces véhicules
présentent des facultés purement humaines. L'animation est donc
un moyen de fusionner deux concepts qui, a priori, ne peuvent cohabiter sans
conséquences dommageables (la voiture dans le slapstick est
synonyme, au mieux d'une panne, au pire, d'un carambolage) : l'homme et sa
monture des temps modernes.
I.2/ Le tapis roulant ou la fatalité
mécanique
C'est justement dans Modern Times (Charlie Chaplin,
1936) que le tapis roulant (ou convoyeur) prend le relais de la voiture pour
faire subir les affres de la mécanique au héros burlesque.
Symbole par excellence de l'automatisation du travail, le convoyeur imprime un
rythme que l'ouvrier doit impérativement suivre pour ne pas perturber la
chaîne de production. Là où Chaplin utilisait cet
élément comme une métaphore de l'aliénation par le
travail, le studio Pixar exploite le convoyeur comme un outil narratif
supplémentaire.
Car chez Pixar, le tapis roulant n'entre pas dans une logique
d'aliénation du personnage. Dans Monsters Inc., il est
plutôt synonyme de mort. Et quand Sully croit que sa
protégée est passée par le vide-ordure, il ne peut que
constater avec horreur le sort réservé aux déchets.
Alternent alors des plans du cheminement des ordures sur un tapis roulant et
des plans rapprochés de Sully, derrière une vitre,
réagissant à chaque étape de la compression des
détritus. Dans ce cas précis, il s'agit d'illustrer l'impuissance
du vivant face à la machine. Aux énormes pilons, lames et
rouleaux compresseurs qui ponctuent le convoyeur, répondent les grimaces
d'effroi de Sully. Car la mécanique imperturbable du système ne
laisse aucune chance de survie à quiconque la traverse, a fortiori
lorsqu'il s'agit d'un enfant. Cette séquence reste néanmoins
comique puisque, contrairement au héros, le spectateur sait qu'elle
n'aura pas d'issue fatale. Ce montage alterné cristallise alors
49
l'opposition entre la mécanique froide et
inéluctable du tapis roulant et la sensibilité exacerbée
du vivant.
Le motif du tapis roulant qui conduit à la mort
réapparaît dans Toy Story 3. Une fois encore, les jouets
suivent le chemin des ordures, de la poubelle à la décharge en
passant par le camion-benne. Mais dès l'instant où ils se
retrouvent sur un convoyeur, l'intrigue prend une tournure dramatique d'une
rare ampleur dans un film d'animation. Car ce ne sont plus les personnages qui
impriment leur rythme à l'action, mais le tapis roulant. Les jouets se
démènent pour rester maîtres de la situation, en vain. Le
mouvement continu de ce mécanisme oblige les protagonistes à
suivre son rythme, à l'image du sportif qui s'entraîne sur son
tapis de course. Malheureusement pour eux, les jouets ne sont pas assez rapides
et ne peuvent que regarder ce qui les attend. Après avoir
échappé de justesse au broyage, ils atteignent le bout du
convoyeur et sont plongés dans un gigantesque amas de détritus
pulvérisés, voués à être engloutis par la
fournaise qui se trouve face à eux. Pris dans cet immense tourbillon de
plastique en fusion, les héros n'ont plus aucune prise sur leur destin,
comme sur ce qui les entoure, car tout se dérobe sous leurs mains. C'est
à ce moment que le film atteint son sommet dramatique. Les personnages
échangent des regards désespérés, puis finissent
par se prendre par la main, unis face à la mort. Le tapis roulant est
donc, chez Pixar, plutôt que la promesse d'une issue fatale, la mort
elle-même, car la fournaise vers laquelle se dirigent les héros
fait écho, dans l'inconscient collectif, à la
représentation de l'enfer.
En effet, à la mécanique froide et radicale
présente dans Monsters Inc., répond la chaleur intense
du destin funeste des jouets de Toy Story 3. Dans les deux cas, le
tapis roulant matérialise la mort, mais c'est surtout à travers
le deuxième exemple que ce procédé prend une dimension
supérieure. Finalement, ces marionnettes sont renvoyées à
leur condition d'objet : puisqu'elles ne remplissent plus leur fonction
divertissante, elles sont mises au rebut, vouées à la
destruction.
50
I.3/ Prendre les commandes
La plupart des héros burlesques ont ce point commun de
vouloir s'accaparer le monde, l'adapter pour mieux le posséder, le
maîtriser. Ainsi, dans Monsters Inc., la porte de l'appartement
de Mike et Sully a été adaptée à leur
différence de taille. Une petite porte a été
ajoutée à celle d'origine (annexe 42). Car à quoi
bon ouvrir une porte si grande si le personnage qui sort est si petit ? La
prise du pouvoir par les machines est donc un frein à cet apprivoisement
du monde, le héros Pixar va donc tenter d'enrayer cette mécanique
immuable. Mais la voiture et le tapis roulant ne sont que les symboles d'un
monde moderne auquel le protagoniste semble avoir du mal à s'adapter.
Partout autour de lui se manifestent des machines capricieuses et complexes
dont il tente de prendre le contrôle, non sans mal.
Le cas de Rex, le tyrannosaure en plastique de Toy
Story, qui n'arrive pas à jouer à la console vidéo
à cause de ses bras trop courts, inaugure ce rapport délicat aux
machines, à l'électronique. En dehors de ce problème
purement physique, le héros Pixar semble se poser une question
récurrente : sur quel bouton appuyer ? Ainsi, lorsque Wall-e est
propulsé du vaisseau dans une capsule programmée pour
s'auto-détruire, l'incompréhension s'ajoute à la panique.
Dans cette situation, le réflexe du robot est d'actionner un
énorme bouton rouge clignotant. Bien sûr, son action n'a aucun
effet, et Wall-e se met à appuyer désespérément sur
tous les éléments du tableau de bord. Mais la profusion
d'indications n'aide pas le héros à se sortir de cette situation
délicate (annexe 43). Au contraire, cela renforce sa solitude
car, dans sa panique, Wall-e déclenche tout un éventail de
fonctions totalement inutiles. Un plan large montre alors la capsule dans
l'immensité de l'espace, et le déploiement de ses accessoires :
une antenne, un radar, des fusées de détresse, un parachute, un
radeau pneumatique, et enfin un klaxon. Le ridicule de cette situation
révèle non seulement l'incapacité du personnage, mais
aussi l'absurdité d'un appareil ultra-sophistiqué qui,
malgré toutes ces options destinées à la
sécurité de son passager, ne fait qu'entraver sa survie.
Mais la panique liée à l'urgence se mue parfois
en simple stress, comme dans Lifted (2006), où Stu, un jeune
extraterrestre, doit piloter une soucoupe volante sous le contrôle d'un
inspecteur. L'immense console devant laquelle il se trouve laisse augurer une
grande
51
confusion chez le héros. Soumis à un
véritable examen, Stu hésite et finit inévitablement par
faire le mauvais choix. Le réalisateur, Gary Rydstrom, directeur du son
sur la majeure partie des films du studio, explique comment il a imaginé
ce tableau de bord :
« Quand je faisais du mixage, je travaillais avec une
énorme console pleine d'atténuateurs et de boutons et tout le
monde se demandait comment je faisais. Mon métier se résumait
à commander cette machine infernale tout en étant jugé par
les gens. On a essayé de créer la pire console qui puisse
exister. »1 (annexe 44).
Stu se retrouve donc face à des milliers de boutons
identiques et sans aucune indication. Contrairement à la capsule de
Wall-e, la soucoupe volante se caractérise par la
simplicité de sa forme et l'inexistence d'informations concernant sa
prise en main. En outre, le corps vert et gélatineux (donc
malléable) de Stu s'oppose à la grise monotonie des
rangées de boutons métalliques qui se présentent à
lui, renforçant ainsi l'idée de l'incompatibilité de
l'extra-terrestre et de la console.
Qu'il y ait surenchères ou absence d'informations, le
résultat est le même, prendre les commandes de la machine reste,
pour le héros Pixar, un véritable défi. Les
différentes mises en scène de ces situations soulignent la
même solitude du héros face à des circuits complexes qui le
renvoient à son incompétence. Cela n'est pas sans rappeler le
vieux personnage de Playtime qui, lorsqu'il annonce l'arrivée
de Monsieur Hulot, doit utiliser un tableau électronique
incompréhensible. Là aussi, l'hésitation et l'inaptitude
sont les principaux ressorts comiques de la scène.
Finalement, chez Pixar, les rapports entre les personnages et
les machines relèvent presque toujours de l'opposition radicale. La
voiture, le tapis roulant ou n'importe quel autre système
mécano-électrique incarnent une menace pour le vivant, mais c'est
justement ce qui permet de faire ressortir la difficile relation du personnage
avec le monde qui l'entoure : un univers peuplé de boutons en tous
genres, de commandes aux fonctions insondables. Pour ne pas se laisser
manipulé par la machine, le héros burlesque doit tenter de
comprendre son fonctionnement, même si cela doit passer par des essais
infructueux. L'hostilité de la technique est donc le vecteur de
l'apprentissage du monde par des personnages qui lui sont initialement
inadaptés.
1 Gary Rydstrom, dans les commentaires du DVD de
Lifted.
52
CHAPITRE II : INDIVIDUS ET COMMUNAUTÉS
Tous les personnages issus des studios Pixar peuvent se
rattacher à une communauté, c'est-à-dire à un
groupe de personnes (par extension, cette définition s'applique aussi
aux animaux et aux objets) habitant dans un même lieu et pouvant partager
des intérêts communs. Mais le héros Pixar est un individu
au sens premier du terme : un être considéré comme distinct
par rapport au groupe auquel il est censé appartenir, typique du
personnage burlesque. Il s'agit alors de déterminer ce qui fait de ces
héros des personnages à part, en traitant d'abord des
manifestations d'une marginalité qui menace chacun d'eux, puis en
essayant de comprendre comment ces héros peuvent remédier
à cette mise à l'écart à travers la recherche de
leur identité.
II.1/ La norme et la marge
II.1.1/ De la particularité physique à la
marginalité
La plupart des héros burlesques peuvent se
résumer par leur silhouette bien spécifique. Charlot se distingue
par ses vêtements trop larges et son chapeau melon, Harold Lloyd par son
canotier et ses lunettes rondes, Monsieur Hulot par son grand corps oblique et
sa pipe. Ses silhouettes complètent souvent un physique particulier,
comme celui de Fatty, sorte de poupon géant. Le personnage burlesque est
donc trop petit, trop grand, trop gros, en bref, il n'entre pas dans la norme.
Mais comme le rappelle Chuck Jones, « si dix toiles sont
accrochées au mur, la seule qui risque d'attirer l'attention est celle
qui est de travers. Ne serait-ce que parce qu'elle met les gens mal à
l'aise, ce qui peut s'avérer utile. »1 Certains
personnages Pixar correspondent à cette approche du personnage en tant
qu' individu à part. Ceux-ci sont reconnaissables entre mille parce
qu'il sont physiquement différents.
1 Chuck JONES, Chuck Jones ou l'autobiographie
débridée du créateur de Bip-Bip, du coyote et leurs
amis, Dreamland, 1995, p.16.
53
Ainsi, dans For the Birds l'oiseau qui retient
l'attention du spectateur est le plus grand. Les autres, bien que dotés
d'une personnalité qui leur est propre, sont identiques entre eux. S'il
ne s'agissait pas d'un film comique, ce grand oiseau arriverait sur la ligne
à haute tension, se poserait avec autorité au milieu des petits
et bomberait le torse en faisant trembler ses voisins. Ici, le plus grand tente
de se faire accepter (après tout, il est bleu, comme les autres), mais
sa taille est plus un handicap qu'une force. Et lorsque, d'un air avenant, il
interpelle la bande, celle-ci lui répond par des moqueries. La
particularité physique de l'animal constitue un frein à son
insertion, d'autant plus que son poids entraîne l'inconfort de ses
détracteurs (annexe 45). Ce film symbolise à lui seul le
drame des personnages Pixar qui tentent d'exister dans un monde qui leur est
hostile.
Déjà dans Red's Dream, le monocycle
était mis à l'écart à cause de son physique.
Soldé car difficile à vendre, il se retrouve dans un coin,
d'autant plus isolé qu'il s'apparente plus à la pompe à
vélo située à côté de lui qu'aux bicyclettes
de la boutique (annexe 46). Cette fois, la différence entre le
groupe et l'individu est mise en avant par la ressemblance à un objet
complètement exclu de cette communauté.
Quant à Nemo, il est unique avant de naître. Sa
mère a été tuée par un barracuda, tandis que ses
milliers de frères et soeurs ont été engloutis par le
prédateur. Marin, son père, découvre qu'un seul oeuf a
survécu, celui de Nemo. Dès lors, il prendra soin de son fils,
jusqu'à le surprotéger, prétextant que sa nageoire droite,
atrophiée, l'expose encore plus aux dangers de la mer. Nemo, de par ce
handicap, reste dans le giron paternel et n'entre en contact avec le monde
extérieur que lorsqu'il doit entrer à l'école. Ici, la
communauté sous-marine ne rejette pas Nemo, mais son père semble
savoir que, dans ce monde, il ne fait pas bon être différent.
La particularité physique chez le personnage Pixar est,
plus qu'un simple moyen de distinguer le héros des autres, un outil
narratif extrêmement efficace, puisqu'elle permet de donner toute son
épaisseur au personnage. Dès lors qu'un individu marginal se
présente à la communauté, la réaction de l'un par
rapport aux autres (et inversement) est, sinon le point de départ de
l'intrigue, son basculement, la clé qui mène au
dénouement.
54
II.1.2/ De l'isolement spatial à l'isolement
social
Certes la différence physique est un critère de
marginalité, et Nick, le héros de Knick-Knack (John
Lasseter, 1988), en est une bonne illustration. Mais ce qui caractérise
vraiment ce personnage, c'est son isolement spatial. En effet, le film commence
par l'exposition de bibelots (knick-knack), souvenirs de vacances
rapportés de Miami, d'Égypte, etc. Tous ces bibelots sont des
personnages joyeux, colorés, et portent des lunettes de soleil. Un long
panoramique dévoile le héros du film : un bonhomme de neige,
enfermé dans sa boule de verre. Nick est seul dans sa froideur, face
à la chaleur renvoyée par les autres souvenirs, et à leurs
lunettes de soleil répondent son haut de forme et son écharpe.
L'isolement spatial de sa ville d'origine, Nome, en Alaska, est restitué
à travers la distance qui sépare le héros des autres, et
par la paroi de verre qui l'enferme dans sa solitude. Cette séparation
physique, ajoutée à d'aussi nettes différences entre le
héros et ceux qu'il aspire à rejoindre, suffit pour le
marginaliser définitivement. D'autant plus que cet isolement est aussi
sonore car son environnement liquide ne lui permet pas de parler. Nick se
contente alors de communiquer avec le spectateur par le biais du regard
caméra. Ce procédé largement utilisé, en
particulier dans le genre burlesque, consiste à prendre le spectateur
à témoin. Oliver Hardy a d'ailleurs élevé ce type
de regard au rang d'art, y « apportant un nombre considérable
de nuances [É], le coup d'oeil pouvant être de complicité,
de colère, de conspiration, d'exaspération, de
résignation, d'embarras[...] ».1 Dans le cas de
Nick, il s'agit surtout de souligner sa triste condition d'objet
enfermé, mais en-dehors. Cette incommunicabilité le pousse donc
à sortir de sa bulle par tous les moyens. Après maintes
tentatives, sa boule à neige se renverse, et dans une chute vertigineuse
depuis le haut de son étagère, Nick parvient à sortir par
une issue de secours. Mais il tombe dans le bocal d'un poisson. Heureusement,
une magnifique sirène l'attend au fond de l'eau. Nick n'a pas le temps
de la rejoindre, sa boule à neige lui retombe dessus, l'enfermant
doublement. Quoiqu'il arrive, Nick ne peut échapper à son statut
de victime, le sort s'acharne contre lui, et son isolement (spatial et sonore)
est conforté malgré tous ses efforts.
Dans Partly Cloudy (Peter Sohn, 2009), la question de
l'isolement concerne Gus, un nuage qui, contrairement à ses
congénères, ne crée que des animaux dangereux, au grand
1 Roland LACOURBE, Laurel et Hardy ou l'enfance de
l'art, Ramsay, 1989, p.37.
55
dam de son partenaire, Peck, une cigogne chargée de
livrer ces bébés à leurs parents. Après avoir
essuyé les charges d'un petit bélier et les morsures d'un
crocodile, Peck quitte Gus pour aller voir un autre nuage, un peu plus haut. En
bas, Gus est définitivement seul, et commence à gronder, il
tonne, puis se met à pleuvoir, ne pouvant ni pleurer, ni parler. Encore
une fois, l'eau remplace la parole. Dans les deux cas, les personnages
n'acceptent pas leur isolement, car une peur persiste, celle d'être
écarté à jamais du reste de la communauté, de ne
pas parvenir à exister parmi les autres.
II.1.3/ La hantise de l'oubli
Cette obsession du personnage animé à exister
à tout prix repose sur un principe simple, celui de sa capacité
à simuler la vie, alors qu'il n'est qu'inertie. La peur de l'oubli
serait en fait la peur de la disparition. Quand Mr. Incredible parvient
à être maîtrisé par son ennemi, c'est en se faisant
engloutir par des boules noires caoutchouteuses (annexe 47). Le
héros, enseveli est littéralement effacé de l'image,
malgré tous ses efforts pour y rester. Cette hantise concerne aussi
Woody, à travers toute la trilogie Toy Story.
Dans le premier épisode, le cowboy est le jouet
préféré d'Andy, avant que ne débarque Buzz
l'éclair qu'il considère immédiatement comme un
concurrent. Le second volet de ses aventures commence par sa mise au rebut sur
une étagère haut perchée, à cause d'un bras
décousu. De son perchoir poussiéreux, Woody constate
amèrement qu'il peut être oublié, surtout lorsqu'il entend
la mère d'Andy dire : « Tu sais, les jouets ne sont pas
éternels. » La séquence du cauchemar de Woody est
particulièrement éloquente en ce qui concerne cette peur de
disparaître. Quand Andy rentre dans sa chambre, il se saisit de Woody,
puis le laisse tomber négligemment. Le jouet traverse alors un tas de
cartes, lesquelles sont toutes des as de pique, c'est-à-dire la
représentation de la mort au tarot. Woody atterrit finalement dans une
poubelle où il est absorbé par une armée de bras issus de
jouets cassés (annexe 48). Une fois encore, l'inutilité
est synonyme de mort pour les jouets, comme dans la séquence de la
décharge de Toy Story 3. Cela s'avère aussi exact pour
toutes les créatures issues du studio, ces objets vivants et autres
corps objets qui doivent servir à quelque chose ou disparaître
dans l'anonymat.
56
II.2/ À la recherche d'une identité
II.2.1/ La représentation du Moi
La peur de la mort n'est pas la seule préoccupation de
ces personnages. Car, pour parvenir à exister au sein d'une
communauté qui les rejette, ils doivent avant tout savoir qui ils sont.
Cette quête de l'identité passe notamment par la question de
l'image que renvoient ces personnages à eux-mêmes. En effet,
nombreux sont ces héros qui ne parviennent pas à se situer dans
leur univers, à s'affirmer en tant qu'individu à part
entière. Quand il ne s'agit pas d'une défiguration
perpétuelle (Mr. Patate), c'est un véritable travestissement qui
vient court-circuiter l'identification du protagoniste. C'est ainsi que Buzz se
retrouve en pleine crise existentielle après avoir été
contraint par la petite soeur d'Andy de prendre le thé avec des
poupées (annexe 49), ou que Wall-e se retrouve maquillée
par un robot défaillant issu d'un institut de beauté. Le
travestissement reste une constante dans les films burlesques, mais il reste,
la plupart du temps, volontaire, comme ce fut le cas pour Laurel et Hardy,
véritables adeptes du double rôle mari et femme.
Cependant, cette représentation est souvent
prétexte à des malentendus profonds concernant la nature du
personnage. Dans l'esprit d'Andy, comme dans l'esprit de beaucoup d'enfants,
Rex est censé être un terrible prédateur. Mais le pauvre
dinosaure ne fait que s'entraîner à faire peur, complexé
par la taille de ses bras. Quant à Marin, il est
appréhendé par des parents lorsqu'il amène Nemo à
l'école. Ceux-ci lui demandent de les faire rire, puisque c'est un
poisson-clown. Malheureusement pour Marin, sa timidité et sa maladresse
pour raconter des blagues déçoivent son public et le range dans
la catégorie des perdants, des êtres inintéressants.
La relation délicate du héros Pixar avec le
monde qui l'entoure commence donc par la difficulté qu'il a à
concilier ce qu'il doit représenter et ce qu'il est réellement.
C'est sur cela que repose le dilemme de Woody dans Toy Story 2, quand
il découvre qu'il est le héros d'une série
télévisée, et une pièce de musée pour les
collectionneurs (annexe 50).
57
II.2.2/ La multitude du même
La réaction de Woody face aux produits
dérivés à son effigie lui fait prendre conscience de son
statut d'objet rare. La réaction du collectionneur à sa vue ne
laisse aucun doute sur la valeur de la figurine. En cela, Woody se distingue de
Buzz qui, dans le premier volet, comprend qu'il n'est qu'un jouet reproduit par
milliers en voyant la publicité de Buzz l'éclair à la
télévision (annexe 51). Le long couloir de jouets
visible à l'écran réapparaît dans Toy Story 2
(annexe 52). Cette fois, Buzz doit non seulement faire face à la
réalité, mais il affronte un deuxième Buzz l'éclair
qui le prend pour un imposteur. Une fois encore, le héros prouvera son
identité par son unicité en montrant à ses amis le nom
d'Andy inscrit sous son pied. Dans le troisième volet, le même
personnage se transforme en romantique espagnol suite à une
réinitialisation qui a mal tournée. De tous les héros du
studio Pixar, Buzz est celui qui est confronté au plus grand nombre de
déclinaisons de sa personne. Finalement, c'est en prenant conscience
qu'il n'est pas un super-héros mais un jouet parmi d'autres, qu'il
parvient à faire le chemin inverse, du banal à l'unique,
construisant ainsi sa propre identité. À travers le cas de Buzz,
les créateurs de tous ces personnages se jouent de leur héros et
démontrent également qu'il ne suffit pas d'imiter pour
égaler, n'en déplaise à leurs concurrents.
La multitude du même est d'ailleurs un des axes majeurs
de The Playhouse (Buster Keaton, 1921), où
l'acteur-réalisateur s'amuse avec son image en incarnant tous les
personnages d'une représentation d'opéra, du public aux chanteurs
en passant par l'orchestre. Bien sûr, il s'agit d'un rêve, mais la
persistance d'une foule uniforme contamine plusieurs films de Keaton. Dans
Cops, c'est un troupeau de policiers, dans Seven Chances
(1925), ce sont des hordes de jeunes prétendantes toutes de blanc
vêtues, et enfin, dans Go West (1925), des centaines de vaches.
La foule (pour)suit le héros, comme pour mieux faire ressortir son
individualité. Dans Finding Nemo, Marin doit faire face
à un gigantesque banc de méduses. Le contraste entre la petite
taille du poisson et cette masse uniforme, renvoie le héros à sa
solitude, au fait qu'il n'est intégré à aucun groupe et
qu'il va devoir lutter contre ses peurs pour s'affranchir de cette situation
(annexe 53).
58
II.2.3/ Duos comiques
Pour mieux saisir le personnage dans toute son
individualité, il faut aussi s'intéresser à son partenaire
à l'écran. Car les personnages Pixar, bien que souvent
isolés, ne sont jamais totalement seuls. De véritables duos
comiques se mettent en place, faisant ressortir le meilleur comme le pire de
chacun, une bonne façon de définir des personnages.
Un des tandem les plus développés chez Pixar
reste celui de Woody et Buzz, de par un champ plus large couvert par leurs
aventures (trois films au total). En effet, ces deux personnages forment le duo
comique par excellence. D'abord parce que leur physique fait ressortir tout ce
qui peut les opposer : Woody est un cowboy, vêtu de cuir et de tissu,
tandis que Buzz est un ranger de l'espace ultra-sophistiqué. La simple
mécanique de Woody se résume en une ficelle que l'on tire pour
faire parler le personnage, alors que Buzz est parcouru de boutons en tous
genres et prétend pouvoir voler. À travers ce duo, ce sont deux
grands mythes de la culture américaine qui se font face, le héros
de la conquête de l'Ouest et celui de la conquête de l'espace. Et
quand le premier se fait l'organisateur de la vie des jouets, le second
s'attache à réparer sa boîte qu'il prend pour un vaisseau,
afin de protéger la galaxie. Car Woody se caractérise par son
sens pratique, alors que Buzz est définitivement dans la lune. C'est
justement leurs différences qui rendent ces deux héros
complémentaires, et chacune des compétences de l'un répond
aux défaillances de l'autre.
Dans Finding Nemo, les différences ne sont pas
purement physiques, mais avant tout psychologiques entre Marin et Dory. Le
premier se caractérise par une prudence maladive, tandis que Dory, elle,
est l'inconscience même. Souffrant d'une absence de mémoire
immédiate, elle n'a aucune idée des risques qu'elle prend. Ce duo
devient comique quand la témérité de Dory entraîne
Marin dans des situations qu'il n'aurait jamais osé imaginer, comme dans
cette séquence surréaliste où les deux poissons se
retrouvent au milieu de trois requins affamés qui luttent contre leur
instinct en organisant des réunions à la manière des
alcooliques anonymes. La décontraction de Dory ne fait que renforcer les
craintes de Marin et creuse encore plus l'écart entre la
réalité et l'absurdité délirante de la situation.
Finalement, le duo se résume en une séquence, celle où les
deux personnages atteignent les abysses pour récupérer un masque
de plongée. Dans l'obscurité, Marin
59
s'adresse à Dory qui, bien sûr, a oublié
ce qui se passe. S'installe alors un dialogue dans lequel Marin se fait passer
pour la conscience de Dory afin qu'elle l'écoute attentivement. Car il
s'agit bien là de la clé de l'équilibre du duo : Marin est
la conscience qui leur permet de survivre malgré les dangers de
l'océan, tandis que Dory incarne l'inconscience qui pousse Marin
à dépasser ses peurs.
Le but premier des duos dans les films Pixar est de parvenir
à concilier deux personnages opposés pour installer un
décalage perpétuel qui va nourrir le pendant comique de
l'intrigue. Peu à peu, les deux héros font connaissance avec
l'autre et avec eux-mêmes, repoussent leurs limites, et commencent
à se forger une vraie identité.
60
CHAPITRE III : CONTRE L'ORDRE ÉTABLI
Si une certaine rivalité existe bel et bien entre les
différents héros de ces films, rien ne peut remettre en cause la
solidité de ces tandems. La célébrité de Sully,
véritable star à Monstroplis (Monsters Inc.),
n'entraîne pas pour autant la jalousie de Mike. Et quand les deux amis
regardent en direct la publicité dans laquelle ils ont tourné,
Mike ne s'offusque même pas d'être caché par le logo de leur
entreprise (annexe 54), tout comme sa jubilation fait oublier le fait
qu'il est dissimulé sous un code-barre à la une d'un magazine
(annexe 55). Mais le comportement de ce personnage n'est-il pas
typique du héros burlesque qui n'admet pas la logique du monde et qui
préfère se construire sa propre réalité ? C'est
d'abord une façon d'aller contre l'ordre établi,
c'est-à-dire de recréer les conditions d'une vraie liberté
d'esprit. Cela passe avant tout par un aveuglement complet des protagonistes au
profit de leur objectif, c'est notamment le cas dans la séquence de la
miraculeuse traversée de la rue dans Toy Story 2. De plus, ce
déni du monde est un moyen de réinterpréter le réel
pour ouvrir de nouvelles portes aux personnages. Ceci, afin de pouvoir adapter
la société au héros, et non le contraire.
61
III.1/ La traversée miraculeuse ou l'aveuglement
salutaire
Dans Toy Story 2, quand les amis de Woody
décident de retrouver leur leader, un obstacle de taille se
présente à eux, une rue dont le trafic est plutôt dense. La
projection d'une canette de soda écrasée par une voiture juste
devant les protagonistes, en démotive plus d'un. Mais la
détermination de Buzz a raison de leurs craintes. C'est ainsi qu'ils se
cachent sous des cônes de signalisation pour traverser en toute
discrétion. Mais dès qu'une voiture se dirige vers eux, les
personnages se figent, provoquant un dérapage du véhicule qui
fonce sur une herse et crève ses pneus. Les jouets reprennent leur
chemin tandis que d'autres voitures viennent percuter la première. C'est
ensuite un camion qui se met en travers de la route pour éviter ces
cônes de signalisation mobiles, après être passé
juste au-dessus d'eux. Les jouets, sans avoir conscience de la situation
suivent Buzz, mais Mr. Patate, qui a marché sur un chewing-gum, doit
rebrousser chemin pour récupérer son pied. Il évite de
justesse l'énorme rouleau tombé du camion qui risquait de
l'écraser. Tandis que tous se félicitent de leur réussite
sur le bord de la route, un lampadaire, percuté par le rouleau, vient
parachever le tableau en se couchant sur la chaussée (annexe
56). Cette séquence, dans ses moindres détails,
démontre l'extrême efficacité du hasard dans le domaine
comique. Car le hasard, quand il ne se range pas du côté du monde,
est le meilleur allié du personnage burlesque, « il se
manifeste de préférence comme un ange gardien »1.
En effet, une des images les plus marquantes du cinéma reste celle
de la façade tombant sur Buster Keaton sans le blesser, dans Steamboat
Bill Jr. (1928). Ce dernier, debout, sans bouger, n'a pas vu le danger venir et
c'est justement son ignorance qui l'a sauvé. En restant à sa
place, il passe comme par magie par le trou d'une fenêtre. Le hasard est
donc un élément déterminant dans l'agencement des
mouvements du monde et des personnages qui le peuplent. Les jouets, sains et
saufs, ne le seraient peut-être pas s'ils avaient eu conscience du
danger. Il s'agit pour eux de faire abstraction du monde pour mieux lui
échapper. Cet aveuglement salutaire transforme ce moment de bravoure en
un véritable miracle de synchronisation, car le hasard, lorsqu'il joue
sa partition, respecte un rythme bien précis et marque des pauses juste
au bon moment. L'inconscience et le hasard font donc bon ménage dans le
genre burlesque, d'autant plus que dans le cas d'un film d'animation, le hasard
ne peut pas se tromper. Finalement, ceux qui subissent les
1 Petr KRÀL, Le burlesque ou la morale de la tarte
à la crème, Ramsay, 2007, p.84.
62
conséquences de cette traversée sont les
automobilistes qui, malgré l'absurdité des indications
données par les cônes de signalisations, se plient aux
règles, tout comme les personnages des films de Tati sont soumis aux
panneaux indicateurs qui « se révèlent ordonnateurs, au
point qu'il semble quasiment impossible d'échapper à leur
prescription »1.
III.2/ Ré-interprétation du réel
En évacuant de sa pensée les obstacles qui
pourraient le ralentir dans sa mission, le héros burlesque tend à
une ré-interprétation du monde. Cette approche nécessite
une détermination des plus tenaces pour faire plier la
réalité face au rêve, mais également un sens profond
de l'alternative dans le rapport aux objets.
III.2.1/ De l'illusion à la réalité,
la victoire de l'obstination
Plusieurs personnages issus du studio Pixar ont en commun leur
volonté de ne pas se laisser décourager par les règles qui
régissent le monde. Remy décide de marcher debout pour ne pas
salir les mains avec lesquelles il cuisine, en dépit du fait que les
rats marchent à quatre pattes depuis qu'ils existent. Mais Remy ne
s'arrête pas là, car il brise une des règles
d'hygiène fondamentales en entrant dans une cuisine et en se permettant
d'améliorer une soupe en train de mijoter. Faisant fi des lois, le rat
risque de perdre à la fois la considération des siens et ses
infimes chances de pouvoir cuisiner. Remy se laisse guider par sa passion et
poursuit son ascension contre toute attente.
Mais cette manière d'évacuer la
réalité pour mieux la traverser relève souvent d'un
optimisme débordant chez le héros. En effet, quand sa colonie
envoie Flik chercher de l'aide à l'extérieur de l'île,
celui-ci ne comprend pas que tout le monde cherche à l'éloigner
pour ne pas subir sa maladresse. Lors de son départ, Flik s'adresse
à ses congénères en affirmant que la colonie est entre de
bonnes mains, puis se met en route. Après un long
1 Stéphane GOUDET, Jacques Tati, de François le
facteur à Monsieur Hulot, Cahiers du Cinéma, 2002, p.13.
63
silence d'étonnement, les fourmis poussent des cris de
soulagement que Flik interprète comme des encouragements. Il bombe le
torse, prend une grande inspiration et active son pas (annexe 57).
Ici, l'écart entre la vision du personnage principal et celle des autres
est tel que le malentendu qui s'installe rend Flik comique contre sa
volonté. C'est pourtant lui qui apportera la solution, devenant le
héros de toutes les fourmis.
La victoire de l'obstination est donc un moyen de
révéler à une communauté sceptique la
possibilité de renverser l'ordre des choses, en se libérant des
contraintes qui enferment les esprits.
III.2.2/ Autisme et détournement de l'objet
Pour François Truffaut, Charlot est comparable à
l'enfant autiste par son rapport aux objets. Il rapproche ainsi deux citations
:
« L'enfant autistique a moins peur des choses et agira
peut-être sur elles puisque ce sont les personnages et non les choses qui
semblent menacer son existence. Cependant, l'utilisation qu'il fait des choses
n'est pas celle pour laquelle elles furent conçues. »1
« Il semble que les objets n'acceptent d'aider Charlot
qu'en marge du sens que la société leur avait assigné. Le
plus bel exemple de ces décalages est la fameuse danse des petits pains
où la complicité de l'objet éclate dans un
chorégraphie gratuite. »2
Le personnage de Charlot serait donc une sorte d'autiste
donnant aux objets une utilité supérieure à leur fonction
initiale. Ce rapport spécifique à l'objet est d'ailleurs un des
éléments les plus importants dans Wall-e. Le petit
robot, abandonné par les hommes, et seul survivant de son genre, ne sait
pas comment s'utilisent les objets qu'il récolte au gré de ses
déambulations. Mais cette situation fait de lui le nouveau maître
des objets. Puisqu'il n'y a plus personne pour lui expliquer comment fonctionne
ce que l'homme a fabriqué, Wall-e peut leur attribuer de nouvelles
fonctions. C'est ainsi qu'il utilise le couvercle d'une poubelle comme un
canotier (attribut principal de la silhouette de Buster Keaton). L'objet, s'il
enlève toute dignité à celui qui le porte comme un
chapeau, prend une dimension poétique que personne ne
soupçonnait. Ici, l'autisme laisse la place à une imagination
1 Bruno BETTELHEIM, La forteresse vide, cité dans
André BAZIN, Éric ROMHER, Charlie Chaplin, Cerf,
Collection 7e art, Paris, 1973, p.9 (préface de François
Truffaut).
2 André BAZIN, ibid.
64
libérée de tout préjugé. La valeur
des choses est remise en question par ces détournement constants. Et
quand Wall-e trouve une boîte contenant une bague, il pousse un cri
d'admiration, lance le bijou avec désinvolture, sans quitter des yeux la
boîte dont le simple mécanisme d'ouverture et de fermeture le
fascine. En quelque sorte, plus rien n'a de sens qu'à travers le regard
désintéressé du robot. L'objet retrouve sa fonction
principale qui est l'utilité, la praticité.
65
III.3/ Renverser la vapeur
En tant que héros burlesque, le personnage Pixar est
avant tout un être qui refuse le fonctionnement du monde. Se jouant des
règles et des limites à sa fantaisie, il poursuit son chemin en
évitant, autant que faire se peut, de tomber dans le piège du
conformisme. Car c'est bien là que réside la force du genre
burlesque, dans ce décalage entre ce qui doit se passer et ce qui se
passe. Et le héros est là pour garantir, par sa maladresse, son
optimisme, son inconscience ou son obstination, cet écart qui est la
source du comique. Le slapstick est donc bien un genre « qui
rappelle la folie et le rêve, la transgression de toutes les limites et
bien sûr le potentiel subversif d'un cinéma qui s'en prend
à toutes les formes de pouvoir et décourage toutes les
vanités ».1 Dans la filmographie Pixar, trois
héros symbolisent cette transgression des règles. Il y a d'abord
Bob Parr et sa difficile relation avec une société trop
étroite pour lui, vient ensuite Wall-e qui fait rejaillir la folie au
coeur de l'humanité, et enfin, Flik qui parvient à renverser
l'organisation de sa colonie grâce à une nouvelle vision des
choses.
III.3.1/ Bob Parr ou l'étroitesse du monde
Dans The Incredibles, Dash, le fils, se plaint
auprès de sa mère de ne pas avoir le droit d'utiliser son
pouvoir. Sa mère argumente en disant que « Tout le monde est
exceptionnel », mais Dash lui répond : « Autrement
dit personne ne l'est. » La frustration de l'enfant traduit ici le
problème de bon nombre de super-héros qui ne comprennent pas que
la société refuse leurs pouvoirs. Car ces pouvoirs sont une part
de leur identité, et les cacher revient à ne pas
s'épanouir pleinement.
C'est le cas de Bob Parr. Cet ancien super-héros
indestructible, autrefois adulé par ses concitoyens est désormais
cantonné à un service d'assurance des plus ennuyeux, dans un
bureau trop petit pour lui. Le monde dans lequel il est censé
évolué est trop étroit pour sa taille, pour ses envies,
pour ses pouvoirs. Condamné à vivre comme tout le monde, il doit
contenir sa force surhumaine, tout en acceptant d'être humilié par
un patron cynique et
1 Emmanuel DREUX, Le cinéma burlesque ou la subversion
par le geste, L'Harmattan, 2007, p.42.
66
minuscule. La frustration est donc double. Et quand ce patron
dépasse les bornes, Mr. Incredible prend le dessus sur Bob Parr
(annexe 58). Après l'avoir envoyé à
l'hôpital, il est renvoyé de son travail et rejoint sa maison sans
rien dire, pour ne pas décevoir sa femme qui, elle, aspire à une
vie de famille des plus normales.
Sur le chemin du retour, Bob est bien évidemment pris
dans les embouteillages, engoncé dans une voiture trop petit pour lui,
il est encore une fois contraint de subir l'inefficacité de la
société, tout comme les personnages de Trafic (annexe
59). La voiture de Bob est un élément
révélateur de sa frustration. Contrastant avec son ancien
véhicule de super-héros, elle est tout ce qu'il y a de plus
banale. Il faut ajouter à cela que dans cette scène où Bob
descend de sa voiture et déforme la carrosserie pour éviter de
tomber, l'auto se moque un peu plus de lui. Car lorsque Bob veut fermer la
portière, elle ne fonctionne pas. Excédé, il la claque de
toutes ses forces et le choc brise la vitre. Bob s'empare alors de la voiture
et s'apprête à la jeter, mais en se retournant, il
s'aperçoit qu'un enfant l'observe ébahi, et repose doucement son
véhicule.
Dans la cellule familiale, la situation est la même. Et
au cours du fameux dîner des Parr, Bob, perdu dans ses pensées,
découpe la table sans s'en rendre compte, après avoir
coupé la viande de son fils. Ce plan résume tout le
problème du héros pris dans l'étau du système,
condamné à contenir sa force toute sa vie pour ne pas
gâcher celle de sa famille.
Cette pression sociale et familiale, Bob s'en évade en
acceptant une mission qui le replonge dans ses souvenirs. Une fois encore,
l'étroitesse du monde le ramène à la réalité
quand il essaie d'enfiler son costume d'autrefois, car les années ont
passée et sa silhouette n'est plus la même. Après un
passage chez sa costumière, il devient à nouveau Mr. Incredible.
Mais, au-delà de son costume, les passages par lesquels il doit
accéder à sa mission s'avèrent, eux-aussi, trop
étroits pour son gabarit (annexe 60).
Au final, si ces plans relèvent souvent du langage
comique, ils sont surtout une métaphore de la situation psychologique
d'un personnage qui ne s'épanouit pas dans cette société
inadaptée à ses pouvoirs, et qui risque à tout moment
d'exploser.
67
III.3.2/ Wall-e ou la revanche de la folie
Quand Wall-e arrive sur l'Axiom, il découvre une
société humaine totalement couvée par les robots (le
vaisseau compte 500 000 robots pour 5 000 humains)1. Rapidement, il
est dépassé par le trafic des passagers, véritables
limaces qui passent leur temps allongés sur des fauteuils en
lévitation. Comme tout personnage burlesque qui se respecte, il provoque
un accident en se mettant en travers de la route d'un de ces passagers, John
(annexe 61). Devant tant d'automatismes, Wall-e, habitués
à sa solitude et à sa liberté de mouvement, est vite
repéré par les robots comme un éléments
perturbateurs, et se retrouve enfermé dans une cellule de verre, en vue
d'être réparé. Mais après avoir brisé la
vitre qui le retenait, Wall-e déverrouille par erreur les autres
cellules. Porté en triomphe par une bande de robots défectueux,
il devient l'ennemi public numéro un sur le vaisseau.
Si le petit robot a été conçu en pensant
à Buster Keaton pour l'expression corporelle, c'est véritablement
sur le vaisseau qu'un parallèle peut être fait avec ce
génie burlesque. Car, Wall-e suit la même trajectoire que Keaton
dans Go West. En effet, quand Keaton arrive dans la ville, il se fait
littéralement piétiné par les passants, victime, comme
Wall-e, de l'indifférence des automatismes. Après s'être
entiché d'une vache, Keaton décide de la suivre sur le chemin de
l'abattoir pour la libérer. Dans son élan, il libère tout
un troupeau qui commence à le suivre à travers la ville, donnant
au héros la possibilité d'une revanche sur ceux qui le
piétinaient. Or, si Wall-e libère les robots mis au rebut, c'est
avant tout parce qu'il tente de libérer Eve, dont il est amoureux. Et
à partir du moment où Wall-e devient leur héros, il est
suivi fidèlement par toute la troupe, prenant, lui aussi une revanche
involontaire sur un système qui le balayait.
L'influence de Keaton a donc été décisive
sur le personnage, mais aussi sur le schéma narratif. Car Andrew
Stanton, le réalisateur, a déclaré qu'il projetait un film
de Keaton à chaque pause déjeuner de son
équipe2. Le scénario de Go West a semble-t-il
nettement influencé le développement de l'histoire.
1 COLLECTIF, Pixarpedia, a complete guide to the world of
Pixar... and beyond I, DK Publishing, p.277.
2 Tim HAUSER, The Art of Wall-e, Chronicle Books,
p.9.
68
Mais Wall-e n'est pas que l'héritier de Keaton. Bien
qu'il soit lui aussi la cible d'une foule de policiers (en l'occurrence, des
robots-policiers) (annexe 62), il est surtout la source de
l'instillation de la folie dans un lieu où tout est rationnel et
pré-réglé. Dans Playtime, Monsieur Hulot brise la
porte vitrée du Royal Garden, laissant ainsi la liberté de
circuler aux individus qui ne pouvaient pas entrer dans ce lieu bourgeois et
fermé. À partir de ce moment, la folie gagne le restaurant et le
rend définitivement plus vivant.
Wall-e se trouve donc à mi-chemin entre Buster Keaton
et Monsieur Hulot, comme eux, il n'est d'ailleurs pas maître de ses
déplacements, et provoque involontairement le déferlement d'une
folie salvatrice dans un monde organisé et froid. C'est d'ailleurs lui
qui redonne naissance à l'humanité en lui faisant prendre
conscience de l'absurdité de sa condition. La révolte des humains
contre l'ordre des machines commencent avec John et Mary qui, après
avoir rencontré Wall-e, détachent leurs yeux des écrans
pour découvrir une gigantesque piscine. Ils vont alors batifoler
près de l'eau, quand un robot leur rappelle qu'il est interdit
d'éclabousser. John, dans un élan de liberté,
répond à cette interdiction en lançant de l'eau au robot,
immédiatement mis hors-service. Ce simple geste résume à
lui seul le basculement de la servitude à l'indépendance. Car
c'est bien de cela qu'il s'agit quand le capitaine du vaisseau comprend que le
système dans lequel ils sont enfermés n'est dû qu'à
la paresse servile de l'homme. Il reprend d'ailleurs les commandes en se
mettant debout, un exploit qui fait des émules parmi les passagers du
vaisseau. Paradoxalement, c'est un robot qui redonne ce nouveau souffle
à l'humanité, qui finit par retourner sur sa planète pour
se remettre à cultiver.
III.3.3/ Flik et la révolution des fourmis
Le cas de Flik est symptomatique de la progression du
personnage burlesque. En effet, il passe du statut d'incompétent notoire
à celui de leader politique. Car en partant chercher de l'aide en dehors
de sa colonie, la fourmi sort du carcan des traditions et peut laisser libre
court à son imagination, à sa pensée.
69
À travers ce personnage, c'est tout un discours
marxiste qui parcourt le film. Les fourmis travaillent toute l'année
pour rassembler de la nourriture destinée à une bande de criquets
qui les opprime. Le chef de cette bande explique d'ailleurs à ces
acolytes que cette oppression est nécessaire pour garder le
contrôle de la situation :
« On laisse une seule de ces fourmis se rebeller, et un
jour elles se rebellent en masse ! Ces fourmis de rien du tout sont deux cent
fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela et notre
paradis devient l'enfer ! »
C'est bien de conscience qu'il s'agit, puisque cette phrase
fait écho à la théorie de Marx concernant la conscience de
classe. Les fourmis, en acceptant de travailler pour les criquets, forment une
classe en soi, elles n'ont pas conscience de leur force. C'est
justement Flik qui va leur révéler la puissance du nombre, en
s'opposant au chef des criquets à la fin du film :
« Nous ne sommes pas vos esclaves. Les fourmis
accomplissent des prouesses. Année après année, elles
récoltent la nourriture pour leur peuple et pour le votre. Alors qui est
l'espèce inférieure ? Nous ne sommes pas vos esclaves. C'est vous
qui avez besoin de nous. Nous sommes plus forts que vous ne le laissez
croire... et vous le savez, j'en suis sûr. »
Cette tirade de Flik transforme la colonie de fourmis en une
classe pour soi, car elles prennent conscience de la force et du poids
qu'elles représentent pour défendre leurs intérêts.
Par cet accomplissement du héros, Flik clôt le schéma
inhérent au personnage burlesque. Après avoir été
moqué par toute la colonie, il parvient à se faire accepter par
les siens, avant de prendre totalement les commandes pour renverser le
système traditionnel. Flik suit bien le cheminement classique qui
consiste à passer de l'inadaptation à l'adaptation, puis à
la sur-adaptation.
70
CONCLUSION
À la lumière des caractéristiques de tous
ces personnages, il est évident que le corps animé, même
par ordinateur, est un excellent support pour le langage comique. La
capacité des animateurs à recréer le mouvement et la
matérialité, des objets comme des animaux, prouve le potentiel
expressif d'une telle technique. Brûlé, étiré,
écartelé, compressé, le personnage Pixar est avant tout un
corps qui semble pouvoir tout supporter, malgré un sort qui s'acharne
souvent sur lui. Dans toute la filmographie du studio, le corps est
l'unité de mesure. Tout se rapporte à lui : les disproportions
comme le rythme de l'action. Le corps, par ses mouvements, bat la mesure de
l'action, il est la référence principale, le centre de
gravité de l'image. Et si les personnages dansent, gesticulent, ou
courent dans tous les sens, il leur arrive souvent de se figer, comme pour
mieux souligner leur capacité à se mouvoir. Cette liberté
de mouvement place aussi le héros animé dans un monde qui ne lui
est pas forcément adapté. En cela, les personnages Pixar se
jouent des limites entre le rêve (l'espace filmique) et la
réalité. S'échappant du champ d'action qui leur est
réservé, ils contaminent le hors-champ par leur maladresse et
d'autres films par leur simple volonté de continuer à exister. Le
corps burlesque est ici utilisé comme une porte vers le merveilleux, et
se pose logiquement en maître du divertissement en tous genres. De la
comédie musicale à la magie, en passant par les arts du cirque,
rien ne résiste à cette vocation du spectaculaire. À
travers ces multiples représentations, le corps animé exploite le
champ des possibles (et de l'impossible), et donne à voir autre chose
que sa propre matérialité. En effet, il s'agit plutôt de
révéler une personnalité, un individu derrière ce
corps. Car la plupart des personnages Pixar sont avant tout des marginaux,
exclus de la communauté à laquelle ils sont censés
appartenir, souvent parce qu'ils ne voient pas le monde de la même
façon. Cette conception particulière de la société,
et de son environnement, le personnage burlesque l'exploite pour donner un
autre sens aux choses. C'est une manière de montrer que, bien qu'il soit
inadapté au monde, le héros fait fi de la norme pour
accéder à un autre niveau de réalité. En
évacuant les obstacles, par son inconscience, par sa
méconnaissance, ou par son aveuglement, il remet son sort entre les
mains du hasard, allié particulièrement efficace dans le domaine
de l'exploit miraculeux. Grâce à ce passage de l'inadaptation
à l'appréhension du monde par la mise à l'épreuve
de ses limites, le héros parvient à renverser l'ordre des choses
pour en devenir maître. Ainsi, les exemples de Bob Parr, de
71
Wall-e et de Flik, significatifs de ce domptage, sont loin
d'être des exceptions dans la filmographie du studio. Ici se rejoignent
les créateurs et leurs créatures. Car les membres de Pixar ont
suivi la même progression au fil des ans. D'un outil initialement
destiné à promouvoir les recherches dans le domaine de l'imagerie
numérique, le studio a fait un moyen d'expression artistique
mondialement reconnu. Par l'émulation de la technologie et de l'art, il
sont parvenus à maîtriser une technique de pointe, et ont conquis
le public malgré ce statut d'avant-garde. Aujourd'hui, Pixar est un des
trois pôles d'animation les plus importants sur la scène
internationale (avec Disney et les studios Ghibli au Japon). Racheté par
Disney dans le cadre d'un échange d'actions, le studio a fait de son
créateur, Steve Jobs, le principal actionnaire de cette multinationale
du divertissement. En outre, John Lasseter a pris les commandes du
département animation de Disney, et est devenu la personne la plus
influente dans son domaine, puisqu'il est aussi le producteur des films de
Miyazaki. C'est donc en commençant par développer une technique
méconnue et en l'apprivoisant, que les fondateurs de Pixar, se sont
imposés comme les maîtres incontestés du cinéma
d'animation. Le succès critique et public de leurs films en est la
meilleure preuve, et se confirme avec l'immense réussite artistique et
commerciale de Toy Story 3. Cependant les qualités d'adaptation
du héros Pixar, ne suffisent pas toujours à sa réussite.
Tous ces personnages s'inscrivent souvent dans un groupe, dont les membres sont
complémentaires, à l'image des jouets de Toy Story. Cette
complémentarité se retrouve dans l'équipe des
premières années, avec les talents d'animateurs de John Lasseter
et les compétences informatiques d' Ed Catmull et d' Alvy Ray Smith. De
succès en succès, le studio a su s'entourer de collaborateurs de
talents, et de cinéastes issus d'horizons différents. Brad Bird,
arrivé tardivement dans le cercle très fermé des
réalisateurs du studio, a prouvé l'efficacité d'un tel
recrutement, et l'arrivée récente d' Henry Selick
(L'étrange Noël de Monsieur Jack - 1994, Coraline
-2009) au sein de Pixar laisse augurer une diversification du studio.
Malgré cette ouverture et une confiance accordée à des
nouveaux réalisateurs, Pixar reste inextricablement lié au nom de
John Lasseter, et, en dépit de sa volonté de suspendre sa
carrière de réalisateur au profit de celle de producteur, celui
que beaucoup considèrent comme l'âme du studio a été
rappelé à l'aide pour la réalisation de Cars 2.
Comment, dans un tel contexte, concilier l'esprit du studio avec de nouvelles
individualités ? C'est là le principal défi qui se
présente à un studio qui a déjà tout
prouvé.
72
FILMOGRAPHIE DES STUDIOS PIXAR
1
0. The Adventure of André and Wally B. / Les
Aventures d'André et Wally B. (John Lasseter et Alvy Ray
Smith, 1984)
1. Luxo Jr. (John Lasseter, 1986)
2. Red's Dream (John Lasseter,
1987)
3. Tin Toy (John Lasseter, 1988)
4. Knick-Knack (John Lasseter,
1989)
5. TOY STORY (John Lasseter, 1995)
6. Geri's Game / Le joueur d'échec
(Jan Pinkawa, 1997)
7. A BUG'S LIFE / 1001 PATTES John Lasseter
et Andrew Stanton, 1998)
8. TOY STORY 2 (John Lasseter, Ash Brannon
et Lee unkrich, 1999)
9. For the Birds / Drôles d'oiseaux sur une ligne
à haute tension (Ralph Eggleston, 2000)
10. MONSTERS INC. / MONSTRES ET CIE. (Pete
Docter, David Silverman et Lee Unkrich, 2001)
11. Mike's New Car / La nouvelle
voiture de Bob (Pete Docter et Roger Gould, 2002)
12. FINDING NEMO / LE MONDE DE NEMO (Andrew
Stanton et Lee Unkrich, 2003)
13. Boundin' / Saute-Mouton (Bud Luckey,
2003)
14. THE INCREDIBLES / LES INDESTRUCTIBLES
(Brad Bird, 2004)
15. Jack-Jack Attack / Baby-Sitting Jack-Jack
(Brad Bird, 2004)
16. One Man Band / L'Homme-orchestre (Mark
Andrews et Andrew Rimenez, 2005)
17. Mater and the Ghostlight / Martin et la
lumière fantôme (Dan Scalon et John Lasseter,
2006)
18. CARS / CARS, QUATRE ROUES
(John Lasseter, 2006)
19. Lifted / Extra-Terrien
(Gary Rydstrom, 2006)
20. RATATOUILLE (Brad Bird, 2007)
21. Your Friend the Rat / Notre Ami le Rat
(Jim Capobianco et Jeff Pidgeon)
22. Presto (Doug Sweetland, 2008)
1 Les titres en majuscules indiquent les longs
métrages.
23.
73
WALL-E (Andrew Stanton, 2008)
24. Burn-E (Angus MacLane, 2008)
25. Dug's special mission / Dug en mission
spéciale (Ronnie Del Carmen, 2009)
26. Partly Cloudy / Passage nuageux
27. UP / LÀ-HAUT (Pete Docter et
Bob Peterson, 2009)
28. Day and Night / Jour et Nuit (Teddy
Newton, 2010)
29. TOY STORY 3 (Lee unkrich,
2010)
ANNEXES PARTIE I


1/ Le procédé de la goutte d'eau
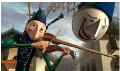

2/ Treble et Bass (One Man Band)
3/ La torture de Woody (Toy
Story)
74


4/ Jim Carrey (Yes Man)
5/ L'immobilité comme ultime refuge (Toy
Story 2)
6/ Les rats dans la cuisine de
Ratatouille


75
7/ Se fondre dans le décor : Zach Braff, dans
Garden State

76
8/ Des corps-objets :

Un poisson-cric pneumatique (Finding Nemo)
Une langue-corde à sauter (Monsters Inc.)

9/ Helen Parr, femme à tout faire (The
Incredibles)

10/ Woody se met en scène (Toy Story
2)


11/ Le rat marionnettiste (Ratatouille)
12/ Linguini poupée vaudou
13/ Linguini danseur de limbo
involontaire
14/ Woody maltraité (Toy Story et Toy
Story 2)
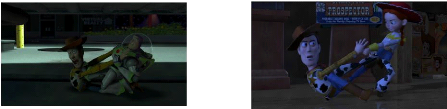
77
15/ Dory écartelée (Finding
Nemo)


16/ Monsieur Patate ou l'éclatement du corps
17/ Monsieur Patate et Jerry Lewis, variations de
l'échec sportif
18/ Émile ou le désir de manger le
monde
78
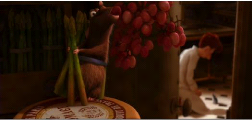

79
19/ Laurel, du tonneau à l'outre
humaine

20/ Mike Wazowski tiraillé entre travail et
amour

80
21/ La parole à la poubelle

22/ Se faire mal pour faire rire
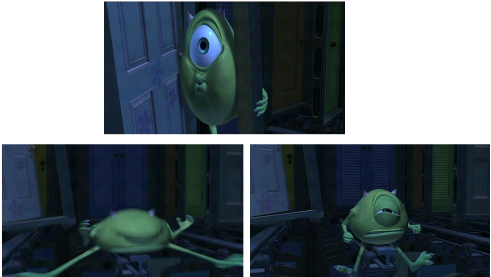
23/ De la simple empreinte...

81
24/... à la destruction

25/ De Monsieur Hulot à Bob
Parr

26/ La solitude par le vide
27/ La solitude au milieu de la foule
28/ Dory et Marin en mauvaise posture


82

ANNEXES PARTIE II
83
29/ Un poisson-(feu)-rouge dans Finding
Nemo
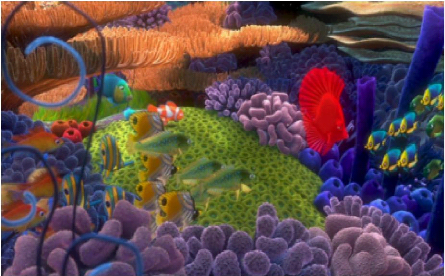
84
30/ Une scène coupée de The
Navigator (Buster Keaton, 1924)
« Plus tard, je compris aussi qu'une fois les spectateurs
empoignés par les actes du héros, ils refusaient tout ce qui
pouvait le dévier de sa trajectoire, quelle que fût la
qualité du gag proposé. J'en eus la démonstration
éclatante quelques années après, pendant le
preview de La Croisière du Navigator (je
considère The Navigator et The General1
comme mes deux meilleurs films). [É] Mais le gag qui fit "flop"
était mon préféré et avait coûté
très cher. Après l'avoir imaginé, je fis fabriquer par les
accessoiristes mille deux cents poissons en caoutchouc de quinze
centimètres, lesquels furent suspendus à des fils invisibles.
Pour les faire évoluer devant l'objectif, on utilisa une grosse machine
ressemblant à une rotative de presse. Nous obtenions ainsi l'effet d'un
banc de poissons entraîné par un courant sous-marin.
Là-dessus arrivait un gros poisson qui ne parvenait pas à couper
le cortège. Pour lui venir en aide, je saisissais une étoile de
mer collée à un rocher, l'attachais sur ma poitrine et
commençais à régler la circulation piscicole comme un
sergent de ville. Je lève la main : le banc de poissons s'immobilise, le
gros poisson traverse, puis je redonne le feu vert au banc de sardines.
D'après moi, c'était l'un des meilleurs gags visuels que j'aie
jamais trouvés et je continue d'en être convaincu. Il fut
inséré dans la bande-annonce de La Croisière du
Navigator, et le public hurla de rire. Mais quand le film entier fut
projeté en avant-première à Long Beach, mon gag aquatique
tomba à l'eau. [É] Le public qui voyait le film en son entier
acceptait les autres gags, car il s étaient en situation et
n'empêchaient pas le héros de sauver la jeune première.
Mais quand je me mettais à jouer les flics de la circulation
sous-marine, j'interrompais mon sauvetage pour faire quelque chose de
totalement gratuit, abandonnant pour un temps précieux
l'héroïne à son triste sort. Je coupai le gag,
c'était la seule solution : le héros n'a pas le droit de musarder
quand une jeune fille est en péril ».
Extrait de Buster Keaton et Charles Samuels,
Slapstick, Seuil, collection « Points virgule », 1984,
p.168-169.
1 The General (Le Mécano de la General,
Buster Keaton, 1927).
85
31/ Un dîner pas comme les autres (The
Incredibles)

32/ Ç Ça va chérie ?
» Bob Parr / Mr. Incredible à Helen Parr / Elastigirl
(The Incredibles)

86
33/ Le corps comme balancier, Buster Keaton dans
Cops

34/ Équilibre du suspense : Finding Nemo
et The Gold Rush

35/ Tension du ressort comique (For the
Birds)


Woody et Jessie dans Toy Story 2
Pierrick Sorin et son théâtre optique
87
36/ Mouvement et musique
|
37/ Deux clowns :
Lumpy, le naïf
|
|
|
Luxo Jr.
|
|
88
Rictus, le clown triste
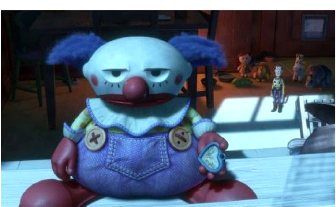
38/ La piste à l'étoile

39/ Deux corps que tout oppose (Slim et Heimlich dans
A Bug's Life)
40/ Duo de trapézistes improvisé
(Ratatouille)
89
Red's Dream
90
41/ La revanche du lapin blanc
(Presto)

91
ANNEXES PARTIE III
42/ Deux monstres, deux tailles, deux
portes

43/ Panique à bord
(Wall-e)
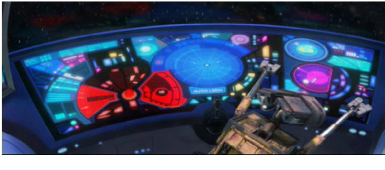
44/ De la difficulté du nombre
(Lifted)

92
45/ La différence et le mécontentement
(For the Birds)

46/ Entre le vélo et la pompe à
vélo (Red's Dream)

47/ Le héros enseveli (The
Incredibles)

93
48/ Le cauchemar de Woody (Toy Story
2)

94
49/ Buzz prend le thé (Toy
Story)

50/ Woody et son image (Toy Story
2)

95
51/ La prise de conscience de Buzz (Toy
Story)

52/ Un Buzz parmi d'autres (Toy Story
2)

96
53/ Marin face à la foule (Finding
Nemo)

54/ Mike à la limite de la gloire (Monsters
Inc.)

97
55/ Ç J'y crois pas ! Je fais la une d'un
magazine ! » Mike Wazowski (Monsters
Inc.)

98
56/ L'art de provoquer un carambolage sans s'en rendre
compte (Toy Story)

99
57/ L'optimisme comme bouclier à la
réalité (A Bug's Life)

100
58/ Bob Parr et l'étroitesse du monde (The
Incredible)

101
59/ Les embouteillages ou la frustration du mouvement
(The Incredibles et Trafic)

102
60/ Retour à la réalité (The
Incredibles)

61/ L'humanité assistée
(Wall-e)

62/ Face aux cops (Wall-e)

103
BIBLIOGRAPHIE
Sur le(s) burlesque(s)
· André BAZIN et Éric ROHMER, Charlie
Chaplin, Cerf, collection 7e art, 1973.
· Louise BEAUDET et Raymond BORDE, Charles R.
Bowers, ou le mariage du slapstick et de l'animation,
Cinémathèque de Toulouse, collection Les Dossiers de la
Cinémathèque, 1980.
· Jean-Pierre COURSODON, Laurel et Hardy,
Avant-Scène, 1965.
· Emmanuel DREUX, Le burlesque ou la subversion par
le geste, L'Harmattan, 2007.
· Stéphane GOUDET, Buster Keaton,
Cahiers du Cinéma, collection Grands cinéastes, 2008.
· Stéphane GOUDET, Jacques Tati, de
François le facteur à Monsieur Hulot, Cahiers du
Cinéma, collection Les Petits Cahiers, 2002.
· Buster KEATON et Charles SAMUELS, Slapstick
(Mémoires), Point Virgule, 1984.
· Petr KRÀL, Le burlesque, ou la Morale de la
tarte à la crème, Ramsay, 2007.
· Petr KRÀL, Les burlesques, ou Parade des
somnambules, Stock, 1986.
· Peter KRAVANJA, Buster Keaton, Portrait d'un corps
comique, Portaparole, 2007.
· Roland LACOURBE, Harold Lloyd, Seghers,
1970.
· Roland LACOURBE, Laurel et Hardy ou l'enfance de
l'art, Seghers, 1975.
· Jérôme LARCHER, Charlie Chaplin,
Cahiers du Cinéma, collection Grands cinéastes, 2007.
· Maud LINDER, Max Linder était mon
père, Flammarion, 1992.
· Maud LINDER, Max Linder, Atlas, collection
Les dieux du cinéma muet, 1992.
· Jean-Philipe TESSÉ, Le burlesque,
Cahiers du Cinéma, collection Les petits Cahiers, 2007.
104
Sur le cinéma d'animation
· Robert BENAYOUN, Le mystère Tex Avery,
Points, 2008.
· Patrick BRION, Tex Avery, Chêne, 2009.
· John CANEMAKER, Félix le Chat, La folle
histoire du chat le plus célèbre au monde, Dreamland
Éditeur, 1998.
· Sébastien DENIS, Le cinéma
d'animation, Armand Colin Cinéma, 2007.
· Sergue
· EISENSTEIN, Walt Disney,
Circé, 1991.
· Pierre FLOQUET, Le langage comique de Tex Avery, Dix
années de création à la MGM, L'Harmattan, 2009.
· Bernard GENIN, Le cinéma d'animation,
Cahiers du Cinéma, collection Les Petits Cahiers, 2003.
· Leslie IWERKS et John KENWORTHY, Ub Iwerks, et
l'homme créa la souris, Bazaar & Co, 2009.
· Charles M. JONES, Chuck Jones, ou l'autobiographie
débridée du créateur de Bip-Bip, du Coyote et de leurs
amis..., Dreamland Éditeur, collection Image par image, 1998.
· Jacques KERMABON (dir.), Du praxinoscope au cellulo,
Un demi-siècle de cinéma d'animation en France (1892-1948),
Éditions Scope, 2007.
· Jean-Pierre PAGLIANO, Paul Grimault, Dreamland
Éditeur, collection Image par Image, 1998.
· Charles SOLOMON, Les pionniers du dessin animé
américain, Dreamland Éditeur, 1996.
· Bob THOMAS, Walt Disney, Un Américain
original, Dreamland Éditeur, Collection Image par image, 1999.
· Dick TOMASOVIC, Le corps en abîme, Sur la
figurine et le cinéma d'animation, Rouge Profond, 2006.
105
Sur les studios Pixar
· Barbara BAZALDUA, Steve BYNGHALL et Jo CASEY,
Pixarpedia, a complete guide to the world of Pixar... and beyond !, DK
Publishing, 2009.
· Mark COTTA VAZ, The Art of Finding Nemo,
Chronicle Books, 2003.
· Mark COTTA VAZ, The Art of The Incredibles,
Chronicle Books, 2004.
· Cyril FIEVET, Apple, Pixar Mania, Édition
d' Organisation, 2004.
· Tim HAUSER, The Art of Wall-e, Chronicle Books,
2008.
· Tim HAUSER, The Art of Up, Chronicle Books,
2009.
· Jeff KURTTI, 1001 pattes, le livre du film,
Dreamland Éditeur, 1999.
· John LASSETER et Steve DALY, L'art de Toy Story,
Disney Hachette Édition, 1996.
· Charles SOLOMON, The Art of Toy Story 3,
Chronicle Books, 2010.
Ouvrages divers
· Michel CHION, La musique au cinéma,
Fayard, 1995.
· Maurice GIRARD, L'automobile fait son
cinéma, Editions Du May, 2006.
· Laurence SCHIFANO (dir.), La vie filmique des
marionnettes, Presses universitaires de Paris 10, 2005.
· Josette SICSIC, Quand l'automobile fait du
cinéma, France-Empire, 1986. Documents
audiovisuels
· Tony KAPLAN et Erica MILSOM, Pixar shorts, a short
story, documentaire (23 min), 2007.
· Leslie IWERKS, The Pixar Story, documentaire
(1h27), 2007.
|
|



