|
ANNEE ACADEMIQUE 2015-2016
UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA
BOUAKE (CÔTE D'IVOIRE)
------------
UFR SCIENCES ECONOMIQUES
ET DEVELOPPEMENT (SED)
-----------
MEMOIRE DE RECHERCHE MASTER 2 :
ECONOMIE DE DEVELOPPEMENT
Présenté en vue d'obtenir le diplôme de
Master de recherche en Economie de Développement
THEME :
LES DETERMINANTS DE L'ENGAGEMENT BENEVOLE EN CÔTE
D'IVOIRE
Présenté par :
KOUAKOU KOUADIO RICHMOND
JURY:
PRESIDENT : M. AKA Bédia
François, Maître de Conférences Agrégé,
Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire.
DIRECTEUR DE RECHERCHE: M. KOUAKOU
Clément, Maître de Conférences Agrégé,
Université Felix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire.
ASSESSEUR : M. TROUPA Sery Guy Flavien,
Maître Assistant, Université Alassane Ouattara, Côte
d'Ivoire.
Master 2 recherche « Economie de
développement » 2015-2016
DECEMBRE 2016
AVERTISSEMENTS
L'Université Alassane Ouattara n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme
propres à son auteur.
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier mon directeur de mémoire,
le Professeur Clément KOUAKOU, Maitre de
Conférence Agrégé de l'Université Félix
Houphouët-Boigny de Cocody. Il a su me rediriger à chaque fois que
je prenais un mauvais chemin. Ses conseils ont été comme une
boussole pour moi.
Je remercie le Doyen de l'UFR des Sciences économiques
et de développement de l'Université Alassane Ouattara de
Bouaké, le Professeur Augustin ANASSE, Professeur
Titulaire en Sciences de Gestion, qui, par son leadership a su tenir ce
programme pour que nous puissions en fin soutenir nos mémoires de
recherche.
Grand merci à mes chers condisciples KUNIBOUO
Angelo, MARAHOUAEpiphane le
délégué, KONE Moumine notre informaticien
et tous les autres qui ont concouru à la bonne tenue de ce
mémoire. Leur soutien indéfectible a été pour
beaucoup dans la réussite de cette année académique.
Merci à M. Paul ANGAMAN,
président de l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture), qui s'est disposé à répondre à mes
questions pendant l'enquête sur terrain. Merci à Madame
Berté OULAÏ, responsable de la CARITAS de la
Paroisse Sainte Famille de la Riviera 2. Merci au condisciple
Cédric EDANO, il m'a été d'une grande
aide pour l'élaboration de mon questionnaire en ligne via google forms.
Ce formulaire m'a permis de recueillir beaucoup plus de réponse sans
avoir à me déplacer.
Je ne peux oublier mon Pasteur Narcisse
OURAGA pour son soutien de tout genre. Merci au Diacre Herve
KOUASSI pour sa disposition à relire et corriger mon travail.
Plus proche de moi, il m'a également soutenu dans tous les moments
difficiles que j'ai pu traverser.
Une mention spéciale à celle qui souffre avec
moi dans les temps difficiles, qui veille pour me porter en prière.
Aujourd'hui, bien que n'étant pas étudiante, elle connait ce que
c'est que faire de la recherche académique. Celle qui m'encourage depuis à trouver un
emploi afin d'apporter ma pierre à la construction du pays...
... à ma mère Marguerite
KLA.
LISTE
DES SIGLES ET ABREVIATIONS
ACAT : Action des Chrétiens pour l'Abolition
de la Torture
ACBF : African Capacity Building Foundation
AGEPE : Agenced'Etude et de Promotion de l'Emploi
BIT : Bureau International du Travail
CEPE : Certificat d'Etude Primaire
Elémentaire
CFA : Communauté Franco Africaine
CRDI : Centre de Recherche pour le
Développement International
EMAB : Echelle de Motivation des Actions
Bénévoles
ENSETE : Enquête Nationale sur la Situation de
l'Emploi et du Travail des Enfants
ENV : Enquête Niveau de Vie des
ménages
EPN : Etablissement Publique National
INS : Institut Nationale de la Statistique
IRIV : Institut de Recherche et d'Information
sur le Volontariat
MEMPD : Ministère d'Etat, Ministère du
Plan et du Développement
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PNUD : Programme de Nations Unies pour le
Développement
RGPH : Recensement Général de la
Population et de l'Habitat
SNC : Système national de
Comptabilité
TAD : Théorie de
l'Autodétermination
VFI : VolunteerFunctionInventory
VNU : Volontariat des Nations Unies
VSI : Volontariat de Solidarité
Internationale
LISTE
DES FIGURES
Figure1 : Les branches du bénévolat par
Gourmelen, 2013....................................P7
Figure 2 : Le continuum d'autodétermination
(Forest, Crevier-Brault et Gagné, 2009) ...P10
Encadré : Motivations bénévoles
basées sur les expériences de la
vie........................P22
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 : Synthèse des motivations au
bénévolat par Gourmelen (2013) ...............P9
Tableau 2 : Présidents américains et leurs
organismes de bénévolat........................P13
Tableau 3 : Différents thèmes du
questionnaire................................................P18
Tableau 4 : Composants du
questionnaire...................................................... P19
Tableau 5 : Statut dans l'emploi en fonction du
genre....................................... P23
Tableau 6 : Statistique descriptive entre
bénévoles et non bénévoles.....................
P24
Tableau7 : Conceptualisation
des variables avec leurs signes attendus.................. P29
Tableau 8 : Résultats de la régression par
un modèle Tobit............................... P34
Tableau9 : Les effets marginaux après
régressions .......................................... P35
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1
CHAPITRE1 : REVUE ANALYTIQUE DU BENEVOLAT
6
SECTION1 : REVUE THEORIQUE DU BENEVOLAT
6
SECTION 2 : REVUE EMPIRIQUE DU BENEVOLAT
12
CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE D'ANALYSE ET
RESULTATS STATISTIQUES
18
SECTION 1 : METHODOLOGIE D'ANALYSE
18
SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE
STATISTIQUE
21
CHAPITRE 3 : LES FACTEURS DETERMINANTS DE
L'ENGAGEMENT BENEVOLE
26
SECTION 1 : CADRE D'ANALYSE ECONOMETRIQUE
26
SECTION 2 : RESULTATS ECONOMETRIQUES ET
DISCUSSION
34
CONCLUSION
40
RESUME
A la fin de la crise postélectorale, il est
constaté un accroissement des engagements bénévoles
à travers les entreprises associatives. La population qui a besoin de
travail (salarié) pour améliorer son bien-être, se voit
fournir du travail dit travail non rémunéré. L'objectif de
comprendre la disposition des individus à oeuvrer de façon
bénévole a guidé une enquête sur les motivations des
bénévoles. L'analyse des données de cette enquête et
de celles issues d'un retraitement de la base de données de
l'enquête emploi a permis de comprendre que : les
bénévoles ivoiriens sont des religieux (86,87% sont des
chrétiens), des chômeurs ou étudiants qui font ce travail
pour acquérir des compétences et qualifications. Aussi, ils
s'engagent à oeuvrer pour la justice sociale surtout parce qu'ils sont
témoins de situations nécessitant des actions
bénévoles. Il serait donc nécessaire de promouvoir ce
secteur qui est un moyen de lutte contre le chômage, la pauvreté,
les inégalités et surtout pour consolider la cohésion
sociale.
Mots clés : motivation bénévole,
engagement bénévole, travail bénévole, travail
salarié.
ABSTRACT:
After the electoral crisis, we notice an increase in
volunteer's engagements in associative enterprises. Populations, which need to
work to improve it well-being, are seeing in work called unremunerated work.
The aim of understanding the person's disposition to work voluntarily has led
an investigation on volunteer's motivations. The analysis of data from this
investigation and those comes from reprocessing of job inquiry, permit to
understand that: Ivoirians volunteers are religious (86, 87% are Christian),
unemployed or students who do this job to purchase competences and
qualifications. They also engage to strive for social justice above all because
they are witness of situation's which need volunteer's actions. It will be
necessary to promote this sector, which is a way to struggle against
unemployment, poverty, social inequality above all to strengthen social
cohesion.
Keywords: volunteer motivation, volunteer engagement,
volunteer work, paid work.
INTRODUCTION
1.
Contexte et Problématique
La problématique du chômage est plus que jamais
une réalité dans tous les pays du monde. Les pays du sud,
éternels habitués à toute sorte de crise
(militaro-politiques, sociales) sont les terrains de prédilection du
chômage (plus de 30% pour l'Afrique de l'ouest)1(*). La Côte d'Ivoire, avec
ces nombreuses années d'instabilité n'en est pas
épargnée. Plus d'une décennie de crisel'a
trainéedans l'accumulation des problèmes. Aujourd'hui, le taux de
chômage est de 24,2% selon l'enquête emploi de 2013. Ce taux, bien
qu'élevé, cacherait des réalités du pays. Les
nombreux diplômés qui sortent chaque année des
universités sans point de chute et la grogne sociale le prouvent bien.
En 2015, la pauvreté monétaire correspondait à une
dépense de consommation inférieure à 737 Francs CFA par
jour soit 269 075 Francs CFA par an. Ainsi dit, près d'un ivoirien sur
deux est pauvre, car sa dépense de consommation est en
deçà de cette barre (ENS et AGEPE, 2013).
L'année 2011 a vu la fin de la crise
postélectorale. Suite à cette crise, l'on a constaté une
prise de conscience générale de la situation
socioéconomique de nombre des populations. Les individus avec un niveau
de vie moyen se sont appauvris (UNICEF, 2012)2(*). Une grande partie de la population qui était
juste pauvre, voit sa situation s'empirée. Depuis bien avant, pendant et
même après cette crise, le taux de pauvreté s'est beaucoup
accru. De 10% en 1985, ce taux est passé à 49% en 2008
(MEMPD/INS, 2008), puis à 51% en 2011 avant de régresser à
46,3% en 2014 (ENV, 2014). Le gouvernement nouvellement installé en 2011
va multiplier les actions en faveur du ``vivre ensemble''. De nombreux appels
contre la pauvreté se font entendre depuis les autorités
politiques jusqu'à la société civile.
En effet, ``vivre ensemble'' est le programme de gouvernement
du président de la république SEM Alassane Ouattara. Selon
lui :
« Nôtre épanouissement
socioéconomique ne se fera pas au détriment de la
solidarité et de la cohésion sociale, profondément
ancrées dans nos pratiques et nos mentalités ».
Partant, plusieurs structures (associations et organisations
non gouvernementales) qui animaient la vie sociale se sont mobilisées en
s'invitant sur le terrain. Depuis cette date, le nombre de ces associations et
organismes utilisateurs de la main d'oeuvre bénévole est devenu
plus important. On en trouve dans presque tous les secteurs d'activité.
Il s'en suit évidement une plus grande croissance du nombre des
bénévoles. En effet, les bénévoles constituent la
majeure partie de la main d'oeuvre, importante au fonctionnement de la plupart
de ces associations (Prouteau et Wolf, 2004a)3(*).
L'étude du marché ivoirien du travail
révèle des disparités et des points qui nécessitent
d'être appréciés de près. En 2013, 52,7% de la
population en âge de travailler est effectivement en emploi, et 0,6% de
cette population fait du bénévolat formel à travers les
ONG et associations (ENSETE, 2013). En 2015, c'est 93,11% de la population en
âge de travailler qui travaille effectivement. Cette fois ci, le
bénévolat n'est pas spécifié, par contre, 8,3% ont
déclaré faire de l'aide familiale et 1,1% sont inclassable
(INS / ENV, 2015). Il est donc certain que les bénévoles
sont contenus dans ces deux derniers groupes.
Nous sommes en mesure de nous poser un certain nombre de
questions dont la recherche de réponse nous guidera dans ce travail.
Qu'est-ce qui suscite le bénévolat ? Qu'elles sont les
caractéristiques de l'engagement bénévole ? Quel lien
y a-t-il entre l'offre de travail salarié et le bénévolat
?
2. Différence notable entre
bénévolat et volontariat
Le terme moderne « volontaire » a une
origine militaire tandis que celui de
« bénévole » semble être
emprunté au domaine religieux. En général, le volontariat
existe sous plusieurs formes4(*). Il désigne un engagement à temps plein
de quelques mois voire des années dans le cadre d'une mission
d'intérêt général et donne droit à une
indemnité.
Le bénévolat est une activité libre qui
peut être exercée directement ou par le biais d'une organisation.
Le bénévolat n'est encadré par aucun statut juridique
tandis qu'il n'existe pas de volontariat sans texte (lois ou décret).
Bénévole et volontaire s'engagent au service de leur
société, mais la différence fondamentale est que le
bénévole consacre un temps qu'il décide de lui-même
et peut y mettre fin à tout moment. Ce temps peut être de quelques
heures par an ou plusieurs heures par semaine. Par contre, le volontaire
s'engage pour plusieurs mois ou quelques années par le biais d'une
organisation et reçoit une contrepartie qui est sous forme
d'indemnité5(*).
3. Les motivations à
l'engagement bénévole
Si le bénévole est celui qui s'engage librement
à fournir un travail qui compte sans aucune rémunération,
une notion fondamentale -la motivation- mérite une attention
particulière. Le dictionnaire Larousse la définit comme :
« ce qui explique, motive, justifie une action quelconque ;
cause ». C'est aussi « les raisons, intérêts,
éléments qui poussent quelqu'un dans son action ; fait pour
quelqu'un d'être motivé à agir ».
Développé dans la deuxième moitié
du XXe siècle, le concept de motivation a fait l'objet de plusieurs
théorisations. La définition admise de la motivation est celle
que Robert J. Valerand et Edgard Till (1993) ont développée dans
Introduction à la psychologie de la motivation. Celle-ci consiste
à la décrire comme étant « le construit
hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes
et/ou externes produisant le déclenchement, la direction,
l'intensité et la persistance du comportement » (Vallerand et
Till, 1993, p.18).
La question à laquelle répond la motivation des
individus dans un travail tel que le nôtre est
« pourquoi ? ». Pourquoi un individu s'engage-t-il
dans le bénévolat à travers des organismes (humanitaires,
de droit de l'homme, éducatifs et sociaux...) ? Quels sont les
facteurs explicatifs et les moteurs de ce comportement ?
4.
Objectifs
L'objectif principal de cette étude est d'analyser les
facteurs explicatifs de l'engagement bénévole en Côte
d'Ivoire.
De façon claire et spécifique, il s'agit
de :
· Montrer l'influence des caractéristiques
sociodémographiques dans le choix de faire du travail
bénévole ;
· Analyser l'impact du milieu socioprofessionnel sur
l'engagement bénévole ;
· Déterminer l'influence des parents sur le choix
de s'engager dans le travail bénévole.
La connaissance de ce qui motive l'engagement
bénévole est une bataille gagnée dans la lutte pour la
socialisation et le développement des valeurs de militantisme et
d'altruisme. Aussi, elle encouragerait la mise en place de politiques
adéquates de l'emploi. Certainement, les structures employeuses de
main-d'oeuvre bénévole trouveraient en ce travail, une
orientation dans la recherche et la fidélisation de leurs
bénévoles.
Pour atteindre ces
différents objectifs, la méthodologie empruntée consiste
à analyser en un premier lieu, les résultats d'une enquête
que nous avons réalisé sur les motivations des
bénévoles. Cette enquête a été
effectuée entre les mois d'octobre et de novembre 2016 à l'aide
d'un ensemble de 30 questions adressées à différentes
populations de bénévoles.
En second lieu, l'accent sera mis sur les données de
l'enquête emploi 2013 de l'AGEPE dont la base de données est
incontournable pour prendre en compte les bénévoles sur le plan
national. Pour mettre en lien la situation socioprofessionnelle des populations
et l'engagement bénévole, les statistiques fournies par le
rapport sur le niveau de vie des ménages de l'INS en 2015 ont
été consultées.
5. Plan de l'étude
Ce travail de mémoire aborde trois axes pour comprendre
ce qui motive les individus au point de s'engager dans le
bénévolat.
Le premier chapitre nous amène à une revue
analytique de l'engagement bénévole. Ainsi, une revue
théorique du travail bénévole sera apportée en
section1. Après cette analyse, Nous faisons un bref tour d'horizon des
différents écrits sur le bénévolat dans le monde
(section2).
Le deuxième chapitre est la méthodologie
d'analyse empruntée dans ce travail.Compte tenu du fait que nous avons
effectué une investigation sur le terrain, il est important de revenir
brièvement sur la méthodologie (section1). Une analyse
descriptive des individus de l'enquête sera proposée (section2).
Dans le chapitre 3, nous faisons des estimations
économétriques et présentons les résultats que nous
analysons. La section 1 permettra de faire la description et la
modélisation de notre modèle, le Tobit simple à double
censure. La section2 porte sur la présentation des résultats
d'estimations, la discussion sur ceux-ci et les recommandations avant de passer
à la conclusion.
CHAPITRE1 : REVUE ANALYTIQUE DU BENEVOLAT
Dans ce premier chapitre, il sera question de faire une revue
théorique de la littérature dans laquelle nous montrons les types
de bénévolat, le bénévolat dans la pensée
économique et la contribution des autres sciences (section1). Il sera
aussi question de faire une revue empirique du bénévolat. Ce qui
nous emmènera à faire un tour d'horizon sur la pratique du
travail bénévole dans le monde (section 2).
SECTION1 : REVUE THEORIQUE DU BENEVOLAT
Cette section est consacrée à une revue
théorique dans lequel nous montrerons la prévalence du terme
« travail bénévole » sur le terme
« bénévolat ».
1.1 Les types de
bénévolat
Le bénévolat formel est le don de temps à
travers un organisme (erlinghagen, 2010). Ici, le bénévole exerce
son activité par l'intermédiaire d'une structure qui peut
être une association, coopérative, mutuelle, ONG ou fondation. Les
engagements bénévoles à travers les associations sont
prédominants (Prouteau et Wolf, 2004b), si bien que le
bénévolat formel est parfois assimilé, à tort, au
bénévolat associatif (Prouteau, 1998, 2001 ; Reimat, 2002).
Cependant, l'organisme d'accueil peut être une administration publique,
une société mutualiste, une coopérative ou encore un
syndicat (Halba6(*) et Le
net, 1997)
La plus grande partie des travaux d'entraide et de
solidarité sont effectuées en dehors d'une organisation bien
définie. Le bénévolat non formel rassemble toutes les
activités non rémunérées pratiquées hors du
cadre familial, de façon individuelle ou désorganisée. Par
exemple une personne qui aide un vieux à monter les escaliers de son
immeuble deux fois par semaine. L'individu faisant ce travail ne se rend pas
compte qu'il fait du bénévolat. D'ailleurs, ils sont moins
nombreux à pouvoir dire exactement ce que c'est que le
bénévolat. Un large éventail d'activités, notamment
les formes traditionnelles d'assistance mutuelle et d'initiative personnelle,
la prestation de services et autres formes de participations civiques,
effectuées librement, pour le bien du public et dont la
rémunération monétaire ne constitue pas la principale
motivation est du bénévolat non formel (Nations Unies, 2001).
Dans la littérature, il est très rare que ces
deux branches soient analysées conjointement, à la vue de trop
grandes différences dans la pratique. Dans ce travail, nous choisissons
de nous focaliser sur la branche formelle, plus précisément le
bénévolat associatif qui nous paraît plus
intéressant, étant donné qu'il implique une organisation
en l'occurrence les associations. Cependant, il est à noter que le
domaine informel existe et est bien plus important qu'on pouvait le penser.
D'ailleurs, nous ne le perdrons pas de vue, car nous le considérons
concurrent directe du bénévolat formel (voir figure1).
Don de temps ou bénévolat
Figure1 : Les branches du bénévolat
par Gourmelen, 2013
Bénévolat informel ou de proximité
Bénévolat formelle ou encadré
Bénévolat extra-familial (voisins, amis,
collègues
Bénévolat familial hors foyer
Bénévolat non associatif (mutuelles,
coopératives)
Bénévolat associatif
Selon la définition vue plus haut, le
bénévole accomplit les activités par
l'intermédiaire des organismes, donc un cadre favorable de travail. Il
s'agit donc bien sûr de la production de biens et services avec une
valeur potentielle pour ceux qui en bénéficient. Il serait donc
plus intéressant d'utiliser un terme plus approprié :
« le travail bénévole »
1.2 Du bénévolat au
travail bénévole
Effectuer un service, une activité non
rémunérée correspond au bénévolat. Selon
qu'il est : letravail non rémunéré effectué
pour les institutions sans but lucratif (Bjarne Ibsen, 1992). Le
bénévolat implique des activités de production de biens et
services qui contribuent quelque chose contenant une valeur pour ceux qui en
bénéficient (Prouteau et Wolf, 2004b). C'est une activité
qui, mesurée devrait contribuer à la production de biens et
services qui relève de la production générale de
l'économie telle qu'il est défini dans le système de
comptabilité nationale (SCN). D'où la notion de travail
bénévole qui définit plus nettement cette activité.
Cela signifie que cette activité n'est pas seulement
faite pour le profit ou le plaisir de la personne qui l'exerce, ni d'un membre
de son ménage. Par exemple, jouer d'un instrument de musique pour son
seul plaisir n'est pas du travail, et donc n'est pas du « travail
bénévole » ; mais jouer d'un instrument de musique
(sans rémunération) pour le plaisir de résidents d'un
établissement de santé ou d'une communauté est du
« travail bénévole ».
Le travail bénévole est du travail
effectué volontairement par une personne, qui consiste à
consacrer du temps au service d'autres personnes ou d'une cause sans but
lucratif, et pour lequel il n'y a pas de rémunération ni de
paiement en nature. (Butcher, 2010).
1. 3 Le
bénévolat dans la pensée économique
Dans la littérature économique, le travail
bénévole a fait et continue de faire l'objet de plusieurs travaux
de recherche. Développant un point de vue microéconomique, des
penseurs ont analysé les motivations des bénévoles. Il
s'agit là, de cerner les motivations du comportement
bénévole et sa sensibilité à certaines variables
socioéconomiques comme le revenu, le coût du temps, la composition
de la sphère familiale (Prouteau7(*), 2002).
L'économie s'est donnée pour objectif
d'expliquer la décision de s'adonner au bénévolat par des
modèles économiques (Mennchik et Weisbrod, 1987 ; Govekar et
Govekar, 2002 ; Prouteau et Wolf, 2004b). Chacun de ces modèles
est « fondé sur une motivation censée animer les
participants » (Prouteau et Wolf, 2004a).
Le modèle de production de biens collectifs ou
motivation de production est le modèle dans lequel les individus font du
bénévolat pour une raison dite
« privée » (Govekar et Govekar, 2002). Cette
motivation est pour le bénévole, la recherche d'une gratification
quelconque (Prouteau et Wolf, 2004a, 2004b), telle que le prestige, un bien
être intérieur. Elle peut consister également en la
recherche d'un « warm glow », c'est-à-dire une
sensation agréable ressentie par le bénévole après
son acte (Adreoni, 1990). Cette motivation
« privée » s'ajouterait à l'altruisme dit
« pur » ou le remplacerait (Govekar et Goverkar, 2002).
Quant au modèle d'influence et de recherche ou
motivation d'utilité, il est centré sur l'utilité
perçue de l'acte, le fait de s'investir pour une cause qui en vaut la
peine (Govekar et Govekar, 2002). Le bénévolat est le plus
fréquemment tiré par le désir d'aider autrui. La plupart
des bénévoles l'évoque avec tant d'aisance. Certains
bénévoles s'engagent juste pour lutter en faveur d'une vie
meilleure de leur communauté. Par exemple, les associations de lutte
pour le droit des personnes vulnérables (les prisonniers, les enfants,
les pauvres, les chômeurs...).
Dans le Modèle d'investissement ou motivation
professionnelle, le bénévole cherche à tirer des
bénéfices futurs de son acte ou son expérience pour sa
profession ou carrière, telles que de nouvelles compétences ou
encore des rencontres pouvant étoffer son réseau (Menchik et
Weisbrod, 1987 ; Prouteau et Wolf, 2004a, 2004b). Tous ces modèles
économiques permettent de structurer les motivations au
bénévolat. Ils ont pour avantage de recenser de grandes
motivations qui diffèrent de par leur caractère altruiste,
égoïste ou ambivalent (tableau 2).
Tableau 1 : Synthèse des motivations au
bénévolat par Gourmelen (2013)
|
Grandes Motivations
|
Sous-catégories (modèle
économique)
|
Déclinaisons
|
|
Motivations altruistes
|
Production de biens collectifs
|
Produire pour les autres : altruisme pur
|
|
Produire des services dont un proche va
bénéficier
|
|
Utilité perçue
|
Faire quelque chose d'utile
|
|
S'investir pour une cause qui en vaut la peine
|
|
Motivations hybrides
|
Production de biens collectifs
|
Produire des services et en bénéficier
|
|
Motivations égoïstes
|
Consommation de biens privatifs (motivations
immédiates) Investissement (motivations à long terme)
|
Warm glow (plaisir, sensation agréable)
|
|
Recherche de gratification, de prestige, de pouvoir
|
|
Bénéficier des compétences, connaissances
à mobiliser dans un cadre professionnel futur
|
1.4
L'analyse du bénévolat par les autres sciences sociales
La question de motivation des bénévoles a
toujours suscité l'intérêt dans plusieurs disciplines. La
plupart des recherches l'ont abordé suivant une approche psycho-sociale.
A l'opposé des économistes qui ont centré leurs travaux
sur la détermination de modèles, les psychologues vont s'investir
largement dans la mise en place de théories. Ils vont donc tenter avec
succès de mettre à jour des motivations pouvant conduire à
l'engagement bénévole.
La théorie de l'autodétermination
(TAD) développée par Edouard Deci et Richard Ryan en 1985
est la plus citée de toutes. L'autodétermination selon les
auteurs est le degré de liberté qu'a un individu lorsqu'il prend
sa décision en l'occurrence, celle de faire du bénévolat.
Cette théorie renferme à la base cinq motivations qui peuvent
être classées par ordre sur un
« continuumd'autodétermination » (Deci et
Ryan, 2000). Selon cette théorie, l'individu agit par choix ou
contrainte. Ainsi donc, il peut choisir de faire du bénévolat
parce qu'il y ressent du plaisir, cela est en adéquation avec ses
valeurs ou cela présente une utilité sociale (motivation
intrinsèque). Il peut au contraire s'engager par contrainte (motivation
extrinsèque). Soit que l'activité relève d'une obligation
sociale ou scolaire ou que l'individu ne veut pas être sous le coût
d'une sanction externe comme manque d'estime (motivation introjectée).
L'individu peut s'engager sans savoir trop pourquoi, on dit qu'il n'est pas
motivé (amotivation).
Figure 2 : le continuum d'autodétermination
(Forest, Crevier-Brault et gagné, 2009)
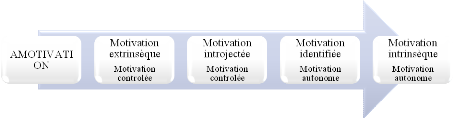
Une deuxième théorie beaucoup citée est
la théorie fonctionnaliste de la motivation. Cette théorie est
basée sur un principe fondamental selon lequel : un
bénévole peut poursuivre plusieurs buts à travers son
activité et deux personnes peuvent s'engager dans la même
activité sans pour autant satisfaire les même motivations (Clary,
Snyder et Stukas, 1996 ; Clary et Snyder, 1999 ; Houle, Sagarin et
Kaplan, 2005). La théorie fonctionnaliste suppose que le
bénévole satisfait à des besoins ou
« fonctions » psychologiques par son activité
(Clary, Snyder et Stukas, 1996). Donc sa décision de commencer ou de
continuer le bénévolat dépend du fait que cette
activité correspond ou non à ses besoins ou buts. Cette
théorie a abouti à l'élaboration de la
volunteerFunctionInventory (VFI), qui comporte six dimensions reflétant
la motivation au bénévolat.
· Motivations de valeurs : le bénévole
cherche à exprimer des valeurs d'altruismes, humanitaires,
tournées vers autrui. Cette fonction s'apparente à de l'altruisme
pur, à des motivations autodéterminées altruistes.
· Motivations d'apprentissage : le
bénévole cherche à apprendre ou à exercer des
compétences qu'il n'a pas eu l'occasion d'exercer ailleurs. Elles
s'apparentent à des motivations autodéterminées
égoïstes acquisitives.
· Motivations de carrière : le
bénévole cherche à acquérir une expérience
pour la valoriser sur le marché de l'emploi. Il s'agit de motivations
non autodéterminées égoïstes.
· Motivations sociales : le bénévole
cherche à développer des relations sociales, à être
reconnu socialement.
· Motivations de protection : le
bénévole cherche à réduire des émotions
négatives, à échapper à des problèmes
personnels à travers son activité.
· Motivation de développement personnel : le
bénévole cherche à se développer psychologiquement
ou à augmenter l'estime qu'il ressent de lui-même.
SECTION 2 : REVUE EMPIRIQUE
DU BENEVOLAT
Nous essayons de revoir les données sur la pratique du
bénévolat dans le monde y compris les résultats de
recherche de nos devanciers.
2.1
Analyse statistique du travail bénévole dans le monde
En parcourant le monde, on se rend compte que ce travail ne
suscite pas le même engouement partout. Nous faisons un tour d'horizon
sur la réalité du travail bénévole dans le monde
avec une mention spéciale sur le cas ivoirien qui nous préoccupe
ici.
2.1.1 Le bénévolat
sur le continent américain
Le continent américain dominé par les deux plus
grands pays, le Canada et les Etats Unis d'Amérique (USA) est
très présent dans la pratique de cette activité. Les USA
sont un pays traditionnellement bénévole. Depuis la
période coloniale, les différents Etats se constituaient
déjà d'habitants qui ne survivaient que par la pratique de la
solidarité et l'entraide dans les travaux d'exploitation. Les occupants,
nouveaux comme anciens avaient tous un même objectif : survivre. La
coopération était dans ce cas chose évidente (Mamba N.
2012).
Aux Etats Unis, pratiquement tout le monde a
déjà été bénévole à un moment
donné de sa vie. Chaque jour, il est compté de million de
personnes qui donnent de leur temps et de leur tallent à leur
collectivité au moyen du bénévolat. Les statistiques du
gouvernement fédéral montrent que, durant une année
entière, plus d'un américain sur cinq, soit près de 62
millions de personnes font du bénévolat (Mamba N. 2012). Selon
l'agence fédérale Corporation of National and Community Service,
qui dirige l'initiative « United We Serve 8(*)» (unis pour servir) du
Président Obama, la valeur de ce travail bénévole est
estimée à 173 milliards de dollars au bas mot. Plusieurs
présidents américains ont fait du bénévolat,
d'autres ont contribué fortement à son développement par
la création d'organismes de bénévoles. Ils ont
apporté ainsi un soutien de taille à la vulgarisation et à
la consolidation de ce secteur. Nous faisons ici une petite statistique dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 2 : Présidents américains et leurs
organismes de bénévolat9(*)
|
Président
|
Organisme crée
|
|
Francklin Roosevelt
|
Civilian conservation corps
|
|
John F. Kennedy
|
Peace corps (corps de la paix)
|
|
Lyndon Johnson
|
VISTA
|
|
George H. W. Bush
|
Point of light Foundation
|
|
Bill Clinton
|
AmeriCorps
|
|
Barack Obama
|
United We Serve
|
|
A la fin de son mandat, le président Jimmy Carter a
commencé à faire du bénévolat avec l'organisation
Habitat for Humanity
|
Source : ejournal, 2013
Au-delà du fait que le Canada soit voisin des USA, ils
ont beaucoup de choses telles que des pratiques culturelles en partage. Ainsi,
au Canada comme aux USA, le bénévolat est ancré dans les
habitudes sociales. Ici encore, la pratique des travaux d'entraide remonte
à des années vieilles et récentes à la fois. Au
Canada, en 2012, plus de 47% de la population s'est adonnée au
bénévolat. En 2006, l'on a dénombré 12,5 millions
de personnes qui se sont impliquées dans des activités
bénévoles à travers 165000 organisations et ont fournis
2,1 milliards d'heures (Imagine Canada10(*), 2012 ; Lasby et Barr, 2012). Toutes ces heures
valorisées économiquement équivalent en 2009 à 1,1
millions d'emploi à temps plein au total (Imagine Canada, 2009).
2.1.2 Le bénévolat
en Europe
En Europe, le constat est bien différent de la
réalité américaine. Ce genre d'activité a
commencé dans cette partie du monde par une sorte de charité
caractérisée par des soutiens financiers ou alimentaires
apportés aux nécessiteux. Commencé avec les
chrétiens, cette pratique s'appuyait sur le don (particulièrement
sur l'aumône).
Au moyen âge, les riches fermiers et autres qui
possédaient de grands biens venaient en aide aux pauvres, ceux-ci, en
échange les aidaient à avoir le salut. L'évolution des
sociétés européennes marquée par la
révolution industrielle, a mis à jour de nouvelles pratiques
à l'égard des plus défavorisés. En effet, la
révolution industrielle avec son cortège de grands
bouleversements va créer de grands fossés entre les couches
sociales. La classe de riches industriels va se renforcer au détriment
de la classe ouvrière. On verra la mise en place par la suite d'un Etat
protecteur. Cet Etat mène désormais des actions en faveur des
couches défavorisées. Edgworth (1881), dans
« mathematicalpsychics » ainsi que Pareto (1906) vont
montrer que l'Etat, en promouvant l'équilibre général
concurrentiel, garantit le bien-être social maximal. En tout, les actions
bénévoles et volontaires sont un mouvement puissant qui contribue
et accompagne la mise en place de politiques sociales.
En France, en 2012, 40% des moins de 35 ans ont
été bénévoles dans au moins une association. A
l'échelle nationale, 45% des plus de 18 ans sont membres d'une
association. Ces statistiques sont plus favorables à l'endroit des
jeunes. Car en 2010, plus d'un jeune sur cinq (21% des 18 à 24 ans) est
bénévole dans au moins une association ou dans un autre type
d'organisme. Ceci prouve combien de fois les français s'entraident entre
eux.
Les associations qui fonctionnent grâce au
bénévolat, constituent la plus grande partie de l'Economie
Sociale et Solidaire (ESS)11(*). Dans la plupart des pays développés,
ce secteur emploie beaucoup de personne et occupe une place importante dans
l'économie. Les travailleurs de ce secteur sont pour le plus grand
nombre des salariés. En France en 2013, il occupait 10,5% de l'emploi,
13,9% de l'emploi privé, 15% de l'emploi des femmes, plus de 25% des
salariés sont dans l'ESS depuis 2000. Ce domaine offre 60000012(*) postes à pouvoir d'ici
l'an 2020 en raison des départs à la retraite selon le CNCRES
(chiffres Insee Clap 2013).
En Angleterre, le taux de participation bénévole
est estimé à 42% en 2014 contre 41% en 2015. Le taux pour le
bénévolat pratiqué directement en faveur des
bénéficiaires (bénévolat informel) est de 60% en
2014 et de 59% en 2015. Il est clair que le taux a sensiblement baissé.
Ainsi, un peu plus de la moitié de la population s'adonne aux pratiques
d'entraide à travers au moins une organisation.
2.1.3 Le bénévolat
ivoirien
En Côte d'Ivoire comme partout ailleurs, les
activités sont d'abord pratiquées de façon informelle.
Elles prennent une forme plus organisée et se pratique quelque fois
même dans les entreprises et administrations publiques. Ce domaine est
très faiblement structuré, ce qui n'ouvre pas de perspective de
développement. L'engagement bénévole dans ces structures
est en nombre de plus en plus croissant et de diverses caractéristiques.
Cependant, même dans ces structures, le bénévolat se
pratique en partie de façon non formelle. Puisque les
bénévoles ne sont pas formés, encadrés et il n'y a
pas de politiques visant à développer ce secteur.
Outre ces constats, l'on remarque quelques belles initiatives
visant à changer la donne. Des états généraux de la
solidarité ont été organisés en 2009 à
l'initiative du ministère de la solidarité et des victimes de
guerre. Il en est sorti de cette rencontre, l'institution de l'Observatoire de
la Solidarité et de la Cohésion Sociale. C'est un
établissement public national (EPN) qui a pour objectifs :
ü Incité à la bonne gouvernance nationale
et locale basée sur l'idée de la solidarité,
ü Mesurer et évaluer les indicateurs de
progrès mais aussi de menace sur la société,
ü Alerter les décideurs,
ü Faire le plaidoyer auprès des acteurs
clés des politiques de développement afin que les actions
identifiées comme positives pour le renforcement de la solidarité
et de la cohésion sociale soient réalisées.
De plus, un ordre du mérite de la solidarité a
été institué dans le même élan, pour traduire
la reconnaissance et l'hommage de la nation à ceux qui auront
contribué avec constance à la promotion et à la
consolidation de la cohésion sociale dans notre pays. Egalement, la
journée nationale de la solidarité célébrée
depuis 2006 a été instituée pour être
célébrée le 25 décembre de chaque année.
2.2 D'autres résultats
empiriques
Gidron (1978), dans sa revue volunteerwork and
itsrewards, donne les résultats de son étude
réalisée auprès de 317 bénévoles dans les
institutions de santé aux Etats Unis. Ses recherches lui permettent
d'identifier trois types de récompense dont deux sont plus susceptibles
de motiver les bénévoles : extrinsèques et
intrinsèques. Se basant sur ses résultats, on s'aperçoit
qu'il existe peu de motivations extrinsèques (la recherche de
récompense tout en évitant les sanctions externes), à
savoir :
- Le développement personnel : supervision
professionnelle et formation ;
- La relation avec les autres bénévoles.
Par contre, les récompenses intrinsèques (le
plaisir, l'utilité sociale) sont nombreuses :
- Etre orienté vers l'autre : penser aux autres,
aider les plus démunis,
- Le développement personnel : faire des choses
intéressantes et variées dans sa vie, apprendre à
travailler avec les autres, prendre des responsabilités, gagner des
compétences ;
- Les relations sociales : participer à des
missions auxquelles d'autres bénévoles participent, rencontrer de
nouvelles personnes, partager ses idées, ses opinions et ses
problèmes avec d'autres personnes ;
- Remplir des obligations : remplir une obligation avec
la communauté, faire un travail important ;
- La reconnaissance sociale : faire partir d'une
organisation importante dans la communauté.
Abordant également une approche
«récompense-motivation«, Fitch (1987) s'est proposé de
savoir, si les motivations de ces bénévoles étaient
centrées sur eux-mêmes ou sur autrui. Parti avec un questionnaire
destiné à des étudiants bénévoles, il a
défini trois natures possibles de la motivation d'un
bénévole :
- Les motivations altruistes : le bénévole
s'intéresse réellement au bien-être d'autrui ;
- Les motivations égoïstes : il espère
retirer certains avantages personnels de son expérience, comme des
compétences, un réseau d'amis etc.
- Les obligations sociales : l'individu se sent
endetté vis-à-vis de la société et devient
bénévole pour corriger cette injustice. Ce type de motivation est
à la fois altruiste (il veut aider l'autre) et égoïste (il
veut soulager sa culpabilité).
Quelques années plus tard, Clary et Al. (1998)
choisissent d'utiliser l'approche fonctionnaliste afin d'évaluer les
motivations des individus à devenir bénévole et à
s'engager durablement. En s'appuyant sur les travaux de recherche de Katz
(1960), Gidron (1978), et Smith et al. (1956), ils proposent et
vérifient six bénéfices (ou avantages ou fonctions)
pouvant motiver un individu à faire du travail
bénévole.
Cette typologie à six facteurs montre bien la
complexité et la variété des motivations des
bénévoles. Elle est basée sur un questionnaire de 30
affirmations dont doivent évaluer l'importance sur échelle de 1
à 7. Ce questionnaire est appelé la VFI
(VolunteerFunctionInventory). Cependant, la VFI a été parfois
remis en cause notamment par Allison, Okun et Dutridge (2002). Ils ont voulu
voir si les six fonctions étaient réellement pertinentes et s'il
n'y en avait pas d'autres pour compléter cette typologie. Leurs
résultats ont montré que trois fonctions du VFI sortaient du lot
et obtenaient des scores particulièrement élevés :
les valeurs, la compréhension et l'estime. Avec les questions ouvertes,
ils ont conclu que trois motivations supplémentaires pouvaient
être ajoutées aux six fonctions : la religion, le plaisir et
le travail d'équipe.
De son coté, Marisa R. Ferreira (2012) a mené
une étude sur plus de 350 bénévoles dans les
hôpitaux au Portugal, leur faisant elle aussi passer le VFI. Elle est
arrivée à la conclusion que les six fonctions de Clary et Al
pouvaient être restreintes à quatre facteurs de motivation.
- Le développement et l'apprentissage : gagner en
expérience, en compétence, en estime de soi, etc.
- L'appartenance et la protection : les interactions
sociales, les amitiés, etc.
- La carrière : le réseau, le CV, les
compétences, etc.
- L'altruisme : l'empathie, l'aide aux autres, etc.
La motivation qui sous-tend
l'engagement bénévole est bien diversifiée, car prenant sa
source principalement dans la culture, ce qui fait du bénévolat
une activité définie selon la communauté. Le chapitre qui
va suivre permettra de voir notre méthodologie d'analyse.
CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE
D'ANALYSE ET RESULTATS STATISTIQUES
La motivation au bénévolat telle que
délimitée dans l'introduction nous permet d'annoncer la
méthode de recueille des données et leurs traitement,
préalable aux analyses (section 1). Dans la section 2 nous
présenterons les résultats de la statistique descriptive.
SECTION 1 : METHODOLOGIE
D'ANALYSE
Cette section nous permet de décrire la
méthodologie suivie pour la recueille de données via
enquête et leur traitement. Il s'agit de circonscrire le cadre de
l'enquête, la population et la méthode pour traiter les
données.
1.1 Collecte des données
par enquête
Comme la plupart des travaux de la
littérature, nous avons fait une enquête auprès de la
population bénévole. Notre questionnaire comportait 30 questions,
et nous visions les 14 ans et plus qui mènent leurs activités par
le truchement d'une organisation (bénévolat formel). Ce
questionnaire a été élaboré sous deux formats
(papier et en ligne via google forms) pour toucher le maximum de
bénévoles. Foncièrement basé sur la
littérature, ce questionnaire comporte six thèmesrésumés dans le tableau ci-dessous.
Tableau3 :
différents thèmes du questionnaire
|
Thèmes
|
Sujet traité
|
|
1 : Q1 et Q2
|
Définir le bénévolat ;
à quoi sert-il ?
|
|
2 : Q3 à Q9
|
Mon profil sociodémographique. Il
s'agit pour le bénévole de livrer des informations personnelles
sur l'âge, le genre, la situation de famille, la religion, le niveau
d'étude etc.
|
|
3 : Q10 à Q14
|
Ma situation familiale, affective et le
bénévolat. Elle vise à établir le lien
entre la pratique du bénévolat par les proches du
bénévole et sa décision de s'engager
bénévolement.
|
|
4 : Q15 à Q21
|
Mon adhésion au
bénévolat. Avec une échelle de Richter, il
s'agissait de livrer des informations sur le nombre d'organisations dans
lesquelles il oeuvre, sa fréquence de participation, le nombre total
d'heures etc.
|
|
5 : Q22 à Q27
|
Mon domaine d'activité. Ici l'on
demande à savoir un peu plus sur l'activité
bénévole du répondant
|
|
6 : Q28 à Q30
|
Mes motivations au bénévolat.
Une échelle de 4 motivations comportant 4 questions chacune
sont proposées.
|
Les antécédents du
questionnaire dans la littérature sont proposés ici.
Tableau4 : Composants du questionnaire
|
Concepts
|
Auteurs
|
Questions
|
|
Définir le bénévolat ; à quoi
sert-il ?
|
Imagine Canada, 2007
|
Q1 et Q2
|
|
Avoir un parent ou un ami bénévole
|
Ajout personnel
|
Q10 et Q11
|
|
Avoir vécu une situation suscitant un acte
bénévole
|
Ajout personnel
|
Q12 à Q14
|
|
Adhésion au bénévolat
|
Gourmelen, 2014
|
Q15 à Q21
|
|
Pour un gain altruiste et ou égoïste
|
Bussell et Forbes, 2002
|
Q28
|
|
EMAB
|
Vallerand et Till, 2000
|
Q29
|
|
Satisfaction des trois besoins psychologiques innés
|
Forest, J et al, 2010
|
Q30
|
1.2 Les données de
l'étude
Notre étude se situe dans le cadre spécifique de
la Côte d'Ivoire. Une méthode simple a été
adoptée pour atteindre les objectifs fixés pour ce travail
portant sur l'offre de travail sur le territoire ivoirien. L'analyse de l'offre
de travail a été réalisée en consultant les
résultats de l'enquête emploi de 2013, et les statistiques de
l'enquête auprès des ménages de 2015 de l'INS.
Nos données sont issues essentiellement de la base de
données de l'Enquête Nationale sur la Situation de l'Emploi et du
Travail des Enfants (ENSETE, 2013) de l'AGEPE. La construction des
données de l'enquête auprès des ménages sur la
situation de l'emploi et le travail des enfants (ENSETE) a été
réalisée pour fournir des informations de qualité sur le
système d'emploi d'une part et le travail des enfants d'autre part. La
population de cette enquête est constituée par l'ensemble des
ménages dénombrés au cours du recensement
général de la population et de l'habitat de 1998 (RGPH98).
L'unité d'analyse qui a guidé la collecte est le membre du
ménage et particulièrement les individus de 5 ans et plus
(Rapport ENSETE, 2014)13(*).
Plus de 48679 individus ont été
interrogés dans l'enquête emploi. Après retraitement de
cette base, ce sont 30500 individus (soit 62,65%) qui constituent
l'échantillon sur lequel nous travaillons.
1.3 Le traitement des
données
L'enquête emploi portait aussi sur la situation de
l'emploi des enfants. Ceci a valu un découpage en de nombreuses tranches
d'âge. Dix-sept groupes d'âge au total, allant de 0 à 80 ans
et plus et espacés de cinq ans ont été retenus. Cependant,
pour ce qui nous concerne, nous avons retenu cinq groupes d'âges de 14
à 55 ans et plus, avec un espacement de 10 ans, sauf le dernier groupe
qui est un peu plus large. Ce choix n'est pas fortuit, car, toute la population
en âge de travailler (individus de 14 ans et plus) y compris les
retraités, nous intéressent. En outre, il est
démontré que les retraités s'adonnent beaucoup au travail
bénévole compte tenu de leur plus grande disponibilité et
la pression temporelle (Gourmelen, 2013). La situation matrimoniale n'a pas
subi de traitement particulier. Quant à la religion qui est une variable
polytomique, elle a subi une réorganisation des modalités de
sorte à faciliter l'analyse et les interprétations. Ainsi, les
protestants et les autres chrétiens ont été
regroupés en une même modalité (codée M9= 3),
les animistes et les sans religion aussi (codée M9=5).
La variable indiquant le niveau de diplôme comportait 19
modalités, ce que nous avons regroupé en 5 modalités. En
effet, les diplômes de la formation professionnelle ont leurs
équivalents dans la formation générale. Ils peuvent
naturellement être mis ensemble pour un travail de mémoire. Ainsi
donc le BAC, le BP et le BT correspondent aux diplômes d'un même
cycle (second cycle). De même que le DEUG, la Licence, le BTS et le DUT
comme diplômes du premier cycle du supérieur. La maitrise, le
Master, le DESS, le DEA, l'Ingénieur et le Doctorat, sont les
diplômes du second et du troisième cycle universitaire. Ils sont
aussi appelés diplômes du cycle supérieur. D'autres
variables telles que le statut dans l'emploi, le type d'unité de
production... ont été également regroupées sous
cinq modalités pour simplifier les analyses. On note que toutes nos
variables sauf le genre, sont des variables polytoniques.
SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE STATISTIQUE
Cette section présente les
résultats de l'analyse statistique des données après leur
traitement. Lequel traitement a permis d'avoir une base souple et plus
adaptée aux exigences de ce travail. Il est essentiellement une
description des bénévoles étudiés ici.
2.1 Motivations des
bénévoles
Des difficultés rencontrées dans le cadre de
l'enquête que nous avons réalisé et la taille de
l'échantillon pour ce travail limitent la validité des
résultats à un essai de compréhension des
bénévoles et de leurs motivations. Ils sont au nombre de 99 sur
102 individus à confirmer avoir fait du travail bénévole
au sein d'une organisation.
Les bénévoles ivoiriens (enquêtés)
sont majoritairement des hommes (55,56%), ils ont pour la plupart un âge
compris entre 16 et 34 ans avec une grande partie (43,43%) qui a moins de 35
ans et l'âge médian est de 24 ans. Ils sont en grande
majorité célibataires (73,74%), religieux (86,87% sont
chrétiens et 11,11% sont musulmans) et sont titulaires de diplômes
universitaires (47,47% ont un Bac+1, +2 ou +3 et 36,36% ont un Bac+4 ou plus).
Cependant, seulement 35,35% travaillent, 44,44% étudient encore et
18,18% autres sont à la recherche d'un premier emploi. Ceci fait
remarquer la grande jeunesse de la population bénévole qui trouve
dans le bénévolat un moyen de lutter contre le chômage.
Quant à leurs motivations pour ce travail, elles sont
de natures diverses. 53,53% font du bénévolat parce qu'ils ont un
proche (ami ou parent) qui fait ou a fait ce même travail, aussi parce
qu'ils ont été témoin de situations motivant au
bénévolat (82,83%). Voir l'encadré ci-dessous.
Ils sont aussi tirés par les difficultés qu'ils
ont vécues eux-mêmes (42,42%) et ne voulant laisser personne vivre
de telles situations. Ainsi, ils s'engagent à travers des organismes de
bénévoles (18,18% sont dans au moins deux organismes),
travaillent très souvent (30,30% au moins une fois par semaine) et
fournissent au moins 2 heures de travail à chaque fois (35,35%) ou plus
de 3 heures (30,30%) par séance.
« Une pouponnière était dans un état
d'insalubrité et j'ai aidé au nettoyage » M.
Gautier, 28 ans.
« J'ai vu dans mon environnement des femmes mal
nourrir leurs enfants et mal s'en occuper. J'ai donc usé de mes
connaissances en nutrition pour aider ses mamans à pratiquer les bonnes
pratiques essentielles (PFE) » Ma. Marlice, 34 ans.
« L'individualisme, l'accessibilité à
l'éducation. J'ai enseigné les enfants délaissés
d'un quartier précaire de kôkôà
Bouaké ». M. Kennedy Dollar, 27 ans.
« Pas plus tard que ce matin, j'ai trouvé mon
vieux voisin de porte en train de rassembler des briques, alors je n'ai pas pu
l'ignorer et passer ». M. Yao, 21 ans.
« Après avoir obtenu mon BAC, j'ai
consacré mes temps libres à aider les élèves. Je
l'ai fait car moi aussi j'ai été élève et je
connais leurs difficultés. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des
répétiteurs » M. Kan Constant 26 ans
...
Encadré : motivation bénévole
basée sur les expériences de la vie
Leurs motivations caractérielles sont mixtes (39,39%)
mais tournent autour de la motivation non autodéterminée
égoïste (MNAE 18,18%) pour la recherche d'une qualification ou
d'une expérience professionnelle par exemple. En outre à la
question : Pourquoi faites-vous le bénévolat ? Ils
répondent :
|
Parce que l'expérience que m'offre le
bénévolat pourra éventuellement me servir du
côté de l'emploi
|
12
|
30 %
|
|
Parce que faire du bénévolat me permet
d'enrichir mon curriculum vitae.
|
19
|
47.5 %
|
|
Parce que cela me permet d'être mieux
considéré(e) socialement
|
14
|
35 %
|
2.2 Caractéristiques de
l'emploi
Dans la deuxième base, les individus peuvent être
classés selon leur statut dans leur emploi principal, qui est la
variable expliquée. Ainsi donc, les agriculteurs indépendants
additionnés aux aides familiales sont dominants avec 8382 personnes pour
43.26%. 3555 personnes (soit 18,35%) sont salariées, 6427 personnes
comptant pour 33,17% sont employeur ou travailleur dans un domaine autre que
l'agriculture. Seulement 64 personnes (soit 0,33%) ont déclaré
faire du bénévolat leur activité principale. Cela se
comprend aisément, puisse que le bénévolat est une
activité non rémunérée ou faiblement
rémunérée. Voir tableau 3 ci-dessous.
Tableau 5 : Statut dans l'emploi en fonction du
genre
|
Sexe
|
|
Statut
|
Homme
|
Taux
|
Femme
|
Taux
|
total
|
Taux
|
|
Salarié
|
2698
|
75,89%
|
857
|
24,11%
|
3555
|
18,35%
|
|
Employeur, travailleur hors agriculture
|
2569
|
39,97%
|
3858
|
60,03%
|
6427
|
33,17%
|
|
Travailleur bénévole
|
40
|
62,5%
|
24
|
37,5%
|
64
|
0,33%
|
|
Stagiaire ou apprenti
|
647
|
68,39%
|
299
|
31,61%
|
946
|
4,89%
|
|
Aide familiale ou agriculteur
indépendant
|
4384
|
52,30%
|
3998
|
47,70
|
8382
|
43,26%
|
|
Total
|
10338
|
53,36%
|
9036
|
46,64%
|
19374
|
100%
|
Source : de l'auteur à partir de l'ENSETE,
2013
Qui sont les
bénévoles ?
En faisant une statistique descriptive comparée entre
les bénévoles et les non bénévoles, on a :
Tableau 6 : statistique descriptive entre
bénévole et non bénévole
|
Variables
|
Bénévoles
|
Non bénévoles
|
|
Modalités
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
Fréquence
|
Pourcentage
|
|
Sexe
|
Masculin
|
40
|
62,05%
|
10298
|
53,33%
|
|
Féminin
|
24
|
37,95%
|
9012
|
46,67%
|
|
Tranche d'âge
|
14-24
|
9
|
14,06%
|
4558
|
23,71%
|
|
25-34
|
16
|
25%
|
5958
|
30,99%
|
|
35-44
|
20
|
31,25%
|
4103
|
21,34%
|
|
45-54
|
8
|
12,5%
|
2591
|
13,48%
|
|
55 et +
|
11
|
17,19%
|
2023
|
10,52%
|
|
Lien avec le chef de ménage
|
Chef
|
38
|
59,38%
|
9645
|
49,92%
|
|
Conjoint du chef
|
10
|
15,62%
|
4813
|
24,92%
|
|
Enfant du chef
|
10
|
15,62%
|
2404
|
12 ?45%
|
|
Parent du chef
|
6
|
9,38%
|
2069
|
10,71%
|
|
Autre
|
0
|
0
|
379
|
1,96%
|
|
Statut matrimonial
|
Marié monogam
|
32
|
50%
|
10062
|
52,11%
|
|
Marié polygam
|
6
|
9,37%
|
1860
|
9,63%
|
|
Célibataire
|
22
|
34,38%
|
6273
|
32,49%
|
|
Divorcé
|
0
|
0
|
281
|
1,45%
|
|
Veuf
|
4
|
6,25%
|
834
|
4,32%
|
|
Religion
|
Musulman
|
29
|
45,31%
|
10035
|
51,80%
|
|
Catholique
|
14
|
21,87%
|
3315
|
17,11%
|
|
Protestant et +
|
18
|
28,12%
|
3085
|
15,92%
|
|
Autres
|
1
|
1,56%
|
328
|
1,69%
|
|
Animistes
|
2
|
3,12%
|
2547
|
13,15%
|
|
Diplôme
|
= CEPE
|
24
|
54,55%
|
6935
|
73,95%
|
|
BEPC et équiva-
|
7
|
15,91%
|
975
|
10,40%
|
|
BAC et équiva-
|
6
|
13,64%
|
665
|
7,09
|
|
<BAC +4
|
2
|
4,54%
|
287
|
3,06%
|
|
BAC+4 et plus
|
5
|
11,36%
|
516
|
5,50%
|
|
Type emploi
|
permanent
|
52
|
81,25%
|
173484
|
90,24%
|
|
Occasionnel
|
12
|
18,75%
|
1826
|
9,76%
|
Source : de l'auteur à partir de l'ENSETE,
2013
L'analyse de ce tableau nous permet de dire que :
Le bénévolat est beaucoup plus pratiqué
par les hommes 62,05%de la population enquêtée. Cependant le taux
de participation des femmes n'est pas à négliger. Les tranches
d'âges les plus concernées sont les 25 à 44 ans avec une
participation nette supérieure des 35 à 44 ans qui est de 31,25%
de la population. Ces bénévoles sont pour la plupart des chefs de
ménage (59,38%) et sont mariés à une seule femme (50%). Le
taux de participation (34,38%) moins élevé des
célibataires montre qu'une partie des chefs de ménages ne sont
pas mariés.
Le tableau révèle également que la
pratique du bénévolat est quasiment le fait des religieux. Les
chrétiens toute confession confondue (catholiques, protestant et autre)
s'adonnent plus à cette pratique (49,99%) que les musulmans (45,31%).
Plus d'un bénévole sur deux (54,55%) n'a pas fait le
collège. Par contre, un peu plus des ¾ (52 sur 64) est en emploi
permanent.
Au niveau des non bénévoles, les
résultats sont quasiment les mêmes sauf la catégorie des 25
-34 ans (31,41%) et les musulmans (51,86%) plus nombreuxqui renversent la
tendance. On peut néanmoins conclure que la participation des
bénévoles et celle des non bénévoles à
l'emploi est la même. Ce qui pousse certaines personnes à
s'adonner au bénévolat est certainement une
caractéristique interne -motivation- propre à chacun comme le
note la littérature (Vallerand et Till, 2000).
Il est certain, un motivé altruiste ou
égoïste l'est dans le coeur, le temps et les circonstances lui
donneront de l'exprimer. Une responsable de groupe de bénévoles
nous a laissé entendre ces mots : « L'altruisme est un
don de Dieu, le temps et les circonstances de la vie nous découvriront,
et un jour ou l'autre on sera appelé bénévole ».
Madame Berté OULAÏ
|
Type du travail bénévole
|
Effectif
|
Pourcentage
|
|
Guide religieux
|
14
|
21,88
|
|
Enseignant bénévole
|
12
|
18,75
|
|
Stagiaire, apprenti, gérant
|
25
|
39,06
|
|
Fondateur
|
3
|
4,69
|
|
Aide & agriculteur
|
10
|
15,62
|
|
Total
|
64
|
100
|
Les bénévoles de la base de données ont
leur activité principale dans le bénévolat et vivent de ce
travail. On doit comprendre par-là que cette activité est
rémunérée.
CHAPITRE 3 : LES FACTEURS DETERMINANTS DE L'ENGAGEMENT
BENEVOLE
Ce chapitre présente les résultats d'analyses et
la discussion sur ceux-ci. Il se présente en deux sections. La
première fournie la modélisation et les estimations
économétriques des variables. La deuxième section
permettra de présenter les résultats
économétriques, la discussion puis les implications avant la
conclusion.
SECTION 1 : CADRE D'ANALYSE ECONOMETRIQUE
A l'aide d'estimations économétriques, nous
allons tester ici nos hypothèses.
1.1. Définition et mesure
des variables
La base de données de l'enquête emploi (2013)
nous offre plusieurs variables possibles. Mais ayant l'objectif d'analyser le
travail bénévole en Côte d'Ivoire, nous retenons seulement
dix variables qui pour nous sont plus intéressantes.
o Le statut dans l'emploi principal (variables
endogène)
Cette variable, comme son nom le dit, détermine le
statut de l'individu dans son emploi principal. Elle comportait à
l'origine sept modalités, ce que nous avons ramené après
traitement à cinq :
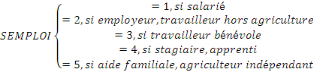
L'individu rationnel choisi son emploi selon des
critères qui lui sont propres. Les variables explicatives devront aider
à comprendre pourquoi l'individu i choisit la modalité j qui dans
notre cas est fixé au travail bénévole.
o Les variables explicatives
Les variables jugées pertinentes pour expliquer le
choix de l'individu i sont :
Sexe (SEXE) : C'est la variable qui
enregistre l'influence du sexe sur le choix de faire du
bénévolat. C'est une variable dichotomique : 1=homme et
2=femme.
Age (AGE) :En 1985, Yavas et Riecken
montrent que l'âge est le facteur le plus discriminant, suivi de
l'éducation et de l'occupation. Selon eux, un bénévole
type avait, en 1985, 35 ans ou plus, atteint le collège, un emploi et
était peu influencé, en termes de temps, par sa famille ou son
travail.
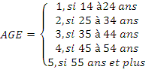
Lien avec le chef de ménage
(LMENAGE) : Riecken et Yavas, en collaboration avec Wymer (1996),
concluaient que l'un des facteurs les plus influents sur l'action
bénévole est l'attitude des parents à propos du
bénévolat, qui prédispose alors les enfants à
participer à ce type d'activité lorsque ceux-ci deviennent
adultes. Les amis sont aussi une grande source d'influence, ainsi que la
communauté, lorsque celle-ci est petite. Cette variable a
été catégorisée sous 5 modalités :
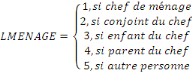
Situation matrimoniale (SMATRI) :cette
variable nous informe sur le lien entre la situation de famille de l'individu
(bénévole) et son engagement dans le travail
bénévole :
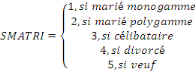
La religion
(RELIGION) : Cette variable, selon notre
enquête est déterminante au point d'être très
importante au dire des répondants. Le fait d'être membre d'une
communauté religieuse inciterait au bénévolat (Van Tienen
et al, 2010). Certains auteurs trouvent une forte
corrélationpositive entre la religiosité collective seule et la
probabilité d'être engagé dans le bénévolat
au sein d'organisations religieuses (Yeung, 2004)comme laïques (Taniguchi
et Thomas, 2011).
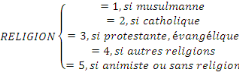
Niveau de diplôme (DIPLOM) :Notre
enquête a révélé également un niveau de
diplôme élevé des bénévoles. Le niveau
d'étude est considéré comme l'un desdéterminants
les plus importants du bénévolat (Chambre, 1984 ; Wilson, 2000 ;
Handy et Hustinx, 2009). Ainsi, plus le diplôme d'un individu est
élevé, plus la probabilité qu'il fasse du
bénévolat est forte (Caro et Bass, 1997, chez les 55 ans et plus
; Choi, 2003).
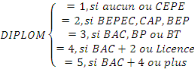
Type de l'unité de production (UPROD) :
Cette variable traduit aussi le type d'employeur qui pourrait inciter
à l'engagement bénévole surtout que le travail
bénévole se pratique aussi en entreprise. Elle comporte cinq
modalités qui sont :
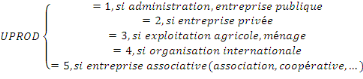
Type d'emploi (TEMPLOI) : cette variable
comporte deux modalités
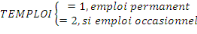
Lieu de résidence à 15 ans
(LRESID) : Cette variable nous informe sur le lien de
parenté de la personne chez qui l'individu a vécu à 15 ans
et son influence possible sur la décision présente de l'individu
face à l'engagement bénévole.
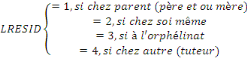
Cette personne (assurément le parent) travaille
-t-elle (PTRAVAIL) ?
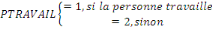
|
Num
|
Variables explicatives
|
Codage
|
Concept
|
Signe
|
|
01
|
Sexe
|
SEXE
|
Influence des variables sociodémographiques sur
l'engagement bénévole
|
Positif
|
|
02
|
Age
|
AGE
|
Positif
|
|
03
|
Situation matrimoniale
|
SMATRI
|
Négatif
|
|
04
|
Religion
|
RELIGION
|
Positif
|
|
05
|
Niveau de diplôme
|
DIPLOM
|
Positif
|
|
06
|
Unité de production
|
UPROD
|
Impact de l'employeur et de l'emploi salarié
|
Négatif
|
|
07
|
Type d'emploi
|
TEMPLOI
|
Positif
|
|
08
|
Lien avec le chef de
|
LMENAGE
|
Influence des parentssur l'engagement bénévole
|
Négatif
|
|
09
|
Lieu de résidence à 15 ans
|
LRESID
|
Positive
|
|
10
|
Chef de résidence travaille-t-il ?
|
PTRAVAIL
|
Positive
|
Tableau7 : Conceptualisation des variables avec
leurs signes attendus.
Source : de l'auteur
et basée sur la littérature
1.2
Instruments de mesure
La plupart de nos variables sont qualitatives polytoniques
(c'est-à-dire comportant plus de 2 modalités). Le travail
d'estimation sera fait à partir du logiciel Stata version 13, et
analysées à l'aide d'un modèle Tobit simple à
double censure. Ce modèle est utilisé lorsque la variable
dépendante -ici statut dans l'emploi- est une variable multinomiale et
où l'on ne veut considérer qu'un ou quelques modalités.
Les modèle Tobit se réfèrent de
façon générale à des modèles de
régressionsdans lesquels le domaine de définition de la variable
dépendante est contraint sous une forme ou une autre. En
économie, de tels modèles ont été initiés
par James Tobin (1958) qui les qualifia de modèle à variable
dépendante limitée14(*) (limited dependent variables model). Toutefois, ces
modèles sont aussi appelés modèles de régression
censurées (censored regression models), lorsque l'on dispose au moins
des observations des variables explicatives sur l'ensemble de
l'échantillon ou modèle de régression tronquée
(truncated regression models), lorsque toutes les observations des variables
explicatives et de la variable dépendante figurant en dehors d'un
certain intervalle sont totalement perdues.
On considère dans le cas général, un
modèle Tobit simple à censures multiples qui s'écrit sous
la forme suivante :
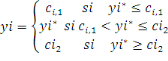 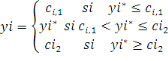 (1) (1)
Où   désigne les bornes de censure et où :
désigne les bornes de censure et où :
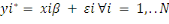 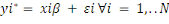 (2)
(2)
Où 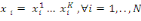 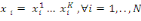 désigne un vecteur de caractéristiques observables et où
désigne un vecteur de caractéristiques observables et où
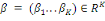
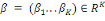 est un vecteur de paramètres inconnus et où les perturbations
åi sont distribuées selon une loi
est un vecteur de paramètres inconnus et où les perturbations
åi sont distribuées selon une loi  . .
Considérons un individu i d'une population N (i = 1,
.., N) catégorisée en m+1 modalité, qui doit
répondre à la question : Quel est le type de l'unité
de production de votre emploi principal ? Sa réponse doit contenir dans
une série de m+1 modalité. On postule que les choix rationnels
peuvent être représentés par une fonction d'utilité
U (.). On pose que pour chaque modalité j = 0, 1, ..,m, l'utilité
del'individu s'exprime sous la forme suivante :
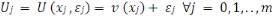 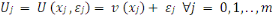 (3)
(3)
Où v (.) est une fonction continue
déterministe,  la
liste des variables explicatives et où åj est une variable
aléatoire i.i.d. dont la loiest décrite par la fonction de
densité f (.) et la fonction de répartition F (.). On suppose que
les perturbations åj, ?j = 0, 1, ...,m sont indépendantes. la
liste des variables explicatives et où åj est une variable
aléatoire i.i.d. dont la loiest décrite par la fonction de
densité f (.) et la fonction de répartition F (.). On suppose que
les perturbations åj, ?j = 0, 1, ...,m sont indépendantes.
Le modèle utilisé ici, le Tobit simple à
double censure (modèle de friction ou deRosett) est un modèle
où les seuils de censures à gauche et à droite sont
identiques pour tous les individus. Où  . .
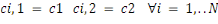 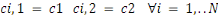 (4)
(4)
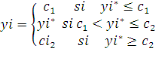 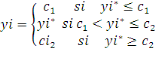 (5)
(5)
La log-vraisemblance concentrée associée
à un échantillon y = (y1, ..., yN) dans un
modèle Tobit simple à double censure s'écrit :
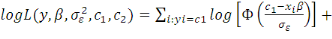 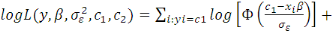 (6) (6)
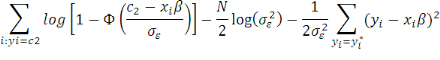
Où N1 désigne le nombre d'observations pour
lesquelles  
1.3Estimation des
paramètres du Tobit
Le modèle Tobit admis est justifié par la fait
que seulement la modalité 3= travail bénévole de la
variable dépendante (statut dans l'emploi) nous intéresse, il
s'agit donc de faire une censure à gauche et une à droite. La
fonction de Vraisemblance d'un tel modèle s'écrit :
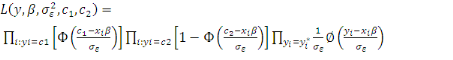 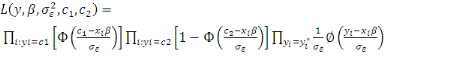 (7) (7)
Le premier terme désigne le produit des
probabilités que les observations yi prennent lesvaleurs de censures
inférieures  : :
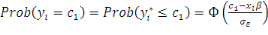 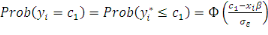 (8)
(8)
Le second terme désigne le produit des
probabilités que les observations yi prennent lesvaleurs de censures
supérieures  : :
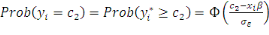 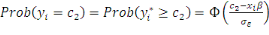 (9)
(9)
Pour mesurer la qualité d'ajustement des modèles
estimés, nous considérons plusieurs indicateurs classiques qui
sont le critère d'information d'Akaike (AIC) [Akaike, 1974], le
critère d'information bayésien (BIC) [Schwarz, 1978], la P-value

 habituellement utilisée dans les modèles logit et le
pseudoR2de McFadden (McFadden, 1974) :
habituellement utilisée dans les modèles logit et le
pseudoR2de McFadden (McFadden, 1974) :
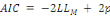
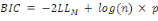
R2de McFadden =  
AvecLLMla log-vraisemblance, p le
nombre de paramètres à estimer du modèle, n la
taille de l'échantillon et LL0 la log-vraisemblance
du modèle nul (sans autre paramètre que la constante ou
modèle par défaut). Il est formulé comme suit :

Où nj et ndésignent
respectivement les effectifs de la modalité jet l'effectif
total de l'échantillon. L'AIC et le BIC permettent de pénaliser
les modèles en fonction du nombre de paramètres afin de
satisfaire le critère de parcimonie, la pénalité
étant encore plus grande avec le BIC. Plus ces critères sont
faibles, meilleur est le modèle. Le R2 de McFadden,
ou pseudo-R2, a été construit pour ressembler
au R2 de la régression linéaire mais doit
s'interpréter en termes de part de déviance et non en termes de
part de variance. Bien que compris entre 0 et 1 (comme le
R2),des simulations ont montré qu'une valeur autour
de 0,3 correspond à une valeur élevée de
R2(Domencich and McFadden [1975, p. 134-135]).
Un autre indicateur de la littérature
économétrique pour juger de la qualité de l'estimation
avec le Tobit est le test de rapport de vraisemblance formulé comme
suit :

Avec   la
déviance du modèle par défaut et la
déviance du modèle par défaut et   la
déviance du modèle d'étude. L'indicateur du test du
rapport de vraisemblance suit une loi de Khi-deux définie par : la
déviance du modèle d'étude. L'indicateur du test du
rapport de vraisemblance suit une loi de Khi-deux définie par :
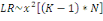
Avec   le
degré de liberté où K est le nombre de paramètres
à estimer et N, le nombre de modalités de la variable
dépendante. Le modèle est de bonne qualité si la valeur
calculée est supérieure à la valeur donnée par la
table de Khi-deux à un seuil á fixé. le
degré de liberté où K est le nombre de paramètres
à estimer et N, le nombre de modalités de la variable
dépendante. Le modèle est de bonne qualité si la valeur
calculée est supérieure à la valeur donnée par la
table de Khi-deux à un seuil á fixé.
L'estimateur du Maximum de Vraisemblance (MV) nécessite
la vérification de deux principales hypothèses pour l'estimation
des modèles Tobit. Il s' agit des hypothèses
d'hétéroscédasticité et de normalité.
De façon générale, on montre que
l'estimateur du MV en présence
d'hétéroscédasticité est asymptotiquement
biaisé. L'importance des biais asymptotiques croît avec le
degré de censure des données. Greene (1997) propose d'utiliser un
test du multiplicateur de Lagrange. Une expression de la statistique LM du test
de l'hypothèse nulle d'homoscédasticité H0 : á = 0
est
  , qui
suit une distribution , qui
suit une distribution  
Où N désigne le nombre d'observations et
où R2 est le coefficient de détermination de la régression
du vecteur unitaire   de
dimension (N, 1) sur les K+P +1 colonne de la matrice de
dimension (N, 1) sur les K+P +1 colonne de la matrice  . .
LM = 0. 2183* 9037 = 1972,7771,
Cette valeur est très supérieure à la
valeur tabulée   donc
l'hypothèse H0 est acceptée, il y a bien
homoscédasticité. donc
l'hypothèse H0 est acceptée, il y a bien
homoscédasticité.
La seconde principale hypothèse qui peut affecter de
façon sensible les propriétés de l'estimateurdu MV est
l'hypothèse de non normalité des perturbations. Nous utilisons un
test de Schapiro-Wilk dont la formule est :
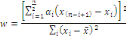
La statistique W peut donc être
interprétée comme le coefficient de détermination (le
carré du coefficient de corrélation) entre la série des
quantiles générées à partir de la loi normale et
les quantiles empiriques obtenues à partir des données. Plus
W est élevé, plus la compatibilité avec la loi
normale est crédible. Le w obtenu est :   pour
chacune des variables. On conclue sur l'hypothèse nulle de
normalité des perturbations. pour
chacune des variables. On conclue sur l'hypothèse nulle de
normalité des perturbations.
La stratégie de test à la Hausman (1978) :
Nelson (1981), Melenberg et Van Soest(1996), plus complexe mais plus
approprié conduit à la même conclusion. Le travail
d'estimation avec le Maximum de vraisemblance peut être effectué
en toute quiétude.
SECTION 2 : RESULTATS ECONOMETRIQUES ET DISCUSSION
Dans cette section, nous
présentons d'abord les résultats issus des estimations
économétriques. Ensuite, nous faisons un bref rappel desobjectifs
de recherche, puis nous montrons le lien entre les résultats obtenus et
ce que dit la littérature. En fin, il sera question de décrire
les limites de cette recherche, avant de donner des idées pour des
recherches futures sur le sujet.
2.1 Les résultats
d'estimations
Nous présentons de façon synthétique,
dans les tableaux suivants, les résultats des estimations
économétriques à l'aide du Tobit simple de censure
à gauche et à droite.
Tableau 8 : Résultats de la
régression par le modèle Tobit
|
|
Variables
|
Coefficients
|
P-Value
|
|
SEXE
|
-28.51422
|
0.000
|
|
AGE
|
-17.0459
|
0.000
|
|
SMATRI
|
2.067341
|
0.285
|
|
RELIGION
|
11.03442
|
0.000
|
|
DIPLOM
|
-21.96551
|
0.000
|
|
UPROD
|
114.2761
|
0.000
|
|
TEMPLOI
|
-28.31921
|
0.000
|
|
LMENAGE
|
16.78534
|
0.000
|
|
LRESID
|
-1.375246
|
0.368
|
|
PTRAVAIL
|
-34.93175
|
0.000
|
|
Constante
|
-186.9519
|
0.000
|
|
|
|
|
Significativité
|
Nombre d'observations = 9037
|
|
5%
|
LR chi2(10) = 2747.42
|
|
Prob > chi2 = 0.0000
|
|
Wald chi2(10) = 3121.85
|
Pseudo R2 = 0.2183
|
|
Log likelihood =-4918.5998
|
|
AIC = 9861.2
|
|
BIC = 9946.509
|
Le tableau 8 montre que seulement deux variables sur dix
ne sont pas significatives. La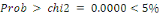 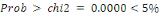 , ce
qui signifie que le modèle est globalement bon. Le Pseudo R²
confirme cette analyse, car ayant une valeur faible (0.2183qui correspond aussi
à une valeur élevée du R² de régression
linéaire), montre la faible part de déviance des variables. Ceci
signifie aussi que les variables explicatives apportent des informations
importantes pour l'explication del'engagement bénévole. La valeur
de LR chi2 (10) = 2747,42est très supérieure à sa valeur
tabulée , ce
qui signifie que le modèle est globalement bon. Le Pseudo R²
confirme cette analyse, car ayant une valeur faible (0.2183qui correspond aussi
à une valeur élevée du R² de régression
linéaire), montre la faible part de déviance des variables. Ceci
signifie aussi que les variables explicatives apportent des informations
importantes pour l'explication del'engagement bénévole. La valeur
de LR chi2 (10) = 2747,42est très supérieure à sa valeur
tabulée  .
L'AIC et le BIC qui permettent de pénaliser les modèles afinde
satisfaire le critère de parcimonie ont des valeurs moyennes. Tous ces
indicateurs s'unissent pour dire que le modèle est bien
spécifié et autorisent ainsi l'interprétation des
variables. .
L'AIC et le BIC qui permettent de pénaliser les modèles afinde
satisfaire le critère de parcimonie ont des valeurs moyennes. Tous ces
indicateurs s'unissent pour dire que le modèle est bien
spécifié et autorisent ainsi l'interprétation des
variables.
Tableau 9 : les effets marginaux de la
régression
|
|
Variables
|
Coefficients
|
P-Value
|
|
SEXE
|
-28.51422
|
0.000
|
|
AGE
|
-17.0459
|
0.000
|
|
SMATRI
|
2.067341
|
0.285
|
|
RELIGION
|
11.03442
|
0.000
|
|
DIPLOM
|
-21.96551
|
0.000
|
|
UPROD
|
114.2761
|
0.000
|
|
TEMPLOI
|
-28.31921
|
0.000
|
|
LMENAGE
|
16.78534
|
0.000
|
|
LRESID
|
-1.375246
|
0.368
|
|
PTRAVAIL
|
-34.93175
|
0.000
|
Les effets marginaux traduisent l'effet d'une variation des
variables explicatives sur la probabilité de s'engager dans le
bénévolat.
Les effets marginaux dans un modèle de
régression censuré correspondent à la déformation
des prévisions sur une variable continue engendrée par une
variation d'une unité d'une des variables explicatives. Il y a alors
plusieurs prévisions possibles dans le cas du modèle Tobit
suivant que l'on s'intéresseà la variable censurée   ou
à la variable latente ou
à la variable latente  . En
effet, trois cas peuvent apparaître. Nous considérons seulement la
prévision sur la variable dépendante censurée
représentée par l'espérance conditionnelle ?i = 1, ..., N
: . En
effet, trois cas peuvent apparaître. Nous considérons seulement la
prévision sur la variable dépendante censurée
représentée par l'espérance conditionnelle ?i = 1, ..., N
:
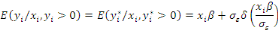
Ainsi, une variation de 1% de la kème
variable explicative   pour
le ième individu, modifie la prévision de la variable
dépendante pour
le ième individu, modifie la prévision de la variable
dépendante   pour
ce même individu de pour
ce même individu de   pour
cent. On peut alors calculer une élasticité moyenne pour
cent. On peut alors calculer une élasticité moyenne   sur
l'ensemble des N individus telle que : sur
l'ensemble des N individus telle que :
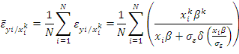
Les estimations du modèle et les effets marginaux du
tableau 9 permettent de dire :
Les P-value des caractéristiques
sociodémographiques sont nulles sauf celle de la situation matrimoniale
(0.285>0,05). En revanche, 3/5 des coefficients sont négatifs, la
variable religion ayant le plus grand coefficient positif. On conclut donc que
les variables sociodémographiques ont un lien très fort mais
négatifs (sauf la religion qui a une relation positive et la situation
matrimoniale qui n'en a pas du tout) sur l'engagement dans le travail
bénévole.
Les variables socioprofessionnelles ont une grande influence
sur la décision de faire du travail bénévole. Pendant que
l'unité de production (35,94% d'emploi privé et 45,31% d'emploi
associative) qui emploie le bénévole favorise le choix de faire
du bénévolat, le type d'emploi (81,25% d'emploi permanent) le
décourage.
Le lien avec le chef de ménage (59,37% sont
eux-mêmes chef de ménage) est en relation positive et
significative, la variable « le parent travail-t-il ?» (Oui
à 90%) a un lien significatif et négatif et la variable
« lieu de résidence à 15 ans » (74,60% ont
vécu chez les parents) n'a aucun lien sur le choix de faire du travail
bénévole. On conclut que la relation avec les parents a une
influence considérable sur l'engagement dans le bénévolat.
2.2 Lien entre la
littérature et nos résultats obtenus
L'objectif principal qui a conduit à ce travail est la
recherche sur ce qui motive certaines personnes à s'adonner au
bénévolat. Dans un contexte où le marché du travail
est fortement resserré et le taux de chômage élevé,
qu'est ce qui guide le choix de certaines personnes appelées
bénévoles ?
Notre quête nous a mené à analyser d'abord
les caractéristiques des personnes en emploi, bénévoles
comme non bénévoles. Nous avons ensuite traité
spécialement le cas des bénévoles. Il s'agissait de
considérer la relation entre leurs caractéristiques
sociodémographiques et leur engagement dans le bénévolat.
Analyser l'influence de leur milieu socioprofessionnelle sur leur engagement
bénévole. En fin, les relations entre eux et leurs parents depuis
l'âge de 15 ans nous ontintéressés pour cerner leurs
influences possibles.
Dans l'analyse de notre premier objectif de recherche,
à savoir déterminer l'influence des caractéristiques
sociodémographiques sur l'engagement dans les activités
bénévoles, l'hypothèse sous-jacente a été
validée comme quoi, les caractéristiques
sociodémographiques ont une forte relation sur l'engagement
bénévole. L'âge, le sexe et le diplôme ont une
influence négative, la situation matrimoniale n'a aucun lien, seule la
religion a une influence fortement positive sur l'engagement
bénévole. Les individus qui s'engagent à fournir du
travail pour autrui sans rémunération, sont guidés par la
motivation au bénévolat qui est leur caractéristique
principale. Cette motivation est du type de production de bien collectif au
service de la communauté (Prouteau et Wolf, 204a).
Ce résultat quelque peu contraire à ce que dit
la littérature est dû au petit nombre de bénévole
dans la base. Le niveau de diplôme favorise l'engagement dans le
bénévolat. La littérature a noté que plus le
diplôme d'un individu est élevé, plus la
probabilitéqu'il fasse du bénévolat est forte (Caro et
Bass, 1997). En effet, certaines des motivations des bénévoles
sont la recherche de qualification, d'une formation, enrichir son curriculum
vitae... qui sont du domaine des besoins des diplômés.
La relation entre le milieu socioprofessionnel et l'engagement
dans le bénévolat est bien existante. Cette relation est positive
avec l'employeur surtout privés mais négative avec le type
d'emploi. La littérature nous a permis de voir que l'engagement
bénévole est tiré par la motivation. Plus l'individu sait
le type d'emploi qui lui est proposer, moins il s'engagera dans le
bénévolat.
Voyons à présent ce qui est des relations avec
les parents et ses influences possibles sur l'engagement
bénévole. Les résultats d'estimations ont montré
que la plupart des bénévoles de l'échantillon, 59,37% sont
chef de ménage, 76,93% ont vécu avec les parents à 15 ans
(Prouteau et Wolf, 2004a, 2004b) et 90% de ces parents travaillent. Ce qui
confirme que la relation avec les parents a une influence considérable
sur l'engagement dans le bénévolat. Cependant, il y a une
restriction sur le fait d'avoir vécu avec les parents à 15 ans
qui n'a rien à avoir avec l'engagement dans le bénévolat,
selon nos résultats. Cetterestriction peut être expliquée
par la tranche d'âge (35 à 44 ans) ou les individus s'adonne
(31,25%) le plus au bénévolat. En effet, jusqu'à cette
tranche d'âge, les futurs bénévoles ne vivent plus chez les
parents, ils sont donc soumis à d'autres influences
socioéconomiques qui les amènerait plutôt à opter
pour un travail bien rémunéré.
Cependant, l'influence de la situation socioprofessionnelle
des parents sur l'engagement bénévole est forte mais
négative. Plus les parents sont socialement stables, moins les enfants
s'adonnent à ce genre de travail. Avec la motivation d'utilité,
les bénévoles se font plaisir et se satisfont en aidant les
autres. C'est aussi une manière pour eux de rendre ce qu'ils ont
reçu des parents en termes d'amour qu'ils transmettent aux
nécessiteux. Ils ressentent en fait une obligation sociale envers leur
entourage, envers la société (Fitch 1978). Leur motivation
« privée » s'ajouterait à l'altruisme dit
« pur » ou le remplacerait (Govekar et Goverkar, 2002).
C'est une motivation de valeur contenue dans la VFI (Houle, Sagarin et Kaplan,
2005).
2.3 Limites
Dans cette étude sur les motivations au
bénévolat, plusieurs situations qui nous sont hors de
contrôle ont fait que ce travail présente plusieurs limites
d'ordre méthodologique.
Nous voulons citer en premier lieu les problèmes
d'indisponibilité de données que nous avons eues.
Préalablement, nous avons voulu travailler sur les déterminants
de la motivation des bénévoles. Il nous fallait pour cela mener
une enquête sur terrain (ce que nous avons pu faire finalement avec
beaucoup de difficulté), et le temps pour y arriver était
limité.Nous avons dû modifier le thème pour nous
serviraussi de la base de données de l'enquête emploi. Cela nous a
pris du temps et de l'énergie, ce qui a joué sur la bonne tenue
de ce travail.
En second lieu, notons les grandes difficultés
méthodologiques que nous avons rencontrées. En effet, la base de
données que nous avons utilisée a été conçue
spécialement pour rendre compte de la situation de l'emploi et du
travail des enfants. Il était donc bien difficile de l'adapter au
bénévolat, vu que seulement deux questions faisaient mention du
travail bénévole. Nous avons donc eu pas mal de souci pour
trouver un modèle qui permette d'analyser l'engagement
bénévole à partir de cette base de données. Ce qui
fait que nos résultats présentent des limites quant à leur
utilisation. La littérature et la diversité des motivations au
bénévolat ont montré qu'il faut une enquête
spécialement dédiée à ce genre d'étude pour
bien rendre compte du travail bénévole et de ses
différents aspects.
Comme troisième limite, nous avons été
face à une faiblesse de la documentation sur le bénévolat.
Comme souligné dans notre introduction, la littérature sur le
bénévolat en économie est peu abondante. Là
où le véritable manque, c'est quand on met en lien le travail
bénévole et le salariat. Nous avons donc été
obligés de nous référer quelque peu aux écrits en
psychologie et en sociologie.
2.4 Ouverture et implications
A l'endroit du pouvoir public :
Le bénévolat à travers les entreprises
associatives est un important moyen dans la lutte contre le chômage, pour
le développement rural et pour le renforcement de la cohésion
sociale, nécessaires pour atteindre les grands objectifs de
développement économique. Il serait donc profitable de le
développer par des actions fortes :
- Mettre en place un cadre favorable à cette
activité par une législation claire ;
- Créer les conditions de développement de
l'économie sociale et solidaire ;
- Encourager le développement des associations par des
structures de suivi ;
- Accroître le financement de ce domaine ;
- Encourager la professionnalisation des structures de
bénévole (associations, mutuelles, coopératives et
fondations) ;
- Promouvoir le bénévolat en entreprise par une
responsabilité sociale confiée à celles-ci suivie
d'allègements fiscaux pour les en encourager ;
- Les encourager à mettre en place des programmes
officiels de bénévolat en entreprise et même au sein de la
communauté.
Au monde de la recherche :
Le champ d'étude du bénévolat n'a pas
encore été beaucoup investi dans les pays en
développement. Il serait intéressant que des études visant
à déterminer le nombre de bénévole, leurs
caractéristiques et leurs motivations réelles soient
menées. Ce type de recherche qui conduirait à des enquêtes
spécifiques sur la question. Cela permettrait de rendre compte
réellement de la situation du bénévolat si possible chaque
année comme le recommande les Nations Unies (Assemblée
générale des Nations Unies, 2001)15(*).
De plus en plus, le monde de l'économie sociale et
solidaire (ESS) se développe tant bien que mal. Dans les villages et
même en ville les mutuelles et associations se mettent en place. La
connaissance des motivations des individus pourrait aider à
l'amélioration des stratégies de recrutement et de
fidélisation des bénévoles nécessaire au bon
fonctionnement de ces structures. Il serait donc bien de mener une étude
sur l'engagement de bénévoles dans ces milieux et d'autres
encore.
Également, comme autre recherche, il serait
intéressant de vérifier si le bénévolatpeut aider
à la satisfaction des trois besoins psychologiques,innés et
fondamentaux, soit l'autonomie, la compétence etl'affiliation sociale,
dans la vie engénéral. Si oui, il serait peut-être
profitable pour les entreprises d'offrir à leurs employés defaire
du bénévolat durant leurs heures de travail (le
bénévolat en entreprise) à raison d'une à deux
heures par semaine, par exemple.
CONCLUSION
En guise de conclusion, de plus en plus de personnes
s'engagent à travailler gratuitement dans les organismes à but
non lucratif (associations). La connaissance de ce qui les motive est un enjeu
majeur, si on veut accroitre leur nombre au vue de l'importance de leur action.
Effectivement leur action a une portée hautement sociale,
économique et humanitaire. Ce type de travail concerne actuellement
toute la population en âge de travailler. A l'heure actuelle où
l'on est dans une dynamique de lutte contre le chômage, le
bénévolat se présente comme une piste de solution. Nous
nous sommes donnés comme objectif d'analyser les facteurs explicatifs de
l'engagement bénévole, qui, n'est pas éloigné du
travail salarié quand on sait que la plupart des bénévoles
sont en emploi salarié. Il s'est agi en fait de savoir ce qui motive
certaines personnes à s'engager dans le travail
bénévole.
L'enquête emploi 2013 dont nous nous sommes servis, nous
a ouvert des perspectives. Nous avons ramifié notre objectif principal
en trois objectifs spécifiques. Il s'agissait de montrer l'influence des
caractéristiques sociodémographiques dans le choix de faire du
travail bénévole, d'analyser l'impact du milieu
socioprofessionnel sur l'engagement bénévole et de
déterminer l'influence des parents sur le choix de s'engager dans le
travail bénévole.
Notre propre base de données conçue à
partir d'enquête a permis de savoir un peu plus sur les
bénévoles ivoiriens qui sont plus des jeunes, hommes,
possèdent de grands diplômes, sont religieux et s'engagent parce
qu'ils ont été témoins de situations de détresse ou
qu'ils veulent contribuer à améliorer la situation sociale et
humanitaire de plusieurs, considérés comme vulnérables du
fait de la pauvreté. Ils s'engagent aussi pour enrichir leur curriculum
vitae, rechercher une qualification et d'expérience professionnelle afin
d'être compétitifs sur le marché du travail.
Nous avons extrait les variables qui nous intéressaient
de la base de données de l'enquête emploi et constitué une
base exploitable pour l'analyse de nos hypothèses. Nos analyses nous ont
permis de nous rassurer que les bénévoles et les non
bénévoles ont les mêmes caractéristiques
sociodémographiques. La différence fondamentale entre eux est la
motivation qui pousse certaines personnes à s'engager
bénévolement. Cette motivation trouve plusieurs sources qui
peuvent être altruiste et ou égoïste (Bussell et Forbes,
2002 ; Haski-Leventhal, 2009), de production de biens et service,
d'utilité (Prouteau et Wolf, 2004).Une fois motivée, ces
personnes servent pour le plus grand nombre à travers les ONG et
associations. N'empêche qu'on retrouve des bénévoles dans
le privé et pour une moindre partie dans le domaine publique. Ce sont
des personnes qui, à 15 ans vivaient avec les parents. Elles ont donc
bénéficié de beaucoup d'amour qu'elles se doivent de
partager avec autrui et avec toute la communauté. Également, nous
avons retenu que les caractéristiques sociodémographiques sont
influentes dans le choix de faire du bénévolat, sauf la situation
matrimoniale. Le diplôme révélé par la
littérature comme très important pour motiver au
bénévolat a été trouvé comme ayant une
action défavorisant dans notre cas.
La situation socioprofessionnelle a une relation significative
(positive pour l'unité de production mais négative pour le type
d'emploi) sur l'engagement bénévole. Les parents ont
également une présence qui influence le choix de faire du travail
bénévole.
Nous retenons deux grandes conclusions de cette étude.
La motivation qui prévaut à l'engagement bénévole
naît de la relation avec les parents depuis le bas âge, elle est de
l'amour, du don de soi appris auprès de ceux-ci. La motivation
bénévole est guidée par les caractéristiques
sociodémographiques, principalement la religion. Elle est
renforcée par la structure employeuse de l'individu, qu'elle soit
privée ou associative.
Les enfants qui sont entourés de beaucoup d'amour sont
plus susceptibles d'en donner à un moment ou à un autre à
travers le bénévolat. Pour ce qui est des parents ou employeurs
(bénévoles), suite à leur engagement ou sensibilité
à ce travail, leurs enfants ou employés finissent par être
motivé de façon intrinsèque afin de s'y engager eux aussi.
Ce don de soi, cette disposition au partage grandissant, les
bénévoles vont enclencher la professionnalisation de leurs
structures (associations, coopératives, mutuelles et fondations) et
constituer une branche importante de l'économie appelée
économie sociale et solidaire (ESS).
BIBLIOGRAPHIE
Archambault. E (2005),« Le bénévolat
en France et en Europe ». Pensée plurielle,
9(1), 11.doi :10.3917/pp.009.0011
Archambault. E& Boumendil. J (1997),« Les dons
et le bénévolat en France ». Laboratoire
d'économie sociale, Fondation de France.
http://www.fondationdefrance.org/Outils/Mediatheque/Etudes-de-l-Observatoire/Dons-etbenevolat/%28language%29/fre-FR
Archambault. E & Prouteau. L (2009),« Mesurer le
bénévolat pour en améliorer laconnaissance et satisfaire
à une recommandation internationale ». RECMA -
Revueinternationale de l'économie sociale, (314), 84-104.
Barbusse. B. V. de Briant, Glaymann. D et Grima. F (2011),
« Bénévolat et insertion professionnelledes jeunes
diplômés : un impact sous condition »,
LargotecMiméo.
Bussell. H & Forbes. D (2002),«Understanding the
volunteer market the what, where, who and why of volunteering».
International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing,
7(3), 244-257. doi:10.1002/nvsm.183
Caro, F. G., & Bass, S. A. (1997), Receptivity to
Volunteering in the Immediate Postretirement Period. Journal of Applied
Gerontology, 16(4), 427 -441. Doi :10.1177/073346489701600403
Chambré, S. M. (1984), Is Volunteering A Substitute for
Role Loss in Old Age ? An Empirical Test ofActivity Theory. The
Gerontologist, 24(3), 292 -298.
Choi, L. H. (2003), Factors Affecting Volunteerism among Older
Adults. Journal of Applied Gerontology, 22(2), 179 -196. Doi
:10.1177/0733464803022002001Dan Ferrand-Bechmann (2000),« Le
métier de bénévole ». Editions Anthropos,
Paris.
Duguet. E. Y, L'hort. Y et P. Petit (2009), « L'apport du
testing à la mesure des discriminations », Connaissances de
l'emploi, (68).
Dumulon-Morin. C (2014),« Les jeunes adultes
étudiants et la motivation de s'impliquer bénévolement,
mémoire de recherche ».Université du Québec
à Montréal.
Edgeworth. F. Y, (1881),Mathematical Psychics: An
Essay on the Application of Mathematics to the MoralSciences. Barrister-at-Law.
London: Kegan Paul &Co. Pp. viii, 150.
Erlinghagen, M. (2010), «Volunteering after retirement.
Evidence from German panel data».European Societies,
12(5), 603-625. Doi : 10.1080/14616691003716902
Forest, J., Crevier-Brault, L. et Gagné, M., 2009,
« Mieuxcomprendre la motivation au travail », Effectif,
12(3) : 23-27
Gourmelen, A. (2013),« La pression temporelle ultime
: conceptualisation et nuance sur les motivations au bénévolat
des retraités ». Gestion et management. Université de
Bretagne occidentale- Brest, Français. <NNT : 2013BRES0035>.
<Tel-00958797>
Govekar, P.L, &Govekar, M. A. (2002),«Using Economic
Theory and Research to Better Understand Volunteer Behavior».
Nonprofit Management and Leadership, 13(1), 33-48
Halba, B. & Le Net, M.
(1997),« Bénévolat et volontariat dans la vie
économique, sociale et politique », Les études de
la Documentation française. Société, ISBN
2-11-003766-0
Halba, B. (2003),« Bénévolat et
volontariat en France et dans le monde ».La Documentation
Française.
HALBA, Bénédicte (2006),« Gestion du
bénévolat et du volontariat : développer son projet et les
ressources humaines bénévoles », De Boeck, - 307 p.ISBN
2-8041-5193-X
HALBA (B), op. cit., p. 79
Handy, F., & Hustinx, L. (2009), The why and how of
volunteering. Nonprofit Management and Leadership, 19(4),
549-558.
Hurlin, Christophe (2003), « Econométrie des
Variables Qualitatives, Modèles à variable
dépendante limitée », Université
d'Orléans.
www.univ-orleans.fr/dg/masters/ESA/
Imagine Canada(2009), « Canadiens dévoués,
canadiens engagés : points saillants del'Enquête canadienne
de 2007 sur le don, le bénévolat et la participation. », En
ligne, <
http://www.donetbenevolat.ca/files/giving/en/csgvp_
highlights_2007 fr.pdf>, page consultée le 2 octobre 2016.
Imagine Canada(2010), « Le don et le
bénévolat au Québec », En ligne,<
http://www.donetbenevolat.ca/files/giving/fr/reports/quebecreport_fr20072112201O.df>,
page consultée le 2 octobre 2016.
Imagine Canada (2012), «
Organismes de bienfaisance et organismes sans but lucratif », En ligne,
http://www.imaginecanada.ca/fr/node/66,
page consultée le 12 octobre 2016.
INS et AGEPE (2014), Rapport descriptif sur la situation de
l'emploi en Côte d'Ivoire.
INS, (2015). « Enquête sur le niveau de vie
des ménages en Côte d'Ivoire »
Jacquot, A (2000), « Les modèles
économétriques-LOGIT-PROBIT-TOBIT », CNAF-Bureau des
Prévisions, pp26-27
Jean-Olivier Hairault, et al (2016). «Optimal
unemployment insurance for older workers».<Hal-01292095>
Menchik, P. L., &Weisbrod, B. A. (1987),«Volunteer
labor supply». Journal of Public Economics, 32(2),
159-183. Doi: 10.1016/0047-2727(87)90010-7
Mutchler, J. E., Burr, J. A., & Caro, F. G.
(2003),«From Paid Worker to Volunteer: Leaving the Paid Workforce and
Volunteering in Later Life». Social Forces, 81(4),
1267-1293.doi:10.1353/sof.2003.0067
Okun, M. A., & Schultz, A. (2003),«Age and motives
for volunteering: testing hypothesesderived from socioemotional selectivity
theory». Psychology and aging, 18(2), 231-239.
Parquet, L., E. Duguet, Y, L'horty, P, Petit et F, Sari
(2010), « Etre mobile pour trouver unemploi ? Les enseignements d'une
expérimentation en région parisienne », Document de Travail
del'EPEE, (10.08).
Patrick Viveret (2001),« Reconsidérer la
richesse ». Rapport d'étape de la mission «Nouveaux
Facteurs deRichesses« au Secrétaire d'Etat à l'Economie
Solidaire.
Prouteau, L., & Wolff, F. (2004a),« Donner son
temps : les bénévoles dans la vie associative ».
Economie & Statistique, (372), 3-39.
Prouteau, L., & Wolff, F. (2004b),« Les
motivations des bénévoles. Quel pouvoir explicatif des
modèles économiques ? » In D. Girard.
« Solidarités collectives. Famille et
solidarités ». Actesde la 24 e journée de
l'Association d'économie sociale. (Vol. 1, p. 197-211).
L'Harmattan.
Prouteau, L et Wolff, F (2004), « Les motivations des
bénévoles, Quel pouvoir explicatif desmodèles
économiques », in Girard D, Solidarités collectives,
Famille et solidarités, Tome 1, Actes des24ème
journées de l'Association d'Economie Sociale, L'Harmattan, pp,
197-211.
Prouteau, L, et Wolff, F (2006), « Does volunteer work
pay off in the labor market? », Journal ofSocio-Economics, 35,
pp, 992-1013
Prouteau, L., & Wolff, F. (2007),« La
participation associative et le bénévolat des
seniors ». Retraite et Société, La
Documentation Française, 1(50), 157-189.
Prouteau, L, & Wolff, F. (2008), « On the relational
motive for volunteer work». Journal of EconomicPsychology,
29(3), 314-355. Doi : 10.1016/j.joep.2007.08.001
Prouteau, L.,& Wolff, F (2010),« La
participation associative en France : une analyse longitudinale ».
Economie & Prévision, 2010/1(192), 45-63.
Prouteau, L. (2015),« Les emplois occasionnels dans
les associations de l'économie sociale » LEMNA-
Université de Nantes,
Reimat, A. (2002),« Production associative et
bénévolat informel : quelle significationéconomique pour
les activités de production des retraités
? »Innovations, 15(1),
73.doi:10.3917/inno.015.0073
Simonet, Maud (2010),« Le Travail
Bénévole ? », La dispute.
Simonet, Maud (2010),« Travail (Le)
bénévole : engagement citoyen ou travail gratuit ? » La
dispute,. - 219 p. ISBN 9-782843-032042
Taniguchi, H., & Thomas, L. D. (2011), The Influences of
Religious Attitudes on Volunteering. Voluntas : International Journal of
Voluntary and Nonprofit Organizations, 22(2), 335-355.
Vallerand, R, & Thill, E. (1993),« Introduction
au concept de motivation ». InIntroduction à la
psychologie de la motivation, Etudes Vivantes, p. 3-38.
Vallerand, R. J., Carbonneau, N., &Lafrenière, M.
(2009),« La théorie del'autodétermination et le
modèle hiérarchique de la motivation intrinsèque et
extrinsèque : perspectives intégratives ». In F.
Fenouillet & P. Carré, Traité de psychologie de la
motivation(p. 47-66). Dunod.
Van Tienen, M., Scheepers, P., Reitsma, J., & Schilderman,
H. (2010), The Role of Religiosity for Formaland Informal Volunteering in the
Netherlands. Voluntas : International Journal of Voluntary and
NonprofitOrganizations, 1-25.
Wilson, J. (2000), Volunteering. Annual Review of
Sociology, 26, 215-240
Yeung, A. B. (2004), An Intricate Triangle-- Religiosity,
Volunteering, and Social Capital : The EuropeanPerspective, the Case of
Finland. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 33(3), 401
-422. Doi :10.1177/0899764004265426
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENTS
i
REMERCIEMENTS
ii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
LISTE DES FIGURES
iv
LISTE DES TABLEAUX
iv
SOMMAIRE
v
RESUME
vi
INTRODUCTION
1
1. Contexte et Problématique
1
2. Différence notable entre
bénévolat et volontariat
2
3. Les motivations à l'engagement
bénévole
3
4. Objectifs
4
5. Plan de l'étude
4
CHAPITRE1 : REVUE ANALYTIQUE DU BENEVOLAT
6
SECTION1 : REVUE THEORIQUE DU BENEVOLAT
6
1.1 Les types de bénévolat
6
1.2 Du bénévolat au travail
bénévole
7
1. 3 Le bénévolat dans la
pensée économique
8
1.4 L'analyse du bénévolat par les
autres sciences sociales
9
SECTION 2 : REVUE EMPIRIQUE DU BENEVOLAT
12
2.1 Analyse statistique du travail
bénévole dans le monde
12
2.1.1 Le bénévolat sur le continent
américain
12
2.1.2 Le bénévolat en Europe
13
2.1.3 Le bénévolat ivoirien
15
2.2 D'autres résultats empiriques
15
CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE D'ANALYSE ET
RESULTATS STATISTIQUES
18
SECTION 1 : METHODOLOGIE D'ANALYSE
18
1.1 Collecte des données par
enquête
18
1.2 Les données de l'étude
19
1.3 Le traitement des données
20
SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE
STATISTIQUE
21
2.1 Motivations des bénévoles
21
2.2 Caractéristiques de l'emploi
23
CHAPITRE 3 : LES FACTEURS DETERMINANTS DE
L'ENGAGEMENT BENEVOLE
26
SECTION 1 : CADRE D'ANALYSE ECONOMETRIQUE
26
1.1 Définition et mesure des
variables
26
1.2 Instruments de mesure
29
1.3 Estimation des paramètres du Tobit
31
SECTION 2 : RESULTATS ECONOMETRIQUES ET
DISCUSSION
34
2.1 Les résultats d'estimations
34
2.2 Lien entre la littérature et nos
résultats obtenus
36
2.3 Limites
38
2.4 Ouverture et implications
38
CONCLUSION
40
BIBLIOGRAPHIE
42
TABLE DES MATIERES
46
ANNEXES
49
ANNEXE 1: Test de normalité
49
ANNEXE 2 : Régression avec Tobit
à double censure
50
ANNEXE 2: les effets marginaux
50
ANNEXES
ANNEXE
1 : Test de normalité
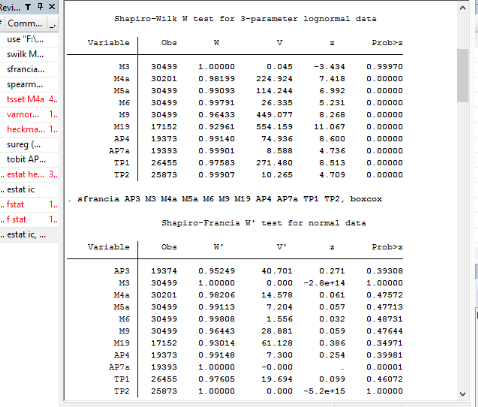
ANNEXE 2 : Régression avec Tobit à double
censure

ANNEXE
2: les effets marginaux
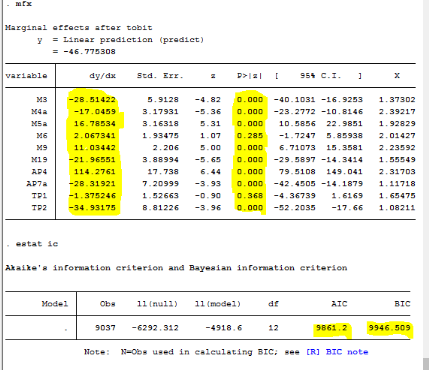

* 1Voir
http://www.jeuneafrique.com/depeches/23717/politique/le-chomage-des-jeunes-une-menace-pour-la-stabilite-de-lafrique/
site consulté le 18 janvier 2017
* 2 UNICEF (2012), Cadre de
développement de la stratégie nationale de protection sociale en
Côte d'ivoire. Etat des Lieux, Défis et Perspectives de
Renforcement de la Protection Sociale (tome1, PP21-22)
* 3 Lionel Prouteau
appartient LEN-CEBS de la faculté des Sciences Economiques de
l'Université de Nantes. François Charles Wolf appartient au
LEN-CEBS de la faculté des Sciences Economiques de l'Université
de Nantes, à la direction des Recherches de la CNAV et à
l'INCED.
* 4 Il y a plusieurs formes
de volontariat : le VNU= Volontariat des Nations Unis qui est un corps de
volontaires de plusieurs nationalités qui vont pour des missions
diverses dans des zones qui traversent des crises (alimentaires, politiques,
économiques ou militaire), des catastrophes naturelles etc. Le VSI=
Volontariat de Solidarité Internationale, France volontaire etc.
* 5 Ces indemnités
sont parfois très conséquentes et peuvent dans la plupart des
cas, être supérieures au salaire payé dans le cas d'un
contrat de travail dans pays d'accueil. Car elles couvrent tous les besoins de
base (alimentation, santé, logement, déplacement etc.) et une
prime en fin de mission.
* 6 Bénédicte
HALBA est économiste spécialiste des questions de
bénévolat et la participation associative. Elle est
présidente de l'IRIV et cofondatrice de la revue électronique
«les rives de l'iriv''.
* 7Lionel Prouteau appartient
au LEN-CEBS de la Faculté des Sciences Economiques de
l'Université de Nantes
* 8 Dans la revue
électronique du département d'Etat des Etats Unis,
eJournalUSA, volume 16, numéro 5, 2012
* 9 Nicholas Mamba (2013),
eJournal, USA, revue électronique du département d'Etat
des Etats Unis, volume 18, numéro 3
* 10 Imagine Canada est un
organisme national qui intervient en faveur des organismes de bienfaisance, des
organismes sans but lucratif et des entreprises dotées d'une conscience
sociale du Canada et assure la promotion de leurs oeuvres au sein des
collectivités.
* 11« Le concept
d'économie sociale et solidaire (ESS) désigne un ensemble
d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles,
associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les
activités sont fondés sur un principe de solidarité et
d'utilité sociale »http://www.gouvernement.fr/
* 12 Panorama de l'ESS en
France 2015, CNCRES (chiffres Insee Clap 2013) / Recherches &
Solidarités
* 13 INS et AGEPE, Rapport
descriptif sur la situation de l'emploi en Côte d'Ivoire, août 2014
* 14Tobin J. (1958),
»Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables»,
Econometrica, 26, 24-36.
* 15 Manuel sur la mesure du
travail bénévole / Bureau international du travail,
Genève : BIT, 2011
| 


