|
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
BP : 1365 - YAOUNDE CAMEROUN
fseg@.univ-yde2.org
Tél. : (237) 22 06 26 98/ Fax (237) 22 23 84
28
TROPICAL FOREST AND RURAL DEVELOPMENT
B.P: 5619 YAOUNDÉ
Email:
tfrd2009@yahoo.fr
Tel: +237 91 67 57 21
IMPACT DE DE LA CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE SUR
LES PETITS PRODUCTEURS DE CACAO A LA PÉRIPHÉRIE DE LA RESERVE DE
BIOSPHERE DU DJA AU CAMEROUN
MÉMOIRE
POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MASTER II
RECHERCHE EN
ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE
L'AGRO-ALIMENTAIRE
OPTION : ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Présenté et soutenu
par :
FOPA ROMEO
Sous la direction du :
Pr. Joël SOTAMENOU
Enseignant titulaire à
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Université de Yaoundé II
Et l'encadrement professionnel de :
M. EPANDA MANFRED Aimé
President de Tropical Forest and Rural Development
Année Académique 2014 - 2015
AVERTISSEMENT
«L'Université de Yaoundé II n'entend
donner aucune approbation ou improbation aux
opinions contenues dans ce
mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme
étant propres
à leur auteur »
SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
PREMIÈRE PARTIE :
8
ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA
CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE SUR LES PRODUCTEURS DE CACAO AUTOUR DE LA
RESERVE DU DJA
8
CHAPITRE I :
9
ANALYSE THÉORIQUE DE L'IMPACT DE LA
CERTIFICATION
9
I.1. IMPACT DE LA CERTIFICATION :
ÉLÉMENTS THÉORIQUES
9
I.2. IMPACTS DE LA CERTIFICATION : REVUE DE LA
LITTÉRATURE
22
CHAPITRE II :
28
ANALYSE EMPIRIQUE DE L'IMPACT DE LA CERTIFICATION
AUTOUR DE LA RESERVE DU DJA
28
II.1. MÉTHODOLOGIE DE COLLECTE ET D'ANALYSE
DE DONNÉES
28
II.2. IMPACT ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ET
ENVIRONNEMENTAL DE LA CERTIFICATION RAINFOREST
36
DEUXIÈME PARTIE :
45
ANALYSE DES DÉTERMINANTS DE L'ADOPTION DE LA
CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE
45
CHAPITRE III :
46
ANALYSE THÉORIQUE DES DÉTERMINANTS DE
L'ADOPTION DES INNOVATIONS AGRICOLES
46
III.1. ANALYSE THEORIQUES DE L'ADOPTION DES
INNOVATIONS AGRICOLES
46
III.2. L'ADOPTION DES INNOVATIONS AGRICOLES :
REVUE DE LA LITTÉRATURE
53
CHAPITRE IV :
58
LES DÉTERMINANTS DE L'ADOPTION DE LA
CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE
58
IV.1. CADRE MÉTHODOLOGIQUE
58
IV.2. RÉSULTATS ET ANALYSES
62
CONCLUSION GÉNÉRALE ET
RECOMMANDATION
66
DÉDICACES
À mes parents FOTSING JEAN PAUL
Désiré et YOUNDA Gisel vous qui, m'avez
enseigné le sens de l'effort, et m'avez soutenu dans les moments
difficiles.
REMERCIEMENTS
Au moment où je
présente ce travail, je voudrais exprimer mes sentiments de
reconnaissance aux personnes qui de près ou de loin ont contribué
à la réalisation de ce travail. De ce fait je tiens à
remercier :
L'Université de Yaoundé II (SOA) et plus
particulièrement la coordination du Master II Économie du
Développement Rural et de l'Agro-alimentaire, pour l'opportunité
offerte à travers cette formation, pour la qualité des
enseignements et des enseignants mis à notre disposition ;
Le Dr. SOTAMENOU Joël Directeur de ce mémoire pour
la marque de bienveillance et la rigueur scientifique ;
M. EPANDA MANFRED Aimé, encadreur professionnel de ce
mémoire, pour son soutien à la recherche et l'opportunité
qu'il m'a offerte de découvrir les merveilles du milieu rural ;
M. NGOUCHEME RENÉ, chercheur à L'IRAD (Institut
de Recherche Agricole pour le Développement) pour les conseils et les
orientations apportés à l'élaboration de ce travail ;
M. OKALA SERGE étudiant doctorant à
l'Université de Yaoundé II pour une bouffée
d'oxygène apporté à ce mémoire ;
Mme EPANDA née Lady NGWA pour ses encouragements et ses
conseils
Mes frères et soeurs : MUKAM FOTSING JUNIOR, KENGNE
FOTSING LAURAINE ; FONGANG FOTSING ALEX JORDAN ; NZONTSO FOSTSING
DELILLAH ; KEUTCHE FOTSING TRESOR qui m'aiment bien et m'ont
encouragés tout au long de cette aventure ;
Mes amis : MBESSOH ULRICH IGOR ; FONKOU YMELDA
MANUUELLA ; AZEMKOUO CEDRIC ; AZEMKOUO MARTIN ; MAGNE
ELIANE ; NWAFI ADI pour leur soutien multi forme et leurs encouragements
;
À toute l'équipe de la Plateforme de
transformation des PFNL (Produits Forestiers Non Ligneux) de TROPICAL FOREST
AND RURAL DEVELOPMENT pour leur encouragement au quotidien.
LISTE
DES TABLEAUX
Tableau 1 : Présentation de la taille
de l'échantillon par village
32
Tableau 2: Comparaison des revenus moyens des
producteurs étant dans le processus de certification et ceux
n'étant pas
36
Tableau 3: Description de la source de revenu des
producteurs dans le processus de certification
37
Tableau 4: Description de la source de revenu des
producteurs n'étant pas dans le processus de certification
37
Tableau 5 : Prix du cacao selon que le
producteur de cacao soit certifié ou non
38
Tableau 6 : Niveau d'éducation des
producteurs des cacaos certifiés et non certifiés
42
Tableau 7: Définition des variables du
modèle
62
Tableau 8: Résultats de l'estimation du
modèle
63
LISTE DES FIGURES
Figure 1: Piliers de l'Agriculture durable
12
Figure 2: Localisation de la zone
d'étude
28
Figure 3:Possession des parcelles certifiées
et des parcelles non certifiées
39
Figure 4: Rendement moyen des producteurs qui sont
dans le processus de certification
40
Figure 5: Rendement moyen des producteurs
n'étant pas dans le processus de certification
40
Figure 6: Trou servant à la gestion des eaux
usées ménagers
42
|
BPA
|
Bonne pratique agricole
|
|
COSA
|
Committee on Sustainability Assessment
|
|
CTB
|
Trade for Développement Centre
|
|
FAO
|
Food and Agriculture Organization
|
|
GBCC
|
Global Business Consulting Company
|
|
ICCO
|
International Coco Organization
|
|
ISEAL
|
International Social and Environnemental Accréditation and
Labelling
|
|
ISO
|
International Standard Organization
|
|
KPMG
|
Cabinetd'audit
|
|
ONG
|
Organisation Non Gouvernementale
|
|
ONCC
|
Office National du Café et du Cacao
|
|
RA
|
Rainforest Alliance
|
|
RBD
|
Reserve de Biosphère du Dja
|
|
RSCE
|
Roundtable for a Sustainable Cocoa Economy
|
|
SAN
|
Sustainable Agriculture Network
|
|
TF-RD
|
Tropical Forest and Rural Development
|
|
GIZ
|
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
|
|
PIASI
|
Programme d'appui aux acteurs des secteurs informels
|
|
PAJER-U
|
Programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine
|
LISTES DES ABRÉVIATIONSLISTE DES ANNEXES
Annexe 1 :
Questionnaire
73
Annexe 2 :
Remarques
77
Annexe 3 :
Informations sur les données et informations de convergence
78
Annexe 4: Effets
marginaux et estimations des paramètres
79
Annexe 5 : Tests de
Khi - deux
79
Annexe 6 : Effectifs
et résidus
80
RESUME
L'objectif principal de cette recherche est d'évaluer
les avantages liés à la certification Rainforest Alliance pour
les producteurs de cacao autour de la réserve du Dja à l'Est
Cameroun. Plus spécifiquement, il s'agit d'une part, d'évaluer
l'impact socio-économique de la certification Rainforest Alliance sur
les producteurs de cacao autour de cette réserve ; et d'autre part,
d'identifier les facteurs qui encouragent son adoption. Les données ont
été collectées auprès de 100 producteurs de Cacao
autour de la réserve du Dja, dont 44 d'entre eux sont engagés
dans le processus de certification depuis plus d'un an. Il ressort de
l'estimation du modèle Logit portant sur les facteurs d'adoption de la
certification que l'âge et le sexe ne semblent pas avoir d'effet positif
sur l'adoption de la certification.
Mots clés : impacts ;
standards de durabilité ; certification ; petits
producteurs.
ABSTRACT
The main objective of this research is to evaluate the
benefits of Rainforest certification for cocoa farmers around the Dja Reserve
in the eastern region of Cameroon. More specifically, it is firstly to assess
the socioeconomic impact of certification on Rainforest cocoa farmers around
the Dja Reserve; and secondly, to identify the factors that encourage the
adoption of Rainforest certification by farmers around the reserve. Data were
collected from 100 cocoa farmers around the Dja Reserve, 44 of them are
certified for over a year. According to the estimation of Logit model on the
adoption of the certification factors as ageand sex seem to have a negative
effect on the adoption of certification.
Keywords: Impacts; Sustainability Standards; Certification;
Small producers
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. Contexte de
l'étude
Le cacao constitue, selon l'Agence Belge de
Développement 1(*)« Trade for Développement Centre », le
troisième marché alimentaire mondial, avec un montant annuel des
échanges estimé à environ10 milliards de dollars (CTB,
2011). Selon les statistiques de l'Organisation Internationale du Cacao (ICCO,
2014/15), la demande totale de cacao, approximée par les
quantités broyées, est passée de 3,2 millions de tonnes en
2004 à plus de 4,0 millions de tonnes en2015.Pour répondre
à cette demande mondiale sans cesse croissante, le développement
de la culture du cacao a pris de l'ampleur en Afrique où elle est
passée de 2836 millions de tonnes en 2013 à plus de 3051millions
de tonnes en 2015 (ICCO, 2014/15).
Les perspectives de la filière cacao demeurent d'autant
plus favorables que la demande effective et la demande potentielle sont
appelées à croître, eu égard aux profondes mutations
en cours, notamment la montée en puissance de la classe moyenne partout
dans les pays en développement, y compris ceux d'Afrique. Les broyages
de cacao au niveau mondial augmentent. Cette augmentation est liée en
partie à une demande en hausse en Asie et dans d'autres pays en
développement affichant une croissance rapide. Or dans ces pays, cette
demande sans cesse croissante est associée à la qualité
des produits mis sur le marché.
La globalisation de l'économie mondiale durant ces
dernières décennies a eu pour conséquences une
standardisation accrue des caractéristiques de production, de
commercialisation et de consommation dans le but de renforcer la confiance des
marchés GBCC, (2012).
Désormais, Les consommateurs sont de plus en plus
préoccupés par le respect des normes de production ainsi que du
mode de commercialisation des produits qu'ils consomment. La normalisation de
la qualité des produits est devenue une exigence des exportateurs, des
ONG, et des Consommateurs. La production de cacao n'est pas reste de processus
car elle fait désormais l'objet d'une grande attention et se retrouve
ainsi impliquée dans les grandes questions d'actualité
internationale telles que le travail des enfants, la préservation de
l'environnement et la pauvreté en milieu rural. Ce processus correspond
à ce que bon nombre de spécialistes appellent aujourd'hui, la
certification.
La certification de produits tropicaux comme le café et
le cacao a longtemps relevé d'un marché de niche, de type «
commerce équitable » ou « agriculture
biologique». A la fin des années 2000, le secteur cacao
connaît un virage vers la « certification de masse »
basée sur un concept de « développement durable »
combinant des normes environnementales, éthiques et des « bonnes
pratiques agricoles 2(*)» supposées augmenter les
rendementsYOUSSOUPHA N'DAO, (2012) .
Au cours des 20 dernières années, le nombre de
normes et de programmes de certification pour la production agricole a
rapidement augmenté. Les producteurs souhaitant exporter sont
confrontés non seulement à une pléthore de
réglementations sur l'importation, mais également, dans ces pays
d'importation, à différents marchés de niche pour lesquels
des conditions supplémentaires doivent être remplies.
De la même manière, les problèmes
liés à la durabilité suscitent de plus en plus de craintes
au sein de l'industrie du cacao. Les entreprises privées
déploient un nombre croissant de programmes pour promouvoir des formes
durables de production du cacao. Ceci est en partie lié aux
inquiétudes concernant la nécessité de garantir un
approvisionnement de fèves de cacao pour répondre à la
demande mondiale en hausse de produits à base de cacao. Tandis que les
normes de durabilité sociale et environnementale dans le secteur du
cacao s'y développent rapidement la production reste
caractérisée par des petites exploitations agricoles. Par
exemple, environ 90% de la production mondiale est cultivée dans 5,5
millions d'exploitations qui sont généralement des exploitations
familialesPALAZZO et al, (2011)cité par YOUSSOUPHA N'DAO, (2012). Cette
tendance conduit les producteurs certifiés à des changements dans
leurs manières de produire et de commercialiser leur production.
Mais derrière les critères
avancés par les « certificateurs », quels sont les avantages
réels de ces programmes ?
Des multinationales du chocolat (Cadbury / Kraft,
Nestlé et Mars) ont également réagi à ces nouvelles
préoccupations en élaborant des stratégies commerciales et
d'approvisionnement de cacao diverses, y compris par le développement
des standards de certification (Agriculture biologique, commerce
équitable, Utz, Rainforest Alliance, etc.).
L'organisation internationale du café et d'autres
organisations soutiennent la Fondation mondiale du cacao (WCF),
créée en 2000 par un groupe d'entreprises telles que ADM, Arma-
jaro, Barry Callebaut, Nestlé et Cargill, présidée
actuellement par Kraft Foods, ces entreprises représentant plus de 80 %
du marché mondial du cacao. L'objectif principal de la WCF est de
promouvoir et de coordonner la production et la consommation durables de cacao.
En 2011, la Fondation a accueilli cinq nouveaux membres originaires du Nigeria,
des États-Unis et d'Indonésie. Lors du Symposium sur
l'agriculture et la sécurité alimentaire mondiales, qui s'est
tenu parallèlement au Sommet du G8 à Washington en mai 2012, la
WCF a lancé une initiative de 4 millions de dollars pour former
près de 35 000 petits exploitants en Côte d'Ivoire, au Nigeria et
au Cameroun et améliorer leurs techniques agricoles. Celle-ci sera
menée sous les auspices du Cocoa Livelihoods Program d'un
montant de 40 millions de dollars financé par la GIZ.
Outre les initiatives collectives, des entreprises ont
également lancé leurs propres initiatives pour soutenir les
producteurs de cacao en fournissant des informations capitales sur
l'application d'engrais, la culture des plantes, les techniques de
récolte et d'autres pratiques agricoles, ainsi que des messages sociaux.
Mars et d'autres fabricants de confiseries se sont engagés à
utiliser d'ici 2020 un cacao certifié comme étant produit de
manière durable. Barry Callebaut (représentant 12 à 15 %
des broyages mondiaux) met pour sa part l'accent sur de nouvelles
régions adaptées à la production durable de cacao, et
développe également ses opérations de transformation
existant en Côte d'Ivoire, en concluant de nouveaux accords de
sous-traitance et en développant ses activités gastronomiques.
L'Afrique, l'Amérique Latine et l'Asie sont les
principaux fournisseurs de cacao. L'Afrique de l'Ouest est le principal
fournisseur de cacao, elle assure 70% de la production mondiale ICCO,
(2014/15). La Côte d'Ivoire et le Ghana sont les locomotives de la zone.
La Côte d'ivoire est le principal pays producteur et exportateur de
cacao. Elle produit environ 1794 millions tonnes par ans ICCO, (2014/15). C'est
les raisons pour lesquelles les grandes entreprises dominant le secteur du
broyage du cacao (Cargill, ADM, Barry-callebaut) ont commencé à
investir dans les pays producteurs où se développe donc
l'activité de transformation.
Les grands industriels du cacao déclarent viser des
centaines de milliers de tonnes, voire la totalité de leurs
approvisionnements en cacao certifié, vers 2020. Cette certification de
masse a été promue par l'agro-industrie et les ONG
internationales comme Rainforest Alliance (RA) ou
UTz. Face aux critiques récurrentes de lobbies
environnementaux et médias envers les plantations de cacao
accusées de détruire la forêt tropicale et d'utiliser la
main d'oeuvre enfantine, l'Industrie du chocolat a désormais besoin de
standards montrant sa prise en considération d'un développement
dit durable. Ainsi les grands principes qui régissent le
standardRainforest Alliance tournent autour de normes environnementales
(conservation des écosystèmes) et éthiques (traitement
équitable des travailleurs, santé) tout en intégrant des
« bonnes pratiques agricoles » telles que la taille des cacaoyers,
une utilisation raisonnée des pesticides, la mise en place de fosses de
compostage de déchets agricoles. Mais derrière ces standards,
quels sont les avantages réels pour les petits producteurs de
cacao ? En d'autres termes, La certification a-t-elle un impact sur les
petits producteurs? Quels sont les facteurs qui encouragent l'adoption de la
certification par les producteurs de cacao ?
2.
Problématique
Le cacao est l'une des cultures de rente au Cameroun,
troisième producteur après la cote d'ivoire et le GhanaICCO,
(2014/15), Ce cacao est principalement produit dans quatre régions du
Cameroun et est exporté principalement à partir du port de Douala
vers le marché européen.
La libéralisation du marché du cacao au Cameroun
en 1994 (abolition du monopole d'État, suppression de la fixation
des prix, suppression d'intrant subventionnés) a eu pour
conséquence une baisse de la qualité et des rendements de la
production. Le recours aux pratiques d'achat et de commerce durable tel que la
certification est de plus en plus exigé chez les principaux acheteurs de
produit de base tels que le cacao.
Si le cacao camerounais a l'avantage de bien se prêter
à la fabrication de poudre de cacao très demandée au
niveau mondial, il souffre toutefois d'une décote sur le marché
en raison d'une qualité jugée parfois insuffisante.
Les Pays Bas qui importent environs 70% du cacao du Cameroun
ont fixé en 2025 la date à laquelle ils n'admettront plus
d'importation de cacao non certifié sur leur territoire.
Également la date fixée par les chocolatiers Nidar AlbertHeijn
et MARS sont respectivement 2015 et 2020. Face à cela, plusieurs
initiatives de certification de la durabilité se développent
rapidement dans le secteur cacao au Cameroun.
Selon les statistiques de l'office national du café et
du cacao L'ONCC, (2015), les producteurs camerounais ont mis sur le
marché au cours de la campagne2014-2015 plus de 10 000 tonnes de
cacao certifié. Cette production double pratiquement celle de la
campagne précédente, qui avait culminé à 5446
tonnes, contre environ 2000 tonnes seulement lors de la campagne 2012-2013. Ce
qui signifie que sur les trois dernières campagnes cacaoyère, les
producteurs camerounais ont quintuplé la production du cacao
certifié dans le pays. A l'origine de cette augmentation de la
production du cacao certifié, les programmes de certification mis en
place par des négociants. Parmi ceux-ci, l'on retrouve Telcar Cocoa,
représentant local du négociant Cargill, qui demeure leader sur
le marché du cacao certifié au Cameroun. Sic Cacaos, filiale de
Barry Callebaut, et Agro-produce Management Services
Limited(AMS), filiale de la société
néerlandaise Théobroma. Tous ont pour objectif répondre
à la demande des consommateurs de plus en plus exigeante sur la
qualité, et l'accompagnement des producteurs et groupes de producteurs
dans la production d'un cacao respectant les normes environnementales. Ainsi,
la certification se présente comme un moyen de répondre à
une demande mondiale de consommation qui tienne compte de la protection du
consommateur et de l'environnement et d'une certaine éthique sociale.
Mais quels sont les avantages réels de ces programmes sur les petits
producteurs de cacao ?
Cette problématique suscite un certain nombre de
questions à savoir : La certification a-t-elle un impact sur les
petits producteurs? Quels sont les facteurs qui encouragent l'adoption de la
certification par les exploitants agricoles de cacao ? Telles sont les
questions que nous nous proposons de répondre tout au long de ce
travail.
3. Objectifs de
recherche
L'objectif principal de cette recherche est d'analyser les
avantages liés à la certification Rainforest pour les producteurs
de cacao autour de la réserve du Dja.
Plus spécifiquement, il s'agit de:
Ø Évaluer l'impact Socio-économique de la
certification Rainforest Alliance sur les producteurs de cacao autour de la
réserve du Dja.
Ø Identifier les déterminants de l'adoption de
la certification Rainforest par les cacaoculteurs autour de la Réserve
de Biosphère du Dja.
4. Hypothèses de
recherche
Les deux hypothèses qui correspondent respectivement
à nos objectifs spécifiques sont:
Hypothèse 1 : La certification
Rainforest Alliance permet d'améliorer les conditions
socio-économiques des producteurs de cacao autour de la réserve
du Dja (augmentation des quantités produites ; amélioration des
revenus des producteurs ; amélioration du niveau de
scolarisation).
Hypothèse 2 : L'appartenance
à une organisation, les possibilités d'accès au
marché ainsi que la sensibilisation sont les principaux facteurs qui
encouragent l'adoption de la certification Rainforest Alliance par les petits
producteurs de cacao autour de la Reserve du Dja.
5. Importance de
l'étude
Ce sujet suscite un véritable intérêt
théorique. En effet, très peu d'études ont
été menées sur la production durable de cacao au Cameroun
ainsi que les normes et critères de Rainforest Alliance. Une meilleure
connaissance dans ce domaine pratiquement nouveau contribuerait à
élargir d'avantage la littérature sur ce champ d'activité.
L'intérêt de cette étude réside
également au fait qu'elle permettra d'une part, d'amener les producteurs
à exploiter de manière durable leur exploitation de cacao tout en
préservant l'équilibre socio-économique et environnemental
et d'autre part, elle permettra d'orienter le gouvernement camerounais à
créer les conditions favorables à l'essor de la certification
tout en améliorant la perception des producteurs vis-à-vis de la
certification.
6. Organisation du
travail
Compte tenu du contexte d'étude, de notre
problématique et des contraintes méthodologiques, notre
étude sera organisée en deux grandes parties.
Dans la première partie, il est mis en exergue l'impact
Socioéconomique de la certification Rainforest Alliance à travers
d'une part l'analyse théorique de l'impact de la certification (chapitre
I), et d'autre par l'analyse empirique de l'impact de la certification
(chapitre II).
La deuxième partie prend en compte les
déterminants de l'adoption de la certification Rainforest Alliance des
exploitations agricoles autour du Dja par les producteurs : elle
présente en (chapitre III), l'analyse théorique des
déterminants de l'adoption des innovations agricoles, ainsi que les
déterminants de l'adoption de la certification Rainforest Alliance
autour de la réserve de biosphère du Dja (chapitre IV).
PREMIÈRE PARTIE :
ÉVALUATION
SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE SUR LES
PRODUCTEURS DE CACAO AUTOUR DE LA RESERVE DU DJA
La certification de produits tropicaux comme le café et
le cacao a longtemps relevé d'un marché de niche. A la fin des
années 2000, le secteur cacao connaît un virage vers la «
certification de masse » basée sur un concept de «
développement durable » combinant des normes environnementales,
éthiques et des « bonnes pratiques agricoles »
supposées augmenter les rendementsSYLVAINE LEMEILLEUR et al,
(2012).
Au cours des 20 dernières années, le nombre de
normes et de programmes de certification pour la production agricole a
rapidement augmenté. Les producteurs souhaitant exporter sont
confrontés non seulement à une pléthore de
réglementations sur l'importation, mais également, dans ces pays
d'importation, à différents marchés de niche pour lesquels
des conditions supplémentaires doivent être remplies. En revanche,
il est possible que leurs produits soient déjà conformes à
ces conditions, et que ces marchés de niche offrent l'opportunité
d'un meilleur accès au marché, voire à des prix plus
élevés (prime de prix). D'un autre côté, les
consommateurs sont confrontés à un nombre croissant de labels de
produits, et bien que leurs exigences soient souvent à l'origine de ces
labels, ils peuvent se sentir dépassés par la quantité.
Cette partie dédiée à l'analyse de
l'impact socioéconomique de la certification Rainforest Alliance sur les
petits producteurs de cacao se subdivise en deux chapitres :
L'analyse théorique de l'impact la certification
(chapitre I) d'une part, et d'autre part l'analyse empirique de l'impact
de la certification Rainforest Alliance autour de la Réserve de
Biosphère du Dja (chapitre II).
CHAPITRE I :
ANALYSE THÉORIQUE DE
L'IMPACT DE LA CERTIFICATION
La certification des produits agricoles offre
l'opportunité de créer des marchés de niche dans lesquels
des prix plus élevés peuvent être demandés.Dans la
littérature néoclassique, le concept de qualité
génère bien souvent des problèmes d'asymétrie
d'information quand la qualité recherchée ne peut être
mesurée au moment de l'achat AKERLOF, (1970) cité par YOUSSOUPHA
N'DAO, (2012). En effet, les solutions de réputation et de
répétition des achats restent limitées pour
résoudre le problème d'asymétrie d'information, amenant
alors à l'émergence de nouvelles institutions de marché
que sont les standards et leur certification LIZZERI, A., (1999).
Dans ce chapitre, présenterons en (I.1) quelques
élément théoriques sur les évaluations d'impact,
ensuite nous présenterons en (I.2) une revue de la littérature
sur l'impact de la certification.
1.1.1 I.1. IMPACT DE LA CERTIFICATION :
ÉLÉMENTS THÉORIQUES
Dans cette section, nous présenterons quelques concepts
importants avant de présenter la théorie économique
relative à la certification agricole.
1.1.2 I.1.1. Définitions et
présentation de quelques concepts
- Certification
Un consensus, à travers la littérature, se
dégage sur la notion de certification selon la conception juridique ou
économique.
La Petite Encyclopédie Juridique3(*), considère la
certification comme une procédure destinée à faire
valider, par un organisme agréé indépendant, la
conformité du système qualité d'une organisation aux
normes ISO 9000 ou à un référentiel de qualité
officiellement reconnu. La certification donne aux cocontractants et au public,
l'assurance qu'un produit, un processus ou un service respectant de
système de qualité est conforme à des exigences de
qualité déterminées et que l'organisation certifiée
respectait ce système de qualité lorsque l'organisme a
effectué sa validation.
Selon le « Lexique du Management de la qualité
4(*)», la certification
est le processus de vérification qu'un produit ou un service est
conforme à un référentiel (une norme, un standard) de
gestion de la qualité, de sécurité. La certification se
traduit par la mise en oeuvre d'un système de management respectant les
exigences d'un référentiel, puis par validation de ce
système par un organisme externe accrédité (l'audit de
certification).
Pour le Roundtable for a Sustainable Cocoa Economy
(RSCE5(*)), la certification
est la procédure par laquelle une tierce partie atteste par écrit
qu'un produit ou un processus est conforme à certaines normes. La
certification peut être un outil de communication dans l'ensemble de la
filière. Un certificat prouve à l'acheteur que le fournisseur
respecte certaines normes, qui peuvent être plus convaincantes que si le
fournisseur donnait lui-même cette assurance. L'organisation
chargée de la certification est appelée organisme de
certification ou certificateur.
Le rapport d'inspection pour l'octroi d'une attestation
écrite ou « certificat », émane d'un audit. Les audits
peuvent varier en termes de fréquence et d'échantillonnage. Il
existe trois degrés d'attestation dans la certification : le
contrôle de tierce partie, lorsque l'attestation est fournie par une
partie qui n'a pas d'intérêt direct dans la relation
économique entre le fournisseur et l'acheteur ; le contrôle de
seconde partie, lorsqu'un acheteur vérifie que le fournisseur respecte
une norme ; et le contrôle de première partie, lorsque la
déclaration de conformité du fournisseur est basée sur un
mécanisme de contrôle interne (RSCE2, op.cit).
Ces trois conceptions de la certification ont en commun les
notions de référentiel ou norme ou standard et l'audit.
- Durabilité
La durabilité est définie selon le dictionnaire
Larousse comme la Durée au-delà de laquelle il n'est plus
rentable de maintenir en état un équipement.
En
droit, c'est la
période d'utilisation d'un
bien. Dans le
domaine de la
sûreté
de fonctionnement, c'est l'aptitude d'un bien à accomplir une
fonction jusqu'à ce qu'un état limite soit atteint6(*), ce qu'on appelle couramment la
solidité d'un objet ou d'un équipement, par opposition à l'
obsolescence.
Les termes de durabilité, appliqué à
l'environnement naturel, et celui de
développement
durable, avec le sens de pérennité des ressources, se sont
imposés dans les
années
1990.
En
1987, le
Rapport
Brundtland définissait le
développement
durable comme l'objectif de développement compatible avec les
besoins des
générations futures. Il doit inclure trois piliers :
économique,
environnemental, et
d'équité sociale.
- Petits producteurs7(*)
Pour les acteurs du commerce équitable un petit
producteur est un agriculteur qui travaille en général sur une
surface de moins de quatre hectares.
- Standard
Un standard8(*) est un référentiel publié par une
entité privée autre qu'un organisme de normalisation national ou
international ou non approuvé par un de ces organismes pour un usage
national ou international. On ne parle de standard qu'à partir du moment
où le référentiel a une diffusion large, on parle alors de
standard de facto (standard de fait).
- Rainforest
Alliance
Rainforest Alliance est une ONG internationale basée
à New York faisant partie d'une coalition d'ONG regroupés au sein
d'un Réseau d'Agriculture Durable appelé SAN. Le Réseau
d'Agriculture Durable (SAN) fait la promotion des systèmes agricoles
productifs, de la protection de la biodiversité et du
développement communautaire durable à travers la création
de normes sociales et environnementales. Le SAN s'emploie à dresser ses
meilleures pratiques agricoles durables comme le standard mondial le plus
reconnu et adopté par tous les acteurs de la chaîne de valeur
agricole. Le SAN encourage à l'adoption des meilleures pratiques pour la
chaîne de valeur agricole en incitant les producteurs à se
conformer à ses normes, et stimule les
Développement humain
commerciaux et les consommateurs à soutenir le
Développement Durable.
Ressources naturelles et conservation de la
faune
Production agricole
Standards sociaux, économiques et
environnementaux pour la production durable
Figure 1: Piliers de
l'Agriculture durable
Source : Rapport de l'audit diagnostic RA des producteurs
de cacao autour de la réserve du Dja au Cameroun 2015
Créée depuis 1987, sous forme d'association,
Rainforest Alliance élabore des normes de certification depuis 1991
(SAN), Les produits certifiés à la date d'aujourd'hui sont le
café, les bananes, le cacao, les fruits, le bétail, Etc. Elle est
financée par les organismes publics, les entreprises et des donateurs
privés et est membre actif de l'ISEAL, association mondiale libre des
organismes de certification. Ses standards sont inspirés des normes de
cette association.La vision de Rainforest est de faire la promotion des
systèmes agricoles productifs, de la protection de la
biodiversité et du développement communautaire durable à
travers la création de normes sociales et environnementales.
- Principes des Standards d'Agriculture Durable du SAN
La version actuelle des Standards d'Agriculture Durable
(applicable aux exploitations) date de 2010. Cette version est en
révision. La nouvelle version qui sera publiée cette année
sera d'application obligatoire à partir de Janvier 2017
Ci-dessous les 10 principes de la version courante (Juillet
2010) des Standards d'Agriculture Durables :
a. Système de gestion sociale et environnementale
b. Conservation des écosystèmes
c. Protection de la vie sauvage
d. Préservation de l'eau
e. Traitement équitable et bonnes conditions de travail
pour les travailleurs
f. Santé et sécurité au travail
g. Relations avec les communautés
h. Gestion intégrée des cultures
i. Gestion et conservation des sols
j. Gestion intégrée des déchets
Les 10 principes regroupent au total 99 critères. Outre
les Standards d'Agriculture Durable, les Standards de Groupe et les Standards
de la chaîne de Contrôle sont applicables
1.1.3 I.1.2. Approches théoriques
et méthodes d'estimation d'évaluation d'impacts
Approches théoriques :
L'évaluation est une appréciation
périodique et objective de projets, programmes ou politiques
prévus, en cours de réalisation ou achevés. Les
évaluations permettent de répondre à des questions
précises liées à la conception, la mise en oeuvre ou les
résultats des programmes. Contrairement au suivi, qui est continu, les
évaluations sont périodiques et effectuées à un
moment donné, généralement par des spécialistes
extérieurs au programme. La conception, la méthodologie et le
coût des évaluations varient fortement en fonction du type de
question à laquelle elles répondentPAUL J. GERTLER et al,
(2011).
L'impact d'un projet ou d'un programme est défini comme
l'ensemble des changements intervenu dans les conditions de vie des
participants, tels qu'eux-mêmes et leurs partenaires perçoivent au
moment de l'évaluation, ainsi que tout changement durable dans leur
environnement, auquel le projet ou le programme a contribué. Ces
changements peuvent être positifs ou négatifs, voulus ou
imprévusIFAD, (1998)
Une évaluation globale se définit dans la
littérature comme une évaluation qui intègre
l'évaluation du processus, l'évaluation du cout
-bénéfice, le contrôle, et l'évaluation
d'impactBAKER J.L., (2000). Ainsi, puisqu'il s'agit d'analyser les impacts
socioéconomique de la certification Rainforest chez les petits
producteurs de cacao autour de la Reserve de Biosphère du Dja, notre
analyse se limitera au dernier cas c'est-à dire à une
évaluation d'impact. La question fondamentale de l'évaluation
d'impact constitue essentiellement un problème d'inférence
causale. Évaluer l'impact d'un programme sur une série de
résultats revient à évaluer l'effet causal du programme
sur lesdits résultats. La plupart des questions de politique invoquent
des relations de cause à effet : la formation des professeurs
entraîne-t-elle une amélioration des résultats des
élèves aux examens ? Les programmes de transferts
monétaires conditionnels entraînent-ils une
amélioration de l'état de santé des enfants ? Les
programmes de formation professionnelle entraînent-ils une
amélioration des revenus des bénéficiaires ?
Même si les questions qui abordent une relation de cause
à effet sont courantes, il n'est jamais facile d'établir qu'une
relation est effectivement causale. Par exemple, le simple fait d'observer que
le revenu des bénéficiaires d'un programme de formation
professionnelle augmente ne suffit pas à établir un lien de
causalité. Le revenu d'un bénéficiaire pourrait en effet
avoir augmenté même s'il n'avait pas suivi le programme de
formation grâce, par exemple, à ses propres efforts, à
l'évolution des conditions sur le marché du travail ou à
tout autre facteur susceptible d'avoir un impact sur le revenu à travers
le temps. Les évaluations d'impact permettent d'établir un lien
de causalité en démontrant empiriquement dans quelle mesure un
programme donné et uniquement ce programme a contribué à
changer un résultat.
Pour établir un lien de causalité entre un
programme et un résultat, nous utilisons des méthodes
d'évaluation d'impact qui permettent d'écarter la
possibilité que des facteurs autres que le programme à
l'étude puissent expliquer l'impact observé.
La réponse à la question fondamentale de
l'évaluation d'impact, à savoir quel est l'impact ou l'effet
causal d'un programme P sur un résultat Y, est donné par la
formule de base d'évaluation d'impact :
á = ( Y | P =1) - (Y | P = 0 ).
Selon cette formulePAUL J. GERTLER et al, (2011), l'effet
causal á d'un programme (P) sur un résultat (Y)
est la différence entre le résultat (Y) obtenu avec le
programme (autrement dit avec P = 1) et le même résultat
(Y) obtenu sans le programme (c.-à-d. avec P = 0). Par
exemple, si P est un programme de formation professionnelle et Y
le revenu, l'effet causal du programme de formation professionnelle
á est la différence entre le revenu d'une personne donnée
(Y) après avoir participé au programme de formation
(donc avec P = 1) et le revenu qu'aurait eu la même personne
(Y) au même moment si elle n'avait pas participé au
programme (avec P = 0). Autrement dit, nous cherchons à mesurer
le revenu au même moment et pour la même unité d'observation
(une personne dans le cas présent), mais dans deux cas de figure
différents.
S'il était possible de procéder ainsi, nous
pourrions observer le revenu gagné par une même personne au
même moment à la fois après avoir suivi le programme de
formation professionnelle et sans l'avoir suivi, de manière à ce
que toute différence de revenu pour cette personne ne puisse s'expliquer
que par sa participation au programme. En comparant une même personne
à elle-même au même moment avec et sans le programme, nous
serions capables d'éliminer tout facteur externe susceptible de
contribuer à la différence de revenu. Nous pourrions alors
conclure sans aucun doute que la relation entre le programme de formation
professionnelle et le revenu est bel et bien causale.
La formule de base d'évaluation d'impact est valable
pour toute unité à l'étude, qu'il s'agisse d'une personne,
d'un ménage, d'une communauté, d'une entreprise, d'une
école, d'un hôpital ou de toute autre unité d'observation
qui peut bénéficier d'un programme. Cette formule est
également applicable à tout indicateur de résultat
(Y) qu'un programme en place peut de manière plausible
affecter. Si nous parvenons à mesurer les deux éléments
clés de cette formule, à savoir le résultat (Y)
à la fois en présence et en l'absence du programme, nous pourrons
alors répondre à n'importe quelle question sur l'impact de ce
programme.
On peut distinguer dans la littérature (des
évaluations ex-post)qui visent à déterminer de
façon plus large si une innovation, un projet, un programme a eu un
impact désiré sur des individus, des ménages et des
institutions, et si ces effets sont attribuables à l'intervention du
projet ou du programme, ainsi que (des évaluations ex-ante) dans le cas
des évaluations d'impact probables de programmes ou d'innovation
potentiels ou proposés. Les évaluations d'impact peuvent aussi
explorer des conséquences imprévues, soit positive, soit
négative sur les bénéficiaires.
Dans la théorie il existe plusieurs approches
d'évaluation d'impact : l'approche « avant et
après » et celle « avec/ sans » ;
l'approche dite « naïve » ; l'approche
« expérimentale » et l'approche « non
expérimentale ».
L'approche « avant et
après »AHOUANDJINOU. M .S, (2010) compare la performance des
variables clés après l'introduction de la technologie, du
programme ou de l'innovation avec celui avant son introduction. Elle emploie
des méthodes statistiques pour évaluer s'il Ya changement
significatif de quelques variables essentielles avec le temps. Mais cette
comparaison des situations « avant et après »
l'introduction de de l'innovation ne permet pas d'isoler les effets liés
aux facteurs exogènes qui pourraient survenir au cours de l'adoption de
la technologie comme par exemple l'inflation, la pluviométrie, les
catastrophes naturelles, les politiques économiques et agricoles, etc.
L'approche « avec et sans »
innovationSCHERR, S . et MULLER , E, (1991) permet de réduire ces bais
et est plus conceptuellement claire. Elle consiste à diviser le groupe
cible potentiel en deux groupes. Un sous-groupe reçoit l'innovation ou
la technologie et l'autre n'en reçoivent pas. Au bout d'un certain
moment donné, on procède à la comparaison entre les deux
sous-groupes. Le problème avec cette méthode réside dans
la difficulté de trouver des échantillons de paysans suffisamment
semblables de telle sorte que c'est seulement l'adoption ou non de l'innovation
qui les différencie. Ainsi de cette approche découlent celles qui
suivent :
L'approche dite « naïve »consiste
à prendre un échantillon aléatoire d'adoptant et de non-
adoptants de l'innovation et à utiliser les différences simples
des résultats moyens observés des deux groupes comme l'estimation
de l'impact de l'innovation. Cet estimateur est potentiellement biaisé
HECKMAM, J. , (1990) et ne prend en compte les caractéristiques
socio-économiques des exploitants ; il correspond à la
méthode d'estimation utilisée couramment dans la
littérature managériale.
L'approche « expérimentale » ou
aléatoire consiste quant à elle à réunir un groupe
de personnes ayant les mêmes droits et acceptant de participer à
l'expérience et de les assigner de façon aléatoire en deux
groupes : le groupe de ceux qui bénéficieront de
l'intervention (groupe de traitement) et celui de ceux qui n'en
bénéficient pas (groupe témoin). Les, participants
à l'expérience ayant été choisis au hasard, toute
la différence avec les non-participants est seulement due au traitement.
C'est la raison pour laquelle les approches expérimentale sont
considérées comme étant les plus fiables et donnant les
résultats plus faciles à interpréterCOCHRANE , J et al,
(1973). Cependant, ce type d'évaluation est difficile a appliquer dans
la pratique, car posant des problèmes d'éthique dans le cas des
phénomènes sociaux DIAGNE, (2003).
Ainsi les approches non expérimentales sont les plus
utilisées par les économistes car ils se basent sur les
théories économiques et économétriques pour guider
l'analyse et minimiser les erreurs potentielles dans l'estimation des impacts
DIAGNE, (2003). Cette approche est utilisée lorsque n'est pas possible
de sélectionner un groupe de contrôle ou de comparaison. On peut
comparer les participants au programme avec les non participants en faisant
appel à des méthodes statistiques pour contrôler des
différences observées entre les deux groupes. Il est donc
possible à l'aide d'une régression d'obtenir un contrôle de
l'Age du revenu, du sexe et d'autres caractérisés des
participants. Cette approche d'évaluation est peu onéreux et
facile à appliquer, mais l'interprétation des résultats
n'est pas direct et les résultats eux-mêmes peuvent être
moins fiables DIAGNE, (2003).
Les méthodes d'estimation :
Supposons que nous voulons déterminer l'effet de
l'adoption d'une nouvelle innovation agricole sur un indicateur de
résultat défini par y, la production par exemple. Soient y1
et y0 deux variables aléatoires qui représente
le niveau de production pour un individu i s'il utilise la nouvelle innovation
(Y1) ou s'il n'en utilise pas (y0). Soit la variable binaire wi =1
lorsqu'il a adopté l'innovation et wi = 0, sinon. L'effet
causal de l'adoption de la technologie pour cet individu i est la
différence entre y1 et y0.
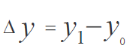
La principale difficulté dans l'estimation de
Äyest que pour un individu donné, le revenu est observé,
soit suite à l'adoption, soit avant l'adoption, mais jamais les deux
à la fois. Ceci dit, lorsqu'intervient un changement suite à une
innovation, on ne peut pas observer ce que serait la production sans
l'innovation agricole, et s'il n'intervient pas, on ne peut pas observer ce qui
se passerait si le changement intervenait effectivement. Dans la
littérature, cette donnée manquante est appelé
contrefactuel DIAGNE, (2003). CependantROSENBAUM et al, (1983) dans leur
étude ont eu à démontrer qu'on pouvait déterminer
un effet causal moyen du changement technologique au sein d'une population si
on admet une hypothèse d'indépendance conditionnelle entre y
1, y0 et w. leur idée consiste à faire la
différence entre le niveau moyen de l'indicateur des
bénéficiaires et celui des non bénéficiaires. On
obtient alors l'effet moyen du traitement (ATE9(*)).
ATE = E (y1 -y0)
Cet indicateur mesure l'impact de l'innovation sur un individu
tiré au hasard dans la population, ce qui est encore égale
à la moyenne d'impact de la technologie sur la population
entièreWOOLDRIDGE J M., (2009.). Mais cette hypothèse
d'indépendance des moyennes est souvent inapplicable pour les
études d'évaluations d'impact des innovations agricoles ou
technologiques en ce sens que, l'adoption d'une technologie par un individu
dépend du bénéfice (y1 -y0) qu'il
espère tirer du programme. Ainsi, il se pose un problème d'auto-
sélection des individus dans le processus d'adoption de l'innovation ou
de la technologie.
Pour corriger ces biais et pouvoir estimer de façon
consistante ATE plusieurs méthodes sont proposées dans la
littérature sur l'évaluation d'impact. Ces méthodes
peuvent être classées en deux catégories : La
méthode semi-paramétrique et la méthode
paramétrique.
- Estimation par la méthode semi
-paramétrique
Cette méthode est issue de la combinaison des
méthodes paramétriques et non paramétrique. Ainsi, dans un
premier temps, on estime le score de propension qui n'est rien d'autre que la
probabilité prédite de l'adoption de l'innovation ou de la
technologie. Cette méthode a été proposée par
ROSENBAUM et al, (1983) pour réduire le biais dû au fait que l'on
ne peut observer le résultat d'un adoptant actuel s'il n'avait pas
adopté, et le résultat d'un non adoptant actuel s'il avait
adopté. Pour ces auteurs, le score de propension se définit comme
la probabilité conditionnelle d'avoir adopté l'innovation
étant donné un vecteur x des caractéristiques observables
qui déterminent l'adoption.
P(  ) = Pr(w-1/ ) = Pr(w-1/  ) - E (w / ) - E (w /   ) (1) ) (1)
ROSENBAUM et al, (1983) Ont aussi démontré que
si en plus de l'hypothèse d'indépendance conditionnelle, P(x)
remplit les conditions 0P(x) 1 alors, ATE peux s'écrire de la
façon suivante :
ATE - E  (2) (2)
Estimer les équations (1) et
(2) revient d'abord à estimer p(.) par
un modèle de régression probit ou logit et ensuite utiliser la
valeur estimée pour obtenir ATE en remplaçant l'espérance
conditionnelle.
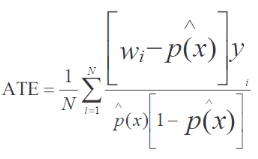 (3) (3)
Ou wi est le statut d'adoption de
l'individu
yiest la variable de mesure
d'impact
N est la taille de l'échantillon
- Estimation par la méthode
paramétrique
Cette dernière comprend les méthodes de
régression (régression simple et celle basée sur le score
de propension) et de variables instrumentales.
Méthode de régression
simple :
En reprenant les deux variables aléatoires y1
et y0 qui représente le niveau de production pour un
individu i s'il utilise l'innovation (y1) ou pas (y0). En
décomposant chaque contrefactuel en fonction des éléments
observables (  ) nous pouvons écrire : ) nous pouvons écrire :
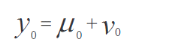 (4) (4)
 (5) (5)
En introduisant les équations (4) et (5) on obtient
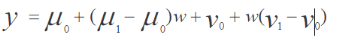 (6) (6) 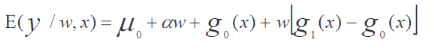 (7) (7)
 (8) (8)
 (9) et (10) (9) et (10)
En introduisant l'équation (9) et (10) dans (8) nous
obtenons
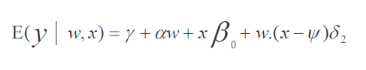 (11) (11)
Ou  sont des vecteurs des paramètres à estimer sont des vecteurs des paramètres à estimer 
L'estimation de l'équation (11) donne une valeur
consistante de ATE (WOOLDRIDGE J M., 2009.)
Méthodes basées sur les scores de
propensions :
Cette méthode n'est que le prolongement n'est que le
prolongement de la méthode de régression simple.ROSENBAUM et al,
(1983) Ont proposé que l'équation (11) peut être
estimée en utilisant la probabilité d'adopter une innovation
étant donné les éléments observables (x)
c'est-à-dire p(x) = p (w-1 /x). En effet, ces auteurs ont
prouvés que, sous l'hypothèse d'indépendance
conditionnelle de (y1, y0) et w étant donné
les variables explicatives x, (y1, y0) et w sont aussi
indépendants étant donné p(x). et cette fonction p(x).
qui , dans la littérature d'impact est encore appelé score de
propension. Ainsi, en considérant le score de propension,
l'équation (11) devient :
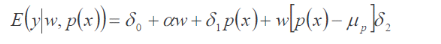
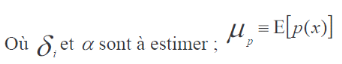
Méthodes des variables
instrumentales :
La méthode des variables instrumentales part aussi de
l'équation (11) et est plus adaptée pour générer
des estimateurs consistants l'osque l'hypothèse d'indépendance
conditionnelle n'est plus assuré .de plus, cette m méthode
est fréquemment suggérée dans la littérature
l'osque les données disponibles sont issues d'une seule enquête
transversale.
1.1.4 I.2. IMPACTS DE LA CERTIFICATION : REVUE DE LA
LITTÉRATURE
Plusieurs travaux en économie se sont
intéressés à l'impact des normes de production durable sur
les petits producteurs. Cependant, les résultats de ces travaux font
l'Object d'un vaste débat. Une partie de littérature empirique
soutient que les normes de production durables ont des effets positifs sur les
petits producteurs et sur leur organisation paysanne YOUSSOUPHA N'DAO, (2012).
D'autres études révèlent, par contre, des impacts
négatifs de la certification sur les producteurs GIOVANNUCCI et al,
(2008).
Dans notre travail, nous cherchons à
contribuer à ce débat en examinant l'impact de la certification
Rainforest Alliance sur les petits producteurs de cacao autour de la
réserve de biosphère du Dja (Est Cameroun).
Cette revue reprend les travaux de GBCC, (2012)qui a
mené une étude visant à examiner et analyser d'un point
de vue critique toute la littérature et les études pertinentes
sur la certification du cacao. Cette recherche a englobé l'analyse de la
documentation sur les spécifications, les exigences et l'impact produit
par les programmes de certification existants ainsi que les études
indépendantes réalisées.
1.1.5 I.2.1. Impact économique de
la certification
KPMG, (2011), en utilisant une combinaison de comparaison de
méthode latitudinale et longitudinales entre les producteurs
certifiés Utz et les producteurs non certifiés, démontre
que la certification à entrainer un accroissement du rendement des
exploitations de cacao de 15%. L'étude révèle, cependant,
que ce taux d'accroissement de la productivité dû à la
certification serait statique quel que soit la saison cacaoyère et de
loin, inférieur au potentiel d'accroissement de rendement de 30% attendu
de l'adoption de bonnes pratiques agricoles. Les principales raisons
évoquées portent, en particulier, sur le manque d'exigences de
certains standards sur la productivité et la mauvaise programmation des
formations dispensées aux producteurs.
GIOVANNUCCI et al, (2008)montrent des impacts négatifs
de la certification dans le secteur du café sans pour autant fournir les
raisons de cette baisse de productivité. Selon les résultats de
leurs travaux, 60% des producteurs interviewés dans le cadre du test de
la méthodologie COSA ont rapporté une réduction des
rendements du café au terme de la mise en oeuvre des programmes de
durabilité dans ledit secteur. En outre, ALLEN BLACKMAN,et al(2010)
démontrent que les rendements sur les exploitations certifiées
Organiques sont inférieurs aux rendements des exploitations
conventionnelles au Costa Rica. En fait, une norme affecte les producteurs
différemment et affecte les producteurs en fonction de sa nature, de
l'environnement institutionnel du pays ainsi que les caractéristiques de
la ferme.
CATHERINE VOGELl et al, (2010)a évalué l'impact
potentiel de la certification sur le rendement du cacao en se fondant sur les
résultats du comptage des cabosses réalisés sur les champs
écoles paysans. Elle démontre que l'impact potentiel de la
certification sur le rendement pourrait être de 49% à la suite de
l'application intégrale des bonnes pratiques agricoles. Ses conclusions
demeurent, cependant, basées sur une taille réduite de champs
écoles et des effets de simulation.
Les travaux de la COSA JASON POTTS et al, (2012)montrent que
l'impact de la certification sur le rendement des producteurs de café et
de cacao pourrait se situer à un taux d'accroissement de 17%, tous
standards de certification confondus Toutefois, ce taux d'accroissement
pourrait varier d'un standard à un autre. Ainsi, est-il possible de
relever le fait que la certification UTZ génère le taux
d'accroissement de la productivité le plus élevé (environ
32%) suivis de Rainforest Alliance (15%) et du commerce équitable (13%).
L'impact de la certification organique sur la productivité est
très faible de l'ordre de 5%.
Toutefois, les conclusions des travaux de KPMG, (2011)
indiquent que l'impact de la certification sur la qualité du cacao
pourrait varier d'un standard à un autre. Ainsi, est-il possible de
relever le fait que la certification UTZ produit généralement un
cacao de bonne qualité (près de 70% de cacao de type grade 1)
suivis de Rainforest Alliance (45% de cacao de type grade 1). L'impact de la
certification Fairtrade sur la qualité est mitigé. Ils montrent
également que les producteurs certifiés à travers leurs
coopératives bénéficient d'un accès renforcé
aux informations du marché du fait des exigences des normes de
certification. Celles-ci recommandent plus de transparence dans toutes les
transactions financières et commerciales réalisées dans
l'optique de la traçabilité des produits.
Les travaux de MAN-KWUN CHAN et al, (2009)montrent que la
certification a amené les organisations des producteurs et leurs membres
à adopter les bonnes pratiques de récolte et post-récolte
et à investir davantage dans l'acquisition des matériels de
contrôle nécessaire au traitement et au conditionnement des
produits certifies. Les formations sur la qualité fournies par la
plupart des standards de certification, la fourniture d'équipements de
contrôle qualité par certains standards de certification, et
l'accroissement de la propension des producteurs et de leurs
coopérative, à investir dans la conversion des systèmes de
production traditionnels vers des systèmes de productions intensifs
améliorant la quantité et la qualité des produits, sont
des éléments de justification avancés par la
littérature pour soutenir ces résultats.MAN-KWUN CHAN et al,
(2009)Évoquent les même effets positifs de la certification sur
l'accès au marché et les justifient à travers :
l'amélioration des capacités de négociation et
commercialisation des producteurs et de leurs coopératives, les
relations privilégiées qu'elles développent avec les
exportateurs qui leur facilitent souvent l'accès aux informations de
marchés ;
- l'action des standards tels que Fair Trade, UTZ et FSC,
fournissent plusieurs actions de renforcement des capacités sur les
questions d'accès au marché, tout en facilitant
l'établissement des contacts entre les coopératives et leurs
membres à des partenaires commerciaux ;
- le renforcement des capacités de commercialisation
qui offre un accès élargi au marché.
Nicolas EBERHART, (2007)en évaluant l'impact du
commerce équitable chez les producteurs de café en Bolivie,
montre que Les prix offerts par le commerce équitable sont très
avantageux et largement supérieurs à ceux des autres
marchés lorsque les cours internationaux sont bas. Ceux qui ne vendent
pas sur les marchés du commerce équitable, ne pouvant même
pas satisfaire convenablement leurs besoins alimentaires de bases ont
obligé de consommer leur épargne, mais surtout de vendre leur
force de travail en ville.
L'accès au commerce équitable dans
une proportion significative pour l'ensemble des
familles membres des
organisations certifiées leur permet de couvrir leurs
besoins
alimentaires et autres besoins essentiels (éducation,
santé, etc.) et de développer un système de production
durable.
Certes les effets économiques du commerce
équitable ne sont vraiment visibles qu'en période de prix
internationaux bas, puisque lorsque les cours dépassent le prix minimum
défini par FLO, les différences entre les circuits conventionnels
et équitables sont faibles. Cependant, le mécanisme du prix
minimum garanti induit une certaine sécurité pour les petits
producteurs.
Cette stabilité permet à la famille de conforter
son système de production et d'entreprendre
sereinement des
investissements constants dans l'éducation des enfants, et
des
investissements productifs (taxi, maison à La Paz...).
Les travaux deKPMG, (2011), montrent que la certification
induit un accroissement des prix d'achats aux producteurs et à leurs
coopératives. Selon les résultats de cette étude,
l'environnement de la commercialisation du cacao certifié
créé ses propres leviers, qui impactent positivement les prix
offerts aux producteurs et aux coopératives en dépit du fait
qu'un système d'achat différentié du cacao certifié
par rapport au conventionnel ne soit formellement établi. Au niveau des
producteurs, l'étude en s'appuyant sur l'analyse comparée des
prix moyens au kilogramme reçu par les producteurs, révèle
que les prix payés aux producteurs certifiés sont
généralement supérieurs (de 7 à 10%) à ceux
payés aux producteurs non certifiés.
1.1.6 I.2.2. Impact Social et
Environnemental de la certification
Impact Social de la
certification :
Il ressort des résultats des travaux de KPMG, (2011)
que le taux de scolarisation des enfants des producteurs certifiés est
de 63,60% en moyenne contre 67,60% pour les producteurs non certifiés.
Ce résultat, a priori, inattendu indique que la certification n'a pas
d'impact sensible sur la scolarisation des enfants. Ce résultat semble
être confirmé par les conclusions de l'étude
réalisée par Vogel (2009) et qui évoque la faible
capacité des infrastructures comme la principale contrainte à
l'accroissement du niveau de scolarisation des enfants. D'autres études
dans le secteur café ont présenté des effets positifs de
la certification sur l'accès à l'éducation sans mettre en
exergue les fondements scientifiques qui soutiennent cette affirmationMAN-KWUN
CHAN et al, (2009).
Le faible taux de scolarisation serait lié à
l'implication des enfants dans les activités champêtres. De
manière générale dans plus de 23% des cas, les enfants
vivant avec les producteurs de cacao (certifié ou non) participent
à l'ensemble des travaux de la chaine de production cacaoyère,
notamment les travaux dangereux sur les exploitations (GBCC et KPMG, op.cit).
Cependant, selon ces auteurs, la certification n'aurait pas d'impact
quantitatif visible sur la réduction du phénomène du
travail des enfants. La certification assure la sensibilisation des
communautés sur la question du travail des enfants mais ne fournit pas
les actions de remédiassions nécessaires à la mitigation
du phénomène.
KPMG, (2011) évaluant l'impact de la certification sur
Les conditions de travail des enfants arrivent à la conclusion que la
certification à un impact sur la qualité des efforts fournis
prouve que les manoeuvres et leurs familles qui vivent sur les plantations
certifiées ont accès à des formations sur les risques
potentiels liés à l'exercice de leurs activités. Les
producteurs certifiés et leurs manoeuvres ont augmenté
significativement leur niveau de connaissance sur la question de santé
et sécurité au travail comparativement aux producteurs non
certifiés. Ces résultats sont, par ailleurs, confirmés par
les travaux de Chan & Barry (op.cit), qui révèlent plusieurs
impacts incluant notamment : Amélioration des pratiques de santé
et sécurité au travail dans les champs, résultant des
formations reçues sur la santé et la sécurité et
l'utilisation rationnelle des pesticides, l'utilisation accrue des
équipements de protection individuels (EPI), l'amélioration de la
gestion des accidents, l'amélioration de la fourniture d'assistance
médicale et des premiers soins. Certaines études fournissent des
évidences de résultats sur la réduction des accidents au
champ ainsi que l'accroissement du niveau de connaissance des producteurs sur
les risques liés à l'utilisation des produits agrochimiques ;
réduction des heures de travail pour assurer la conformité avec
les heures de travail maximum prescrit par la législation ;
réduction de la mortalité infantile issue d'une comparaison entre
un groupe de producteurs certifiés Fairtrade un autre groupe de
producteurs non certifiés Fairtrade. L'impact positif de la
certification sur la santé et la sécurité au travail est
corroboré par l'étude de CATHERINE VOGELl et al, (2010)Cette
étude révèle, cependant, que des contraintes liées
à l'accès des producteurs aux centres de santé et produits
pharmaceutiques subsistent.
Impact Environnemental de
la certification :
Selon KPMG, (2011)la mise en oeuvre des normes a des impacts
environnementaux sur les exploitations et leur entourage. La
biodiversité, les ressources naturelles, le cadre de vie, et
l'utilisation des pesticides peuvent être affectés de
manière positive ou négative, et doivent être
analysés ensemble.
La FAO, (2004) définit Les bonnes pratiques agricole
(BPA) comme l'utilisation de techniques agricoles qui minimisent les risques,
maximisent la production tout en assurant la sécurité humaine Des
enquêtes menées sur les pratiques de lutte intégrée
au cours de ces deux (2) dernières campagnes dans les exploitations
cacaoyères Ivoiriennes révèlent que les bonnes pratiques
agricoles ont une ampleur plus élevée au niveau des producteurs
certifiés. Ils pratiquent des récoltes sanitaires et font usage
de compost comme fertilisant ce qui réduit l'utilisation des pesticides
et des engrais chimiques. Cela a pour effet induit, la réduction de
l'impact négatif sur l'environnement KPMG, (2011).
Les résultats de l'étudeKPMG,
(2011)révèlent que les producteurs contrôlent peu leur
utilisation d'énergie, néanmoins 20,5% de producteurs
certifiés contre 1,56% des producteurs non certifiés affirment
avoir réduit ces deux dernières années leur consommation
d'énergie (combustible et carburant La majorité du bois de
chauffe provient des fagots issus des tailles, par contre un taux
élevé de producteurs non certifiés (42.19% contre 29.81%
des producteurs certifiés) tirent le bois de chauffe de la coupe
d'arbres forestiers. Ce qui est dommageable pour l'environnement. Les normes
UTZ et FT par rapport à la norme RA se montrent plus dominants en
matière de gestion de l'énergie.
Au niveau de la gestion de la ressource d'eau, l'impact n'est
pas perceptible. En effet, seulement 13% des producteurs certifiés ont
diminué le volume d'eau utilisée pour les activités de
production. Et à ce niveau les producteurs certifiés Fairtrade
ont une tendance évoluée dans la diminution du volume d'eau
utilisée et la pratique de conservation de l'eau. Par contre, dans
l'article « The CENTER for AGROECOLOGY et SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS, 2008
», l'impact est beaucoup plus perceptible dans les projets d'agriculture
biologique et Fairtrade initiés au Nicaragua dans le secteur du
café. En effet, 43% des ménages FLO ont adopté le
système de conservation de l'eau contre 10% des ménages
ordinaires. Ce qui réduit les coûts pour les ménages. L'eau
est économisée grâce à l'utilisation de
systèmes d'irrigation efficaces - un producteur estime que la
certification Utz avec la ferme utilise seulement environ 2 pour cent (2%) de
l'eau qu'ils utilisaient avant la certification, en raison de la perte d'eau
réduite, ce qui est une possibilité car ils sont passés de
l'utilisation de sillons ouverts, avec la perte d'eau par le biais de haute
évaporation et percolation, à aspersion d'ambiance et de
l'irrigation au goutte à goutte Lazaro etal., (2008). Les
producteurs certifiés réduisent nettement leur utilisation de
biocide et de fertilisant synthétique à la faveur d'autres
méthodes qui dégradent moins l'environnement ou minimisent les
risques de contamination. La plupart d'entre eux connaît les dangers
d'utilisation des biocides près des sources d'eau et ont des
systèmes de traitement d'eau usagées fonctionnels. En la
matière, les producteurs UTZ ont une longueur d'avance par rapport aux
deux autres normes KPMG, (2011). Avec la certification, les matières
solides organiques sont de plus en plus recyclées ou
réutilisées dans les exploitations agricoles. Plus de 15% des
producteurs certifiés recyclent ou réutilisent les coques de
cacao contre moins de 10% des producteurs non certifiés. Cependant, les
producteurs certifiés réutilisent moins les déchets
solides inorganiques. Cela pourrait s'expliquer par certaines techniques
utilisées dans la gestion des déchets inorganiques afin
d'éviter tout intoxication par les produits agrochimiques ou chimiques
(GBCC et KPMG, op.cit). En général avec UTZ, les producteurs
recyclent et réutilisent plus les déchets solides. 37,74% des
coques de cacao sont recyclés et plus de 25% de matière
inorganique ou organique et de fumier sont soient recyclés ou
réutilisés par ces derniers. Ils sont tout de même
concurrencés par les producteurs de Rainforest Alliance qui eux
recyclent plus la matière inorganique.
Ce chapitre avait pour objectif de présenter le cadre
conceptuel sur l'évaluation l'impact de la certification. Il ressorte
de cette analyse que L'impact d'un projet ou d'un programme est défini
comme l'ensemble des changements intervenu dans les conditions de vie des
participants, tels qu'eux-mêmes et leurs partenaires perçoivent au
moment de l'évaluation, ainsi que tout changement durable dans leur
environnement, auquel le projet ou le programme a contribué. Ainsi,
plusieurs approches d'évaluation d'impact peuvent être mise en
exergue : l'approche « avant et après »
et celle « avec/ sans » ; l'approche dite «
naïve » ; l'approche
« expérimentale » et l'approche « non
expérimentale ». Dans la revue empirique, nous avons
constaté qu'il y'a un large débat sur les impacts des standards
de durabilité sur les producteur. Notre étude contribue donc
à élargir d'avantage la littérature sur ce champ
d'activité.
CHAPITRE II :
ANALYSE EMPIRIQUE DE L'IMPACT DE
LA CERTIFICATION AUTOUR DE LA RESERVE DU DJA
Dans ce chapitre, nous présenterons en (II.1) notre
méthodologie de collecte des données et en (II.2) nous
évaluerons l'impact socioéconomique de la certification
Rainforest Alliance
1.1.7 II.1. MÉTHODOLOGIE DE
COLLECTE ET D'ANALYSE DE DONNÉES
Dans cette section, nous présenterons successivement la
zone d'étude, la démarche méthodologique et enfin la
méthode d'analyse.
1.1.8 II.1.1. Présentation de la
zone d'étude
Notre étude s'est déroulée à l'Est
du Cameroun dans le département HAUT NYONG précisément
dans l'arrondissement de MESSAMENA. Le choix de cette localité se
justifie par la forte production de cacao dans cette zone mais également
par la présence d'une antenne de notre Structure d'accueil la
TROPICAL FOREST AND RURAL DEVELOPMENT qui y intervient depuis
2003.

Figure 2: Localisation de la zone d'étude
- Présentation du milieu physique
Le relief de la commune de Messamena dans son ensemble est
très peu accidenté. Il est caractérisé par des
faibles collines, drainant d'énormes quantités d'eau de
ruissellement en saison de pluies, ce qui a pour résultat la formation
des cours d'eau dans les vallées.
Le climat de la Commune de Messamena est calqué au type
équatorial avec des températures moyennes pouvant aller
jusqu'à 30°C. Il est caractérisé par :
- Une petite saison de pluie qui va de Mars à Juin
- Une petite saison sèche qui va de Juillet à
Août
- Une grande saison de pluies qui va d'Août à
mi-novembre
- Une grande saison sèche allant de mi-novembre
à mi-mars.
La commune est située dans une zone
agro-écologique de forêt dense. La formation
végétale que l'on rencontre est la forêt équatoriale
de type sempervirente constituée par endroit des quelques poches de
savane arbustive et arborée à
AnnonasenegalensisetBrideliaferruginea, des jachères
à ChromelinaOdoata et de forêt secondaire. Toutefois, les
conditions édaphiques jouent un rôle important dans la
répartition des groupements végétaux.
Le régime des fleuves et des rivières de la
commune de MESAMENA est très dense. Le principal fleuve est le Nyong.
Par ailleurs, on note les fleuves Long Mafok, Léhé, Mpomo et bien
d'autres. Le réseau hydrographique est marqué par des nombreux
lacs et des marécages. Ces cours d'eau sont très riches en
poissons d'eau douce.
Le sol de la commune de Messamena appartient à la zone
de forêt dense humide. De ce fait, la chaleur et l'humidité
alternent et facilite la décomposition de l'humus sur plusieurs
profondeurs. Il en résulte que des sols ferralitiques sont très
épais, de couleurs rouges ou jaunes parfois belges à pH acide.
Par endroit, il se présente sous-forme argilo-sableux. La
perméabilité de ces sols leur confère une
fertilité, raison pour laquelle les cultures vivrières et de
rentes sont favorables. Leur étendue ou importance économique
joue un rôle prépondérant.
La flore de la commune de Messamena est riche en
espèces. Cependant, elle subit sans cesse une déforestation et
d'autres actions anthropiques liées à l'habitat, aux besoins
alimentaires, à la pression de la poussée démographique et
à l'expansion des activités agricoles. La flore de Messamena
présente un intérêt économique varié. On y
trouve des espèces médicinales, des produits forestiers non
ligneux (PFNL) et à bois d'oeuvre, ce qui explique la présence de
nombreuses sociétés forestières dans la
localité.
La population récolte et collecte des produits
forestiers non ligneux tels que : le Djangsang
(Ricinodendronheudoloti), les mangues sauvages
(Ivingiagabonensis), le bita kola (Garcinia kola), le cola des singes
(Coula edulise).La faune est constituée des animaux tels que :
le Rat, les chauves -souris, la biche, les serpents boa, le Lièvre, la
vipère, le hérisson, l'antilope, le porc-épic, le varan,
la taupe, le sanglier, le Paresseux, la Tortue, le Serpent noir, des Singes, le
Chimpanzé et le gorille, la volaille. Beaucoup de ces animaux sont
déjà en voie de disparition.
La plupart des rivières et des fleuves sont poissonneux
et la population riveraine pratique de la pêche traditionnelle pour
capturer des espèces telles : les silures, les crabes, les
tachetés destinées à l'autoconsommation.
- Activités économiques
C'est l'activité la plus importante, du point de vue de
la proportion des populations qui la pratiquent (près de 80% de la
population) et de sa contribution est relative par rapport aux revenus des
ménages. Les populations font essentiellement une agriculture
itinérante sur brûlis dans les jachères vieilles de deux
à trois ans. Malgré l'abondance des terres, les habitudes et les
techniques culturales sont demeurées les mêmes c'est-à-dire
traditionnelles voire rudimentaires. Ces pratiques rendent ainsi la
productivité et le niveau de revenus des populations très faible.
C'est une agriculture destinée en grande partie à l'auto
consommation, caractérisée par une diversité des
spéculations ; les produits de rente (le cacao, le café, le
palmier à huile) et les produits vivriers (.les arachides, le maïs,
le manioc, la banane plantain, le macabo).L'absence des pistes de collecte, le
mauvais état des routes ne permettent pas un écoulement et une
commercialisation facile de ces produits vivriers et de rente pour
améliorer le revenu des producteurs.
L'élevage n'est pas beaucoup pratiqué et demeure
traditionnel. Les espèces élevées sont : les poules, les
porcs, les chèvres, les moutons. La plupart de ces animaux vivent en
divagation Ils sont principalement destinés à l'autoconsommation
et quelques-uns à la commercialisation.
Elle se fait dans tout l'espace communal au mépris des
textes en vigueur au Cameroun. Malgré la présence des postes de
contrôle de la faune et de la flore, on trouve dans le marché
local la commercialisation du gibier tel que (la biche, pangolin, le singe,
sanglier, lièvres, porc épique). Les moyens utilisés pour
la chasse sont : les pièges, les armes à feux, les lances et les
chiens.
Elle a lieu dans les cours d'eau qui arrosent la Commune de
Messamena. Mais le fleuve Nyong reste la zone de prédilection des grands
pêcheurs. Elle se fait à tout moment de l'année et les
techniques de pêche couramment utilisées sont : filets, barrage,
nasse, ligne. Les espèces pêchées sont les silures, les
tilapias, les capitaines, les carpes. La population y tire de nombreuses
sources de revenus. Elle se limite à la récolte des fruits
d'arbres tels que ; la papaye, le citron, les oranges, les safouts, les mangues
et au ramassage des mangues sauvages, de diverses kola, le Ndjangsang,
(Ricinodendronheudoloti), la cueillette du vin de palme.
L'activité artisanale est constituée de la
menuiserie, la couture, la vannerie, la fabrication des meubles en rotin et en
bambou de raphia. La demande des produits artisanaux est importante mais la
production est faible à cause du nombre réduits d'artisans.
La Commune de Messamena comme la plupart des Communes du
Cameroun est dominée par un secteur informel. Sur le plan industriel, il
y a quelques industries ambulantes de bois exercent leurs activités
d'exploitation forestière dans l'espace Communal. Il s'agit de la
transformation du manioc en bâton ou du manioc et du maïs en
farine.
Les populations de la Commune de Messamena font dans le petit
commerce en détail, dominé par la vente des vivres, des produits
de rente (cacao, café) et pour des produits manufacturés, leur
vente est dominée par les ressortissants de l'Ouest et les Camerounais
détenteurs des boutiques du centre-ville et des villages. Le
marché est alimenté en produits vivriers en provenance des
villages. Les grandes quantités convergent vers Bertoua et
Yaoundé. Les lieux de ravitaillement en produit manufacturés sont
Yaoundé, Abong-Mbang et Bertoua.
1.1.9 II.1.2. Processus de collecte et
d'analyse des données :
- Technique d'échantillonnage
Notre étude à pour cible la commune de Messamena
donc la population est estimée à 32.282 habitants ( (CVUC) .
Sur les 86 villages que comporte cette commune, nous avons
porté notre intérêt sur 25d'entre eux (voir tableau 1) ce
en raison de la forte activité de production cacaoyère et de la
présence de la certification Rainforest alliance dans cette zone.
Tableau 1 : Présentation de la taille de
l'échantillon par village
|
Villages
|
Nombre de producteurs enquêtés
|
Nombre de producteurs certifiés
|
Nombre de producteur non certifiés
|
|
Doumo pierre
|
4
|
2
|
2
|
|
Mimpalla
|
2
|
1
|
1
|
|
Malen V
|
7
|
4
|
3
|
|
Ntibonkeuh
|
6
|
2
|
4
|
|
Kabilone
|
3
|
2
|
1
|
|
Medjoh
|
5
|
2
|
3
|
|
Ngoulminanga
|
3
|
1
|
2
|
|
Kompia
|
2
|
1
|
1
|
|
Malen III
|
3
|
1
|
2
|
|
Nemeyong
|
3
|
1
|
2
|
|
Madjuih II
|
3
|
2
|
1
|
|
Malen II
|
3
|
2
|
1
|
|
Bibom
|
2
|
0
|
2
|
|
Essiembot
|
1
|
0
|
1
|
|
Ntoumzock
|
4
|
2
|
2
|
|
Bellay
|
5
|
4
|
1
|
|
Madjuih I
|
11
|
3
|
8
|
|
Doumo Mama
|
8
|
3
|
5
|
|
Eko'o
|
4
|
2
|
2
|
|
Ndjolé mpoum
|
1
|
0
|
1
|
|
Mboumo
|
6
|
3
|
3
|
|
Palisco
|
4
|
2
|
2
|
|
Nkonzuh
|
2
|
0
|
2
|
|
Nkoul
|
2
|
1
|
1
|
|
Bitsil
|
4
|
3
|
1
|
|
Lamakara
|
1
|
0
|
1
|
|
TOTAL
|
100
|
44
|
56
|
Source : données d'enquêtes2015
Des lors, nous avons reçu de la coopérative des
producteurs de cacao présente dans la zone une liste des producteurs
engagé dans le processus de certification et ceux n'étant pas,
et à base de celle-ci nous avons utilisé la technique
d'échantillonnage systématique. Cette technique nous a permis
d'avoir un échantillon dans chaque village.
- Élaboration du questionnaire
En fonction de la nature de notre hypothèse, notre
questionnaire s'adressait principalement à deux catégories
d'acteurs :
Les producteurs de cacao ayant adhéré
volontairement au processus de certification Rainforest Alliance et les
producteurs n'ayant pas fait cette expérience. Notre questionnaire
traite des termes suivants :
Le premier est relatif aux caractéristiques
socio démographiques, car il s'agissait de recenser les
producteurs et les représentants de coopérative avec leur
âge, niveau d'instruction, ethnie et date d'arrivée au village
s'il n'est pas autochtone. .
Le troisième est relative au système
de production des producteurs, et les principales données
collectées se rapportent à la taille de la plantation, au
foncier, les techniques agricoles utilisées et au capital productif.
Le quatrième concerne la vie sociale et
économique. A ce niveau nous nous sommes
intéressés à l'avantage que retirent la coopérative
et les producteurs de l'adoption de la certification. Les données
collectées incluent donc l'appréciation des revenus,
infrastructures sociales bénéficiées, l'emploi
généré et la scolarisation des enfants.
La cinquième et sixième sections concernent
respectivement la dynamique environnementale. Chaque
section des questionnaires est utile à une meilleure
compréhension du contexte et tend à tester les hypothèses
développées
- Réalisation des enquêtes
Au cours de nos entretiens avec les différents acteurs,
La méthode d'enquête utilisée a été
l'entretien semi-directif qui est une technique
fréquemment utilisée dans le milieu. La durée des
entretiens variait entre 30 à 45 minutes et était fonction des
réponses fournies par l'enquêté et de l'orientation prise
par la conversation. Nous avons questionné les producteurs de cacao dans
chacun des différents villages en fonction de leur disponibilité
lors de notre passage dans lesdits villages. Ne se limitant pas seulement
à des simples entretiens, il était important que nous fassions
une visite des plantations de chaque producteurs afin de prendre leur position
géographique et d'observer l'application ou non de certains
critères des standards durables ,mais aussi de pouvoir faire une
comparaison des pratiques agricoles entre les plantations certifiées et
les plantations non certifiées. Durant cette périodes
j'étais accompagné d'un facilitateur de terrain qui en cas de non
compréhension des questions par les différents producteurs
m'aidait à mieux leur expliquer. Ces enquêtes se sont
effectuées pendant deux semaines et ont consisté à
administrer le questionnaire de type qualitatif auprès de 100
producteurs donc 50 membres d'une coopérative certifiées et 50
autres appartenant ou pas à des coopérative mais non
certifié. Compte tenu de l'importance de l'organisation des producteurs
dans le processus de certification, Nous avons également
enquêté la coopérative représentée par le
président qui a volontiers accepté de nous fournir les
informations dont on avait besoin.
- Recherche bibliographique
La recherche bibliographique marque une étape
importante dans la recherche. Elle permet de mieux comprendre le sujet afin de
cerner avec brio toutes les étapes nécessaires pour son
élaboration .Notre recherche bibliographique s'est faite pendant 1 mois
et a consister à rassembler les informations en ce qui concerne la
filière cacao dans le monde de manière générale et
au Cameroun en particulier. Elle a également consisté à
approfondir notre connaissance sur les standards durables afin de cerner, et de
mieux maitriser le sujet. Nous avons sélectionné dans un premier
temps toutes les études qui traitent de l'impact des programmes de
certification dans le secteur cacaoyer ainsi que toutes les études
similaires menées dans le secteur du café et autres produits de
base agricoles tropicaux le cas échéant. Les études
retenues, ont répondu aux critères ci-dessous :
- Elles examinent l'impact des standards de certification
actuels dans le secteur du cacao et du chocolat, tels que ceux liés
à Rainforest Alliance, UtzCertified, au commerce équitable,
à l'agriculture biologique et à tout autre système de
certification s'appliquant au secteur du cacao/chocolat et tous autres produits
de base agricoles tropicaux ;
- Elles mettent l'accent sur l'identification des impacts
socio-économiques et environnementaux de la certification (et non sur
les aspects de description des normes)
- Elles présentent les résultats d'études
empiriques issues d'évaluation ex-post réalisées sur le
terrain, et non des résultats basés sur des simulations
ex-ante.
- Elles reposent sur des méthodes d'évaluation
d'impact rigoureuses établissant les liens de causes à effets
entre les intrants, produits, résultats et impacts des programmes de
certification. Ainsi, hors mis les articles, plusieurs documents sur le
terrain ont permis de mieux cerner le sujet. (Le business plan de la
coopérative ; le plan d'action annuel ; et les rapports
d'audits).
- Méthodes
d'analyse des données
Compte tenu de notre démarche méthodologie et de
la qualité des données collectée, La méthode
d'analyse utilisée dans cette première partie est la
méthode de différences simple dite latitudinale encore
appelée l'approche « avec ou
sans ».
L'approche « avec et sans »
innovationSCHERR, S . et al (1991) consiste à diviser le groupe cible
potentiel en deux groupes. Un sous-groupe reçoit l'innovation ou la
technologie et l'autre n'en reçoivent pas. Au bout d'un certain moment
donné, on procède à la comparaison entre les deux
sous-groupes.
Cette méthode présente l'avantage d'isoler les
effets liés aux facteurs exogènes qui pourraient survenir au
cours de l'adoption de la technologie comme par exemple l'inflation, la
pluviométrie, les catastrophes naturelles, les politiques
économiques et agricoles, etc. et de réduire les biais
causés par la méthode « avant et
après » (opcit).
Cependant, le problème avec cette méthode
réside dans la difficulté à trouver des
échantillons de paysans suffisamment semblables de telle sorte que c'est
seulement l'adoption ou non de l'innovation qui les différencie.
- Traitement des données
Les données recueillies sur le terrain ont
été entrée dans une base Excel et son analyse reste
qualitative. Ainsi afin de vérifier notre hypothèse de recherche,
l'utilisation des outils de la statistique descriptive s'avère
nécessaire afin d'arriver à des résultats cohérant
et appréciables. La statistique descriptive permet une description
appuyée par des chiffres et des graphiques de la situation grâce
aux données récoltées auprès des planteurs.
L'analyse descriptive permet dans cette étude de décrire les
impacts socioéconomiques de la certification Rainforest Alliance.
1.1.10 II.2. IMPACT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ET ENVIRONNEMENTAL DE LA CERTIFICATION
RAINFOREST
Cette partie est consacrée à la description des
résultats de notre travail de terrain qui porte sur l'impact
socio-économique de la certification Rainforest Alliance sur les petits
producteurs de cacao autour de la réserve de biosphère du Dja.
Nous présenterons donc tour à tour, l'impact de
la certification sur le revenu des producteurs sur la production et les prix
dans un premier temps. Dans un second temps, nous analysons son impact social
et environnemental.
1.1.11 II.2.1. Impact
économique de la certification Rainforest Alliance
Nous allons apprécier l'impact sur le revenu et les prix
ainsi que l'impact sur la production
Impact sur le revenu et
les prix :
Les résultats de notre travail montrent que l'effet de
la certification Rainforest Alliance sur le revenu total des producteurs
l'ayant adopté semble plutôt positif en raison de la pratique des
prix supérieurs.
Tableau 2:Comparaison des
revenus moyens des producteurs étant dans le processus de certification
et ceux n'étant pas
|
Quel est votre revenu moyen annuel ?
|
|
Etes-vous dans le processus de certification ?
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
Pourcentage valide
|
Pourcentage cumulé
|
|
Manquante
|
Système manquant
|
1
|
100,0
|
|
|
|
Non
|
Valide
|
entre 50000 et 100000
|
23
|
41,1
|
41,1
|
41,1
|
|
plus de 100 000
|
33
|
58,9
|
58,9
|
100,0
|
|
Total
|
56
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Oui
|
Valide
|
entre 50000 et 100000
|
10
|
22,7
|
22,7
|
22,7
|
|
plus de 100 000
|
34
|
77,3
|
77,3
|
100,0
|
|
Total
|
44
|
100,0
|
100,0
|
|
Source : Données d'enquêtes 2015
Ainsi, selon les données recueillies lors de notre
enquête, 77,3% des producteurs étant dans le processus de
certification affirment avoir un revenu supérieur à 100.000
franc CFA contre 58.9% des producteurs n'étant pas dans le processus.
Cette différence se justifie par des prix plus élevé qui
résulte des conseils prodigués pour un accroissement de la
production.
Tableau 3: Description de
la source de revenu des producteurs dans le processus de certification
|
Quelle est votre principale source de revenu ?a
|
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
Pourcentage valide
|
Pourcentage cumulé
|
|
Valide
|
Cacao
|
35
|
79,5
|
79,5
|
79,5
|
|
Café
|
2
|
4,5
|
4,5
|
84,1
|
|
Commerce
|
1
|
2,3
|
2,3
|
86,4
|
|
Maçonnerie
|
1
|
2,3
|
2,3
|
88,6
|
|
Moto
|
1
|
2,3
|
2,3
|
90,9
|
|
Palmier
|
1
|
2,3
|
2,3
|
93,2
|
|
Pèche
|
1
|
2,3
|
2,3
|
95,5
|
|
Pension
|
1
|
2,3
|
2,3
|
97,7
|
|
Vin
|
1
|
2,3
|
2,3
|
100,0
|
|
Total
|
44
|
100,0
|
100,0
|
|
a Etes-vous dans le processus de certification ? =
oui
Source : données d'enquêtes
De plus les producteurs étant dans le processus de
certification affirment que 79% de leur revenu provient du cacao contre 82,1%
chez les producteurs n'étant pas dans le processus.
Tableau 4:Description de
la source de revenu des producteurs n'étant pas dans le processus de
certification
|
Quelle est votre principale source de revenu ?a
|
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
Pourcentage valide
|
Pourcentage cumulé
|
|
Valide
|
Cacao
|
46
|
82,1
|
82,1
|
82,1
|
|
Café
|
1
|
1,8
|
1,8
|
83,9
|
|
Chasse
|
4
|
7,1
|
7,1
|
91,1
|
|
Elevage
|
1
|
1,8
|
1,8
|
92,9
|
|
Macabo
|
1
|
1,8
|
1,8
|
94,6
|
|
Menuisee
|
1
|
1,8
|
1,8
|
96,4
|
|
Salaire
|
1
|
1,8
|
1,8
|
98,2
|
|
Vin
|
1
|
1,8
|
1,8
|
100,0
|
|
Total
|
56
|
100,0
|
100,0
|
|
a Etes-vous dans le processus de certification ? =
oui
Source : données d'enquêtes
Ces résultats confirment la théorie
économiques selon laquelle, le producteur revoit ses prix à la
hausse en fonction de l'évolution croissante de la qualité de ses
produits qui induisent des coûts additionnels, en fonction de
l'augmentation de la demande au cas où ses capacités de
production serait saturée et aussi compte tenu des tendances
haussière du marché.
L'optimisation des revenus est l'un des avantages tirés
par les producteurs de cacao suite à leur entrée dans le
processus de certification Rainforest Alliance. En effet, avant la
certification, les producteurs se contentaient du prix du marché. Il n'y
avait pas de différenciation de produits par une différence de
prix entre les qualités car tous avaient une mémé
façon de produire leur cacao. L'introduction des certifications sur le
marché du cacao est à l'origine de pratiques concurrentielles
qui visent l'amélioration de la qualité de la production et
l'accroissement des gains subséquents. Avec l'adoption de la
certification, les producteurs de cacao doivent désormais faire des
choix de production. Ainsi, l'adoption est volontaire. Chaque producteur doit
désormais faire le choix qui lui convient : produire du cacao
certifié pour avoir un prix élevé et accroitre son revenu
de facto ou bien continuer à faire du cacao conventionnel.
Tableau 5 : Prix du cacao
selon que le producteur de cacao soit certifié ou non
|
A combien vendez-vous votre cacao ?
|
|
êtes-vous dans le processus de certification ?
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
Pourcentage valide
|
Pourcentage cumulé
|
|
Manquante
|
Système manquant
|
1
|
100,0
|
|
|
|
Non
|
Valide
|
1000
|
56
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Oui
|
Valide
|
1350
|
44
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Source : Données d'enquêtes
Il ressort donc clairement que les producteurs qui sont dans
le processus de certification ont un prix plus élevé que ceux qui
ne le sont pas. Avec respectivement 1350frs chez les producteurs
certifiés contre 1000 frs chez les non certifié.

Figure 3:Possession des
parcelles certifiées et des parcelles non certifiées
Source : Données d'enquêtes
Cependant, malgré l'adoption de la certification
Rainforest, il est à noter que, 65% des producteurs certifiés
possèdent encore des parcelles non certifiées. Cette statistique
nous montre que, bien que concurrencée par la production du cacao
certifié qui semble bien plus lucrative, la production du cacao
conventionnel occupe encore une place non négligeable sur le
marché du cacao dans notre zone d'étude.
Impact sur la
production :
Les données dont nous disposons ne nous permettent pas
de faire une étude d'impact de la certification sur la production en
mettant en comparaison les producteurs certifiés et les non
certifiés. En effet, le niveau de production d'une plantation
dépend à la fois de son âge, de son traitement
phytosanitaire, des engrais utilisés et des pratiques agricoles
adoptées. Pour avoir une étude fiable, il faut trouver un
échantillonnage où la plantation des certifiés a le
même âge que la plantation des non certifiés. En effet, la
plantation atteint sa productivité maximale entre 08 et 12 ans
d'existence YOUSSOUPHA N'DAO, (2012).
Toutefois, on donne une comparaison des rendements par hectare
des producteurs certifiés et des producteurs non certifiés dans
notre zone d'étude, la région de l'Est, plus
précisément dans l'arrondissement de Messamena.

Figure 4: Rendement moyen
des producteurs qui sont dans le processus de certification
Source : Données d'enquêtes 2015

Figure 5:Rendement moyen
des producteurs n'étant pas dans le processus de certification
Source : Données d'enquêtes 2015
Le rendement moyen des producteurs certifiés tourne
autour de 249 kg/ha. Par contre celui des non certifiés tourne autour
est 113 kg /ha. Cette différence entre les certifiés et les non
certifiés est non significative. Ceci se justifie par le fait
qu'étant donné que le processus de certification dure 3ans ces
derniers (dans le processus de certification) ne sont qu'à leur
deuxième année.
1.1.12 II.2.2.
Impact social et environnemental
Dans cette partie, nous traitons l'impact social et
environnemental lié à l'adoption de la certification Rainforest
Alliance chez les petits producteurs de cacao à la
périphérie de la réserve du Dja.
Impact
social :
Dans la plupart des pays africains producteurs de cacao tels
que le Cameroun, les petits producteurs de cacao ne bénéficiaient
pas d'une véritable politique sociale coordonnée en leur faveur.
Désormais, avec les standards de Rainforest Alliance, l'adoption du
projet de certification a considérablement révolutionné
cet état de délaissement et de non prise en charge de cette
catégorie de producteurs.
- Impact sur l'éducation
Après la vaste campagne médiatique des
Occidentaux destinée à lutter contre le travail des enfants dans
les plantations de cacao, le standard RA a introduit des critères qui
interdisent ce travail. Un enfant pouvait aider ses parents dans les
plantations avant le projet de certification. Avec ce projet, le standard
Rainforest Alliance mène une autre campagne de sensibilisation
contre le travail des enfants. En effet, selon le standard RA, la place de
l'enfant, c'est à l'école et non dans les plantations.
Avec les principes de RA on encourage désormais les
planteurs à scolariser leurs enfants au moins jusqu'à l'âge
de 16 ans. Dans cette zone, à partir de 16 ans, une personne peut se
marier et gérer une plantation. On considère également
qu'à cet âge, il peut déjà entretenir une plantation
cacaoyère.
À la question vos enfants vont-ils à
l'école ? Il apparait que les enfants des producteurs
certifiés et non certifiés vont tous à l'école. Sur
le plan de l'éducation, il n'y a pas de différence significative
entre les producteurs certifiés et ceux non certifiés.
Tableau 6 :Niveau
d'éducation des producteurs des cacaos certifiés et non
certifiés
|
quel est votre niveau d'éducation ?
|
|
êtes-vous dans le processus de certification ?
|
Effectifs
|
Pourcentage
|
Pourcentage valide
|
Pourcentage cumulé
|
|
Valide
|
|
1
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
Non
|
Valide
|
pas été à l'école
|
3
|
5,4
|
5,4
|
5,4
|
|
CEP
|
53
|
94,6
|
94,6
|
100,0
|
|
Total
|
56
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Oui
|
Valide
|
pas été à l'école
|
5
|
11,4
|
11,4
|
11,4
|
|
CEP
|
33
|
75,0
|
75,0
|
86,4
|
|
BEPC
|
3
|
6,8
|
6,8
|
93,2
|
|
probatoire
|
3
|
6,8
|
6,8
|
100,0
|
|
Total
|
44
|
100,0
|
100,0
|
|
Source : Données d'enquêtes 2015
Il apparait également que la plupart des producteurs de
cacao n'ont pas dépassé le niveau du CM2.
- Impact sur la santé
Avec la certification Rainforest Alliance, les
producteurs étant dans le processus de certification commencent
à se soucier plus des règles sanitaires. En effet les standards
de Rainforest Alliance recommandent la construction des trous et des fosses
pour la gestion des eaux usées et des déchets solides
ménagers.
Figure 6:Trou servant à la
gestion des eaux usées ménagers

Source : l'Auteur
Ces fosses sont construites dans les cours des
habitats et consistent à évacuer toutes les eaux issues des
différentes tâches domestiques. Cette recommandation contribue
à l'amélioration de la qualité de vie des producteurs
notamment à la propreté des cours (voir Figure 6).
Désormais la propreté et la sécurité des
producteurs de cacao sont tenues en compte dans le processus de
traçabilité. L'application de cette recommandation n'est pas
encore totalement adoptée, mais semble améliorer le niveau de
propreté des producteurs dans leur cadre de vie réduisant ainsi
la vulnérabilité face à certaines maladies sanitaires.
Impact environnemental :
La particularité du standard Rainforest Alliance est la
préservation de l'environnement. L'essentiel des 10 principes de ce
standard est axé sur l'application des normes environnementales.
Cependant, l'impact environnemental de notre étude est très
difficile à déterminer avec notre méthodologie. En effet,
les producteurs certifiés enquêtés ont du mal à
sentir dès à présent, l'impact de la certification sur
l'environnement. Cela peut-être senti dans les années à
venir car c'est trop tôt selon eux pour sentir réellement l'impact
de la certification.YOUSSOUPHA N'DAO, (2012)
Le standard RA a prôné l'application de nouvelles
pratiques agricoles destinés à favoriser la préservation
de l'environnement.
On peut citer :
- interdiction de défricher les forêts
classées,
- ne pas pulvériser de façon excessive,
- arrêter les feux de brousses,
- ne pas faire la chasse dans les plantations,
- faire des zones tampons dans la plantation (pour indiquer
à l'applicateur les zones sensibles à ne pas traiter pour ne pas
intoxiquer les passants sur les routes ou les rivières),
- ne pas brûler les résidus après
défrichement dans les plantations. A long terme, l'application totale de
ces différentes pratiques, si elles sont bien respectées,
pourraient avoir des effets.
Cette partie avait pour
objectif d'évaluer les avantages liés à la certification
Rainforest Alliance sur les petits producteurs de cacao autour de la
réserve de biosphère du Dja (Est Cameroun). L'étude a
été conduite auprès de 100 producteurs de cacao dans la
région de l'Est Cameroun Parmi lesquels 44 d'entre eux sont à la
deuxième année du processus de certification. A cet effet,
l'utilisation d'un tableur Excel nous a permis d'analyser les données.
Les résultats montrent que la certification semble
avoir des effets positifs sur la production (avec des rendements moyens de
249kg /hectares chez les producteurs étant dans le processus de
certification contre 113kg /hectares chez ceux n'étant pas). Toutefois,
ces résultats ne nous permettent pas de conclure sur les impacts
environnementaux.
DEUXIÈME PARTIE :
ANALYSE DES DÉTERMINANTS
DE L'ADOPTION DE LA CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE
Plusieurs changements sont survenus au cours des
dernières décennies. La Société, l'économie,
la politique, le sport, et d'autres domaines ont subi des changements profonds
tout au long du XXe siècle. Parmi ces changements, les plus importants
sont ceux qui sont liés aux chaînes agro-industrielles, mettant en
évidence la production croissante et la consommation d'aliments
certifiés, le cacao étant l'un d'entre eux. La consommation
alimentaire qui répond à des critères sociaux et
environnementaux de production est une tendance récente BARBOSA et al.
(2010). Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par
l'origine de leur nourriture. Ils veulent savoir qui l'a produit, si
l'environnement a été respecté tout au long du processus
de production, si les travailleurs ont reçu un salaire équitable
pour leur travail. Ils ont une préoccupation légitime pour la
durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les
principaux standards de certification du cacao ont un ensemble de
critères environnementaux, économiques et sociaux, et leur
degré varie selon l'organisme de certification. Ces critères,
exigences économiques, la résilience environnementale et
l'équité sociale sont les piliers de la durabilité. Pour
le producteur, avoir une certification peut garantir l'accès à de
nouveaux marchés ou assurer un meilleur prix pour son produit. La
certification permet donc au producteur de différencier son produit, qui
commence à être vendus en dehors du circuit traditionnel. Soutenu
par le statut que les certifications ont de nos jours et les
opportunités offertes aux producteurs, cette partie vise à
contribuer à la compréhension des facteurs qui déterminent
l'adoption des innovations, plus précisément l'adoption de la
certification Rainforest alliance par les petits producteurs de cacao autour de
la réserve de biosphère du Dja.
Cette partie sera structurée en deux chapitres :
nous présenterons au chapitre III l'analyse théorique des
déterminants de l'adoption des innovations agricoles ensuite, et au
chapitre 4 nous présenterons les déterminants de l'adoption de la
certification Rainforest Alliance autour du Dja.
CHAPITRE III :
ANALYSE THÉORIQUE DES
DÉTERMINANTS DE L'ADOPTION DES INNOVATIONS AGRICOLES
Alors que les travaux sur l'adoption des innovations agricoles
focalisent sur ses déterminants,les travaux sur la diffusion des
innovations environnementales décrivent le taux de
pénétration de l'innovation sur son marché potentiel. Ce
chapitre présente à cet effet les différents concepts
clés utilisé dans le document ainsi que la présentation de
la théorie développé dans la littérature pour
aborder les divers aspects du thème. Ainsi, nous passerons en revue
l'analyse théorique des déterminantes d'adoption des innovations
agricoles en (III.1), ensuite nous présenterons en (III.2) la revue de
la littérature sur les déterminants de l'adoption des innovations
agricoles.
1.1.13 III.1. ANALYSE THEORIQUES DE L'ADOPTION DES
INNOVATIONS AGRICOLES
Dans cette section nous définirons un certain nombre de
concepts avant de présenter la théorie.
1.1.14 III.1.1. Définition de quelques concepts
- Innovation
Une innovation est une idée, une pratique ou un objet
qui est perçue comme nouveaux par un individu ou tout autre unité
d'adoptionROGERS, EVERETT M, (1983). Peu importe si oui ou non l'idée
est objectivement nouvelle par rapport au lapse de temps depuis son premier
usage ou sa découverte. La perception de nouveauté de
l'idée pour l'individu détermine sa réaction par rapport
à elle. Si l'idée semble nouvelle pour l'individu, alors il
s'agit d'une innovation.
- Diffusion
La diffusion est le processus par lequel une innovation est
communiquée à travers certains canaux au fil du temps au sein des
membres d'un système social ROGERS, EVERETT M, (1962). C'est un type
spécial de communication dans lequel les messages incluent des nouvelles
idées. Ce sont ces nouvelles idées contenues dans le message de
communication qui donnent à la diffusion un caractère
spécial.
Selon Rogers (1983), la diffusion est un type de changement
social défini comme le processus par lequel une altération
apparait dans la structure et la fonction d'un système social. Lorsque
certaines idées sont inventées diffusées et
adoptées ou rejetées, aboutissant à certaines
conséquences, le changement social apparait.
- Adoption
L'adoption d'une innovation peut être définie
comme le processus mental par lequel un individu passe de la première
information à propos de l'innovation à son adoption finaleROGERS,
EVERETT M, (1983). Cette définition parait incomplète pour
plusieurs raison :
D'une part il est important de distinguer l'adoption au niveau
de l'individu et de l'adoption à grande échelle telle que au
niveau villageFEDER, (1985). Pour cet auteur, l'adoption au niveau individuel
est définie comme le degré d'utilisation de la technologie par
l'individu après qu'il a reçu des multiples informations sur la
technologie et de ses performances. L'adoption au niveau macro se
réfère à l'ampleur de la diffusion dans la
régionFEDER, (1985).
Il faut également souligner que l'adoption varie en
fonction des types innovations. Les innovations agricoles sont majoritairement
les paquets technologiques qui regroupent plusieurs technologies
complémentaires.
1.1.15 III.1.2. Les modèles d'adoption et de diffusion
des innovations
L'innovation s'accompagne souvent de deux processus à
savoir le processus de diffusion et celui d'adoption. Rogers distingue ces deux
notions en précisant que la diffusion s'observe au sein d'une
société alors que l'adoption se limite au niveau individuel. Il
définit alors la diffusion comme le processus par lequel une innovation
est communiquée par le biais de certains canaux au fil du temps au sein
des membres d'une société. Pour cet auteur, l'adoption d'une
innovation peut être définie comme le processus mental par lequel
un individu passe de la première information à propos de
l'innovation à son adoption finale. Cette dernière
définition parait incomplète pour plusieurs raisons.
D'une part, il important de distinguer l'adoption au niveau
individuel de l'adoption au niveau à grande échelle telle qu'au
niveau villageFEDER, (1985). Ces auteurs précisent donc que l'adoption
au niveau individuel est définie comme le degré d'utilisation de
la nouvelle technologie par le producteur après qu'il a reçu une
multitude d'informations à propos des technologies et de ses
performances. L'adoption au niveau macro se réfère à
l'ampleur de la diffusion dans la régionFEDER, (1985).
Quelques modèles d'adoption et de diffusion
d'innovations :
Trois principaux modèles sont à la base de la
plupart des études sur la diffusion et l'adoption des innovations
technologiques : le modèle de Bass (1969), le modèle de Rogers
(1962, 1971, 1986, 1995, 2003), et le modèle TAM Davis (1989). Dans ce
qui suit, nous allons les expliciter.
- Le Modèle de diffusion de Bass
Ce modèle traite de l'adoption et de la diffusion de
nouveaux produits et technologies. Il est souvent utilisé en marketing
comme base à une modélisation qui permettra la prise de
décision ou de se faire une meilleure idée de ce que sera le
lancement d'un nouveau produit. Formulé par Frank Bass en 1969 sous le
nom original '' un modèle de croissance d'un nouveau produit pour
consommateurs durables `' ce modèle distingue deux comportements dans
l'adoption d'une innovation : le comportement
« innovateur » et le comportement
« imitateur ». Dans le premier cas, aucune influence des
précédents adopteurs n'est en jeux l'adoption est due à
l'influence des actions externes au système social. Les
« imitateurs », en Revenge adoptent l'innovation parce
qu'influencés par les personnes ayant déjà adopté
l'innovation. Bass postule donc qu'il existe deux types d'adopteurs qui sont
impulsés par deux types de forces : les innovateurs par la tendance
à innover « p » et les imitateurs par la tendance
à imiter « q ». « p » est
appelé le coefficient de communication externe ou d'innovation qui
traduit toute source d'information exogène, et
« q » est appelé coefficient de communication
interpersonnelle ou coefficient d'imitation qui traduit le bouche à
oreille.
Si on définit m le nombre total d'individus qui
potentiellement adopterons l'innovation (le marché potentiel) et N(t) le
nombre cumulé d'adopteurs au temps t, chacun des m-N(t) individus peux
passer du groupe de non-adopteurs à la classe d'adopteurs. Le
modèle de Bass essaie fondamentalement de modéliser le taux de
risque d'adoption Z(t) comme une fonction linéaire croissante du taux de
pénétration N(t)/m.

A partir du taux de risque d'adoption il est possible
d'exprimer l'augmentation temporelle du nombre total d'adopteurs par une
équation différentielle de la forme :

La courbe descriptive du nombre d'adopteurs N(t) est
sigmoïdale avec une saturation donnée par le potentiel d'adopteurs
m.
Cependant le modèle de Bass comporte quelques limites.
La première est que le modèle est influencé par la
durée de la période d'analyse utilisée. Lorsque l'on
augmente ou diminue la période donnée, les estimations des
paramètres sont alors portées à changer de façon
notoire. La deuxième limite est celle qui apparait lorsque l'on effectue
plusieurs régressions, le modèle est alors affecté par la
multi-colinéarité. Ainsi, les variables indépendantes
venant expliquer le modèle deviennent de plus en plus dépendantes
l'une de l'autre et il est alors plus difficile de distinguer leur effet
respectif. Finalement, la dernière critique formulée par les
auteurs est l'obligation d'obtenir des informations sur l'adoption lors du
lancement d'une innovation afin de pouvoir utiliser le modèle, ce qui
rend le modèle peu intéressant comme modèle de
prédiction du taux d'adoption : en effet, une fois le produit
lancé, il est trop tard pour reculer si les prédictions du
modèle se révèlent peu intéressantes.
La diffusion est le processus par lequel une innovation est
communiquée par certains canaux au fil du temps entre les membres d'un
système social. La diffusion est un type spécial de communication
concerné par la diffusion de messages qui sont perçus comme de
nouvelles idées. Une innovation est tout simplement, "une idée
perçue comme nouvelle par l'individu" .Les caractéristiques d'une
innovation, telle que perçue par les membres d'un système social,
déterminent son taux d'adoption. Les quatre principaux
éléments de la diffusion de nouvelles idées sont les
suivantes: L'innovation, Les canaux de communication, Temps et Le
système social (contexte).
- Le modèle de diffusion de Rogers
D'après les théories relatives à
l'innovation, une innovation se diffuse dans la société en
suivant un processus qui touche différentes catégorie de
consommateurs, des plus enthousiastes jusqu'aux plus réticents face
à la technologie.ROGERS, EVERETT M, (1983) a modélisé ce
processus par une courbe de diffusion (dite courbe en S ou courbe en cloche) en
y associant les différents profils de consommateurs correspondant aux
différentes phases du processus d'adoption. Le challenge étant
d'arriver à passer d'une diffusion confidentielle (innovateurs et
earlyadopters) à une diffusion de masse (majorité avancée
et retardée) qui représente plus de 60 % du marché
potentiel. PourROGERS, EVERETT M, (1962) plusieurs facteurs conditionnent la
rapidité d'adoption par les consommateurs et de diffusion de
l'innovation dans la société. Ces facteurs peuvent être de
deux natures différentes :
Les facteurs endogènes à l'innovation qui
résultent généralement des caractéristiques
intrinsèques du produit ou de la technologie.Les facteurs
endogènes correspondent aux caractéristiques intrinsèques
du produit ou service qui influencent la vitesse de diffusion de l'innovation.
Ils dépendent donc : de la qualité du produit et ses
caractéristiques techniques d'une part ; et de la pertinence du mix
marketing établi pour introduire le produit innovant sur le
marché d'autre part.Rogers a ainsi identifié cinq qualités
qui déterminent le succès de la diffusion d'une innovation, et
qui expliquent entre 49 et 87 % de la variation de l'adoption de nouveaux
produits.
La seconde catégorie de facteurs qui peuvent influencer
la diffusion d'une innovation sont les facteurs dit « exogènes
», c'est-à-dire qui ne sont pas liés à l'innovation
elle-même mais à l'environnement dans lequel elle s'insère.
Ces facteurs sont l'une des caractéristiques les plus marquantes des
industries de haute technologie et des technologies de l'information. En effet,
dans ces industries, l'environnement de l'innovation joue un rôle
décisif puisque la valeur globale de l'innovation augmente avec le
nombre d'utilisateurs ou le nombre de biens complémentaires
disponibles.Cette caractéristique est appelée « effet de
réseau ». On distingue deux types d'externalités de
réseau :
Les externalités directes, c'est-à-dire le fait
que le nombre d'utilisateur d'un bien ou service (appelé « base
installée ») augmente la valeur de celui-ci pour les utilisateurs
potentiels ;
Les externalités indirectes, correspondent au nombre de
biens complémentaires disponibles sur le marché (exemple : les
jeux vidéo pour une console de jeux) et augmente également la
valeur de l'innovation.
Ainsi, la valeur perçue d'une innovation par les
utilisateurs influence la vitesse à laquelle elle se diffusera dans la
société. Cette valeur dépend elle-même de facteurs
qui peuvent être endogènes à l'innovation (avantage
relatif, compatibilité avec les valeurs et pratiques existantes,
simplicité d'utilisation, possibilité de l'essayer et
visibilité des résultats), ou exogènes à
l'innovation (taille de la base installée et disponibilité de
biens complémentaires)
L'avantage relatif correspond à la perception par les
consommateurs que l'innovation est meilleure ou plus performante que les
solutions existantes. Cette « performance » est mesurée sur
les attributs de l'innovation qui compte pour les consommateurs comme le gain
financier ou le prestige social. Ce facteur et très lié à
la perception particulière et aux besoins de chaque groupe de
consommateurs.
La compatibilité de l'innovation avec les valeurs et
pratiques existantes des consommateurs potentiels influe également la
rapidité d'adoption d'une innovation. Elle correspond au degré
d'adéquation entre les valeurs et les pratiques des consommateurs
potentiels et celles nécessaires à l'utilisation de
l'innovation.
La simplicité et facilité d'utilisation de
l'innovation que perçoivent les consommateurs potentiels peut
également représenter un frein ou un catalyseur à sa
diffusion. En effet, une innovation qui nécessite un apprentissage sera
plus lente à se diffuser que si elle ne requiert pas le
développement de compétences spécifiques.
La possibilité d'essayer l'innovation peut faciliter
son appropriation par les usagers et ainsi favoriser le bouche à oreille
et diminue l'incertitude et donc le risque qui l'entoure.
L'observabilité des résultats est
également un facteur déterminant dans la diffusion des
innovations puisqu'il permet de prouver plus facilement le ou les avantages de
l'innovation. Des résultats visibles par les consommateurs potentiel
réduisent l'incertitude perçu et facilite le bouche à
oreille.
Certains auteurs critiquent ce modèle qui repose sur
une « vision positiviste de la technologie» et qui implique une
passivité chez les usagers qui doivent accepter l'innovation telle
quelle sans avoir le choix de la modifier. Rogers a cependant introduit la
notion de réinvention dans la troisième édition de son
livre, ce qui minimise grandement la critique de positivisme technologique.
D'autres auteurs introduisent des variantes au processus d'adoption et de
diffusion d'innovation. Par exemple, Silverstone et Haddon (1996) proposent
quant à eux le modèle de Domestication pour expliquer les phases
d'adoption d'un nouveau produit. Ce dernier viendrait surtout s'insérer
lors de la phase de décision du modèle de Rogers. Ce
modèle se base sur quatre dimensions, soit : l'appropriation, qui
désigne le processus durant lequel on prend possession d'un produit ou
qu'on se l'approprie; l'objectification, qui est le processus par lequel on
détermine le rôle joué par un produit; l'incorporation, qui
réfère au processus d'interaction avec le produit; l'inclusion,
qui est le processus par lequel on transforme
- Le modèle TAM ou modèle de l'action
raisonnée
DAVIS, et al, (1989)sont ceux qui ont développé
ce modèle (en anglais, Technology Acceptance Model) qui concerne plus
spécifiquement la prédiction de l'acceptabilité d'un
système d'information. Le but de ce modèle est de prédire
l'acceptabilité d'un outil et d'identifier les modifications qui doivent
être apportées au système afin de le rendre acceptable aux
utilisateurs. Ce modèle postule que l'acceptabilité d'un
système d'information est déterminée par deux
facteurs : la perception de l'utilité et la perception de la
facilité d'utilisation.
La perception de l'utilité est définie comme
étant le degré auquel une personne croit que l'utilisation d'un
système améliorera ses performances. La perception de la
facilité d'utilisation se réfère quant à elle au
degré auquel une personne croit que l'utilisation d'un système
sera dénuée d'efforts. Plusieurs analyses factorielles ont
démontré que la perception de l'utilité et la perception
de la facilité d'utilisation pouvaient être
considérés comme deux dimensions distinctesHAUSER, J. R et al,
(1980).
Comme dans la théorie de l'action raisonnée, le
modèle d'acceptation de la technologie postule que l'utilisation d'un
système d'information est déterminée par l'intention
comportementale mais stipule par contre que cette intention est
déterminée conjointement par l'attitude de la personne envers
l'utilisation du système et la perception de l'utilité. Ainsi,
selon Davis, l'attitude générale de l'individu face au
système ne serait pas la seule chose qui déterminerait
l'utilisation, mais peut être basé sur l'impact qu'il aura sur ses
performances. De ce fait, même si un employé n'apprécie pas
un système, il a de grandes chances de l'utiliser s'il le perçoit
comme améliorant ses performances au travail. Par ailleurs, le
modèle d'acceptation de la technologie stipule un lien direct entre la
perception de l'utilité et la perception de la facilité
d'utilisation. Ainsi, face à deux systèmes offrant les
mêmes fonctionnalités, l'utilisateur trouvera plus utile celui
qu'il trouve plus facile à utiliserDILLON, A.et al, (1996).
1.1.16 III.2. L'ADOPTION DES INNOVATIONS AGRICOLES :
REVUE DE LA LITTÉRATURE
Il est aujourd'hui difficile de synthétiser tous les
résultats obtenus dans la littérature économique sur les
déterminants socio-économiques et agronomiques sur l'adoption
d'innovationsBELZILE, L, (2015). La littérature en économie est
vaste mais certains auteurs ont réalisé des revues se concentrant
sur certains types d'innovation (l'agriculture de conservation, les bonnes
pratiques agricoles.
Nous nous intéressons ici aux travaux récents
sur l'adoption d'innovations proches des systèmes de culture innovants,
plus précisément à des innovations de pratiques
incrémentales (les bonnes pratiques agricoles, l'agriculture de
précision) à systémique (agriculture biologique ou
intégrée) ou encore à des pratiques innovantes
liées à la conservation des ressources naturelles (sol, eau
...).
Selon KOESTELING, (2008), L'aboutissement à une
décision de se convertir est régit par plusieurs
déterminants et non basé uniquement sur un objectif de
maximisation du profit espéré. Ces déterminants peuvent
être d'ordres endogènes, exogènes et même
inobservables.
1.1.17 III.2.1. Déterminants endogènes et
exogènes
Déterminants économiques et
financiers :
Les premiers travaux en économie menés par
Griliches puis Rosenberg ont mis en évidence l'importance des facteurs
financiers dans le changement technologique et l'adoption d'innovations
Griliches, (1957) cité par Roussy, (2012). La richesse est
considérée comme un facteur clef dans l'adoption, d'abord par
son effet sur l'aversion au risque (plus un individu est riche plus il est
prêt à prendre des risque). De plus, le niveau de richesse
conditionne l'investissement et permet aussi de supporter des pertes à
court terme lors de la mise en place de l'innovation. Dans la
littérature, différents indicateurs de la richesse sont
utilisés: le revenu netFEDER G. et al, (1993), le capital social ou le
chiffre d'affaires. La richesse a généralement un effet positif
sur l'adoption. Cependant, la variété des indicateurs en fonction
des études ne permet pas de mettre en évidence la même
causalité dans le choix de production de l'agriculteur. En effet, une
exploitation peut avoir un chiffre d'affaires élevé et une
profitabilité faible qui elle-même n'est pas forcément
liée à la richesse de l'exploitant.Ngondjeb, (2009) analysant les
Déterminants de l'adoption des techniques de lutte contre
l'érosion hydrique en zone cotonnière au Cameroun arrive à
la même conclusion. Il montre que la main- d'oeuvre salariée
influence également positivement sur la décision de l'adoption.
Les agriculteurs riches, peu nombreux, l'emploient les plus pauvres
échange d'argent ou de nourriture. Cependant, Selon SOTAMENOU&
PARROT (2014), les revenus assez faibles des agriculteurs ne leur permettent
pas toujours d'adopter les innovations agricoles.
Déterminants liés aux
caractéristiques de l'agriculteur :
Les caractéristiques du producteur comprennent :
le niveau d'éducation, l'expérience dans l'activité,
l'âge, le sexe, le niveau de richesse, la disponibilité en main
d'oeuvre et l'aversion face au risque, la conscience du problème
ciblé par la nouvelle technologie, la taille de l'exploitation, le type
d'exploitation.
Le niveau d'éducation de l'exploitant est
généralement reconnu comme favorisant l'adoption d'innovations
intensives en capital humainKEBEDE, Y., K. et al, (1990). Même si
certains travaux ne trouvent pas de relations significatives entre
l'éducation et l'adoptionKNOWLER, D.et al, (2007), on peut
considérer que les exploitants les plus éduqués disposent
de plus d'informations leur permettant de mieux évaluer l'innovation et
ainsi de limiter leur niveau d'incertitude.
Contrairement à l'éducation, et par extension
à l'accès à l'information, le rôle de
l'expérience est moins clair. Certaines études montrent le
rôle positif de l'expérience sur l'adoption SAUER, J. et al,
(2009) BAFFOE-ASARE, R et al, (2013).
Par contre,WU, J. et al, (1998) montrent des effets
contrastés de l'expérience sur trois types d'innovations
différentes. Celle-ci influe négativement sur l'adoption du
non-labour et positivement sur l'application localisée de fertilisants
KEBEDE, Y., K. et al, (1990) met en évidence que l'expérience
joue un rôle distinct en fonction du risque perçu.
L'expérience agricole facilite l'adoption d'innovations réduisant
le risque perçu (comme l'apport de plus de pesticides et d'engrais),
mais elle peut avoir l'effet inverse sur l'adoption d'innovations augmentant le
risque perçu). Les résultats sur l'effet de l'expérience
sont donc contrastés. Les agriculteurs expérimentés
connaissent mieux leur contexte de production et peuvent prendre plus de
risques. A l'opposé les agriculteurs les plus âgés,
c'est-à-dire les plus expérimentés, ont un horizon de
planification plus court qui ne les pousse pas à changer de
pratiquesAHOUANDJINOU. M .S, (2010).
On considère généralement que l'âge
réduit l'adoption AHOUANDJINOU. M .S, (2010) car les exploitants plus
âgés ont un horizon de planification plus court. Ils valorisent
moins les bénéfices à long terme de certaines innovations.
Cependant, les jeunes exploitants sont souvent soumis à des contraintes
financières fortes ce qui peut les dissuader d'investir dans une
nouvelle technologie. Enfin, en présence d'un successeur, l'âge de
l'exploitant accroît les chances d'adoption d'une innovation. En effet,
si une possibilité de reprise de l'exploitation existe, alors l'horizon
de planification de l'agriculteur est plus long RODRÍGUEZ-ENTRENA, M. et
al, (2013).
Déterminants
exogènes :
L'exploitant est soumis de manière récurrente
à des contraintes externes qu'il peut difficilement anticiper. Nous
distinguons deux types de déterminants exogènes. Les premiers
sont externes et non contrôlables par l'exploitant comme son
environnement de production comprenant les contraintes pédoclimatiques
et réglementaires. Le second type de déterminants est
partiellement contrôlable par l'exploitant comme le contexte
informationnel qui peut être partiellement modifié si
l'agriculteur achète ou se procure de l'information. On parle ici de
l'information au sens large, de la communication ou du conseil.
FEDER G. et al, (1993) montrent que les déterminants
agronomiques ou pédoclimatiques peuvent être nombreux mais doivent
être ciblés en fonction de l'innovation concernée et de la
zone de production.
Khanna met en évidence qu'il existe un effet de la zone
de production sur l'adoption de pratiques de fertilisation parcellaire (KHANNA,
M., 2001). Dans les zones de grandes cultures, les conditions
pédoclimatiques peuvent contraindre les agriculteurs dans leurs choix de
production. Des conditions limitantes, comme des sécheresses
répétées poussent les agriculteurs à rejeter
certaines innovations pour des raisons techniques. Cependant le
pédoclimat peut aussi faciliter l'adoption comme par exemple la mise en
place de pratiques de conservation des sols par le non labour dans des zones de
coteaux qui peuvent être soumis à des risques
d'érosionERVIN, C. A. et al, (1982). La variété des
contextes de production ne permet pas de mettre en évidence des
déterminants généralisables mais les contraintes de
production ont généralement un effet sur l'adoption d'innovation.
Les travaux en économie s'intéressent
généralement à l'effet ex ante d'un changement de
la réglementation sur l'évolution des pratiques agricoles.
BOUGHERARA, D. et al, (2010)Étudient l'effet du découplage des
aides de la PAC l'utilisation des terres non cultivées. Ils concluent
que les exploitants n'envisagent pas de changements radicaux dans l'utilisation
des terres ou des intrants avec les évolutions futures de la .Il
existent cependant peu de résultats sur l'effet de la
réglementation sur l'adoption d'innovations. Les innovations sont
généralement conformes aux réglementations en cours dans
les différents pays concernés. On peut cependant souligner que la
réglementation peut limiter le nombre de pratiques innovantes
proposées à l'exploitant. Dans le secteur des grandes cultures en
France, la Directive Cadre sur l'Eau impose une couverture hivernale des sols
dans les zones définies comme vulnérables. Cependant, il est
interdit d'implanter des couvertures végétales composées
uniquement de légumineuses pour éviter des effets de lixiviation
lors de leur destruction. Ainsi, la réglementation implique que les
exploitants des zones vulnérables disposent de moins de choix dans les
cultures à mettre en place.
1.1.18 III.2.2. Déterminants inobservables de
l'adoption : perceptions et préférences
L'hétérogénéité des
agriculteurs et de leur contexte de production explique en partie leur
comportement face à l'adoption. En fonction des déterminants
observables et de leurs croyances, les individus développent des
perceptions et des préférences individuelles pour l'innovation et
celles-ci ne sont pas directement observables. Pour les révéler,
divers travaux mobilisent des méthodologies spécifiques de
révélation des préférences. Cependant, parmi ces
travaux, peu s'intéressent au rôle des perceptions dans le
processus.
Préférences face au
risque :
Le risque est un des principaux facteurs de rejet de
l'innovation (FEDER G. et al, 1993). Grâce aux méthodes
d'économie expérimentale, basées sur des jeux de loteries
financiers, de nombreux travaux ont mis en évidence le poids de
l'aversion au risque dans le processus d'adoption d'innovations. Elles
révèlent aussi que le niveau d'aversion au risque des exploitants
agricoles est généralement plus élevé que celui des
entrepreneurs des autres secteurs agricoles HELLERSTEIN, D., (2013). En effet,
les exploitants agricoles sont habitués à subir des risques et
sont globalement plus tolérants aux risques, mais, comme tous les
entrepreneurs, ils sont plus sensibles au risque de perteBOCQUEHO, G.et al,
(2011).
Préférences face aux
caractéristiques de l'innovation :
Les méthodes de révélation des
préférences regroupent les préférences
révélées et les préférences
déclarées. Dans les travaux sur les préférences
révélées, c'est le comportement observé des
individus qui permet d'évaluer de manière ex-post les
déterminants de l'adoption. Dans les travaux sur les
préférences déclarées, c'est sur la base des
déclarations ex ante de l'individu (interview, enquêtes) que les
préférences sont évaluées. De nombreux travaux
utilisent les méthodes de révélation des
préférences déclarées afin d'évaluer la
valeur monétaire des biens non marchands associés à des
pratiques ou des techniques économes en intrantsBIROL, E., K. et al,
(2006). Ces méthodes permettent aussi d'analyser les
préférences des individus pour les caractéristiques de
l'innovation. Elles sont utilisées à la fois pour concevoir des
politiques de soutien et d'accompagnement au changement de pratique, mais aussi
pour définir les attentes des individus pour les caractéristiques
des innovations. Les préférences les agriculteurs
dépendent de leur condition de production, de leurs contraintes et des
caractéristiques de l'innovation. Les méthodes de
révélations des préférences déclarées
permettent de hiérarchiser et de quantifier le rôle de chacun de
ces facteurs dans le choix d'adoption.
Le chapitre III avait pour objectifs l'analyse
théorique des déterminants d'adoptions des innovations. Il
ressort que la certification du cacao entre dans la théorie des
innovations agricoles. Ainsi, l'adoption d'une innovation est régit par
plusieurs déterminants et non basé uniquement sur un objectif de
maximisation du profit espéré KOESTELING, (2008). Ces
déterminants peuvent être endogènes ou exogènes.
CHAPITRE IV :
LES DÉTERMINANTS DE
L'ADOPTION DE LA CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE
Ce chapitre fait le point des différentes étapes
qui nous ont permis d'opérationnaliser notre deuxième question
de recherche à savoir : Quels sont les facteurs
qui encouragent l'adoption de la certification Rainforest Alliance par les
petits producteurs de cacao autour de la réserve du
Dja.
Nous présenterons en (IV.1) notre cadre
méthodologie avant de présenter les résultats (IV.2).
1.1.19 IV.1. CADRE
MÉTHODOLOGIQUE
Dans cette section, nous présenterons successivement,
la spécification du modèle Logit ainsi que les variables de notre
modèle.
1.1.20 IV.1.1. Spécification du modèle Logit
dichotomique
Les données utilisées sont les mêmes qu'au
chapitre II. Elles concernent 100 producteurs parmi lesquelles 44 producteurs
certifiés.
Plusieurs études empiriques ont étudié
l'adoption des innovations agricoles. Diverses méthodes d'analyse ont
été appliquées dont notamment l'utilisation de
modèles économétriques SOTAMENOU .J, (2011) ; PARROT.
L. et al, (2009). Trois sont fréquemment utilisés pour analyser
l'adoption des nouvelles innovations technologies agricoles : Les
modèles de probabilité linéaire, de Logit et de Probit.
Notre analyse concerne les facteurs qui expliquent l'adoption
de la certification Rainforest par les producteurs de cacao autour de la
réserve de biosphère du Dja. La décision d'adoption de
l'innovation étant dichotomique10(*); le producteur peut décider d'utiliser ou non
la technologie.
L'adoptant a été défini comme le
producteur qui accepte d'entrer dans le processus de certification
indépendamment de la quantité. La décision d'adopter est
considérée comme variable dépendante qualitative dans une
régression dont la valeur est 0 ou 1 et qui dépend des
caractéristiques de l'adoptant. L'approche utilisée dans
l'analyse des facteurs déterminant l'adoption peut être
estimée par un modèle qui permet de prédire la
décision d'un agent économique d'adopter ou non une technologie
donnée qui lui est proposée. La décision sera aussi
fonction des caractéristiques socioéconomiques du
décideur.
Un modèle Logit a été utilisé pour
analyser Les données collectées pour cette deuxième partie
grâce au logiciel SPSS (Statistical package for social sciences) version
20 (SPSS 2014).
Généralement, une étude qui a pour but
d'analyser l'influence de plusieurs variables explicatives sur une variable
dépendante qualitative (avec 2 possibilités telles que
« adoption » ou « non adoption ») ne
marche pas avec le model de probabilités linéaires à cause
de ses faiblisses (Les erreurs ne sont pas distribuées selon une loi
normale, les variances ne sont pas constantes pour chaque valeur de Xi et les
probabilités qui sortent de l'intervalle [0-1]). Donc pour de telles
études, la littérature économétrique suggère
2 modèles alternatifs : le model Logit et le model Probit qui sont
estimés par la méthode maximum de vraisemblance (MLE) WOOLDRIDGE
J M., (2009.).
Dans cette étude, le modèle Logit est plus
approprié parce qu'on utilise un échantillon de faible taille
(N=100) ce qui nous permet de calculer les probabilités
nécessaires pour interpréter chaque variables explicatives. De
plus l'un des avantages de l'utilisation du modèle Logit est qu'on peut
associer dans le model à la fois plusieurs variables explicatives qui
sont quantitatives et qualitatives WOOLDRIDGE J M., (2009.). Les données
pour cette hypothèse contiennent des variables explicatives qui sont
continues et qualitatives donc le modèle Logitest plus approprié
pour analyser les déterminants de la certification Rainforest Alliance
par les petits producteurs de cacao à la périphérie de la
réserve du Dja.
Dans le modèle Logit on prédira le Logit qui est
le log naturel du ratio ODDS d'avoir une des deux décisions
(« adoption » ou « non adoption » de la
certification) en dénotant P la probabilité de prendre une telle
décision en fonction d'une variable explicative X, la formulation
mathématique du modèle Logit est exprimée dans
l'équation(1) comme :

De manière équivalente on peut dériver P
de l'équation (1) comme suit :
  (2) (2)
Ou : P est la probabilité prédite que
l'évènement se réalise (adoption de la
certification),1-Pla probabilité prédite que
l'évènement ne se réalise pas (non adoption de la
certification), X la variable explicative représentant les
différent facteurs qui influencent la décision du paysan
d'adopter ou non la certification, Y est la variable dépendante
désignant l'adoption ou non de la certification par le paysan, Exp est
la fonction exponentielle, á est l'intercepte et â est le
coefficient de pente. Le côté gauche de l'équation (1)
ci-dessus représente le ratio ODDS et le modèle est appelé
modèle LogitWOOLDRIDGE J M., (2009.).
1.1.21 IV.1.2. Définition des variables et effet
théorique attendu
Variable expliquée :
ADOPTION : il s'agit d'une variable dichotomique, soit le
producteur adopte la certification soit il ne l'adopte pas.
Variables explicatives :
AGE : il s'agit de l'âge du producteur
mesuré en nombre d'année. C'est une variable continue donc le
signe ne peut être conclu à l'avance car sujet à des
résultats contradictoire.
SEXE : il s'agit d'une variable qualitative binaire
mesurant le genre du producteur. Le signe positif est attendu.
NIVETUD : il s'agit du niveau d'étude de
l'exploitant. C'est une variable binaire donc le signe positif est
prédit car l'éducation favorise l'adoption d'une innovation.
ACCMARCH : il s'agit de la possibilité de
l'exploitant d'avoir accès au marché. On s'attend à un
signe positif car la possibilité pour un producteur d'avoir accès
au marché est primordiale.
OP : il s'agit de l'appartenance du producteur à
une organisation paysanne
SENSIB : Il s'agit si le producteur à
été sensibilisé sur l'innovation ou pas. Le signe positif
est positif car on pense que la sensibilisation des producteurs sur une
nouvelle innovation augmente leur probabilité d'adopter.
A partir de là on peut obtenir l'équation 3
suivante :

Ou : Y : groupe du producteur (1=producteur
certifié, 0=producteur non certifié), X1 : Age du
producteur (en années), X2 : sexe du producteur
(1=féminin, 2=masculin), X3 : le niveau d'étude
du producteur, X4 : la possibilité de l'exploitant
d'avoir accès au marché, X5 :l'appartenance du
producteur à une organisation paysanne(0=membre d'une op, 1=n'appartient
pas à une op), X6 :la superficie de l'exploitation (en
hectare), X7 : la sensibilisation(0=le producteur a
été sensibilisé, 1=le producteur n'a pas été
sensibilisé), A partir de l'équation 3 ci-dessus nous pouvons
dériver P comme suit :
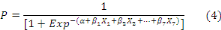
L'équation (4) représente la fonction de
probabilité logistique cumulative. En la généralisant
à chaque observation, Pi est la probabilité que le producteur i
adopte la certification et 1-Pi la probabilité que le producteur i
n'adopte pas la certification. A partir de cette notation, le Logit est tout
simplement le logarithme naturel du ratio ODDS   en faveur de l'adoption de la certification par le producteur i, ce qui
est encore le ratio de la probabilité que le producteur i adoptera la
certification sur la probabilité qu'il ne l'adoptera pas. en faveur de l'adoption de la certification par le producteur i, ce qui
est encore le ratio de la probabilité que le producteur i adoptera la
certification sur la probabilité qu'il ne l'adoptera pas.
Les exponentiels du coefficient de pente âk
associé à chaque variables explicatives sont
interprétés comme le ratio ODDS (OR) d'adoption de la
certification pour chaque variables explicatives. En général,
comme les ratios ODDS du modèle Logit sont juste les exponentiels des
coefficients estimés âk un coefficient positif va
indiquer un (OR>1) tandis qu'un coefficient négatif va indiquer un
(OR<1). Généralement l'expression   désigne l'inverse du ratio ODDS qui est calculé pour
faciliter l'interprétation des variables avec des coefficients
négatifs. désigne l'inverse du ratio ODDS qui est calculé pour
faciliter l'interprétation des variables avec des coefficients
négatifs.
1.1.22 IV.2.
RÉSULTATS ET ANALYSES
Cette section est consacrée à la
présentation des résultats de notre travail de terrain qui porte
sur les facteurs d'adoption de la certification Rainforest Alliance par les
petits producteurs de cacao autour de la réserve de biosphère du
Dja.
Nous présenterons et discuterons tour à tour,
les résultats de la statistique descriptive des producteurs puis des
déterminants de l'adoption.
1.1.23 IV.2.1.
Caractéristiques descriptive des cacaoculteurs autour de la
réserve du Dja
Plusieurs facteurs peuvent influencer l'adoption de la
certification Rainforestalliance par les agriculteurs. Les variables retenues
pour notre modèle sont décrites dans le tableau ci-dessous.
Tableau 7: Définition des variables du
modèle
|
N
|
Minimum
|
Maximum
|
Moyenne
|
Ecart type
|
Variance
|
|
Adoption
|
43
|
0
|
1
|
,74
|
,441
|
,195
|
|
Age
|
42
|
23
|
76
|
48,19
|
13,924
|
193,865
|
|
Sexe
|
43
|
1
|
2
|
1,16
|
,374
|
,140
|
|
Nivetud
|
43
|
1
|
3
|
1,93
|
,402
|
,162
|
|
Accmarch
|
43
|
0
|
1
|
,72
|
,454
|
,206
|
|
Op
|
40
|
0
|
1
|
,82
|
,385
|
,148
|
|
Sensib
|
42
|
0
|
1
|
,79
|
,415
|
,172
|
|
Format
|
43
|
0
|
1
|
,84
|
,374
|
,140
|
|
N valide (listwise)
|
39
|
|
|
|
|
|
Source : données d'enquêtes
2015
Les facteurs décrits dans le tableau 7 sont
interprétés différemment selon que la nature de la
réponse du producteur est discrète ou continue. Les facteurs avec
des réponses continues sont l'âge et la superficie de
l'exploitant.
Pour l'âge de l'exploitant la moyenne d'âge est de
48,19 ans avec un écart type de 13,92. Le producteur le moins
âgé a 23 ans et le plus âgé a 76 ans. L'écart
type de 13,92 montre que la plupart des producteurs ont un âge qui
oscille entre 34,27 et 62,11 ans. Des interprétations similaires peuvent
être faites pour la superficie.
Les facteurs avec des réponses discrètes sont le
sexe du producteur, le niveau d'étude, l'accès au marché,
l'appartenance ou non à une organisation paysanne, la sensibilisation et
la formation. La moyenne du genre (1=féminin ; 2=masculin) de 1,91
indique que plus de la moitié (un peu plus des 3/4) des producteurs
enquêtés sont des hommes. L'écart type de 0,228 qui est
éloigné de la moyenne signifie une large déviation des
valeurs observés par rapport à la moyenne ceci pourrait
probablement s'expliquer par la nature discrète des réponses
(1=féminin ; 2=masculin). Des interprétations similaires
pourraient être faites pour les autres variables discrètes.
1.1.24 IV.2.2. Les
facteurs d'adoption de la certification Rainforest Alliance
Plusieurs facteurs ont
été mis en évidence à travers le modèle
logit.
Tableau 8: Résultats de l'estimation du
modèle
|
Paramètre
|
Estimation
|
Erreur Std.
|
Z
|
Sig.
|
Intervalle de confiance à 95 %
|
|
Limite inférieure
|
Limite supérieure
|
|
LOGIT
|
Age
|
-,001
|
,017
|
-,068
|
0,946
|
-,035
|
,033
|
|
Sexe
|
,109
|
,660
|
,165
|
0,869
|
-1,185
|
1,402
|
|
Nivetud
|
,697
|
,499
|
1,397
|
0,162
|
-,281
|
1,674
|
|
Accmarch
|
-1,605
|
,593
|
-2,705
|
0,007***
|
-2,768
|
-,442
|
|
Op
|
-,313
|
1,245
|
-,251
|
0,019**
|
-2,752
|
2,127
|
|
Sensib
|
-,341
|
,587
|
-,581
|
0,051**
|
-1,492
|
,809
|
|
Constante
|
0
|
5,423
|
13,965
|
,388
|
0,698
|
-8,542
|
19,388
|
|
1
|
-,167
|
1,833
|
-,091
|
0,927
|
-2,000
|
1,665
|
***: significatif à 1%; **: significatif à 5%;
*: significatif à 10%; -2 log likelihood=Nagelkerke R2=0.536;
Percentage of correct prediction=70.13%; Omnibus Test of Model Coefficients:
÷2=89.319***; Hosmer and Lemeshow Test: ÷2=8.271
Le tableau 8 montre les résultats du modèle
Logit utilisé pour mesurer les déterminants de l'adoption de la
certification Rainforest Alliance par les petits producteurs de cacao dans la
zone d'étude. Le test d'Omnibus donne un coefficient ÷2=89.319 qui
est significatif à 1% ce qui signifie que les coefficients du model pris
dans l'ensemble sont significatifs. Le model a un bon pourcentage de
prédiction (70.13%) et tous les coefficients des variables
indépendantes ont les signes attendus. Le Nagelkerke
R2indique 53,6% des changements dans la variable dépendante
sont dues aux changements dans les variables indépendantes.
Les coefficients sont séparément
interprétés pour chaque variable comme suit :
L'adoption de la certification n'est pas liée avec
l'âge des exploitants car cette variable « âge » n'est
pas significative. D'après les effets aux marges fournis par les
résultats de nos estimations, la variation de la variable âge
d'une unité se traduit par une tendance baissière à
hauteur de 0.13 de la probabilité d'adoption de la certification
Rainforest Alliance. Autrement dit, plus un agriculteurprend de l'âge
moins il sera enclin à adopter la certification. En effet, le taux
d'adoption le plus important est réalisé par les agriculteurs
dont l'âge moyens est de 48,19 ans.son signe négatif indique
néanmoins que, les jeunes producteurs sont plus à même
d'adopter la certification que les vieux.
Le choix d'adopter la certification ne semble pas non plus
être influencé par le « sexe ». En effet, bien
que la culture du cacao comme toute culture de rente reste pratiquée par
les hommes, les femmes s'intéressent de plus en plus aux cultures de
rente, car elles se sont rendu compte qu'elles pouvaient aussi améliorer
leur cadre de vie grâce à ces cultures sans pour autant dé
laisser les cultures vivrières qui sont leurs priorités.
La modalité « nivetud »n'est pas
significative. On s'attendait à ce qu'il existe une relation analogue
entre l'adoption et le niveau d'instruction car le fait que l'exploitant ait
reçu une éducation, l'amène à comprendre les
avantages économiques liés à l'adoption des innovations.
Cependant la cacaoculture reste encore une activité pratiquée
majoritairement par des vieux et la plupart non pas traversé le niveau
du CM2. Le niveau d'étude n'a donc aucun effet sur la décision
d'adopter ou pas.
La variable « Accmarch » est
significative. Son signe positif indique que les producteurs qui ont
accès au marché sont plus à même à adopter la
certification comparé à ceux qui n'y ont pas accès.En
effet, conformément à sa significativité, la variable
« Accmarch » revêt un effet marginal
conséquent. En d'autres termes, la variation de cette variable,qui
pourrait se traduire par un meilleur accès au marché ou le
désenclavement progressif des zones rurales, augmente la
probabilité d'adoption de la certification de 3.689. Ceci pourrait
s'expliquer par Les opportunités crées par l'accès au
marché, et les facilités de pouvoir écouler la production
qui augmentent la propension des producteurs à adhérer à
la certification.
La variable « Sensib » est significative
et a un signe positif. Ceci s'explique par le fait que la plupart des
producteurs ont généralement peur des nouvelles innovations et du
risque qu'ils encourent à adopter cette dernière. De plus,
d'après, les effets marginaux propres à la variable Sensib, il
est loisible de constater que plus le niveau de sensibilisation varie à
la hausse, plus la probabilité d'adoption de la certification pour un
agriculteur connait une augmentation de 1.002. En effet, leur sensibilisation
sur les bienfaits et les méthodes d'utilisation de cette technologie les
amènent à comprendre et à lever cette crainte qu'ils ont
vis-à-vis de cette nouvelle technologie.
La variable « OP » est significative et
conforte le lien positif entre l'adoption et l'Organisation Paysanne. Il
confirme le rôle positif des organisations de développement
à la base dans l'incitation à adopter. Ce résultat est
conforté par les effets marginaux issus de l'estimation de cette
variable. La pratique d'association paysanne à la base en tant
qu'arrangement institutionnel de réduction des coûts de
transaction constitue un outil efficace d'amélioration des perspectives
d'adoption des agents.
Il était question dans cette partie d'évaluer
les déterminants d'adoption de la certification Rainforest Alliance par
les petits producteurs de cacao autour de la Reserve de Biosphère du
Dja. Il ressort grâce à l'utilisation d'un modèle
économétrique de type logit que l'appartenance à une
organisation paysanne, la sensibilisation et l'accès au marché
sont les facteurs qui encouragent l'adoption de la certification par les
producteurs autour de la Reserve. Ces résultats confirment donc notre
hypothèse de départ relative à l'importance du rôle
des organisations de développement, la sensibilisation et
l'accès au marché à la base encourageant l'incitation
à adopter.
CONCLUSION GÉNÉRALE
ET RECOMMANDATION
L'objectif de notre recherche était de mieux
appréhender les avantages liés à la certification
Rainforest Alliance sur les producteurs de cacao à L'Est du Cameroun
ainsi que l'examen des déterminants de son adoption. Plus
spécifiquement, il s'agissait d'une part, d'évaluer l'impact
socio-économique de la certification Rainforest Alliance sur les
producteurs de cacao autour de la réserve du Dja ; et d'autre
part, d'identifier les facteurs qui encouragent son adoption. Grâce
à des enquêtes de terrain qualitatives, et quantitatives
auprès de 100 producteurs parmi lesquels 44 sont à leurs
deuxième année du processus de certification, Il ressort que la
certification semble apporter une amélioration sur la production avec un
rendement moyen de (249 kg/ha chez les certifiés contre 113 kg/ha)
chez les non certifié ainsi que sur le prix. Mais tels n'est pas le cas
sur l'environnement car L'impact visible ou pas de l'environnement
nécessite d'attendre sans doute quelques années pour y avoir une
idéeN'DAO, (2012).
Concernant les déterminants d'adoption de la
certification par les cacaoculteurs autour du Dja, l'utilisation d'un
modèle économétrique de type logit montre que
l'appartenance à une organisation paysanne, la sensibilisation et
l'accès au marché ont une influence positive sur l'adoption de la
certification par les producteurs autour de la Reserve tan disque que
l'âge et le sexe ne semblent pas avoir d'effet positif sur l'adoption de
la certification.
Parmi les limites de ce travail, il faut souligner qu'il est
avant tout exploratoire et qu'il ne nous a pas été possible dans
le temps imparti de réaliser de réels mesures d'impacts
grâce à des méthodes robustes et un bon contrefactuel. Il
va falloir développer les enquêtes sur un échantillon
beaucoup plus large et sur plusieurs années pour confirmer ou infirmer
certain résultat.
Sur la base des résultats obtenus et au regard des
objectifs de cette étude qui portaient d'une part sur l'analyse des
avantages socioéconomiques de la certification Rainforest Alliance sur
les producteurs de cacao, et d'autre part sur déterminants d'adoption
de la certification, nous recommandons :
Ø Créer un environnement qui favorise
l'implication des jeunes et des femmes dans la Culture du cacao ; il
s'agit:
· Faciliter l'accès des jeunes et des femmes
à des centres de formation agricole ;
· Faciliter l'accès des jeunes et des femmes aux
micro-financements à travers des programmes comme le PIASI, PAJER-U
etc ...
Ø Regrouper les producteurs au sein des
coopératives agricoles afin de renforcer leur capacité sur la
gouvernance des organisations, le marketing agricole et l'accès aux
marchés.
Ø Sensibiliser les producteurs sur les bienfaits
économiques, sociaux et environnementaux de la certification.
BIBLIOGRAPHIE
AHOUANDJINOU. M .S. (2010). Adoption et impact
socioéconomique de la sémi mécanisation du
procédé de transformation des amandes de karité en beure
au Nord-Benin.
AKERLOF. (1970). The Market For Lemons": Quality Uncertainty
and the Market Mechanism. The quarterly journal of economics ,
488-500.
ALLEN BLACKMAN AND JORGE RIVERA. (2010). The Evidence Base for
Environmental and Socioeconomic Impacts of «Sustainable»
Certification. Discussion papers Resources for the Future , 34.
ANDREW TYLECOTE. (2007). The role of finance and corporate
governance in national systems of innovation. Organization Studies ,
1461-1481.
BAFFOE-ASARE, R et al. (2013). "Socioeconomic Factors
Influencing Adoption of Codapec and Cocoa High-tech Technologies among Small
Holder Farmers in Central Region of Ghana.". American Journal of
Experimental Agriculture .
BAKER J.L. (2000). Evaluation de l'impact des projets de
developpementsur la pauvreté. Manuel à l'attention des
practiciens. 208.
BELZILE, LUC. (2015). Etude des facteurs
socio-économiques de la conversion à l'agriculture
biologique. agriculture, pecherie et alimentatio,.
BIROL, E., K. KAROUSAKIS AND P. KOUNDOURI. (2006). "Using a
choice experiment to account for preference heterogeneity in wetland
attributes: The case of Cheimaditida wetland in Greece.". Ecological
Economics 60(1) , 145-156.
BOCQUEHO, G.et al. (2011). Expected utility or prospect
theory maximizers? Results from a structural model based on field-experiment
data. Zurich , Switzerland: XIIIth Congress of the European Association of
Agricultural Economists.
BOUGHERARA, D. AND L. LATRUFFE. (2010). "Potential impact
of the EU 2003 CAP reform on land idling decisions of French landowners:
Results from a survey of intentions.". Land Use Policy.
CATHERINE VOGELl et al. (2010). Comparison of Private-Sector
Standards applicable to Cocoa Production. 27.
COCHRANE , J et al. (1973). Controling bias in observational
studies. 417-446.
CTB. (2011, février). le cacao un levier de
développement. (C. Michiels, Éd.)
CVUC. (s.d.). Communes et villes unies du Cameroun.
Consulté le 03 21, 2016, sur
cvuc.cm/national/index.php/fr/carte.../region.../479-messamena:
http://cvuc.cm/national/index.php/fr/carte-communale/region-du-sud/121-association/carte-administrative/est/haut-nyong/479-messamena
DAVIS, et al. (1989). User Acceptance of Computer Technology:
A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science , 31.
DIAGNE. (2003). Evalualtion de l'impact : Synthèse des
developpements methodologiques recents. 15.
DILLON, A.et al. (1996). User acceptance of information
technology: Theories and models. Annual Review of Information Science and
Technology , 31-32.
ERVIN, C. A. AND D. E. ERVIN. (1982). "Factors Affecting the
Use of Soil Conservation Practices: Hypotheses, Evidence, and Policy
Implications.". Land Economics 58(3) , 277-292.
FAO. (2004). Voluntary Standards and Certification for
Environmentally and Socially Responsible Agricultural Production and Trade.
Technical paper , 70.
FAO. (2004). Voluntary Standards and Certification for
Environmentally and Socially Responsible Agricultural Production and Trade.
Technical paper , 70.
FEDER G. and D. L. ULALI . (1993). "The adoption of
agricultural innovations: A review.". Technological Forecasting and Social
Change .
FEDER. (1985). Adoption of agricultural innovation in
developing countries : a survey economic devlopment and cultural
change.
GBCC. (2012). Étude sur les coûts, les
avantages et les désavantages de la certification du cacao (phase
I).Global Business Consulting Company.
GIOVANNUCCI et al. (2008). Standards as a New Form of
Social Contract? Sustainability Initiatives in the Covee Industry. Food
Policy.
Golan Kuchler et Mitchell. (2000). Economics of Food
Labelling. Agricultural Economic Report .
Griliches, Z. (1957). . "Hybrid Corn: An Exploration in
the Economics of Technological Change." . Econometrica .
HAUSER, J. R et al. (1980). Intensity Measures of Consumer
Preference. Operation Research, , ,, Vol. 28, No. 2, 278-320.
HECKMAM, J. . (1990). varieties of selection bias.
American economic review , 313-318.
HELLERSTEIN, D., N. HIGGINS AND J. HOROWITZ. (2013). The
predictive power of risk preference measures for farming decisions.
European Review of Agricultural Economics.
Howard Aldrich. (1999). Organisation Evolving. 413.
ICCO. (2014/15). Grindings of cocoa beans. Quarterly
Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLI ( 4).
IFAD. (1998). Managing for impact in rural agriculture. a
Guide for project . 50-62.
JASON POTTS AND DANIELE GIOVANNUCCI. (2012). COSA: GLOBAL
FINDINGS. 13.
JASON POTTS AND DANIELE GIOVANNUCCI. (2012). COSA: Global
Findings. 13.
KEBEDE, Y., K. GUNJAL AND G. COFFIN. (1990). Adoption of new
technologies in Ethiopian agriculture: The case of Tegulet-Bulga district Shoa
région.". 27-43.
KHANNA, M. (2001). "Sequential adoption of site-specific
technologies and its implications for nitrogen productivity: A double
selectivity model.". American Journal of Agricultural Economics 83(1)
, 35-51.
KNOWLER, D. AND B. BRADSHAW. (2007). "Farmers' adoption of
conservation agriculture: A review and synthesis of recent research.". food
policy .
KOESTELING. (2008). Etude des facteurs qui influencent la
conversion à l'agriculture biologiquerealisé aupres de 850
polyculteurs et 862 eleveurs laitiers( enquetes realisée par l'envoi
d'un questionnaire aupres de 1700 agriculteurs).
KPMG, G. (2011). Mission d'évaluation de la
certification du cacao origine cote d'ivoire.
LIZZERI, A. (1999). "Information Revelation and Certification
Intermediaries. The RAND Journal of Economics , 214-231.
MAN-KWUN CHAN AND BARRY POUND. (2009). Literature review of
sustainability standards and their poverty impact. 48.
N'DAO, Y. (2012, 09 05). Rationalités, changements de
pratiques et impacts des standards durables sur les petits producteurs : le cas
de la certification Rainforest Alliance dans le secteur du cacao en Côte
d'ivoire. Monpelier, France.
Nelson Phililip. (1970). Information and Consumer Behavior.
Journal of Political Economy , 78.
Ngondjeb, Y. (2009). Déterminants de l'adoption des
techniques de lutte contre l'érosion hydrique en zone cotonnière
du Cameroun.
Nicolas EBERHART. (2007). Impact du commerce équitable
chez les producteurs de café en Equateur. 27.
NKAMLEU G.B ET COULIBALY, O. (2000). Les
déterminants du choix des méthodes de lutte contre les pestes
dans les plantations de cacao et café du sud-cameroun.
NTSAMA ETOUNDI ET al. (2012). Les déterminants de
l'adoption des variétés des semences améliorées de
maïs: adoption et impact de la « cms 8704 ».
PALAZZO et al. (2011). Evaluation De La Performance
Sociale Et environnementale des entreprises.Unil (université de
Lausanne),.
PARROT L., SOTAMENOU J., KAMGNIA DIA B., NANTCHOUANG A. 2009.
Determinants of domestic waste input use in urban agriculture lowland systems
in Africa: The case of Yaounde in Cameroon. Habitat International, 33
(2009), pp. 357-364.
PAUL J. GERTLER et al. (2011). Evaluation d'impact en
pratique.
Rivera, A. B. (2010). The Evidence Base for Environmental and
Socioeconomic Impacts of «Sustainable» Certification. Discussion
papers Resources for the Future , 34.
RODRÍGUEZ-ENTRENA, M. AND M. ARRIAZA. (2013). "Adoption
of conservation agriculture in olive groves: Evidences from southern Spain.".
Land Use Policy 34 , 294-300.
ROGERS, EVERETT M. (1983). Diffusion of innovations
(éd. third). New york: The free press.
ROGERS, EVERETT M. (1962). The diffusion of
innovations (éd. first). new york: The free press.
ROSENBAUM et al. (1983). The central role of propensity score
in observational studies for causal effet. Biometrica , 41-55.
Roussy. (2012). Adoption d'innovations par les
agriculteurs :. France: Agrocampus Ouest.
SAUER, J. AND D. ZILBERMAN. (2009). Innovation behaviour at
farm level-Selection and identification .49th annual meeting of the German
Association of Agricultural Economics and Sociology, GEWISOLA, Kiel.
SCHERR, S . et MULLER , E. (1991). Technology impact
evaluation in agroforestery project. 235-257.
SOTAMENOU .J. (2011). Les déterminants de
l'utilisation des déchets organiques au Cameroun : Une analyse
économétrique. Revue CEDRES-ETUDES, N°54, 2ème
Semestre.
SOTAMENOU JOEL & PARROT L.,(2014). The determinants of
organic fertilizers use in urban and peri-urban agriculture: an econometric
analysis. ) . Acta Horticulturae. (ISHS , 325-338.
Stiglitz, J. E. ( 2011). Rethinking macroeconomics: what
failed and how to repair it. Journal of the European Economic
Association , 591-645.
SYLVAINE LEMEILLEUR et al. (2012). Certification du cacao,
stratégie à hauts risques. Inter-reseau Developpement
Rural , 7.
WOOLDRIDGE J M. (2009.). Introductory Econometrics: a
Modern Approach.
WU, J. AND B. A. BABCOCK. (1998). The choice of tillage,
rotation, and soil testing practices: Economic and environmental
implications.". American Journal of Agricultural Economics ,
494-511.
WWF. (2010). Certification and roundtables: do they work?
WWF review of multistakeholder , 38.
YOUSSOUPHA N'DAO. (2012). Rationalités, changements
de pratiques et impacts des standards durables sur les petits producteurs : le
cas de la certification Rainforest Alliance dans le secteur du cacao en
Côte d'ivoire. Monpelier, France.
ANNEXES
Annexe 1 : questionnaire
FICHE D'ENQUÊTES
QUESTIONNAIRE DES PRODUCTEURS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
|
Numéro de l'enquêté
|
|
|
Village
|
|
|
Age
|
|
|
Sexe
|
|
|
Nombre d'enfants
|
|
|
Diplôme le plus élevé
|
|
|
Date d'arrivée dans le village
|
|
|
Ethnie
|
|
|
Nationalité
|
|
|
Numéro de téléphone
|
|
|
Principale production de la plantation
|
|
INFORMATIONS SUR LA PLANTATION
|
Numéro
|
Questions
|
Réponses et codes
|
|
1
|
Qualité de l'exploitant
|
1. Propriétaire
2. Occupant
3. Autre
|
|
2
|
Main d'ouvre (mentionner le chiffre)
|
1. Familiale
2. Travailleurs temporaires
3. Travailleurs en CDI
4. Autre
|
|
3
|
Superficie totale de la plantation
|
|
ASPECT ORGANISATIONNEL
|
numéro
|
Questions
|
Réponses et codes
|
|
4
|
Êtes-vous membre d'une coopérative
certifiée Rainforest alliance ?
|
|
|
5
|
Quel est le nom de cette coopérative ?
|
|
|
6
|
Quelle est sa date de création ?
|
|
|
7
|
Quelle est la date d'adoption de la certification dans votre
coopérative ?
|
|
|
8
|
Depuis quand commencez-vous à cultiver le
cacao ?
|
|
|
9
|
Pourquoi cette année ?
|
|
|
10
|
Quelle est l'année de votre adhésion à
cette coopérative ?
|
|
|
11
|
Quelles sont les conditions d'adhésion ?
|
|
|
12
|
Y'a-t-il des couts liés à
l'adhésion ?
|
|
|
13
|
Combien ?
|
|
|
14
|
Êtes-vous satisfait de votre coopérative ?
|
|
|
15
|
Pourquoi ?
|
|
|
16
|
Qui sont les principaux acheteurs de cacao certifié
(statuts et noms) ?
|
|
LE SYSTÈME DE PRODUCTION
|
Numéro
|
Question
|
Réponse
|
|
24
|
Quelle est la superficie totale de votre plantation de
cacao ?
|
|
|
25
|
Avez-vous des parcelles qui ne sont pas
certifiées ?
|
|
|
26
|
Pourquoi ?
|
|
|
27
|
Quelle est la superficie de la plantation de cacao
certifiée ?
|
|
|
28
|
Comment appréciez-vous son évolution depuis la
certification ?
|
|
|
29
|
Depuis combien de temps possédez-vous ces
terres ?
|
|
|
30
|
Comment s'est faite l'acquisition de ces terres ?
|
|
|
31
|
Quelle est la production de votre exploitation à
l'hectare ?
|
|
|
32
|
Quelle est la production non certifiée à
l'hectare ?
|
|
|
33
|
Si vous avez des plantations certifiées et non
certifiées sur lesquelles avez-vous la meilleure production ?
|
|
|
34
|
S'il existe une différence est-ce lié à
l'âge ou à la certification ?
|
|
|
35
|
Comment appréciez-vous son évolution depuis la
certification ?
|
|
|
36
|
Listez les changements de pratiques agricoles liés
à la certification
|
|
|
37
|
Lesquelles sont plus importantes pour la
certification ?
|
|
|
38
|
Y'a-t-il des trous d'ordures dans votre cour ?
|
|
|
39
|
Faites-vous du compostage de cabosses dans votre
plantation ?
|
|
|
40
|
Avez-vous les 18 arbres par hectare recommandés ?
|
|
|
41
|
Avec la certification comment a évolué
l'activité de production en termes de conditions de travail ?
|
|
|
42
|
Quel est le nombre de tige moye par plantation de
cacao ?
|
|
|
43
|
Combien dépensez-vous pour respecter ces
normes ?
|
|
|
44
|
Combien de jours de travail environs pour respecter ces
normes ?
|
|
|
45
|
La certification introduit-elle un cout supplémentaire
supporté par vous ?
|
|
|
46
|
Quelle est la superficie totale de votre exploitation ?
|
|
ASPECT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
|
Numéro
|
Questions
|
Réponses
|
|
47
|
Quel avantage tirez-vous de votre appartenance à la
coopérative ?
|
|
|
48
|
Comment appréciez-vous les revenus tirés de la
vente de la production depuis la certification ?
|
|
|
49
|
Pensez-vous que vos revenus peuvent désormais faciliter
l'accès à l'éducation de vos enfants ?
|
|
|
50
|
Et l'accès à la santé de la
famille ?
|
|
|
51
|
Avez-vous observé des changements sur le plan de
l'éducation depuis l'adoption de la certification ?
|
|
|
52
|
Lesquels ?
|
|
|
53
|
Avez-vous observé des changements sur le plan de
l'emploi depuis l'adoption de la certification ?
|
|
|
54
|
Expliquez
|
|
|
55
|
Avez-vous remarqué des problèmes de foncier
depuis l'adoption de ces normes ?
|
|
|
56
|
L'adoption de ces normes nécessite-t-elle une formation
des planteurs ?
|
|
|
57
|
Sur quels éléments ?
|
|
|
58
|
Les enfants des travailleurs ont t'ils accès à
l'éducation ?
|
|
|
59
|
Les mineurs de 12 à 14 ans de la famille participent
t'ils ?
|
|
|
60
|
La participation à des travaux interfère-t-elle
sur leur éducation ?
|
|
|
61
|
Ou disposez-vous de vos produits phytosanitaires ?
|
|
|
62
|
A combien vous revient le kilogramme de cacao
certifié ?
|
|
|
63
|
A combien vous revient le kilogramme de cacao non
certifié ?
|
|
|
64
|
Quelle est la principale source de votre revenu ?
|
|
|
65
|
Quel est votre revenu moyen annuel ?
|
1. Entre 0 et 50000
2. Entre 50000 et 100000
3. 100000 et plus
|
ENVIRONNEMENT
|
numéro
|
Questions
|
Réponse et code
|
|
66
|
Avez-vous constatez des changements sur le plan environnemental
dans la localité depuis la certification ?
|
|
|
67
|
Expliquez
|
|
|
68
|
Quelles sont les pratiques culturales que vous adoptez pour
améliorer l'environnement ?
|
|
|
69
|
Qui vous conseille de telles pratiques ?
|
|
|
70
|
Comment gérez-vous vos déchets ?
|
|
|
71
|
Quelles méthodes utilisez-vous pour protéger les
sols ?
|
|
|
72
|
Ou versez-vous vos eaux usées ?
|
|
|
73
|
Existe-t-il une zone tampon entre l'exploitation et les
écosystèmes aquatiques ? ou entre l'exploitation et les
zones d'activité humaine ?
|
|
|
74
|
Avez-vous observé des changements au niveau du climat
ces derniers temps ?
|
|
|
75
|
A quoi sont dus ces changements selon vous ?
|
|
Annexe 2 : Remarques
|
Remarques
|
|
Résultat obtenu
|
|
|
Commentaires
|
|
|
Entrée
|
Ensemble de données actif
|
Ensemble_de_données3
|
|
Filtrer
|
<aucune>
|
|
Poids
|
<aucune>
|
|
Scinder fichier
|
<aucune>
|
|
N de lignes dans le fichier de travail
|
43
|
|
Gestion des valeurs manquantes
|
Définition des valeurs manquantes
|
Les valeurs manquantes définies par l'utilisateur sont
considérées comme manquantes.
|
|
Observations utilisées
|
Les statistiques sont basées sur toutes les observations
possédant des données valides pour toutes les variables du
modèle.
|
|
Syntaxe
|
PROBIT Adoption OF Superf BY Format(0 1) WITH Age
SexeNivetudAccmarch Op Sensib
/LOG NONE
/MODEL LOGIT
/PRINT FREQ
/CRITERIA ITERATE(20) STEPLIMIT(.1).
|
|
Ressources
|
Temps de processeur
|
00:00:00,08
|
|
Temps écoulé
|
00:00:00,09
|
[Ensemble_de_données3]
Annexe 3 :
Informations sur les données et informations de convergence
|
Informations sur les données
|
|
Effectif
|
|
Valide
|
36
|
|
Rejeté
|
Hors limite
|
0
|
|
Manquant
|
7
|
|
Nombre de réponses > Nombre de sujets
|
0
|
|
Groupe de contrôle
|
22
|
|
Format
|
0
|
1
|
|
1
|
35
|
|
Informations de convergence
|
|
Nombre d'itérations
|
Solution optimale trouvée
|
|
LOGIT
|
20
|
Non
|
Annexe 4: Effets
marginaux et estimations des paramètres
|
A= Effets aux margesSig= SignificativitéExp(B)=
magnitudeddl= Degré de liberté
Effets marginaux et estimation des
paramètres
|
|
A
|
E.S.
|
Wald
|
ddl
|
Sig.
|
Exp(A)
|
|
LOGIT
|
Age
|
-,013
|
,068
|
,041
|
1
|
,946
|
,986
|
|
Sexe
|
,081
|
,602
|
2 ,252
|
1
|
,869
|
1,906
|
|
Nivetud
|
-,076
|
,045
|
2,107
|
1
|
,162
|
1,801
|
|
Accmarch
|
3,689
|
1,987
|
,863
|
1
|
,007
|
1,002
|
|
Op
|
2,951
|
1,361
|
3,173
|
1
|
,019
|
1,192
|
|
Sensib
|
1,002
|
1,367
|
3,118
|
1
|
,051
|
1,283
|
|
Constante
|
2,485
|
0,536
|
,793
|
1
|
,927
|
,872
|
|
Variable(s) : Age, Sexe, Nivetud, Accmarch, Superf, Sensib.
|
Annexe 5 : Tests de
Khi - deux
|
Tests du Khi-deux
|
|
Khi-deux
|
ddl
|
Sig.
|
|
LOGIT
|
Test de la qualité d'ajustement de Pearson
|
21,754
|
28
|
,453
|
Annexe 6 : Effectifs
et résidus
|
Effectifs et résidus
|
|
Nombre
|
Format
|
Age
|
Sexe
|
Nivetud
|
Accmarch
|
Op
|
Sensib
|
Nombre de sujets
|
Réponses observées
|
Réponses attendues
|
Résidu
|
Probabilité
|
|
LOGIT
|
1
|
0
|
60,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
,000
|
,000
|
1
|
1
|
,995
|
,005
|
,995
|
|
2
|
1
|
52,000
|
2,000
|
2,000
|
,000
|
1,000
|
1,000
|
1
|
1
|
,674
|
,326
|
,674
|
|
3
|
1
|
38,000
|
2,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
,000
|
2
|
0
|
,746
|
-,746
|
,373
|
|
4
|
1
|
40,000
|
1,000
|
3,000
|
1,000
|
1,000
|
,000
|
2
|
1
|
1,033
|
-,033
|
,517
|
|
5
|
1
|
72,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
2
|
0
|
,308
|
-,308
|
,154
|
|
6
|
1
|
51,000
|
1,000
|
1,000
|
,000
|
1,000
|
1,000
|
1
|
1
|
,481
|
,519
|
,481
|
|
7
|
1
|
71,000
|
2,000
|
1,000
|
,000
|
1,000
|
1,000
|
1
|
1
|
,502
|
,498
|
,502
|
|
8
|
1
|
45,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
3
|
1
|
,820
|
,180
|
,273
|
|
9
|
1
|
58,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
7
|
1
|
1,893
|
-,893
|
,270
|
|
10
|
1
|
33,000
|
2,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1
|
1
|
,299
|
,701
|
,299
|
|
11
|
1
|
51,000
|
2,000
|
3,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
4
|
1
|
1,822
|
-,822
|
,455
|
|
12
|
1
|
45,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
,000
|
2
|
1
|
,692
|
,308
|
,346
|
|
13
|
1
|
52,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
,000
|
1,000
|
5
|
1
|
1,014
|
-,014
|
,203
|
|
14
|
1
|
60,000
|
1,000
|
3,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
2
|
1
|
,852
|
,148
|
,426
|
|
15
|
1
|
60,000
|
1,000
|
2,000
|
,000
|
1,000
|
1,000
|
2
|
1
|
1,296
|
-,296
|
,648
|
|
16
|
1
|
55,000
|
1,000
|
3,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1
|
1
|
,427
|
,573
|
,427
|
|
17
|
1
|
76,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
,000
|
3
|
1
|
1,014
|
-,014
|
,338
|
|
18
|
1
|
55,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
12
|
1
|
1,876
|
-,876
|
,156
|
|
19
|
1
|
46,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
1
|
1
|
,273
|
,727
|
,273
|
|
20
|
1
|
23,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
,000
|
2
|
1
|
,704
|
,296
|
,352
|
|
21
|
1
|
47,000
|
2,000
|
2,000
|
,000
|
1,000
|
1,000
|
2
|
1
|
1,351
|
-,351
|
,676
|
|
22
|
1
|
52,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
2
|
1
|
,544
|
,456
|
,272
|
|
23
|
1
|
25,000
|
1,000
|
2,000
|
,000
|
1,000
|
1,000
|
2
|
1
|
1,315
|
-,315
|
,657
|
|
24
|
1
|
62,000
|
2,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
2
|
1
|
,583
|
,417
|
,291
|
|
25
|
1
|
60,000
|
1,000
|
2,000
|
,000
|
1,000
|
1,000
|
1
|
1
|
,648
|
,352
|
,648
|
|
26
|
1
|
29,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
8
|
1
|
2,218
|
-1,218
|
,277
|
|
27
|
1
|
55,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
4
|
1
|
1,085
|
-,085
|
,271
|
|
28
|
1
|
52,000
|
1,000
|
2,000
|
,000
|
1,000
|
,000
|
2
|
1
|
1,447
|
-,447
|
,723
|
|
29
|
1
|
34,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
2
|
1
|
,552
|
,448
|
,276
|
|
30
|
1
|
40,000
|
1,000
|
2,000
|
,000
|
1,000
|
1,000
|
1
|
1
|
,653
|
,347
|
,653
|
|
31
|
1
|
49,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
5
|
1
|
1,363
|
-,363
|
,273
|
|
32
|
1
|
73,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
,000
|
3
|
1
|
1,016
|
-,016
|
,339
|
|
33
|
1
|
67,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
1,000
|
2
|
1
|
,537
|
,463
|
,268
|
|
34
|
1
|
42,000
|
1,000
|
2,000
|
,000
|
1,000
|
1,000
|
3
|
1
|
1,958
|
-,958
|
,653
|
|
35
|
1
|
26,000
|
1,000
|
2,000
|
1,000
|
1,000
|
,000
|
1
|
1
|
,351
|
,649
|
,351
|
|
36
|
1
|
25,000
|
1,000
|
2,000
|
,000
|
1,000
|
1,000
|
1
|
1
|
,657
|
,343
|
,657
|
TABLE DES
MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT
ii
DÉDICACES
iii
REMERCIEMENTS
iv
LISTE DES TABLEAUX
v
LISTE DES FIGURES
vi
RÉSUME
vii
ABSTRACT
viii
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
1. Contexte de
l'étude
1
2.
Problématique
4
3. Objectifs de
recherche
6
4.
Hypothèses de recherche
6
5. Importance de
l'étude
6
6. Organisation du
travail
7
PREMIÈRE PARTIE :
8
ÉVALUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA
CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE SUR LES PRODUCTEURS DE CACAO AUTOUR DE LA
RESERVE DU DJA
8
CHAPITRE I :
9
ANALYSE THÉORIQUE DE L'IMPACT DE LA
CERTIFICATION
9
I.1. IMPACT DE LA CERTIFICATION :
ÉLÉMENTS THÉORIQUES
9
I.1.1. Définitions et présentation
de quelques concepts
9
I.1.2. Approches théoriques et
méthodes d'estimation d'évaluation d'impacts
13
I.2. IMPACTS DE LA CERTIFICATION : REVUE DE LA
LITTÉRATURE
22
I.2.1. Impact économique de la
certification
22
I.2.2. Impact Social et Environnemental de la
certification
25
CHAPITRE II :
28
ANALYSE EMPIRIQUE DE L'IMPACT DE LA CERTIFICATION
AUTOUR DE LA RESERVE DU DJA
28
II.1. MÉTHODOLOGIE DE COLLECTE ET D'ANALYSE
DE DONNÉES
28
II.1.1. Présentation de la zone
d'étude
28
II.1.2. Processus de collecte et d'analyse des
données :
31
II.2. IMPACT ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ET
ENVIRONNEMENTAL DE LA CERTIFICATION RAINFOREST
36
II.2.1. Impact économique de la
certification Rainforest Alliance
36
II.2.2. Impact social et environnemental
41
DEUXIÈME PARTIE :
45
ANALYSE DES DÉTERMINANTS DE L'ADOPTION DE LA
CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE
45
CHAPITRE III :
46
ANALYSE THÉORIQUE DES DÉTERMINANTS DE
L'ADOPTION DES INNOVATIONS AGRICOLES
46
III.1. ANALYSE THEORIQUES DE L'ADOPTION DES
INNOVATIONS AGRICOLES
46
III.1.1. Définition de quelques concepts
46
III.1.2. Les modèles d'adoption et de
diffusion des innovations
47
III.2. L'ADOPTION DES INNOVATIONS AGRICOLES :
REVUE DE LA LITTÉRATURE
53
III.2.1. Déterminants endogènes et
exogènes
53
III.2.2. Déterminants inobservables de
l'adoption : perceptions et préférences
56
CHAPITRE IV :
58
LES DÉTERMINANTS DE L'ADOPTION DE LA
CERTIFICATION RAINFOREST ALLIANCE
58
IV.1. CADRE MÉTHODOLOGIQUE
58
IV.1.1. Spécification du modèle Logit
dichotomique
58
IV.1.2. Définition des variables et effet
théorique attendu
60
IV.2. RÉSULTATS ET ANALYSES
62
IV.2.1. Caractéristiques descriptive des
cacaoculteurs autour de la réserve du Dja
62
IV.2.2. Les facteurs d'adoption de la certification
Rainforest Alliance
63
CONCLUSION GÉNÉRALE ET
RECOMMANDATION
66
RECOMMANDATIONS
67
BIBLIOGRAPHIE
68
ANNEXES
73
TABLE DES MATIERES
78

* 1
L'Agence belge de développement est
l'Agence d'exécution de coopération au développement
bilatérale belge. C'est une société anonyme de droit
public à finalité sociale dont les relations avec l'Etat
fédéral sont définies dans un contrat de gestion. La CTB
met en oeuvre et fait le suivi des programmes conçus par la DGD ; mais
aussi des programmes appartenant à d'autres institutions (par exemple :
UE).
* 2La FAO définit les
bonnes pratiques agricoles (BPA) comme des pratiques qui «abordent la
durabilité environnementale, économique et sociale des processus
au niveau des exploitations agricoles et qui se traduisent par des produits
agricoles alimentaires et non alimentaires sains et de qualité ".
Exemple : l'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, la
récolte sanitaire etc.....
*
3http://www.lawperationnel.com/EncyclopedieJur/Certification.html,
Consulté le 19/04/2016
* 4
http://www.qualiteonline.com/definition-67-certification.html
consulté le 19/04/2016
* 5La Table ronde pour une
économie cacaoyère durable (RSCE) est une initiative de dialogue
et de développement durable entre tous les acteurs de l'économie
du cacao : les producteurs de cacao et des coopératives,
négociants, exportateurs, transformateurs, fabricants de chocolat, les
grossistes, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les
institutions financières ainsi que les organismes donateurs.
* 6Norme NF X60-500 Octobre
1988 Terminologie relative à la fiabilité - Maintenabilité
- Disponibilité
* 7
http://www.ekitinfo.org/infos/lexique/lexique
*
8https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_et_standard_techniques#Standard
* 9AverageTreatmentEffect.
Terme utilisé en Anglais
* 10 Le producteur peut
décider d'utiliser ou non l'innovation
|
|



